CHARLES COMTE,
Traité de législation,
ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire. Tome Premier (1826)
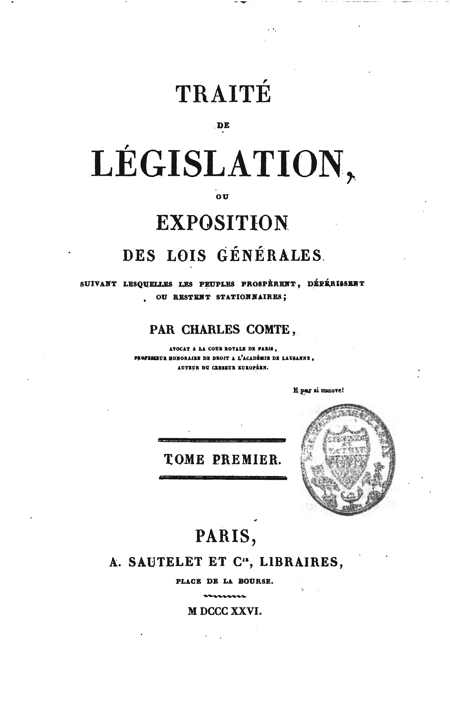 |
[Created: 21 November, 2021]
[Updated: 16 September, 2023 ] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-27). Tome premier.http://davidmhart.com/liberty/Books/1827-Comte_TraiteLegislation/Comte_TdL1827_T1-ebook.html
Charles Comte, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-27). Tome premier.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
- inserted Greek and Hebrew words as images
[I-525]
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME
LIVRE PREMIER
De la méthode analytique appliquée aux sciences de la législation et de la morale, et des divers systèmes sur lesquels on a cherché à fonder ces deux sciences.
- Chapitre Premier. Des diverses manières de traiter les sciences de la morale et de la législation; des phénomènes nécessaires à connaître pour posséder ces sciences; des causes qui en ont arrêté ou qui en favorisent les progrès; et de l'objet de cet ouvrage. l
- Chap. II. De la méthode analytique appliquée à l'étude de la morale et de la législation; et des effets de cette méthode sur le perfectionnement des mœurs et des lois. 31
- Chap. III. De l'influence qu'exerce sur les mœurs et sur les lois une analyse fausse; ou des effets des sophismes et des faux systèmes en morale et en législation. 74
- Chap. IV. De deux élémens essentiels au progrès des sciences morales; et de l'opposition qu'on a cru observer entre la méthode analytique, et l'action du sens moral ou de la conscience. 99
- Chap. V. Des lois auxquelles les hommes sont assujettis par leur propre nature; des systèmes des jurisconsultes sur les lois naturelles; de ce qu'il faut entendre par le mot droit ; et de la différence qui existe entre le droit et la puissance ou l'autorité. 116
- Chap. VI. Du système dans lequel on considère les lois civiles et politiques comme des conséquences d'une convention primitive, ou du Contrat social de J.-J. Rousseau, et de l'opposition qui existe entre ce système et la méthode analytique. 153
- Chap. VII. Du système dans lequel on considère les lois comme l'expression de la volonté générale; de ce qu'on entend par cette volonté; des erreurs qui se trouvent dans ce système, et des conséquences où elles conduisent en législation et en morale. 188
- Cbap. VIII. Du système qui fait d'une religion positive le fondement exclusif de la morale et des lois, et de l'influence de ce système sur la civilisation. 217
- Chap. IX. De la doctrine qui fonde la morale et la législation sur le principe de l'utilité, ou sur l'intérêt bien entendu. 240
- Chap. X. De la discordance qui existe, en morale et en législation, entre les systèmes adoptés en théorie, et les règles suivies dans la pratique; et de la nécessité de mettre l'intelligence des hommes en harmonie avec leur conduite.—Conclusion de ce livre. 263
LIVRE SECOND.
De la nature et de la description des lois, et des diverses manières dont elles affectent les hommes.
- Chap. I. De la nature des lois; des élémens de force ou de puissance dont elles se composent, et des diverses manières dont quelques-unes se forment et se détruisent. 278
- Chap. II. Des descriptions des lois; des effets que ces descriptions produisent; des vices qui s'y rencontrent, et des interprétations auxquelles elles donnent lieu. De la pensée du législateur. S'il est bon de consulter cette pensée. 316
- Chap. III. Distinction entre un régime arbitraire et un régime légal — De ce qui constitue la différence. 344
- Chap. IV. Des divers élémens de puissance qui constituent les lois; ou des causes générales de l'action que les hommes exercent les uns sur les autres. 353
- Chap. V. Des peines et des plaisirs physiques considérés comme élémens de la puissance des lois.—Des jugemens qui ont été portés des plaisirs et des peines de ce genre, par des sectes religieuses et par des sectes philosophiques. 363
- Chap. VI. Des peines et des plaisirs moraux considérés comme élémens de la puissance des lois. 395
- Chap. VII. Des opinions ou des idées des diverses classes dea population, considérées comme élémens de la puissance des lois. 404
- Chap. VIII. Des élémens de puissance dont se composent les lois de la morale; et de l'influence qu'exerce la connaissance de ces élémens sur les jugemens que nous portons des actions et des habitudes humaines. 411
- Chap. IX. Des effets particuliers à chacun des principaux élémens de force dont une loi se compose; et de l'influence qu'exerce la connaissance de ces effets, sur le jugement des causes qui les produisent. 428
- Chap. X. De la puissance qui appartient à chacun des élémens de force dont une loi se compose; de l'étendue des lois morales , et des limites posées, par la nature même de l'homme, à l'action des gouvernemens. 463
- Chap. XI. De l'action des lois de la morale ; des obstacles que cette action rencontre quelquefois dans celle des gouvernemens, dans des institutions publiques ou dans des erreurs populaires. 482
- NOTES
TRAITÉ DE LÉGISLATION,
OU EXPOSITION DES LOIS GÉNÉRALES SUIVANT LESQUELLES LES PEUPLES PROSPÈRENT, DÉPÉRISSENT OU RESTENT STATIONNAIRES
PAR CHARLES COMTE
Avocat à la Cour royale de Paris,
Professeur honoraire de droit à l’Académie de Lausanne,
Auteur du Censeur Européen.
E pur si muove !
TOME PREMIER↩
[I-v]
PRÉFACE
DE L’AUTEUR.↩
Les hommes qui écrivent sur la législation peuvent, en général, être divisés en deux grandes classes. Les uns, étrangers à la pratique et même à l’étude des lois d’aucun pays, ne se livrent qu’à des considérations philosophiques. Les autres, au contraire, se renferment rigoureusement dans la pratique de la jurisprudence, et ne s’élèvent à aucune vue générale. Il résulte de là que les personnes qui veulent se livrer à l’étude des lois ne rencontrent souvent, dans les écrits des premiers, que des spéculations sans utilité réelle ; et, dans les écrits des seconds, que des dissertations propres à intéresser des plaideurs ou leurs avocats.
Livré fort jeune à l’étude et à la pratique de la jurisprudence, mais en même temps entraîné par un penchant irrésistible vers des études philosophiques, [I-vi] je m’étais occupé, depuis plusieurs années, d’un traité de législation, lorsque le gouvernement impérial fut renversé. Le double but que je me proposais était d’introduire les considérations philosophiques dans l’étude des lois, et de porter, en même temps, dans le jugement des théories législatives ou politiques, les connaissances acquises dans la pratique. Ce moyen de vérifier les unes par les autres deux choses qui avaient été presque toujours séparées, me plaisait d’autant plus qu’il était le seul de concilier une profession que j’avais prise par choix, avec un goût qui était devenu une passion.
La révolution que produisit, en France, la chute du gouvernement impérial, sans rien changer à la direction de mes idées, me détermina à choisir un mode de publication différent de celui que je m’étais d’abord proposé. Il me sembla qu’en traitant successivement les questions de politique ou de législation, que les circonstances feraient naître, j’arriverais à mon but d’une manière plus sûre et plus prompte. Des idées qui ont une application immédiate à des faits dont on est témoin, frappent beaucoup plus les esprits, que des idées dont l’utilité ne se présente que dans l’éloignement. La faculté de manifester publiquement ses opinions, que le dernier gouvernement avait [I-vii] complètement détruite, commençait d’ailleurs à reparaître, et il était urgent d’en prendre possession. Car, il en est de la liberté comme du pouvoir : on risque fort de la perdre, si on ne sait pas la saisir à l’instant où elle se présente.
Mais je m’étais singulièrement abusé, lorsque j’avais pensé qu’il était possible de faire faire quelques progrès à la science, en traitant séparément les questions auxquelles les circonstances donneraient naissance, et en publiant mes opinions à mesure qu’elles se développeraient. Les discussions politiques qui touchent aux intérêts les plus vivement sentis, et de la solution desquelles dépend la chute ou le triomphe de tel ou tel parti, ne laissent pas l’esprit assez calme et assez libre pour qu’on puisse porter dans la recherche de la vérité, cette impartialité, cette patience, cette persévérance sans lesquelles il n’est pas de progrès possible.
Des questions qui n’ont que peu d’importance lorsqu’on les considère dans les rapports qu’elles ont avec l’ensemble de la législation, paraissent avoir une importance colossale lorsque l’esprit de parti s’en empare ; tandis que d’autres qui sont la base de la science, restent inaperçues ou paraissent indignes de fixer l’attention publique, si elles ne se rattachent pas d’assez près aux intérêts du moment. Aussi n’est-il pas très rare de voir [I-viii] des questions qui ont mis des peuples en mouvement, tomber peu de temps après dans un profond oubli, ou n’être rappelées que comme des témoignages de la folie des hommes. Il semble même que ce sont les sujets les plus frivoles qui ont toujours eu le privilège d’agiter des populations entières. Est-il aucune question philosophique, quelque intéressante qu’elle soit pour le genre humain, qui ait jamais excité autant d’intérêt et qui ait été débattue avec plus d’opiniâtreté que l’orthographe de tel mot grec, ou que la rivalité des cochers du Bas-Empire ?
Enfin, lorsqu’on ne traite des questions que dans l’ordre où les événements politiques les présentent, ou dans l’ordre qu’il plaît aux caprices des hommes momentanément investis du pouvoir de leur assigner, il est souvent impossible de les traiter d’une manière convenable ; parce que, pour les résoudre, il en est une multitude d’autres auxquelles on n’a jamais pensé, et qui auraient besoin cependant d’avoir été approfondies. Il n’est rien qui souffre moins l’arbitraire que l’exposition des phénomènes dont la connaissance forme une science. Si l’on ne met pas chaque chose à la place qui lui est propre, c’est-à-dire si on n’expose pas les faits dans l’ordre dans lequel ils s’engendrent, non seulement il est impossible d’en apercevoir [I-ix] l’enchaînement, mais on s’expose à tomber dans de nombreuses erreurs.
Aussi après avoir, pendant six ans, traité une multitude de questions diverses, et les avoir insérées dans des recueils périodiques, ne me suis-je pas trouvé beaucoup plus avancé, relativement au but principal que je m’étais proposé, que je ne l’étais en commençant. Il m’eût été aussi difficile d’employer, à faire un traité de législation, les écrits que j’avais publiés jusqu’alors, qu’il serait difficile à un peintre de former un tableau, en réunissant les diverses parties du corps humain, qu’il aurait peintes dans le cours de ses études. Non seulement il n’eût existé aucune liaison dans l’ordre des idées, non seulement il n’y eût eu aucune proportion entre les parties ; mais, ce qui est plus grave, il eût fallu reproduire des théories inexactes, et des vues quelquefois superficielles [1].
La révolution qui s’opéra, en 1820, dans les pouvoirs politiques, par l’établissement d’une nouvelle loi d’élection, l’irritation dont cette loi fut la cause et le résultat, et le rétablissement de la [I-x] censure des journaux, ayant rendu impossible ou improfitable toute discussion philosophique, je renonçai complètement à traiter des questions de circonstance, et je revins à mon ancien projet.
Je m’en occupais déjà depuis environ quinze mois, à Genève où je m’étais retiré, lorsque le gouvernement du canton de Vaud me fit proposer de donner un cours de législation dans l’académie de Lausanne. Le regret de m’éloigner d’une ville où tout homme qui veut se livrer à des études utiles, est assuré de trouver des ressources de tous les genres ; où l’on rencontre, toute proportion gardée, plus d’hommes instruits et plus d’activité intellectuelle que dans aucune ville du monde ; où l’esprit de parti est presque sans influence dans les discussions, et où je pouvais me flatter de compter de nombreux amis, me fit beaucoup hésiter à accepter la proposition qui m’était faite, quelque honorable qu’elle fût ; peut-être même l’aurais-je refusée, si je n’avais été déterminé à l’accepter par les conseils de mes amis.
La nécessité de parler à des jeunes gens qui, à la vérité, étaient exempts de préjugés, mais dont l’esprit était encore peu habitué aux études philosophiques, m’obligea à mettre de l’ordre, de la clarté, et de la simplicité dans l’exposition de mes idées. Obligé d’exposer un sujet très vaste, [I-xi] dans l’espace de quelques mois, je craignais de ne pas être compris, ou de ne pas fixer suffisamment l’attention de mes auditeurs. Mes craintes me semblaient d’autant mieux fondées, qu’il existait beaucoup de préventions contre les étudiants auxquels j’avais à parler. Je fus très agréablement trompé : il n’était pas possible de trouver des jeunes gens plus attentifs, plus zélés à rechercher la vérité, plus prompts à la saisir.
Cet exercice, qui dura deux ans, non seulement ne me détourna point de mon ouvrage, mais m’obligea à y travailler avec plus de suite, et à juger mes propres opinions avec plus de sévérité. Tout homme qui publie ses jugements est sans doute dans l’obligation de ne rien dire qui puisse être désavoué par sa conscience ; mais celui qui expose ses idées devant des jeunes gens dont l’instruction lui est confiée, a des devoirs bien plus rigoureux à remplir. Les erreurs du premier peuvent être réfutées par les écrivains qui ne partagent pas ses opinions ; s’il se trompe, il ne trahit du moins la confiance de personne. Mais il n’en est pas de même des erreurs du second : ceux à qui elles s’adressent, ne peuvent souvent ni les juger, ni s’en défendre.
L’agression qui fut dirigée alors contre le gouvernement constitutionnel d’Espagne, porta [I-xii] l’effroi chez tous ceux dont l’existence était fondée sur l’assentiment des peuples, et non sur le droit divin. Les notes diplomatiques adressées, dans cette circonstance, aux divers gouvernements de la Suisse, au sujet des étrangers qui se trouvaient sur leur territoire, parurent être le prélude d’une attaque plus sérieuse. Sachant combien il est facile à la puissance de couvrir les attentats les plus graves sous les prétextes les plus frivoles et souvent même les plus ridicules, je me démis de mes fonctions et je me retirai en Angleterre. C’est là que, pendant deux ans, j’ai continué à travailler à l’ouvrage dont je publie aujourd’hui le premier volume. J’ai tâché de ne m’écarter jamais de l’objet que je m’étais proposé ; j’ai, autant qu’il m’a été possible, cherché à fonder la théorie sur l’exacte observation des faits.
Si l’on ne jugeait cet ouvrage que par le premier titre que je lui donne, on s’en ferait peut-être une fausse idée. En général, toute personne qui ouvre un Traité de Législation, espère y trouver des règles sur l’art de faire des lois ou du moins d’en interpréter. Ce n’est pas ainsi que j’ai considéré la science : je n’ai voulu tracer ni règles, ni devoirs, mais simplement exposer quelle est la nature des choses. J’aurais renoncé au premier titre, si j’avais trouvé un mot plus [I-xiii] convenable ; n’en trouvant pas de plus propre à rendre ma pensée, j’ai tâché de l’expliquer par un second titre : il n’y a que celui-ci qui expose réellement l’objet de cet ouvrage.
Il m’est plusieurs fois arrivé de me trouver opposé d’opinions avec des hommes qui ont rendu à l’esprit humain de grands services, et dont j’honore les talents et le caractère. J’ai combattu leurs pensées, lorsqu’elles m’ont paru manquer d’exactitude ; mais sans méconnaître les services qu’ils ont rendus, ni la pureté des motifs qui les ont animés. Il n’y a guère que les erreurs des hommes de talent qui méritent d’être combattues ; les autres passent sans avoir fait d’impression et souvent même sans être aperçues. Des opinions d’ailleurs ne sont à nous qu’autant que nous les jugeons fondées ; elles cessent de nous appartenir, à l’instant où l’erreur nous en paraît démontrée.
En publiant un seul volume d’un ouvrage considérable, dont toutes les parties sont intimement liées entre elles, on affaiblit nécessairement l’effet de l’ensemble. Mais si, lorsqu’on écrit un livre, on n’est obligé de consulter que les intérêts de la vérité, on est obligé de consulter de plus, quand on le publie, les intérêts et les convenances des éditeurs. Les lecteurs auront peu à perdre, au reste, à cette séparation ; j’ose croire que je n’ai rien [I-xiv] dit dans ce volume, qui ne puisse être parfaitement compris sans le secours de ceux qui doivent suivre. L’inconvénient le plus grave qui pourrait résulter, pour eux, d’une publication partielle, serait de ne pas voir les nombreuses. conséquences auxquelles conduisent les vérités que j’ai développées.
Dans la première partie de ce volume, j’ai exposé la méthode à suivre dans l’étude des sciences morales, les inconvénients qui résultent d’une méthode vicieuse, et les erreurs auxquelles ont été conduits les écrivains les plus célèbres qui ont établi de faux systèmes. J’ai traité, dans la seconde partie, de la nature des lois, des divers éléments de puissance dont elles se composent, de la manière dont elles se forment, se modifient ou détruisent, et de la manière dont elles affectent les hommes. Ce volume peut être considéré, en quelque sorte, comme formant la logique de la législation et de la morale. Composé principalement pour des jeunes gens, c’est à des jeunes gens qu’il est destiné ; car il n’y a qu’eux pour qui des vérités nouvelles soient profitables.
Ayant exposé dans ce volume, les bases générales du raisonnement, j’en donnerai la matière dans les volumes suivants.
Paris, le 28 mai 1826.
[I-1]
TRAITÉ DE LÉGISLATION.
LIVRE PREMIER.
De la méthode analytique appliquée aux sciences de la législation et de la morale, et des divers systèmes sur lesquels on a cherché à fonder ces deux sciences.
CHAPITRE PREMIER.↩
Des diverses manières de traiter les sciences de la morale et de la législation ; des phénomènes nécessaires à connaître pour posséder ces sciences ; des causes qui en ont arrêté ou qui en favorisent les progrès ; et de l’objet de cet ouvrage.
En écrivant sur la législation, je n’ai pas pour but de présenter un système de lois, d’attaquer ou de défendre les institutions d’un pays quelconque ; je veux rechercher simplement quelles sont les causes qui font prospérer ou dépérir un peuple, ou qui le rendent stationnaire. Pour me livrer à [I-2] ces recherches, je n’ai besoin ni d’imaginer des systèmes, ni de raisonner sur des principes généraux ; il me suffit d’observer les faits, de les classer dans l’ordre le plus naturel, et de voir comment les uns naissent des autres.
Cette méthode n’est point nouvelle ; elle est tous les jours appliquée avec succès à l’étude des sciences naturelles, et même à une partie des sciences morales. C’est à l’application qui en a été faite à l’étude de l’économie politique et de l’entendement humain, qu’il faut attribuer les progrès qu’ont faits ces deux branches de nos connaissances.
Ne produisant que d’heureux résultats dans les sciences auxquelles elle est appliquée, étant même considérée par les savants comme le seul moyen d’arriver à la découverte de la vérité, cette méthode pourrait-elle être trompeuse ou dangereuse dans l’étude de la morale et de la législation ? Il faut bien qu’elle ait paru inapplicable ou dangereuse, puisqu’elle est repoussée, au moins en théorie, par trois classes de personnes qui d’ailleurs ne s’accordent guère, par des théologiens, par des philosophes et par des jurisconsultes.
On conçoit que des théologiens, de quelque religion qu’ils soient, repoussent l’application de la méthode analytique, de l’étude de la morale, et même, dans quelques cas, de l’étude de la législation. Leurs idées religieuses peuvent leur faire considérer l’emploi de cette méthode comme [I-3] dangereux, ou tout au moins comme inutile. Ils trouvent des règles de conduite, et quelquefois de gouvernement, dans les livres qui sont la base de leurs croyances religieuses. Ils voient les causes de ces règles, non dans les besoins des hommes, ou dans des circonstances accidentelles, mais dans la volonté de l’auteur de leur religion. Ils n’ont pas à en rechercher les effets, parce qu’elles leur paraissent bonnes indépendamment des conséquences qu’elles peuvent produire sur le bonheur du genre humain. Il est bon de les observer, par cela seul que celui qui en est cru l’auteur trouve bon qu’on les observe.
À quoi servirait à un musulman vivement persuadé de la vérité de sa religion, de rechercher les conséquences bonnes ou mauvaises qui peuvent résulter de l’observation des préceptes de Mahomet ? Si l’application à ces préceptes de la méthode analytique ne doit avoir pour résultat que d’en prouver la bonté et d’en recommander l’observation, elle n’ajoute rien à la science, elle est inutile. Si elle doit avoir pour effet de prouver que l’observation ne produit aucun bien, ou même qu’elle produit du mal, elle n’est propre qu’à ébranler la foi des croyants, elle est dangereuse ou impie. Un juif trouvera ce raisonnement vicieux dans la bouche d’un sectateur de Mahomet ; mais appliqué à sa propre religion, il lui paraîtra sans réplique. Il en sera de même de tout homme dont la religion aura consacré un système [I-4] de morale, de législation ou de gouvernement, s’il est vivement persuadé de la vérité de ce système, ou s’il a un intérêt puissant à le soutenir.
L’application de la méthode analytique à l’étude de la morale est quelquefois repoussée, même par des théologiens dont les principes moraux n’ont rien à craindre d’un examen approfondi. La raison en est sensible. Le résultat de l’analyse, ainsi qu’on le verra plus loin, est de convaincre les hommes qu’il leur importe d’avoir de bonnes mœurs, indépendamment de telle ou telle opinion particulière. Une telle conviction ne porterait sans doute atteinte qu’à des religions malfaisantes, et elle serait pour toutes un motif de plus de se bien conduire. Elle ferait perdre cependant à certains dogmes, et à ceux dont la mission est de les enseigner, une partie de leur importance temporelle. On ne pourrait plus dire que telle ou telle opinion religieuse est le fondement exclusif des lois et des bonnes mœurs ; un mollak, par exemple, ne pourrait pas prétendre qu’il est impossible d’avoir de la probité si l’on ne croit pas aux miracles de Mahomet et à la vérité du Coran.
Une autre raison doit faire repousser la méthode analytique par les systèmes théologiques, qui ont consacré des principes de législation, de gouvernement ou de morale. Lorsque de pareils systèmes sont formés, il n’y a plus de progrès possibles pour l’esprit humain, à moins que les religions qui les consacrent n’admettent des [I-5] interprètes de la volonté divine, dont la mission soit de faire subir aux mœurs et aux institutions les changements dont les progrès des lumières démontrent la nécessité. En pareil cas, pour changer une loi ou une maxime de morale, il ne suffit pas de prouver que ce changement est avantageux au genre humain ; il faut prouver de plus qu’il est commandé ou du moins autorisé par la divinité ; preuve qui devient d’autant plus difficile à faire, que les hommes sont plus éclairés. On a attribué à l’ambition des prêtres l’état stationnaire des peuples soumis à des gouvernements théocratiques ; un tel état est une conséquence inévitable de la nature même de ces gouvernements. Les principes de la législation et les règles de la morale étant le résultat d’une volonté supérieure, sont hors de l’influence de la raison ; tenter de les modifier, est un acte d’impiété, même dans les ministres de la religion ; en inspirer le désir, c’est ébranler les fondements de l’édifice tout entier.
On aurait tort d’attribuer toujours à la mauvaise foi et à l’intérêt personnel la répugnance qu’éprouvent, en général, les ministres de toutes les religions, à voir appliquer aux sciences morales la méthode qui a fait faire des progrès si rapides aux sciences naturelles. Il suffit, pour que cette répugnance existe, qu’ils soient vivement persuadés de la bonté de leurs principes de morale, de législation ou de gouvernement, et qu’ils aient [I-6] peu de confiance dans le jugement des hommes. On leur a parlé si souvent de la faiblesse et des égarements de la raison humaine, qu’il est tout naturel qu’ils s’en méfient, et qu’ils ne veuillent en permettre l’usage que dans les cas où la foi ne peut pas les diriger. Le raisonnement ne saurait paraître un guide bien sûr à des hommes qui font un devoir à leurs semblables d’humilier leur raison, et qui leur en donnent souvent l’exemple.
Mais s’il est naturel que les ministres de toutes les religions préfèrent, en général, la méthode théologique à la méthode analytique, il n’est pas aisé de comprendre que des philosophes, qui n’admettent pas la première, rejettent cependant la seconde. Repousser tout à la fois de l’étude des sciences morales, et l’autorité de toute religion positive, et l’autorité qui résulte de l’examen des faits, est un procédé si étrange, qu’on refuserait de le croire possible, si l’on n’en avait pas des exemples. Des écrivains qui ne pensaient pas que tous les livres religieux fussent des guides infaillibles, ont fait de très longs raisonnements pour prouver que dans l’étude des sciences morales il fallait consulter le sentiment, et ne pas raisonner. L’application de la méthode analytique à l’étude de ces sciences, leur a paru plus dangereuse encore qu’aux théologiens ; ils lui ont attribué la plupart des vices ou des crimes qui ont déshonoré le monde. Ces écrivains ont voulu en quelque sorte proscrire l’emploi de l’intelligence, [I-7] et consulter exclusivement, tantôt le sentiment intime, et tantôt le sentiment religieux ; ils ont prétendu que ces sentiments dirigeaient l’homme d’une manière si sûre, que, s’il n’était pas égaré par sa raison, ils pouvaient dans toutes les circonstances lui faire distinguer une bonne d’une mauvaise action.
Il est une autre manière d’écrire sur les sciences morales, qui a été souvent employée par les philosophes, et qui n’a pas encore cessé de l’être, surtout en politique. Elle consiste à se créer, par la force de l’imagination, un système particulier, et à y ramener ensuite les faits que l’histoire nous présente. Cette méthode a été mise en pratique dans presque toutes les sciences, et elle en a été repoussée à mesure que l’art de l’observation a fait des progrès. Les hommes ont commencé par chercher à deviner la vérité, et ce n’est qu’après être tombés dans de nombreuses erreurs, et avoir épuisé en quelque sorte le nombre des suppositions, qu’ils ont pu se résigner à observer les faits et à en suivre l’enchaînement. Les écrivains moralistes et politiques n’ont pu se soumettre encore à cette nécessité, ils repoussent une méthode qui doit arrêter l’essor de leur imagination, qui ne laisse aucune place au génie d’invention, et qui les condamne à de longues et pénibles études. Que resterait-il, en effet, dans la plupart des ouvrages de morale ou de législation, si l’on en supprimait tout ce qui ne serait pas un fait [I-8] bien observé, ou la déduction exacte d’un fait ?
Les jurisconsultes, au moins pour la plupart, ont repoussé de l’étude des lois la méthode d’observation, avec autant d’énergie que les philosophes. Ils ont adopté un certain nombre de maximes auxquelles ils ont donné le nom de lois naturelles, et ils n’ont admis comme justes que les déductions tirées de ces maximes. Ils ne se sont pas accordés, il est vrai, sur le nombre qu’il fallait en admettre ; les uns les ont multipliées à l’infini, et les autres les ont réduites à presque rien ; mais cela ne les a pas empêchés d’être d’accord sur le fond du système. Il est vrai aussi que plusieurs de ces maximes ont été méconnues en pratique, non seulement par des multitudes d’individus, mais même par des nations entières, et que des philosophes en ont contesté la vérité, même en théorie ; mais cela n’a pas empêché de soutenir qu’elles étaient reconnues par le genre humain. Et il fallait bien les soutenir, puisque, si on avait cessé de les considérer comme la base de la science de la législation, nul n’aurait pu dire sur quoi pouvait reposer cette science, ni même en quoi elle pouvait consister.
Enfin, d’autres ont voulu fonder la science de la législation et de la morale sur la justice ou sur le devoir ; ils ont voulu écarter toute considération d’utilité, de plaisir ou de peine. Ils ont mis le devoir à la place du droit, qui leur a paru trop susceptible ou trop pointilleux, et ils ont espéré qu’ils [I-9] allaient mettre ainsi le genre humain en paix avec lui-même, en changeant deux ou trois mots.
Il y a, dans tous ces systèmes, un fond de bonnes intentions qu’on ne peut assurément pas méconnaître ; mais, sous quelque point de vue qu’on les considère, on ne saurait y trouver ni une science, ni une méthode scientifique. Et qu’on ne se hâte pas de conclure de là que, pour s’instruire dans les sciences morales, il est nécessaire de n’avoir point de règles, de mépriser la justice, de ne tenir compte d’aucun devoir. Qui pourrait avoir une telle pensée ? La question n’est pas de savoir s’il faut se conformer à la justice, s’il est des devoirs qu’il faut observer, des droits qu’il faut respecter, des maximes ou des principes qu’il est bon de mettre en pratique ; elle est de savoir quelle est la meilleure méthode pour arriver à la découverte de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est un devoir. On tomberait dans une étrange erreur si l’on s’imaginait que, pour enseigner la morale ou la législation aux hommes, il suffit de les convaincre qu’ils doivent être justes, qu’ils doivent observer leurs devoirs, qu’ils doivent être moraux. Cette erreur ressemblerait à celle d’un professeur de mathématiques qui croirait que, pour faire de ses élèves de grands mathématiciens, il lui suffit de les convaincre qu’ils doivent toujours être justes dans leurs calculs. Il pourrait employer beaucoup de temps et de talents à leur faire comprendre cette grande vérité ; mais si, après les avoir persuadés, [I-10] il ne leur disait pas un mot sur la manière dont ils doivent s’y prendre pour calculer, il les laisserait aussi ignorants qu’il les aurait pris.
Des règles ou des maximes de législation et de morale doivent sortir sans doute de la science, comme les règles qu’on observe dans les arts, sortent des recherches des savants ; mais s’imaginer qu’on fera sortir une science d’un certain nombre de maximes, au lieu de faire sortir les maximes de l’observation, est la plus vaine des prétentions.
Mais la méthode analytique est-elle réellement applicable aux sciences morales ? Peut-on soumettre à l’observation toutes les causes physiques ou morales qui influent sur la prospérité ou sur la décadence des peuples ? Peut-on y soumettre les actions, les habitudes, les institutions et les effets qui en résultent, comme on peut y soumettre des corps organisés ? Locke et, après lui, Condillac ont appliqué cette méthode à l’étude de l’entendement humain, à la formation de nos idées, au mécanisme des langues. Or, il serait difficile de concevoir comment une méthode qui nous conduit à la découverte de la vérité, quand nous l’appliquons à l’étude de nos idées, ne serait propre qu’à nous égarer, quand nous l’appliquons à l’étude de nos actions. Adam Smith, et après lui J.-B. Say, ont fait l’application de la même méthode à l’étude de l’économie politique ; et ce n’est que depuis la publication de leurs écrits, que l’économie politique a acquis le caractère et la [I-11] certitude d’une véritable science. La méthode qui nous fait voir comment les richesses d’une nation se forment, se distribuent, se détruisent, ne saurait-elle nous faire voir avec la même certitude les effets que produisent les institutions humaines sur la prospérité ou la décadence des peuples ? Une partie de l’économie politique n’est-elle pas même consacrée à nous faire connaître les effets de certaines lois ou certaines institutions sur les richesses des nations, et par conséquent sur leur prospérité ? Et il y a-t-il quelque raison de croire qu’une méthode qui a fait apprécier avec tant de justesse les effets d’une partie considérable de la législation, sera trompeuse si on l’applique aux autres parties de la même science ?
Il n’y a qu’une manière d’arriver à la connaissance de la vérité : c’est l’observation des faits. Le botaniste qui étudie une plante, l’anatomiste qui étudie l’organisation physique de l’homme, et le moraliste qui étudie les causes, la nature et les conséquences d’une action ou d’une habitude suivent exactement le même procédé. Tous décrivent les choses ou les phénomènes qu’ils ont sous les yeux : la méthode est la même ; la différence n’existe que dans les objets auxquels elle est appliquée. Si les descriptions qu’ils nous donnent sont exactes et complètes, ils forment véritablement des sciences ; si, au lieu de décrire des faits, ils nous donnent des suppositions ou des hypothèses ; si, au lieu de nous faire connaître simplement [I-12] ce que les choses sont et ce qu’elles produisent, ils cherchent à nous inspirer de l’affection ou de l’éloignement pour telle chose, telle forme particulière, ou tel genre d’actions, on ne peut plus les considérer comme des hommes qui étudient une science, et qui veulent lui faire faire des progrès : ce sont des hommes plus ou moins ingénieux, plus ou moins éloquents, plus ou moins estimables, selon le but qu’ils se proposent ; mais ce ne sont pas des hommes que les sciences puissent reconnaître.
Les hommes qui créent des systèmes par la puissance de l’imagination, et ceux qui nous exposent ce que les choses sont, font tous également usage des faits, mais ce n’est pas de la même manière. Les premiers les appellent à l’appui de leurs systèmes, et leur en donnent la couleur ; ils écartent ceux qui y sont contraires, ou les expliquent de manière à en rendre le témoignage nul. Ils ne se livrent ordinairement à la recherche des faits que lorsque leur système est complet, et qu’ils s’imaginent n’avoir plus rien à apprendre. C’est une espèce de complaisance qu’ils ont pour leurs auditeurs ou pour leurs lecteurs, desquels ils n’osent pas exiger une foi aveugle. Ils procèdent comme des avocats qui cherchent dans les écrits des jurisconsultes des autorités, non pour se former une opinion, mais pour défendre leur cause ; quel que soit le résultat de leurs recherches, ils n’en défendent pas moins les intérêts qui leur ont été confiés.
[I-13]
Lorsqu’on se borne, au contraire, à l’observation et à l’exposition des phénomènes de la nature, on écarte toute opinion, tout système arrêté d’avance. On est convaincu qu’on ne sait rien, aussi longtemps qu’on n’a pas étudié chacun des faits sur lesquels on veut faire porter ses recherches. Les jugements ne se forment qu’à mesure qu’on avance dans l’étude des faits : ils sont des résultats de l’examen auquel on se livre ; mais ces résultats sont imprévus et ne dépendent en rien de notre volonté. L’opinion qui résulte dans notre esprit de l’observation d’un fait est aussi indépendante de nous que l’impression de la chaleur, des sons ou des odeurs, lorsque nous exposons nos organes à l’action de corps chauds, sonores ou odorants. Il n’est pas rare qu’en se livrant à une recherche on arrive à des conséquences inattendues, contraires à nos idées, à nos intérêts ou à nos espérances. On peut bien alors faire un nouvel examen, recommencer ses expériences : mais si le même procédé amène toujours les mêmes conséquences, il nous est impossible de ne pas rester convaincus. Nous pouvons cacher notre opinion, ou même manifester une opinion contraire ; mais c’est là que se borne notre puissance. Il est possible de croire sur le témoignage d’autrui ; il n’est pas possible de croire contre le témoignage des faits.
Il résulte de cette manière de procéder qu’on ne tient aux opinions qui se sont formées dans notre esprit, qu’aussi longtemps qu’on les croit [I-14] vraies, et qu’on est disposé à les abandonner, aussitôt qu’on commence à douter si les observations qui y ont donné naissance ont été bien faites. Comme il n’est en la puissance de personne de changer la nature des choses, ou de faire que, dans telle circonstance donnée, tel fait ne soit pas suivi de telle conséquence, les savants ne s’inquiètent ni des contradictions qu’ils éprouvent, ni des critiques dont leurs écrits peuvent être l’objet, ni même des obstacles que leur opposent les préjugés populaires. Ils sont bien convaincus que la vérité, par la force qui lui est propre, finira par vaincre toutes les résistances, et qu’une fois qu’elle à été démontrée, elle est indestructible, fût-elle repoussée par le monde entier et désavouée par celui même qui l’a découverte. Quand Galilée eut démontré le mouvement de la terre, ce fut un fait constaté qui ne put être détruit ni par l’autorité de la Bible, ni par la puissance de l’église romaine, ni par les préjugés populaires, ni par les illusions de nos sens, ni même par le désaveu de l’auteur de la découverte, et qui a fini par être reconnu par ceux mêmes qui croyaient avoir le plus grand intérêt à le contester.
Cette sécurité qu’inspire la vérité à ceux qui la recherchent, les empêcherait de recourir à des moyens violents pour faire adopter leurs opinions, lors même qu’ils pourraient en mettre de pareils en usage. Ils se bornent à exposer ce que les choses sont, sans se livrer à des déclamations, [I-15] et même sans se mettre beaucoup en peine si l’on adopte ou non les procédés qu’ils ont découverts. Ils savent que la tendance du genre humain vers sa prospérité a plus de force que tous les orateurs du monde, et que, lorsqu’une vérité utile a été découverte et démontrée, ce n’est pas la faute de ceux qui la connaissent, s’ils ne la mettent pas en pratique. Si l’on découvre, par exemple, que tel procédé dans les arts produit une économie de temps, de force ou de capitaux, il n’est pas fort nécessaire de recourir à des moyens oratoires pour déterminer les fabricants à ne pas perdre leur temps, à ne pas faire un emploi inutile de forces, ou à ne pas dissiper sans fruit leurs capitaux. Si l’on découvre et si l’on démontre que tel remède fait cesser telle douleur, ou guérit telle maladie, on n’a besoin ni d’exhortations ni d’autorités pour déterminer des personnes qui souffrent à mettre un terme à leurs douleurs, et à recouvrer la santé.
Ce n’est pas avec cette simplicité que procèdent les hommes qui veulent faire adopter un système produit par l’imagination ou enfanté par l’intérêt personnel. Ceux-ci ne croient jamais que l’exposition de leurs idées ait par elle-même assez de force pour produire la conviction. Après avoir employé le raisonnement, lorsqu’en effet ils veulent bien se donner la peine de raisonner, ils mettent en usage toutes les ressources de l’éloquence, et quelquefois même de l’invective. La [I-16] contradiction les offense et les irrite, et ils sont toujours disposés à imputer à ceux qui ne partagent pas leurs opinions, de la mauvaise foi, de mauvaises intentions, ou tout au moins un aveuglement déplorable. Ils veulent suppléer par la puissance de l’autorité publique à ce qui manque de force à leurs raisonnements ; et c’est par le supplice des incrédules, qu’ils cherchent à porter la conviction dans l’âme des sceptiques.
On se tromperait, si l’on croyait que cette manière de convaincre les esprits a été particulière à des sectes religieuses, elle a été commune à tous les hommes qui ont voulu fonder ou soutenir des systèmes dont la vérité ne pouvait pas être démontrée par l’expérience. Elle ne convient pas seulement aux partisans du pouvoir absolu ; elle plaît aussi aux partisans du pouvoir populaire. Les premiers n’hésitent point à dire que c’est avec le canon qu’il faut prouver le principe de la légitimité, et renverser les raisonnements qu’on a faits en faveur de la civilisation et des progrès des lumières [2] ; mais Jean-Jacques Rousseau n’hésitait pas davantage à soutenir que l’État avait le droit d’imposer aux citoyens une croyance politico-religieuse, et de bannir ou même de mettre à mort quiconque ne l’adopterait pas, ou qui ne l’observerait pas après l’avoir jurée [3]. [I-17] Les philosophes n’ont pas agi autrement que les théologiens et les politiques, aussi longtemps qu’ils ont prétendu arriver à la découverte de la vérité autrement que par l’étude des faits. Les arrêts du parlement de Paris, en faveur des opinions d’Aristote, ne diffèrent en rien, quant à l’esprit qui les obtint ou qui les dicta, des décisions de la Sorbonne, ou des jugements qui plus tard ont été rendus pour raffermir dans l’esprit des hommes certains dogmes politiques que la discussion avait ébranlés.
En dégageant les sciences morales et politiques des croyances particulières à chaque religion, elles ne sont donc que la description des actions et des institutions humaines, des causes physiques et morales qui les produisent, et des effets qui en [I-18] résultent relativement au bien-être des hommes. C’est uniquement sous ce point de vue que je me propose de les considérer ; je ne veux ni établir un système, ni présenter sous de nouvelles formes un système imaginé par d’autres ; mon unique but est, en ramenant, s’il est possible, les sciences de la législation et de la morale à la simple observation des faits, de faire considérer ces deux branches de nos connaissances comme une partie de l’histoire naturelle de l’homme.
La connaissance des systèmes imaginés par des écrivains, forme-t-elle une partie de la science ? Il faut distinguer : les systèmes qui n’ont produit et ne peuvent produire aucun effet, sont étrangers à la science ; il n’est même pas nécessaire de les connaître, ou du moins d’en parler ; mais ceux qui ont été adoptés, soit par des peuples, soit par des gouvernements, sortent du domaine des opinions ; ils rentrent au nombre des faits dont il faut déterminer le caractère, rechercher les causes, suivre les conséquences. On verra même que ces faits ont eu quelquefois des résultats fort importants. J’aurai donc à examiner les divers systèmes de morale ou de législation qu’ont imaginés des écrivains plus ou moins célèbres, toutes les fois que je croirai que ces systèmes ont produit ou peuvent encore produire quelques effets sur la conduite des hommes. Dans les sciences morales, le nombre des erreurs qui sont à détruire, excède peut-être le nombre des vérités qui sont à démontrer. [I-19] On réduirait singulièrement nos immenses bibliothèques, si l’on en supprimait l’exposition de tous les faux systèmes, et les réfutations ou les commentaires auxquels ils ont donné naissance.
Mais, quoique les sciences morales ne puissent se former que par l’observation des faits, l’étude en est infiniment plus difficile que l’étude des sciences physiques. Un physicien est maître de la matière sur laquelle il fait ses expériences ; s’il a des doutes sur la justesse de telle ou telle observation ; s’il ne lui paraît pas clairement démontré que tel effet doive être attribué à telle cause, il peut répéter ses expériences jusqu’à ce qu’il soit arrivé à une certitude complète. Les effets sont, en général, assez rapides et assez rapprochés des causes qui les produisent, pour que le savant qui les étudie puisse en voir la liaison, et n’ait jamais besoin de s’en rapporter au témoignage d’autrui. S’il peut se tromper, il n’a pas du moins à craindre les erreurs des autres ; car il peut voir tout ce qu’ils ont vu, et refaire les expériences qu’ils ont faites.
Dans les sciences morales et politiques, on ne trouve pas les mêmes avantages. Les savants ne disposent pas des peuples comme les chimistes disposent de la matière. Ils peuvent faire des observations sur les faits que l’histoire a constatés, ou dont ils sont eux-mêmes les témoins ; mais il n’est pas en leur pouvoir, soit de faire de nouvelles expériences, soit de répéter celles qui ont [I-20] été faites en d’autres temps ou en d’autres lieux. À la vérité les gouvernements, qui ont aussi leurs systèmes, n’agissent guère sur les nations que comme sur une matière expérimentale : mais leurs expériences sont toujours faites dans le même sens, et dans la vue d’arriver à un résultat qui n’est pas toujours avoué. Ils n’accordent pas à ceux qui ne sont pas convaincus de la bonté de leurs procédés, la faculté de faire des expériences contraires. La liaison entre les effets et les causes n’est pas d’ailleurs aussi aisée à démontrer dans les sciences morales que dans les sciences naturelles ; d’abord, parce qu’un grand nombre de causes agissant en même temps sur un peuple, il est difficile de démêler les effets qu’il faut attribuer à chacune d’elles ; et, en second lieu, parce que l’intervalle qui s’écoule entre le moment où une institution est établie, et le moment où il est possible d’en apprécier les résultats, est souvent trop long pour bien suivre l’enchaînement des faits, et pour que le même individu qui a vu commencer la cause, puisse être témoin des résultats. Souvent aussi il est impossible de se transporter sur les lieux qui sont le théâtre des faits : la vie d’un homme n’est point assez longue pour lui permettre de visiter tous les peuples du monde, et, quand même il vivrait assez longtemps, l’ignorance des langues ou le défaut de fortune le mettraient dans l’impossibilité de vérifier les faits par lui-même. De là, la nécessité [I-21] pour les hommes qui s’occupent des sciences morales, de s’en rapporter au témoignage des historiens ou des voyageurs, nécessité à laquelle ne sont pas assujettis, en général, les hommes qui se livrent à l’étude des sciences naturelles.
L’espèce humaine est douée d’ailleurs d’une si grande flexibilité, elle porte, en elle-même des principes de conservation et de développement si énergiques, que si elle ne prospère pas également dans toutes les positions, il n’en est du moins aucune où elle ne puisse se conserver. Elle s’habitue à tous les climats, se nourrit de toutes sortes d’aliments, se fait des vêtements ou des abris de tout ce qui peut la garantir des injures du temps, et obéit à tous les gouvernements que l’ignorance, le caprice ou la force lui imposent. Soumise à des institutions qui la gênent de mille manières, et qui ne semblent propres qu’à la détruire, elle trouve souvent en elle-même le moyen d’en paralyser l’effet, et prospère malgré les lois qui ne tendent qu’à la faire dépérir. Les hommes qui profitent des abus ou qui espèrent d’en profiter un jour, ne manquent pas de dire alors que les lois qu’ils ont faites, ou qu’ils soutiennent, sont la cause de sa prospérité, et il se trouve toujours un grand nombre de gens qui ajoutent foi à leurs discours et qui les répètent.
Les obstacles qu’on rencontre dans l’étude de la morale privée sont moins grands que ceux qui s’opposent à la formation des sciences politiques. [I-22] Il est plus facile de voir les causes et de calculer les effets d’une action ou d’une habitude privée, que de voir les causes et de calculer les effets d’une loi qui régit une nation. Ces causes sont moins nombreuses, moins éloignées ; ces effets sont moins divers, moins étendus, plus rapprochés : on peut les constater sans recourir au témoignage d’autrui, et l’on n’a par conséquent à se mettre en garde que contre ses propres erreurs. Pour exposer les causes et décrire les effets d’une loi ou d’une institution politique, il faut quelquefois consulter l’histoire d’un peuple qui a cessé d’exister, ou se transporter chez un peuple qui vit à une grande distance ; mais pour indiquer les causes et décrire les effets d’une action ou d’une habitude privée, il suffit souvent de regarder autour de soi. Enfin, les intérêts qui s’opposent aux progrès de la morale privée sont moins puissants, que ceux qui s’opposent au perfectionnement des institutions publiques. Tel individu qui compromettrait sa fortune et même sa vie pour soutenir une institution vicieuse, serait au désespoir s’il voyait son fils, sa femme ou sa fille, se livrer à une habitude déshonorante. Il doit donc у avoir plus de certitude dans les jugements qu’on porte sur les actions privées, que dans ceux qu’on porte sur les lois ou sur les institutions. On doit aussi, par les mêmes raisons, mettre dans la discussion des questions de morale, moins d’animosité que dans les questions de législation ou de politique. [I-23] Enfin, les premières de ces questions doivent être à la portée d’un plus grand nombre d’esprits que les seconds.
Mais, quelque difficile qu’il soit de réduire à l’observation et à l’exposition des faits la science de la législation et de la morale, cela n’est cependant pas impossible ; peut-être même le nombre des faits qui ont été constatés est-il assez grand pour qu’on puisse donner à plusieurs branches de ces deux sciences le même degré de certitude qu’on a donné aux sciences naturelles. Depuis un demi-siècle, en effet, les savants ont recueilli une quantité si prodigieuse de faits nouveaux, et l’esprit humain a fait des progrès si immenses, que des questions qui divisaient les hommes les plus savants du siècle dernier, peuvent être résolues aujourd’hui par des hommes d’une capacité fort médiocre ; et que, sans être doué d’une sagacité extraordinaire, on peut découvrir, dans les plus célèbres de leurs ouvrages, de graves et nombreuses erreurs.
Et pourrait-on s’en étonner, lorsqu’on songe aux moyens que nous possédons et qui leur ont manqué ? Depuis moins d’un demi-siècle, toutes les sciences ont agi les unes sur les autres, et se sont prêté des secours mutuels ; l’étude de l’entendement humain nous a appris à donner de la précision au langage, et nous a mis en possession d’une nouvelle méthode ; les progrès de l’économie politique et de l’art de la critique, ont porté [I-24] la lumière dans l’histoire des peuples anciens et des peuples modernes ; l’histoire naturelle, la navigation et le commerce, nous ont fait connaître des peuples nouveaux sur lesquels on n’avait pu former que des conjectures ; des lois dont la description ne se trouvait que dans des milliers de volumes, et qu’on était accoutumé à révérer comme des oracles de la sagesse, ont été discutées, systématisées, réduites à l’expression la plus simple ; enfin, des hommes qui avaient étudié la législation en jurisconsultes, en ont fait la critique en philosophes, et nous ont indiqué le moyen d’en constater les bons et les mauvais effets.
Il faut ajouter à ces moyens, que les sciences nous ont fournis, l’expérience que les révolutions nous ont donnée. L’indépendance de l’Amérique du nord a donné naissance à des gouvernements dont les anciens n’ont eu aucune idée, et dont les modernes Européens n’auraient peut-être pas cru l’existence possible, si l’expérience ne les avait pas convaincus ; la formation d’un monde nouveau, plus étendu que l’ancien, destiné à être un jour plus populeux et plus riche, possédant ou aspirant à se donner des gouvernements également éloignés des formes européennes, des formes asiatiques, et des formes des anciens peuples de la Grèce et de Rome, nous fait perdre une partie de notre importance et ébranle la confiance que nous avions dans l’infaillibilité de nos maximes politiques ; les révolutions et les contre-révolutions [I-25] qu’ont subies la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, la Hollande, dans un espace d’environ trente années, ont déraciné ou renversé nos vieilles institutions, et changé jusqu’à nos habitudes ; les guerres auxquelles ces révolutions ont donné naissance ont fait passer alternativement les peuples les uns sur le territoire des autres, et ont ainsi mis les hommes les plus ignorants à même de comparer leur état à celui de leurs voisins ; la décadence du système colonial, accélérée par les progrès des lumières et par l’indépendance du continent américain, a renversé les lois et les maximes commerciales ; enfin la liberté des opinions religieuses et politiques, la multiplication et la diffusion des ouvrages philosophiques, et les changements opérés par les gouvernements mêmes qui professent pour les innovations une haine violente, ont achevé de détruire la confiance qu’on avait dans les anciennes doctrines, et mis presque hors d’usage les écrits dans lesquels elles étaient exposées.
On admire encore, par habitude, des écrivains qui ont joui d’une juste célébrité, parce qu’au moment où ils ont paru, ils se sont trouvés beaucoup plus avancés que ne l’étaient leurs contemporains ; on les cite même quelquefois, mais on les cite sans les croire, et souvent même sans les avoir lus. On considère leurs écrits, non comme des corps de doctrine, mais comme des arsenaux qui peuvent nous fournir des armes contre des [I-26] ennemis. Ceux qui se donnent la peine de les étudier, sentent qu’ils ont été faits pour un ordre de choses qui n’existe plus, et pour des temps qui ne sauraient revenir. On y tient cependant, parce qu’on n’a pas le temps ou le moyen de se faire des idées plus justes, et qu’on ne se croit pas l’esprit assez fort pour se permettre de marcher sans guides ; mais on les suit sans y avoir confiance, et avec la circonspection d’un général qui se fait conduire, par un prisonnier, sur le territoire de l’ennemi.
Cette absence de doctrines ou de vérités reconnues, qui se fait si vivement sentir en politique ou en législation, donne naissance à des systèmes plus ou moins ingénieux qu’on adopte quelquefois avec enthousiasme, et qu’on rejette ensuite avec dédain. On se fait, presque au hasard, des principes ou des maximes qu’on accommode autant qu’on peut aux circonstances et aux intérêts du moment, et auxquels on s’efforce de croire. On cherche toutes les raisons qui peuvent les justifier, et lorsque l’illusion est arrivée à son comble, lorsqu’on s’imagine avoir acquis une foi bien robuste, et qu’on répète avec la plus vive confiance le symbole qu’on a imaginé ou adopté, il arrive un événement imprévu qui déjoue toutes nos combinaisons, et qui nous fait voir un résultat contraire à toutes nos espérances. On attribue alors les événements inattendus, non aux vices du système qu’on a adopté, mais aux mauvaises [I-27] intentions de ceux qui l’ont combattu, ou à l’incrédulité de ceux qui n’y ont pas ajouté foi. Si des expériences répétées finissent par convaincre qu’on a adopté un système vicieux, on le rejette pour en adopter un autre également imaginaire ; ou bien on cherche à en corriger les vices par quelque modification ; ou bien l’on se persuade qu’il n’y a rien de certain en législation, et qu’on ne saurait mieux faire que s’en occuper. Ce dernier parti est ordinairement celui que prend la foule, parce qu’il convient également à la paresse, à l’ignorance, à la tranchante présomption, et aux vices des hommes qui possèdent le pouvoir. Le jour où le peuple se persuade qu’il n’y a rien de certain en politique, est un jour de triomphe pour les mauvais gouvernements ; car, à compter de ce jour, ils n’ont plus de résistance à craindre.
Quel est le moyen de sortir de cet état d’incertitude ou d’indifférence, dans lequel nous ont laissé la ruine des anciens systèmes, et les révolutions que le monde a subies ? Faut-il imaginer des systèmes nouveaux, enflammer les esprits pour des spéculations métaphysiques, ou tâcher de rétablir des systèmes décriés ? Aucun de ces moyens ne saurait produire des effets durables, ni même bien étendus. Les peuples n’ont pas assez de lumières, pour voir par eux-mêmes les conséquences bonnes et mauvaises de leurs institutions ; mais ils en ont beaucoup trop pour adopter aveuglément les opinions de qui que ce soit, ou [I-28] pour se passionner pour un système philosophique, quelque ingénieux qu’il puisse être. Il est encore possible de mettre au jour des vérités nouvelles, mais le temps de former des sectes est passé. On ne consent à croire que ce qu’on trouve démontré, et l’on mesure son enthousiasme en faveur d’une opinion, par l’intérêt qu’on croit avoir à ce que cette opinion soit adoptée.
Cette disposition des esprits, loin d’être un obstacle aux progrès des sciences morales, est, au contraire, la circonstance la plus favorable qui puisse se présenter. On n’est jamais plus disposé à se laisser diriger par les faits que lorsqu’on a cessé d’avoir confiance dans les systèmes, et même dans les individus. Mais, pour que la lumière sorte des faits, il ne suffit pas de les recueillir et de les entasser au hasard dans un ouvrage ; il ne suffit pas d’affirmer que tel fait est produit par tel autre : il faut les présenter dans l’ordre même dans lequel ils s’engendrent, et en démontrer la filiation. Ce n’est qu’en les classant de cette manière et en en faisant voir l’enchaînement, qu’on suit une marche scientifique, et qu’on peut espérer de faire faire quelques progrès à l’esprit humain. Il est vrai qu’en suivant cette méthode on est obligé de s’arrêter aussitôt qu’on cesse d’être conduit par les faits, et qu’on peut, par conséquent, se trouver dans la nécessité de laisser indécises des questions importantes. Il est vrai aussi qu’on ne peut pas se livrer à ces mouvements d’inspiration, [I-29] que le public prend quelquefois pour du génie, et qui ne sont bien souvent que les produits d’une imagination déréglée. Mais, lorsqu’on traite une science, on ne s’engage pas à résoudre toutes les questions qui peuvent se présenter, et l’on ne parle pas à ses lecteurs ou à ses auditeurs, sur le même ton qu’un orateur populaire qui cherche à mettre en mouvement la multitude qui l’écoute.
On voit, par ce qui précède, qu’en écrivant cet ouvrage, je me propose plus d’un objet : je voudrais d’abord tâcher d’introduire dans l’étude de la morale et de la législation, la méthode qui a fait faire aux autres sciences des progrès si sûrs et si rapides, en substituant l’étude des faits à l’invention et à l’étude des systèmes. Je voudrais, en second lieu, faire usage de l’immense quantité de faits nouveaux que les sciences et les révolutions nous ont fournis depuis un demi-siècle, pour mettre la morale et la législation au niveau de nos autres connaissances, ou du moins pour les en approcher. Je voudrais, en troisième lieu, fournir aux jeunes gens que l’amour de l’étude et de la vérité tourmente, des moyens d’instruction plus sûrs que des systèmes imaginaires et que les déclamations qui enflamment leur imagination, sans éclairer leurs esprits. Enfin je voudrais essayer de donner à la partie de nos connaissances qui intéresse le plus l’humanité, la même certitude qui a été donnée à d’autres moins importantes.
Si je n’avais à compter que sur mes propres [I-30] forces, je n’aurais pas le courage de former une telle entreprise. Mais, quoique la législation soit bien loin d’être aussi avancée que les autres sciences, tout n’est cependant pas à faire. Quelques-unes des branches de cette science ont même fait de si grands progrès, qu’il reste peu de chose à y ajouter ; et la méthode qui a servi à y porter la lumière peut aisément éclairer celles qui sont moins avancées. On doit à la réunion de deux savants, dont il n’est pas possible de séparer les noms, MM. Bentham et Dumont, d’avoir tout à la fois donné une meilleure manière de raisonner, et d’en avoir fait souvent l’application avec beaucoup de succès. D’un autre côté, les progrès de l’économie politique, et les recherches qui ont été faites sur les causes de l’accroissement et du décroissement de la population, dans tous les pays, nous ont donné le moyen de résoudre une foule d’importantes questions. Enfin, une bonne méthode donne à l’esprit une telle puissance, qu’elle peut en quelque sorte remplacer le talent ; c’est un levier qui donne à l’homme faible qui l’emploie, une force que ne saurait posséder l’homme le plus fort, qui serait privé d’un semblable moyen.
[I-31]
CHAPITRE II.↩
De la méthode analytique appliquée à l’étude de la morale et de la législation, et des effets de cette méthode sur le perfectionnement des mœurs et des lois.
La première difficulté que l’on rencontre, lorsqu’on se propose de traiter de la science de la législation, est de déterminer nettement quels sont les objets sur lesquels on doit faire porter ses recherches. Tous les phénomènes de la nature sont tellement liés les uns aux autres, qu’on ne peut les séparer sans une espèce de violence, et qu’il y a toujours quelque chose d’arbitraire dans les lignes qu’on trace pour les distinguer. Aussi, parmi les sciences morales, n’en est-il aucune qui puisse être traitée d’une manière complète, si l’on ne fait quelques pas sur le domaine de celles qui en sont les plus rapprochées. Il ne serait pas possible à l’économie politique, par exemple, de nous faire voir quelles sont les causes de l’accroissement et du décroissement des richesses, si elle restait étrangère au domaine de la législation ; si elle n’exposait pas les effets d’une multitude de lois, de règlements, de traités relatifs aux monnaies, au commerce, aux manufactures, aux établissements de banque, et aux relations commerciales des nations. À son tour, le savant qui s’occupe de législation, ne traiterait des lois que d’une manière [I-32] très-imparfaite, s’il ne montrait pas l’influence qu’elles ont sur l’accroissement, la distribution et la diminution des richesses. On ne peut traiter de la morale sans rechercher quels sont les effets que produisent sur le physique de l’homme certaines habitudes, et par conséquent sans empiéter sur une autre branche de nos connaissances. Il est impossible que le médecin qui recherche les causes de certains désordres physiques ou moraux, et le moraliste qui décrit les effets d’une habitude pernicieuse, ne se rencontrent pas sur le même terrain. Il est également impossible que le savant qui décrit les effets des institutions civiles ou politiques d’un peuple, et le moraliste qui recherche les causes des vices ou des vertus de ce peuple, ne passent pas alternativement l’un sur le territoire de l’autre.
Mais si, en traitant une science, on est obligé, par la nature même des choses, de faire des incursions dans le domaine d’autres sciences, on n’est pas moins obligé de restreindre ses recherches dans certaines limites, et de négliger des matières qu’on pourrait traiter sans sortir de son sujet. Si le savant qui écrit sur l’économie politique, par exemple, voulait ne rien laisser à dire sur les causes qui influent sur l’accroissement et le décroissement des richesses, il serait obligé de faire un traité de morale et un autre de législation, car il n’existe pas de loi ou d’habitude qui n’influent plus ou moins sur la prospérité d’un peuple, et [I-33] par conséquent sur ses richesses. De même, si celui qui traite des lois voulait décrire tous les effets qu’elles produisent, il ne laisserait rien à dire ni au moraliste, ni à celui qui s’occupe d’économie politique. C’est faute d’avoir senti cette nécessité de se restreindre, que des écrivains ont considéré les lois sur l’organisation sociale comme une partie essentielle de l’économie politique, et que d’autres ont reproché à des économistes de n’avoir point parlé de la forme des gouvernements dans des traités où ils exposaient les principes de la formation, de la distribution et de la consommation des richesses.
Puisque plusieurs branches de nos connaissances sont intimement liées entre elles, et qu’elles se prêtent mutuellement des lumières, il est impossible d’en traiter une sans toucher aux autres ; la difficulté est de saisir le point auquel il convient de s’arrêter. On ne peut se tracer à cet égard des règles invariables ; dans chaque cas particulier, on est obligé de se laisser plus ou moins diriger par des circonstances accidentelles. Si le sujet sur lequel on écrit se trouve bien développé dans une autre science à laquelle il appartient également, il suffit de l’exposer d’une manière sommaire, et de renvoyer les lecteurs aux ouvrages qui en ont spécialement traité. Si, au contraire, le sujet sur lequel on écrit a été négligé par d’autres sciences dont il aurait pu faire également partie, ou bien s’il a été traité d’une manière fausse [I-34] ou incomplète, il est difficile de se restreindre exactement dans la science dont on s’occupe, et de ne pas faire, dans d’autres sciences, des incursions plus ou moins longues. L’esclavage domestique, par exemple, est un sujet qui appartient à l’économie politique par les effets qu’il produit sur l’industrie et sur les richesses d’un peuple, à la morale par les effets qu’il produit sur les mœurs des maîtres et des esclaves, à la législation par les effets généraux qu’il produit sur la prospérité publique. Mais si l’esclavage a été considéré, par l’économie politique, sous un point de vue trop restreint, et par conséquent peu exact ; si, d’un autre côté, les moralistes l’ont négligé ou ne l’ont considéré que dans les rapports qu’il a avec telle ou telle religion, il est évident que celui qui s’occupera du même sujet en traitant de législation, sera obligé de se livrer à des développements beaucoup plus étendus que si le même sujet avait été traité d’une manière complète par les deux premières sciences.
J’ai dit que les sciences de la morale et la législation consistaient dans la simple description et dans la classification des faits qui rentrent dans le domaine de ces deux sciences ; mais il ne faut pas s’imaginer que cette description et cette classification obligent à présenter le tableau de tous les usages ou de toutes les coutumes qui ont été adoptées, et de toutes les lois qui ont été faites ; à exposer chacune des causes particulières qui ont [I-35] concouru à les produire, et à faire connaître tous les effets qui en sont résultés. Une telle entreprise excéderait de beaucoup les forces d’un homme, et quand elle serait exécutée, elle ne serait peut-être pas d’une grande utilité. Des écrivains français ont tenté de recueillir et de classer les ordonnances faites par les rois de France de la troisième race. Le recueil qu’ils en ont formé ne contient ni la description des lois romaines qui régissaient une partie de la France, ni celle des coutumes qui étaient particulières à chaque province ; et cependant il se compose de 16 volumes in-folio ; de sorte que, si l’on ajoutait à ce recueil tous les actes qui, en France, ont eu le caractère de loi, depuis le commencement de la monarchie jusqu’à ce jour, on formerait une bibliothèque d’une moyenne grandeur. Mais, comme les gouvernements des autres nations n’ont pas été beaucoup moins productifs à cet égard que les gouvernements de France, on voit que la vie d’un homme ne suffirait pas pour recueillir les usages qui ont existé, ou pour rassembler les lois qui ont été rendues en divers temps et en divers pays, et qu’on ne saurait par conséquent avoir le temps de les lire toutes, et encore moins d’en rechercher les causes et d’en constater les effets particuliers.
De cette impossibilité de connaître chacune des lois et des coutumes qui ont été rendues ou adoptées en divers lieux et en divers temps, il ne faut pas conclure que les sciences de la morale et de [I-36] la législation ne peuvent pas être formées. Un médecin ne saurait connaître les maladies dont chaque individu de l’espèce humaine a été atteint, les causes qui les ont produites, et les circonstances dont elles ont été accompagnées dans chaque cas particulier ; faut-il en conclure que la médecine n’est point une science, et qu’il est impossible d’arriver à aucune vérité générale ? Le nombre des lois auxquelles les peuples ont été soumis depuis les temps les plus reculés de leur histoire, est incalculable ; mais, dans ce nombre, combien en trouvera-t-on qui soient permanentes, générales, et ayant un caractère d’originalité ? Si l’on supprimait de ces compilations immenses que forment les érudits, les dispositions passagères ou transitoires, celles qui ne sont que des répétitions, celles qui ne sont que des exceptions aux lois générales, et celles qui ne règlent que des détails d’exécution, on les réduirait à un petit nombre de volumes. Quand il a été bien constaté d’ailleurs que telle institution produit tel effet sur un peuple, on peut être assuré qu’elle produira des effets semblables sur tous les peuples qui l’adopteront, à moins que des circonstances accidentelles n’en modifient la puissance.
On ne peut donc s’occuper, en traitant de la science de la législation, que des lois générales et permanentes, de celles qui exercent une grande influence sur le sort des nations, ce sont celles-là dont nous avons à rechercher les causes, à [I-37] déterminer la nature, à exposer les effets. Nous ne pouvons espérer d’en trouver les causes qu’en remontant aux faits qui leur ont donné naissance. Nous ne pouvons en déterminer la nature qu’en examinant la manière dont elles disposent, la force qui leur est propre, et les divers éléments dont cette force se compose. Enfin, nous ne pouvons en connaître les résultats que par l’examen des faits qu’elles ont engendrés. Les faits qui les ont produites sont dans les choses ou dans les hommes ; les faits qui en sont résultés ne peuvent également se trouver que là. Mais comme les choses n’ont d’importance que par la manière dont elles nous affectent, les phénomènes qui s’y rapportent ne peuvent être appréciés que par l’action qu’ils exercent sur nous. Ainsi, en recherchant les causes, et en décrivant les résultats d’une habitude, d’une loi ou d’une institution quelconque, nous n’avons à tenir compte que de ceux qui affectent les peuples, soit en agissant sur les objets qui sont à leur usage, soit en agissant immédiatement sur eux.
Mais quelles sont les causes et les conséquences qu’il faut décrire pour avoir une connaissance complète de l’objet qu’on étudie ? Il est évident qu’il faut les décrire toutes, celles qui existent dans l’homme, et celles qui existent dans les choses, celles que nous jugeons bonnes, comme celles que nous jugeons mauvaises ; une description incomplète aurait les mêmes inconvénients qu’une description fausse. Un naturaliste qui, en [I-38] décrivant une substance, ferait connaître les effets agréables qu’elle produit sur le goût, et qui, par ignorance ou par calcul, s’abstiendrait de décrire les effets qu’elle produit sur les viscères de l’estomac, ne serait pas seulement un savant peu recommandable, ce serait un homme très dangereux. De même, un écrivain qui, en faisant l’analyse d’une action, d’une habitude ou d’une loi, les attribuerait à de fausses causes, qui en exposerait les bons effets et n’en décrirait pas les mauvais, ou n’en décrirait qu’une partie, serait un homme très peu recommandable comme savant, s’il n’agissait ainsi que par ignorance ; mais, s’il laissait sa description incomplète par intérêt ou par corruption, si, après avoir parlé comme savant, il agissait comme législateur, il serait dans le même cas que le naturaliste qui ferait usage de la force pour obliger les hommes à prendre le poison qu’il leur aurait présenté comme une substance agréable.
Il n’est pas rare de voir attribuer la plupart des biens et des maux qui affectent les peuples, à leurs habitudes morales, à leurs lois, à leurs gouvernements. On se tromperait cependant si l’on croyait que ce sont là les causes premières qui agissent sur les hommes, et qui les rendent heureux ou misérables. Les lois et les mœurs des nations ne sont souvent elles-mêmes, ainsi qu’on le verra plus loin, que des effets de causes antérieures et plus puissantes. Si l’on ne remonte pas [I-39] à celles-ci, ou si l’on n’a aucun moyen d’agir sur elles, c’est vainement qu’on tenterait de modifier celles-là. Il ne suffit donc pas, pour faire faire des progrès à la législation ou à la morale, d’exposer les effets bons et mauvais qui résultent des mœurs, des lois ou des institutions. Il faut de plus remonter aux causes par lesquelles ces institutions, ces lois et ces mœurs ont été produites ; il faut, en allant d’un fait à l’autre, arriver à des faits primitifs, c’est-à-dire à ceux dont il ne nous est plus possible de trouver les causes.
Les faits primitifs auxquels il faut remonter sont ou dans les hommes ou dans les choses. Les premiers se trouvent dans la constitution physique de l’homme ou dans son organisation ; dans la nature de ses idées ou de ses opinions ; dans ses systèmes moraux, politiques ou religieux ; dans les rapports qui existent, soit entre les individus, soit entre les peuples. Les seconds se trouvent dans la nature et la configuration du sol, dans le cours des eaux, dans la position géographique, dans la température de l’atmosphère, dans la division des saisons, et jusque dans la direction et la force des vents. Il n’est, en effet, aucune de ces circonstances qui n’influe plus ou moins sur les produits au moyen desquels une nation pourvoit à son existence, sur les divers genres d’industrie auxquels elle peut se livrer, sur les relations qu’elle peut avoir avec d’autres peuples, et sur le nombre de la population. À leur tour, chacune de [I-40] ces circonstances influe sur les mœurs, sur les lois, sur les gouvernements : tenter de modifier les effets aussi longtemps que les causes subsistent, est la plus vaine des entreprises.
L’application de la méthode analytique à l’étude de la morale et de la législation, exigeant qu’on décrive les effets bons et mauvais qui résultent des habitudes et des institutions humaines, en faire usage n’est-ce pas reproduire, sous une forme nouvelle, le système qui fonde ces deux sciences sur le principe de l’utilité ? Si l’on entend par principe une maxime générale ou une règle de conduite, je répondrai que les sciences servent à former les principes ; mais qu’à proprement parler, elles n’en ont point. Elles ne sont que l’exposition méthodique de ce qui est. Un savant décrit ce qu’il voit, mais il ne crée rien, il ne conseille même rien. Il peut bien dire que tel phénomène est la conséquence de tel autre ; mais ce serait une folie de le considérer comme l’auteur de tel ou tel phénomène. Les sciences morales différent des autres par la nature des faits qui en sont l’objet ; elles ne peuvent en différer ni par la méthode, ni par la puissance qui est propre à la vérité. Je ne suivrai donc aucun système, je ne proposerai aucune maxime pour règle de conduite. Si, lorsqu’un savant a décrit avec exactitude les effets qui résultent de telles causes, les nations tendent à détruire les causes qui leur sont funestes et à multiplier celles qui leur sont utiles ; et si cette [I-41] tendance est un mal, ce n’est pas à la science qu’il faut en faire le reproche ; c’est à celui qui crée la puissance de la vérité, ou qui a donné à la nature humaine la tendance à laquelle elle obéit. La description des effets, et des causes qui les engendrent, n’impose, au reste, aucune obligation aux adversaires du principe de l’utilité ; après l’avoir lue et en avoir vérifié l’exactitude, ils pourront, s’il leur plaît, n’en tenir aucun compte ; ils pourront, comme auparavant, diriger leur conduite ou par leur sens moral, ou par leur sentiment intime, ou par leur intérêt bien entendu, ou par le principe de l’utilité, ou par tel autre principe qu’il leur plaira. En lisant la description des causes et des effets d’une action ou d’une loi, ils n’auront acquis qu’une seule chose, c’est de connaître d’avance les résultats de cette loi ou de cette action, et de savoir comment il faut s’y prendre pour la conserver ou pour la détruire [4].
[I-42]
Les descriptions de ce genre peuvent avoir sans doute des dangers ; c’est un défaut commun à toutes les sciences. Il est clair que le jour où un chimiste eut prouvé que telle substance, employée de telle manière, donnait la mort, tous les hommes possesseurs de cette substance eurent le moyen de s’empoisonner, ou même d’empoisonner d’autres personnes. L’analyse, appliquée à la morale et à la législation, peut aussi indiquer aux peuples le moyen de se détruire ou de se rendre misérables, si cela leur convient. Lorsqu’il leur aura été démontré, par exemple, que telle habitude énerve les organes physiques et affaiblit l’intelligence, tous ceux qui voudront produire de semblables effets sur eux- mêmes ou sur les autres, en auront un moyen assuré. De même, lorsqu’il leur aura été démontré que telle institution est un obstacle à leur prospérité, ou une cause de dégradation et de ruine, tout peuple ou tout gouvernement qui voudront obtenir quelqu’un de ces effets, en auront un moyen infaillible. Mais ces inconvénients, qui sont inévitables et qu’on rencontre dans toutes les sciences, sont fort peu dangereux ; pour qu’ils fussent à craindre, il faudrait que le penchant du genre humain le portât vers sa destruction, et s’il y était porté, ce ne sont pas les moyens d’exécution qui lui manqueraient.
Si l’application de la méthode analytique à l’étude de la morale et de la législation n’a pas [I-43] d’autre but que de faire connaître les causes et les effets des actions et des institutions humaines, on ne peut pas dire qu’elle est dangereuse, à moins de prétendre que les bonnes mœurs et les bonnes lois sont inséparables de l’ignorance et de l’erreur, et que les hommes cessent de bien se conduire et de se bien gouverner, aussitôt qu’ils connaissent les malheurs attachés à une législation et à une conduite vicieuses. J.-J. Rousseau a bien soutenu, sans en être persuadé, que le développement des sciences avait contribué à corrompre les mœurs ; mais il n’est pas allé jusqu’à soutenir qu’il fallait attribuer la corruption des mœurs à la science de la morale, et les mauvaises lois à la science de la législation. Une science ne détruit que deux choses, l’ignorance et l’erreur ; elle n’est funeste qu’à une classe de personnes, à celle qui trouve dans l’ignorance et les erreurs des hommes des moyens de vivre à leurs dépens.
Si la science de la morale et celle de la législation ne consistent qu’à décrire des faits, et à en faire voir l’enchaînement, si elles ne donnent ni préceptes ni conseils, si elles ne tracent pas les règles de nos devoirs, si elles s’abstiennent même des exhortations, à quoi peuvent-elles être bonnes ? N’est-ce pas perdre son temps que de les enseigner, ou du moins de les étudier ? On peut parler aux hommes de leurs devoirs, lorsqu’on est l’interprète d’une volonté supérieure, qui leur en a tracé les règles. Ainsi, je conçois qu’un ministre de la religion qui parle au nom de la divinité ; un magistrat qui parle au nom des lois de son pays ; un père qui parle à ses enfants au nom de l’autorité qui lui est propre, enfin, un supérieur qui parle à ses subordonnés, leur tracent des devoirs et en exigent l’accomplissement. Mais à quel titre, au nom de quelle autorité, un homme qui étudie une science s’aviserait-il d’imposer des devoirs à ses semblables, de leur tracer des règles de conduite, de leur donner des conseils, de leur faire des exhortations ? Un savant qui fait des recherches sur les causes, la nature et les conséquences des actions ou des institutions humaines, n’a pas plus d’autorité sur les peuples, que n’en a sur les classes industrielles un homme qui fait des recherches sur la mécanique. L’un et l’autre peuvent décrire les phénomènes relatifs aux sciences dont ils s’occupent ; l’un et l’autre doivent exposer les conséquences d’un bon ou d’un mauvais procédé ; mais il n’appartient pas plus au premier qu’au second de parler de devoirs.
Il est des personnes qui se hâteront peut-être de conclure de là, qu’en traitant ainsi les sciences morales, elles sont inutiles si elles ne sont pas funestes. Je ne serais même pas étonné que ce reproche me fût adressé par les mêmes écrivains qui considèrent l’utilité comme l’ennemi le plus dangereux de la morale, et qui croient que genre humain a été perdu le jour où il a commencé à consulter son intérêt bien entendu. Ces écrivains sont des hommes difficiles à contenter : si l’on écarte les considérations d’utilité, ils se plaignent de ce qu’on dit des choses inutiles ; si l’on juge des choses par l’utilité dont elles sont, on est accusé par eux de corrompre les mœurs. Il est impossible d’écrire sur les sciences morales, et d’échapper à l’une et à l’autre de ces deux accusations. Je vais tâcher cependant, au risque d’encourir le dernier reproche, de prouver qu’en réduisant à l’observation des faits les sciences de la morale et de la législation, elles ne sont point inutiles. J’examinerai ailleurs si les autres manières de traiter les mêmes sciences peuvent produire de plus grands avantages, ou même s’il peut exister d’autres manières de les traiter.
Il est évident, pour tout homme qui a étudié les mœurs et les institutions des peuples, depuis leur état le plus grossier jusqu’au dernier degré de civilisation auquel ils sont parvenus, qu’à mesure qu’ils se sont éloignés des temps de barbarie, à mesure qu’ils sont devenus plus éclairés et plus industrieux, leur morale et leur législation se sont perfectionnées, et que ceux que des circonstances accidentelles ont retenus ou replongés dans l’ignorance, sont aussi ceux qui ont été les plus corrompus et qui ont eu les plus mauvaises lois. Les hommes qui ont lu avec quelque attention les descriptions que les historiens et les voyageurs, nous ont données des mœurs et des lois des nations anciennes et modernes, n’ont pas besoin qu’on leur démontre cette proposition ; quant aux autres, ils en trouveront la démonstration dans le cours de cet ouvrage. Je me bornerai ici à faire une exposition générale de ce phénomène, et à en rechercher les principales causes.
Si nous comparons entre eux les peuples que nous connaissons, quels sont ceux chez lesquels nous trouverons les plus adonnés à l’intempérance, à la perfidie, à la vengeance, à la cruauté, au vol, au mépris des engagements, à l’oppression envers les femmes, les enfants et tous les êtres faibles ? Ne sont-ce pas d’abord les peuples les plus sauvages, les hordes qui vivent dans les forêts de l’Amérique, dans les déserts de l’Afrique, ou dans les îles des mers du sud ? N’est-ce pas ensuite chez les nations que le despotisme a replongées dans la barbarie et ramenées en quelque sorte à l’état sauvage, que tous les mêmes vices se développent ? Serait-il possible de trouver chez une nation sauvage un seul vice qui n’appartienne pas à une nation que l’esclavage a abrutie ? La cruauté, la trahison, l’intempérance, la vénalité, la perfidie, et les autres vices qui se manifestent au sein des palais asiatiques, ne sont-ils pas les mêmes que ceux auxquels se livrent les hordes les plus sauvages ?
Si nous comparons les peuples anciens aux peuples modernes les plus avancés dans la civilisation, nous trouverons entre les uns et les autres les mêmes différences. En lisant dans notre enfance l’histoire de quelques hommes célèbres de l’antiquité, nous prenons l’habitude d’attribuer aux populations entières les vertus d’un très petit nombre d’individus. Nous ne remarquons pas que ces vertus ont dû frapper d’autant plus les historiens, qu’elles étaient moins communes, et que les éloges accordés à quelques grands hommes sont la satire des nations dont ils faisaient partie. Nous admirons la chasteté d’un général qui ne fait pas violence à ses captives, et la probité d’un administrateur qui ne vole pas le trésor public, comme si nos mœurs ou nos usages rendaient de tels procédés bien extraordinaires ! comme si nous étions habitués à considérer comme des prodiges ceux de nos généraux qui n’ont fait violence à aucune femme, après la victoire, ou qui ne se sont pas enrichis par le pillage des nations vaincues !
Mais sans vouloir rabaisser le mérite de quelques hommes célèbres de l’antiquité, ce n’est pas en comparant entre eux un petit nombre d’individus, qu’on peut juger des mœurs des nations. Il faut examiner quelles étaient chez les anciens les mœurs générales des diverses classes de la population, et les comparer aux mœurs des mêmes classes chez des nations plus éclairées. Or, en les jugeant de cette manière, tout l’avantage est du côté des peuples dont les facultés intellectuelles ont été les plus développées. Est-il chez les peuples un peu civilisés de l’Europe, un gouvernement qui use envers la population, de plus d’impostures et de fourberies que le sénat de Rome envers le peuple romain ? Est-il en Europe une population plus avide et plus vénale que ne le fut la population romaine, aussitôt qu’il se trouva des hommes assez riches pour la payer ? Est-il dans le monde entier une aristocratie plus disposée à s’enrichir par le pillage et les rapines, que ne le fut l’aristocratie romaine, depuis son origine jusqu’à son anéantissement ? Est-il, même chez les peuples les moins éclairés, une armée aussi avide de pillage avant le combat, aussi féroce après la victoire, que les armées romaines depuis le commencement jusqu’à la fin de la république ? Est-il chez les modernes une population qui ait jamais pris, à voir verser le sang humain, le même plaisir que le peuple de Rome ? Est-il, enfin, un peuple qui se soit abandonné avec moins de retenue à des plaisirs plus crapuleux, lorsque le pillage des nations lui en eut fourni les moyens ?
Si, portant nos regards sur une des nations de l’Europe moderne, nous comparons les mœurs qui ont existé aux diverses époques de son histoire, nous trouverons exactement les mêmes différences que nous remarquons lorsque nous comparons des nations entre elles. Nous verrons les vices décroître à mesure que les intelligences se développent ; nous les verrons se restreindre graduellement dans les classes de la société qui restent les plus étrangères aux progrès de l’esprit humain. Il y a peu de siècles, les crimes et les vices qui offensent le plus la société, se faisaient principalement remarquer dans cette partie de la population qui, dans tous les pays, est le plus en évidence. Les meurtres, les vols, les violences de toutes les espèces, enfin les vices que nous jugeons aujourd’hui les plus bas, semblaient appartenir exclusivement à la partie dominante de la population, non que les mœurs des autres classes fussent meilleures, mais on jugeait qu’elles ne valaient pas la peine d’être observées. On ne trouve presque aucune différence entre les mœurs qui régnaient en Europe au Moyen-âge, et les mœurs des barbares qui peuplent la côte occidentale d’Afrique. À mesure que les lumières se sont répandues, que l’industrie a fait des progrès, les vices et les crimes se sont restreints dans un cercle plus étroit. Les annales judiciaires de France et d’Angleterre prouvent que, dans le dernier siècle, une grande partie des criminels appartenaient encore à la classe moyenne et à la classe élevée de la société. Aujourd’hui, si l’on fait exception des crimes politiques, que les lois n’atteignent pas, rien n’est plus rare que de rencontrer des criminels dans l’une ou l’autre de ces classes : ils sortent presque tous des derniers rangs de l’ordre social. Non seulement les crimes sont devenus moins communs ; ils sont aussi devenus moins atroces : on les trouve rarement accompagnés de ces cruautés froides et réfléchies, si communes chez [I-50] les peuples du Moyen-âge et dans les cours asiatiques.
Les lois ont généralement fait les mêmes progrès que les mœurs. Quelque éloignées qu’elles soient encore de la perfection, elles ont fait d’immenses progrès depuis deux siècles. Dans presque tous les pays de l’Europe, elles fixent mieux l’état des individus et des familles ; elles garantissent mieux la sûreté des personnes et des propriétés contre les atteintes privées ; elles font mieux exécuter les conventions, assurent mieux aux propriétaires la disposition de leurs biens, et en règlent la répartition, entre les membres des familles, d’une manière plus équitable ; enfin, la justice s’administre d’une manière plus régulière, soit en matière criminelle, soit en matière civile. Les pays les moins industrieux et les moins éclairés, tels que la Russie, la Pologne, l’Espagne et l’Autriche, sont aussi les pays où la législation est restée la plus vicieuse. Les pays où les lumières ont fait le plus de progrès, tels que l’Angleterre, la France, les Pays-Bas et une partie de la Suisse, sont ceux où elle est la plus avancée. Ce n’est pas à la différence qui peut exister entre les cours, qu’il faut attribuer ce perfectionnement ; car elles ont toutes et les mêmes lumières et les mêmes mœurs [5].
[I-51]
Les progrès de la morale et de la législation, en Europe, étant incontestables, il reste à savoir quelles en ont été les causes. L’esprit de système est naturellement porté à attribuer tous les événements heureux à un principe unique, et tous les événements funestes à tout ce qui est contraire à ce principe. Ainsi, je ne doute pas que quelques personnes n’attribuent à la religion chrétienne tous les progrès qui ont été faits en morale et en législation, et qu’ils n’attribuent à l’incrédulité tous les vices et tous les crimes qui ont existé, sans songer que la religion chrétienne était au Moyen-âge ce qu’elle est aujourd’hui ; que les peuples du temps des croisades avaient au moins une foi aussi robuste que les peuples de nos jours, et que toutes les nations de l’Europe n’ont pas fait les mêmes progrès, quoiqu’elles aient eu le même évangile. D’autres attribueront les progrès des mœurs uniquement à l’accroissement des richesses et à l’aisance qui en est la suite, oubliant que les Romains, dans les derniers temps de leur république, étaient beaucoup plus riches que leurs ancêtres, sans valoir cependant beaucoup mieux. D’autres enfin attribueront ce phénomène au triomphe du sens moral ou du sentiment religieux, sans se mettre en peine de nous expliquer ce que c’est que ce sens ou ce sentiment, ou de rechercher quelles sont les causes qui en ont amené le triomphe.
Une multitude de causes ont contribué au perfectionnement des mœurs et des lois ; celui qui voudrait les exposer toutes serait obligé de faire l’histoire de la civilisation, et de tracer le tableau de toutes les connaissances humaines ; car toutes y ont plus ou moins concouru. Je ne prétends donc point attribuer ce perfectionnement à un seul principe : tout ce que je me propose ici est de faire voir comment la connaissance que nous avons des causes et des résultats des habitudes et des institutions humaines, agit sur le perfectionnement des unes et des autres.
Faire l’application de la méthode analytique à une action, à une habitude, à une loi, c’est, avons-nous dit, exposer clairement et avec méthode les causes, la nature et les effets de cette action, de cette habitude ou de cette loi. Mais quel peut être sur les esprits le résultat de cette exposition ? Nous pouvons répondre, sans hésiter, que, si le mal produit excède le bien, l’action, l’habitude ou la loi, sera généralement condamnée, et qu’elle sera, au contraire, approuvée, si c’est le bien qui excède le mal. Car, en considérant une nation dans son ensemble, on ne la voit pas agir différemment des individus : elle réprouve ce qui la blesse ; elle applaudit à ce qui lui est utile. Mais comme une action, une habitude et une loi, produisent en général un mélange de biens et des maux ; comme ces biens et ces maux n’arrivent pas simultanément, et ne se répartissent pas d’une manière égale sur tous les hommes, les jugements que chaque individu porte de la cause qui les engendre, doivent être divers. Or, c’est de ces jugements qu’il faut faire voir l’influence : prenons pour exemple l’intempérance, habitude qui a été commune à tous les peuples barbares lorsqu’ils ont eu le moyen de s’y livrer, et que nous voyons disparaître peu à peu de chez toutes les nations de l’Europe.
Cette habitude produit incontestablement un mélange de biens et de maux, ou, si l’on veut, des plaisirs et des peines. Les effets qui en résultent n’arrivent pas en même temps : les uns sont éprouvés à l’instant même de l’action, les autres ne se font souvent ressentir que plus tard. Ils se répartissent sur plusieurs personnes, mais ne les affectent pas de la même manière. Si cette habitude n’est appréciée que par les effets immédiats qu’elle produit ; si, faute de jugement ou de prévoyance, les effets ultérieurs n’en sont pas observés ou sont attribués à d’autres causes, elle sera considérée comme bonne. On sera d’autant plus disposé à s’y livrer, qu’elle sera condamnée par un plus petit nombre de personnes ; on la considèrera comme honorable, et l’on se fera un mérite de pouvoir impunément s’y livrer, si personne ne la désapprouve. C’est ce que nous avons vus, il n’y a pas bien longtemps, dans presque tous les États de l’Europe, et ce qu’on trouverait peut-être encore dans quelques-uns.
Mais si un moraliste, soumettant cette habitude à l’analyse, expose tous les effets, en bien et en mal, qu’elle produit ; si, après avoir décrit, d’un côté, les plaisirs qui en résultent pour celui qui s’y livre, et pour ceux qui lui vendent les objets de ses consommations, il décrit, d’un autre côté, les maux qui en sont les conséquences ; s’il fait voir comment elle affaiblit les facultés intellectuelles et morales de celui qui s’y abandonne ; comment elle altère ses organes physiques, et le rend incapable de se livrer à aucun travail soutenu, soit de corps, soit d’esprit ; comment, en même temps qu’elle multiplie ses besoins, elle lui fait perdre les moyens de les satisfaire ; comment elle prive sa femme, ses enfants, ses vieux parents, de leurs moyens d’existence, et de l’appui qu’ils trouvaient en lui ; comment elle détruit la confiance qu’il leur inspirait, détruit leurs affections, et les rend victimes de sa brutalité ; comment elle les expose à périr de misère ou à se livrer à des vices honteux ; comment elle nuit enfin, non seulement à lui et à sa famille, mais à tous ceux qu’il entraîne par son exemple, et à ceux auxquels il aurait été utile s’il n’avait pas contracté un semblable vice : il est clair qu’on ne portera plus de cette habitude le même jugement ; elle sera d’abord décidément réprouvée par tous ceux qui, ne trouvant aucun avantage à ce qu’elle soit satisfaite, auront à supporter une partie des mauvais effets qu’elle produit ; elle sera condamnée, en second lieu, par ceux mêmes qui croiront n’avoir point à en souffrir, s’ils n’ont aucun avantage à y trouver ; car, lorsqu’une habitude ou une action produisent des effets évidemment funestes, tous les hommes qui ne peuvent pas prendre part aux plaisirs qui en résultent, s’accordent généralement à la condamner ; enfin, celui-là même qui l’aura déjà contractée, cessera de la croire bonne, quand il verra bien clairement tous les effets qu’elle produit, soit sur lui-même, soit sur les autres ; il pourra s’y livrer encore, mais ce sera en la condamnant, et il empêchera, s’il se peut, sa femme ou ses enfants de suivre son exemple.
Appliquée à une habitude d’un autre genre, l’analyse produira des effets analogues. Si, par exemple, on y soumet l’habitude de l’économie, qui n’est guère moins décriée chez les peuples à demi barbares, que l’intempérance n’est approuvée, on aura encore à décrire deux séries de faits. Dans la première, se trouveront les maux qui résultent de certaines privations ; dans la seconde, les avantages qui résultent de la cumulation des richesses. Les privations seront ressenties par l’individu même qui aura contracté cette habitude ; en partie par les membres de sa famille, et surtout par les individus qui auraient pu espérer de profiter de sa prodigalité. Mais les avantages seront également éprouvés par sa famille ; ils le seront de plus par tous les individus dont l’industrie ne peut être mise en œuvre que par la cumulation des capitaux ; ces avantages seront plus étendus, plus durables, et se répandront sur un plus grand nombre de personnes, que les privations au prix desquelles ils seront achetés. Dans ce cas, comme dans le précédent, l’effet d’une description complète de tous les résultats de cette habitude sera de la faire approuver, en premier lieu, de tous ceux pour lesquels elle produira des biens sans mélange de maux ; en second lieu, de tous ceux qui y trouveront plus d’avantages que d’inconvénients ; et, enfin, de tous ceux qui croiront n’y avoir aucun intérêt, mais qui, en même temps, n’en éprouveront aucun dommage.
Ainsi, le premier effet de l’analyse appliquée à la morale est de diviser en deux classes les actions ou les habitudes humaines ; de mettre d’un côté celles qui produisent pour l’humanité plus de biens que de maux, et de placer de l’autre celles qui produisent plus de maux que de biens. Le second effet est de faire réprouver les actions malfaisantes par toutes les personnes à qui elles nuisent, même par celles qui n’en souffrent pas, mais qui ne peuvent pas en profiter. Toutes les fois, en effet, qu’il devient évident qu’une action ou habitude produit plus de maux que de biens, le public la classe naturellement au rang des actions ou des habitudes vicieuses ou réprouvées. Ceux qui auparavant s’y livraient publiquement et avec une sorte d’ostentation, en deviennent honteux. S’ils s’y abandonnent encore, c’est en secret ; si on leur impute une telle habitude, ils s’en défendent, ou cherchent à s’excuser sur des circonstances particulières ; s’ils ne peuvent pas se corriger, ils font en sorte du moins que leurs enfants ne les imitent pas. Lorsque, au contraire, l’analyse a pour effet de faire voir qu’une habitude ou une action, auparavant jugée indifférente ou même funeste, produit pour le genre humain plus de biens que de maux, le public la fait passer au rang des actions ou des habitudes vertueuses ou approuvées. Ceux qui ne s’y livraient qu’en secret cessent d’en être honteux ; ceux mêmes qui ne l’ont point se vantent souvent de la mettre en pratique, et font en sorte de la faire contracter à leurs enfants, ou du moins de leur en donner les apparences. C’est là le troisième résultat de l’emploi de l’analyse.
Il ne faut pas s’imaginer cependant que l’exposition des effets d’une habitude vicieuse ou d’une habitude vertueuse, suffise pour détruire la première ou pour établir la seconde, si les causes qui ont produit l’une ou qui s’opposent à l’établissement de l’autre, continuent d’exister. L’intempérance et la prodigalité, par exemple, ne sont pas produites seulement par l’ignorance des effets qui en résultent : elles le sont aussi par les dangers continuels auxquels sont exposées ou les propriétés ou les personnes. L’individu à qui rien ne garantit la jouissance du fruit de ses travaux, cesse de travailler, ou consomme immédiatement ce qu’il a produit : chez lui, la paresse, l’intempérance et la prodigalité sont de la prévoyance. De même, celui qui se voit exposé sans cesse au danger de perdre la vie, est peu touché par la description des maux physiques ou moraux qu’engendrent les mauvaises habitudes : pour lui il n’y a de sûr, dans ce monde, que le présent. Il y a peu de soldats que la crainte de la goutte rende tempérants la veille d’une bataille ; et les sauvages ou les esclaves s’imposent peu de privations pour enrichir leurs héritiers. Il ne suffit donc pas, pour faire faire des progrès à la morale et à la législation, d’exposer les conséquences des mauvaises lois et des mauvaises mœurs ; il faut de plus en indiquer les causes, et montrer comment ces causes peuvent être détruites. Si l’on se borne à en exposer les effets, on tourne contre elles le sentiment qui porte la nature humaine vers sa conversation et sa prospérité ; mais, quelle que soit la force de ce sentiment, il ne saurait détruire ce qui, de sa nature, est indestructible ; et il faut considérer comme tel tout effet dont on n’attaque point la cause, même quand cet effet est un vice [6].
Si l’on faisait l’histoire des habitudes humaines, en remontant jusqu’à l’état sauvage, et descendant jusqu’aux époques où la civilisation a fait le plus de progrès, on trouverait qu’elles ont changé de caractère, à mesure que les effets en ont été mieux constatés, et les causes mieux connues. Les premières actions qui ont été mises au rang des actions criminelles, sont celles qui ont pu produire le moins de bien, et dont les mauvais effets ont été les plus évidents. Ainsi, le meurtre et l’assassinat ont été réprouvés comme funestes, même par les peuples barbares ; mais ces faits n’ont pas eu le même caractère qu’ils ont aujourd’hui. On les a considérés comme n’intéressant que les parents ou les amis des personnes assassinées ; l’on a pu s’y livrer sans déshonneur, et sans courir d’autre risque que de payer une compensation, ou d’être exposé à des représailles. Les atteintes à la propriété n’ont pas été envisagées sous un point de vue différent ; voler des marchands allant en foire, dévaliser des voyageurs, ou rançonner des juifs, étaient des faits qui ne déshonoraient pas les hommes puissants, il y a peu de siècles. Sous le règne même de Louis XIV, tromper au jeu n’était pas une action déshonorante dans la bonne société.
On trouve, il est vrai, que des peuples barbares ont prononcé des châtiments très sévères contre des actions qu’on punit aujourd’hui moins cruellement. Les Germains punissaient de mort la femme coupable d’adultère ; et, dans le Moyen-âge, les hommes qui n’appartenaient pas à la caste dominante n’étaient pas traités moins sévèrement, pour des faits qui n’étaient pas plus graves. Mais cette sévérité était le résultat, non de la haine qu’inspirait le vice, mais du mépris qu’on avait pour les femmes et pour les hommes asservis, mépris qu’on rencontre chez les peuples sauvages ou barbares de tous les pays.
Quelles sont encore aujourd’hui, parmi nous, les habitudes vicieuses les plus communes ? Ce sont celles dont les effets bons et mauvais n’ont pas été clairement exposés ou parfaitement compris ; celles sur lesquelles l’opinion des hommes est indécise, et celles surtout dont les causes n’ont pas été détruites. Mais faites perdre à ces habitudes, par une analyse rigoureuse, le caractère douteux qu’elles conservent ; mettez le public à même d’en voir clairement tous les effets, et elles rentreront aussitôt dans le rang auquel elles appartiennent ; elles seront considérées comme des vices par tous ceux qui en souffrent, et ceux qui en profitent cesseront de les avouer. Sans doute, elles existeront encore chez un grand nombre d’individus, si l’on n’en connaît pas les causes, ou si l’on n’a pas le moyen de les faire cesser ; mais les personnes qui en seront atteintes seront obligées de se cacher ; elles perdront l’appui que leur prête l’ignorance publique, et la nécessité d’agir dans l’isolement leur fera perdre le moyen d’avoir des complices. S’il était démontré, par exemple, que la corruption d’un électeur ou d’un député par un ministre, produit, pour une nation, des effets infiniment plus funestes que la corruption d’un magistrat par un individu qui veut obtenir de lui un jugement inique, le premier genre de prévarication serait tenu plus secret encore que le second, et la nécessité du secret suffirait souvent pour rendre le fait impossible.
Telle est, dans la morale, la puissance d’une opinion dont la vérité est incontestée, qu’un individu qui avoue une action évidemment mauvaise, sans alléguer aucune excuse pour s’en justifier, nous paraît, ou un insensé, ou une espèce de monstre ; et que celui qui veut commettre une action malfaisante, ou entraîner quelqu’un de ses semblables à y participer, cherche toujours à prouver qu’il a quelque bonne raison : il ne peut devenir un malfaiteur qu’en commençant par être un sophiste.
Les effets que produit sur les lois l’application de la méthode analytique sont aussi grands et plus incontestables encore que les effets qu’elle produit sur les mœurs. Pour exposer complètement les premiers de ces effets, il faudrait donner l’histoire de tous les perfectionnements que la législation a éprouvés dans tous les pays. Qu’est-ce, en effet, qui a déterminé quelques-uns des gouvernements d’Europe à faire disparaître de la législation civile ou pénale de leur pays, un grand nombre de dispositions malfaisantes ? Qu’est-ce qui a fait cesser le secret des procédures, abolir la torture, diminuer les peines, établir la liberté de la défense ? Qu’est-ce qui a fait sortir de la classe des crimes, des faits imaginaires, des opinions innocentes, la sorcellerie et l’hérésie ? Qu’est-ce qui a fait cesser les persécutions religieuses, abroger les lois contre les étrangers, abolir les confiscations ? N’est-ce pas l’exposition des effets produits sur la société par la législation ? En d’autres termes, n’est-ce pas l’application de la méthode analytique ? Je ne voudrais rabaisser l’importance d’aucune discussion politique, offenser l’amour-propre d’aucun parti ; mais j’avoue que les discussions sur l’origine des pouvoirs, sur le droit divin ou sur la souveraineté du peuple, ne m’ont jamais paru avoir des effets bien considérables sur la législation ou sur les mœurs. Jamais Beccaria n’eût produit une révolution dans la législation criminelle, si, au lieu d’exposer les effets de quelques lois vicieuses, il se fût borné à nous donner le développement de ses principes sur le droit de punir ; et les discussions auxquelles ont donné lieu, dans le dernier siècle, quelques procédures célèbres, ont fait faire plus de progrès à la science que le Contrat social.
Ainsi, la méthode analytique agit dans les sciences morales de la même manière qu’elle agit dans les autres. Elle ne donne ni préceptes, ni conseils ; elle n’impose ni devoirs ni obligations ; elle se borne à exposer les causes, la nature et les conséquences de chaque procédé. Elle n’a pas d’autre force que celle qui appartient à la vérité. Mais il faut bien se garder, pour cela, de croire qu’elle soit impuissante ; l’effet qu’elle produit est, au contraire, d’autant plus irrésistible qu’elle commande la conviction. Lorsque des savants ont eu découvert la puissance de certaines machines, l’efficacité de certains remèdes, il n’a pas été nécessaire, pour les faire adopter, de parler de devoirs, ou de faire usage de la force ; il a suffi d’en démontrer les effets. De même, en morale et en législation, le meilleur moyen de faire adopter un bon procédé, et d’en faire abandonner un mauvais, est de montrer clairement les causes et les effets de l’un et de l’autre. Si nous sommes exempts de certaines habitudes vicieuses, et si nous avons vu disparaître quelques mauvaises lois, c’est à l’emploi de ce moyen que nous devons l’attribuer. Les mauvais gouvernements en connaissent si bien la puissance que tous leurs effets ne tendent qu’à l’empêcher.
On a fait aux philosophes qui ont mis au jour les causes et les effets d’un certain nombre de lois, un reproche grave ; on les a accusés d’avoir tout détruit et de n’avoir rien su fonder. Ce reproche a fait même une telle impression, que des écrivains dont on ne peut soupçonner les intentions, se sont empressés de déclarer qu’il était temps d’abandonner la critique, et de prendre le rôle de fondateurs : nos prédécesseurs, ont-ils dit, ont démoli le vieil ordre social ; c’est à nous qu’il appartient de construire le nouveau. D’autres écrivains, d’une opinion différente, se sont également prononcés, contre la critique ; ils ont aussi reproché aux philosophes du dernier siècle, d’avoir tout détruit et de n’avoir rien su construire ; mais ceux-ci, au lieu de vouloir fonder un édifice nouveau, ont prétendu qu’il fallait rétablir les anciennes ruines.
[I-65]
Il y a dans quelques-uns de ces reproches une apparence de modération qu’on est très disposé à considérer comme de la sagesse. Des hommes qui viennent se placer entre deux partis, dans la vue de les mettre en paix, et qui les condamnent en même temps l’un et l’autre, ont un air d’impartialité et de supériorité très propre à séduire la multitude. Je doute cependant que ceux qui font ce reproche, et ceux qui le croient fondé, sachent bien en quoi il consiste. Entendent-ils proscrire l’étude des faits ? S’imaginent-ils que pour détruire une loi malfaisante, il faut s’abstenir d’en rechercher les causes, d’en examiner les résultats ? S’ils ne proscrivent pas l’étude des faits, veulent-ils nous faire considérer seulement ceux qui sont de même nature ? Faut-il ne voir, en faisant l’analyse d’une habitude, d’une action ou d’une loi, que les plaisirs ou les biens qui en résultent, et s’abstenir d’en examiner les mauvaises conséquences ? Veulent-ils arriver au perfectionnement de la législation et de la morale, en remplaçant des lois par d’autres lois, des habitudes par d’autres habitudes, sans avoir examiné les conséquences des lois et des habitudes qu’on abandonne, ni les conséquences de celles par lesquelles on les remplace ? Croient-ils, enfin, leurs idées tellement justes, leurs projets si essentiellement bons, que les races futures n’aient rien à y changer ? Voudraient-ils nous insinuer qu’ils sont arrivés aux derniers termes de la perfection, et qu’il ne reste plus au genre humain qu’à jouir en repos du produit de leurs veilles ? Si, à cet égard, leur modestie n’est pas un obstacle à leur conviction, ils ont encore tort de proscrire le raisonnement ; car, lorsqu’on est sûr d’avoir découvert la vérité, on provoque l’examen, mais on ne commande pas la foi.
Le reproche fait à la critique d’avoir tout détruit et de n’avoir rien fondé, est d’autant plus mal appliqué, qu’en morale et en législation, ces deux choses sont presque toujours inséparables. Les philosophes qui sont parvenus à détruire le secret des procédures, ne sont-ils pas les fondateurs de la publicité ? Ceux qui ont fait abolir la torture, n’ont-ils pas garanti d’un horrible supplice tous les hommes injustement accusés ? Ceux qui ont brisé les entraves qui résultaient, dans l’intérieur des États, d’une multitude de lois fiscales, n’ont-ils pas fondé la liberté du commerce ? Ceux qui ont fait abolir les corporations, les jurandes, les maitrises, n’ont-ils pas fondé la liberté de l’industrie ? Celui qui parviendrait à détruire tous les liens dans lesquels le despotisme enlace les hommes, ne serait-il pas le fondateur de la liberté ? À entendre les reproches adressés aux écrivains qui sont parvenus à nous faire voir les vices de quelques institutions, on dirait qu’on est convenu de ne compter pour rien les avantages que le public a retirés de son affranchissement, et qu’il ne faut voir que la perte que les peuples ont faite, quand des codes funestes sont restés sans force entre les mains de ceux qui en étaient possesseurs, ou qui en faisaient l’application.
Il est vrai que les philosophes n’ont pas seulement détruit des institutions, mais qu’ils ont aussi détruit de fausses opinions ou de fausses croyances ; on ne croit plus à la sorcellerie, et on n’attribue pas à un esprit malfaisant la plupart des phénomènes de la nature. Mais quand on détruit une erreur, ne fonde-t-on pas la vérité contraire ? Quand on détruit un vice, ne fonde-t-on point par cela même une vertu ? Prouver, contre l’opinion commune, que tel effet n’est pas produit par telle cause, n’est-ce pas tarir une source d’erreurs et faciliter la découverte de la vérité ? Si jamais la médecine faisait assez de progrès pour extirper les germes de toutes les maladies, les médecins encourraient-ils une grande responsabilité ? Faudrait-il les accuser d’avoir tout détruit, et de n’avoir rien su fonder ? Faudrait-il penser que les maladies de l’esprit humain méritent des égards particuliers qu’on ne doit pas aux maladies physiques ? Ou croirait-on qu’on a déjà fait tant de progrès, qu’il n’existe plus ni erreur, ni vices, ni mauvaises lois [7] ?
Tous les reproches adressés à quelques philosophes ; d’avoir fait remarquer les conséquences funestes de certaines institutions, peuvent également être adressés à la méthode analytique ; puisque cette méthode consiste principalement à exposer les conséquences bonnes et mauvaises des institutions et des lois humaines, ou à faire voir la liaison des effets et des causes. Cependant on ne pourrait proscrire l’emploi de cette méthode des sciences morales, sans proscrire par cela même l’étude des faits, c’est-à-dire les sciences elles-mêmes. Car on ne saurait mettre au nombre des sciences la connaissance de certaines opinions ou de certains systèmes, lors même que ces opinions ou ces systèmes seraient exposés dans de gros livres, avec un appareil plus ou moins scientifique.
Des esprits timides et bien intentionnés, tout en reconnaissant que l’analyse a produit de bons effets dans un grand nombre de cas, craignent qu’elle n’en produise de mauvais, si on l’applique à toutes nos habitudes et à toutes nos institutions. Il est, disent-ils, des institutions et des habitudes sur lesquelles l’opinion des peuples est hautement prononcée. Toutes les fois que le jugement qui en a été porté est juste, à quoi bon les remettre en question ? Ne vaut-il pas mieux s’en tenir à ce qui a été décidé, que de compromettre par un nouvel examen les conquêtes qu’on a déjà faites ?
Les personnes qui raisonnent ainsi, ressemblent à ces plaideurs qui n’ont qu’une médiocre confiance dans les lumières et l’intégrité de leurs juges, et qui ont obtenu un triomphe inespéré. La pensée des dangers qu’elles ont courus les fait trembler : elles ne peuvent supporter l’idée d’un appel qui les exposerait à perdre ce qu’elles ont gagné. Si on pouvait leur garantir qu’elles ne seront pas dépouillées de ce qu’elles ont acquis, elles consentiraient volontiers à l’abolition des tribunaux, pour n’avoir plus à craindre de jugements.
L’application de la méthode analytique paraît également dangereuse aux hommes qui ont imaginé ou adopté des systèmes ; elle peut détruire les conceptions des uns, et effacer la science des autres. Lorsqu’on a passé la partie la plus considérable de sa vie à combiner certaines idées, du succès desquelles on a fait dépendre le bonheur du genre humain en même temps que sa propre réputation, il est fâcheux de s’apercevoir tout à coup que le travail auquel on s’est livré se réduit à un simple arrangement de mots ; il ne l’est pas moins d’avoir employé sa vie à se meubler l’esprit de faux systèmes, et de découvrir qu’on ne sait rien, lorsqu’on s’imaginait avoir acquis des titres à la qualité de savant.
Enfin, il est une troisième classe de personnes qui considèrent comme dangereuse l’application de la méthode analytique ; ce sont celles qui jouissent, dans l’ordre social, de certains avantages funestes à leurs semblables, et qui craignent de voir compromettre leurs possessions par un examen impartial. Ce sont ordinairement les personnes de cette dernière classe qui se prononcent avec le plus d’énergie contre toute recherche, et qui excitent les alarmes de la première. Si on veut les en croire, rien n’est plus propre à propager le vice que d’en faire voir les causes et les conséquences, et à ébranler la vertu que d’en examiner les effets. Pour que les bonnes institutions soient durables, il faut que les peuples n’en voient pas les résultats ; pour se mettre à l’abri des mauvaises lois, il faut s’abstenir de regarder ce qu’elles produisent. Enfin, l’examen des faits et de leurs conséquences n’est propre qu’à ébranler les droits anciennement établis, et il est des choses qui ne doivent pas être mises en question quand on tient à la tranquillité des peuples.
C’est ainsi que parlent, dans tous les pays, les hommes qui profitent des abus ; et c’est probablement de la même manière que parleraient, s’ils avaient la parole, des loups qui se seraient introduits, pendant la nuit, au sein d’une bergerie : Gardez-vous, diraient-ils, de porter ici la lumière, si vous voulez ne pas troubler la sécurité du troupeau.
Je ne sais s’il existe, en effet, des choses qui ne doivent pas être examinées quand on tient à la tranquillité des peuples ; mais ceux qui repoussent l’examen ne veulent pas sans doute nous faire croire que ces choses-là sont funestes à l’espèce humaine. Si les faits qu’on nomme des droits anciennement établis, ne produisent que d’heureuses conséquences, l’examen ne peut que leur être favorable ; car plus l’utilité en sera démontrée, plus les peuples s’y attacheront. Si, au contraire, ils n’ont que de funestes résultats, quel motif aurait-on de les respecter et de s’en interdire l’examen ? Suffira-t-il qu’une chose nuisible ait pris le nom de droit, pour que la raison humaine doive s’arrêter devant elle ? Personne d’ailleurs ne saurait se plaindre de ce qu’en faisant abstraction de ce qu’on nomme droits, on examine les choses en elles-mêmes, et par les résultats qu’elles produisent ; car du moment qu’on écarte de la discussion les droits du plus fort comme les droits du plus faible, la condition est égale pour tous, et nul n’oserait avouer qu’il défend comme des droits des prérogatives funestes au genre humain. L’examen des faits ne peut pas avoir d’autre résultat que de faire voir ce qu’il y a de bon et de mauvais dans chaque chose, et puisqu’on s’accorde à reconnaître l’utilité des droits, on n’a rien à en redouter ; il est naturel, au contraire, que chacun le sollicite.
On redoute la faiblesse de la raison humaine ; on craint que chacun ne s’égare du moment qu’il consultera son intelligence. Mais ces craintes, qui semblent annoncer une si grande modestie chez ceux qui les éprouvent ou qui veulent nous les inspirer, ne seraient-elles pas en effet un orgueil déguisé ? Ceux qui veulent les inspirer aux autres, n’auraient-ils pas pour but de s’assurer le monopole de l’intelligence et du jugement ? Si la raison est si faible, s’il est si dangereux d’en faire usage, quel est l’instrument à l’aide duquel nous discernerons, entre cent religions qui nous sont offertes, la seule qu’il nous importe de suivre ? Quel est l’instrument à l’aide duquel nous arriverons à choisir, parmi des milliers de sectes entre lesquelles telle religion s’est divisée, celle d’entre elles qui n’a exclu aucune vérité, ou qui s’est garantie de toute erreur ? Et si, en de pareilles matières, il est impossible à chacun d’avoir un guide plus sûr, plus impartial, plus intéressé à ne pas se tromper, que sa propre intelligence, comment serait-il possible d’en avoir un meilleur dans des questions de législation ou de morale ?
Mais si l’égoïsme, la vanité, la paresse et la peur font repousser des sciences morales l’application de la méthode analytique, il ne faut pas croire que toutes les craintes qui se manifestent à cet égard soient le résultat d’un préjugé ou d’un vice. Des craintes semblables peuvent être conçues par des hommes qui ne manquent ni de lumières, ni de désintéressement, et qui ne sont les protecteurs, ni des préjugés, ni de l’ignorance, ni d’aucun genre d’abus. Pour que la méthode analytique n’ait point de danger, il faut qu’elle soit employée par des hommes qui aient non seulement de la bonne foi, mais encore assez de sagacité pour savoir rapporter chaque effet à la cause qui le produit, et pour suivre tous les effets qui résultent d’une même cause ; une analyse incomplète ou vicieuse peut avoir des résultats aussi funestes que quelque système que ce soit. La même méthode qui, dans les mains d’un homme éclairé et d’un esprit droit, conduit aux découvertes les plus utiles, peut conduire aux plus funestes écarts, dans les mains d’un homme sans lumières et d’un esprit faux.
J’examinerai, dans le chapitre suivant, quelles sont, en législation et en morale, les conséquences soit d’une analyse incomplète, soit l’emploi des sophismes et des faux systèmes.
[I-74]
CHAPITRE III.↩
De l’influence qu’exerce sur les mœurs et sur les lois une analyse fausse ; ou des effets des sophismes et des faux systèmes en morale ou en législation.
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que l’application de la méthode analytique à l’étude de la morale et de la législation, a pour effet de diviser en deux classes les actions et les institutions humaines ; de mettre d’un côté celles qui produisent pour l’humanité plus de biens que de maux, et de placer de l’autre celles qui produisent plus de maux que de biens ; de faire réprouver les premières par toutes les personnes à qui elles nuisent, par celles même qui n’en souffrent pas, mais qui ne peuvent pas espérer d’en profiter, et souvent même par celles qui en profitent ; de rendre ainsi ces actions plus rares, ou de faire tomber ces institutions, en tournant contre elles l’opinion qui les soutenait, ou qui ne les condamnait pas.
Nous avons vu, de plus, que l’application de la même méthode à des actions et des institutions bienfaisantes, a pour effet de les faire approuver par toutes les personnes à qui elles peuvent être utiles, et par celles qui n’ont aucun bien direct à en espérer, si d’ailleurs elles n’ont aucun mal à en craindre ; d’affaiblir l’opposition des personnes qui ont ou croient avoir des intérêts contraires ; et de multiplier ainsi le nombre de ces actions, ou d’amener l’établissement de ces institutions. Je rendrai la même pensée en moins de termes, si je dis que l’effet de l’application de la méthode analytique à l’étude de la morale et de la législation, est de déterminer l’action de la plus grande partie du genre humain, à proscrire les habitudes ou les institutions qui lui sont funestes, et à multiplier ou à établir les habitudes ou les institutions qui lui sont avantageuses. Les hommes tendant naturellement vers leur conservation et leur développement, l’analyse a pour effet de leur faire voir quelle est la route qu’ils doivent suivre, et quelle est celle qu’ils doivent éviter.
J’ai à déterminer maintenant quels sont, dans les mêmes sciences, les effets des analyses incomplètes, des faux systèmes, des paradoxes, et enfin de toutes les erreurs, sous quelque nom qu’on les désigne. On concevra facilement qu’en me livrant à cet examen, il ne m’est pas possible de déterminer l’influence de chaque erreur en particulier ; il у a mille manières de mal raisonner, et chacune d’elles produit des effets qui lui sont propres. Il ne peut pas non plus être question ici de se livrer à l’examen de tous les faux systèmes qui ont été imaginés, et d’en suivre toutes les conséquences. Ce serait un travail qui n’aurait point de fin, et dont l’utilité ne serait pas très grande. L’unique objet que je me propose, dans ce moment, est d’exposer la manière dont les erreurs agissent d’abord sur les esprits des hommes, et ensuite sur leurs actions et sur leurs institutions.
Il serait impossible de déterminer l’influence qu’exerce une fausse analyse ou un faux système, d’abord sur les intelligences, et ensuite sur les mœurs et sur les lois, si l’on n’avait pas des idées bien exactes de la méthode à suivre dans l’exposition des sciences de la morale et de la législation. J’ai déjà fait observer que, toutes les fois qu’on procède suivant la méthode analytique, on se borne à exposer un certain genre de faits, et à faire voir comment ils naissent les uns des autres. Mais quel est l’ordre qu’il convient de suivre dans cette exposition ? Quels sont les faits qu’il convient d’exposer les premiers ? Les plus évidents, ceux que chacun est à même d’observer, et dont il n’est pas possible de contester l’existence. Il faut commencer par l’observation d’un fait tellement simple, que l’expression ne soit en quelque sorte qu’une vérité triviale. S’il s’agit de morale, par exemple, il faut décrire les caractères auxquels on reconnaît telle action ou telle habitude. S’il s’agit d’une loi, il faut décrire les faits matériels par lesquels cette loi se manifeste [8].
[I-77]
Ayant décrit avec exactitude les phénomènes les plus simples qui se présentent, il faut décrire avec la même exactitude ceux qu’ils engendrent, et ceux par lesquels ils sont engendrés. Pour trouver ceux par lesquels ils sont produits, il faut les chercher alternativement dans les hommes et dans les choses. Dans les hommes, il faut considérer leurs idées, leurs préjugés, leurs erreurs, leurs habitudes, leurs besoins, leurs passions, leur religion, leur gouvernement, et enfin l’influence qu’ils exercent les uns à l’égard des autres. Dans les choses, il faut considérer toutes les circonstances qui influent sur le nombre, les mœurs, l’industrie et la distribution de la population ; telles que la nature du sol, la température de l’atmosphère, le cours des eaux, et d’autres analogues. En procédant ainsi, on arrive à des faits primitifs ou à des phénomènes dont on ne trouve plus les causes ; là, il faut s’arrêter, parce que au-delà on ne trouve plus que des ténèbres. On peut ne pas toujours remonter jusqu’à ce qu’on arrive à des causes inexplicables ; mais il faut cependant, pour que les sciences ne soient pas des connaissances stériles, passer d’un phénomène à un autre, jusqu’à ce qu’on arrive à des faits qu’il soit en la puissance des hommes de modifier. En morale et en législation, comme en toute autre science, on n’agit efficacement qu’autant qu’on agit sur des causes. L’action qu’on exerce sur des effets est presque toujours vaine, même quand elle n’est pas dangereuse.
Les phénomènes les plus simples et ceux qui les ont engendrés étant connus, il reste à exposer ceux auxquels ils donnent eux-mêmes naissance, et à faire voir de quelle manière les hommes et les choses en sont affectés. Pour découvrir et décrire ce troisième ordre de faits, il faut encore les chercher ou dans les hommes ou dans les choses. Il faut considérer les hommes dans leurs facultés physiques, dans leurs facultés intellectuelles, et dans leurs facultés morales ou dans leurs passions. Il faut considérer les choses dans les qualités qui les rendent propres à satisfaire les besoins des hommes. Je dis des hommes, et non pas de quelques hommes ; des choses, et non pas de quelques choses ; car, lorsqu’on décrit les conséquences d’une action, d’une habitude ou d’une loi, il faut les suivre aussi loin qu’elles s’étendent, ou du moins aussi loin qu’on peut les apercevoir. Il ne peut y avoir, dans les sciences morales, pas plus que dans les sciences physiques, ni maîtres, ni esclaves, ni rois, ni sujets, ni citoyens, ni étrangers. Il ne peut y avoir que des hommes ou des agrégations d’hommes, différant entre eux par leurs habitudes, par leurs préjugés, par leurs lumières, par leurs prétentions, agissant bien ou mal les uns sur les autres, et portant des noms divers.
Ayant exposé ce que j’entends par la méthode analytique, ou plus simplement par l’analyse, on concevra facilement ce que j’entends par une analyse fausse ou infidèle : c’est ce qu’on désigne souvent par les mots sophismes, faux systèmes, faux raisonnements. Une analyse est fausse ou infidèle si elle ne décrit pas tous les caractères du fait simple qu’elle prétend faire connaître, ou si elle le décrit avec des caractères qui y sont étrangers. Elle est également fausse, si elle attribue ce fait à des causes autres que celles qui l’ont produit, ou si elle l’attribue exclusivement à certaines causes, tandis qu’elle en laisse ignorer d’autres qui y ont concouru. Enfin, elle est fausse, si elle attribue à ce fait des conséquences qu’il ne produit pas, ou si elle ne présente qu’une partie des conséquences qui en résultent, en affirmant qu’il n’en existe pas d’autres.
Il ne faut pas confondre une analyse incomplète avec une analyse fausse ou infidèle. La première n’indique qu’une partie des caractères de l’objet décrit ; mais tout ce qu’elle décrit est exact, et elle n’affirme pas qu’il n’existe point d’autres caractères que ceux qu’elle a tracés. La seconde décrit les choses autrement qu’elles ne sont, ou elle présente comme complètes des descriptions qui ne le sont pas. On est souvent obligé de se borner à des analyses incomplètes ; on peut ne pas apercevoir toutes les causes ou suivre tous les effets d’un phénomène qu’on décrit. On n’est jamais obligé de faire des analyses infidèles : il ne faut affirmer que les faits qu’on a constatés.
Après avoir déterminé ce que j’entends par une fausse analyse, il me sera facile d’en exposer les effets.
Pour déterminer les effets que produisent les faux systèmes, les sophismes ou les analyses incomplètes ou fausses, nous devons observer que toutes les actions et les institutions humaines rentrent nécessairement dans ces trois classes : plusieurs sont généralement considérées comme utiles au genre humain, d’autres sont considérées comme funestes, et d’autres comme douteuses ou comme indifférentes. Nous simplifierons le raisonnement, si nous supposons que le jugement porté par le public dans cette classification est juste ; si nous mettons de côté les actions jugées indifférentes, et si, au lieu de nous occuper en même temps des habitudes et des institutions, nous nous occupons d’abord des premières. Nous pouvons d’autant plus nous abstenir de parler des institutions, que je ne dirai rien des habitudes, qui ne puisse s’appliquer aux lois.
Supposons maintenant qu’un homme qui s’occupe de morale, prenne une des habitudes que l’opinion publique a classées au rang de celles qui sont avantageuses au genre humain, et qu’il veuille soumettre à l’analyse les effets qu’elle produit. Il peut se tromper de plusieurs manières ; il peut ne pas apercevoir une partie des maux qui en sont inséparables, et mettre au rang des effets qui en résultent, des avantages qui sont produits par une cause différente. En d’autres termes, il peut ne pas exposer les maux propres à détourner les hommes de cette habitude, et lui attribuer faussement des avantages qui sont propres à la faire contracter. Par ce procédé, il ne la fait pas sortir de la classe des habitudes vertueuses ; il ne peut pas la rendre immédiatement moins commune ; au contraire, il est probable qu’il détermine quelques personnes à la contracter ; si l’infidélité est volontaire, c’est un mensonge fait à bonne intention.
Mais il ne faut pas croire qu’une telle infidélité, dans la description des effets, ne soit suivie d’aucune mauvaise conséquence. Il arrivera que ceux qui chercheront à contracter cette habitude, sur la foi de la description des conséquences qu’on lui aura attribuées, la trouveront accompagnée de maux qu’ils n’avaient pas prévus, et dépourvue d’avantages qu’ils avaient espérés. Leur attente étant ainsi doublement trompée, ils se sentiront disposés à la repousser comme mauvaise, sans se donner la peine d’en soumettre les effets à l’examen ; la force avec laquelle ils la repousseront sera en raison de la déception qu’ils auront éprouvée. D’un autre côté, ceux qui, par un motif quelconque, voudront s’opposer à ce que cette habitude se forme, ne manqueront pas de diriger leurs attaques sur la partie fausse de la description ; et, l’inexactitude en étant prouvée, ils croiront, et feront croire qu’ils ont triomphé. Ce que peut désirer de mieux un avocat qui défend une mauvaise cause, c’est de voir son adversaire défendre la sienne par de mauvaises raisons ; car ces raisons sont pour lui des moyens d’excuse et quelquefois même de succès.
L’analyse des conséquences d’une habitude qualifiée vertueuse, ou utile au genre humain, peut être infidèle d’une autre manière. Elle peut ne pas présenter toutes les conséquences avantageuses qui en résultent, et présenter, comme des effets qui en dérivent, des maux qui sont produits par d’autres causes. Le premier effet de cette infidélité est de tirer l’habitude dont il est question de la classe des habitudes utiles ou vertueuses, et de la faire passer, ou dans la classe des habitudes douteuses, ou dans celle des habitudes funestes. Le second effet que la même infidélité produit est de corrompre les mœurs des personnes dont elle a faussé le jugement. Un exemple fera mieux comprendre la manière dont agit sur les mœurs une analyse infidèle.
Un moraliste soumet à l’analyse les effets de l’habitude de l’économie : il décrit les privations qui sont inséparables de cette habitude ; mais, lorsqu’il arrive à en faire connaître les conséquences, il n’aperçoit pas l’indépendance qu’elle donne, soit à celui qui la possède, soit à sa famille ; ou bien il ne comprend pas comment, en formant de nouveaux capitaux, elle crée des moyens de travail pour les classes laborieuses de la société. Il est évident qu’en procédant ainsi, il affaiblit les motifs qui pouvaient déterminer les hommes à contracter ou à conserver cette habitude. Nul ne consent à s’imposer des privations dont il ne peut résulter aucun avantage ; et une action dont les avantages ne sont pas aperçus par celui qui l’exécute, est pour lui la même chose qu’une action qui n’en produit aucune. D’un autre côté, les autres personnes à qui cette habitude est utile, ne voyant pas les avantages qui en résultent pour elles, cessent de la soutenir on de l’encourager ; le public lui-même n’y attache aucune importance et n’accorde aucune estime à ceux qui la possèdent. Cette habitude s’affaiblit alors de plus en plus, le nombre des personnes qui la possèdent décroît, parce qu’elle n’est plus soutenue par l’opinion, et que les privations dont elle est accompagnée exercent une action continuelle propre à la détruire.
Mais si le moraliste, après avoir laissé inaperçue une partie des bons résultats de l’économie, attribue à cette habitude des mauvais effets qu’elle ne produit pas ; s’il lui attribue l’inactivité de l’industrie, la stagnation du commerce, la misère de la classe ouvrière, il tournera contre elle l’opinion publique ; il la fera condamner par toutes les personnes qui lui attribueront une partie de leurs souffrances, et même par toutes les personnes désintéressées. Le public la fera passer alors au rang des habitudes funestes ; il la flétrira du nom de vice, et exercera son influence pour la rendre aussi rare que possible. Par une conséquence inévitable, ce sera l’habitude contraire qu’il encouragera, et qu’il fera passer au rang de celles qui sont jugées bonnes. Cependant le jugement qu’on portera de l’économie ou de la prodigalité, ne changera rien, ni à la nature, ni aux résultats de ces habitudes. Le premier continuera de produire de bons effets, mais elle sera moins pratiquée. La seconde continuera de produire des effets funestes, mais elle sera plus commune.
Telles sont les conséquences d’une fausse analyse lorsqu’elle est appliquée aux résultats d’une bonne habitude. Nous allons voir qu’elle produit des conséquences analogues lorsqu’on l’applique aux effets d’une habitude funeste.
L’analyse des effets d’une mauvaise habitude peut être défectueuse de plusieurs manières ; elle peut présenter comme en étant des conséquences, des maux qui n’en résultent pas réellement, et ne pas présenter tous les biens qu’elle produit. Cette inexactitude ou cette infidélité, laissera l’habitude dans la classe à laquelle elle appartient. Elle n’aura pas pour effet de la rendre immédiatement plus commune ; au contraire, il est possible qu’elle détermine momentanément quelques personnes à s’en abstenir. Mais elle finira cependant par produire de mauvaises conséquences : les personnes qui se livreront à cette habitude, y trouvant des jouissances qu’on avait dit ne pas y être, et n’y trouvant pas tous les maux qu’on avait dit en résulter, verront qu’on les a trompées. Elles seront d’autant plus disposées à s’abandonner à leurs penchants, que, si elles ne les considèrent pas comme vertueux, elles seront au moins très disposées à les considérer comme innocents. En exagérant les maux que produisent les mauvaises habitudes, on fournit des armes à ceux qui veulent les défendre. Il faut s’abstenir de calomnier même le vice, de peur que le public ne le prenne pour une victime, et ne finisse par s’intéresser à lui.
L’analyse des effets d’une mauvaise habitude peut être vicieuse d’une autre manière. Elle peut la présenter accompagnée de biens qu’elle ne produits pas, et ne pas faire voir les maux qui en sont la suite, ou n’en faire voir qu’une partie. L’effet que produit sur l’esprit une telle description, est de faire sortir l’habitude décrite du rang des habitudes funestes, et de la faire passer au rang des habitudes indifférentes, ou même avantageuses. On multiplie ainsi les motifs qui portent les hommes à la contracter, et l’on diminue les motifs propres à les en détourner. Ceux qui hésitaient à s’y livrer, s’y abandonnent avec confiance, d’abord parce qu’ils s’attendent à y trouver de grandes jouissances ; en second lieu, parce qu’ils ne prévoient pas les maux qui en résulteront, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres ; enfin, parce que les personnes qui en souffrent, ne voyant pas la cause de leurs maux, n’exercent sur elle aucune action pour la faire cesser. Ainsi, l’analyse infidèle des effets d’une mauvaise habitude, tend nécessairement à la rendre plus commune et à détruire l’habitude contraire.
Ce genre d’infidélité, qui est de tous le plus fécond en mauvais résultats, a été et est encore souvent employé. Il ne l’est pas seulement par les individus qui veulent se livrer à des passions funestes, ou qui cherchent à séduire leurs semblables pour en faire des instruments ou des complices. Il l’est aussi quelquefois par des écrivains qui aspirent à se rendre célèbres par la nouveauté et par l’indépendance de leurs opinions, et qui se font un mérite de se mettre au-dessus des jugements du vulgaire. Ne voyant pas les résultats éloignés de certaines actions ou de certaines habitudes, et trouvant que ces habitudes ou ces actions sont suivies immédiatement de certaines privations ou de certaines jouissances, ils s’imaginent que l’ignorance et le caprice ont pu seuls les commander ou les interdire, et poussent les hommes vers le désordre et la misère, en croyant la ramener dans leur état naturel. C’est ainsi qu’on est arrivé à considérer l’association et la fidélité conjugales, la subordination des enfants envers leurs parents, le respect de la propriété, et l’ordre social lui-même, comme des résultats de la violence, de l’imposture ou du caprice ; c’est au nom des intérêts de l’humanité qu’on a poussé les peuples vers un état pire que l’état sauvage.
Dans la législation, une analyse incomplète ou infidèle produit des effets analogues à ceux qu’elle produit en morale ; mais ces effets sont souvent plus inévitables, et par conséquent beaucoup plus étendus. Un ouvrage immoral, et je donne cette qualification à tout écrit qui tend à propager ou à fortifier de mauvaises habitudes, et à en affaiblir de bonnes, n’influe immédiatement que sur les personnes qui le lisent et qui ont l’esprit assez faible pour ne pas en démêler les erreurs ou la fausseté ; s’il influe sur d’autres personnes, ce n’est qu’après avoir égaré le jugement ou dépravé les mœurs de ceux qui l’ont lu. Un écrivain peut vanter la prodigalité sans que personne se sente forcé de renoncer à l’économie ; s’il détermine le gouvernement à faire de folles dépenses, les particuliers du moins restent libres dans leur conduite privée. Une analyse fausse ou incomplète, qui fait établir ou conserver une mauvaise loi, influe sur le sort de toutes les personnes que cette loi atteint, et celles qui en voient le mieux les vices, sont celles aussi qui en souffrent le plus. De même une analyse infidèle qui empêche l’adoption d’une institution salutaire, agit immédiatement sur la destinée de tous ceux qui eussent profité de cette institution ; et ce sont encore ceux qui jugent le mieux cette institution, qui en sentent le plus vivement la privation.
Supposons, par exemple, qu’un légiste recherche quel est le moyen le plus sûr d’arriver à la découverte d’un fait donné, d’une opinion ou d’une action jugées funestes. Il observe qu’en général, lorsque les hommes souffrent, ils se résignent aux plus grands sacrifices pour mettre un terme à leurs douleurs. Il observe, de plus, qu’en soumettant à la torture un accusé, et en augmentant graduellement ses douleurs, on peut arracher de lui l’aveu du fait qui lui est imputé, et le moyen de connaître ou de convaincre ses complices. L’idée d’une découverte si précieuse enflamme son imagination ; il voit que, si elle est adoptée, on aura un moyen sûr d’arriver à la découverte de tous les criminels ; que les malfaiteurs, craignant d’être dénoncés les uns par les autres, ne trouveront plus de complices, et que le seul défaut de complices rendra impossibles la plupart des crimes, ceux du moins qui alarment le plus la société. Si notre légiste n’est investi d’aucune autorité, il n’agira que sur les esprits, et la force de l’action qu’il exercera sera en raison de l’ignorance des hommes auxquels il se sera adressé, et du talent avec lequel il aura exposé son système. S’il est investi de la puissance publique, il emploiera sa raison pour convaincre les ignorants, et son autorité pour soumettre les incrédules. Mais, dans l’un et l’autre cas, si le système est converti en loi, il agira sur la population entière, et il se maintiendra jusqu’à ce qu’un homme plus habile, soumettant les effets de la même loi à une analyse fidèle, ait démontré qu’elle ne produit pas les avantages qu’on en avait espérés, et qu’elle produit des maux qu’on n’avait pas prévus.
Par la même raison qu’une analyse infidèle peut faire adopter une institution funeste, elle peut empêcher l’adoption d’une bonne, ou en amener le renversement. Il suffit de présenter comme des conséquences de cette institution des maux qui sont produits par d’autres causes, et de taire les biens qui en résultent, ou de les attribuer à des causes différentes.
Ayant exposé les effets que produit en morale et en législation une analyse incomplète ou infidèle, je pourrais me dispenser de parler des conséquences que produisent les sophismes et les faux systèmes, puisque c’est le même sujet considéré sous un point de vue différent. N’est-il pas clair, en effet, que tout faux raisonnement, quelle qu’en soit la forme, consiste à attribuer à une cause des conséquences qu’elle ne produit pas, ou à ne pas lui attribuer toutes les conséquences qu’elle produit ? Et si, au fond, tous les faux raisonnements se ressemblent, ne conduisent-ils pas tous dans la même route ? Cependant les faux systèmes et les sophismes jouent un rôle si important en législation et en morale ; ils se reproduisent sous des formes si variées, et l’usage en paraît si innocent, qu’on me pardonnera de m’y arrêter pour en exposer les conséquences.
Un écrivain, voulant remonter aux causes qui produisent la servitude et la liberté, examine quelles sont les parties du globe sur lesquelles se trouvent placés les peuples libres, et les peuples soumis à des gouvernements despotiques. Il croit s’apercevoir que les peuples esclaves sont placés dans les pays chauds, et les peuples libres dans les pays tempérés. De ces deux faits il tire la conséquence que l’esclavage est un résultat nécessaire du climat, et que, sous telle latitude, un peuple ne peut pas être libre. Pour bien raisonner, il faudrait prouver comment un de ces faits est la conséquence de l’autre ; car il ne suffit pas d’établir que deux faits existent simultanément sur le même lieu, pour en conclure que celui-ci a été engendré par celui-là, il faut de plus en faire voir la filiation. Mais il ne s’agit pas, dans ce moment, d’examiner si cette opinion est bien ou mal fondée ; admettons-la telle qu’elle est énoncée, et supposons qu’elle soit exposée avec assez de talent, et par un homme assez considéré, pour qu’elle soit généralement adoptée. Quelles en seront les conséquences ?
Il est évident, d’abord, que les peuples placés sous le climat supposé productif de l’esclavage, doivent désespérer d’arriver jamais à la liberté. Ils ne peuvent, en effet, cesser d’être esclaves qu’en détruisant la cause qui les a rendus tels ; mais dépend-il d’eux de changer la nature de leur climat ? Peuvent-ils affaiblir la puissance des rayons du soleil, ou déplacer leur territoire ? Une nation nombreuse peut-elle quitter son pays, et emporter ses richesses comme une famille ? Dans quelle partie du globe trouvera-t-elle un territoire vacant disposé à la recevoir ? La nécessité du despotisme étant admise, il faut considérer comme une folie toute tentative de diminuer l’ignorance, les préjugés, les vices et les crimes qui en sont la suite ; car les conséquences du despotisme ne sont pas moins inévitables que celles du climat. Cette ignorance, ces préjugés, ces vices, ces crimes, sont en quelque sorte les éléments dont il se forme ; si l’on détruisait les éléments, la chose elle-même n’existerait plus.
Si le despotisme est une conséquence inévitable des climats chauds, on peut croire raisonnablement qu’un climat froid ou tempéré produira un effet contraire. Ainsi, dans aucune position, les peuples n’ont rien à faire pour devenir libres, c’est-à-dire pour acquérir de bonnes lois et de bonnes mœurs. S’ils sont placés sous un climat chaud, leurs efforts seraient vains : ils ne peuvent vaincre la nature. S’ils sont placés sous un climat froid ou tempéré, leurs efforts ne sont pas nécessaires : le climat agira pour eux. Les Français, les Allemands et même les Russes, n’ont point d’efforts à faire pour devenir aussi libres que les citoyens des États-Unis d’Amérique ; mais aussi les peuples américains placés entre les tropiques, s’agiteront vainement pour conquérir la liberté ; ils sont condamnés par la nature à être aussi esclaves que les Perses.
Tel est l’effet d’un système qui fait dépendre les institutions et le bien-être des peuples d’une fausse cause, d’une cause indépendante de leur volonté et de leurs efforts. L’auteur de ce système, ennemi du despotisme par sentiment autant que par conviction, lui aurait rendu le service le plus grand qu’il fût possible de lui rendre, s’il eût fait adopter ses idées sur l’influence des climats ; car, quel plus grand service pourrait-on rendre aux despotes, que de paralyser les efforts de tous les peuples vers la liberté ?
Un système qui fait dépendre toute la bonté des institutions d’un peuple d’une cause qui est à leur portée, mais qui n’est pas la seule influente, produit des conséquences moins funestes que le précédent. Il ne paralyse pas l’action que les nations tendent à exercer sur elles-mêmes pour améliorer leur condition ; il les égare, mais il leur laisse les moyens de découvrir leurs erreurs par l’expérience, et par conséquent de se corriger. Cependant il peut produire encore beaucoup de mauvais effets.
Qu’un éloquent écrivain, en voyant les maux enfantés par le pouvoir arbitraire d’un individu ou d’une caste, s’imagine que tous ces maux n’existent que par la raison que le pouvoir n’est pas possédé par le corps entier des citoyens ; il pourra prouver, de manière à convaincre les hommes les plus bornés, qu’un peuple ne peut être la propriété d’un individu ou d’une famille, et que le pouvoir qui est exercé sur lui, sans son aveu, n’est qu’une force matérielle susceptible d’être détruite par une force de même nature ; il pourra imaginer ensuite des combinaisons plus ou moins ingénieuses, pour que la volonté des citoyens domine dans toutes les affaires publiques.
Mais, lorsque ce système aura été bien développé, et que le public en aura fait une espèce d’évangile, qu’en résultera-t-il ? Que la population, attribuant des avantages immenses à une cause qui, seule, ne peut pas les produire, tendra à se rendre maîtresse de tous les pouvoirs ; qu’elle s’en emparera peut-être, et que, lorsqu’elle les possédera, elle ne saura pas quel est l’usage qu’elle en doit faire ; qu’elle sera dominée par ses préjugés, par ses habitudes, égarée par son ignorance ou par ses vices ; que les choses n’iront pas beaucoup mieux qu’auparavant ; que les vices et la corruption d’une cour seront remplacés par des vices et des violences populaires, et que l’on retournera peut-être au point d’où l’on était parti, convaincu que l’on sera, qu’entre deux gouvernements qui produisent autant de mal l’un que l’autre, le moins mauvais est celui qui exige le moins de peine. Il faudra, pour aspirer une seconde fois à obtenir des institutions populaires, qu’on ait éprouvé de nouveau les excès du despotisme ; qu’on ait appris par expérience qu’on peut être très mal gouverné même quand la multitude commande, et qu’un peuple qui aspire à posséder le pouvoir, doit d’abord se donner la peine d’apprendre quel est l’usage qu’il lui convient d’en faire.
Un autre écrivain, témoin des excès auxquels peut se porter une multitude ignorante et fanatique, pourra, à l’exemple de Hobbes, voir la cause de tous les maux dans les institutions populaires, et en chercher le remède dans le pouvoir absolu d’un prince et de sa cour. Si ce système est exposé avec art, et soutenu avec talent, il aura pour effet de tromper l’opinion publique sur les causes qui rendent un peuple heureux ou misérable. Il détruira ou affaiblira le sentiment de mépris et de haine qu’inspirent aux peuples éclairés les agents du despotisme ; il accroîtra par conséquent le nombre et le zèle de ces agents, en les justifiant à leurs propres yeux et aux yeux des hommes peu éclairés. Il augmentera la résignation ou affaiblira la résistance des victimes de l’arbitraire, et fera considérer comme des coupables, comme des ennemis du bien public, les hommes qui se dévoueront pour la délivrance et le bonheur des peuples. Ainsi, un sophiste peut être un homme plus malfaisant qu’un tyran et que ses ministres. Une action tyrannique peut n’en pas engendrer une seconde ; il est possible même qu’en donnant une secousse à l’opinion publique, elle produise une heureuse révolution. Mais un mauvais système exposé avec art, en même temps qu’il multiplie les mauvaises actions, empêche qu’on y mette un terme : il accroît la violence du mal, et neutralise le remède.
Il est deux genres de sophismes qui produisent des effets moins dangereux que le précédent, mais qui sont loin cependant d’être innocents : l’un consiste à attribuer des vices ou des malheurs à une cause qui ne les a pas produits ; l’autre à attribuer à une cause des effets heureux qu’elle ne produit pas. Il n’est pas rare de voir employer ces deux sophismes simultanément, parce qu’ils sont propres à conduire au même but. Un homme qui attribue à un système un bien qu’il ne produit pas, se sent tout disposé à attribuer au système contraire tous les maux imaginables. On peut observer cette disposition chez presque tous les hommes qui s’occupent de discussions politiques ou religieuses. Aux yeux des uns, la monarchie ou la religion seront la cause d’où naîtront tous les biens dont il est permis aux peuples de jouir ; la république ou l’incrédulité seront la cause de toutes les calamités. Aux yeux des autres, ce sera précisément le contraire.
Ces sophismes sont presque aussi malfaisants les uns que les autres, et le mal qu’ils produisent est de même nature. Il est évident qu’en attribuant à la religion ou à l’irréligion des maux qu’elles ne produisent pas, on fausse le jugement du public ; on empêche les hommes de voir la véritable cause de ces maux, et par conséquent d’en trouver le remède. Il en est de même, si on leur attribue des biens qui n’en sauraient être la suite : on dirige ainsi l’attention et les efforts des hommes vers une fausse cause, et on les détourne de la cause véritable. Nous pouvons dire la même chose des sophismes semblables qu’on fait à l’égard de la forme des gouvernements : attribuer à la monarchie ou à la république des biens ou des maux qui sont produits par d’autres causes, c’est donner aux esprits une fausse direction, et empêcher les peuples, soit de se délivrer des maux qui les affligent, soit d’obtenir les biens qu’ils sollicitent.
Ce n’est pas toujours dans de mauvaises intentions qu’on se permet ce genre de sophismes ; il est commun, au contraire, que les hommes qui en font usage soient bien intentionnés. Un homme vivement persuadé de la vérité de sa religion, peut en exagérer les bons effets dans la vue de déterminer ceux qui l’écoutent ou qui lisent ses ouvrages, à l’adopter, ou à l’observer, s’ils l’ont déjà adoptée. De même, un homme persuadé que telle ou telle religion est fausse ou malfaisante, peut lui attribuer des maux qu’elle n’a point produits, dans la vue de la détruire plus promptement. Ceux qui raisonnent ainsi, quelque bonnes que soient leurs institutions, produisent deux genres de maux ; d’abord, ils empêchent les hommes de remonter aux véritables causes, et par conséquent d’obtenir ou d’éviter les résultats qu’ils désirent ou qu’ils redoutent ; en second lieu, ils nuisent à la cause qu’ils défendent, en fournissant des armes à leurs adversaires ; pour lui procurer un triomphe momentané, ils lui préparent des coups dont elle ne saurait se défendre.
Il résulte de ce qui précède qu’en morale et en législation, les analyses infidèles, les sophismes, les faux systèmes, enfin toutes les erreurs, sous quelque dénomination qu’on les désigne, sont plus funestes au genre humain que les mauvaises actions isolément prises ; et que, si jamais les hommes mesurent leur mépris et leur aversion par la somme de mal qui leur est faite, ils placeront les sophistes de mauvaise foi au rang des plus grands malfaiteurs. Des hommes de talent se sont fait quelquefois un jeu de soutenir de faux systèmes, pour donner des preuves de la force de leur raisonnement, et des peuples ignorants et crédules ont applaudi à leur force ou à leur adresse, comme ils eussent applaudi à un combat de gladiateurs ; ils n’ont pas vu que, dans ces luttes, l’erreur était aux prises avec la vérité, et qu’ils paieraient, par de longs malheurs, chacun des triomphes que remporterait la première.
Le genre humain est naturellement progressif ; il tend, par sa propre nature, vers sa conservation et son développement ; mais, pour prendre la bonne route, il a besoin d’être éclairé. Une bonne analyse porte la lumière sur toutes les routes, sur celles qui conduisent à la misère et à la destruction, comme sur celles qui conduisent à la prospérité. Une analyse infidèle ou un faux système, ne jettent qu’une fausse lumière, et font voir les choses autrement qu’elles ne sont. L’auteur d’une analyse infidèle est, pour les peuples, ce que serait, pour les voyageurs, un homme qui changerait les inscriptions placées sur les chemins pour leur indiquer leur route. Il leur fait prendre un chemin qui n’a point d’issues ou qui les conduit dans un lieu qu’il était de leur intérêt d’éviter. L’auteur d’une analyse fidèle et complète est, au contraire, pour les peuples, ce que serait pour les voyageurs un homme qui irait placer sur une multitude de chemins qui se croisent, l’indication exacte de tous les lieux où chacun conduit. Mais ni l’un, ni l’autre, ne crée le principe d’activité qui met les peuples en mouvement : ils sont aussi étrangers à la création de ce principe, que l’individu qui inscrit à l’entrée des chemins les noms des lieux où ils conduisent, est étranger aux motifs qui déterminent les hommes à entreprendre des voyages.
[I-99]
CHAPITRE IV.↩
De deux éléments essentiels au progrès des sciences morales ; et de l’opposition qu’on a cru observer entre la méthode analytique et l’action du sens moral ou de la conscience.
Les hommes, de même que toutes les espèces animées, tendent, par leur propre nature, à leur conservation et à leur développement. Cette tendance se manifeste en nous par deux sentiments opposés ; par la peine que nous cause, toutes les fois qu’un intérêt particulier ne nous aveugle pas, l’aspect d’une action malfaisante, et par l’admiration que nous éprouvons au spectacle d’une belle action. Ces sentiments sont produits en nous avec une telle rapidité, qu’ils précèdent presque toujours la réflexion : nous considérons comme une offense qui nous est en quelque sorte personnelle, l’action d’un homme qui, en notre présence, en outrage un plus faible que lui, sans en avoir une excuse légitime ; et l’action d’un homme qui s’expose volontairement à un grand danger pour en secourir un autre, nous inspire des mouvements d’admiration dont nous ne sommes pas maîtres. Ces sentiments nous semblent même si naturels que nous éprouverions une espèce d’antipathie pour un homme qui, se trouvant dans la même position que nous, ne les éprouverait pas avec la même vivacité, et qui aurait besoin qu’on [I-100] lui démontrât que telle action est bonne ou mauvaise, pour la trouver digne d’éloge ou de blâme.
La rapidité avec laquelle nous jugeons ou nous sentons qu’une action est utile ou malfaisante, a fait croire que le sentiment seul pouvait nous conduire, et que nous n’avions pas besoin de jugement. On est allé plus loin : on a observé que, dans certains cas, nous avions de la répugnance pour certaines actions jugées mauvaises, et que l’esprit nous fournissait des raisons ou des sophismes pour nous livrer à ces actions ; on a cru alors que le sentiment était un guide infaillible, et que le raisonnement n’était propre qu’à nous égarer. Enfin, on a observé que nos sentiments sont inséparables de notre nature, et se développent en même temps que l’individu, tandis que notre développement intellectuel dépend presque toujours de circonstances accidentelles. De ces deux faits on a tiré la conséquence que tous les hommes ont le sentiment de ce qui est bien ou mal, quoique l’intelligence de tous ne soit pas également développée. On a donné à ce sentiment le nom de sens moral ou de conscience, et on l’a considéré comme la base de la science de la morale.
Il y a dans ce système des observations justes : mais il y en a d’autres qui manquent de vérité ; il s’agit de bien démêler les unes des autres, si l’on ne veut pas tomber dans l’erreur. Il y aurait peut-être autant de danger à repousser ce système en entier qu’à l’admettre sans restriction.
[I-101]
Une science, par elle-même, ne crée rien ; elle n’est que l’exposition de ce que les choses sont. Ainsi, l’analyse appliquée à la législation et à la morale, ne peut, par elle seule, ni créer une bonne loi, ni en détruire une mauvaise ; elle ne peut ni faire exécuter une bonne action, ni empêcher une action funeste. Le seul effet qui lui soit propre, et qu’elle produit sans le concours d’aucun autre agent, est de faire connaître le bien et le mal qui résulte de telle action ou de telle loi. Il faut donc, pour que les connaissances qu’elle donne ne soient pas stériles, qu’il existe dans l’homme un principe d’action qui le pousse vers ce qui est bien, et qui l’éloigne de ce qui est mal ; qui le détermine à approuver les habitudes ou les institutions utiles au genre humain, et à réprouver celles qui lui sont funestes. Si l’homme ne portait en lui-même aucun principe d’action, la science serait sans effet, car elle ne saurait en créer un ; elle ne saurait imprimer au genre humain un mouvement qu’il n’aurait pas. Si l’homme portait en lui un principe d’action qui le dirigeât vers la ruine de son espèce, la science hâterait sa destruction en lui montrant la voie la plus courte par laquelle il pourrait y arriver. Il faut donc qu’il existe dans l’homme une tendance qui le porte vers ce qui est utile à ses semblables, et qui le détourne de ce qui leur est funeste.
Supposez, en effet, les hommes susceptibles d’intelligence comme ils le sont ; supposez de plus qu’on expose à leurs yeux toutes les conséquences bonnes et mauvaises que peuvent produire telles habitudes ou telles institutions : vous aurez des individus connaissant le bien et le mal, mais vous n’aurez pas encore des individus agissant pour produire l’un et pour détruire l’autre ; et s’ils n’agissent pas, leurs connaissances seront inutiles. Mais, si vous placez chez un individu un sentiment d’aversion ou de haine pour ce qui est funeste à leur espèce, et un sentiment de sympathie ou d’affection pour ce qui lui est utile, les effets des connaissances se feront aussitôt remarquer dans la direction que les mêmes individus donneront à leurs efforts. Or, ce sentiment est incontestable ; il se manifeste par une multitude de faits, il est inhérent à la nature humaine ; il est pour l’homme un principe ou une cause d’action ; il contribue à former ses mœurs. Sous ce rapport, il est un des fondements de la morale et de la législation ; il en est en quelque sorte la première cause. Je ne donne pas de nom à ce principe : que les uns lui donnent le nom de sens moral ou de conscience ; que les autres l’appellent amour de soi, intérêt bien entendu, peu importe : l’essentiel est de s’entendre sur les choses et d’éviter les disputes de mots.
Mais, si ce principe d’action est un fait incontestable, il est un autre fait qui ne me paraît pas moins évident ; c’est que l’intelligence qui est propre à l’homme, lui est aussi nécessaire pour se bien conduire, que le principe même qui le met en mouvement. Privez-le de son principe d’action, ses connaissances lui seront inutiles : vous n’aurez qu’un être passif. Privez-le de ses connaissances, son principe d’action ne lui sera pas moins inutile, si même il ne lui est pas funeste. Pour marcher avec sûreté, il ne suffit pas d’en avoir le désir et de posséder des jambes ; il faut de plus avoir des yeux pour se conduire.
La supposition que le principe d’action qui détermine nos jugements en législation ou en morale, suffit aux hommes pour bien se diriger dans toutes les circonstances de la vie, est démentie par l’histoire même du genre humain, et par une multitude de faits qui se passent journellement sous nos yeux.
Nous pouvons observer d’abord que le sentiment qui dirige l’homme vers ce qui est utile à ses semblables, et qui lui fait repousser ce qui leur est funeste, ne se manifeste pas seulement dans la législation et dans la morale ; il est le principe qui donne la vie à toutes les sciences et à tous les arts. Un homme qui fait des recherches sur la médecine, sur la chirurgie, sur la physique, sur la chimie, sur la mécanique, ne peut, comme celui qui fait des recherches sur la législation et sur la morale, qu’exposer les découvertes qu’il a faites ; sa puissance se borne à mettre devant les yeux de ses lecteurs ou de ses auditeurs, les faits qu’il a observés et qu’on n’avait pas remarqués avant lui. Ayant communiqué ses connaissances, il faut, pour qu’elles deviennent utiles, qu’il existe dans les hommes qui se les sont appropriées, un principe d’action qui les porte à en faire usage dans l’intérêt de leur espèce. Si ce principe n’existait pas, les connaissances qu’on aurait données aux hommes des arts ou des sciences seraient aussi stériles dans leur esprit qu’elles le seraient si elles restaient consignées dans des livres qui ne seraient lus par personne.
Mais, quoiqu’il existe chez les hommes un principe qui les porte à faire l’usage le plus utile des découvertes des savants, peut-on dire que ce principe suffit pour se bien diriger, et que les recherches des savants sont inutiles ? Peut-on dire que ce principe d’action, auquel on donne le nom de sens moral ou de conscience, lorsqu’on en considère les effets en morale et en législation, suffit pour faire un médecin, un chimiste, un mécanicien ou un astronome ? Suffira-t-il à un capitaine de vaisseau d’avoir de la conscience, et de consulter son sentiment intime, pour éviter les écueils et conduire son navire au port ?
La rapidité avec laquelle nous approuvons ou nous condamnons certaines actions, nous fait croire que le raisonnement et l’habitude ne sont pour rien dans les sentiments de plaisir ou de peine que nous fait éprouver le spectacle d’une bonne ou d’une mauvaise action ; mais il est une multitude de choses que l’habitude nous fait exécuter avec une facilité tout aussi grande, et que nous avons eu beaucoup de peine à apprendre. Quand nous marchons, nous n’avons pas besoin de porter notre attention alternativement tantôt sur une jambe et tantôt sur l’autre, pour les faire avancer : elles nous portent là où nous voulons aller, sans que nous ayons besoin de penser à elles. Un musicien, en exécutant le morceau le plus difficile, n’a nul besoin de penser à ses doigts ; il les dirige avec une sûreté et une rapidité qui nous étonnent, sans y faire la moindre attention. Nous lisons, nous écrivons, nous parlons avec la même facilité, et sans qu’il soit nécessaire de porter notre attention sur les organes à l’aide desquels nous exécutons ces diverses opérations ; ils se meuvent en quelque sorte d’eux-mêmes, et sans que nous songions à les diriger. Si tous les jours nous n’étions pas témoins de la peine qu’ont les enfants à apprendre à marcher, à parler, à lire, à écrire, nous croirions que nous exécutons toutes ces opérations sans les avoir jamais apprises, et que nos organes se meuvent dans telle ou telle direction, comme notre sang circule, sans la participation de notre volonté. Nous remarquons moins la manière dont se forment nos idées morales, précisément parce que notre éducation commence plus de bonne heure, et que nous en donnons ou en recevons des leçons, à chaque instant et sans y penser. Il en est de ces idées comme de l’atmosphère qui nous environne ; nous ne faisons pas attention à la manière dont elles nous frappent, parce qu’elles nous pénètrent de toutes parts, et que notre caractère est formé avant que nous ayons vécu assez longtemps pour réfléchir.
Les personnes qui prétendent que le principe d’action que nous avons reconnu en nous, suffit pour nous faire distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, et qui pensent que l’intelligence n’est propre qu’à nous égarer, se montrent, dans leur conduite, peu convaincues de la vérité de leur système ; si elles ont des enfants, elles sont loin de s’en rapporter au sentiment intime pour leur faire discerner le bien du mal ; elles ne cessent de leur inspirer de l’aversion pour le mensonge, de l’amour pour la vérité ; elles répriment, en eux, les petits mouvements de vanité, de méchanceté, qu’ils laissent apercevoir ; elles approuvent, elles encouragent les sentiments de bonté ou de bienveillance qu’ils montrent ; elles choisissent leurs petites sociétés avec une précaution qu’elles ne mettent pas toujours dans le choix de celles qui leur sont propres ; elles écartent d’eux, avec un soin extrême, tous les livres qui pourraient leur donner des idées fausses, ou leur inspirer de mauvais sentiments ; elles placent dans leurs mains les livres qu’elles croient les plus propres à leur donner des idées justes, à leur inspirer des sentiments purs et généreux ; ces soins, qui commencent avec la première enfance, se poursuivent dans la jeunesse ; les enfants, en sortant des mains de leurs parents, passent dans les mains des instituteurs, des professeurs, des ministres de la religion, qui leur donnent, ou sont supposés leur donner les mêmes leçons. Enfin, nous recevons des leçons de morale, depuis le moment où nous avons la faculté de recevoir une impression ou une idée, jusqu’au moment où les hommes ne peuvent plus agir sur nous ; les écoles, les écrits qui se publient tous les jours, les discussions qui ont lieu dans la société, les établissements religieux, et même les débats et les décisions judiciaires, servent à nous instruire à tous les moments de notre vie [9].
Si le sentiment qui fait approuver ou rechercher à l’homme ce qui est utile à son espèce, et qui lui fait réprouver ou éviter ce qui peut lui être funeste, n’avait pas besoin d’être dirigé par l’habitude ou éclairé par l’intelligence, les mœurs des hommes n’eussent été sujettes à aucune variation ; nous les trouverions dans l’état sauvage, telles que nous les voyons chez les peuples les plus civilisés ; et, chez le même peuple, on ne remarquerait aucune différence de mœurs entre les diverses classes de la société. Il faudrait admettre que le genre humain, perfectible sous tout autre rapport, ne l’est point sous le rapport des mœurs ; que l’intelligence peut nous apprendre à faire un meilleur usage de nos organes physiques ; qu’elle peut nous servir à former un agriculteur, un mécanicien, un musicien ou un danseur ; mais qu’elle est impuissante pour former un honnête homme, un bon magistrat ou un bon citoyen. Si, à cet égard, le sens moral suffit, on peut se passer de livres, de professeurs, de prédicateurs, et surtout des écrivains qui font des systèmes de morale.
Des hommes qui considèrent comme une science, des sentiments communs à tous les individus dont se compose le genre humain, et qui cependant reconnaissent la nécessité d’écrire et d’enseigner cette science, affirment une véritable contradiction. Si l’écrivain, le professeur ou le prédicateur, n’importe le nom, ne peut dire à ses lecteurs ou à ses auditeurs que ce qu’ils sentent comme lui, il n’a rien à leur apprendre ; ils sont tout aussi savants que lui-même. S’il a des sentiments qui lui sont particuliers et qu’il se propose de leur communiquer, il doit reconnaître que le sens moral ou la conscience ne parle pas également à tout le monde. Il faut alors rechercher quelles sont les causes de la différence, et trouver, sans le secours de l’intelligence, des raisons qui soient capables de faire parler des consciences qui se taisent. Ou bien il faut déterminer des hommes à se laisser diriger par un sens moral qui n’est pas le leur, après leur avoir persuadé qu’ils ne peuvent pas trouver de guide plus sûr que leur propre conscience. Il faut leur prouver que le sentiment moral, inhérent à la nature humaine, ne recevant aucune direction de l’intelligence, a toujours également bien dirigé les hommes, et que cependant le christianisme a changé les mœurs d’une partie des nations qui l’ont adopté, tandis que des nations qui ne sont pas chrétiennes se livrent, par principe de conscience, à des actions que notre sens moral réprouve.
Il arrive presque toujours que, lorsque des hommes établissent un système exclusif qui repousse des vérités incontestables, il se trouve d’autres hommes qui, pour le renverser, cherchent à fonder un système également exclusif, et qui mettent au nombre des erreurs les vérités même que peut renfermer le système contraire. Ainsi, lorsque des savants ont porté le calcul dans les sciences morales, et qu’ils ont voulu diriger notre attention vers l’étude des faits, ils ont incontestablement fait faire de grands progrès à l’esprit humain. Mais peut-être ont-ils retardé les effets d’une bonne méthode, en refusant de reconnaître l’existence d’un fait sans lequel toutes nos connaissances seraient stériles : le sentiment qui nous fait approuver ce que nous jugeons utile au genre humain, et condamner ce que nous croyons lui être funeste. Si ce sentiment n’existait pas, à quoi servirait, je le répète, d’exposer aux yeux des hommes les conséquences bonnes et mauvaises de nos institutions et de nos habitudes ? Quelle serait la cause qui pourrait déterminer les peuples à préférer les unes aux autres [10] ?
La méthode analytique n’est point exclusive de ce sentiment ; elle ne peut, au contraire, être efficace que parce qu’elle en admet ou en suppose l’existence. En éclairant les hommes ignorants sur la nature, les causes et les conséquences de leurs actions ou de leurs habitudes, elle réveille leur sens moral dans des cas où, faute de lumières, il ne pouvait se faire entendre. En éclairant les hommes qui se trompent dans les jugements qu’ils portent des institutions ou des habitudes humaines, elle les délivre de craintes mal fondées, ou leur fait condamner ce qu’ils approuvaient auparavant. En éclairant les hommes qui ont reçu de bonnes habitudes, mais qui ont peu de lumières, elle leur donne des motifs de persévérance, et ajoute leur approbation personnelle à l’approbation du public. Ainsi, la conscience de chaque individu se met au niveau de ses lumières, et elle devient d’autant plus étendue, et d’autant plus impérieuse, qu’on voit mieux les conséquences de tout ce qu’on fait. Ce serait donc une grave erreur de croire qu’un des effets de l’analyse appliquée aux sciences morales, est de faire taire le sens moral. L’effet qu’elle produit est, au contraire, de donner à ce sens une direction plus sûre, et d’en accroître l’énergie.
On serait également dans l’erreur si l’on croyait que l’analyse est un obstacle à la formation des bonnes habitudes. Les lumières qu’elle donne n’ont, au contraire, une grande influence sur nous, qu’autant qu’elles ne sont pas contrariées par des habitudes vicieuses. La plupart des hommes, même chez les peuples les plus éclairés, ne peuvent être conduits que par leurs habitudes, et par les impressions qu’ils ont reçues dans leur enfance ; ils n’ont ni le temps, ni les moyens d’apprendre à calculer les conséquences de chacune de leurs actions. Ceux mêmes qui ont reçu une certaine éducation, sont souvent obligés d’agir sans qu’il leur soit possible de calculer d’avance les résultats de leur conduite : ils obéissent alors à leur sens moral, selon les idées et les habitudes qu’on leur a données. Ils se conduisent bien, s’ils ont reçu des idées justes et de bonnes habitudes ; ils se conduisent mal, s’ils ont contracté de mauvaises habitudes ou reçu des idées fausses. Lorsque les habitudes d’un individu sont complètement formées, les lumières que l’analyse lui donne ont rarement pour résultat de le réformer : elles ne produisent pas, en général, d’autres effets sur lui, que d’exciter ses remords pour des actions qu’il exécutait auparavant en toute sûreté de conscience, et de lui faire réprouver dans les autres des faits dont il n’a plus la puissance de s’abstenir. Ainsi, des parents qui ont eu le malheur de contracter de mauvaises habitudes, et qui n’ont plus assez d’énergie pour s’en délivrer, peuvent encore en préserver leurs enfants.
Ayant exposé, dans le chapitre précédent, les effets généraux que produisent les faux systèmes, il me reste peu de chose à dire de ceux que produit le système qui repousse l’examen des faits, pour n’admettre que les décisions du sens moral ou de la conscience. Ce système, comme tous les autres, a pour résultat d’être un obstacle au perfectionnement moral de l’homme, en attribuant à une cause des effets plus nombreux que ceux qu’elle produit, et en faisant considérer comme une source d’erreurs, la seule méthode qui peut conduire à la découverte de la vérité. Mais il a de plus quelques effets qui lui sont particuliers, et qu’il convient par conséquent d’exposer.
Il est évident, en premier lieu, qu’un homme qui exclut le raisonnement des sciences morales, et qui ne prend pour juge que le sentiment intime, ne reconnaît aucune autorité à laquelle il soit possible d’en appeler en cas de discussion. La science est inutile toutes les fois que les hommes sont d’accord, et lorsqu’ils sont d’opinion différente, elle ne leur offre aucun moyen de s’éclairer ; ce qui les conduit à l’anarchie.
En second lieu, ce système est la justification de tous les vices et de tous les crimes auxquels se sont livrés et auxquels peuvent se livrer encore les fanatiques de toutes les religions et de tous les partis. S’il suffit, pour qu’une action soit utile au genre humain, de trouver des fous auxquels il soit possible de persuader qu’elle leur est commandée par leur conscience, il n’est aucun crime qui ne puisse être considéré comme un devoir ; car il n’en est aucun qui, à une époque quelconque, n’ait été exécuté en toute sûreté de conscience.
Enfin, dans l’ordre social, chacun est porté à considérer comme l’expression de son sens moral, le principe qui sert de base à son métier ou à sa profession ; dans presque tous les pays du monde, le sens moral d’un soldat lui commande l’obéissance passive ; le sens moral du ministre d’un culte quelconque, lui commande de se conformer aux livres de sa religion, tels qu’ils sont interprétés par la secte à laquelle il appartient ; le sens moral d’un jurisconsulte lui commande de se conformer aux lois de son pays, quelles qu’elles soient ; le sens moral d’un philosophe lui commande de faire triompher ses systèmes ; et le sens moral d’un paysan, d’obéir aux directions de son curé. Si nous examinons, en un mot, ce qui se passe généralement dans le monde, nous trouverons que chacun exécute en conscience tout ce qu’il croit pouvoir exécuter sans aucun danger ; et que le sens moral ne réprouve que les actions qui, dans un temps ou dans un autre, peuvent être funestes, soit à nous-même, soit à des êtres pour lesquels nous avons des affections. Montrer les mauvaises conséquences d’une action ou d’une institution, c’est faire voir un danger ; c’est troubler la sécurité de ceux qui en sont les auteurs, et de ceux qui peuvent en souffrir. En montrer, au contraire, les bonnes conséquences, c’est donner des motifs de sécurité à ceux qui en sont les auteurs, ou qui peuvent en profiter. Dans les deux cas, c’est faire prononcer le sens moral de tous sur cette action ou cette institution, et les déterminer, soit à la condamner, soit à l’approuver.
Tout cela paraît simple jusqu’à l’évidence ; et cependant, parmi les hommes qui ne veulent pas donner aux nations d’autre guide que la conscience, il en est qui considèrent les lumières propres à l’éclairer, comme le présent le plus funeste qu’il soit possible de leur faire : on croirait à les entendre, que c’est l’esprit des ténèbres qui a enfanté la lumière. Mais qu’on y regarde de près ; qu’on suive la conduite de la plupart de ces hommes, et l’on verra que leurs efforts continuels ne tendent qu’à former les consciences selon leur propre entendement. Ils veulent que chacun obéisse à la voix de sa propre conscience ; mais c’est sous la condition que ce seront eux qui lui apprendront à parler, et qui, seuls, formeront son langage.
[I-116]
CHAPITRE V.↩
Des lois auxquelles les hommes sont assujettis par leur propre nature ; des systèmes des jurisconsultes sur les lois naturelles ; de ce qu’il faut entendre par le mot droit ; et de la différence qui existe entre le droit et la puissance ou l’autorité.
Dans la formation de l’homme, de même que dans la formation de tous les êtres organisés, la nature suit une marche constante et invariable ; elle les crée tous avec les mêmes facultés, et les assujettit aux mêmes besoins. Si des aberrations se font quelquefois remarquer dans quelques-uns, ces aberrations, produites par des accidents, disparaissent ordinairement avec les individus sur lesquels on les a observées, et l’espèce n’en est pas affectée.
Naissant avec les mêmes organes, ayant à satisfaire les mêmes besoins, et étant sujets à contracter les mêmes habitudes, les hommes prospèrent ou dépérissent par les mêmes causes. Ils sont nombreux et forts partout où ils satisfont leurs besoins dans une juste mesure ; ils sont faibles et rares partout où ils ne peuvent les satisfaire qu’avec difficulté. La faim et la soif, le froid et la chaleur, la crainte et la sécurité, produisent sur tous les mêmes effets, lorsqu’ils ont contracté les mêmes habitudes et reçu le même développement.
[I-117]
Cette liaison qui existe entre une cause et l’effet qu’elle produit, est ce qu’on nomme une loi naturelle, ou simplement une loi. Ainsi, c’est une loi que l’individu qui s’abstient de prendre des aliments pendant un temps donné, souffre un certain genre de douleur, ou périsse si l’abstinence est trop longtemps prolongée ; c’est une autre loi que celui qui expose ses organes à l’action du feu, se chauffe ou se brûle, selon la distance à laquelle il se place ; c’est une autre loi que celui qui est privé de la quantité d’air respirable qui lui est nécessaire, souffre ou meure, selon la durée et l’étendue de la privation ; c’est une autre loi que la multiplication de l’espèce résulte de l’union des sexes ; c’en est une autre que des jouissances trop souvent répétées, ou trop longtemps prolongées, affaiblissent nos organes ; c’en est une autre qu’un exercice modéré les fortifie.
Lorsqu’on affirme que le genre humain est soumis à telle loi, on ne fait donc pas autre chose qu’indiquer la relation qui existe entre deux phénomènes, dont l’un est constamment produit par l’autre. C’est dans le même sens qu’on parle des lois du monde physique : c’est une loi que tel grain germe et se multiplie, s’il est déposé dans la terre ; qu’il se réduise en vapeur et en cendres, s’il est exposé à l’action du feu ; qu’il soit dissous d’une autre manière, si un animal quelconque s’en nourrit ; c’est une autre loi du monde physique que tel corps tombe s’il cesse d’être soutenu ; que tel autre s’élève, selon la manière dont il est comprimé. Dans ce sens, on peut dire, avec Montesquieu, que tous les êtres ont leurs lois ; que le monde physique a ses lois, et que les intelligences célestes ont les leurs. Tout ce que cela signifie, c’est que, la nature des choses étant déterminée, les mêmes causes produiront constamment les mêmes effets ; et que les effets ne peuvent être différents, à moins qu’on ne change la nature des choses.
En le prenant ainsi dans le sens le plus général, le mot loi a la même signification que puissance : deux choses étant données, nous considérons comme une loi de leur nature, l’action que l’une d’elles exerce constamment sur l’autre dans tous les cas qui se ressemblent. On observe qu’il y a une action et une réaction continuelles, soit entre les hommes et les choses, soit entre les individus qui sont de même nature ou de même espèce. Cette action et cette réaction nous sont favorables ou funestes, non par un effet de notre volonté, mais par une conséquence de leur propre nature et de la nôtre. Il n’est pas en notre pouvoir de nous soustraire à l’action des choses dont la nature a fait une condition de notre existence, et d’échapper en même temps à la destruction : nul individu n’a la faculté de se soustraire à l’action qu’exercent sur lui l’air atmosphérique ou les substances alimentaires, sans en porter aussitôt la peine. Tout homme est également dans l’alternative ou d’échapper à l’action de certaines choses, ou de subir les mauvais effets qu’elles produisent sur lui : ce sont les lois de sa nature.
Pour connaître toutes les lois auxquelles le genre humain est soumis, il faudrait connaître les diverses manières dont les hommes peuvent être affectés ; l’action que les individus de même espèce ou de même genre exercent ou peuvent exercer les uns à l’égard des autres ; les effets qui sont ou peuvent être produits sur eux par les choses qui existent dans la nature, et l’influence qu’ils peuvent eux-mêmes exercer sur ces choses ; de même que, pour connaître toutes les lois du monde physique, il faudrait savoir quel est le genre d’action que les choses exercent ou sont susceptibles d’exercer les unes sur les autres.
L’application de la méthode analytique aux habitudes et aux institutions humaines, n’a pas d’autre objet que de rechercher les lois suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent, ou restent stationnaires : c’est la connaissance de ces lois, qui forme la science de la morale ou de la législation. L’affirmation que telle action ou telle institution est conforme ou contraire à la loi naturelle de l’homme, ne peut donc pas signifier autre chose, si ce n’est que de tel fait il résulte telle conséquence bonne ou mauvaise ; c’est une manière abrégée d’énoncer le résultat d’une démonstration précédemment faite, ou jugée inutile à cause de l’évidence des faits. Mais si la démonstration n’a pas été faite, ou si les faits ne sont pas reconnus, l’affirmation ne signifie absolument rien : elle se réduit à une pétition de principes.
J’ai donné aux mots loi naturelle le sens qu’on leur donne généralement, lorsqu’on veut désigner la relation de deux faits dont l’un est constamment produit par l’autre ; mais ce n’est pas ainsi qu’ils sont entendus en jurisprudence ; ils ne servent qu’à désigner une certaine collection de maximes ou de principes, que les jurisconsultes étendent ou restreignent presque arbitrairement, et qu’ils considèrent comme la base de toutes les lois sociales.
Ulpien avait défini les lois naturelles, celles que la nature a enseignées à tous les animaux. Des jurisconsultes modernes, trouvant cette définition vicieuse, et ne voulant pas assimiler l’homme à la bête, ont défini ces lois, celles que Dieu a promulguées au genre humain par la droite raison [11]. D’autres ont pensé qu’on pouvait rendre cette définition plus juste en disant que les lois naturelles sont celles que la raison éternelle a gravées dans tous les cœurs [12]. Montesquieu avait dit que la loi, en général, est la raison humaine en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre [13]. Enfin, d’autres ont cru que l’assentiment universel à une maxime, était une marque infaillible que cette maxime était une loi naturelle.
On ne s’est pas mieux accordé sur les choses définies que sur la définition ; ce que les uns ont considéré comme une loi naturelle, n’a été considéré par les autres que comme une loi arbitraire ou positive. Ainsi, tandis que Domat assure que c’est une loi naturelle que les pères laissent leurs biens à leurs enfants [14], Montesquieu affirme que la loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais qu’elle ne les oblige pas de les faire héritiers [15].
Les lois naturelles, dans le sens que les jurisconsultes attachent à ces deux mots, étant invariables, et l’éternelle raison les ayant gravées dans tous les cœurs, il semble qu’il ne devrait pas y avoir de dispute sur le nombre de celles qui existent. Les écrivains sont loin cependant d’être d’accord à cet égard. Quelques-uns mettent au nombre des lois naturelles les principales maximes de la morale ; ils disent, par exemple, que ces lois défendent à l’homme de tromper ses semblables, de les blesser, de porter atteinte à leur honneur, d’usurper leurs propriétés. D’autres, et Montesquieu est de ce nombre, prétendent que, pour les connaître, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les lois de la nature, disent-ils, seront celles qu’il recevrait dans cet état [16]. Partant de ce principe, Montesquieu réduit à cinq les lois naturelles : la première par son importance, est celle qui, en imprimant dans nous l’idée d’un créateur, nous porte vers lui ; la seconde celle qui porte l’homme à la paix ; la troisième celle qui le porte à chercher à se nourrir ; la quatrième celle qui porte un sexe vers l’autre ; la cinquième celle qui porte les hommes à vivre en société [17]. Montesquieu exclut ainsi du nombre des lois naturelles toutes les maximes que les jurisconsultes y font entrer.
Il est un autre point sur lequel les jurisconsultes ne sont pas plus d’accord que sur le précédent. Les uns admettent que les lois naturelles peuvent être modifiées par des lois positives ; les autres sont d’avis que rien ne peut les changer. Grotius pense que ce pouvoir n’appartient pas même à la divinité, et son opinion est partagée par plusieurs écrivains. Blackstone, tout en professant un profond respect pour l’autorité des gouvernements, leur refuse la puissance de changer les lois de la nature et de la révélation. On ne doit pas souffrir, dit-il, que les lois humaines contredisent celles-là : si une loi humaine nous ordonne une chose défendue par les lois naturelles ou divines, nous sommes tenus de transgresser cette loi humaine [18]. D’autres jurisconsultes, non moins dévoués au pouvoir, assurent que les lois naturelles sont immuables, qu’elles ne dépendent ni du temps, ni des lieux, et qu’elles règlent également le passé et l’avenir. Ces propositions sont professées publiquement et sans contradiction, même dans des pays soumis à des gouvernements absolus : on les considère comme des vérités évidentes par elles-mêmes, et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer.
En lisant ce que les jurisconsultes et les philosophes ont écrit sur les lois naturelles, une réflexion se présente à l’esprit : on se demande comment il se peut que des lois que la nature enseigne à tous les animaux, que Dieu a promulguées au genre humain par la droite raison, que la raison éternelle a gravées dans tous les cœurs, qui ne sont que la raison humaine en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre, donnent lieu à tant de contradictions ! Si elles sont gravées dans tous les cœurs, ou si la divinité a pris soin elle-même de les promulguer aux hommes, elles doivent être connues aussi bien de l’ignorant qui ne sait pas lire, que des savants qui prennent soin de nous les expliquer ; chacun doit les définir de la même manière, et en connaître exactement les dispositions. Nous voyons cependant que ceux qui passent pour les mieux connaître, ne s’entendent pas entre eux ; que ce que les uns prennent pour une loi naturelle, n’est considéré par les autres que comme une loi positive, et que la droite raison de Domat a découvert au moins dix fois plus de lois naturelles que le génie de Montesquieu.
Le consentement universel, qui est le signe à l’aide duquel on prétend les reconnaître, est pour cela d’un faible secours ; car quel sera le moyen à l’aide duquel on constatera un pareil consentement ? Consultera-t-on tous les individus qui peuplent la terre ? S’assurera-t-on du consentement des générations passées et des générations à venir ? Si, dans quelque lieu et dans quelque temps que ce soit, on trouve des hommes qui refusent leur assentiment, cela suffira-t-il pour commander la croyance du reste du monde ? Peut-être dira-t-on qu’en parlant du consentement universel, on n’entend parler que du consentement des gens éclairés ; mais alors il ne faut pas dire que les lois naturelles ont été promulguées au genre humain par la droite raison ; il faut reproduire le sophisme rapporté par Locke, et dire : Les lois que tout le genre humain reconnaît sont naturelles ; celles que les personnes de bon sens reconnaissent sont admises par tout le genre humain ; nous et nos amis sommes des personnes de bon sens, donc nos maximes sont des lois naturelles [19].
Les hommes qui nous présentent leurs pensées comme des lois naturelles, et qui en donnent pour preuve le consentement universel, ne se mettent guère en peine de constater l’existence d’un tel consentement. S’ils avaient un peu mieux observé les faits, ils se seraient convaincus de l’impossibilité d’obtenir presque sur rien l’assentiment de tous les hommes ; ils auraient vu les mêmes actions honorées en Grèce, flétries à Rome, considérées dans un pays comme indifférentes, proscrites dans un autre comme essentiellement immorales ; ils auraient vu les Japonais, ayant pour certains animaux domestiques un si profond respect qu’ils ne peuvent les punir, et surtout les mettre à mort, sans une autorisation spéciale de leur empereur, exposer leurs enfants ou les étrangler sans être assujettis à aucune peine [20] ; ils auraient vu enfin les lois les plus absurdes, les usages les plus immoraux ou les plus atroces, être en vénération chez des nations entières, et les actions les plus innocentes, ou même les plus utiles, être punies comme les plus grands crimes [21].
[I-126]
Un célèbre jurisconsulte anglais, M. Jérémie Bentham, frappé des contradictions des jurisconsultes, de l’incohérence de leurs définitions, et surtout de l’inutilité de leurs systèmes, a prétendu qu’il n’existait aucune loi naturelle, dans le sens du moins généralement attaché à ce mot.
« Les auteurs, a-t-il dit, ont pris ce mot comme s’il avait un sens propre, comme s’il у avait un code de lois naturelles ; ils en appellent à ces lois, ils les citent, ils les opposent littéralement aux lois des législateurs, et ils ne s’aperçoivent pas que ces lois naturelles sont des lois de leur invention, qu’ils se contredisent tous sur ce code prétendu, qu’ils sont réduits à affirmer sans prouver, qu’autant d’écrivains autant de systèmes, et qu’en raisonnant de cette manière, il faut toujours recommencer, parce que, sur des lois imaginaires, chacun peut avancer ce qu’il lui plaît, et que les disputes sont interminables. S’il y avait une loi de la nature qui dirigeât tous les hommes vers leur bien commun, les lois seraient inutiles. Ce serait employer un roseau à soutenir un chêne ; ce serait allumer un flambeau pour ajouter à la lumière du soleil [22]. »
Les systèmes des jurisconsultes sur les lois naturelles ne paraissent pas à M. Bentham de vaines théories ; il les considère comme des erreurs fort dangereuses, comme les plus grands ennemis de la raison, comme les armes les plus terribles qu’on puisse employer pour détruire les gouvernements. Suivant lui, on ne peut plus raisonner avec des fanatiques armés d’un droit naturel, que chacun entend comme il lui plaît, applique comme il lui convient, dont il ne peut rien céder, rien retrancher, qui est inflexible en même temps qu’inintelligible, qui est consacré à ses yeux comme un dogme, et dont on ne peut s’écarter sans crime. Au lieu, dit-il, d’examiner les lois par leurs effets, au lieu de les juger comme bonnes ou comme mauvaises, ils les considèrent par leur rapport avec ce prétendu droit naturel ; c’est-à-dire qu’ils substituent au raisonnement de l’expérience toutes les chimères de leur imagination.
Après avoir démontré, par des exemples, comment les erreurs des jurisconsultes se glissent de la théorie dans la pratique, et comment elles excitent les citoyens à transgresser les lois, le même écrivain ajoute :
« N’est-ce pas mettre les armes à la main de tous les fanatiques contre tous les gouvernements ? Dans l’immense variété des idées sur la loi naturelle et la loi divine, chacun ne trouvera-t-il pas quelque raison pour résister à toutes les lois humaines ? Y a-t-il un seul État qui pût se maintenir un jour, si chacun se croyait en conscience tenu de résister aux lois, à moins qu’elles ne fussent conformes à ses idées particulières sur la loi naturelle et la loi révélée ? Quel horrible coupe-gorge entre tous les interprètes du code de la nature et toutes les sectes religieuses [23] ! »
Les systèmes des jurisconsultes sur les lois naturelles ont pour base deux suppositions également inadmissibles : l’une, que les maximes auxquelles on donne le nom de lois naturelles sont des idées innées, communes à tous les individus de notre espèce ; l’autre que les hommes sont sortis de l’état de nature à une époque qu’on ne saurait indiquer, mais sur l’existence de laquelle on ne peut élever aucun doute. Il n’est aucune erreur, surtout en morale et en législation, qui n’ait des conséquences plus ou moins funestes, et celles que je viens d’indiquer ont retardé beaucoup les progrès de l’esprit humain. Je ne crois pas cependant que le danger le plus grand qu’elles présentent soit celui que paraît craindre le philosophe anglais. Les hommes sont si généralement portés à la soumission, qu’on ne les voit guère se révolter contre leurs gouvernements pour soutenir des systèmes philosophiques. Si l’on a vu, dans des révolutions, des hommes se faire des armes de quelques principes généraux pour soulever des populations entières ; si ces principes sont devenus des signes de ralliement contre l’autorité, c’est qu’on avait pour s’insurger, des causes plus réelles ; on les expliquait mal sans doute, on se trompait sur le moyen de faire triompher ses intérêts ; mais on ne s’armait pas pour des chimères. Loin de craindre la résistance aux bonnes lois, il faudrait craindre plutôt une soumission trop facile à des lois vicieuses. Pour un peuple qui résiste à une bonne institution, on peut en trouver dix qui se soumettent à des institutions qui sont et qu’ils savent malfaisantes. La crainte de blesser une nation dans ses sentiments moraux, et de la porter à la résistance, doit produire, à tout prendre, plus de bien que de mal, puisqu’il y a au moins autant de lumières et de morale chez les peuples que chez les gouvernements, et qu’il y a un intérêt plus vif et plus immédiat à n’être soumis qu’à de bonnes lois.
L’objection tirée de la crainte de la résistance peut avoir d’autant moins de force, qu’elle peut s’appliquer à tous les modes de raisonnement. L’affirmation que telle loi est contraire au droit naturel, peut ne troubler la sécurité de personne ; mais l’affirmation que telle loi sera suivie de tels et tels maux, peut inquiéter tous les hommes qui se sentiront menacés, et les disposer à la résistance. Les défenseurs des mauvaises lois peuvent dire aussi que, si chacun peut juger les lois par leurs conséquences ou par l’utilité dont elles sont, on mettra les armes à la main de tous les raisonneurs contre tous les gouvernements ; que, dans l’immense variété des idées, sur ce qui est utile ou funeste, chacun trouvera quelque raison pour résister à toutes les lois humaines ; qu’il n’y a pas un seul État qui pût se maintenir un jour, si chacun se croyait en conscience tenu de résister aux lois, à moins qu’elles ne fussent conformes à ses idées particulières sur l’utilité.
Le plus grave inconvénient qui résulte des doctrines des jurisconsultes sur les lois naturelles, n’est donc pas la résistance à laquelle ces doctrines peuvent exciter les peuples contre leurs gouvernements ; il est dans les obstacles qu’elles mettent aux progrès de nos connaissances. Une fois qu’on a posé en principe que les lois naturelles de l’homme sont gravées dans tous les esprits ou dans tous les cœurs, on n’a plus rien à ajouter : nul ne peut se prétendre plus instruit que les autres. Un homme qui avouerait qu’il a quelque chose à apprendre, devrait être considéré, en quelque sorte, comme un monstre ; il serait, au moral, ce que serait, au physique, un individu qui naîtrait privé des organes de la vue.
Toutes les fois que, dans une discussion, on voit de part et d’autre une égale bonne foi, et un désir sincère d’arriver au bien, on peut soupçonner qu’il y a dans le langage quelque expression mal définie, qui n’a pas le même sens dans l’esprit de tous ceux qui l’emploient ; qu’on n’aperçoit la vérité que d’une manière confuse, et qu’on tomberait promptement d’accord si l’on savait mieux s’exprimer, c’est-à-dire si la valeur de chaque mot était mieux déterminée. Je vais tâcher d’écarter ici les disputes de mots, et examiner ce qu’il y a de vrai et de faux dans le système des jurisconsultes, et en quoi ce système se rapproche ou s’éloigne de celui du savant anglais. Pour se livrer à cet examen, il est nécessaire de rappeler quelques-uns des faits que j’ai précédemment énoncés ; parce que ces faits ne peuvent être contestés ni par les défenseurs ni par les adversaires de ce qu’on nomme le droit naturel ; et que, si l’on veut tomber d’accord sur le langage, il faut commencer par s’entendre sur les phénomènes à observer.
Les causes qui font prospérer ou dépérir l’espèce humaine produisent partout les mêmes résultats. Il peut dépendre quelquefois de nous de les faire naître ou de les détruire ; mais quand elles existent, il n’est pas en notre puissance d’en empêcher les effets. Un homme peut bien s’abstenir de prendre des aliments ; mais il ne peut pas empêcher qu’une abstinence absolue ne le détruise. Il peut ne se nourrir que d’aliments malsains, mais il ne peut pas faire que ces aliments lui donnent de la santé et de la force. Il peut se livrer à tel ou tel vice, mais il ne peut pas faire que ce vice ne soit pas suivi de tels ou tels maux. Il peut ne pas tenir la parole qu’il a donnée, mais il ne peut pas empêcher que la tromperie ne produise la méfiance. Il peut attaquer son semblable, mais il ne peut pas empêcher que l’attaque ne produise la résistance, la crainte, la malveillance. Il peut bien ne pas prendre soin de ses enfants, mais il ne peut pas empêcher que l’abandon ne soit suivi d’une multitude de misères, et l’extinction de sa race.
On peut dire pour les causes productives de bien, ce que nous disons pour les causes productives de mal : partout où elles existeront elles seront suivies des mêmes résultats. Il est aussi impossible d’empêcher un peuple qui possède de bonnes institutions de prospérer, qu’il est impossible d’empêcher un peuple qui est soumis à de mauvaises lois de dépérir. Or, ces causes de prospérité ou de dépérissement produisant toujours les mêmes effets, étant inhérentes à notre nature, on a pu les considérer comme des lois auxquelles il est impossible à l’espèce humaine de se soustraire. Dans ce sens, il est vrai de dire avec Grotius et Blackstone, que les gouvernants n’ont pas la puissance de les changer ; ils peuvent les enfreindre, comme on peut violer toutes les lois, mais ils ne peuvent pas empêcher que l’infraction ne soit suivie de sa peine. S’il est dans la nature humaine, par exemple, que le défaut de sécurité produise la misère, il peut être au pouvoir d’un gouvernement de ne donner à la société aucune garantie ; il n’est pas en sa puissance de faire que cette privation ne produise pas le résultat que la nature y a attaché.
Mais les causes qui contribuent à la prospérité ou à la décadence d’un peuple sont très nombreuses ; et il est donné à peu de gens de les connaître. La plupart des hommes sont heureux ou misérables sans se douter de ce qui produit leur misère ou leur bien-être ; l’expérience même ne les éclaire pas, parce qu’ils ne savent pas remonter des effets aux causes, et que souvent même ils ne se doutent pas qu’ils puissent être autrement qu’ils ne sont. S’il leur arrive de s’apercevoir des conséquences de telle habitude ou de telle institution, ils manquent d’énergie pour l’adopter ou pour la détruire, selon qu’elle est bonne ou mauvaise. En général, les peuples profitent peu des expériences qui se font sur eux-mêmes ; les mauvaises habitudes et les mauvaises lois faussent le jugement, en même temps qu’elles détruisent les facultés physiques. Il est donc très difficile pour eux d’apercevoir les conséquences bonnes et mauvaises des actions et des institutions humaines ; de connaître, en un mot, quelles sont les lois suivant lesquelles les peuples prospèrent ou dépérissent.
Les jurisconsultes rendent à cet égard tout progrès impossible, en ne voyant, dans les lois auxquelles est soumis le genre humain, que des maximes en quelque sorte théologiques, dont on ne doit examiner ni l’origine, ni les conséquences. Suivant les uns, ces maximes se trouvent dans toutes les têtes ; suivant les autres, elles sont gravées dans tous les cœurs. Pour les connaître, il suffit de rentrer en soi-même, et de consulter les idées ou les sentiments qu’on apporte en venant au monde ; c’est pour cette raison, disent quelques-uns d’entre eux, que les lois naturelles règlent le passé, tandis que les lois positives ne règlent que l’avenir [24].
C’est en raisonnant sur une fausse analogie que les jurisconsultes ont été conduits à penser que tous les hommes avaient connaissance des lois auxquelles le genre humain est soumis par sa nature. Nous admettons, en législation pénale, que nul juge ne peut infliger un châtiment qu’en vertu d’une loi précédemment promulguée ; nous voulons que tout individu, avant que de commettre une action jugée mauvaise, puisse avoir connaissance de la peine à laquelle il s’expose : on trouverait qu’il y a de l’injustice et de la barbarie à punir une personne pour avoir enfreint une loi qu’elle ignorait. Or, on n’a pas voulu supposer qu’il y eût dans l’auteur de notre nature moins de justice et de raison que dans le plus mauvais de nos gouvernements ; s’il a soumis le genre humain à des lois invariables ; s’il a voulu que la misère et la décadence fussent la conséquence inévitable de telle conduite, et que la prospérité et l’accroissement fussent le résultat d’une conduite contraire, ne faut-il pas en conclure qu’il nous a donné connaissance des lois qu’il nous a imposées ? Pourrait-on, sans offenser sa bonté et sa justice, admettre qu’il nous punit, parce que nous enfreignons des lois que nous ignorons ?
Il est assez ordinaire que les hommes prêtent à la providence leur manière de penser et d’agir, et qu’ils mettent ensuite des suppositions à la place des faits pour ne pas la trouver en défaut. Cependant, cette manière de procéder est peu scientifique ; et, si l’on en faisait usage dans l’étude des sciences physiques, il est probable qu’on ne ferait pas un grand nombre de découvertes. Les lois qui régissent les plantes et les corps célestes, sont aussi anciennes, aussi invariables que celles suivant lesquelles un peuple prospère ou dépérit. L’ignorance des premières peut nous être funeste comme l’ignorance des secondes, et nous trouvons des avantages dans la connaissance de celles-là, comme dans la connaissance de celles-ci. Mais faut-il dire, pour cela, que les lois astronomiques sont celles que Dieu a promulguées au genre humain par la droite raison ? Faut-il en conclure que la raison éternelle a gravé dans tous les cœurs la connaissance de la botanique ? Dieu n’a pas promulgué les lois auxquelles notre nature est soumise, autrement qu’il n’a promulgué les lois du monde physique. Il ne les a pas plus gravées dans nos cœurs ou dans nos esprits qu’il n’y a gravé la connaissance de la chirurgie ou de la médecine.
L’idée que la providence n’a pas pu procéder autrement que les gouvernements, en déterminant les lois auxquelles la nature humaine serait soumise, n’est pas la seule qui a servi de base aux systèmes des jurisconsultes modernes sur les lois naturelles. Les jurisconsultes romains ayant admis un semblable système, et leurs décisions étant devenues des lois, on les a admises comme l’expression même de la vérité. On a cru que le respect qu’on devait à ces décisions ne permettait pas d’en faire l’examen, et l’on n’a pas même supposé que, dans le nombre, il put s’en trouver de fausses. La science de la législation est devenue ainsi une espèce de théologie qui a eu ses dogmes et sa croyance, et devant laquelle a dû s’abaisser la raison humaine. Il était plus facile, d’ailleurs, d’adopter un système tout fait et d’y croire sur parole, que d’examiner les choses en elles-mêmes, et de chercher la vérité par l’observation. D’un autre côté, l’habitude de voir les fondements de la morale ailleurs que dans la nature même de l’homme, devait égarer les esprits dans la recherche des principes de la législation. Il était naturel que celui qui ne trouvait une action bonne ou mauvaise que par la raison qu’elle était commandée ou défendue par le livre fondamental de sa religion, s’imaginât qu’en législation il n’y avait de vrai ou de faux que ce que tel code avait admis ou rejeté.
Il y a cependant, dans une loi, des choses qu’il faut bien distinguer. D’abord, la puissance qui lui appartient, soit qu’elle commande, soit qu’elle prohibe ; c’est en général la partie la moins contestée et la moins contestable. La puissance d’une loi est un fait qui se manifeste par des actes contre ceux qui refusent de la reconnaître. Il y a, en second lieu, les conséquences bonnes ou mauvaises qu’elle produit : ce sont encore là des faits auxquels on peut être forcé de se soumettre, mais que chacun a la faculté de juger. Enfin, il peut y avoir, dans la description d’une loi, des déclarations sur ce que les choses sont. Ces déclarations ne changent rien à la nature des choses ; ce sont des opinions semblables à celles que pourraient publier des personnes sans autorité ; elles sont incapables, soit de rien créer, soit de rien détruire. Tous les gouvernements du monde se réuniraient pour déclarer que le sang ne circule point dans nos veines, ou que la terre ne tourne point autour du soleil, que la nature n’en suivrait pas moins sa marche : ce qui est vrai continuerait de l’être, ce qui est faux le serait toujours. Or, les opinions des jurisconsultes romains sur les lois de notre nature, sont des opinions du même genre ; peu importe qu’elles aient été insérées dans un code de lois écrites, peu importe qu’elles aient été reproduites par une multitude d’écrivains ; ces circonstances ne sauraient leur donner une vérité qu’elles n’auraient pas par elles-mêmes.
Montesquieu, en adoptant un système qui lui est propre, a été entraîné par deux erreurs ; il a admis d’abord des idées innées, et il a pensé qu’à une époque quelconque, l’homme était sorti de son état naturel, pour passer dans un état qui n’est pas celui de sa propre nature. « Pour connaître bien les lois naturelles, dit-il, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les lois de la nature sont celles qu’il recevrait dans un pareil état. »
Les nations ont passé par divers états ; elles sont parties de l’ignorance la plus complète pour arriver au point où nous les voyons ; elles sont, peu à peu, devenues plus éclairées, mieux pourvues de choses nécessaires à leur existence, et par conséquent beaucoup plus nombreuses. Mais ce n’est pas en violant les lois de leur propre nature qu’elles ont fait des progrès ; c’est, au contraire, en apprenant à les connaître, et en s’y conformant tous les jours davantage ; c’est en étudiant les causes qui peuvent les faire prospérer ou dépérir ; c’est en multipliant les unes et en écartant les autres.
L’homme ne change pas de nature en passant d’un état d’ignorance et de dénuement à un état où il connaît mieux ses intérêts, et où il peut plus aisément satisfaire ses besoins. Un travail modéré, l’abondance des choses nécessaires à la vie, la paix, la sécurité, la modération dans les jouissances, produiraient sur une peuplade de sauvages, exactement les mêmes effets que sur un peuple civilisé. De même, un travail excessif ou une oisiveté absolue, la rareté et la mauvaise qualité des subsistances, la crainte d’être assailli à tout moment par des ennemis, un état de guerre continuel, produiraient sur le peuple le plus civilisé les mêmes effets que sur les peuples les plus barbares. Une nation tendant par sa propre nature vers sa prospérité, elle ne cesse d’être dans son état naturel que lorsqu’une force quelconque lui imprime un mouvement rétrograde, et la fait dépérir.
M. Bentham, après avoir réfuté le système des jurisconsultes sur les lois naturelles, expose ses propres idées sur le même sujet. Il distingue d’abord, en nous, deux genres d’inclinations : celles qui paraissent exister indépendamment des sociétés humaines, et qui ont dû précéder l’établissement des lois politiques et civiles, et celles qui n’ont pu prendre naissance qu’après l’établissement des sociétés. Il donne exclusivement aux premières le nom de lois naturelles : « Voilà, dit-il, le vrai sens de ce mot. » Mais c’est là l’erreur que j’ai déjà fait remarquer, et qui consiste à croire que le genre humain sort de son état naturel quand il suit une marche progressive. Les inclinations ou les sentiments de l’homme se développent et se rectifient à mesure que les facultés intellectuelles s’étendent, et il serait difficile de voir pourquoi les inclinations d’un individu ignorant et trompé prendraient le nom de naturelles, plutôt que les inclinations d’un homme qui est éclairé et qui a donné à ses sentiments une bonne direction. La qualification conviendrait beaucoup plus, ce semble, aux dernières qu’aux premières, puisque, en effet, les unes sont plus favorables que les autres à la prospérité du genre humain.
« Ce qu’il y a de naturel dans l’homme, ajoute M. Bentham, ce sont des sentiments de peine ou de plaisir, des penchants : mais appeler ces sentiments et ces penchants des lois, c’est introduire une idée fausse et dangereuse ; c’est mettre le langage en opposition avec lui-même : car il faut faire des lois précisément pour réprimer ces penchants. Au lieu de les regarder comme des lois, il faut les soumettre aux lois. C’est contre les penchants naturels les plus forts qu’il faut faire les lois les plus réprimantes. S’il y avait une loi de la nature qui dirigeât tous les hommes vers leur bien commun, les lois seraient inutiles. Ce serait employer un roseau à soutenir un chêne ; ce serait allumer un flambeau pour ajouter à la lumière du soleil. »
Après avoir rapporté un passage de Blackstone qui, s’appuyant de l’autorité de Montesquieu, dit que la nature impose aux parents l’obligation de pourvoir à l’entretien de leurs enfants, et que c’est cette obligation qui a fait établir le mariage, M. Bentham ajoute :
« Les parents sont disposés à élever leurs enfants, les parents doivent élever leurs enfants : voilà deux propositions différentes. La première ne suppose pas la seconde ; la seconde ne suppose pas la première. Il y a sans doute des raisons très fortes pour imposer aux parents l’obligation de nourrir leurs enfants. Pourquoi Blackstone et Montesquieu ne les donnent-ils pas ? Pourquoi se réfèrent-ils à ce qu’ils appellent la loi de nature ? Qu’est-ce que cette loi de la nature qui a besoin d’une loi secondaire d’un autre législateur ? Si cette obligation naturelle existait, comme le dit Montesquieu, loin de servir de fondement au mariage, elle en prouverait l’inutilité, au moins pour le but qu’il assigne. Un des objets du mariage est précisément de suppléer à l’insuffisance de l’affection naturelle. Il est destiné à convertir en obligation cette inclination de parents qui ne serait pas toujours assez forte pour surmonter les peines et les embarras de l’éducation [25]. »
J’ai dit, et je suis obligé de répéter que les hommes ne prospèrent pas à toutes conditions. Il existe pour eux des causes de prospérité et des causes de dépérissement, qui produisent constamment les mêmes effets. Ces causes ou ces conditions étant dans la nature des choses, nous pouvons les appeler des lois naturelles, puisque les biens ou les maux qui en résultent sont infaillibles. De ce que ces lois ne nous sont pas connues, ou de ce qu’il nous est possible de les violer, il ne faut pas en conclure qu’elles n’existent pas. Il en est des actions humaines comme de toutes les choses qui existent ; elles agissent indépendamment de la connaissance que nous pouvons avoir de leurs effets. Un homme qui prend du poison en croyant prendre un remède, ou un remède en croyant prendre du poison, éprouvera l’action de ce qu’il aura pris, comme s’il avait agi en pleine connaissance de cause. Il en est de même de celui qui se livre à une habitude vicieuse ou vertueuse ; ces habitudes agissent sur lui et sur les êtres de son espèce, indépendamment de la connaissance qu’il peut avoir des effets qu’elles produisent. Sans doute, les hommes qui connaissent les lois auxquelles est soumise la nature humaine, peuvent les enfreindre comme ceux qui ne les connaissent pas ; mais cela n’en prouve pas la non-existence. Il n’est personne qui ne puisse commettre quelques-uns des crimes que les lois punissent ; cela suffit-il pour contester l’existence ou l’efficacité de ces lois ? Blackstone et Montesquieu, au lieu de citer vaguement la loi naturelle comme base de l’obligation imposée aux parents d’élever leurs enfants, auraient mieux fait sans doute de faire connaître les causes qui déterminent les parents à les soigner ; mais ce sont précisément ces causes qui sont les lois de notre nature, puisqu’elles existent indépendamment de notre volonté, et que les effets en sont inévitables [26].
[I-143]
Il n’est pas exact de dire que c’est contre les penchants naturels les plus forts qu’il faut faire les lois les plus réprimantes, et s’il y avait une loi de la nature qui dirigeât tous les hommes vers leur bien commun, les lois seraient inutiles. Si cela était vrai, il faudrait faire des lois contre la tendance qui porte les hommes vers leur conservation et leur prospérité. Les hommes qui font des lois, s’ils ne sont ni des tyrans ni des esprits faux, examinent la manière dont les choses se passent dans le monde ; ils calculent les biens et les maux qui résultent de telle manière d’être ou d’agir, et s’ils voient que, par la nature des choses, tel fait produit toujours des conséquences funestes, ils le signalent comme nuisible ; et, pour que nul ne soit tenté de l’exécuter, ils ajoutent une peine nouvelle à celle que le fait eût pu produire pour son auteur ; ils rendent le châtiment plus fort, ou plus régulier, ou plus inévitable. S’ils trouvent, au contraire, que tel fait produit plus de biens que de maux, ils le signalent encore ; ils ajoutent quelquefois une récompense à la récompense que la nature elle-même y avait attachée, ou bien ils accroissent, pour celui qui l’omet, le mal qui serait résulté pour lui de l’omission. Mais l’action que ces hommes prescrivent ou prohibent n’est pas favorable ou funeste par la raison qu’il leur a plu de la déclarer telle, et de la récompenser ou de la punir ; elle l’est par les conséquences qui en résultent indépendamment de leur volonté. Ce n’est pas le médecin qui fait que telle manière de vivre produit telle maladie, ou que telle plante guérit de tel mal ; sa science se borne à faire voir ce que les choses sont, et à montrer la liaison des effets et des causes. Il en est de même des hommes qui décrivent ou font des lois ; ils ne rendent pas les actions bonnes ou mauvaises ; ils font connaître ce qu’elles sont ; ils favorisent les unes et diminuent le nombre des autres. La seule différence consiste dans le plus ou moins d’autorité.
En agissant ainsi, les hommes investis du pouvoir ne répriment point les penchants naturels les plus forts du genre humain ; au contraire, ils y obéissent, ils les secondent et en rendent les effets plus infaillibles. Si les législateurs voulaient imprimer aux peuples un mouvement contraire aux penchants les plus forts de l’homme, à ceux qui sont le plus dans sa nature, où prendraient-ils leur point d’appui ? Se placeraient-ils en dehors de la nature humaine ? Leurs instruments ne seraient-ils pas aussi des hommes ? En employant de tels instruments, ne se conduiraient-ils pas comme des enfants qui, se trouvant enfermés dans un vaisseau, voudraient le faire aller contre le courant en le poussant avec leurs mains [27]. Il ne faut donc pas dire que, s’il existait dans l’espèce humaine une force ou une loi qui dirigeât les hommes vers leur bien commun, toutes les lois seraient inutiles. Il serait plus vrai de dire, au contraire, que si cette force n’existait pas, toutes les lois seraient impuissantes, ou qu’il n’existerait que de mauvaises lois. Les peuples marcheraient vers leur ruine malgré tous les efforts qu’on ferait pour les retenir, ou, pour mieux dire, personne ne ferait de tels efforts, et jamais il n’eût existé de peuples, car le genre humain eût péri dès sa formation. Les hommes qui décrivent ou publient des lois et ceux qui composent des livres, ne sont pas d’une autre nature que ceux pour lesquels ces lois et ces livres sont faits : tous sont entraînés par le même mouvement. Il serait insensé de croire que la partie gouvernante ou législative des nations tend, par sa propre nature, vers le perfectionnement des peuples, tandis que la partie gouvernée tend naturellement vers sa ruine. La proposition contraire serait beaucoup plus facile à établir, dans les pays du moins où la population n’exerce aucune influence sur les affaires publiques.
Il est une illusion que je dois faire ici remarquer, parce qu’elle exerce une grande influence sur les idées, et qu’elle se reproduit souvent, soit en législation, soit en morale. Lorsqu’on parle de législateurs et de peuples, il semble que ce sont des êtres tellement distincts qu’ils ne sont pas de même nature ; les uns sont présentés comme une espèce de dieux, qui donnent à tout ce qui est placé au-dessous d’eux le mouvement et la vie ; les autres paraissent, au contraire, des êtres privés d’action, ou n’ayant qu’une action irrégulière ou désordonnée ; les lois semblent alors des puissances placées hors de la nature humaine, et se montrent comme un pouvoir en quelque sorte surnaturel. Mais, si l’on ne se laisse pas tromper par le mot, on ne verra, dans les législateurs et dans les peuples, que des êtres de même nature, sujets aux mêmes besoins, aux mêmes passions, aux mêmes préjugés ; on verra, dans la formation de certaines lois, une partie du genre humain agissant sur une autre partie, en même temps qu’elle agit sur elle-même. Cette action d’un peuple ou d’une partie d’un peuple, sur lui-même ou sur une partie de lui-même, est tout aussi simple que celle qu’exerce un individu sur sa propre personne. Si elle a pour effet de le faire prospérer, on peut dire qu’elle est naturelle ou conforme à sa nature ; si, au contraire, elle tend à le dégrader ou à le rendre misérable, on peut dire qu’elle est contraire à sa nature, ou qu’elle ne lui est point naturelle. Le sauvage qui poursuit par la vengeance le meurtrier de son fils, de son père ou de son ami, obéit, dit-on, à la loi de sa propre nature : on doit considérer comme une sanction naturelle le châtiment qu’il inflige à celui qui l’a offensé. Mais pourquoi ne considérerait-on pas également comme des actions naturelles les peines que des collections d’hommes établissent ou infligent pour la sûreté commune, et les précautions qu’ils prennent pour rendre le châtiment plus juste, plus sûr et plus exemplaire ? A-t-il dépendu d’une partie du genre humain de se placer hors de sa propre nature ?
Les systèmes des jurisconsultes sur les lois naturelles consacrent un certain nombre de maximes dont l’observation est généralement utile pour le genre humain : mais ces maximes, présentées comme elles le sont, ne portent avec elles aucune lumière. Ainsi, lorsqu’on nous assure que la loi naturelle ordonne au père d’avoir soin de ses enfants, aux époux d’être fidèles l’un envers l’autre, aux débiteurs de remplir leurs engagements, on n’apprend rien à personne. Il faudrait, pour que l’enseignement fût profitable, exposer les faits généraux qui ont donné naissance à ces maximes, et présenter ensuite toutes les conséquences auxquelles on est nécessairement conduit en les violant ou en les observant : on verrait alors quelles sont les lois auxquelles la nature humaine est soumise. D’un autre côté, en posant en principe qu’il n’y a pas d’autres lois naturelles que celles que chacun trouve dans son esprit ou dans son cœur, ou autorise tout individu qui a reçu une éducation vicieuse, à se livrer à tous les désordres qu’on ne lui a pas appris à détester ; et l’on rend impossible tout progrès dans la morale ou dans la législation, puisque nul ne peut se croire moins instruit qu’un autre.
Mais le système qui n’admet l’existence d’aucune loi naturelle, ou qui considère la législation comme un ouvrage en quelque sorte artificiel, n’est pas exempt d’inconvénients. Il est clair d’abord que, si le genre humain n’était pas soumis à des règles invariables de prospérité ou de dépérissement ; si, son organisation étant donnée, les mêmes causes ne produisent pas constamment sur lui les mêmes effets, il n’y aurait point de science possible. Les connaissances qu’on acquerrait seraient infructueuses, puisqu’on ne pourrait en faire résulter aucune règle de conduite. En présentant les lois comme l’ouvrage d’un certain nombre d’individus, et non comme des conséquences de la nature même de l’homme, on ouvre un vaste champ à l’arbitraire, puisque l’esprit de système cesse d’avoir des bornes. Enfin, en posant en principe que la tendance la plus forte du genre humain ne porte point les hommes vers leur perfectionnement, et que les lois ont pour but de réprimer leurs sentiments les plus naturels et les plus énergiques, on est obligé de considérer les individus par qui les lois sont faites, déclarées ou décrites, comme une espèce particulière, dont la tendance naturelle les porte vers le bien, tandis que la tendance générale des peuples est vers le mal.
La méthode de raisonnement, dont fait usage l’illustre savant qui n’a pas craint d’attaquer les idées de ses devanciers, repousse, il est vrai, de semblables conséquences ; mais les inexactitudes qui lui sont échappées peuvent servir à combattre les grandes vérités qu’il a établies. Il peut reconnaître avec nous que le genre humain est invariable dans sa nature ; que les mêmes causes produisent toujours sur lui les mêmes effets ; qu’il dépérit ou prospère suivant des règles immuables ; il suffira qu’il ait refusé le nom de lois naturelles à cet enchaînement nécessaire d’effets et de causes, pour soulever contre lui une multitude de sentiments et de préjugés, et pour faire rejeter les vérités les plus clairement démontrées.
J’ai dit que le genre humain ne sort pas de son état naturel lorsqu’il suit une marche progressive, et que, la perfectibilité étant dans sa nature, plus il se perfectionne, plus l’état dans lequel il se place lui est naturel. Il suit de là qu’on tombe dans une inconséquence, lorsqu’on met en opposition les lois qu’on nomme naturelles avec les lois qu’on nomme positives. Si un peuple suit la marche qui lui est naturelle lorsqu’il fait un progrès, il obéit aux lois de sa propre nature lorsqu’il adopte une bonne institution ou qu’il en détruit une mauvaise. On peut mettre en opposition une loi qui produit de bons effets avec une loi qui en produit de mauvais ; une bonne loi avec une loi mauvaise ; [I-150] une loi naturelle avec une loi contraire à la nature de l’homme ; on sait alors ce que cela signifie. Mais opposer les lois naturelles aux lois sociales, les lois de la nature aux lois positives, c’est se mettre en contradiction avec soi-même, ou supposer que l’homme sort de son état naturel, à mesure qu’il se débarrasse de ses erreurs, de ses vices et de ses misères.
Ayant examiné les principaux systèmes qu’on a faits sur les lois naturelles, je terminerai ce chapitre par quelques observations sur ce qu’on nomme le droit naturel ; c’est exactement le même sujet donné par une expression différente.
Il n’est personne, ayant quelque connaissance de notre langue, qui ne sache quelle est la signification de l’adjectif droit, droite, lorsqu’il est appliqué à un objet matériel ; personne n’a besoin qu’on lui définisse ce que c’est qu’une ligne droite, un arbre droit. Le même mot, employé dans un sens figuré ou dans un sens moral, a une signification semblable. Ainsi, admettant que le genre humain tend naturellement vers son perfectionnement ou sa prospérité, on considèrera comme droite toute action qui tendra vers ce but par le chemin le plus court. On dira que tel homme a naturellement le droit de faire telle chose, pour indiquer qu’il est utile au genre humain que cette chose puisse être librement faite par lui et par tous les hommes qui se trouvent dans la même position que lui. On dira que tel acte est contraire au droit naturel, pour indiquer qu’il met obstacle à des actions utiles aux hommes, ou qu’il fait exécuter des actions funestes. C’est encore là une expression abrégée qui suppose une démonstration faite, ou jugée inutile à cause de l’évidence des faits ; mais cette expression ne signifie rien toutes les fois qu’aucune démonstration n’a eu lieu, et que les faits ne sont pas établis.
Lorsqu’on parle du droit naturel comme science, on ne peut désigner par là que la connaissance des lois suivant lesquelles le genre humain prospère ou dépérit : c’est la science de la législation. Pour la plupart des jurisconsultes, c’est tout simplement la connaissance d’un certain nombre de maximes, dont on ne recherche ni les causes ni les conséquences.
On donne le nom de droit positif aux lois particulières à chaque nation, en faisant abstraction du bien et du mal qu’elles produisent ; c’est la science des jurisconsultes.
On confond souvent le mot droit avec les mots faculté, puissance, autorité : ces mots sont loin cependant d’avoir la même signification. En prenant le mot droit dans le sens qu’il a naturellement, rien de ce qui est droit ne peut être funeste aux hommes, considérés sous un point de vue général ; mais on ne peut pas dire également que nul acte de puissance ou d’autorité ne peut être malfaisant. Un père a la faculté ou la puissance de faire élever ses enfants comme il juge convenable ; s’il les fait mal élever, il abuse de son pouvoir, mais il n’use pas d’un droit. Un magistrat sur son siège a la puissance ou la faculté de prononcer un arrêt contre sa conscience ; mais si, après avoir rigoureusement observé les formes extérieures qui lui sont prescrites, il envoie un innocent à l’échafaud, personne n’osera dire qu’il a fait usage de ses droits. L’autorité et la puissance supposent, dans ceux qui en sont revêtus, des devoirs à remplir : le droit, chez un individu, place, dans d’autres, le devoir ou l’obligation [28].
En donnant aux mots lois naturelles le sens que nous y avons attaché, quel est l’état le plus naturel à l’homme ? C’est évidemment celui dans lequel il prospère le mieux, celui dans lequel toutes ses facultés morales, intellectuelles et physiques, se développent avec le plus de liberté. L’état qui est le plus contre sa nature est celui dans lequel il souffre le plus, celui qui présente au perfectionnement et à l’accroissement de son espèce les obstacles les plus nombreux et les plus forts.
[I-153]
CHAPITRE VI.↩
Du système dans lequel on considère les lois civiles et politiques comme des conséquences d’une convention primitive, ou du Contrat social de J.-J. Rousseau, et de l’opposition qui existe entre ce système et la méthode analytique.
Une nombreuse assemblée, composée de gens raisonnables, se réunit dans l’intention d’entendre l’exposition des principes d’une des sciences les plus intéressantes pour le genre humain ; le professeur qui a promis de lui faire part de ses lumières, se présente devant elle pour remplir sa promesse ; il commence par annoncer qu’il écartera tous les faits, et n’en tiendra aucun compte ; il dit ensuite qu’il fera une supposition, fausse à la vérité, mais qu’il la considérera comme vraie ; qu’il tirera de cette supposition une multitude de conséquences aussi imprévues qu’intéressantes ; et que ces conséquences, systématiquement exposées, formeront la science qu’il a promis d’enseigner.
Se trouvera-t-il, je le demande, beaucoup de personnes qui, après un tel préliminaire, consentent à en entendre davantage ? S’il s’en trouve quelques-unes que la curiosité retienne, s’en trouvera-t-il d’assez simples pour s’imaginer qu’elles vont réellement apprendre quelque chose ? S’il était question d’histoire naturelle, de physique, de chimie ou d’astronomie, il n’est pas douteux que le prétendu professeur serait sur-le-champ abandonné, peut-être même serait-il accueilli par des huées. Mais, s’il était question de législation ou de politique, il se pourrait bien que l’assemblée fût saisie d’admiration, en entendant un si magnifique début, surtout s’il était soutenu par un style pompeux et par un ton dogmatique.
Les Principes de droit politique de J.-J. Rousseau, ou son Contrat social, ces principes qui ont été considérés comme les oracles de la sagesse, sont-ils, en effet, autre chose qu’une suite de déductions tirées d’une supposition évidemment fausse ? Quel est le pays dans lequel des hommes se sont réunis, de propos délibéré, pour former un peuple, et régler, par une convention, les conditions de leur association ? Comment ces hommes ont-ils été doués de tant de sagacité, de tant de prévoyance, que tous les peuples qui sont venus après eux, ont dû être gouvernés par ce contrat, et qu’ils ne sauraient y ajouter, ni en retrancher un seul mot, sans cesser d’être ? Comment est-il arrivé que toutes les nations qui couvrent la terre, aient procédé au moment de leur formation par une convention conçue dans les mêmes termes ? Quel est le moyen à l’aide duquel Rousseau est parvenu à connaître des procédés qui sont antérieurs à tous les monuments historiques ? Comment les peuples actuels et les peuples à venir peuvent-ils se trouver irrévocablement liés par un contrat qu’ils n’ont certainement pas fait, et dont rien ne leur révèle l’existence ? Comment, enfin, un contrat qui est antérieur à toute espèce de lois et de gouvernement, a-t-il pu être obligatoire ? Qu’est-ce qui a pu en faire la force, puisqu’il fait lui-même la force des lois et des autorités publiques ?
Ces questions seraient fondées, si le contrat social était un fait dont l’existence fût positivement affirmée ; mais comme ce n’est qu’une supposition fausse, destinée à servir de base à un système, il est clair que toute question relative à l’existence de ce pacte, est sans objet. Il ne peut plus être question que de savoir comment l’auteur a pu être conduit à voir, dans les conséquences d’une fausse supposition, des principes du droit politique, et quelle a été et quelle peut être encore l’influence de ces prétendus principes.
Il est peu d’écrivains qui aient manifesté, en faveur de la liberté, des sentiments plus vifs que ceux qui sont exprimés dans les écrits de Rousseau ; et il n’en est peut-être aucun qui ait établi des maximes plus propres à conduire les peuples à la servitude ou à l’anarchie. Lorsque cet écrivain attaque les auteurs qui ont parlé en faveur du pouvoir absolu, il déploie une force de raisonnement qui n’appartient qu’à lui ; et lorsqu’il veut établir des principes de législation, on croirait entendre le ministre d’un sultan, qui veut créer des hommes libres. Cette opposition entre ses sentiments et ses maximes, explique la popularité dont il a joui, et les erreurs déplorables dans lesquelles il a entraîné ses aveugles admirateurs. Tout le monde pouvait partager ses sentiments, peu étaient en état de juger ses idées.
On sait comment, par le désir de faire effet, et sur le conseil que lui donna Diderot, Rousseau fut conduit à soutenir que les sciences et les arts avaient plus contribué à corrompre qu’à épurer les mœurs. Une fois engagé dans cette route, il s’y enfonça toujours de plus en plus, autant par vanité que par le mépris que lui inspiraient ses adversaires. Il finit par croire à la vérité d’une opinion qu’il n’avait d’abord soutenue que comme un jeu d’esprit et pour faire preuve d’habileté. En passant d’une conséquence à l’autre, il devait arriver à croire qu’à chaque pas que les peuples avaient fait dans la civilisation, ils s’étaient enfoncés dans le vice et la misère, et que, pour trouver le temps où ils avaient eu le moins de vices et le plus de bonheur, il fallait remonter à une époque où les hommes vivaient isolés dans les bois, comme des bêtes sauvages, et où ils n’avaient pour nourriture que de l’eau et du gland. Ce fut, en effet, à cette conséquence qu’il arriva : il prétendit que l’état d’isolement était l’état naturel de l’homme ; que la formation de la famille était déjà un premier pas vers la corruption, et que la réunion en société était un état contre nature.
[I-157]
Ces principes étant admis, il ne lui était plus possible de considérer la formation et l’accroissement des peuples comme une suite naturelle du développement du genre humain ; il ne pouvait plus considérer les mœurs et les lois des nations comme des conséquences du besoin et des facultés de l’homme, ou, pour mieux dire, de son organisation, puisque c’eût été reconnaître que les nations, en perfectionnant leurs lois ou leurs institutions, n’avaient pas agi d’une manière contraire à la nature humaine. D’un autre côté, son amour pour l’indépendance, avantage inappréciable de l’état de nature, ne lui permettait pas d’admettre, avec quelques publicistes, que les hommes s’étaient soumis volontairement à des chefs. Pour expliquer la formation des peuples et leur soumission à un gouvernement, il fallut trouver un moyen qui ne fût, ni une conséquence de la nature de l’homme, ni une application de la force, ni l’abnégation de la liberté : ce fut le contrat social ; c’est-à-dire la supposition d’une convention entre des individus isolés, se réunissant pour former un peuple. Voici comment il établit ce système.
Rousseau suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature l’emportent, par leur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s’il ne changeait de manière d’être.
Mais les hommes ne peuvent pas créer de nouvelles forces pour vaincre les obstacles qui nuisent à leur conservation ; ils ne peuvent qu’unir et diriger celles qui existent ; et comme la force et la liberté de chaque individu sont les premiers instruments de sa conservation, il se présente une difficulté : c’est de savoir comment il les engagera sans se nuire, et sans négliger les soins qu’il se doit.
Nos sauvages, qui jusqu’ici avaient vécu isolés comme des ours, qui n’avaient eu aucun langage, qui n’avaient consulté que l’instinct et l’appétit, s’aperçoivent de la difficulté ; un d’entre eux, sans doute un géomètre, pose la difficulté en ces termes : « Trouvez une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. »
Tel est le problème qui se présenta à résoudre. Rousseau ne nous dit point dans quelle langue il fut exprimé, ni même s’il fut proposé par écrit ; il nous apprend seulement que le contrat social en donna la solution, sans même daigner nous instruire quel fut le rare génie qui imagina ce contrat. Il rapporte ce contrat en ces termes, après en avoir écarté ce qui n’est pas de son essence : Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps, chaque membre comme partie indivisible du tout.
Sans doute, quand le contrat fut ainsi proposé, il se trouvait dans l’assemblée des enfants et des femmes, et comme il n’y avait pas de loi positive qui distinguât les capables des incapables, il serait bon de savoir comment la distinction en fut faite. Il serait bon de savoir également si les parties contractantes s’engagèrent, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leur postérité, et si elles se crurent autorisées à traiter pour les générations à venir. Enfin, il serait curieux de savoir si, lorsqu’on proposa la formule chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance , les dames ne furent pas effrayées, et ne demandèrent pas quelques explications avant que de signer le contrat.
L’aliénation que chacun fit de sa personne et de sa puissance fut sans réserve ; car, suivant Rousseau, chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu’elle se forme, tel qu’il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu’il possède font partie. Les clauses de ce contrat, dit-il, sont tellement déterminées par la nature de l’acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu’à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça.
Ainsi, le contrat social est admis tacitement partout où les clauses n’en sont point violées, ce qui est certainement incontestable ; mais la violation d’une des clauses le rend nul, et chacun reprend alors sa liberté naturelle. Si donc il arrive qu’un des associés, après avoir mis en commun sa personne et toute sa puissance, ne tienne pas l’engagement qu’il a contracté ; s’il n’obéit pas à la suprême direction de la volonté générale ; s’il prend la fuite quand il est appelé au combat ; s’il refuse de payer sa part de l’impôt ; si, de retour d’un voyage, il soustrait aux recherches des douaniers une paire de boucles ou un mouchoir des Indes, il viole évidemment le contrat social ; à l’instant l’État est dissous ; chacun reprend sa liberté naturelle, et a droit à tout ce qu’il peut atteindre.
Mais, avant que d’examiner quelles sont les conséquences de la violation du contrat, voyons quelles sont les suites immédiates de sa formation. Aussitôt que la formule en est rédigée et unanimement adoptée, les associés passent de l’état de nature à un ordre social parfait : la justice est sur-le-champ substituée à l’instinct, les actions prennent une moralité qu’elles n’avaient pas ; la voix du devoir succède à l’impulsion physique, et le droit à l’appétit ; les facultés s’exercent et se développent ; les idées s’étendent ; les sentiments s’ennoblissent ; l’âme tout entière s’élève ; un animal stupide et borné devient un être intelligent et un homme ; et si des abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais.
Cette transformation miraculeuse d’une multitude d’animaux stupides et bornés, n’ayant entre eux aucune liaison, en une population unie, intelligente, morale, et rigoureuse observatrice de ses devoirs, est due uniquement à la vertu secrète du contrat social, au pouvoir magique de ces paroles : chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Ces mots sont à peine prononcés, que la ruse du sauvage devient de la bonne foi, l’avidité du désintéressement, la cruauté de l’humanité, et l’intempérance de la modération.
Avant le contrat, ces animaux stupides et bornés, qui n’obéissaient qu’à l’instinct et à l’appétit, et dont les actions étaient sans moralité, avaient cependant des biens. Rousseau ne nous a point appris d’où ils les tenaient. Les avaient-ils créés par leurs travaux ? Les avaient-ils reçus de leurs ancêtres ? Le premier moyen n’est guère vraisemblable ; car des animaux stupides, isolés et sans protection, ne doivent pas être fort laborieux. Le second moyen suppose un ordre social déjà établi. Les biens de chacun des membres de la société passent à l’État par le seul effet du contrat. L’État, dit Rousseau, à l’égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l’État sert de base à tous les droits. Cependant les particuliers ne sont pas dépouillés des biens qu’ils possèdent, mais ils sont considérés comme dépositaires du bien public.
Les associés ne mettent pas en commun leurs biens seulement, ils y mettent aussi leurs personnes ; et, comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens. Il suit de là que, quand le prince a dit à un citoyen, il est expédient à l’État que tu meures, il doit mourir ; puisque ce n’est qu’à cette condition qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, et que sa vie n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’État.
La fin du contrat social est le plus grand bien de tous ; et le grand bien de tous se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité. Mais cette liberté ne consiste pas à disposer de soi de la manière qu’on juge convenable ; à faire de ses facultés et de ses moyens l’usage qu’on croit le plus avantageux. Elle consiste à se conformer à la loi, même quand la loi nous gêne ; on peut même dire que plus la loi met des entraves à l’exercice de nos facultés individuelles, et plus elle approche de la perfection. Elle est parfaite, si elle parvient à anéantir les forces naturelles de l’homme à tel point, qu’il soit incapable d’agir, si ce n’est au moyen de forces qui lui soient étrangères et en faisant usage du secours d’autrui. On va voir quel est le moyen à l’aide duquel les associés peuvent obtenir des lois si parfaites, et devenir des hommes libres.
Le contrat social est rédigé et adopté. À l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui prend des noms divers selon le point de vue sous lequel on la considère, s’appelle souverain, lorsqu’elle fait des lois. Toute sa puissance consiste à vouloir, et chacune de ses volontés est une loi. Sa puissance est indivisible, inaliénable, intransmissible ; de sorte qu’aucun peuple ne peut prétendre avoir des lois, si la personne morale que le contrat social a formée, ne les a pas faites.
C’est le contrat social qui forme le souverain ; c’est le souverain qui forme la loi, et la loi ne peut se former qu’à la majorité ; le seul acte qui exige l’unanimité, est celui qui sert de fondement à tout le reste. Les lois sont donc l’expression de la volonté générale, c’est-à-dire de la majorité des membres du souverain. Lorsque chacun est admis à voter, nul ne peut se plaindre du résultat de la délibération ; elle est essentiellement juste, puisque nul n’est injuste envers soi-même, que la volonté générale est toujours droite, et qu’elle tend toujours à l’utilité publique.
Mais, quoique nul ne puisse être injuste envers soi-même, et que la volonté générale, qui n’est que celle de la majorité, soit toujours droite, le peuple peut ne pas toujours voir ce qui lui est avantageux. Il a besoin d’un guide, d’un homme qui le fasse vouloirs en un mot, d’un législateur. Ce législateur doit se proposer, ainsi qu’on l’a vu précédemment, la liberté et l’égalité, et voici comment il y parvient.
Il faut qu’il se sente en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être ; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer ; de substituer une existence partielle et morale à l’existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses forces, pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et parfaite : en sorte que si chaque citoyen n’est rien, et ne peut rien que par les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre.
Il se présente ici une difficulté : un acte ne peut avoir le caractère de loi, et être obligatoire pour les membres de la communauté, qu’autant qu’il est l’ouvrage du souverain, et qu’il exprime la volonté de la majorité. Il faut donc que le législateur trouve le moyen de faire adopter ses idées par le souverain qui ne les comprend pas, ou qui les trouve fausses ou funestes. Les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien, n’en sauraient être entendus : or, dit Rousseau, il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée ; chaque individu, ne goûtant d’autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois.
Le raisonnement est impuissant ; la force ne peut être employée ; c’est donc une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence, et persuader sans convaincre. Ici Rousseau s’arrête, comme s’il craignait d’expliquer nettement sa pensée, en nous faisant connaître sans détour quelle est cette autorité qui est étrangère au raisonnement et à la force. On ne peut douter cependant du sens de ses paroles, lorsqu’on lit immédiatement :
« Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l’intervention du ciel et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois de l’État comme à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique [29]. »
Laissons de côté les pères des nations, qui n’ont rien à faire ici, les modestes philosophes qui croient honorer la divinité en lui attribuant leurs sublimes conceptions, et les citoyens qui consentent à porter en commun le joug de la félicité publique ; examinons la pensée de Rousseau, en la dégageant du pompeux appareil sous lequel il nous la présente. De quoi s’agit-il ? de faire adopter, par la majorité d’un peuple, des lois qui lui déplaisent. Comment doit s’y prendre pour arriver à ce but, un homme qui trouve le raisonnement insuffisant, et qui ne peut ou ne veut pas faire usage de la force ? Il doit mentir, et tromper ses crédules auditeurs ; il doit, par des prestiges ou des miracles, leur persuader qu’il a reçu une mission du ciel ; il doit leur faire croire que les ordres qu’il leur apporte, sont dictés par la divinité, et que ceux qui refuseront de s’y soumettre, subiront des peines plus ou moins sévères dans ce monde ou dans un autre.
Voilà donc à quoi se réduit l’expression de la volonté générale ! À l’adoption, par une multitude égarée, des opinions d’un imposteur ! Et comme une telle méthode ne comporte ni discussion, ni raisonnement ; comme le succès du moyen dépend de l’ignorance de la majorité et du silence ou de la complaisance de la minorité ; comme les hommes éclairés forment toujours le petit nombre, et se laissent difficilement tromper, il est aisé de prévoir que la conséquence de l’adoption des lois proposées, sera le massacre ou la proscription des opposants ; ce seront des incrédules, des athées, des ennemis des dieux, peut-être même des organes des puissances infernales ; leur existence serait incompatible avec la durée du nouvel ordre de choses ; car, s’ils démasquaient l’imposteur, ils renverseraient son système.
Puisque le mensonge et la peur sont, aux yeux de Rousseau, des moyens légitimes de faire adopter un système de législation, par une population ignorante, on ne voit pas pourquoi il se borne à une espèce particulière d’imposture ou de frayeur ; pourquoi un fourbe qui menacerait un peuple stupide du feu du ciel, serait préférable à un chef d’armée qui menacerait un peuple moins ignorant du feu de son artillerie : l’un peut aussi bien que l’autre déterminer l’expression de la volonté générale. Il est même rare que les deux moyens ne marchent pas ensemble : les mensonges sont pour les ignorants ; les violences pour les raisonneurs. Rousseau convient, au reste, qu’il ne suffit pas de mentir, mais qu’il faut de plus une grande âme.
Lorsque la majorité a adopté les lois qui ôtent à chacun ses forces pour lui en donner qui lui soient étrangères, et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui ; lorsque les forces individuelles de chacun sont mortes et anéanties ; lorsque chaque citoyen n’est rien et ne peut rien que par le secours des autres, et que chacun a ainsi acquis la plus grande somme de liberté possible, il peut se trouver des individus qui veuillent être quelque chose par eux-mêmes, qui désirent de jouir d’un peu d’action sans le secours d’autrui, et tendent à ressusciter une petite partie de leurs forces mortes et anéanties : cette tendance doit être réprimée par tout le corps, afin que le pacte social ne soit pas un vain formulaire. Ce pacte renferme, en effet, l’engagement tacite qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose, dit Rousseau, sinon qu’on le forcera d’être libre : car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle, et particulièrement de la sienne.
Le législateur ne doit pas se proposer seulement la liberté ; il doit se proposer aussi l’égalité. Il ne faut pas entendre, par ce dernier mot, que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes ; mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessus de toute violence, et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois ; et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Il ne faut pas non plus entendre par le mot égalité l’exclusion des privilèges, même héréditaires : la loi peut bien statuer, dit Rousseau, qu’il y aura des privilèges, mais elle ne peut en donner nommément à personne ; il faut que les familles ou les individus qui doivent être privilégiés soient choisis, non par le souverain, mais par le gouvernement. On peut donc, sans blesser l’égalité, établir des castes comme dans les Indes ; donner aux uns une puissance plus ou moins étendue sur les autres ; former une classe de parias ; on peut donner à une partie de la population le privilège d’exercer, à l’exclusion des autres, certaines professions, certaines branches d’industrie ou de commerce, ou même certaines fonctions publiques : on peut ordonner même que les enfants ne pourront jamais embrasser d’autres professions que celle de leur père, sans blesser en rien l’égalité ; il suffira que la puissance ne soit jamais exercée qu’en vertu du rang et des lois. Quant à l’égalité de richesses, qui consiste en ce que nul citoyen ne soit assez riche pour pouvoir en acheter un autre, il n’y a pas d’autre moyen de l’établir que de rechercher quelle est la valeur que met à ses opinions l’individu le plus bas, le plus méprisable, le plus vénal qui soit dans l’État ; lorsque cette valeur aura été déterminée, il faudra niveler les fortunes de manière que nul n’ait le moyen d’acheter ce misérable. Cette perfection est difficile à atteindre ; Rousseau convient même que, dans la pratique, elle est une chimère, mais c’est une chimère vers laquelle le législateur doit tendre de toute sa puissance.
Un législateur est un homme rare qui ne paraît qu’à de longs intervalles, et qui a même besoin de saisir, pour établir ses lois, l’instant précis où un peuple est mûr pour la législation. Le souverain qui a besoin de faire des lois tous les jours, ne peut donc pas espérer d’être constamment dirigé par un génie qui le trompe pour son bien. On peut, à l’aide d’une adroite organisation, trouver le moyen d’obtenir l’expression de la volonté générale, sans consulter même la majorité. Il suffit pour cela de diviser le souverain en fractions, de faire plusieurs fractions des citoyens riches et puissants, de mettre la multitude dans une seule classe, et de faire ensuite voter par classes et non par têtes. Par ce moyen, il arrivera qu’on aura obtenu l’expression de la volonté générale, sans qu’il ait même été nécessaire de consulter la classe la plus nombreuse, celle qui renferme la majorité des citoyens. Si on la consulte, ce sera seulement pour rendre hommage à son impuissante souveraineté.
On aurait pu objecter à Rousseau que son contrat social ne pouvait pas être obligatoire pour ceux qui n’y avaient pas donné leur assentiment. Il a prévu cette objection, et, pour y répondre, il dit qu’on est supposé y consentir, quand on ne manifeste pas une opinion contraire. Mais, outre qu’une supposition de consentement, n’est pas la même chose qu’un consentement, il reste une autre difficulté à résoudre ; c’est de savoir quel est l’âge auquel on est supposé avoir consenti, et quel rang tiennent dans l’État les personnes qui sont incapables de consentir, ou qui s’y refusent. Si le contrat social n’est obligatoire, ni pour les enfants, ni pour les insensés, ni pour les étrangers, ni pour ceux qui ne veulent pas s’y soumettre, les lois qui ne sont qu’une conséquence de ce contrat, doivent être bien moins obligatoires encore ; elles ne doivent aux personnes de ces classes aucune protection ; ces personnes ne doivent aux lois aucune obéissance. Un enfant en naissant ne doit appartenir à aucune nation ; n’ayant rien promis à un État dont il n’est pas membre, il ne doit ni impôt, ni service militaire, et à son tour l’État ne lui doit rien. Ce peut être aussi une question de savoir si les femmes, qui, dans aucun pays, n’ont jamais fait partie du souverain, doivent être soumises à des lois qu’elles n’ont point consenties, et si elles ne se trouvent pas dans l’état de nature, au sein même de la société. On ne peut pas dire, à leur égard, qu’elles sont supposées avoir consenti au contrat social et aux lois, puisqu’elles ne sont pas admises à manifester leur consentement.
Ayant exposé les principes et l’étendue du pacte social, il reste à examiner quelles sont les conséquences auxquelles on peut arriver à l’aide de ce système.
Nous voyons d’abord qu’on ne peut l’admettre qu’en allant de fausse supposition en fausse supposition, et qu’on arrive même à un terme où les fausses suppositions s’arrêtent, parce qu’on se trouve réduit à supposer l’impossible, tel que le consentement d’individus qui ne peuvent avoir de volonté. Ainsi, l’on suppose d’abord que tous les peuples se sont formés par un acte unique, et que chaque individu a mis en commun sa personne et ses biens ; on suppose ensuite qu’à mesure que chaque homme arrive à un âge de raison, il donne son assentiment au prétendu contrat qu’on a déjà supposé ; on suppose de plus qu’en formant le contrat supposé, ou en donnant son assentiment supposé, on a consenti à trouver bonnes toutes les lois qu’adopterait la majorité ; on suppose enfin que la minorité qui repousse des projets de loi, les veut en réalité, puisque l’approbation s’en trouve dans le contrat supposé.
Rousseau ne connaît pour le genre humain que deux positions ; l’état de nature, et l’état dans lequel la place le contrat social. Suivant lui, tout peuple qui n’admet pas ce contrat reste dans l’état de nature, et tout peuple qui le viole, y retombe par ce seul fait. Ainsi, une nation peut se croire extrêmement civilisée, tandis que les individus qui la composent se trouvent, les uns à l’égard des autres, dans la même position que ces animaux stupides et bornés, dont la vertu magique du contrat social n’a pas encore fait des hommes. Dans l’état de nature, il n’existe pas de justice ; l’homme ne connaît que l’instinct ; ses actions n’ont point de moralité ; il a un droit illimité à tout ce qui lui est nécessaire, même à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre [30] ; il ne doit rien à ceux à qui il n’a rien promis ; il ne reconnaît pour être à autrui que ce qui lui est inutile [31].
[I-174]
Mais le contrat social crée la justice, donne de la moralité aux actions humaines, devient le principe des lois, qui sont elles-mêmes la source de tous les droits. Si le contrat social n’est pas formé, les hommes restent dans l’état de nature ; s’il est violé, ils y retombent. Mais qu’arrive-t-il alors ? Chacun, dit Rousseau, rentre dans ses premiers droits, et reprend sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle par laquelle il y renonça [32].
Les conséquences de la violation du contrat social sont si terribles, qu’il importe de se faire une idée claire du fait qui les produit. On pourrait être porté à penser que le gouvernement qui ne remplit pas ses devoirs, ou qui se rend coupable d’oppression, viole le contrat social. Mais ce contrat est antérieur à l’acte par lequel le gouvernement est institué ; les membres du gouvernement ne peuvent donc pas être au nombre des parties contractantes ; ce n’est absolument, dit Rousseau, qu’une commission, un emploi dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent, en son nom, le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu’il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît. Ce ne sont donc pas, à proprement parler, les attentats des gouvernements qui violent le pacte social.
Ce pacte ne peut être violé que de deux manières : si un ou plusieurs individus ne remplissent pas les engagements qu’ils ont contractés envers le corps ; si le corps ne remplit pas les engagements qu’il a contractés envers les individus. Les particuliers violent leurs engagements, s’ils peuvent se soustraire impunément à l’exécution d’une loi quelconque ; le corps politique viole les siens, s’il n’a pas le moyen ou la puissance d’obliger chaque individu à se soumettre à la suprême direction de la volonté générale : s’il ne peut pas empêcher un membre du gouvernement, par exemple, de s’approprier une partie de la fortune publique, ou d’opprimer un citoyen.
Lorsqu’un de ces événements arrive, le contrat social est donc violé ; chacun rentre dans l’état de nature, et a droit à tout ce qu’il peut atteindre. Si un ministre, par exemple, met impunément la main dans le trésor public, il n’est pas un commis de banquier qui ne puisse aussitôt mettre la main dans la caisse dont la garde lui est confiée. Si un prince, pour agrandir ses domaines, usurpe impunément la moitié du champ de son voisin, l’autre moitié peut aussitôt être saisie par le premier individu qui se présente. Si un agent de la force publique maltraite impunément un citoyen, il n’est pas de mari qui ne puisse à l’instant maltraiter sa femme et ses enfants, et même les priver légitimement de tout moyen de subsistance. Si un homme puissant peut faire dissoudre arbitrairement les liens qui l’unissent à sa femme, il n’est point de femmes qui ne soient aussitôt dégagées de la fidélité qu’elles devaient à leurs maris. Il suffit en un mot que le contrat social reçoive une violation, pour que toute espèce d’ordre soit renversée, qu’il n’existe plus ni obligations ni devoirs moraux : chacun reprend sa liberté naturelle, et a droit à tout ce qu’il peut atteindre.
En morale et en législation, un des effets les plus infaillibles des faux systèmes, est de conduire ceux qui les adoptent et qui veulent être conséquents, à se livrer, en sûreté de conscience, au vice, au crime ou à la tyrannie : quand on part d’un faux principe, c’est par devoir qu’on devient oppresseur. Si l’on arrive à quelque vérité utile, c’est parce qu’on cesse de bien raisonner : on tombe dans des inconséquences, dans des contradictions ; on devient infidèle à son propre système. Il est impossible qu’il en soit autrement, puisqu’on ne peut tirer d’une proposition que ce qu’elle renferme, et que la vérité ne saurait sortir de l’erreur.
Rousseau, dans son Contrat social, se propose deux choses : il veut prouver d’abord que le despotisme ou la servitude ne peuvent être fondés que par la violence et que rien ne saurait les rendre légitimes ; il veut prouver, en second lieu, que l’ordre social, les lois et même les devoirs moraux, ne sont fondés que sur un pacte primitif. Si ses propositions sur le contrat social sont justes, tous ses raisonnements contre le despotisme et la servitude sont des erreurs. Si, au contraire, ses propositions contre l’esclavage sont vraies, il n’y a rien de vrai dans son système de pacte social. On va voir comment les diverses propositions à l’aide desquelles il veut établir ces deux systèmes, s’excluent mutuellement.
Hors du contrat social, l’homme a un droit illimité à tout ce qui lui est nécessaire, à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; il ne doit rien à qui il n’a rien promis ; il ne reconnaît pour être à autrui que ce qui lui est inutile : telles sont les maximes que Rousseau considère comme des vérités évidentes par elles-mêmes. Supposons donc qu’un homme cultive un champ, construise une cabane, et y réunisse ses provisions ; un autre, qui ne reconnaît pour être à autrui que ce qui lui est inutile, veut s’emparer de ce champ, de cette cabane, de ces provisions ; en a-t-il le droit ? Oui, dit Rousseau, s’il peut y atteindre. Mais, si le possesseur est le plus fort, n’a-t-il pas droit de les conserver ? Sans doute, puisqu’il a droit à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre. Le droit est donc toujours du côté du plus fort, et comme il ne peut pas y avoir de droit sans une obligation correspondante, c’est un devoir pour le plus faible de respecter les droits des plus forts.
Ainsi raisonne l’auteur du pacte social, lorsqu’il veut prouver que ce pacte doit être le fondement des lois et de tous les devoirs ; mais il raisonne autrement lorsqu’il combat le système de l’esclavage.
[I-178]
« Le plus fort, dit-il, n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe (on vient d’en voir un exemple). Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois pas quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ?
« Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias inexplicable. Car sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause ; toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu’on peut désobéir impunément, on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or, qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse ? S’il faut obéir par force, on n’a pas besoin d’obéir par devoir, et si l’on n’est plus forcé d’obéir, on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout... Convenons donc que la force ne fait pas droit [33]. »
Tout ce que dit ici Rousseau peut s’appliquer avec une justesse parfaite au droit universel et illimité dont jouit l’homme qui n’est point lié par le contrat social. En supposant un moment ce prétendu droit, je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias inexplicable. Car sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause ; toute force qui succède à la première succède à son droit... On voit donc que ce mot droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout... Convenons que la force ne fait pas droit.
Les principes de Rousseau contre le despotisme renversent donc ses principes en faveur du droit illimité de l’homme, dans l’état de nature. On va voir comment ses maximes sur l’état de nature, sont la justification de l’esclavage ou du despotisme même le plus violent.
Un homme adroit et audacieux, un Cromwell ou un César, ne reconnaît pas le contrat social, ou le viole ; il s’empare de la puissance suprême et asservit ses concitoyens. Quelle est, suivant Rousseau, la première conséquence de cette usurpation, ou de cette violation du pacte social ? C’est que chacun rentre dans ses premiers droits et reprend sa liberté naturelle. L’usurpateur rentre dans les siens comme tous les autres. Mais quels sont ces premiers droits dans lesquels rentre chaque individu ? C’est un droit illimité à tout ce qui lui est nécessaire, à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre. Pour que l’usurpateur, rentré dans l’état de nature, ait un droit illimité sur les biens des hommes qu’il a asservis, quelles sont les conditions nécessaires ? Il y en a deux : la première, que ces biens le tentent ; la seconde, qu’il puisse les atteindre. Les mêmes conditions lui donnent un droit illimité sur la vie des citoyens et même sur l’honneur de leurs femmes : il suffit qu’il éprouve des désirs et qu’il ait la puissance de les satisfaire.
« Si le contrat social n’est point admis, ou s’il est violé, je ne reconnais, dit Rousseau, pour être à autrui que ce qui m’est inutile ; je ne dois rien à qui je n’ai rien promis. » C’est précisément ce que dit un despote à ses sujets, un maître à ses esclaves ; et si ce langage est juste dans la bouche de l’homme de la nature, s’il est conforme à son droit illimité, il serait difficile de voir pourquoi il serait injuste ou contraire au droit, dans la bouche d’un tyran ou d’un maître d’esclaves : il n’existe pas plus de contrats entre les uns qu’entre les autres.
Le système de Rousseau sur les droits illimités dont jouissent les hommes avant la formation et après la dissolution du pacte social, a cela de commode pour les tyrans, qu’il justifie par un premier attentat tous les attentats qui peuvent suivre. Lorsque le premier magistrat d’une nation s’est environné d’une force suffisante pour vaincre la résistance que pourraient lui opposer les citoyens, il n’y a plus de crimes possibles pour lui ; tout ce qu’il peut faire impunément, il le peut faire légitimement ; la première atteinte qu’il porte au pacte social, lui donne à tout un droit illimité.
Il suit de là que ce prétendu pacte n’est bon à rien : aussi longtemps qu’aucun individu n’a la force d’en opprimer un autre, il est inutile ; il périt aussitôt que la force le surmonte, et alors le plus fort a droit à tout.
Avant la formation et après la dissolution du contrat social, l’homme ayant droit à tout ce qu’il peut atteindre, il s’ensuit que ses actions n’ont point de moralité, qu’il n’est soumis à aucun devoir, et qu’il n’existe point de propriété. Mais, comme ce contrat, même quand il existe, ne peut avoir de force qu’envers ceux qui l’ont formé ou qui l’ont adopté, il est clair qu’il est sans force à l’égard des nations étrangères et des membres dont elles se composent. Ainsi, lorsque des individus se réunissent en société, l’acte d’association a bien pour effet d’établir la propriété les uns à l’égard des autres ; mais il ne peut l’établir relativement aux étrangers. L’État, dit Rousseau, est maître, à l’égard de ses membres, de tous leurs biens par le contrat social, qui dans l’État sert de base à tous les droits ; mais il ne l’est, à l’égard des autres puissances, que par le droit de premier occupant qu’il tient des particuliers. Ce droit du premier occupant n’est point en lui-même un véritable droit ; ce n’est qu’un résultat de la force.
Ces principes que, dans l’état de nature, les actions de l’homme n’ont point de moralité ; que chacun a droit à tout ce qu’il peut atteindre ; qu’il n’existe point de propriété ; qu’on ne doit rien à qui on n’a rien promis (principes dont Rousseau a besoin pour prouver la nécessité du pacte social), autorisent évidemment les corsaires et les pirates à s’emparer des propriétés qui leur tombent sous la main. Ils autorisent également une armée victorieuse à s’approprier non seulement les biens qui appartiennent à la nation vaincue, et qui composent le domaine public, mais encore ceux qui appartiennent aux particuliers. Ils autorisent un individu à disposer de lui ou même de ses enfants, de la manière qu’il juge convenable ; puisque, n’ayant point de devoirs à remplir, et ses actions n’ayant point de moralité, il ne peut ni violer un devoir, ni se livrer à une action immorale.
Mais ces principes, évidents aux yeux de Rousseau lorsqu’il fait le tableau de l’état de nature, et qu’il cherche à démontrer la nécessité du pacte social, lui semblent des erreurs manifestes, lorsqu’il a besoin de combattre les sophismes à l’aide desquels on a cherché à justifier l’esclavage. « Ce qui est bien et conforme à l’ordre, dit-il, est tel, par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Un homme ne peut se rendre volontairement esclave ; car renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs ; un homme ne peut donner ses enfants irrévocablement et sans condition ; car un tel don est contraire aux fins de la nature, et passe les droits de la paternité. Le droit de conquête n’a d’autre fondement que la loi du plus fort ; même en pleine guerre, un prince juste s’empare bien, en pays ennemi, de tout ce qui appartient au public, mais il respecte la personne et les biens des particuliers ; il respecte les droits sur lesquels sont fondés les siens. Ainsi voilà des droits, des devoirs indépendants de toute convention, et antérieurs au pacte social.
Si les relations naturelles qui existent entre les individus, ou entre les hommes et les choses, ne produisent ni devoirs ni obligations, comment les relations qui résultent d’une convention en produiraient-elles ? Si le seul fait que tel individu a donné naissance à tel autre, n’impose aucun devoir à aucun des deux ; si le fait que tel individu a donné à telle chose les qualités propres à satisfaire ses besoins, n’est pas une raison propre à lui en assurer la jouissance, comment le fait que deux ou plusieurs individus ont fait entre eux une convention, pourrait-elle produire des obligations pour les uns et pour les autres ? Dans la société, tous les droits reposent sur les lois ; les lois reposent sur le pacte social ; mais le pacte social, sur quoi repose-t-il ? Ce système n’est-il pas comme celui des Indiens, qui font reposer la terre sur un éléphant, l’éléphant sur une tortue, et la tortue sur rien ?
Un jour on sera surpris qu’il se soit trouvé des peuples qui, n’étant privés ni d’intelligence, ni de lumières, aient cherché des règles de conduite dans un système aussi incohérent, et je ne craindrai pas de dire aussi insensé. Mais, lorsqu’on aura examiné les principes qu’ils prirent pour guide, on ne sera plus surpris de les voir marcher d’excès en excès, et établir le plus violent despotisme en croyant fonder la liberté.
En exposant le système de Rousseau, je n’ai pas examiné les conséquences qu’il en tire relativement au gouvernement. J’ai négligé aussi une multitude d’erreurs de détail ; je serai obligé d’y revenir lorsque j’aurai à parler de gouvernement, ou de quelques branches particulières de la législation.
Il est un autre système qui a quelque analogie avec celui que je viens d’exposer, et qui n’est pas beaucoup mieux fondé, quoique les conséquences en soient moins funestes ; c’est celui qui consiste à supposer qu’il existe un contrat entre les citoyens et les membres du gouvernement, et que les devoirs des uns et des autres résultent de ce contrat. C’est lorsque j’aurai à parler du gouvernement, que j’exposerai ce système, qui consiste, comme le précédent, dans une série de conséquences tirées d’une fausse supposition.
Des écrivains qui ont repoussé le système de Rousseau, à cause des absurdités auxquelles il conduit, n’ont pas pu cependant renoncer à l’idée d’une convention primitive ; suivant eux, la propriété n’existe que par convention, et le mal qui résulte des atteintes qu’on y porte, consiste tout entier dans la violation du contrat ; les peuples eux-mêmes ne sont réunis en société que par convention ; enfin toutes les lois ne sont que des conventions. Ces divers systèmes ne sont que des modifications de celui de J.-J. Rousseau ; ils sont plus vagues, sans être plus vrais.
Mais si nous ôtons à la société, à la propriété, aux lois et aux gouvernements l’appui des conventions primitives, sur quoi les ferons-nous reposer ? Le monde ne va-t-il pas être plongé dans la confusion et le désordre, quand il n’aura plus les bases sur lesquelles nous l’avons établi ? Qu’on se rassure ; notre planète et beaucoup d’autres se soutiennent assez bien, sans que nous ayons besoin d’y porter les mains et de leur donner des appuis ; les sociétés, les gouvernements, les lois, les propriétés et même les familles, se soutiendront de même, par la force qui est inhérente à leur nature ; et si, dans tout cela, il y avait jamais quelque chose qui ne pût se maintenir par une puissance qui lui fût propre, c’est qu’il serait bon que cette chose tombât.
Ayant écarté de la science de la législation le contrat social et les conventions primitives, on demandera peut-être comment les sociétés se sont formées. Si c’est une question théologique dont on demande la solution, chacun peut la résoudre en consultant les livres qui sont la base de sa croyance. Si c’est, au contraire, une question de fait, c’est-à-dire une question historique, elle est insoluble ; l’histoire ne fournit à cet égard aucune lumière. Partout où l’on a rencontré des hommes, on les a vus réunis en groupes et en familles ; mais personne n’a jamais observé la manière dont ces groupes avaient été formés.
Il est une erreur de langage que je dois faire ici observer, parce qu’elle influe sur les idées, et qu’elle est quelquefois commise même par les personnes qui n’adoptent pas les systèmes de Rousseau. On dit souvent : les hommes se sont réunis en société pour tel ou tel objet ; ou bien, les hommes ne se sont pas réunis en société pour tel but. On semble croire, en s’exprimant ainsi, ou que tous les peuples se sont formés, comme le dit Rousseau, par un contrat positif, dont toutes les clauses sont encore obligatoires ; ou bien que des peuples nombreux et civilisés ne peuvent sagement se conduire qu’autant qu’ils ne perdent jamais de vue les motifs qui firent agir, il y a plusieurs milliers d’années, quelques peuplades de barbares.
Les hommes ne viennent pas au monde pour y faire telle ou telle chose : ils y arrivent, comme les plantes, sans but, sans motif ; ils naissent membres de telle nation, comme ils naissent enfants de tels pères et de telles mères, sans avoir rien fait pour cela. Ils parlent telle langue plutôt que telle autre ; ils sont soumis à telles lois ou à telle forme de gouvernement, non parce qu’ils ont jugé à propos de faire un choix, mais parce qu’il était impossible que cela fût autrement. On naît citoyen des États-Unis, comme on naît Grec ou Turc ; on n’a pas plus le choix dans un cas que dans l’autre. Chacun se trouve donc attaché à un lieu déterminé, par sa naissance, par sa langue, par ses relations de parenté, par ses affections, par ses opinions religieuses, par la profession qu’il exerce, par les propriétés qu’il possède, et par une foule d’autres liens ; des individus peuvent quelquefois passer d’un peuple chez un autre : mais une nation civilisée tient aussi fortement au sol sur lequel elle s’est développée, qu’une forêt tient à la terre dans laquelle elle a jeté ses racines.
Ces faits sont des vérités tellement claires, qu’elles sont triviales ; cependant, elles sont continuellement démenties par le langage ; elles le sont même par des écrivains qui s’occupent des sciences morales : qu’on juge, d’après cela, de l’état où ces sciences se trouvent encore.
[I-188]
CHAPITRE VII.↩
Du système dans lequel on considère les lois comme l’expression de la volonté générale ; de ce qu’on entend par cette volonté ; des erreurs qui se trouvent dans ce système, et des conséquences où elles conduisent en législation et en morale.
Lorsqu’un système, par la manière dont il est présenté, paraît propre à combattre des prétentions odieuses, ou à favoriser des passions ou des préjugés populaires, les peuples se mettent peu en peine d’examiner s’il est conforme à la vérité. Si l’état de choses qu’il décrit, semble désirable, on s’imagine qu’il suffit de le considérer comme vrai, et d’en faire le symbole d’une croyance générale, pour qu’en effet il se réalise. Afin d’en amener plus promptement le triomphe, on attache une espèce de défaveur à quiconque ose se permettre d’en faire la critique, et de diminuer ainsi le nombre des croyants. Mais la nature des choses est aussi indépendante des désirs des peuples que des caprices des rois ; ce qui est vrai, est tel par la nature des choses, et non par la manière dont il nous plaît de l’envisager.
Les savants peuvent être flatteurs, mais les sciences ne flattent personne ; elles sont aussi inflexibles pour les passions ou pour les erreurs populaires, que pour les vices et les désirs des grands. Ainsi, quoi qu’on puisse penser des systèmes de Rousseau sur les fondements et sur la nature des lois, il faut juger ces systèmes en eux-mêmes, et faire abstraction de l’opinion qu’on peut en avoir. Est-il vrai que, dans un pays quelconque, les lois sont l’expression de la volonté générale ? Est-il possible qu’une telle volonté existe, et que toutes les lois en soient l’expression ? Serait-il avantageux que cela fût ?
Ces questions diffèrent beaucoup les unes des autres, et elles pourraient être, par conséquent, susceptibles de solutions différentes. Une chose pourrait exister, et produire de mauvais effets ; elle pourrait être ou paraître désirable, et n’avoir aucune existence ; enfin elle pourrait sembler désirable et être impossible. Rousseau présente son système sur la nature des lois, comme étant l’expression de la vérité, et comme le seul juste et raisonnable ; c’est donc comme tel qu’il s’agit de l’examiner. S’il résultait de l’examen que j’en vais faire, qu’il n’est ni ne saurait devenir l’exposition vraie des choses, je laisserais le soin d’examiner s’il serait bon, à ceux qui se plaisent à raisonner sur l’impossible.
Ce système sur la nature des lois, n’est que la suite de celui que j’ai examiné dans le chapitre précédent, il appartient au même écrivain, et se trouve dans le même ouvrage. J’en traite séparément toutefois, parce que je conçois qu’il est possible d’admettre l’un sans adopter l’autre, et que c’est un moyen de se faire des idées plus justes de tous les deux. Il nous serait difficile d’ailleurs de bien savoir ce que les lois sont, si nous ignorions ce qu’elles ne sont pas, et ce qu’elles ne peuvent même pas être. Lorsque, sur une chose quelconque, de fausses idées sont devenues populaires, il n’y a presque pas moyen d’avancer dans la connaissance de cette chose, si l’on ne commence par détruire l’erreur dans laquelle on a été entraîné.
Il est difficile de bien entendre ce que Rousseau se propose de désigner par ces mots volonté générale. Dans la partie de son ouvrage où il cherche à exposer la nature des lois, le mot volonté est presque toujours synonyme de désir. Ces deux mots sont loin cependant d’avoir la même signification : pour désirer une chose, il suffit d’en sentir le besoin ; pour la vouloir, il faut en sentir le besoin, et posséder de plus la puissance de l’obtenir. Un paralytique peut avoir le désir de marcher ; un pâtre le désir d’être propriétaire de vastes domaines, ou même d’être roi ; mais, s’ils entendent leur langue, le premier ne dira point qu’il a la volonté de courir, ni le second la volonté de gouverner un empire.
Après avoir exposé ce qu’il entend par le mot souverain, Rousseau recherche si la volonté générale peut errer. Il dit que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique, mais que les délibérations du peuple n’ont pas toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, ajoute-t-il, mais on ne le voit pas toujours [34]. « Comment, dit-il ailleurs, une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraître... Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent : le public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous ont également besoin de guide [35]. »
Il est évident que la volonté dont parle ici Rousseau, n’est pas autre chose qu’un simple dé sir. Si l’on substitue ce dernier mot à la place du premier, dans les passages qu’on vient de lire, on verra que le langage est beaucoup plus juste. Qu’on dise, par exemple, qu’un peuple désire toujours d’être heureux, mais qu’il ne voit pas toujours ce qui peut le rendre tel ; que les hommes désirent toujours leur bien, mais qu’ils savent rarement ce qui leur est bon ; que le désir général est toujours droit ; mais que le jugement qui le guide n’est pas toujours éclairé, on pourra ne pas être d’accord sur les conséquences de ces phénomènes ; mais on ne pourra pas du moins contester l’exactitude du langage.
Cette substitution d’un mot à un autre, est ici d’une grande importance. Si Rousseau eût employé le terme propre, tout son système croulait de lui-même, ou pour mieux dire il n’y avait plus moyen de le construire. Admettant, en effet, qu’un peuple a toujours le désir d’être heureux, mais qu’il sait rarement ce qui lui est bon, il est impossible de tirer de ces deux faits aucune conséquence en faveur de la législation qu’il adopte. Un malade a toujours le désir de se bien porter ; faut-il en conclure que les remèdes qu’il imagine ou qu’il accepte des mains de son médecin, sont essentiellement bons ? Faut-il considérer l’ordonnance du médecin comme l’expression de la volonté du malade, par la raison que celui-ci consent à s’y soumettre ? En la considérant comme telle, s’ensuit-il qu’elle produira l’effet désiré ?
Rousseau admet qu’une multitude aveugle ne sait souvent ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon ; il dit qu’elle a besoin qu’on lui apprenne ce qu’elle veut ; que le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé ; qu’elle ne voit pas le bien qu’elle veut (qu’elle désire). Il conclut de là la nécessité d’un législateur qui lui fasse voir les objets tels qu’ils sont, ou même tels qu’ils doivent lui paraître. Il va plus loin ; il la déclare incapable de comprendre un système de législation, et de se laisser gouverner par le raisonnement ; il dit qu’il faut la tromper pour lui faire accepter de bonnes lois. Il est donc évident que la volonté dont il parle, n’est pas autre chose qu’un désir vague, qui se rapporte, non à telle loi particulière, mais à l’effet qu’il suppose qu’elle doit produire. Ce désir, auquel Rousseau donne mal à propos le nom de volonté, a une analogie parfaite avec le désir d’un homme qui souffre ; ce que cet homme désire, ce n’est pas précisément de prendre tel ou tel remède, c’est de mettre un terme à ses douleurs.
Ainsi, en supposant qu’une loi fût adoptée à l’unanimité par un peuple, cette circonstance ne prouverait pas qu’elle doit nécessairement produire de bons effets, puisque la multitude voit sûrement ce qui lui est bon : l’acceptation unanime ne prouve pas plus en faveur d’une loi, que le courage avec lequel un malade prend un remède, ne prouve en faveur de l’ordonnance de son médecin.
En substituant le mot désir au mot volonté, on voit sur-le-champ combien peu sont fondées les opinions de Rousseau sur les lois, et sur les conditions qui seules peuvent les rendre bonnes. Est-il exact de dire que les lois sont l’expression du désir général ? Si un peuple ne voit pas quelles sont les lois qui lui sont bonnes, si l’on est obligé de le tromper pour lui en faire adopter de telles, peut-on dire qu’il les désire ? En admettant qu’il les désire, cela suffit-il pour qu’elles produisent un bon effet ? Un individu se livre souvent à des actions qui lui sont funestes : pourquoi une collection d’individus se conduirait-elle plus sagement ? S’ils ont plus de lumières, ce qui n’est pas toujours vrai, leurs intérêts ne sont-ils pas aussi plus compliqués ?
« Mille nations ont brillé sur la terre qui n’auraient jamais pu souffrir de bonnes lois, et celles même qui l’auraient pu, n’ont eu dans toute leur durée qu’un temps fort court pour cela. La plupart des peuples ainsi que des hommes ne sont dociles que dans leur jeunesse ; ils deviennent incorrigibles en vieillissant ; quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c’est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer, le peuple ne peut même pas souffrir qu’on touche à ses maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l’aspect du médecin... La jeunesse n’est pas l’enfance. Il est pour les nations comme pour les hommes un temps de jeunesse, ou, si l’on veut, de maturité, qu’il faut attendre avant de les soumettre aux lois ; mais la maturité d’un peuple n’est pas toujours facile à connaitre, et si on la prévient, l’ouvrage est manqué [36]. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l’est pas au bout de dix siècles [37]. »
Comment peut-on admettre des faits semblables, après avoir posé en principe que la volonté générale est toujours droite, et tend toujours à l’utilité publique ? Si mille peuples qui ont brillé sur la terre, auraient été incapables de souffrir de bonnes lois, n’est-il pas évident que la volonté générale n’est pas toujours droite ? Et si la volonté générale n’est point infaillible, quel est le moyen à l’aide duquel on jugera de la bonté des lois ? Qui saura distinguer le peuple dont la volonté générale est toujours droite, de celui dont la volonté générale se trompe toujours ? Par quel rare privilège sera-t-il donné à l’un d’être infaillible, tandis que l’autre ne saurait jamais rencontrer la vérité !
Si Rousseau se trompe en prenant un désir vague de bien-être, pour une volonté positive portant sur des moyens déterminés, il ne se trompe pas moins lorsqu’il donne à la volonté de la majorité le nom de volonté générale. Pour qu’une volonté soit générale, suivant lui, il n’est pas nécessaire qu’elle soit unanime ; il suffit que toutes les voix soient comptées ; toute exclusion formelle, dit-il, rompt la généralité [38]. Mais, si la généralité consiste en ce que toutes les voix soient comptées, pourquoi ne pas dire alors la volonté de la majorité ou du plus grand nombre, au lieu de dire la volonté générale ? Parce qu’ici le nombre ne prouve que la force, et que s’il avait dit que la volonté du plus grand nombre est toujours droite, c’eût été déclarer, en d’autres termes, que le plus fort a toujours raison.
Rousseau semble avoir prévu cette objection : aussi, après avoir reconnu que l’unanimité n’est pas nécessaire pour constituer la généralité, il ne tarde pas à prétendre que majorité et unanimité sont deux termes synonymes ; et que, lorsqu’une assemblée se divise en deux parties, et que chacune d’elles vote en sens contraire, elles sont cependant du même avis. Le non répondu par la minorité, a le même sens, dans l’intention des votants, que le oui de la majorité ; de sorte que tous les votes sont toujours unanimes, quelque divergence apparente qu’il y ait dans les suffrages.
Voici comment s’opère ce prodige. Par le contrat social, toujours formé à l’unanimité, chacun s’engage à se soumettre à la décision du grand nombre, et à vouloir ce que la majorité voudra. Lorsqu’on vote sur une loi, il est donc convenu d’avance que la minorité voudra ce qui sera voulu par la majorité : et aussitôt que la volonté de celle-ci est connue, on connaît la volonté de celle-là qui est la même, puisqu’on veut toujours ce qu’on a une fois promis de vouloir.
« Le citoyen, dit Rousseau, consent à toutes les lois, même à celles qu’on passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu’une. La volonté constante de tous les membres de l’État est la volonté générale ; c’est par elle qu’ils sont citoyens et libres. Quand on propose une loi dans l’assemblée du peuple, ce qu’on leur demande n’est pas précisément s’ils approuvent la proposition, ou s’ils la rejettent, mais si elle est conforme à la volonté générale qui est la leur ; chacun, en donnant son suffrage, dit son avis là-dessus, et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l’avis contraire au mien l’emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m’étais trompé, et que ce que j’estimais être la volonté générale ne l’était pas. Si mon avis particulier l’eût emporté, j’aurais fait autre chose que ce que j’avais voulu, c’est alors que je n’aurais pas été libre [39]. »
J’avoue que je ne comprends pas ce que cela signifie. Lorsqu’on propose une loi dans l’assemblée du peuple, on ne demande pas aux citoyens, dit Rousseau, s’ils l’approuvent on s’ils la rejettent. Qu’est-ce donc qu’on leur demande ? On leur demande si elle est conforme à la volonté générale. Mais quels seront les éléments dont se composera cette volonté ? À quels signes les votants pourront-ils la connaître ? Comment leur sera-t-il possible de répondre à la question qui leur est faite, tant que personne n’aura fait connaître son opinion individuelle ? Faut-il que chacun déclare qu’il est de l’avis de la majorité ? Mais si chacun fait une déclaration semblable, si nul ne dit ce qu’il pense sur la mesure proposée, qu’est-ce qui formera la majorité, ou ce qu’on nomme la volonté générale ? Si mon avis l’eût emporté, dit Rousseau, j’aurais fait autre chose que ce que j’avais voulu, c’est alors que je n’aurais pas été libre. Mais un avis particulier ne peut l’emporter qu’autant qu’il est un des éléments dont se forme la majorité ; et si, en pareil cas, il n’est pas l’expression de la volonté générale, où se trouve cette volonté et quels sont les signes auxquels on peut la reconnaître ? Comment se fait-il que je sois libre quand l’opinion que je manifeste se trouve en opposition avec l’opinion de la majorité, et que je cesse d’être libre aussitôt que je me trouve d’accord avec le plus grand nombre et que mon avis triomphe ?
Je me suis engagé, par le contrat social, continue Rousseau, à vouloir toujours ce que voudrait la majorité ; d’où il suit que je veux toutes les lois que la majorité adopte, et que les lois que je repousse, ne sont que l’expression de ma volonté. Mais est-il possible de s’engager à vouloir ? Et si un tel engagement est possible, dépend-il de soi de le tenir ? La volonté se composant du désir et de la puissance, peut-on raisonnablement promettre à une ou à plusieurs personnes, qu’on aura, dans toutes les circonstances, le désir et la puissance de faire ou de souffrir tout ce qu’elles voudront ? Dépend-il de soi de désirer des choses qui déplaisent, des choses qu’on juge funestes ? Rousseau ne le pense point, et c’est même sur cette impossibilité qu’il se fonde pour soutenir que la souveraineté est inaliénable.
« S’il n’est pas impossible, dit-il, qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant : car la volonté particulière tend par sa nature aux préférences, et la volonté générale à l’égalité. Il est plus impossible encore qu’on ait un garant de cet accord, quand même il devrait toujours exister ; ce ne serait pas un effet de l’art, mais du hasard. Le souverain peut bien dire : je veux actuellement ce que veut un tel homme, ou du moins ce qu’il dit vouloir ; mais il ne peut pas dire : ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore ; puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l’avenir, et puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’être qui veut [40]. »
S’il est absurde qu’un peuple s’engage à vouloir ce que voudra demain un individu ; si la volonté ne peut se donner des chaînes pour l’avenir ; s’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’être qui veut, comment un individu pourrait-il s’engager à vouloir ce que [I-200] voudra demain la majorité du peuple ? Comment un engagement qu’il n’est pas au pouvoir d’une collection d’individus de prendre ou de remplir, pourrait-il être pris et rempli par un seul ? Si la majorité d’une nation ou d’une assemblée peut dire à la minorité : tu veux aujourd’hui ce que nous voulons, car tu promis jadis de n’avoir jamais d’autres volontés que les nôtres ; quand tu repousses une telle loi comme mauvaise, tu te trompes : tu la trouves bonne, puisqu’elle nous plaît ; en t’obligeant à l’exécuter, nous te forçons à être libre, et à obéir à ta propre volonté ; nous avons promis de te garantir de toute dépendance personnelle, et tu ne dépendras plus que de la volonté générale qui est la tienne ; si, dis-je, la majorité d’une assemblée ou d’une nation peut ainsi parler à la minorité, je ne vois pas pourquoi un prince ne pourrait pas tenir un pareil langage à une nation qui aurait promis d’avoir toujours une volonté conforme à la sienne. Si la volonté d’un peuple est inaliénable, il est absurde de prétendre que celle d’un particulier puisse s’aliéner : il peut aliéner ses biens, ses services ; mais il ne peut pas plus aliéner sa volonté que ses désirs ou ses affections.
En admettant tout ce que j’ai déjà réfuté dans ce chapitre, on serait encore mal fondé à prétendre que les lois sont l’expression de la volonté générale, et que leur conformité avec cette volonté suffit pour les rendre bonnes. Je suppose, en effet, qu’à l’instant où une loi se manifeste, elle est l’expression de la volonté, même unanime, du peuple ou de l’assemblée qui l’a adoptée ; qu’est-ce qui garantit que le lendemain cette volonté n’a point changé ? De nouvelles lumières acquises, des expériences qu’on n’avait pas faites, des intérêts qui n’étaient pas nés ou qu’on n’avait pas aperçus, les mouvements produits dans la population par les décès et les naissances, même le remplacement entier des générations par des générations nouvelles, peuvent-ils permettre d’affirmer que la volonté qui existait il y a plusieurs années ou même plusieurs siècles, existe toujours, et que le peuple d’aujourd’hui veut exactement ce que voulait le peuple qui a cessé d’être ?
Un peuple qui a la puissance de changer ses lois, et qui les laisse subsister, dit Rousseau, déclare, par cela même, qu’elles sont conformes à sa volonté ; plus même elles sont anciennes, et mieux cette conformité est attestée. Il reste à savoir si un peuple, quelle que soit son organisation politique, peut changer sa législation aussi facilement que Rousseau le pense ; il reste à savoir s’il est possible même que la majorité d’un peuple, ou seulement d’une grande assemblée, ait une connaissance parfaite de toutes les lois qui existent dans l’État. Si nous consultons l’expérience, nous trouverons que rien n’est plus rare que de rencontrer, je ne dis pas un peuple, je ne dis pas même une assemblée ou un corps, mais un individu qui connaisse toutes les lois de son pays ; et si nous en cherchons un qui, non seulement connaisse toutes les lois, mais qui soit en état d’apprécier les effets de chacune de leurs dispositions, et de les approuver ou de les rejeter avec une parfaite connaissance de cause, il est fort douteux que nous puissions rencontrer un si rare phénomène.
Dans tous les pays, il existe des hommes qui se livrent à l’étude des dispositions des lois ; mais il en est peu qui les embrassent dans leur ensemble, et il en est encore moins qui les jugent ou qui les considèrent dans les rapports qu’elles ont avec leur volonté particulière. La multitude s’y soumet, même sans se mettre en peine de les connaître ; les magistrats les exécutent, parce que c’est leur métier, et qu’ils ne sauraient faire mieux. S’il arrive que quelque ami du bien public, ou quelque esprit systématique aperçoive ou s’imagine apercevoir quelque vice dans la législation, il expose ses idées. Il porte de ce côté l’attention d’un petit nombre de ses concitoyens ; on discute alors, et quelquefois, après des efforts longtemps soutenus, on parvient à faire une légère correction. Les peuples qui ont eu le plus d’influence dans la formation de leurs lois, n’ont pas été plus instruits à cet égard que les peuples modernes. Les Romains ne connaissaient pas mieux leurs lois que les Anglais ou les Français ne connaissent les leurs ; peut-être même les connaissaient-ils moins, puisqu’ils étaient encore plus esclaves de leurs jurisconsultes, et que chez eux l’imprimerie n’avait pas multiplié les livres.
Le système qui considère les lois d’un peuple comme l’expression de la volonté générale et actuelle des citoyens, ne peut être fondé qu’en admettant comme vrai un fait évidemment impossible. Il faut qu’il existe entre la volonté d’une nation et les lois qui la régissent, le même rapport qu’entre le grand ressort et l’aiguille d’une montre. Si la ressemblance n’existe pas ; si les volontés n’ont pas la simplicité, l’unanimité, et l’activité du ressort ; si les lois dans leur ensemble n’ont pas le mouvement correspondant et régulier de l’aiguille, les unes ne sont pas toujours le résultat des autres. L’ancienneté des lois, même dans les pays les plus libres, n’en prouve point la bonté : un peuple libre peut être longtemps soumis à des lois vicieuses ; un gouvernement absolu renverse quelquefois de mauvaises lois. Les lois pénales de l’Angleterre sont peut-être les plus mauvaises de l’Europe : les Anglais n’en sont pas cependant le peuple le plus esclave.
Nous avons vu que, suivant Rousseau lui-même, une multitude aveugle ne sait pas ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon ; et que si les particuliers voient le bien qu’ils rejettent, le public veut (c’est-à-dire désire ) le bien qu’il ne voit pas. Nous avons vu ensuite que, par l’expression de la volonté générale, il n’entend que l’expression de la majorité. Cela résulte des passages précédemment rapportés, et surtout de ce qu’il dit lorsqu’il parle des suffrages : il n’y a, dit-il, qu’une seule loi qui exige un consentement unanime ; c’est le pacte social... Hors ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige tous les autres ; c’est une suite du contrat même [41]. Ainsi, le souverain, c’est la majorité qui décide dans chaque circonstance ; et cette majorité, loin d’être infaillible dans ses décisions, peut ne pas voir ce qui lui est bon, quoique ses intentions soient toujours droites.
Quel est cependant le pouvoir que Rousseau lui reconnaît, soit à l’égard des individus, soit à l’égard de leurs biens ? un pouvoir absolu ou illimité à l’égard des uns et des autres. Le pouvoir de la majorité sur les personnes est égal à celui qu’a tout individu sur ses propres membres ; car l’aliénation que chacun a faite de soi est sans réserve. Son pouvoir sur les propriétés n’est pas moins étendu, puisque l’État, à l’égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social, qui, dans l’État, sert de base à tous les droits [42].
Les citoyens n’ont aucune garantie contre l’abus d’un pouvoir si étendu, et ils n’en ont pas besoin.
« Le souverain n’étant formé que des particuliers qui le composent, dit Rousseau, n’a ni ne peut avoir d’intérêt contraire au leur ; par conséquent, la puissance souveraine n’a nul besoin de garant envers les sujets, parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons ci-après qu’il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être [43].
« On voit, dit ailleurs Rousseau, qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale (ou des décisions d’une majorité) ; ni si le prince est au-dessus des lois, puisqu’il est membre de l’État ; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même ; ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés [44]. »
On a vu précédemment comment les lois d’un pays sont les registres des volontés des citoyens. Il reste à savoir s’il est impossible que la majorité qui décide, veuille nuire à tous les membres de l’État ; si cette absence de volonté de nuire, suffit pour qu’elle ne nuise pas en effet ; s’il est vrai qu’elle n’ait la puissance de nuire à aucun particulier ; s’il est impossible que la loi soit injuste ; et enfin, si le souverain (c’est-à-dire la majorité qui décide), par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être.
Mais de telles maximes méritent-elles d’être mises sérieusement en question ? Si un peuple ne voit pas toujours ce qui lui est bon, comment la majorité qui adopte une loi serait-elle infaillible ? Cette majorité ne peut avoir la volonté de nuire à tous les membres de l’État. Soit : s’ensuit-il qu’elle ne leur nuira point ? Un particulier ne saurait avoir la volonté de se ruiner, cela prouve-t-il que personne ne fait mal ses affaires ? La majorité ne peut nuire à aucun particulier ; et qu’est-ce qui l’en empêchera, puisque ses pouvoirs n’ont point de limites ? Elle ne peut disposer, dit-on, que d’une manière générale ; elle ne peut disposer ni sur un individu, ni sur une chose déterminée. Mais est-il impossible d’atteindre des individus déterminés au moyen de désignations générales ? Ne suffira-t-il pas de les désigner par les qualités qui les distinguent, par l’étendue de leurs richesses, par leur âge, par leur sexe, par leur naissance, par leur religion, par leur profession, par leurs opinions, par leurs qualités de célibataires ou de gens mariés ?
En disant que les lois doivent disposer d’une manière générale, entendrait-on que, dans tous les cas, elles doivent atteindre indistinctement tous les membres de l’État sans exception ? Il suivra de cette maxime, qu’il ne pourra exister de lois ni sur les mineurs, ni sur les femmes, ni sur le service militaire, ni sur la capacité requise pour exercer certaines professions, ni sur une branche particulière d’industrie ou de commerce, ni enfin sur rien de ce qui n’est pas commun à tous les individus, à tous les sexes, à toutes les positions, à toutes les propriétés. La loi, dit-on, ne peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même ; si cela ne signifie pas que la loi ne peut être funeste à la société, par la raison que nul n’a la puissance de se nuire, cela n’a aucun sens ; et si c’est là ce que Rousseau veut dire, c’est une erreur évidente ; le nombre des gens qui se nuisent par leur conduite, ou qui sont injustes envers eux-mêmes, est fort grand dans tous les pays. Dire, enfin, que le souverain, quel que soit le sens qu’on donne à ce mot, par cela seul qu’il est, est toujours ce qu’il doit être, c’est reconnaître l’infaillibilité là où elle ne saurait certainement se trouver.
Les opinions de Rousseau sur le pacte social, sur le souverain qui en résulte, sur les conditions essentielles à l’existence d’une loi, sur l’infaillibilité de la volonté générale, sur les perfections inséparables des majorités, peuvent faire croire qu’il avait une très haute idée de la sagesse des peuples ; mais personne n’était moins que lui enthousiaste des bonnes qualités du genre humain ; il ne voyait guère, dans les nations, que de la matière sur laquelle de grands hommes pouvaient faire des expériences ; il ne pensait pas qu’elles marchassent par leurs propres forces vers le perfectionnement ; il les croyait destinées à recevoir, des mains des hommes de génie, la pensée, la force, le mouvement et la vie ; aussi, dans son livre, ne prend-il pas le ton modeste d’un savant qui décrit ce qui se passe sous ses yeux ; il parle comme un génie créateur qui anime de la matière : « Par le pacte social, dit-il, nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation [45]. » Que penserait-on d’un astronome qui dirait gravement : Nous avons imprimé le mouvement à la terre ; il s’agit maintenant de faire tourner le soleil ?
Lorsque Rousseau parle d’un peuple qui veut se donner des lois, il n’y voit qu’une multitude aveugle qui ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle ne connaît pas ce qui lui est bon ; lorsqu’il parle d’organisation politique, il admire l’art avec lequel les premiers législateurs de Rome surent enlever à la majorité de la population toute espèce d’influence, sans qu’elle s’en aperçût ; lorsqu’il parle d’un législateur, il ne voit pas en lui un homme qui cherche quelle est la volonté générale, et qui lui donne le moyen de se manifester ; il y voit un génie créateur qui change, pour ainsi dire, la nature humaine, qui altère la constitution de l’homme pour la renforcer, qui ôte à l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères, qui fait que chaque citoyen n’est rien et ne peut rien que par les autres ; il admire dans les institutions de Mahomet, décriées par l’orgueilleuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti, dans ces institutions qui ont dix siècles de durée, ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables [46] ; enfin, comparant les nations à des objets purement matériels, à des fruits que surveille un cultivateur et qu’il doit cueillir à un instant donné, il dit qu’il est pour les nations un temps de maturité qu’il faut attendre avant de les soumettre aux lois ; que la maturité d’un peuple n’est pas toujours facile à connaître, et que, si on la prévient, l’ouvrage est manqué [47].
Et qu’on ne pense pas que toutes ces contradictions, toutes ces incohérences, sont sans influence, et que les unes détruisent l’effet des autres. Lorsque les hommes se sont rempli l’esprit d’une multitude d’idées fausses et contradictoires, ils s’en servent pour justifier leurs passions, sans se mettre en peine si elles s’accordent ou se contredisent ; chacune d’elles règne à son tour, selon l’intérêt de celui qui les a adoptées. Qu’un ambitieux, imbu des principes de Rousseau, parvienne à se faire écouter de la multitude, il ne lui sera pas difficile de lui persuader que tout ce qu’elle veut est juste, et qu’il n’y a de juste que ce qu’elle veut. Que, dans une assemblée, il se mette à la tête d’une majorité passionnée ou fanatique, il lui prouvera tout aussi aisément qu’une majorité ne saurait avoir tort ; que, par cela seul qu’elle est, elle est tout ce qu’elle doit être, et que, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’entendre la minorité. Enfin, s’il parvient à s’emparer du pouvoir suprême, il prouvera non moins clairement qu’il est l’organe de la volonté générale, et que du silence universel on doit présumer le consentement du peuple. S’il veut soumettre la population à une législation bizarre, s’il veut la façonner selon ses caprices, en faire des automates chinois, ou la diviser en castes comme les Indous, il saura très bien qu’il doit changer en quelque sorte la nature humaine, altérer la constitution de l’homme pour la renforcer, et faire que chaque citoyen ne soit rien, ne puisse rien que par les autres. Il saura également que, si le raisonnement ne suffit pas, l’imposture peut y suppléer, et qu’il peut honorer les dieux en les faisant mentir ; l’exemple de Mahomet lui servira d’excuse, et imposera silence à l’orgueilleuse philosophie et à l’aveugle esprit de parti. Enfin, il saura qu’il peut disposer aussi arbitrairement des propriétés que des personnes, attendu que l’État, à l’égard de ses membres, est maître de tous leurs biens, et que le pacte social donne au corps politique dont il est l’organe, un pouvoir absolu sur tous ses membres. Que si on lui opposait que, par un de ses actes, il viole ce pacte, il n’en aurait pas moins raison, car il répondrait qu’en ce cas, il retombe dans l’état de nature, et que, par conséquent, il a droit à tout ce qu’il peut atteindre.
Ce ne sont pas seulement les actes de violence, les systèmes arbitraires, les fraudes sacrées, enfin tous les actes de tyrannie, qui peuvent être justifiés par les principes du contrat social, ce sont aussi toutes les actions qui, sans blesser ouvertement les lois, offensent les mœurs. Rousseau admet, en effet, qu’on ne doit rien à qui on n’a rien promis ; qu’il n’existe, parmi les hommes, d’autorité légitime que celle qui est fondée sur les conventions ; que tous les droits sont fixés par la loi dans l’état civil. On voit bien, dans ce système, comment les droits reposent sur les lois, les lois sur le contrat social, et le contrat social sur rien ; mais où trouverons-nous la première base de la morale privée ? Ici, les conventions n’entrent pour rien, puisque c’est principalement dans les cas où il n’y a point de conventions, que les règles et les sentiments moraux nous servent de guide. Suffira-t-il, pour qu’un peuple soit bien, que les citoyens ne se volent pas ou ne s’égorgent pas les uns les autres ? On ne fera pas de faux serment en justice, mais on pourra mentir en toute sûreté de conscience ; on ne poussera pas un homme dans la rivière, mais s’il y tombe on l’y laissera, pût-on le sauver en lui tendant la main ; on ne maltraitera pas son bienfaiteur, mais s’il est atteint par l’infortune on ne lui portera point de secours ; on ne désertera pas de l’armée un jour de combat, mais si l’on voit son frère assailli par des malfaiteurs on fera sagement de se cacher ; on ne ravira point la femme de son ami, mais si on peut séduire sa fille, on ne s’en fera point de scrupule ; on n’ira pas mettre le désordre dans la maison de son voisin, mais on se livrera chez soi à l’intempérance ou à d’autres vices honteux ; il suffira, en un mot, pour que tout soit bien dans l’ordre social, que chacun ait une crainte suffisante de la police, des gendarmes et des bourreaux. Peut-être les admirateurs du contrat social croient-ils échapper à ces conséquences, en disant que tous les devoirs seront réglés par les lois ; mais on tombera alors dans la plus insupportable de toutes les tyrannies, dans celle qui poursuit les citoyens jusque dans les détails de la vie privée et des mœurs domestiques [48].
En résumant les observations que j’ai faites sur le système de Rousseau, je vais tâcher de les réduire à l’expression la plus simple. Est-il vrai, en fait, que les actes ou la puissance à laquelle on donne le nom de lois, soient l’expression de la volonté générale ? Non, cela n’est vrai dans aucun pays ; nous ne connaissons aucun peuple chez lequel les lois aient jamais été l’expression d’une telle volonté. Est-il possible que les lois soient l’expression de la volonté générale ? Ceci est une question toute différente ; car il est des choses qui n’existent pas et qu’on pourrait cependant établir. Pour résoudre cette question, il faudrait examiner chacun des éléments dont se compose cette puissance à laquelle nous donnons le nom de loi, et voir s’il est au pouvoir d’un individu ou d’une nation de créer ou de détruire chacun de ces éléments : or je démontrerai, dans le livre suivant, que la plupart de ces éléments se trouvent dans la nature de l’homme, et que nous ne pouvons changer la nature de rien. Serait-il bon que toutes les lois fussent l’expression de la volonté générale ? Ceci est encore une question différente : il est des gens qui peuvent désirer et qui désirent même quelquefois des choses impossibles ; mais examiner, quand on s’occupe d’une science, s’il serait bon que l’impossible se réalisât, est une véritable puérilité. Enfin, lorsque l’autorité publique réside, soit dans le corps des citoyens, soit dans des assemblées de représentants, soit dans le conseil d’un prince, peut-on prendre des délibérations autrement qu’à la majorité ? Il ne paraît pas qu’il y ait d’autre moyen que celui-là ; c’est donc pour la minorité une nécessité de se soumettre ; c’est une force à laquelle on obéit. Cette force est-elle toujours éclairée, juste, bien intentionnée ? A-t-elle toujours pour objet et pour résultat l’intérêt général ? S’il en était ainsi, jamais il n’eût existé de mauvaises lois.
En soumettant à l’examen les systèmes de Rousseau, j’ai démontré qu’à l’aide de ces systèmes, on pouvait arriver à établir le plus violent arbitraire, et à justifier les actions les plus immorales. Cet écrivain cependant était un ardent ami de la liberté, et quand, dans ses écrits, il attaquait les mauvaises mœurs de ses contemporains, ce n’était point par hypocrisie. Comment est-il donc arrivé qu’on peut tirer de ses principes des conséquences opposées à ses sentiments ? Parce qu’en écrivant sur une science qu’il ignorait, il raisonna sur des faits imaginaires, au lieu d’observer ceux qu’il avait sous les yeux. Il n’y a point de sciences dans lesquelles un faux principe ne conduise à de funestes conséquences. En partant d’une fausse supposition, un médecin, s’il n’est point inconséquent, conduira son malade au tombeau. De même, l’écrivain moraliste qui fera reposer sa science sur une fiction ou sur un mensonge, entraînera ses crédules sectateurs dans le vice ou dans le crime, à moins qu’ils ne cessent de bien raisonner.
Il est une erreur très grave contre laquelle il est essentiel de se mettre en garde ; c’est de s’imaginer qu’avec du talent, on peut se passer de l’observation des faits. On peut, sans doute, avec une imagination forte et un style éloquent, éblouir pendant quelque temps le vulgaire des lecteurs ; mais les illusions se dissipent à mesure que les esprits s’éclairent, et lorsqu’elles ont complètement disparu, le dédain prend la place de l’admiration. Il n’y a de véritable éloquence que dans l’exposition de ce qui est vrai ; le style le plus soigné et le plus flatteur à l’oreille, n’inspire que du dégoût, aussitôt qu’on s’aperçoit qu’il n’a point de sens, ou qu’il n’exprime que des pensées fausses.
Avant que d’exposer l’influence qu’exercent les faux systèmes sur les lois et sur les mœurs, j’ai fait observer qu’il y avait trois manières principales de faire un faux système ; qu’on pouvait décrire d’une manière fausse ou inexacte le phénomène principal sur lequel on voulait fixer l’attention du public ; qu’on pouvait attribuer ce phénomène à des causes autres que celles qui l’avaient produit ; enfin, qu’on pouvait lui attribuer des effets qu’il n’était pas susceptible de produire, ou dissimuler des conséquences qui devaient naturellement en résulter. Si l’on juge les systèmes de Rousseau, soit sur les conventions primitives, soit sur la nature des lois, on trouvera qu’il a successivement fait usage de ces trois manières de mal raisonner : il a décrit des objets qui n’ont jamais eu d’existence réelle ; il a attribué les objets qu’il a décrits, à des causes dont l’existence n’a jamais été ni constatée, ni convenue ; enfin, il a attribué aux mêmes objets des effets heureux qu’ils ne pouvaient pas produire, et n’a pas observé les mauvaises conséquences qu’on pouvait en tirer.
[I-217]
CHAPITRE VIII.↩
Du système qui fait d’une religion positive le fondement exclusif de la morale et des lois, et de l’influence de ce système sur la civilisation.
Il semble que je ne suis point la gradation naturelle des idées, en passant de l’examen du système dans lequel on considère les lois comme l’expression de la volonté générale, à l’examen du système dans lequel on ne les considère que comme l’expression de la volonté d’un être surnaturel. Mais il y a, entre l’un et l’autre, plus d’analogie qu’il ne paraît, lorsqu’on ne les considère que séparément ; l’écrivain qui a imaginé le premier, en a senti la faiblesse, et c’est par le second qu’il a cherché à le fortifier. N’ayant compté pour rien l’entendement des peuples et les lumières qui peuvent sortir de la discussion, il a été obligé de faire parler son législateur au nom de la divinité. Il a cru qu’il ne pouvait exister ni de bonnes mœurs ni de bonnes lois, qu’autant que les magistrats civils étaient en même temps les ministres de la religion. Il a admiré les institutions de Mahomet, parce qu’il a cru y apercevoir l’union qu’il désirait, et il a condamné la religion chrétienne, parce qu’il a vu que le pouvoir religieux était séparé du pouvoir civil. Ce système, qui a été plusieurs fois mis en pratique, et qui a fait l’admiration de plusieurs philosophes [49], ne déplairait point à quelques ministres de certains cultes chrétiens ; ils consentiraient volontiers, non à remettre leur autorité spirituelle aux magistrats civils, mais à réunir, dans leurs pieuses mains, tous les pouvoirs de l’État ; ils se résigneraient même à ne consulter que la volonté générale, pourvu que la puissance de la faire parler n’appartînt qu’à eux.
En soumettant à l’examen quelques-unes des causes et des conséquences de ce système, je n’ai pas pour but de rechercher quels sont les services que la morale et la législation peuvent tirer de telle ou telle opinion religieuse, ni d’examiner jusqu’à quel point certaines croyances spéciales ont avancé ou retardé les progrès des mœurs ou des lois. Je ne me propose qu’une seule chose ; c’est de faire voir les conséquences d’un système qui, excluant l’observation des faits de l’étude de ces deux sciences, fait reposer tous les devoirs des hommes exclusivement sur les préceptes qu’on suppose avoir été donnés par une volonté supérieure. Dans ce système, on n’a jamais à considérer les conséquences d’une action, d’une habitude ou d’une loi, relativement aux biens et aux maux qui peuvent en résulter dans cette vie ; on n’a pas non plus à en rechercher les causes, soit dans les choses, soit dans les hommes. Le principe et la fin des actions humaines se trouvent exclusivement dans un être surnaturel, invisible, que l’imagination ne peut se figurer, ni l’intelligence concevoir. Il n’y a rien de moral ni de légitime que ce qui est conforme à la volonté de cet être ; et cette volonté ne peut être connue que par les préceptes contenus dans tel ou tel livre, et par les décisions des hommes qui se disent ses ministres.
Ce système, qui a existé et qui existe encore chez différents peuples, au moins en théorie, n’a certainement rien de commun avec la religion chrétienne. L’auteur de cette religion a voulu qu’elle fût étrangère aux lois et au gouvernement ; il a établi des préceptes de morale, mais sans exclure, en aucune manière, ni le raisonnement ni l’étude des faits. Ce que j’ai à dire ici ne peut donc se rapporter qu’à des religions étrangères au christianisme, ou à des prétentions que cette religion condamne, même quand on veut les fonder sur elle. J’ai déjà indiqué, au commencement de cet ouvrage, quelques-unes des raisons qui servent de prétexte au système que j’examine maintenant, et j’ai fait entrevoir une partie des résultats qu’il produit. Mais le sujet est si important qu’il me sera impossible d’en faire voir ici toutes les conséquences, et que je serai obligé de me borner à l’exposition de quelques faits généraux.
Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que les nations sont portées vers leur prospérité par une tendance inhérente à leur propre nature, mais qu’elles ne voient pas toujours ce qui les fait prospérer ou dépérir. Nous avons vu ensuite qu’en les éclairant sur les effets qui résultent de chaque chose, on dirige l’action qui est en elles vers la destruction de ce qui leur est funeste, et vers l’établissement de ce qui leur est utile.
Cette tendance qu’a le genre humain à détruire les obstacles qui s’opposent à ses progrès, n’est pas une création des savants : la science l’observe, elle ne lui donne pas l’existence. Ce ne sont pas non plus les savants qui font que telle cause produit tel effet ; ils montrent comment l’un dérive de l’autre : mais ce ne sont pas eux qui sont les auteurs de la filiation.
Si la tendance qu’a le genre humain à détruire ce qui lui est funeste, est un mal, si elle est le résultat d’une nature corrompue et déchue, ce n’est donc pas aux philosophes qu’il faut l’imputer ; ils font partie du genre humain, mais ils n’en déterminent pas la nature ; si telles opinions, telles habitudes, telles institutions produisent pour les nations telles conséquences, ce n’est pas à eux qu’il faut s’en prendre ; ils ne peuvent pas faire que les choses soient autres qu’elles ne sont.
Ce peut être un malheur que le pouvoir absolu soit pour les peuples une cause de misère et de ruine, au lieu d’être une cause de prospérité. Si les exactions, les violences et l’ignorance, rendaient les nations florissantes, les choses en iraient certainement beaucoup mieux ; tout le monde en serait plus heureux, les maîtres comme les esclaves. Mais l’auteur de notre nature en a décidé autrement : il a attaché le malheur à l’ignorance, à l’erreur, à la servitude ; il a fait dépendre la prospérité, de la liberté et des lumières. Des familles musulmanes, transportées à Philadelphie et éclairées, y prospéreraient comme des familles américaines ; des familles américaines, transportées à Constantinople et abruties, y dépériraient comme des familles musulmanes. Telle est la loi de notre nature.
Mais, si la science ne change rien à la nature des hommes ni des choses, si elle se borne à indiquer la liaison qui existe entre les causes et les effets, comment certains gouvernements et des ministres de certaines religions se montrent-ils si opposés aux progrès des lumières ? Comment craignent-ils qu’on fasse voir aux peuples les effets de certaines opinions, de certaines habitudes et de certaines institutions ? C’est qu’en général ils connaissent aussi bien que nous la tendance indestructible des nations, et qu’ils ne sont pas bien convaincus de la vérité et de la force des dogmes religieux et politiques dont ils leur imposent la croyance. Ils savent que, si jamais les peuples voient clairement la route qui peut les conduire à la prospérité, aucune puissance n’aura assez de force pour les arrêter : pour les empêcher d’avancer, il faut qu’ils les empêchent de voir.
S’il se trouvait des hommes qui se crussent intéressés à conserver chez un peuple des habitudes on des institutions funestes aux hommes, ou à empêcher l’établissement d’habitudes ou d’institutions utiles, comment devraient-ils s’y prendre pour arrêter la tendance qui porte les nations vers leur prospérité ? Ils devraient, en premier lieu, s’opposer à ce que personne fît remarquer la liaison qui existe entre ces habitudes ou ces institutions et les mauvais ou les heureux effets qui en résultent. Ils devraient ensuite attribuer à ces habitudes et à ces institutions les bons ou les mauvais effets qui sont produits par d’autres causes. Ils devraient enfin persuader aux peuples qu’elles produisent, dans un monde qu’ils ne peuvent pas voir, des résultats différents de ceux qu’elles produisent dans celui-ci. Avec de tels moyens, il n’y a pas d’habitudes ou d’institutions funestes qu’on ne puisse longtemps conserver ; il n’y a pas d’habitudes ou d’institutions avantageuses dont on ne puisse empêcher l’établissement.
Il est remarquable cependant que le système qui exclut l’observation des faits, de l’étude de la morale ou de la législation, pour fonder l’une ou l’autre de ces deux sciences sur des préceptes et des dogmes, n’est fondé lui-même sur aucun précepte ou sur aucun dogme religieux. Je ne connais du moins, dans aucune religion, aucun dogme ou aucun précepte qui interdise aux hommes de rechercher quelles sont les conséquences des actions ou des institutions humaines. Les recherches sur la législation et sur la morale ne me semblent pas avoir été plus interdites par les fondateurs des religions, que les recherches sur la physique ou sur l’astronomie. Il se trouve cependant, parmi les ministres de presque tous les cultes, des hommes qui se font un système de les condamner.
Ce système, vanté tout à la fois par des prêtres et par des philosophes, se conçoit aisément, quoiqu’il ne repose sur aucun dogme positif. Il n’est point de système philosophique, créé par l’imagination, qui puisse résister à l’examen ; il n’est point de religion qui n’impose aux hommes un nombre plus ou moins grand de devoirs moraux, qui ne recommande certaines habitudes et qui n’en proscrive d’autres ; il est même des religions qui renferment des systèmes de législation et des principes de gouvernement. En soumettant à l’analyse les actions commandées et les actions interdites, on peut trouver que quelques-unes d’entre les premières sont funestes au genre humain, tandis que, parmi les secondes, il en est qui lui sont favorables. On peut, par conséquent, tourner contre tel commandement ou contre telle défense la tendance qui porte la nature humaine vers sa prospérité. S’il était prouvé, par exemple, que les lumières sont une des principales causes des vertus et de la prospérité des nations, un précepte religieux qui recommanderait l’ignorance, perdrait par cela même une grande partie de son influence, et donnerait peu de considération aux hommes chargés de l’enseigner.
Les fondateurs des religions, en établissant des devoirs moraux, ont eu pour but, du moins en cela, le bonheur des hommes auxquels ils les ont imposés, même lorsque, pour faire remplir ces devoirs, ils ont employé des moyens que la bonne foi condamnait. La plupart des législateurs de l’antiquité ont fait intervenir un être surnaturel dans la formation de leurs lois ; ils se sont environnés de circonstances miraculeuses, propres à entraîner les suffrages d’une multitude ignorante et barbare. L’observation de leurs préceptes moraux ou législatifs ne devant, dans leur opinion, produire que d’heureuses conséquences, ils n’avaient pas à craindre d’en voir rechercher les résultats. Ces recherches d’ailleurs n’étaient probablement pas à la portée des hommes auxquels ils donnaient des lois. Nous ne devons donc pas être surpris de ne pas trouver dans leurs préceptes la défense de rechercher quelles sont les causes ou les conséquences de telles actions ou de telles institutions.
Mais tous les ministres de chaque religion n’ont pas la même confiance que les fondateurs, dans l’utilité des préceptes qu’ils veulent faire observer. Les progrès qu’ont fait les lumières peuvent avoir rendu douteux ce qui ne l’était pas il у a plusieurs siècles. Il arrive d’ailleurs que les préceptes d’une religion se multiplient avec le temps, et qu’à ceux qui ont été établis dans l’intérêt de l’espèce humaine, les ministres chargés de les faire observer en ajoutent quelquefois qui n’ont pour objet que leur intérêt particulier. Ils ne peuvent alors, sans s’exposer à un danger personnel, permettre qu’on recherche les conséquences des actions qu’ils prescrivent ou qu’ils défendent, des institutions qu’ils protègent ou dont ils craignent l’établissement. Ils sont dans le même cas que les agents d’un gouvernement, qui n’existent que par des abus : pour qu’ils continuent de prospérer, il faut que les peuples s’imaginent qu’ils sont intéressés à leur existence. Une erreur découverte sur un seul objet, peut suffire d’ailleurs pour faire défendre l’examen de tous ; peut-on croire, par exemple, que l’église romaine n’eût pas interdit l’étude de l’astronomie, si elle eût pu prévoir que cette science amènerait à la découverte du mouvement de la terre autour du soleil ?
Il est une raison plus puissante encore d’exclure la méthode analytique de la morale et de la législation, pour ne faire reposer ces deux sciences que sur des préceptes religieux. Les peuples ont un tel besoin de législation et de morale, qu’un corps qui peut se rendre le gardien exclusif des lois et des bonnes mœurs, est assuré d’avoir sur eux une influence sans bornes. Persuader à la population que telle ou telle croyance est le fondement exclusif de la probité, de la bonne foi, de la tempérance, de la chasteté, de la piété filiale, de la foi conjugale, du respect pour les propriétés, et enfin de toutes les vertus, c’est faire de cette croyance, et des ministres qui en sont les gardiens, le fondement de l’ordre social ; c’est donner aux membres du clergé une importance qui les place de beaucoup au-dessus de tous les magistrats, et qui les met, en quelque sorte, au rang de la divinité [50].
On mesure alors l’étendue de son respect pour les ministres de la religion, non sur la vérité de de leurs doctrines, mais sur l’utilité qu’on attribue à la croyance. Si l’on ne peut pas croire, on en fait du moins semblant ; on cherche à inspirer aux autres une foi qu’on n’a pas soi-même, parce qu’on suppose qu’ils en vaudront mieux. Ainsi peut s’organiser, chez une nation, un vaste système d’hypocrisie ; ainsi l’on peut arriver à considérer des opinions que l’on croit fausses, comme la garantie unique des bonnes mœurs et des bonnes lois. Plus même on est porté à faire respecter les lois et la morale, et plus on doit témoigner de la déférence pour les hommes qui sont les gardiens des puissances qu’on suppose en être la base, même lorsque soi-même on juge ces croyances mal fondées : on trompe les hommes pour leur intérêt : c’est par vertu qu’on est hypocrite.
Tromper les peuples dans la vue de les rendre meilleurs, est une action que tous les moralistes n’ont pas condamnée, et que des philosophes ont quelquefois hautement approuvée. J.-J. Rousseau, si sévère dans ses principes de morale, admire les législateurs de l’antiquité, qui ont fait intervenir les dieux pour faire triompher leurs idées : il ne trouve pas le mensonge condamnable, pourvu que celui qui en fait usage soit un homme de génie. Mais, comme il n’y a pas de faiseur de projets qui ne se croie tel, il est clair que nul ne doit s’abstenir d’employer ce moyen ; pour ne pas en faire usage, il faudrait supposer que les lois qu’on impose sont mauvaises, ou avouer qu’on les croit telles, et quel est le législateur qui a jamais fait un tel aveu ?
Les effets que produit le système que j’examine ici, ne sont pas les mêmes dans toutes les circonstances et dans toutes les religions.
Les peuples qui couvrent la terre, sont divisés par plusieurs religions principales, chacune desquelles se partage en une multitude de sectes particulières. Non seulement chacune de ces religions proclame que toutes les autres sont fausses, mais chaque secte admet en principe la fausseté de toutes les autres sectes de sa propre religion. Je n’ai pas à examiner ici quelle est la secte qui admet toutes les vérités sans aucun mélange d’erreurs ; il me suffit d’observer qu’il n’en peut pas exister deux qui soient dans le même cas ; et que par conséquent, toutes, moins une, excluent des vérités utiles, ou consacrent des erreurs funestes. En considérant toutes les religions, moins une, comme l’ouvrage des hommes, et toutes les sectes, moins une, comme renfermant des erreurs et excluant un nombre plus ou moins grand de vérités, il nous sera aisé de voir les conséquences que produit, sur le genre humain, un système qui fonde exclusivement la morale ou la législation sur une croyance particulière [51].
Il est évident, en premier lieu, que les préceptes d’une religion, étant jugés bons par cela seul qu’ils sont considérés comme l’expression d’une volonté supérieure, ne peuvent être modifiés ni par les conséquences qui résultent de l’observation, ni par les progrès des lumières. Il suit de là qu’un peuple est stationnaire sur tous les points que sa religion a décidés : nulle des vérités qu’elle exclut ne peut plus être reconnue ; aucune des erreurs qu’elle consacre ne peut être détruite [52].
Une religion dont les dogmes et les préceptes ont été fixés dans des temps d’ignorance et de barbarie, exclut naturellement plus de vérités et consacre plus d’erreurs qu’une religion qui s’est fixée à une époque où il existait déjà quelques lumières, si d’ailleurs l’une ne renferme pas un plus grand nombre de préceptes que l’autre. Ainsi, lorsque deux religions existent simultanément chez un peuple, la dernière est celle qui oppose le moins d’obstacles à ses progrès, si elle est le résultat de la persuasion et non de la violence. Une réforme ne peut s’opérer sans le secours du raisonnement ; les réformateurs commencent toujours par être en minorité ; ils ne peuvent avoir pour eux ni la force qui résulte du nombre, ni celle que donne la possession de l’autorité ; il faut qu’ils aient celle qui résulte de la raison.
En second lieu, entre deux religions, celle qui renferme le moins de dogmes, de préceptes ou de défenses, est aussi celle qui met le moins d’obstacles aux progrès de l’esprit humain, et qui s’oppose par conséquent le moins aux progrès de la morale et de la législation. Une religion qui réglerait tous les rapports sociaux, qui renfermerait un code de morale et un code de législation, et qui déterminerait jusqu’aux usages et aux professions de la vie civile, ferait de la nation qui l’aurait adoptée l’esclave de ses prêtres. Le raisonnement serait considéré chez elle comme séditieux et comme impie ; toute tentative faite pour établir des mœurs plus pures, ou de meilleures lois, serait tout à la fois un outrage à la divinité, et un acte de révolte envers le gouvernement. Les habitudes sociales et les lois étant considérées dans leurs rapports avec la volonté prétendue d’un être supérieur, et non dans leurs rapports avec la prospérité des nations, les peuples ne seraient pas plus éclairés par l’expérience que par le raisonnement. Leurs souffrances et leur décadence même seraient improfitables, et ne les autoriseraient pas à se plaindre. S’ils voulaient faire quelque progrès, il faudrait qu’ils détruisissent leurs idées religieuses, leur législation, leur gouvernement, et jusqu’à leurs habitudes privées. Cela leur serait d’autant plus difficile, qu’ils ne pourraient être éclairés par aucune discussion ; qu’ils n’auraient aucune confiance dans le raisonnement ; que leurs idées et leurs mœurs seraient formées par ceux-là mêmes qui les gouverneraient, et que les ministres de la religion, gardiens naturels des mœurs et des lois, joindraient à l’ignorance et aux préjugés de la multitude, l’intérêt qui naîtrait de l’esprit de corps et de la possession du pouvoir [53].
[I-231]
Un système qui fonde la morale exclusivement sur les préceptes d’une religion positive, et qui laisse la législation soumise au raisonnement et à l’expérience, est beaucoup moins contraire que le précédent aux progrès d’une nation ; cependant, la morale privée exerce une telle influence sur le bien-être des hommes, et elle est si intimement liée avec la législation, qu’il est impossible qu’un tel système ne soit pas une source de querelles, et un obstacle à leur perfectionnement. Si le gouvernement conserve son indépendance, il peut changer les mœurs par la force des lois et par le progrès des lumières ; s’il est asservi ou dominé par les ministres de la religion, ceux-ci peuvent changer les lois en changeant les idées et les mœurs. S’ils s’associent pour l’oppression, on aura tous les vices d’un gouvernement théocratique : les prêtres prêteront l’appui de la religion à des lois oppressives ; les autorités civiles prêteront l’appui des lois aux prétentions sacerdotales. S’ils se divisent avec des forces à peu près égales, on verra renaître les querelles entre le sacerdoce et les autorités civiles, et les peuples se feront la guerre pour savoir s’ils doivent obéir à leurs magistrats ou à leurs prêtres.
Nous avons vu qu’un peuple auquel on persuadait que telle ou telle opinion religieuse était le fondement exclusif de l’ordre social et des bonnes mœurs, pouvait devenir hypocrite par système, et en quelque sorte par vertu. Cela peut arriver, en effet, lorsqu’il existe des institutions, des lois et des lumières suffisantes pour que les mœurs conservent quelque pureté ; mais si le gouvernement est vicieux et la population ignorante, les mœurs se corrompent à mesure que la croyance s’affaiblit. Or, comme chacun reconnaît que toutes les religions, et même toutes les sectes, moins une, sont fausses ; et, comme il est de la nature de l’erreur de périr, il s’ensuit que, dans presque tous les pays, on donne à la morale une base fausse et périssable, toutes les fois qu’on lui donne exclusivement pour appui une croyance particulière.
Le roi Numa, pour inspirer aux Romains le respect des propriétés, pouvait trouver commode de leur persuader que les bornes qui limitaient les champs étaient des dieux, et que ceux qui les déplaceraient seraient punis par des puissances invisibles ; il pouvait trouver convenable aussi de leur faire croire que ses lois lui étaient inspirées par la divinité. Un peuple qui était assez ignorant et assez simple pour le croire, dut se laisser influencer par les opinions qu’il adopta ; cependant, s’il ne voyait, dans le déplacement des bornes, qu’une offense faite aux dieux, la question se réduisait, ou à trouver le moyen de s’emparer de la propriété sans déplacer les bornes, où à se convaincre que des pierres n’étaient pas des dieux.
Ainsi, quand un principe de morale est fondé sur une erreur, il tombe aussitôt que cette erreur se dissipe, car on ne voit plus alors de raison pour l’observer ; et lorsqu’on fait dépendre la morale tout entière de la croyance de telle opinion particulière, on autorise et l’on encourage, en quelque sorte, à n’avoir que de mauvaises mœurs, non seulement les incrédules, mais encore tous ceux qui ont des opinions religieuses différentes. Un prêtre romain, par exemple, peut bien faire à un musulman, à un juif, ou même à un protestant, un crime de ne pas croire à l’infaillibilité du pape ; mais il ne peut leur reprocher de manquer de probité, de bonne foi, de tempérance, ou de toute autre vertu ; car, l’incrédulité étant admise, il ne peut plus y avoir pour eux de raison d’exercer des vertus sociales.
[I-234]
La tendance qu’ont les ministres d’une religion à faire considérer leur croyance particulière comme le fondement exclusif de la morale ou de la législation, est d’autant plus forte, que les préceptes de cette religion sont plus nombreux. Plus, en effet, le fondateur d’une religion a été prévoyant, et plus il a restreint le champ sur lequel les hommes ont pu exercer leur intelligence. La crainte de voir découvrir des préceptes funestes aux hommes, devient d’ailleurs plus forte à mesure que le nombre de ces préceptes se multiplie. De là il suit que les religions qui renferment le plus d’erreurs, ou qui excluent le plus de vérités, sont aussi celles qui souffrent le moins l’exercice de l’intelligence. Il ne faut donc pas être surpris si les peuples dont les mœurs, les lois et les simples usages ont été réglés par des préceptes religieux, se sont arrêtés dans la carrière de la civilisation.
Pour juger des effets généraux du système que nous examinons ici, il ne faut pas se borner à examiner quelles sont les conséquences qu’il produit appliqué à une religion particulière : il faut en voir les conséquences dans le monde entier ; il faut considérer que ce système retient dans la barbarie les peuples de l’Asie et de l’Afrique, et même une partie de ceux de l’Europe ; il faut considérer que, même parmi les sectes chrétiennes, celles qui autorisent sans réserve l’usage de l’intelligence humaine, ne forment qu’une fraction infiniment petite du genre humain.
[I-235]
Cependant, s’il est vrai qu’il n’existe aucun dogme reconnu par les peuples, qui interdise, soit d’examiner quelles sont les conséquences de nos habitudes et de nos institutions, soit de détruire des habitudes ou des institutions vicieuses par des moyens autres que ceux qui seraient tirés de telle ou telle religion, sur quoi pourrait-on fonder un pareil système ? Pourrait-on établir, par des faits, qu’il n’a existé de bonnes lois ou de bonnes mœurs que là où telle croyance spéciale a été admise, et que, partout où la même croyance a été reçue, les mœurs et les lois ont été bonnes ? Pourrait-on établir que tous les moyens pris hors de cette croyance pour établir de bonnes lois ou de bonnes habitudes, ont été funestes aux nations ? Ces propositions sont tellement démenties par les faits, que personne n’a encore osé les soutenir ; il ne s’est trouvé personne qui, après avoir affirmé que ses opinions religieuses étaient l’unique fondement de la morale, ait osé ajouter qu’il n’avait jamais existé de bonnes mœurs que chez les individus qui avaient adopté la même croyance, et que tous ceux qui l’avaient admise avaient eu de bonnes mœurs et de bonnes lois.
Ne pouvant soutenir une proposition si évidemment démentie par les faits, on convient qu’aucune croyance particulière n’est la base exclusive de la morale ou des lois ; on va même jusqu’à dire qu’il est assez indifférent que l’on adopte telle ou telle opinion religieuse, pourvu qu’on en adopte réellement une. Cette doctrine compte un grand nombre de partisans dans tous les pays, et particulièrement en Angleterre. Nous tenons peu, disent-ils, à ce que les hommes professent telle ou telle croyance ; qu’ils soient juifs, catholiques, ou même musulmans, peu importe : l’essentiel est qu’ils aient une religion positive et qu’ils la suivent. Ils reprochent à la nation française, non d’être catholique, non d’adopter de fausses opinions, mais de ne pas être suffisamment religieuse, c’est-à-dire de ne pas tenir assez fortement à des dogmes enseignés par un clergé quelconque. Il est des prêtres, dans certains cultes, qui ne sont pas éloignés de partager cette manière de voir ; ils conviendraient volontiers que les doctrines qu’ils enseignent sont douteuses ou fausses, si l’on voulait leur accorder qu’elles sont nécessaires. Leurs efforts tendent bien moins à en prouver la vérité, qu’à persuader aux hommes qu’elles sont indispensables au maintien de l’ordre et des bonnes mœurs. Ces doctrines, qu’ils présentent comme nécessaires, ne sont pas celles qui sont communes à toutes les religions, et qui se rapportent aux préceptes de la morale ; ce sont, au contraire, les doctrines spéciales qui appartiennent à chacune d’elles.
Ce système, réduit à sa plus simple expression, peut se rendre en ces termes : les hommes ont besoin de bonnes mœurs et de bonnes lois, mais ils ne peuvent obtenir ou conserver les unes et les autres qu’en adoptant un certain nombre d’erreurs convenues, et en chargeant un corps nombreux de les enseigner. Ainsi, vous musulmans, vous devez croire les doctrines de votre prophète, vous, Indous, vous devez croire celles du vôtre, quelque fausses qu’elles soient ; car, si vous ne les croyez pas, vos femmes seront infidèles, vos enfants se moqueront de vous, et vos serviteurs s’empareront de vos biens. Il est vrai que nous, qui n’avons aucune foi dans vos prophètes, et qui les considérons comme des imposteurs, nous avons des serviteurs honnêtes, des femmes chastes et des enfants soumis ; mais c’est par la raison que nous avons adopté une autre croyance que vous considérez comme un tissu d’erreurs et de mensonges.
Ce qu’il y a de remarquable dans ce système, c’est que ceux qui veulent l’établir ne parlent jamais qu’au nom d’un Dieu de vérité, d’un Dieu ennemi du mensonge et de l’imposture ; ils présentent ce Dieu comme le fondateur de la morale ; ils admettent en même temps que toutes les religions et toutes les sectes, moins une, sont des erreurs ou des impostures ; et ils prétendent ensuite que cette morale que Dieu même a fondée ne saurait se soutenir, si les erreurs sur lesquelles elle repose venaient à être détruites.
J’ai parlé, dans ce chapitre, du système qui fait d’une religion positive le fondement exclusif de la morale ou de la législation ; et j’ai fait observer en même temps que ce système n’était que l’ouvrage des hommes. Il ne faudrait donc pas conclure de ce que j’ai dit, que nulle religion ne saurait produire sur les mœurs une influence salutaire. Je n’ai parlé que du système qui exclut l’usage de l’intelligence de l’étude de la morale ou de l’étude des lois. La religion chrétienne n’exclut le raisonnement d’aucune de ces deux sciences : elle ne renferme même aucune disposition législative, aucun principe de gouvernement. Plusieurs des sectes de cette religion n’existent que par l’usage que les hommes ont fait de leur entendement ; et si, dans d’autres sectes, cet usage est condamné, il ne l’est par aucun précepte tiré du fond même de la religion.
On se fonde, pour condamner l’usage du raisonnement, sur ce que tels dogmes ou tels préceptes ont été établis par la divinité elle-même. Mais, en admettant que c’est la divinité qui a créé l’homme, il est au moins aussi clair que l’intelligence humaine est son ouvrage, qu’il est clair que tel précepte ou tel dogme a été donné ou établi par elle. Il dépend de tel ou tel individu de présenter ses opinions particulières comme des dogmes ou des préceptes établis par la divinité ; mais il n’est en la puissance de personne de changer la nature du genre humain. En étudiant cette nature, nous pouvons nous tromper, mais nous n’avons à craindre que nos propres erreurs ; en voulant adopter des opinions qui nous sont transmises, nous avons à craindre tout à la fois nos erreurs personnelles et les erreurs ou les mensonges des hommes qui nous ont précédés.
La méthode qui fait reposer sur l’observation, les sciences de la législation et de la morale, ne peut pas avoir d’autre force que celle qui appartient à la vérité ; elle n’exclut rien de ce qui est vrai, mais aussi elle ne peut être combattue que par des systèmes qui renferment autre chose que la vérité.
[I-240]
CHAPITRE IX.↩
De la doctrine qui fonde la morale et la législation sur le principe de l’utilité, ou sur l’intérêt bien entendu.
Lorsqu’on ramène la science de la législation à la simple observation des faits, on s’aperçoit sur-le-champ qu’elle ne peut être ni la déduction d’un certain nombre de maximes, ni les conséquences d’une convention primitive, ni l’expression de la volonté générale, ni le résultat de certains dogmes religieux ; on est obligé de mettre à l’écart tous les systèmes et les livres qui les renferment, et de ne voir que les hommes, et les choses au milieu desquelles ils sont placés. Un jurisconsulte justement célèbre [54], et joignant à un esprit très philosophique la connaissance des lois de son pays, a écarté, en effet, tous les systèmes qui avaient été faits avant lui, et a cherché à introduire une méthode nouvelle dans l’étude de cette science ; il a jugé les lois et les actions humaines par le bien et le mal qui en résultent ; il n’a admis qu’un seul principe de raisonnement : celui de l’utilité du plus grand nombre. Avant que d’examiner cette doctrine, il ne sera pas sans utilité d’examiner comment l’auteur y a été conduit.
Les sciences morales, ainsi que je l’ai fait précédemment remarquer, n’ont été longtemps que des recueils de préceptes ou d’avis adressés par des théologiens ou par des philosophes, tantôt aux gouvernements, tantôt aux nations. Il est résulté de cette manière de les envisager que, lorsqu’au lieu de donner des conseils ou des préceptes, des écrivains se sont attachés à exposer comment les choses se passent, on les a considérés comme ayant créé les faits qu’ils avaient observés. On les a alors approuvés ou condamnés, selon qu’on a trouvé ces faits conformes ou contraires aux systèmes qu’on avait d’avance adoptés.
Il est peu d’ouvrages, par exemple, qui aient rencontré des adversaires plus violents que le livre De l’Esprit, d’Helvétius. Pourquoi ? Ce n’est pas parce qu’il renferme un certain nombre d’erreurs ; c’est parce que l’auteur a cru voir que les actions humaines sont généralement approuvées par ceux à qui elles profitent, et condamnées par ceux à qui elles sont funestes ; que les individus, les corporations, les peuples, et le genre humain tout entier honorent toujours les hommes en raison du bien qu’ils s’imaginent avoir reçu d’eux ; que l’amitié, l’esprit de corps, le patriotisme, l’humanité, désignent des qualités que nous estimons plus ou moins, selon qu’elles s’appliquent plus ou moins immédiatement à nous ; que nous préférons un individu dévoué à nos intérêts personnels, à un individu qui est dévoué aux intérêts d’un corps dont nous faisons partie ; que nous préférons un individu dévoué à un corps dont nous sommes membres, à celui qui est dévoué aux intérêts de la nation à laquelle nous appartenons ; enfin, que nous préférons un homme dévoué à notre patrie, à un homme qui se dévoue aux intérêts généraux de l’humanité.
Dans l’opinion d’Helvétius, ces observations s’appliquent à nos sentiments de haine comme à nos sentiments de bienveillance : suivant lui, un homme qui serait l’ennemi du genre humain tout entier, nous inspirerait moins de haine ou d’antipathie que celui qui serait l’ennemi particulier de notre nation ; celui-ci nous en inspirerait moins que celui qui serait l’ennemi d’un corps dont nous ferions partie ; et enfin, ce dernier nous en inspirerait moins que celui dont la haine se dirigerait spécialement sur notre personne ; notre aversion pour les mauvaises actions ou pour les sentiments de malveillance acquiert donc de l’intensité à mesure que ces actions et ces sentiments s’individualisent et se rapprochent de nous.
Que ce soit là les dispositions générales des hommes, c’est un fait dont on ne peut guère douter. Serait-il bon que le genre humain fût organisé de manière à juger ou à sentir différemment ? C’est une question sur laquelle on peut se partager, mais sur laquelle on discuterait en vain ; puisqu’il ne dépend point de nous de changer la nature de l’homme. J’observerai cependant que, si la force avec laquelle nous ressentons l’injure n’était pas en raison du danger personnel que nous courons, nous aurions difficilement le moyen de nous conserver ; et que, si les actes qui blessent l’humanité entière nous causaient des souffrances égales à ceux qui nous attaquent directement, nous serions les êtres les plus misérables ; puisque nous serions sans cesse tourmentés par des maux que nous n’aurions aucun moyen d’éloigner. On peut faire sur les bienfaits la même observation que sur les injures : si ceux dont nous sommes personnellement l’objet, ne nous inspiraient pas plus de reconnaissance que ceux qui se répandent sur l’humanité entière, il est probable que nous éprouverions peu de préférences, et que nous en ferions peu éprouver aux autres : c’est alors que l’égoïsme se montrerait dans toute sa puissance. Quoi qu’il en soit, nous ne devons pas perdre de vue qu’il ne dépend pas de nous de changer la nature des choses : tout ce que nous pouvons faire c’est d’observer ce qu’elles sont pour en tirer le meilleur parti.
Il résulte des observations précédentes, que, si un individu exerce un bienfait envers un autre, il pourra lui inspirer plus ou moins de reconnaissance ; mais que, si ce bienfait n’a eu lieu qu’aux dépens d’un nombre plus ou moins grand de personnes, d’une corporation, par exemple, la haine produite d’un côté excédera, par le nombre des personnes, la reconnaissance qui aura été produite d’un autre côté. Si le bienfait s’est répandu sur une corporation, et s’il a été exercé aux dépens d’un peuple, la proportion de bienveillance et de malveillance produites pourra rester la même que dans le cas précédent ; mais il est probable cependant que la somme de malveillance l’emportera. Enfin, si le bienfait s’est répandu sur une nation, et s’il a été exercé aux dépens de l’humanité entière, la somme de mal, et par conséquent de haine, l’emportera sur la somme de bien et de reconnaissance. Ces sentiments d’amour ou de haine, de reconnaissance ou de vengeance, ne peuvent exister cependant qu’autant que tous les individus affectés en bien et en mal voient nettement la cause qui les a affectés.
Mais le sentiment de haine produit par le mal qui résulte d’une action, ne se concentre pas sur l’auteur immédiat de cette action, il se répand sur tous ceux qui en profitent ou qui en témoignent de la reconnaissance. Qu’un général, par exemple, trahisse, en faveur de l’ennemi, la nation qui l’emploie, la haine qu’il inspirera au peuple qu’il aura trahi ne tombera d’abord que sur lui, et elle ne se répandra même pas plus loin si personne ne l’a excité à la trahison, et si, au lieu de l’en récompenser, l’ennemi lui-même l’en a puni, soit par son mépris ou autrement. Mais si la trahison a été récompensée, honorée même par le peuple qui en a profité, c’est sur lui que se répandra la haine qu’elle aura produite : il en sera considéré comme l’auteur. Qu’un ministre, pour la grandeur particulière de son pays, devienne le fléau des autres nations, il pourra mourir chargé de richesses et d’honneurs ; mais qu’on ne pense pas pour cela que les sentiments de haine et de vengeance qu’il aura allumés périront avec lui ; ils passeront sur la nation qui aura profité des calamités des autres, et comme les nations ne meurent pas, elle en sera tôt ou tard la victime. C’est ainsi que réagirent sur le peuple de Rome les nations qu’il avait si longtemps opprimées, et qu’elles lui firent payer les triomphes qu’il avait décernés à ses généraux.
En appliquant ces idées à la morale et à la législation, on n’arrive à cette idée que, pour juger des actions ou des lois, il faut juger les effets qu’elles produisent, non relativement à un individu, à un corps, à un gouvernement ou à une nation, mais relativement au genre humain tout entier ; si le mal qui en résulte excède le bien, le sentiment de haine qu’elles produiront sera plus fort ou plus persévérant que le sentiment contraire qui en sera la suite. Les individus qu’elles favoriseront auront à lutter, pour les maintenir, contre le sentiment même qui porte le genre humain vers son accroissement et sa prospérité ; et comme ce sentiment est indestructible, et qu’il agit constamment, il finira par triompher et par détruire les races qui lui auront fait obstacle. De là le système qui fonde les lois sur la plus grande utilité, ou sur l’intérêt bien entendu. Lorsqu’on les fonde sur ce principe, il est clair qu’elles doivent produire le plus de bien et le moins de mal possible, et que, par conséquent, les forces qui leur sont propres doivent excéder celles qui tendent à les détruire.
Mais l’homme qui étudie ou qui expose une science doit-il procéder de la même manière qu’une assemblée qui donne des lois à un peuple ? La puissance du premier se borne à faire voir ce que les choses sont et ce qu’elles produisent, à rechercher la vérité relativement à un certain ordre de faits, et à exposer le résultat de ces recherches dans l’ordre le plus méthodique. Lorsqu’il a développé ou formé la science, c’est à ceux en qui réside la force, qu’il appartient d’en tirer parti ; sa mission consiste à répandre la lumière, à éclairer les routes diverses que les nations peuvent parcourir ; mais il n’a rien à prescrire à personne. Si, lorsque la vérité a été exposée, la force qui porte le genre humain vers son développement et son bien-être, ne suffit pas pour déterminer les peuples à suivre la meilleure route, la science n’a nul reproche à se faire, elle ne peut plus rien.
Les gouvernements ne procèdent pas de la même manière ; ils n’ont pas à faire connaître les divers systèmes des lois qui ont existé, les causes qui les ont produites, et les conséquences qui en ont été ou qui en seront la suite. Ils se bornent à interdire ou à punir ce qu’ils savent être mauvais, à commander ou à récompenser ce qu’ils savent être bon ; à déterminer les procédés, ou à tracer les règles les plus propres à conduire à la découverte d’un certain ordre de vérités, et à assurer l’exécution de leurs commandements et de leurs défenses. Ils profitent des lumières répandues par la science ; mais ils ne les propagent pas : ils mettent en pratique les règles qu’elle a découvertes. Les résultats auxquels ils arrivent peuvent être les mêmes que ceux vers lesquels tendent les savants ; mais les premiers y arrivent plus immédiatement que les seconds.
Le genre humain tendant par sa propre nature vers sa prospérité, on ne peut pas dire que l’homme qui étudie la législation et qui cherche à éclairer les autres sur les conséquences bonnes et mauvaises que produisent les lois, imagine un système ; car ce n’est pas créer un système que de faire voir ce que les choses sont et ce qu’elles engendrent. Le système consiste à établir un principe pour en faire dériver une science ; à faire d’un précepte de morale, la règle qui doit nous conduire dans la recherche des faits. C’est là une erreur de méthode dans laquelle est tombé M. Bentham : je dis une erreur de méthode, car qui pourrait songer à contester le principe qui sert de base à ses doctrines [55] ?
[I-248]
« Le bonheur public, dit cet illustre jurisconsulte, doit être l’objet du législateur : l’utilité générale doit être le principe du raisonnement en législation. » Ce n’est pas un fait général que le savant auteur affirme ; c’est un devoir qu’il établit ; et j’ai déjà dit que l’objet de la science est d’exposer les faits ; mais que les savants n’ont rien à prescrire à personne, au moins en qualité de savants. Les règles, les devoirs peuvent sortir de l’exposition des faits ; ils peuvent en être des conséquences ; et c’est seulement alors qu’ils sont incontestables. Mais, si l’on commence un ouvrage scientifique par ce qui devrait en être la conclusion ; si, au lieu d’exposer aux hommes ce qui est, on commence par leur déclarer ce qu’ils doivent faire, on risque beaucoup ou de ne pas être écouté, ou de soulever contre soi une multitude de préjugés. Faites voir aux nations que tel fait existe, et qu’il produit telle conséquence ; si l’observation porte avec elle un caractère d’évidence, on n’a point d’objection à craindre, point d’incrédulité à surmonter. Mais dites à tel homme, à un sultan, à son ministre, ou même à leurs esclaves : « Le bonheur public doit être l’objet du législateur : l’utilité générale doit être le principe du raisonnement en législation » ; il est bien possible que, de très bonne foi, ils vous demandent : Pourquoi ? Et où trouver alors la raison du devoir, si l’on ne veut pas recourir au livre de Mahomet ? J’ai supposé que la question pourrait être faite par un sultan, par son ministre ou par leurs esclaves ; mais je n’aurais pas fait une supposition absurde, si, au lieu de mettre cette question dans leur bouche, je l’avais supposée dans l’esprit de la plupart des rois, des ministres et des sujets européens [56] ?
[I-250]
Le bonheur public, l’utilité générale, n’est pas un but qui soit particulier à la science de la législation. Toutes les sciences, tous les arts ont ou se proposent un résultat semblable ; ils ne différent que dans le genre de bien ou d’utilité qui leur est propre. La médecine et la chimie, par exemple, tendent à des fins diverses ; mais l’une comme l’autre a pour résultat le bonheur public ou l’utilité générale. La législation n’a pas pour objet de faire connaître tous les faits qui produisent du bien ou du mal, d’exposer tous les plaisirs et toutes les peines dont l’homme est susceptible, et d’en assigner toutes les causes. Si tel était l’objet de cette science, elle ne devrait rien laisser à dire sur aucune autre ; elle devrait exposer jusqu’aux procédés les plus minutieux des arts, sans en excepter celui qui consiste à donner à nos aliments la dernière préparation. Ainsi, en admettant qu’on procède régulièrement lorsqu’on fait d’un axiome de morale le fondement d’une science, cet axiome serait ici trop général, puisqu’il conviendrait également à toutes les sciences, et même à tous les arts.
En faisant ces observations, je suis loin de méconnaître les services immenses que M. Bentham a rendus à la science de la législation ; mais ces services ne consistent pas à avoir établi un principe nouveau. Ils consistent à avoir indiqué le moyen le plus sûr de calculer les conséquences bonnes et mauvaises qui résultent d’une loi ou d’une action, et à avoir fait à plusieurs branches de la législation, une heureuse application de sa méthode. Avant lui, tous ceux qui avaient écrit sur la législation avaient généralement admis que le bonheur public ou l’utilité générale devait être le résultat des lois ; mais nul n’avait cherché à faire l’analyse des éléments dont le bien public se compose, nul n’était resté fidèle à ce principe. On a paru croire cependant qu’il était le premier qui avait imaginé le système de l’utilité, parce qu’il a fait un devoir de la consulter exclusivement, au lieu de marcher sur les traces de ses devanciers. On lui a su peu de gré de sa méthode ; mais on lui a fait un reproche de son principe fondamental que quelques personnes ont considéré comme une nouveauté dangereuse.
En faisant du principe de l’utilité le fondement de la science, M. Bentham n’a fait que suivre l’exemple que lui avaient donné ses prédécesseurs ; il n’a différé d’eux qu’en ce qu’il n’a jamais voulu s’écarter de ce principe, ou en reconnaître d’autres. En écrivant son livre De la République, Platon ne se proposa que de décrire la forme de gouvernement sous laquelle les hommes jouiraient de la plus grande somme de bonheur possible. Aristote n’eut pas d’autre objet dans son Traité de politique ; c’est même par là qu’il commence son ouvrage, et il revient plusieurs fois sur la même idée. Il est évident, suivant lui, que tous les gouvernements qui ont pour but l’utilité des citoyens, sont bons et conformes à la justice, dans le sens propre et absolu, et que tous ceux qui ne tendent qu’à l’avantage particulier des hommes qui gouvernent, sont dans une fausse route [57]. Cicéron ne raisonnait pas sur un autre principe que les philosophes de la Grèce : il admet, comme eux, que l’utilité commune des citoyens doit être le but de la législation [58].
Les écrivains modernes ont-ils admis un principe opposé ? Ont-ils prétendu que le législateur ou le moraliste devaient se proposer autre chose que l’utilité générale ? On serait disposé à le croire, lorsqu’on se borne à consulter quelques passages de leurs écrits ; mais lorsqu’on recherche quelle a été leur pensée, on voit qu’ils ont adopté la même opinion qu’Aristote. Le mot utilité a deux sens : un restreint, et l’autre très étendu ; dans le sens restreint, il signifie un avantage immédiat et en quelque sorte matériel ; dans le sens étendu, il désigne les avantages présents et futurs, de quelque nature qu’ils soient, et quelles que soient les personnes qui en profitent. En prenant le mot dans le sens restreint, Grotius dit que l’utilité ne doit pas toujours être consultée ; mais il n’est pas du même avis, lorsqu’il prend ce mot dans l’acception la plus étendue. Il trouve alors, dans l’utilité de tous les citoyens, l’origine du droit civil et des sociétés humaines ; et c’est dans l’utilité de toutes les nations, qu’il trouve l’origine du droit des gens [59].
Wolff, un des hommes qui a le plus écrit sur ce qu’on nomme le droit naturel, ne juge les actions humaines que par l’influence qu’elles exercent sur les hommes : il les trouve bonnes si elles ont pour résultat le perfectionnement de l’espèce, mauvaises si elles tendent à la détériorer : ce qui n’est que le principe de l’utilité présenté sous d’autres termes [60].
Burlamaqui commence son traité de droit naturel en ces termes :
« Nous avons dessein, dans cet ouvrage, de rechercher quelles sont les règles que la seule raison prescrit aux hommes, pour les conduire sûrement au but qu’ils doivent se proposer, et qu’ils se proposent tous en effet, je veux dire au véritable et solide bonheur. »
Mais parmi ceux qui ont écrit sur les principes des lois, il n’en est aucun qui se soit montré plus constant au principe de l’utilité, que Guillaume Pestel. Son ouvrage intitulé, Fundamenta jurisprudentiæ naturalis, est divisé en deux parties. Dans la première, l’auteur examine ce qui peut rendre la vie heureuse ; dans la seconde, il recherche quelles sont les lois naturelles qui conduisent au bonheur.
Dans la première section de son livre, l’auteur observe qu’il existe deux sortes de plaisirs : des plaisirs vrais ou salutaires, et des plaisirs faux ou trompeurs ; les premiers sont ceux qui ne sont pas suivis de regrets ou qui n’engendrent point de peine ; les seconds sont ceux qui sont suivis de conséquences funestes. Pestel donne le nom de bien à toute cause productive de véritable plaisir ; il donne le nom de mal à toute cause de faux plaisir : le bonheur, dit-il, est l’état de l’homme qui, sans être exempt de toutes peines, a cependant la certitude de jouir toujours de véritables plaisirs ; le désir du bonheur est inné dans l’homme : tous les hommes sont portés vers lui comme vers une fontaine commune.
Cet auteur est si loin de condamner la tendance de l’homme vers le bonheur, qu’il considère cette tendance comme l’expression même de la volonté de l’Être suprême. La volonté et les fins de Dieu, dit-il, sont connues par ses œuvres ; Dieu a rendu le désir du bonheur inhérent à la nature de l’homme ; il n’a donc pas voulu que la recherche du bonheur fut contraire à cette mère nature. Voluntas et fines Dei ex operibus divinis cognos cuntur. Naturæ humanæ Deus insevit appetitum felicitatis, ergo noluit ut ejus adeptio eidem naturæ repugnaret [61].
Aristote avait dit que, puisque le bien est la fin commune de toutes les sciences et de tous les arts, le plus important et le plus puissant de tous, l’art social, doit avoir pour résultat le plus grand de tous les biens, c’est-à-dire la justice, qui n’est elle-même que l’utilité commune [62]. C’est également dans l’utilité commune que Pastel voit la justice [63].
Comment s’est-il donc trouvé des hommes qui aient pu croire que le principe de l’utilité était une découverte moderne et particulière à un écrivain ? Ce principe, dans la pratique, est aussi ancien que le monde ; dans la théorie, il est aussi ancien que les plus anciens écrivains. Mais lorsqu’on a énoncé le principe que le bonheur public doit être l’objet du législateur, on n’a pas fait faire à la science de la législation plus de progrès qu’on n’en ferait faire à la médecine, en disant que la guérison des malades doit être l’objet des médecins. Cela est très vrai, mais cela n’apprend rien à personne [64].
Tous les peuples tendent naturellement à établir ce qu’ils croient utile pour eux ; ils tendent également à repousser ce qu’ils supposent leur être funeste. Voilà deux faits que les savants peuvent avoir observés, mais qu’ils n’ont point créés, et qu’ils ne sauraient détruire. Ces deux faits reconnus, que reste-t-il à faire à un homme qui veut faire faire des progrès à une science ? A-t-il besoin de recommander au genre humain de rechercher ce qui lui est avantageux, d’éviter ce qui lui est funeste ? Est-il nécessaire de lui faire un devoir de ce qui en lui est une tendance indestructible ? De lui dire qu’il doit s’attacher à ce qui lui est utile, et rien qu’à ce qui lui est utile ? Mais le genre humain ne fait pas autre chose ; s’il ne réussi pas toujours à faire ce qui lui est le plus avantageux, ce n’est point parce que le désir n’existe pas, ou que la tendance n’est point assez forte ; c’est parce que les lumières ou les moyens lui manquent ; ce n’est jamais sciemment et volontairement que les peuples suivent une fausse route. On peut quelquefois être entraîné par de mauvaises habitudes à faire ce qu’on sait être funeste, ou à ne pas faire ce qu’on sait être utile ; mais, lors que cela arrive, les vices ne sont pas d’une longue durée ; ils passent avec les générations qui en ont été infectées, et qui impriment aux générations qui les suivent des habitudes contraires.
La science de la législation peut donc se borner, comme toutes les autres, à exposer clairement ce que les choses sont et ce qu’elles produisent ; elle n’a besoin ni d’imposer des devoirs, ni même de tracer des règles de conduite. Je dirai plus, elle n’a раs besoin de principes, à moins qu’on ne désigne par ce mot des faits généraux qui en produisent d’autres. Les règles, les maximes, ou ce qu’on appelle des principes, appartiennent à l’art ; ils servent de guide au jurisconsulte, au magistrat, ou même à celui qui est chargé de la rédaction des lois ; mais les faits, et les faits seuls, sont du domaine de la science ; les savants les exposent et en montrent l’enchaînement ; les règles en sortent ensuite d’elles-mêmes. Si l’on procède en sens contraire ; si l’on commence par poser un principe qui ne soit pas un fait, pour y ramener ses observations, alors on crée un système, on se trouve réduit à tout fonder sur un devoir, sans avoir une base sur laquelle ce devoir repose.
Si le devoir dont on fait la base de ses raisonnements, n’est pas une idée parfaitement claire et universellement admise, par quel moyen convaincre les personnes qui ne l’adoptent pas ? Si je dis à un ministre ou à une assemblée : le bonheur public doit être votre objet ; l’utilité générale doit être le principe de vos raisonnements en législation, nous pourrons raisonner ensemble, s’ils reconnaissent que tel est en effet leur devoir. Mais s’ils n’admettent pas le principe, s’ils prétendent que leur devoir est de consulter ou leurs intérêts personnels, ou ceux de leur roi, ou ceux d’une caste, ou ceux des ministres d’un culte ; s’ils pensent, comme Rousseau, qu’ils ne doivent rien à ceux à qui ils n’ont rien promis, comment parvenir à s’entendre ? Faudra-t-il leur démontrer que l’intérêt qu’ils placent avant le bonheur public, ou avant l’utilité générale, exige qu’ils consultent exclusivement cette utilité ? On se trouvera donc réduit à remonter à un autre principe ; il faudra admettre alors que l’intérêt des ministres, ou celui du roi, ou celui des nobles, ou celui des prêtres, doit être l’objet du législateur ; il faudra démontrer ensuite que cet intérêt exige que l’utilité générale soit le principe du raisonnement ; démonstration qui ne sera pas facile, si les individus dont l’intérêt devra d’abord être consulté, ne l’ont pas fondé d’avance sur l’utilité générale [65].
[I-260]
Il faut observer d’ailleurs que les hommes se croient, en général, soumis à plus d’un devoir ; lorsqu’on fait d’un seul la règle de toute leur conduite, on soulève tout à coup contre soi une multitude de sentiments et de préjugés ; pour qu’ils fussent disposés à admettre ce principe sans restriction, il faudrait qu’ils vissent sur-le-champ que leurs autres devoirs, loin d’être des exceptions au principe, n’en sont que des conséquences, et s’ils voyaient cela, ils sauraient tout ce qu’on se propose de leur apprendre. C’est pour s’être ainsi laissé prévenir par un mot, et pour n’avoir pas vu que le principe de l’utilité ne peut exclure rien de ce qui est utile, que des écrivains ont été conduits à attaquer ce principe, et à chercher aux sciences morales un autre fondement. On a eu recours tantôt au sentiment moral, tantôt à la justice, tantôt au sentiment religieux, faute d’avoir compris le mot utilité dans toute son étendue.
Les faits, quand ils sont bien constatés, parlent à toutes les consciences, et ne sont soumis à aucune objection ; on n’a besoin de les faire reposer sur aucun principe sujet à controverse ; ils se soutiennent par une force qui leur est propre. Celui qui les expose et qui en démontre l’enchaînement, n’exige la foi de personne ; tout le monde peut voir ce qu’il a vu. On peut errer sans doute en exposant les faits, ou en en suivant l’enchaînement ; on peut être trompé par un faux témoignage ; on peut rapporter un effet à une cause qui n’est pas la sienne ; mais c’est un inconvénient qui est commun à toutes les sciences, sans en excepter les plus exactes : il n’y a pas de mathématicien, qui ne puisse faire un faux calcul. L’erreur, en pareil cas, appartient à l’homme ; elle n’appartient pas à la méthode.
On ne peut attaquer le principe de l’utilité, à moins de tomber sur-le-champ en contradiction avec soi-même, ou à moins d’être atteint de folie ; c’est donc sur la méthode que portent mes remarques, et non sur le principe en lui-même. La question n’est pas ici de savoir si ce principe est vrai ou faux, s’il est utile ou dangereux pour le genre humain ; elle est de savoir quel est le moyen le plus sûr de faire faire des progrès aux sciences morales, ou de faire triompher ce même principe dans le sens le plus étendu.
En disant que M. Bentham a fondé la science de la législation sur un devoir imposé aux savants ou aux législateurs, je suis loin d’avoir voulu faire entendre qu’il n’a point consulté les faits. Ses ouvrages sont, au contraire, remplis d’observations justes ; et s’il m’arrive quelquefois de n’être pas d’accord avec lui, ce n’est que lorsqu’il n’a pas été assez fidèle à son principe, faute d’avoir suffisamment observé les faits.
[I-263]
CHAPITRE X.↩
De la discordance qui existe, en morale et en législation, entre les systèmes adoptés en théorie, et les règles suivies dans la pratique ; et de la nécessité de mettre l’intelligence des hommes en harmonie avec leur conduite. Conclusion de ce livre.
Nous avons vu précédemment que l’effet produit par un faux système est, ou de faire considérer comme utiles au genre humain des actions ou des lois qui lui sont funestes, ou de faire considérer comme funestes des actions ou des lois qui lui sont utiles. En faussant ainsi le jugement des nations, un système vicieux affermit les mauvaises lois et les mauvaises habitudes qui existent déjà, ou il en multiplie le nombre ; ou bien il ébranle les bonnes lois ou les bonnes habitudes déjà établies, ou il empêche que le nombre s’en augmente.
Mais, comme les conséquences que produisent les lois et les habitudes, sont indépendantes du jugement que nous portons de ces habitudes ou de ces lois, et comme, par leur propre nature, les hommes tendent à repousser ce qui les blesse, et à établir ce qui leur est utile, un peuple ne peut adopter un faux système sans qu’il s’établisse aussitôt une lutte entre le mouvement inhérent à sa propre nature, et les opinions qu’il a adoptées.
Cette lutte entre la tendance qui porte le genre humain vers son développement et sa prospérité, et les idées qui tendent à le rendre stationnaire ou à lui imprimer un mouvement rétrograde, a pour effet, non de rectifier immédiatement les fausses opinions qu’on a adoptées, mais d’en affaiblir insensiblement l’influence. D’abord, on cherche à mettre en pratique toutes les opinions qu’on a reçues ; les bons effets qu’on en espère inspirent un zèle qui n’appartient qu’à la conviction ; mais bientôt la tendance inhérente à la nature humaine l’emporte sur des opinions factices ; le relâchement arrive ; les actions cessent d’être en harmonie avec les doctrines ; et des opinions qu’on a adoptées comme l’expression même de la vérité, ne sont plus que de vaines formules qu’on répète par habitude, et qui n’ont plus d’autre résultat que d’obscurcir l’entendement. Quelquefois, en conservant les mots du système, on y attache d’autres idées ; on prête à l’auteur des pensées qu’il n’a point eues ; on suppose qu’on l’a d’abord mal interprété, et on lui fait hommage de sa raison, plutôt que de reconnaître qu’il s’est trompé, et qu’on s’est égaré en le suivant.
Les systèmes religieux sont moins sujets que les systèmes philosophiques ou politiques à éprouver des révolutions de ce genre, parce que toutes les religions font des promesses ou des menaces dont il n’est pas facile de vérifier l’accomplissement. Cependant les systèmes religieux eux-mêmes sont modifiés par la tendance qui porte le genre humain vers sa prospérité ; à mesure qu’une fausse religion vieillit, on voit s’affaiblir le zèle des nations qui l’ont adoptée. Les premières pratiques auxquelles on renonce sont celles qui sont les plus contraires à la nature de l’homme ; les dernières qu’on observe sont celles qui exigent le moins de sacrifices. Les sectes se forment quand l’esprit cesse d’être convaincu, et pour ne pas accuser les fondateurs de s’être trompés, on suppose qu’ils ont été mal entendus. On leur attribue alors les idées qu’on croit soi-même les plus raisonnables ; le zèle religieux se ranime ; et, s’il ne peut se soutenir qu’en combattant des penchants inhérents à la nature de l’homme, il finit encore par succomber.
Les plus durables des faux systèmes sont ceux qui sont adoptés par les législateurs, et qui se confondent avec une religion quelconque. C’est cette alliance de la politique et de la législation aux idées religieuses, qui a fait la durée du système de Mahomet. C’est aussi parce que la puissance de cette alliance est connue, qu’il n’y a point de mauvais gouvernement qui ne cherche à se confondre avec la religion, ni de fausse religion qui ne cherche à s’allier avec les lois. Cependant, même lorsque cette alliance existe, la force inhérente à la nature humaine en affaiblit l’empire, et finit même quelquefois par en triompher.
On a beaucoup vanté la sagesse des rois et des prêtres d’Égypte ; mais qu’est-ce qui nous reste des uns et des autres, si ce n’est quelques débris de monuments et des signes inexplicables ? Les lois de Lycurgue ont fait l’admiration des philosophes modernes ; cependant que sont-elles devenues, et quel est le peuple qui a jamais songé à se les approprier ? Les institutions si admirées des autres peuples de la Grèce ou du peuple de Rome, sont également tombées, sans que personne ait songé à les relever. L’esclavage domestique, qui se liait à tout, a suffi pour tout corrompre ; il a entraîné la ruine de tous les systèmes auxquels il se rattachait, et il a lui-même fini par disparaître. La religion païenne a subi la même destinée ; elle n’a pu être soutenue ni par le génie des plus grands poètes, ni par les efforts de ses prêtres, ni par la puissance des empereurs. Le système féodal qui a couvert l’Europe après la chute de l’empire romain, s’est éteint après un règne de quelques siècles. L’église de Rome, dont le pouvoir suffisait pour ébranler l’Europe, traite maintenant de puissance à puissance avec quelques poignées de brigands. L’empire musulman est ébranlé jusque dans ses fondements par des hommes qu’on prenait pour les derniers et les plus lâches de leurs esclaves ; et la chute de cet empire n’est pas la plus grande des ruines auxquelles nous assistons. Ainsi périssent les erreurs et les faux systèmes qui semblaient devoir arrêter la marche du genre humain.
Mais si, au milieu de ces vastes destructions que les peuples laissent sur leur passage, il se rencontre des observations prises dans la nature ; si un philosophe nous peint avec une sévère exactitude les sombres fureurs d’un tyran, ou les emportements d’une ignorante multitude ; si un poète nous fait le tableau des passions et des discordes qui agitent les chefs d’une armée, ou s’il nous apprend quelles furent les mœurs domestiques de ses concitoyens ; si un sculpteur, animant le marbre sous son ciseau, nous montre l’espèce humaine dans ses plus belles proportions ; si un observateur profond nous trace les caractères des infirmités auxquelles les hommes sont assujettis, et nous en fait connaître les remèdes ; si un savant jurisconsulte prononce une décision qui soit fondée sur la nature invariable de l’homme ; les ouvrages des uns et les observations ou les décisions des autres vont, à travers les siècles et les révolutions, servir de modèle ou de guide aux générations les plus reculées. Des esprits à systèmes peuvent nous faire admirer des législateurs qui, par force ou par adresse, sont parvenus à faire adopter certaines institutions à des populations plus ou moins barbares ; mais lorsque nous voyons, d’un côté, ces institutions célèbres tomber en ruine sans que personne songe à les relever ; et que, d’un autre côté, nous voyons les décisions des jurisconsultes romains, qu’un heureux hasard a fait découvrir après plusieurs siècles de barbarie, adoptées et converties en loi par presque tous les peuples de l’Europe, sans l’intervention ni des miracles, ni de la violence, il est permis de croire à la puissance de la vérité, et à la durée des lois qui ont été prises dans la nature même de l’homme.
Si les systèmes établis ou soutenus par la puissance des gouvernements et par l’autorité des religions, perdent insensiblement de leur influence, et tombent en ruine lorsqu’ils sont en opposition avec le mouvement qui porte le genre humain vers son développement, des systèmes qui n’ont pour appui que les sophismes et l’éloquence des écrivains qui les ont imaginés ne sauraient avoir sur la conduite des hommes une longue influence. On peut les adopter dans un moment d’entraînement et d’enthousiasme ; mais, si les effets qu’ils produisent ne répondent pas aux espérances qu’ils ont fait naître, on ne se laisse pas longtemps diriger par eux ; il est rare même qu’on adopte un faux système en entier, et qu’on en suive toutes les conséquences. Comme les faux systèmes peuvent se multiplier à l’infini, et qu’il n’est pas possible qu’une longue série d’erreurs soit volontairement et unanimement adoptée, les fausses opinions se neutralisent mutuellement. Un individu qui a adopté de fausses idées, et qui voudrait les mettre en pratique, aurait à lutter contre une foule d’autres individus qui ont adopté d’autres idées. Il suit de là que chacun est obligé de chercher des raisons et d’adopter des lois qui puissent convenir au plus grand nombre, et qu’on fait ainsi, du système qu’on a adopté, des formules de sa croyance, sans en faire les règles de sa conduite. Il y a alors deux êtres dans le même individu : celui qui pense, et celui qui agit : celui-ci se conforme autant qu’il le peut au mouvement qui convient à sa propre nature ; celui-là n’existe que dans un monde imaginaire.
L’expérience de tous les jours nous prouve que l’entendement des hommes n’est plus en harmonie, ni avec leurs intérêts, ni avec leur conduite. Un écrivain peut soutenir, en thèse générale, que la conscience est le seul juge éclairé des lois et des actions, ou que, pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, il suffit de consulter le sens moral ou le sentiment intime ; mais, s’il se trouve dans une assemblée où une question de morale soit controversée, et où quelqu’un soutienne une opinion contraire à la sienne par principe de conscience, il affirmera sans la moindre hésitation que la conscience de son adversaire se trompe ; il lui prouvera, par des raisons tirées du bien et du mal, qu’il a tort de la prendre pour guide, et qu’on ne doit suivre les mouvements de sa conscience que lorsqu’on a éclairé son jugement.
Un publiciste pourra soutenir que le sentiment religieux est le principe unique des bonnes lois et des bonnes mœurs, et que la morale et la liberté ont été perdues, le jour où les hommes ont jugé les actions et les lois par le bien et le mal qu’elles produisent, et où ils ont consulté leur intérêt bien entendu ; il prouvera son système par l’histoire des hordes sauvages et des nations civilisées, par celle des peuples modernes et par celle des peuples anciens ; mais si le même écrivain est appelé dans une assemblée législative, et qu’il ait à combattre une loi qu’il croit mauvaise, il laissera de côté son système sur le sentiment religieux ; aux hommes impartiaux, il exposera les conséquences bonnes ou mauvaises de la loi proposée ; il leur fera voir que le bien qu’elle doit produire est nul, ou du moins infiniment petit, tandis que le mal qui en résultera sera immense, bien convaincu que, s’il parvient à leur prouver que les mauvais effets excèdent les bons, il les déterminera à rejeter la loi ; aux hommes avides ou craintifs, il prouvera que la loi doit leur être funeste ; qu’elle est contraire à leurs intérêts bien entendus, et que, par cette raison, ils doivent la rejeter. Après que l’homme d’État aura ainsi rempli son devoir, le philosophe ira faire le sien ; il retournera à son système ; il prouvera que les écrivains qui ont enseigné aux hommes à consulter leur intérêt bien entendu, et à juger les lois et les actions par les conséquences bonnes et mauvaises qu’elles produisent, ont été les destructeurs de la morale et des bonnes lois, et qu’il n’y a rien à espérer des nations, aussi longtemps qu’on ne renoncera point à ces funestes doctrines.
Un troisième, après s’être rempli l’esprit des maximes de Grotius ou de Burlamaqui, présentera un système de lois naturelles ; s’il est professeur, il enseignera que ces lois, gravées dans tous les cœurs, admises par le genre humain tout entier, sont éternelles et immuables, et qu’aucune autorité humaine ne peut les changer ; mais, s’il est appelé dans un conseil, et qu’il soit question de prendre quelques mesures énergiques, ce seront d’autres doctrines et un autre langage ; alors on proclamera la nécessité de modifier, de suspendre même les lois éternelles, immuables, invariables ; le salut du monarque ou du peuple deviendra la loi suprême sous laquelle toutes les autres plieront ; on poursuivra, on enfermera dans des cachots quiconque s’avisera de parler, autrement qu’en théorie, des lois immuables qu’aucune puissance ne peut ni suspendre ni modifier.
Un cinquième, imbu des dogmes du Contrat social, ne reconnaîtra, en théorie, le caractère de lois qu’aux actes qui seront l’expression de la volonté générale ; il établira qu’il n’existe parmi les hommes d’autres obligations que celles qui résultent des conventions ; mais, s’il est question ensuite de faire des lois, il trouvera qu’on n’en peut faire de bonnes, à moins d’enlever toute sorte d’influence aux quatre-vingts dix-neuvièmes de la population ; il proclamera la souveraineté du peuple, pourvu qu’il n’existe ni assemblées, ni nominations populaires, et que nul, excepté les ministres, n’ait la faculté de publier un fait ou une opinion.
De cette multitude de systèmes, et de cette opposition continuelle qui existe entre les doctrines qu’on professe et les principes qu’on met en pratique, il résulte que les nations ne savent ni ce qu’elles doivent faire, ni ce qu’elles doivent penser ; et, ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que les hommes qui ont ainsi une double doctrine leur reprochent, tantôt de ne point se passionner pour leurs systèmes, tantôt de s’attacher à l’un et de faire violence à l’autre : comme s’il était possible de se passionner pour des contradictions, et de marcher en même temps vers deux points opposés !
Les hommes qui imaginent des systèmes, se bornent, en général, à en avoir deux ; celui de la théorie, qui est celui d’un monde imaginaire doué de perfection, et celui de la pratique, qu’on est obligé de conformer aux imperfections de la nature humaine. Mais les hommes qui n’ont pas assez de confiance dans leur jugement pour avoir des opinions qui leur soient propres, et qui n’osent penser que d’après des livres, ne s’en tiennent pas à deux systèmes contradictoires. Ils étudient souvent tous ceux qui leur tombent sous la main, et les reçoivent tous avec la même confiance, pourvu que les auteurs n’appartiennent pas à des partis opposés. Leur entendement devient ainsi un véritable chaos, formé de mots auxquels ils n’attachent aucun sens précis, mais qui leur servent à manifester des sentiments de satisfaction ou de mécontentement, dont ils ne démêlent pas les véritables causes. Si une loi leur paraît mauvaise, ils diront qu’elle est telle parce qu’elle est une violation ou des principes du droit naturel, ou du contrat social, ou des droits de l’homme. Si elle leur paraît bonne, ils manifesteront leur approbation par des mots opposés, auxquels ils n’attacheront pas des idées plus précises. Ce n’est pas que les peuples ne fassent des progrès, malgré cette confusion. Il est beaucoup d’idées justes qui se trouvent hors du cercle de tous les systèmes, et qui, par conséquent, sont peu contredites. Il y a d’ailleurs, même dans les hommes les plus simples, un fond de bon sens que ne peuvent étouffer tous les sophismes, et qui, dans la pratique, a plus d’influence que les mots qui obscurcissent l’entendement. Mais, si les peuples avancent, ce n’est, pour ainsi dire, qu’à tâtons et en hésitant ; ils ne sont pas sûrs du terrain sur lequel ils marchent ; et, après avoir fait quelques pas, il n’est pas rare de les voir revenir en arrière, dans la crainte de s’être engagés dans une fausse route.
Dans toutes les sciences, on a commis des erreurs ; dans toutes, on a imaginé de faux systèmes ; mais ce n’est qu’en politique ou en législation que l’on observe ce défaut d’harmonie entre la théorie et la pratique. Les physiciens, les chimistes, les médecins, agissent comme ils pensent ; ils ne se remplissent pas l’esprit de tous les faux systèmes imaginés par leurs prédécesseurs. Pour eux, tout ce qui n’est pas reconnu bon dans la pratique, est rejeté comme mauvais même dans la théorie ; une erreur démontrée, est une opinion détruite ; une vérité constatée, est une conquête qui ne peut plus être perdue ; leur entendement n’est jamais en arrière de leurs procédés. Il en est tout autrement dans la législation ; dans cette science, il n’y a, pour la plupart des hommes, ni vérités ni erreurs ; il n’y a que des opinions ; on admire en théorie, ce qu’on repousserait en pratique ; et il n’est jamais sûr que l’action réponde à la pensée.
Tous les gouvernements font des lois, et les gouvernements ne peuvent être composés que d’hommes. Il ne faut donc pas être surpris si les lois n’ont presque jamais été considérées que dans leurs rapports avec les formes de gouvernement établies, et si l’on a cherché tour à tour à faire des lois démocratiques, aristocratiques ou monarchiques. Il ne faut pas non plus être surpris, si, en général, on s’occupe de la forme du gouvernement pour rechercher ensuite quelles sont les lois qui conviennent à cette forme. Pour la plupart des hommes qui s’occupent de législation ou de politique, le premier besoin est de posséder l’autorité, le second de s’y maintenir. En elle-même, cette tendance n’est point un mal, puisqu’il n’est pas impossible de désirer la puissance, pour s’en servir dans l’intérêt du public, encore plus que dans son propre intérêt. Mais si, en elle-même, cette tendance n’est pas vicieuse, elle n’est pas non plus scientifique : elle n’est pas un moyen bien sûr d’arriver à la découverte de la vérité. Ce que nous avons à rechercher, ce sont les lois suivant lesquelles les peuples prospèrent ou dépérissent ; lorsque nous aurons trouvé ces lois, nous pourrons rechercher quels sont les gouvernements qui en assurent le mieux la durée, ou qui tendent avec le plus de force à les détruire. Les lois, pour être bonnes, doivent sortir de la nature même de l’homme ; un gouvernement, pour être bon, doit être tel qu’il tende, par sa propre nature, à l’observation exacte de ces mêmes lois.
Il résulte de cette manière d’envisager les choses, qu’en étudiant la législation comme science, on n’a point à rechercher si telle loi est démocratique, aristocratique, oligarchique ou monarchique ; et que, par conséquent, on n’a point à s’occuper des diverses formes de gouvernement. Les mots au moyen desquels on désigne ces formes, ne rappellent que des idées indéterminées et confuses ; ils ne sont propres qu’à réveiller des sentiments aveugles de sympathie ou d’antipathie. Tel individu croira avoir flétri une loi en disant qu’elle est antimonarchique ; tel autre croira avoir fait un fort bon raisonnement, en disant qu’elle est mauvaise, parce qu’elle est aristocratique. Les systèmes qu’on fait sur les gouvernements, ne sont ni mieux conçus, ni mieux suivis que ceux qu’on a faits sur les fondements de la législation : mais ce n’est pas ici le lieu de les examiner.
Il résulte de ce chapitre que, si les divers systèmes qu’on a faits sur la législation, servent à obscurcir l’entendement des peuples, ils ne dirigent pas leur conduite ; qu’ils sont même souvent abandonnés dans la pratique, par les écrivains mêmes qui les ont imaginés ; que ce ne sont plus, par conséquent, que des formules qu’on étudie et qu’on répète sans y croire. Ce sont des espèces de religions dont le fonds a disparu, et dont on conserve les formes par bienséance ou par habitude ; on invoque le Contrat social, comme les poètes invoquent Jupiter, sans avoir plus de foi dans l’un que dans l’autre. Mais, comme une fausse religion ne disparaît entièrement que lorsqu’elle a été remplacée par une religion nouvelle, les faux systèmes, en législation et en politique, ne tomberont dans l’oubli que lorsqu’ils auront été remplacés par quelque chose de plus propre à satisfaire l’esprit. Qu’est-ce donc qui pourra les remplacer ? Qu’est-ce qui établira l’harmonie entre l’entendement des hommes et leur conduite ? L’étude, l’observation des faits : c’est là une répétition ; mais c’est une vérité sur laquelle il faudra revenir plus d’une fois, avant qu’elle soit comprise.
Mais les faits résoudront-ils toutes les questions ? Jetteront-ils la lumière sur tout ce qui est obscur ? Non sans doute. Lorsqu’on étudie une science, et qu’on a bien constaté quelques faits, on peut remonter à ceux qui les ont produits ou descendre à ceux qui en résultent. Soit qu’on monte des effets aux causés, ou qu’on descende des causes aux effets, on doit aller aussi loin qu’ils peuvent nous conduire. Mais quand ils s’arrêtent et qu’ils cessent de nous éclairer, nous devons nous arrêter avec eux, nous ne pouvons aller au-delà, sans entrer aussitôt dans l’empire des ténèbres, des vagues conjectures, et des interminables disputes. Si des questions importantes restent à résoudre, il faut laisser au temps et à l’expérience le soin d’en donner la solution. Il n’est point de sciences qui se soient formées spontanément ; il n’en est aucune qui se soit chargée de résoudre toutes les questions soulevées par notre intérêt ou par notre curiosité. Un fait bien constaté vaut mieux que le système imaginaire le plus ingénieux. Si nous ne voulons pas nous engager dans la route de l’erreur, n’oublions pas que la vérité a pour devise :
Je suis fille du Temps, et dois tout à mon père.
[I-278]
LIVRE SECOND.↩
De la nature et de la description des lois, et des diverses manières dont elles affectent les hommes.
CHAPITRE PREMIER.↩
De la nature des lois ; des éléments de force ou de puissance dont elles se composent, et des diverses manières dont quelques-unes se forment et se détruisent.
En examinant, dans le livre précédent, les divers systèmes qu’on a imaginés sur la législation et la morale, nous avons vu qu’on ne peut faire reposer les mœurs ni les lois, sur les bases qu’on leur a données, et que les auteurs de ces systèmes, en ont méconnu la nature et le fondement. Ayant vu ce que les lois ne sont pas, et ce que même elles ne peuvent pas être, j’ai maintenant à exposer ce qu’elles sont, et à indiquer quelle en est la base et la nature. Mais, puisque les sciences de la législation et de la morale ne peuvent se former, comme les autres, que par l’observation et l’exposition de certains phénomènes, où faut-il rechercher les faits au moyen desquels il nous est possible de déterminer la nature des lois et des mœurs ? Nous ne pouvons les chercher que dans les hommes, ou dans les choses au milieu desquelles ils sont placés. Il faut donc écarter les livres ; s’il est permis d’en faire usage, ce n’est qu’autant qu’ils peuvent nous aider dans la recherche ou l’examen des faits.
De tous les individus de la race humaine, qui existaient il y a un siècle, il n’en est presque point qui n’aient disparu ; et de tous ceux qui vivent dans ce moment, il n’en existera que fort peu dans le même espace de temps. Le genre humain cependant, bien loin de décroître ou de dépérir, s’accroît, au contraire, dans une progression très grande, et les générations qui existent, vivent, en général, plus heureuses que celles qui les ont précédées. Mais, quoique les nations prospèrent, chacun des individus dont elles se composent, naît, croît et meurt dans un temps donné ; ce n’est donc que par un mouvement continuel de production, d’accroissement et de destruction des individus, que le genre humain se perpétue et se perfectionne.
Ce mouvement qui s’opère chez les peuples et qui en perpétue la durée, n’a lieu qu’au moyen de certains rapports qui existent ou qui s’établissent, soit entre les hommes et les choses, soit entre les individus ou les collections d’individus dont le genre humain est formé. Un homme ne vit qu’au moyen de l’animal, de l’arbre ou du champ qui le nourrit, des vêtements qui le couvrent, de la cabane ou de la maison qui lui sert d’abri. Il ne se reproduit qu’au moyen d’un être de son espèce auquel il s’unit. Ses enfants ne croissent et ne se multiplient à leur tour, qu’au moyen des soins qu’ils reçoivent de lui ou d’autres individus de son espèce. Lorsqu’il périt, les choses qu’il employait à perpétuer son existence ou à satisfaire ses plaisirs, vont satisfaire les plaisirs ou perpétuer l’existence d’autres individus, aussi longtemps qu’elles sont propres à cet usage. Enfin, tous ayant des besoins et des désirs, emploient à les satisfaire les moyens qui sont en leur puissance.
Ayant les mêmes besoins et étant doués des mêmes facultés, les hommes prennent en général les mêmes mœurs, toutes les fois qu’ils se trouvent dans la même position, qu’ils ont les mêmes lumières et qu’ils possèdent les mêmes moyens. De là il résulte que, lorsque tous les individus dont une nation se compose, sont arrivés à peu près au même degré de civilisation, tous agissent d’une manière à peu près uniforme à l’égard les uns des autres. L’uniformité est encore augmentée par l’influence qu’une partie de la population exerce sur les autres parties, influence qui résulte de la force, du courage, des lumières ou de la richesse. On remarque dans l’homme deux tendances qui semblent opposées, et qui le poussent cependant vers le même but. L’une est celle qui le porte à contraindre ses semblables à régler leur conduite d’après la sienne, toutes les fois qu’il s’imagine avoir sur eux quelque supériorité. L’autre est celle qui le porte à imiter ce qu’il voit faire, toutes les fois qu’il s’imagine que l’imitation sera suivie de quelque heureux résultat pour lui-même.
Il est remarquable que moins une population s’est éloignée de la barbarie, et plus il y a d’uniformité dans la conduite et dans les mœurs des individus ou des familles dont elle se compose. Tous les individus parvenus au même développement, ayant en effet les mêmes besoins, la même force, les mêmes moyens d’existence, et les mêmes dangers à courir, ne peuvent avoir que des idées et des mœurs semblables. Les différences d’organisation physique, qui existent chez quelques-uns, ne produisent que de légères différences dans leur intelligence et dans leurs passions ; parce que tous sont obligés de se livrer aux mêmes occupations, que nul ne peut avoir plus qu’un autre le temps ou le moyen de développer les dispositions particulières qu’il a apportées en naissant, et que d’ailleurs il n’y est excité par aucun motif individuel. Aussi, lorsqu’on étudie les coutumes des peuples barbares, trouve-t-on que, dans les mêmes circonstances, ils se conduisent tous à peu près de la même manière, et sont doués des mêmes vertus et des mêmes vices. Cette ressemblance est telle que, dans la même horde, tous les individus de même âge et de même sexe étant mus par les mêmes passions, se livrant aux mêmes exercices et se nourrissant des mêmes aliments, portent tous la même physionomie. Les différences qu’on observe entre deux hordes, tiennent à des différences d’origine, de position ou d’occupations.
Chez les peuples qui ont fait quelques progrès dans la civilisation, les différences d’occupations, de fortune et de développement intellectuel, produisent nécessairement quelques différences dans les mœurs ou dans la manière de se conduire les uns à l’égard des autres ; cependant, ces différences sont loin d’être aussi grandes que les inégalités qui les produisent. Un homme a quelquefois sur un autre une immense supériorité par son intelligence, par sa fortune ou par le rang qu’il occupe dans l’ordre social ; mais, si l’on compare la conduite de l’un à la conduite de l’autre, relativement aux divers membres de leurs familles, à la distribution de leurs biens, à leurs mœurs privées ou publiques, on ne trouvera entre eux que des nuances très légères. Les différences qu’on remarquera, ne seront même pas toujours en faveur de ceux qui, à d’autres égards, auront la supériorité.
Ces diverses manières d’être et de procéder, qu’un peuple tient de sa propre nature, de ses facultés, de ses besoins, de l’état de ses connaissances, de la position dans laquelle il se trouve, sont le résultat des lois auxquelles il obéit ; et puisqu’il est impossible qu’un peuple existe et se reproduise, sans un mode quelconque d’être et de procéder, il est impossible de concevoir un peuple privé de lois ou de mœurs : cela est aussi impossible qu’il est impossible de concevoir de la matière destituée de toute forme. Les lois d’un peuple étant les puissances qui déterminent le mode suivant lequel il existe, se maintient et se perpétue dans un état donné, on ne peut pas avoir à rechercher quels ont été les premiers fondateurs de ces lois ; car ce serait rechercher quels ont été les auteurs de sa propre nature, des objets qui l’environnent et des forces auxquelles il obéit. On ne peut pas non plus avoir à rechercher s’il est possible d’enlever à un peuple toute sorte de lois ; ce serait rechercher si une nation peut exister et se reproduire, sans aucune force qui détermine son mode d’existence et de reproduction. Ainsi, l’étude des lois auxquelles un peuple est soumis, n’est pas autre chose que l’étude des forces qui déterminent la manière dont ce peuple existe, se maintient et se reproduit [66].
[I-284]
Mais, pour trouver ces forces ou ces puissances auxquelles les peuples obéissent, et que nous désignons sous le nom de lois, où devons-nous les chercher ? Je l’ai déjà dit : c’est dans les hommes eux-mêmes, ou dans les choses qui les environnent. Les livres, à moins qu’ils ne soient des recueils de mensonges, ne peuvent renfermer que des descriptions de ce qui existe ou de ce qui a existé. On conçoit fort bien cela dans les sciences naturelles et dans quelques branches des sciences morales ; personne n’est assez simple pour confondre un livre sur la botanique avec les plantes dont il renferme la description, un livre sur la minéralogie avec les minéraux dont il indique les caractères, un livre sur la morale ou sur la statistique avec les mœurs ou les richesses de tel ou tel peuple.
Mais il n’en est pas de même en législation : il est très commun, dans cette science, de prendre la description pour la chose décrite, et de considérer même comme une réalité, une description purement imaginaire. Il existe cependant une si grande différence entre la puissance à laquelle nous donnons le nom de loi, et la description de cette loi ; ces deux choses sont tellement distinctes, tellement indépendantes l’une de l’autre, qu’il semble impossible de les confondre, lorsqu’on veut se donner la peine de les considérer attentivement. Souvent, des lois existent sans qu’il soit possible d’en trouver nulle part la description ; ainsi, les lois qui ont déterminé le mode d’existence de tous les peuples de l’Europe, auxquelles nous donnons le nom de coutumes, et que les Anglais nomment loi commune (common law ), ont une existence qui remonte à des temps inconnus, quoique la description qu’on en a faite chez plusieurs, soit toute récente. Souvent aussi des lois ont cessé d’exister depuis des siècles, quoique nous en possédions des descriptions très minutieuses et très exactes ; nous avons, par exemple, la description d’une partie des lois juives, grecques, romaines ; mais la plupart de ces lois n’existent plus depuis longtemps. Celui qui croirait qu’elles existent encore, par la raison qu’il possède des livres dans lesquels il peut en trouver la description, commettrait la même erreur que celui qui croirait à l’existence actuelle des empereurs romains, par la raison qu’il posséderait des médailles sur lesquelles il trouverait leur effigie.
[I-286]
En disant que les lois d’un peuple sont en lui-même, et dans les choses qui l’environnent et qui concourent à déterminer sa manière d’être, j’énoncerais une proposition qui paraîtrait aux uns paradoxale, et que d’autres n’hésiteraient pas à déclarer fausse ; je ne ferais cependant qu’énoncer des faits qui me semblent évidents. Les lois d’un peuple sont en lui, ou font partie de lui, comme ses mœurs, comme ses besoins, comme ses passions, comme ses idées, comme sa physionomie, comme telle forme appartient à tel objet matériel. Si nous sommes portés à penser le contraire, c’est d’abord parce que nous croyons voir identité de choses, là où nous trouvons identité de noms ; et, en second lien, parce que nous prenons souvent, ainsi que je l’ai déjà fait observer, la description pour la chose décrite. En disant que les lois d’un peuple sont une partie de sa propre nature, je ne parle pas de la description de ces lois ; on accordera sans doute que la physionomie d’un individu est une partie de cet individu, mais on n’en dira pas autant de son portrait, quelque exacte que soit la ressemblance.
Les lois d’un peuple changent souvent, et cependant ce peuple reste le même ; souvent aussi les lois restent les mêmes, quoique la population se renouvelle ; comment, dira-t-on, ses lois pourraient-elles donc être une partie de lui ? Les lois d’un peuple changent, cela est évident ; mais il n’est pas moins évident qu’il change lui-même avec elles. La nation française qui existait du temps de Louis XIV, portait le même nom, parlait la même langue, habitait le même sol et en partie les mêmes maisons que le peuple qui existait du temps de Charles IX, ce n’était cependant pas le même peuple ; celui-ci avait disparu. La nation française qui existe en ce moment, parle également la même langue, cultive les mêmes champs, habite en partie les mêmes maisons, exerce les mêmes arts, étudie les mêmes sciences que la nation du temps de Louis XIV ; ce n’est cependant pas la même : tous les individus dont se composait la dernière ont disparu depuis longtemps. Insensibles au mouvement qui nous emporte avec tout ce qui nous environne, nous croyons que rien ne change, tandis que tout est dans un mouvement perpétuel, et qu’il n’est pas un seul objet soumis à l’influence des temps, qui soit exactement le même d’un instant à l’autre. La moindre réflexion suffit pour nous convaincre que la nation qui existe aujourd’hui, n’est pas la même que celle qui existait il y a un siècle ; mais cette substitution sur le même sol, d’un peuple à un autre peuple, ne s’est pas opérée instantanément et par un seul fait. Quel est donc l’instant où la population a cessé d’être la même ? À chaque minute, et nous pouvons dire même à chaque seconde. Il n’est pas un instant où il ne se soit opéré une révolution par la création et par la destruction d’une multitude d’individus, et par les changements qu’ont éprouvés ceux qui ont paru le moins soumis à l’action du temps.
Non seulement les peuples changent à chaque instant lorsqu’on les considère en masse, mais chaque individu change d’un moment à l’autre : nul n’est exactement et absolument le même pendant deux minutes de suite. Sans doute, la matière dont nous sommes formés, le sang qui circule dans nos veines, les sentiments qui nous animent, les passions qui nous agitent, les idées ou les affections qui nous dirigent, les traits même de notre physionomie, et jusqu’à la couleur de notre teint, sont des parties de nous-mêmes ; les détruire serait nous détruire, les modifier serait nous modifier. Mais, s’il en est ainsi, peut-on dire, en parlant avec exactitude, que ce vieillard décrépit qui va descendre dans la tombe, et cet enfant qui naquit il y a quatre-vingt-dix ans, sont le même individu ? Si l’identité ne se trouve, ni dans la matière, ni dans les sentiments ou dans les affections, ni dans les idées, ni dans les traits, ni dans les formes intérieures ou extérieures, ni même dans la couleur, ou se trouve-t-elle ? Si elle n’existe dans aucune des parties, peut-on dire qu’elle existe dans le tout, ou bien prétendrait-on que le tout est identique, quoique l’identité n’existe dans aucune des parties ? Un individu peut donc changer du tout au tout, sans que nous cessions pour cela de le considérer comme étant toujours le même individu ; et par la même raison, une nation peut éprouver diverses modifications, sans que nous cessions de la considérer comme étant toujours la même nation. Nos langues sont trop imparfaites pour se prêter aux innombrables révolutions auxquelles sont soumis et les hommes, et les objets qui les environnent ; et les choses ont quelquefois totalement changé que les noms restent encore [67].
Ainsi, de ce que les nations nous paraissent rester les mêmes, tandis que les lois auxquelles elles sont soumises changent ou se modifient, ou de ce que les lois restent invariables tandis que la population se renouvelle, nous ne devons pas conclure que les lois d’un peuple ne sont pas une puissance dont les éléments résident en partie en lui, et qui déterminent le mode ou les conditions de son existence.
Les éléments de puissance qui forment les lois d’un peuple ne peuvent être qu’en lui-même, ou hors de lui ; s’ils sont en lui, ils sont inhérents à sa propre nature de la même manière que ses idées ou ses affections ; s’ils sont hors de lui, on ne peut les trouver que dans d’autres peuples ou dans des choses matérielles. Toutes les nations ont eu des lois non écrites, et il en est plusieurs qui sont encore dans ce cas : or, si l’on n’admet pas que ces lois sont en elles-mêmes, et qu’elles sont une certaine modification de leur existence, je demanderai où elles étaient et ce qu’elles étaient avant qu’on nous en eût donné la description [68] ?
Il ne faut pas considérer cette distinction entre une loi et la description de cette même loi, comme n’ayant aucune utilité réelle, et n’étant qu’une vaine subtilité de l’esprit : elle est la base même de la science de la législation. Une science, ainsi que je l’ai déjà fait observer, n’est que la connaissance et l’enchaînement d’un certain ordre de faits. Or, si nous ne trouvons pas les lois dans la nature même des peuples ; si nous ne les voyons pas dans les principes d’action qu’ils portent en eux-mêmes, et qui déterminent des modes particuliers d’être et de procéder ; enfin, si nous ne les trouvons ni dans les hommes, ni dans les choses, comment nous sera-t-il possible de les classer au nombre des faits ? Pourra-t-on y voir autre chose qu’une série de mots ou de phrases disposées avec plus ou moins d’ordre ? L’erreur qui consiste à prendre une description pour une loi, l’affirmation écrite d’un certain ordre de faits, pour l’existence même de ces faits, a été plus d’une fois fatale aux nations. Souvent, elles ont cru que pour être placées sous des lois protectrices, il leur suffirait d’en posséder une description faite avec plus ou moins de solennité ; souvent aussi elles ont pensé que pour détruire des lois malfaisantes, il leur suffisait d’en effacer la description de leurs codes. L’expérience a toujours prouvé que c’étaient là de pauvres moyens ; mais l’expérience n’a éclairé personne.
Qu’un prince ou une assemblée fassent écrire, sur une feuille de parchemin, que la propriété, la sûreté individuelle, la liberté d’exprimer et de publier ses opinions, sont garanties ; qu’ils écrivent des noms et mettent de la cire au bas de cette description ; pourra-t-on dire qu’elle est une loi, par la seule raison qu’elle en porte le nom, qu’elle a été revêtue de certaines formes, et publiée avec plus ou moins d’éclat ? Pour décider si c’est une loi, c’est-à-dire une puissance à laquelle rien ne résiste, il faut se demander quels sont les éléments de force dont elle se compose ? Où résident-ils ? Contre qui peuvent-ils agir ? Par qui, et contre qui les garanties sont-elles données ? Si elles ne sont pas données contre les personnes ou les autorités qui ont le désir et la force d’attenter à une des choses prétendues garanties, ce n’est pas une loi ; c’est une fausse déclaration ou un mensonge. C’est également une fausse déclaration, s’il n’existe dans la société aucune puissance garantissante, ou, ce qui est la même chose, si la puissance qui existe, est inférieure à celle contre laquelle la prétendue garantie est accordée. Enfin, c’est encore une fausse déclaration, si la puissance qui doit garantir, et celle contre qui la prétendue garantie est donnée, sont une seule et même puissance. Ainsi, ce qui peut constituer la loi, dans le cas dont il est ici question, ce n’est pas la description faite avec plus ou moins de solennité d’une chose qui n’existe pas ; c’est l’existence réelle, dans le sein d’une nation, d’une puissance ayant une tendance irrésistible à produire le résultat annoncé [69].
Que, d’un autre côté, une assemblée amoureuse de l’égalité, et plus avancée que son siècle, écrive dans ses registres que tous les hommes sont égaux, qu’il n’existe point de distinctions de naissance, qu’on ne reconnaît plus ni rang, ni titres, ni décorations ; pense-t-on que cette description d’un monde imaginaire, sera une puissance qui changera le monde réel ? Si elle menace de peines quiconque ne s’y conformera pas, elle pourra avoir pour effet de commander momentanément l’hypocrisie, d’abaisser en apparence les uns, et de relever un peu les autres ; mais, à la première occasion, les vanités comprimées surgiront de toutes parts, et formeront une puissance qui sera la loi : on verra reparaître alors et les rangs, et les titres, et les distinctions, et tout ce qui s’ensuit.
Mais quels sont les éléments dont se compose cette force à laquelle nous donnons le nom de loi ? Dans l’ordre physique, on donne ce nom à toute puissance qui agit d’une manière constante et régulière, mais dont on ignore presque toujours la nature ; on parle des lois de la pesanteur ou de la gravitation, sans connaître ces lois autrement que par les effets qu’elles produisent. Toutes les fois qu’on observe un effet toujours le même dans une circonstance donnée, et qu’on ne peut pas en expliquer la cause, on donne à cette cause inconnue le nom de loi ; dans ce sens, il n’est point de corps qui n’ait ses lois, ou dont l’existence ne soit soumise à des conditions invariables.
Dans l’ordre moral, on donne également le nom de loi à toute force ou à toute puissance qui agit d’une manière constante et régulière ; on peut la juger par les faits qui en manifestent l’existence ; on peut même quelquefois la décomposer jusqu’à un certain point ; mais la nature des éléments primitifs dont elle est formée, est aussi cachée à nos yeux que la nature des lois du monde physique. Il est possible, dans la législation comme dans d’autres sciences, de remonter d’un fait à un autre ; mais nous arrivons toujours à des faits devant lesquels nous sommes forcés de nous arrêter, parce qu’au-delà nous ne voyons plus rien. Tout ce que nous pouvons faire en décomposant une loi, c’est de montrer les éléments divers dont elle est formée ; mais il ne faut pas espérer d’arriver à la décomposition de chacun de ces éléments.
Il est assez commun de voir une loi dans un ordre écrit, donné par un gouvernement, rédigé et publié dans certaines formes. Ces choses-là font quelquefois, en effet, partie d’une loi ; mais jamais elles ne forment une loi tout entière. Une loi est une puissance qui détermine certaines manières d’agir ou de procéder ; mais cette puissance est rarement un être simple. Elle se compose presque toujours d’une multitude de forces qui concourent vers le même but, et qu’il faut examiner séparément, si l’on veut avoir une idée complète de l’ensemble. On comprendra cette vérité, si je l’applique à une loi spéciale : je prendrai pour exemple la loi qui détermine, en France, l’ordre des successions.
Suivant cette loi, si un père meurt laissant un enfant légitime, et sans avoir fait aucune disposition testamentaire, cet enfant recueille tous ses biens ; s’il laisse deux enfants ou un plus grand nombre, ces enfants se partagent ses biens par égales parts, quelle qu’en soit la nature, sans distinction de sexe ni d’âge, et sans être tenus de suivre d’autres règles que celles qui leur sont tracées par leurs propres intérêts, intérêts dont ils sont eux-mêmes les arbitres. « Les enfants ou leurs descendants, dit le Code civil, succèdent à leurs père et mère, aïeuls et aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages. »
Qu’est-ce que nous trouvons dans ces lignes ? Une seule chose : la simple description dont certaines propriétés se transmettent et se partagent, dans un cas donné. Mais, à proprement parler, ce n’est pas cette description qui constitue la loi : la description pourrait rester la même, tandis que la loi serait changée. La loi n’est pas non plus dans le fait décrit ; ce fait est un simple résultat ; quand il a lieu, c’est la loi elle-même qui le produit. Où donc faut-il voir la loi ? Dans la puissance même qui, dans tous les cas qui se ressemblent, produit le fait dont on vient de lire la description. La plupart des éléments dont se compose cette puissance, ont existé longtemps avant que personne eût songé à en décrire les résultats ; et il est évident qu’ils pourraient survivre, non pas aux faits qu’ils produisent, mais à la description qui en a été donnée. Pour connaître ces divers éléments de puissance, nous devons donc les chercher ailleurs que dans les livres.
Si nous demandons quels sont les éléments dont se compose cette loi, ou, en d’autres termes, quelles sont les forces ou les puissances qui déterminent, en France, cette transmission et ce partage de propriétés, les hommes les plus disposés à penser que les actions des peuples ou leurs manières de juger et de procéder, ne sont que l’expression de la pensée de tels ou tels hommes qu’on appelle des ministres, des princes, des députés ou des législateurs, répondront, sans hésiter, que la cause de la manière dont les biens se transmettent et se partagent, est dans une douzaine de lignes imprimées dans un petit livre que les Français appellent le Code civil. Ces lignes, en effet, peuvent y être pour quelque chose ; mais elles y sont pour bien peu ; les enfants succédaient à leurs pères et se partageaient leurs biens, longtemps avant qu’elles eussent été écrites ; si l’on remontait à d’autres lignes écrites, dont celles-là n’ont été qu’une copie, nous pourrions remonter à des successions et à des partages bien plus anciens encore.
L’écriture au moyen de laquelle on décrit le fait matériel que produit une loi, n’est que l’expression de la pensée d’un certain nombre d’hommes ; ce n’est pas une cause première, c’est un effet et un moyen. La pensée de ces hommes n’est pas non plus une cause première ; elle est le résultat des impressions produites sur eux par une multitude de causes diverses. Les individus qui décrivent les lois ou les phénomènes qu’elles produisent, quels que soient les noms sous lesquels on les désigne, ne sont que des hommes. Ils sont soumis à la même action, ils sont susceptibles des mêmes impressions, des mêmes sentiments, des mêmes besoins, que tous les êtres de leur espèce ; et la plus grande partie du genre humain peut sentir tout ce qu’ils ont eux-mêmes éprouvé. Il résulte de là que les causes qui déterminent une certaine classe d’hommes à décrire ou à ordonner une manière de procéder, agissent, presque toujours, avec la même force ou même avec une force plus grande, sur un nombre très considérable des membres de la société. Si ces hommes s’abstenaient de décrire ou d’ordonner cette manière d’agir ou de procéder, elle n’en serait pas moins suivie par un grand nombre de personnes. Elle le serait même si les individus investis de l’autorité se permettaient de la défendre ; mais elle le serait moins généralement et avec beaucoup plus de peine. Si un gouvernement s’avisait de défendre aux pères de nourrir leurs enfants, ou de leur laisser leurs biens, les pères nourriraient leurs enfants et leur transmettraient leurs biens malgré lui.
Il faut donc mettre au nombre des éléments dont une loi se compose, les forces mêmes qui agissent sur un gouvernement, et qui le déterminent soit à ordonner certaines actions, soit à en interdire d’autres. Ces causes sont même la partie la plus considérable de la puissance que nous désignons sous le nom de loi, lorsqu’elles agissent sur les membres de la société comme sur le gouvernement lui-même. Elles varient comme les idées, les sentiments, les besoins et même les préjugés de la population ; et leur action est souvent plus immédiate et plus forte sur les individus auxquels la loi paraît imposée, que sur ceux qui paraissent les auteurs de cette loi. Pour y obéir, les citoyens n’ont souvent besoin ni de l’intermédiaire de l’écriture qui indique l’action à exécuter, ni de la pensée du gouvernement par lequel cette description a été donnée. Un nombre infini d’actions, qui sont le résultat de la puissance qui forme la loi, sont exécutées à chaque instant par des individus qui n’ont jamais su lire, et qui meurent sans avoir jamais su ce que c’est qu’une loi ou un gouvernement.
L’action exercée sur une partie de la population par une autre partie, au moyen de l’exemple ou par la seule influence de l’opinion, est un second élément dont la loi se compose ; car elle détermine la conduite ou règle les actions d’un nombre considérable d’individus. L’homme est un animal imitateur, de sa propre nature, et c’est là ce qui constitue en partie sa perfectibilité ; il tient aussi à être imité à son tour, et il emploie pour cela les divers genres d’influence qui lui appartiennent. Cette action et cette réaction qu’une nation exerce sur elle-même, contribuent beaucoup à donner une marche uniforme aux divers membres dont elle se compose. Si on voulait en connaître les éléments, il faudrait les chercher dans les besoins, les passions, les idées ou les préjugés des [I-300] diverses fractions dont la population se compose.
Les opinions religieuses contribuent souvent aussi à déterminer un certain genre d’actions : sous ce rapport, elles sont un des éléments de la loi ; elles sont une force qui vient se joindre à des forces d’une nature différente, pour produire le même résultat.
La description que le législateur donne de l’action à exécuter, et la promulgation que cette description reçoit, sont encore au nombre de ces éléments ; elles contribuent à rendre l’action qui est à exécuter, plus générale et plus régulière. Elles ajoutent de plus à l’influence de l’exemple et de l’opinion. Cette description et cette promulgation, faites dans certaines formes, prennent souvent à elles seules le nom de loi ; c’est même le sens vulgaire de ce mot.
Les officiers dont les fonctions consistent à faire paraître les citoyens devant les tribunaux, les magistrats dont ces tribunaux se composent, les individus chargés de mettre leurs jugements à exécution, sont également des forces qui contribuent à produire les faits que le gouvernement à décrits, et qui, par conséquent, font partie de la loi.
L’influence que les nations et les gouvernements exercent les uns sur les autres, entre, comme puissance, dans les éléments dont se forment certaines lois ; cette influence en est quelquefois même la partie principale.
Enfin, les diverses circonstances physiques au milieu desquelles les hommes se trouvent placés, et qui déterminent leur manière de vivre, leurs idées, leurs mœurs, leurs relations mutuelles, sont aussi des puissances qui sont au nombre des éléments de la loi : telles sont la nature et la position du sol, la température de l’atmosphère, la direction des eaux, et d’autres circonstances analogues.
La plupart de ces éléments pourraient se décomposer encore ; mais une décomposition plus grande ne serait ici d’aucune utilité, et nous finirions toujours par arriver à des faits simples qui resteraient inexplicables. Tout ce que je voulais démontrer, c’est qu’une loi n’est qu’un faisceau de forces diverses, produisant toujours des actions semblables dans des cas donnés.
Ces forces, dont l’action réunie forme la puissance légale, peuvent ne pas concourir simultanément vers le même but, ou ne pas agir avec une égale énergie ; elles peuvent quelquefois agir dans des sens opposés. Ce serait une question frivole que celle de savoir quel est le moment précis où elles cessent ou commencent de former une loi ; autant vaudrait rechercher quel est l’instant où tel bloc de marbre, placé sous le ciseau du sculpteur, peut s’appeler une statue. Je ferai seulement observer que, lorsque les forces dont j’ai fait connaître les principaux éléments n’ont plus assez d’énergie pour produire l’action qui devrait en être le résultat, il n’existe plus de loi.
Lorsqu’un gouvernement n’est déterminé à ordonner ou à défendre un certain genre d’actions, que par des causes qui n’agissent pas sur la population d’une manière immédiate ; lorsqu’un des principaux éléments de la puissance qui forme la loi, est l’influence d’un peuple ou d’un gouvernement étranger ; enfin, lorsque les citoyens ne sont déterminés à agir ou à s’abstenir, que par les ordres mêmes qu’un gouvernement leur donne, et par les forces matérielles au moyen desquelles il les contraint, ces lois sont dites injustes ou tyranniques. Lorsqu’au contraire, les causes qui agissent sur le gouvernement, agissent immédiatement et avec la même force sur les citoyens, et qu’elles ne consistent pas dans une influence étrangère, l’autorité publique, en décrivant le fait matériel que produit la loi, n’a pas d’autre objet que de ramener à la règle commune que suit la population, le petit nombre d’individus qui tendent à s’en écarter. Un gouvernement qui déclare, par exemple, que les pères sont tenus de nourrir leurs enfants, et qui emploie sa puissance pour faire exécuter sa déclaration, ne fait pas autre chose que de contraindre un nombre d’individus infiniment petit, à faire ce que l’immense majorité des citoyens exécute sans lui, et exécuterait même malgré lui. Les législateurs n’ont pas jugé qu’il fût nécessaire d’enjoindre aux citoyens de se nourrir et de se vêtir, quoiqu’il se rencontre quelquefois des individus qui se laissent mourir de faim, ou qui sont mal vêtus. La raison en est sensible ; c’est que les causes qui le porteraient à faire une telle ordonnance, agissent avec autant de force sur les citoyens que sur lui-même ; pour que la loi soit observée, il n’est besoin ni qu’elle soit décrite, ni que les tribunaux se mêlent de la faire exécuter [70].
Les lois d’un peuple étant les puissances ou les forces qui déterminent les divers modes suivant lesquels il existe et se perpétue, étant par conséquent, pour la plupart, inhérentes à sa propre nature, qu’est-ce donc qu’un législateur ? Est-ce un génie qui crée les peuples, ou qui les modifie selon ses caprices ? Les hommes qui ont écrit sur les lois, ont fait jouer aux législateurs un rôle immense ; ils en ont fait en quelque sorte des génies divins. Ils les ont nommés les pères des nations, les fondateurs des États ; ils les ont placés au-dessus de l’humanité. Il est vrai qu’après les avoir élevés si haut, ils se sont eux-mêmes placés plus haut encore, puisqu’ils ont démontré les fautes ou les erreurs des législateurs qui ont déjà existé, et qu’ils ont tracé des règles de conduite aux législateurs à venir.
[I-304]
En prenant les lois pour ce qu’elles sont réellement, on voit combien il est difficile de changer les lois d’un peuple, lorsqu’on ne peut opérer ce changement qu’au moyen d’une force intérieure appartenant au peuple même dont on veut modifier l’existence. Il faut modifier ses idées ou son entendement, ses habitudes, et en quelque sorte sa manière de sentir ; il faut le faire renoncer aux choses auxquelles il tient le plus, le soustraire aux puissances qui exercent sur lui l’empire le plus absolu. Aussi, lorsqu’on examine de près l’ouvrage des législateurs, s’aperçoit-on presque toujours que ces hommes se sont bornés, soit à décrire les faits matériels produits par les lois déjà existantes, soit à déclarer les changements que le temps et l’expérience avaient apportés dans la manière de juger et de sentir d’une partie plus ou moins considérable de la population. On a vanté les Romains de ce qu’ils ne détruisaient pas les lois des nations vaincues : c’est que cela n’était guère possible, à moins de détruire les nations elles-mêmes. On peut, au moyen de la ruse, de l’imposture ou de la violence, changer cette partie de la législation qui tient à l’organisation des pouvoirs politiques, si les idées et les habitudes de la population ne sont point formées à cet égard. Mais, pour changer les lois qui tiennent aux mœurs des familles, à la conservation et à la transmission des propriétés, il faut la force d’une armée conquérante, et cette force ne suffit même pas toujours. Il est peu de conquérants qui aient montré plus de violence, plus de mépris pour les peuples vaincus, et surtout moins de politique, que les barbares qui subjuguèrent l’orient de l’Europe au cinquième siècle. Nous voyons cependant que, même dans la confusion inséparable de la conquête, chaque race continua d’être régie par ses propres lois [71].
Une loi peut avoir des siècles d’existence, avant que personne songe à décrire les phénomènes qu’elle produit ; ces phénomènes peuvent être décrits au moment où ils se déclarent ou se manifestent ; ils peuvent l’être même avant qu’ils se soient manifestés. Les phénomènes qui résultent immédiatement de la loi, et dont personne n’a encore donné la description, peuvent être décrits par tout individu qui est doué d’une capacité suffisante pour bien l’observer. Il n’est pas plus nécessaire, pour bien les décrire, d’être revêtu d’une autorité quelconque, que cela n’est nécessaire pour décrire les mœurs d’un individu, ou l’organisation d’une plante. La description peut aussi en être donnée par les membres d’un gouvernement ou par leurs agents : c’est ainsi que les résultats matériels des lois coutumières des diverses provinces de France, furent décrits par des commissaires que le gouvernement français avait choisis. Enfin, elle peut être donnée par un homme qui, s’étant rendu remarquable par son talent pour l’observation, et par son exactitude à bien décrire ce qu’il a observé, a reçu d’un peuple la mission spéciale de décrire la manière dont les choses se passent dans l’ordre social. Je suis très disposé à croire que les législateurs les plus renommés de l’antiquité, auxquels on attribue la création des lois qui portent leur nom, n’ont guère fait que donner la description de phénomènes déjà existants, et que ce qu’il a paru y avoir de nouveau dans leurs systèmes, n’a été que l’expression d’une révolution déjà opérée dans les mœurs ou dans les esprits. En manifestant cette opinion, je suis bien loin de vouloir rabaisser leur mérite ; je pense, au contraire, que c’est le plus grand éloge qu’on puisse faire d’eux ; si, au lien de décrire ce qu’ils avaient observé, ou d’être les organes d’un besoin nouveau, il avaient consulté les rêves de leur imagination, il est douteux que leurs ouvrages eussent été adoptés et que leurs noms fussent parvenus jusqu’à nous.
Si les faits que produit une loi, peuvent n’être décrits que longtemps après qu’elle a été établie, ils peuvent l’être aussi, comme je viens de le dire, au moment où ils vont se manifester, c’est-à-dire au moment où il se fait une révolution dans la manière d’exister d’un peuple, dans la forme de son gouvernement, ou chez les hommes qui exercent sur lui quelque influence. C’est même ainsi que les choses se passent, depuis que l’usage de l’écriture est devenu général, et surtout depuis l’invention de l’imprimerie. Lorsqu’il s’est opéré un changement dans l’esprit ou dans les mœurs de la partie de la société la plus puissante, de celle qui exerce sur les autres la plus forte influence, les phénomènes qui vont être produits par ce changement, sont décrits par les individus chez lesquels il s’est opéré, ou par ceux qui consentent à être leurs organes, et la description qui en est donnée, devient la représentation des effets immédiats de la loi nouvelle ; c’est la représentation de la nouvelle manière d’être, dans laquelle la population est placée.
Lorsqu’on ne juge les événements que sur les apparences, on est disposé à croire que ce sont toujours les gouvernements ou les hommes investis de l’autorité publique, qui sont les auteurs des lois, ou qui produisent les révolutions diverses auxquelles les nations sont assujetties. La raison de cela est que ce sont toujours les gouvernements qui décrivent, de la manière la plus solennelle et la plus authentique, les phénomènes produits par la puissance des lois, et qui déclarent les résultats des changements qui se sont opérés soit en eux, soit dans quelques parties de la population. Mais, lorsqu’on examine attentivement comment les choses se passent, on est bientôt convaincu que les gouvernements eux-mêmes subissent presque toujours les lois qu’ils paraissent dicter, et que, dans les moments où ils semblent doués de la plus grande activité, ils ne sont que des instruments passifs obéissant à l’impulsion qui leur a été donnée. L’impulsion part quelquefois d’un individu qui n’est revêtu d’aucune autorité ; quelquefois elle part d’une petite fraction de la population, quelquefois de la masse entière du peuple, et quelquefois d’un peuple ou d’un gouvernement étranger.
Dans un moment où toutes les nations de l’Europe trafiquent sans scrupule des hommes de couleur, un individu, par exemple, s’avise de soutenir que les blancs qui réduisent les noirs en esclavage, violent les préceptes de leur religion, offensent la morale et l’humanité. Cette opinion répandue dans la société, y engendre des discussions ; les esprits s’échauffent et se partagent, les défenseurs de la liberté gagnent du terrain, et enfin une voix s’élève, dans une assemblée législative, pour demander que la traite des noirs soit abolie. Les hommes qui gouvernent, résistent ; ils sont soutenus, dans l’assemblée et hors de l’assemblée, par une majorité imposante ; la proposition est rejetée. Cette défaite ne décourage point les ennemis de la servitude ; ils continuent à soutenir leur opinion ; la vieillesse et la mort affaiblissent ou emportent les vieilles idées et les passions vicieuses avec les hommes qui en étaient infectés ; des générations nouvelles, plus éclairées, plus justes, plus impartiales, se montrent, et pénètrent dans les assemblées législatives, et jusqu’au sein du gouvernement ; le nombre des défenseurs de la liberté se multiplie ; ils sont soutenus par des intérêts nouvellement formés ou mieux sentis, et après une lutte de trente années, ils forment la majorité dans la nation, dans les assemblées législatives et dans le gouvernement ; la vieille puissance fléchit, une nouvelle puissance règne, et la traite est abolie. Voilà un nouveau mouvement imprimé à la population ; un changement opéré dans sa manière d’être et de procéder ; un nouvel ordre de choses, ou, si l’un veut, de nouvelles lois. Mais qui a produit ces lois ? Les hommes qui gouvernent les ont-ils créées, ou les ont-ils subies ? Ils peuvent en avoir décrit le résultat matériel ; mais, soit que la conviction ait été portée ou n’ait pas été portée dans leur esprit, ce ne sont pas eux qui les ont produites : ils ont été l’instrument de la révolution, ils n’en ont pas été la cause. Maintenant, si l’impulsion qui a été donnée, se continue sur d’autres peuples ou d’autres gouvernements, les lois qui en seront des conséquences, seront subies bien plus qu’elles ne seront faites par eux.
J’ai pris pour exemple l’établissement de lois salutaires au genre humain ; mais on peut prendre également l’exemple d’une loi funeste. Il sera aussi facile, dans ce dernier cas que dans le précédent, de prouver que celui qui décrit le résultat matériel d’une loi n’en est pas toujours l’auteur.
Supposons qu’un peuple soumis à un gouvernement absolu, quelles que soient les formes extérieures sous lesquelles ce gouvernement se manifeste, jouisse d’une entière liberté de conscience ; que chacun des individus dont il se compose, puisse librement se livrer à l’exercice de son culte, et manifester ses opinions telles qu’elles existent dans son esprit ; supposons enfin qu’il existe, dans l’État, des lois, c’est-à-dire des puissances qui garantissent un tel ordre de choses ; quelques hommes, qui aspirent à se rendre maîtres de la population et du gouvernement, veulent renverser ces lois et en établir de nouvelles ; ils veulent qu’il n’y ait plus dans l’État qu’une seule doctrine, et que cette doctrine soit la leur.
Comment s’y prendront-ils pour renverser les lois existantes, et pour en établir de nouvelles ? Se borneront-ils à effacer une simple description renfermée dans deux ou trois lignes, et dans laquelle il sera dit que chacun professe son culte avec la même liberté, et jouit de la même protection ? Ils sauront bien que cette description n’est pas la puissance qui constitue loi, et que, lorsque cette puissance aura disparu, peu importe que la description des résultats qu’elle produisait, reste ou soit effacée. S’ils entendent leurs intérêts, ils examineront attentivement quels sont les éléments dont cette puissance se compose ; si le mouvement principal part d’un prince ou de sa cour, ils s’introduiront, comme des reptiles, dans l’intérieur du palais. Là, ils travailleront dans l’ombre ; ils tâcheront de modifier, s’ils le peuvent, les idées et les passions des hommes faits ; ils s’empareront surtout des enfants, et formeront leur entendement de la manière la plus convenable à leurs vues. L’intelligence et les passions des personnages les plus influents ayant été modifiées, ils s’en serviront pour introduire dans les cours de justice, dans les administrations, dans les armées, et surtout dans les maisons d’éducation, des hommes dévoués à leurs intérêts ; lorsqu’ils seront ainsi devenus les maîtres de la force matérielle qui est à la disposition du gouvernement, en s’emparant du principe qui la fait mouvoir, les lois anciennes auront, par cela même, cessé d’exister, quoiqu’on n’ait pas effacé une ligne d’écriture.
Cette révolution, dans les éléments de force ou de puissance dont une loi se compose, se manifestera par des phénomènes qu’on décrira peut-être, mais qui pourraient aussi rester sans description. La loi se manifestera par des dispositions pénales contre ceux dont les opinions seront proscrites ; par leur exclusion des emplois publics ; par l’établissement de tribunaux chargés de les rechercher et de les poursuivre ; par les encouragements donnés aux délateurs ; enfin, par l’exil, l’emprisonnement ou le supplice des individus coupables de ne pas avoir la croyance légale. Si l’on demande alors quels sont les auteurs de cette législation nouvelle, ou, en d’autres termes, quels ont été les législateurs qui ont paru à telle époque, où faudra-t-il les chercher ? Faudra-t-il les voir dans les hommes qui auront décrit les peines nouvellement établies, les formes à observer dans les poursuites, les jugements et les exécutions ? Non certes ; ces hommes auront eux-mêmes subi le joug de la puissance nouvelle ; ils n’auront été que ses instruments. Les véritables législateurs seront ces hommes obscurs, qui, à force d’intrigues et de souplesse, seront parvenus à modifier dans l’ombre l’intelligence et les passions d’un petit nombre d’individus [72].
Le principe qui donne naissance à de mauvaises lois, peut donc se trouver placé hors du gouvernement, comme celui qui donne naissance à des lois salutaires ; l’une, comme l’autre, peut partir d’un pays étranger. Le nombre des lois dont les gouvernements ont été les auteurs, n’est presque rien en comparaison de celles qu’ils ont subies, et dont ils se sont bornés à décrire les résultats immédiats.
Depuis que l’art de l’écriture s’est répandu, que l’imprimerie a donné le moyen de multiplier les copies d’un même écrit, et que les gouvernements ont pris de la régularité dans leurs manières de procéder, les principaux changements matériels qui s’opèrent dans l’ordre social, et qui donnent à une nation une nouvelle manière d’être, sont décrits à mesure qu’ils arrivent, et la description qui les constate, est devenue même une partie de la loi. Mais il en est de cette description comme de celle de la plupart des actes de la vie civile : les naissances, les mariages, les décès, les échanges, les ventes, les donations, et toutes les transmissions de propriété, sont décrits d’une manière plus ou moins solennelle à mesure qu’ils arrivent ; ces descriptions servent à constater les événements qui sont arrivés, et à en conserver le souvenir ; mais, si l’on cessait de décrire ces événements, ou de les constater à mesure qu’ils se passent, en existeraient-ils moins ? Les hommes cesseraient-ils de naître, de se marier, de mourir, s’il n’existait plus d’officiers de l’état civil, ou des prêtres pour constater les naissances, les mariages et les décès ? Cesseraient-ils de faire des échanges, des ventes, des transmissions de propriété, s’ils ne savaient pas écrire, ou s’il n’existait pas de notaire pour décrire ou constater leurs conventions ou leurs volontés ? Le défaut de description des événements de la vie civile, entraînerait sans doute de graves inconvénients ; mais ces événements n’en arriveraient pas moins. Il en est de même des révolutions ou des changements qu’éprouve l’ordre social ; les lois n’en existeraient pas moins ; elles ne seraient pas moins exposées à des modifications, si les résultats immédiats qu’elles produisent, n’étaient pas décrites à mesure qu’ils se manifestent ; mais le défaut de description causerait plusieurs désordres surtout dans un état avancé dans la civilisation. C’est pour éviter ces désordres, que plusieurs gouvernements ont fait décrire les phénomènes matériels produits par les anciennes lois coutumières, et que tous décrivent les phénomènes que doivent produire les lois nouvelles qui s’établissent.
J’ai dit précédemment que la législation ne peut être qu’une science de faits ; cette proposition est évidente, lorsqu’on prend les codes, les livres, les écrits, pour ce qu’ils sont réellement : pour de simples descriptions. On voit alors comment un peuple peut se laisser tromper, s’il prend la description du phénomène que doit produire une loi, pour une loi ; comment une loi peut ne plus exister, quoique la description des faits matériels qui devaient en être la suite immédiate, n’ait pas été détruite ; comment les jurisconsultes ont eu raison de dire qu’une loi périt par le non usage, c’est-à-dire par l’extinction de sa puissance ; et comment on a tant de peine à faire passer une loi, d’un pays dans un autre. Mais, si, au lieu de voir la loi dans les faits, dans l’état réel de la société, on ne la voit que dans la description, la science de la législation n’est plus qu’une science de mots ; elle ne fournit plus de matière à l’observation ou au raisonnement. On pourra tout au plus former des recueils de dogmes ou de préceptes, mais on ne saurait rendre raison, ni pourquoi l’on croit aux uns, ni pourquoi l’on obéit aux autres [73].
[I-315]
Quoique la description d’une loi ne soit pas la même chose que la loi décrite, il faut bien se garder de croire qu’elle est sans importance. On verra au contraire, que les descriptions de ce genre exercent une influence très étendue sur les nations : c’est par elles que la législation devient une science, et qu’on arrive à perfectionner les lois et à en rendre l’action plus générale et plus régulière. Les livres qui décrivent les maladies et les remèdes qui peuvent les faire cesser, ne sont pas la même chose que ces maladies on ces remèdes ; faudrait-il en conclure que ceux de ces livres qui contiennent les descriptions les plus exactes ne sont bons à rien ?
[I-316]
CHAPITRE II.↩
De la description des lois ; des effets qu’elles produisent ; des vices qui s’y rencontrent, et des interprétations auxquelles elles donnent lieu. De la pensée du législateur. S’il est bon de consulter cette pensée.
Les lois générales suivant lesquelles les peuples vivent et se reproduisent, ont existé longtemps avant que personne ait songé à décrire les diverses manières dont elles agissent. Il est même encore aujourd’hui des populations nombreuses et civilisées, qui ne possèdent pas une description exacte et complète des dispositions de celles qui les régissent. Avant la Révolution française, on comptait, en France, environ cent quarante-quatre provinces, ayant chacune ses coutumes particulières ; ces coutumes n’avaient commencé à être décrites que du temps de Charles VII ; et à la fin du règne de Louis XII, on ne possédait la description que de seize. Ainsi, depuis l’instant où il exista des peuples sur notre territoire, jusqu’au commencement du seizième siècle, le plus grand nombre de ces peuples fut soumis à des lois dont la description ne se trouvait nulle part. La France était cependant un des pays les plus civilisés de l’Europe, ou, si l’on veut, un des moins barbares.
Il a fallu, pour que les différentes manières dont ces lois agissaient fussent décrites, non seulement qu’elles existassent, mais qu’il se trouvât des hommes doués d’une sagacité suffisante pour les observer. Il ne suffit pas, en effet, que des lois soient établies, pour qu’on sache en observer la nature et les résultats. Les peuples y obéissent par une sorte d’instinct, sans se donner la peine de réfléchir sur leur existence, et souvent sans les connaître. Cela est peu conforme aux systèmes qu’on a faits sur les lois ; mais cela n’en est pas moins exact ; et nous devrions même être surpris s’il en était autrement. Les hommes parlent correctement, sans avoir jamais lu de grammaire, et sans avoir étudié les règles du langage ; ils acquièrent des idées, pensent, raisonnent, sans avoir réfléchi sur les facultés de l’entendement humain, et sans connaître les écrits des métaphysiciens ; ils cultivent la terre et en recueillent les fruits, sans connaître aucun principe de physique ; ils font des instruments, sans avoir réfléchi sur les lois de la mécanique ; ils font du pain, du vin, préparent leurs aliments, sans connaître aucun principe de chimie ; enfin, ils sont malades, se guérissent ou meurent, sans avoir jamais observé les symptômes d’une maladie. Ils ne réfléchissent pas plus sur les lois qui régissent l’ordre social, que sur les principes des arts ou des sciences ; et cela ne les empêche pas de se conduire d’une manière plus ou moins régulière ; ils font et exécutent, à chaque moment de leur vie, des ventes, des échanges, des prêts, des donations, des dépôts, et une multitude d’autres contrats, ils se marient, ont soin de leurs enfants, recueillent et partagent des successions, respectent les propriétés de leurs voisins, sans avoir jamais songé aux lois, sans avoir lu un livre de jurisprudence, et même sans se mettre en peine s’il en existe.
Il s’élève souvent, entre les hommes, des discussions au sujet de leurs transactions, ou de leurs prétentions respectives, et alors ils sont forcés de réfléchir sur leurs actes et sur leurs procédés. En pareil cas, ils sentent la nécessité de recourir à des hommes qui ont étudié la manière dont les choses se passent dans la société. Mais, si l’on compare le nombre des affaires qui se traitent régulièrement et sans donner lieu à la plus légère discussion, chez une nation civilisée, au nombre de celles où les règles communes sont violées ou contestées, on trouvera que le nombre des dernières est excessivement petit. Si l’on compare également la masse de propriétés ou de richesses dont les propriétaires jouissent sans trouble et sans inquiétude, aux richesses qui sont ravies par la violence ou par la fraude, ou qui donnent lieu à des contestations, on trouvera que, comparativement aux premières, la quantité des dernières se réduit à presque rien. Enfin, l’on arrivera au même résultat, si l’on compare le nombre des personnes dont la conduite est à l’abri de toute poursuite légale, au nombre de celles dont les actions ont besoin d’être réprimées. On se laisse diriger par les lois sociales, comme par les principes de l’hygiène, sans les avoir étudiés et sans les consulter ; ce qui n’empêche pas une foule de gens de se bien porter.
Pour observer et pour décrire les lois suivant lesquelles les nations se régissent, il ne faut ni moins de pénétration, ni moins de patience, ni moins de justesse dans l’esprit, qu’il n’en faut pour décrire l’organisation des animaux ou des plantes. Aussi, n’est-ce que fort tard, et après que l’art de l’observation a été perfectionné et appliqué à toutes les autres sciences, qu’on a commencé à décrire les dispositions des lois avec quelque exactitude. Les jurisconsultes romains qui nous ont donné la description des divers contrats en usage parmi leurs concitoyens, ne sont venus que longtemps après que ces contrats ont été mis en pratique ; car on ne prétendra pas, sans doute, qu’avant eux, il ne se faisait à Rome ni ventes, ni échanges, ni aucun genre de transactions. Les descriptions modernes que nous possédons à cet égard, ne sont, pour la plupart, que la reproduction ou le développement de celles que les Romains nous ont transmises, et elles ne remontent pas à un temps fort reculé. Enfin, ces descriptions sont encore inconnues chez beaucoup de nations qui font les mêmes actes que nous, et qui suivent les mêmes règles.
Une loi, ainsi que nous l’avons vu dans le chapitre précédent, n’est pas un fait simple et unique ; c’est une puissance qui, dans un cas donné, produit toujours un résultat semblable ; mais cette puissance se compose d’une multitude de forces qui concourent à produire la même action. Il faudrait donc, pour donner la description complète d’une loi, décrire d’abord chacune des forces qui est un des éléments dont elle est formée ; il faudrait décrire ensuite l’action que ces forces produisent, et enfin les conséquences qui résultent de cette action ou de ce fait. Lorsqu’on étudie la législation comme science, ce n’est qu’en décomposant ainsi une loi, qu’on peut parvenir à la connaître ; mais les gouvernements ne donnent pas et n’ont pas besoin de donner des analyses si complètes : ils se bornent à décrire l’action matérielle qui doit être exécutée ; c’est ce qu’on nomme la disposition de la loi, ou la manière dont la loi dispose. Ils ne s’occupent jamais de toutes les forces qui doivent concourir à la produire, et rarement ils exposent tous les effets qui doivent en résulter ; et cela n’est pas nécessaire pour le but qu’ils se proposent.
Mais il n’en est pas ainsi lorsqu’on s’occupe de la législation comme science : il faut décrire alors les éléments de force dont la loi se compose, le fait matériel qui en est le résultat immédiat, et qu’on nomme la disposition de la loi, et les conséquences qui résultent de ce fait, soit pour les hommes, soit pour les choses qui sont à leur usage. Si l’on néglige de s’occuper des forces diverses destinées à produire l’action ou la disposition de la loi, on s’expose souvent à prendre pour une loi une vaine déclaration. Si l’on ne décrit pas ou si l’on décrit mal la manière dont la loi dispose ou agit, il est fort difficile de se faire des idées exactes des effets que son action produit. Enfin, si l’on ne décrit pas chacun de ces effets, il arrive souvent qu’on établit de mauvaises lois, en croyant en établir de bonnes.
Je me suis occupé des effets produits par les descriptions complètes, qui sont propres à la science : il ne s’agit ici que des descriptions que donnent les gouvernements, soit lorsqu’ils veulent faire connaître des lois déjà établies, soit lorsqu’ils veulent établir eux-mêmes de nouvelles lois.
Les jurisconsultes décrivent quelquefois les dispositions des lois qui existent déjà dans un pays, dans la vue d’en faciliter l’étude à ceux qui se destinent à la pratique de la jurisprudence. Ils se bornent alors, comme les gouvernements, à exposer les faits matériels qui se passent, sans s’occuper ni des forces qui les produisent, ni des effets qui en résultent. On peut appliquer à ceux-ci une grande partie des observations qui se rapportent à ceux-là.
J’ai précédemment fait remarquer que les lois qui régissent un peuple, résultent des besoins, des facultés, des lumières et de la position des individus dont ce peuple se compose, et de beaucoup d’autres circonstances. J’ai fait remarquer, en même temps, qu’il existe dans l’homme deux tendances : l’une qui le porte à contraindre ses semblables à régler leur conduite d’après la sienne, s’il les croit inférieurs à lui ; l’autre qui le porte à imiter ceux qui lui semblent se conduire mieux que lui. C’est cette double tendance de la population, qui établit l’uniformité dans les diverses manières de procéder, même chez les peuples dont toutes les parties n’ont pas acquis la même civilisation ou le même développement. Mais, aussi longtemps qu’il n’existe point de communications par écrit, cette action d’une partie de la population sur l’autre, ne peut s’exercer qu’autant que les hommes se trouvent immédiatement en contact les uns avec les autres. Aussi, voyons-nous que, dans toute l’Europe, les peuples ont été divisés en une multitude de fractions infiniment petites, chacune desquelles avait des lois qui lui étaient propres. Chaque ville, dont la position était déterminée par la configuration du sol, par le cours des eaux, par la nature du terrain, formait une république particulière. Si l’on comptait en France, avant la Révolution, cent quarante-quatre coutumes, cela prouverait l’existence de cent quarante-quatre états indépendants ; mais je suis très disposé à croire que le nombre en avait déjà été réduit par les conquêtes. En Suisse, non seulement chaque canton a ses lois, mais, dans quelques cantons, chaque petite ville avait les siennes. Ni les conquêtes des Romains, ni le despotisme de leurs empereurs, ni les conquêtes et les ravages des barbares, ni la puissance des rois, ne purent effacer en France les lois qui appartenaient à chaque peuple. Il a fallu que l’imprimerie portât dans tous les esprits les mêmes idées, et qu’une révolution terrible promenât en quelque sorte son niveau sur le sol, pour réduire cette multitude de peuples divers à une législation uniforme.
Il ne faut pas croire, cependant, que cette multitude de peuples, dont chacun avait ses lois particulières, eussent en tout point des lois différentes. Les nations sont susceptibles de perfectionnement et de dégradation, et par conséquent, elles doivent souvent différer les unes des autres ; mais, d’un autre côté, tous les hommes étant organisés de la même manière, sont soumis, pour leur existence, à des conditions auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire, sous peine de périr. Dans tous les pays, il faut que les parents prennent soin des enfants, si l’on veut qu’ils se conservent ; que le mari joigne ses efforts à ceux de la femme, si l’on ne veut pas que la famille tombe en décadence ; que les propriétés soient respectées, si l’on ne veut pas qu’elles se dissipent ; que les contrats soient exécutés, si l’on ne veut pas manquer de tout ; enfin, que les enfants succèdent aux pères, si l’on ne veut pas qu’ils périssent de misère, et que les pères consomment ou détruisent leurs richesses avant que de mourir. Les lois ne peuvent donc différer d’un pays à l’autre, que par des nuances plus ou moins prononcées, ou par les manières à l’aide desquelles on tend à obtenir un résultat semblable.
Un peuple peu nombreux, resserré dans l’enceinte d’une ville, ou dans les limites d’un territoire peu étendu, ayant fait peu de progrès dans la civilisation, et ayant peu de rapports avec ses voisins, a peu besoin que les diverses manières dont ses lois disposent soient décrites. Tout marche d’un pas à peu près égal, et les rapports qui existent entre les personnes sont si peu compliqués, que, pour les connaître, la plus légère attention suffit. Si une partie de la population tente de changer sa manière d’être, ou elle entraîne les autres parties, ou elle est arrêtée par elles. Chaque changement est un fait simple qui peut être aperçu et apprécié par tous les esprits, et qui est imité ou réprimé, selon qu’il semble favorable ou funeste à la partie la plus influente de la population. La république de Sparte n’avait pas la dixième partie des lois qui existent dans la république de Genève, et une tribu d’Arabes, vivant de pillage ou du produit de ses troupeaux, en a moins que n’en avait Sparte. Il ne faut à un tel peuple ni registres publics, ni bibliothèques, pour lui apprendre comment les choses se passent chez lui, pour connaître ses usages ou les dispositions de ses lois.
Mais, lorsque les progrès des sciences, des arts et du commerce ont multiplié les rapports entre les individus et les nations ; lorsqu’il existe dans la société une multitude de professions différentes, chacune desquelles absorbe tout le temps des personnes qui s’y livrent ; lorsqu’une suite de guerres et de conquêtes ont placé sous un seul gouvernement une multitude de peuples ayant chacun ses usages particuliers ; enfin, lorsque les discussions deviennent tellement multipliées entre les hommes, qu’il est nécessaire, pour les décider, que des personnes y consacrent leur vie, les diverses manières dont les lois agissent ont besoin d’être décrites, pour être connues ; il devient nécessaire de décrire non seulement les dispositions de celles qui existent depuis longtemps, mais aussi les dispositions de toutes les lois qui s’établissent. Le défaut de description suffirait pour mettre le désordre dans leur action, ou pour en rendre l’établissement impossible, ou du moins très difficile.
Que dans un État qui n’a que quelques milliers de citoyens exerçant, d’une manière grossière, les arts les plus indispensables à la vie, il s’élève une discussion d’intérêt entre deux individus, il suffit de consulter quelques vieillards, pour savoir quel est celui des deux qui soutient une prétention injuste. Mais s’il existe dans l’État où la discussion s’élève, une multitude de professions différentes et étrangères les unes aux autres, si les transactions sociales s’y multiplient à l’infini, par la variété autant que par le nombre, il ne sera plus si facile de trouver des personnes qui aient observé comment les choses se passent dans toutes les circonstances, et qui soient capables de rendre une décision juste. Cela deviendra absolument impossible, si une multitude de peuples ayant des lois différentes, sont réunis sous un seul gouvernement, et si les juges qui doivent terminer les discussions qui s’élèvent entre les particuliers, sont étrangers au pays dans lequel ces discussions ont pris naissance. Comment, par exemple, un parlement, ou un tribunal tel qu’est aujourd’hui la Cour de cassation, aurait-il pu juger, dans tous les cas, d’une manière conforme aux nombreuses lois coutumières qui régissaient la France, avant que les dispositions de ces lois eussent été décrites ? On aurait pu composer ce tribunal d’autant de juges qu’il y avait de coutumes, et en prendre un dans chaque pays ; mais le seul avantage qu’on eût obtenu par là, aurait été de posséder une cour qui, sur cent quarante-quatre magistrats, en aurait compté, dans chaque cause, cent quarante-trois complètement ignorants [74].
Si les progrès de la civilisation, et surtout la réunion de plusieurs peuples sous un seul gouvernement, ont rendu nécessaire la description des dispositions des lois anciennes ; si, dans un grand nombre de cas, cette description est devenue le seul moyen de connaître les lois d’un pays, les mêmes causes ont rendu non moins nécessaire la description des dispositions des lois nouvelles. L’influence des faits ou de l’exemple ne saurait jamais s’étendre bien loin, si la connaissance n’en était pas répandue au moyen de l’écriture, et si l’action de l’autorité ne secondait pas la puissance de la raison. Supposons que la coutume ait établi que, dans une famille, le premier né des enfants mâles succède, à l’exclusion de ses frères et sœurs, à tous les immeubles de son père ; supposons, de plus, qu’une partie de la population ait cru s’apercevoir que l’exclusion des autres enfants était funeste non seulement à la famille, mais à la société tout entière ; cette loi pourra être détruite, et remplacée par une autre, de deux manières : par le non usage, c’est-à-dire par une pratique contraire, ou par une destruction formelle et subite. Elle sera détruite par le non usage, si celui des enfants à qui la coutume a tout accordé, partage volontairement avec ses frères ; si les parents éludent la loi par des ruses, par des actes secrets ou feints ; si les classes les plus influentes de la société, si les magistrats eux-mêmes ne se conforment point à la coutume, ou en favorisent l’abolition. La destruction de l’ancienne loi, et la formation de celle qui la remplacera, s’opéreront, dans ce cas, d’une manière lente, irrégulière, et presque imperceptible. Ces faits pourront n’avoir lieu que dans un territoire très borné, dans l’intérieur d’une ville, ou dans le ressort d’une cour. En pareil cas, la loi nouvelle ne sera décrite que lorsqu’elle sera parfaitement établie. Mais si la partie la plus influente de la société, celle qui exerce l’action la plus directe et la plus immédiate, trouve l’ancienne loi mauvaise, elle commencera par décrire les dispositions de la loi par laquelle elle prétend la remplacer ; elle portera cette description à la connaissance de toutes les personnes par qui la loi doit être exécutée, et particulièrement des magistrats, et la société éprouvera ainsi une révolution immédiate et subite.
En décrivant le nouvel ordre de choses qu’on veut établir, et en contraignant, par la force publique, tous les individus à conformer leurs actions à la description qu’on leur en a donnée, on détruit donc l’ordre de choses qu’on juge mauvais, d’une manière plus prompte, plus régulière, plus générale ; on ne laisse aucune incertitude dans les esprits ; chacun sait sur-le-champ ce qu’il a à faire. On opère, de plus, des révolutions bien plus étendues : quand des lois anciennes ne périssent que par le non usage, et que des lois nouvelles ne s’établissent que par la violation d’un ordre ancien, un système de législation se détruit de la même manière qu’une forêt qui succombe sous la faux du temps ; les branches se dessèchent et tombent les unes après les autres, et il s’écoule des siècles avant que les troncs aient complètement péri, et qu’ils aient été remplacés. Mais, quand les dispositions des lois sont décrites à l’instant même où les lois se forment, et où une partie de la population imprime à l’autre un nouveau mouvement, les anciennes lois périssent, et les nouvelles s’établissent dans tout leur ensemble. Ceux qui en sont les auteurs, procèdent comme des architectes qui renversent d’anciens monuments, qui déblaient le sol, et en construisent d’autres sur de nouveaux plans.
La description des dispositions des lois déjà existantes, et celle des dispositions des lois qu’on établit, ont de grands avantages ; elles servent de règle à ceux qui ne savent pas observer les choses par eux-mêmes, ou qui n’ont pas d’autres moyens de les connaître ; elles donnent aux éléments de force dont la loi se compose, une action plus régulière et plus uniforme ; elles opèrent tout d’un coup et rendent généraux des changements qui sont souvent utiles. Mais elles ne sont pas sans inconvénients ; elles en ont même quelquefois de très graves qu’il importe d’observer.
Il est plus facile d’étudier les choses en lisant les descriptions qu’on en a données, qu’en soumettant les choses elles-mêmes à l’observation ; si donc il arrive qu’un observateur décrive les dispositions des lois qui sont depuis longtemps établies, chacun se sent disposé à considérer la description comme l’expression exacte de la vérité. L’obscurité que le savant a mise dans ses expressions, les contradictions dans lesquelles il est tombé, l’ambiguïté de son langage, les faits qu’il a affirmés sans les avoir bien constatés, ceux qui existaient et qu’il a mal observés, ou auxquels il n’a pas fait attention, donnent naissance à une multitude de disputes et de commentaires. On ne cherche pas alors à s’éclairer, en soumettant les faits à des observations nouvelles, comme cela se pratique dans d’autres sciences ; on commente des phrases par d’autres phrases, des mots par d’autres mots. On a remarqué que la description des dispositions de la coutume de Paris avait donné naissance à une vingtaine de commentaires : ce qui prouve ou que les auteurs ne s’étaient pas clairement exprimés, ou qu’ils avaient laissé leur description bien incomplète, ou qu’ils avaient décrit les choses autrement qu’elles étaient. En législation, une fausse description a des effets bien plus étendus que ceux qu’elle peut avoir dans d’autres sciences. La fausse description d’une plante peut tromper ceux qui l’étudient ; mais elle ne change pas la nature de la chose décrite ; une observation mieux faite suffit pour détruire l’erreur. Il en est autrement de la fausse description des dispositions d’une coutume ou d’une loi : elle égare ceux qui la consultent, et détermine leur conduite ou leur jugement ; elle fait arriver les choses, non pas d’une manière conforme à ce qui se passe habituellement, mais d’une manière conforme à la description. Cela est quelquefois un bien ; mais ce peut être aussi un mal.
La description des lois anciennes a deux conséquences remarquables : elle donne aux peuples dont les lois sont défectueuses, la connaissance d’autres lois qui valent mieux, et les met par conséquent à même de corriger celles auxquelles ils sont soumis ; mais elle donne en même temps à la partie de la population qui est la plus influente, le moyen de porter atteinte aux lois des autres peuples, pour leur faire adopter les siennes. Si, par exemple, les lois coutumières de Paris n’eussent pas été décrites, la population à laquelle ces lois étaient particulières, n’eût jamais eu le moyen de les porter dans toutes les provinces de France. Elle n’eût pu exercer d’autre influence que celle qui résulte de l’exemple et de la force de la raison, Mais ces lois ayant été décrites, et ceux qui les trouvaient conformes à leurs habitudes, ayant été en majorité dans les conseils, rien ne leur fut plus facile que de les présenter aux provinces qui avaient des lois ou des habitudes différentes, et de les considérer comme le droit commun de la nation. Nous pouvons appliquer à toutes les lois françaises, en général, l’observation que je viens de faire à l’égard des lois coutumières de Paris. En supposant les dispositions des premières de ces lois suivies, exécutées, confondues avec les mœurs nationales, mais n’étant pas plus décrites que ne l’étaient, au quinzième siècle, les diverses coutumes qui régissaient la France, jamais le gouvernement impérial, avec toute sa puissance, n’eût osé tenter de les porter au-delà du territoire dans lequel elles auraient été renfermées ; il eût été obligé de respecter les lois des peuples que ses armées lui avaient soumis, comme les Romains, et les barbares qui leur succédèrent, furent obligés de respecter les coutumes des nations qu’ils voulurent ne pas exterminer. Je n’ai pas à examiner, dans ce moment, si cette transplantation, plus apparente que réelle, fut utile ou funeste aux nations qui l’éprouvèrent ; je ne me propose que de faire observer la puissance que trouve un gouvernement dans la simple description des dispositions des lois d’un peuple, et le penchant que cette description lui donne d’user de violence pour établir les lois décrites.
Lorsque deux peuples contemporains se trouvent placés à côté l’un de l’autre, qu’ils ont fait, dans les arts et les sciences les mêmes progrès, qu’ils parlent la même langue et ont la même religion, il ne peut exister dans leurs mœurs et dans leurs lois, que des nuances fort légères. Tenter alors de transporter chez l’un les lois qui existent chez l’autre, ce n’est guère que substituer des descriptions, des classifications, des dénominations nouvelles à des descriptions, des classifications, des dénominations anciennes ; c’est réformer le langage bien plus que les idées. S’il existe quelques différences réelles dans les dispositions, ces différences portent, en général, sur des manières de procéder, et le fond reste le même ; on arrive au même résultat par des moyens divers. Mais ce n’est pas toujours à rendre communes à une nation tout entière, les lois qui en régissent une partie, que se bornent les gouvernements ; possédant des descriptions de lois particulières à des peuples qui ont disparu de la terre, ils s’imaginent quelquefois qu’il est en leur puissance de rétablir ces lois, par la raison qu’ils ont le pouvoir d’en refaire la description ; ils emploient alors toute la force dont ils disposent, à donner aux générations existantes les idées, les passions, les préjugés des générations qui ne sont plus. Quelquefois aussi, au lieu de prendre pour modèle les lois d’un peuple contemporain, ou les lois d’un peuple d’un autre âge, ils forment un monde idéal, tracent les règles suivant lesquelles ce monde doit vivre ; et, donnant à ces règles le nom de lois, ils ordonnent aux peuples de modifier leurs idées, leurs passions, leur existence, de telle sorte qu’ils ressemblent en tout au monde imaginaire qu’ils ont conçu [75].
Possédant la description d’une multitude de dispositions de lois, pouvant en décrire un nombre encore plus grand d’imaginaires, et prenant pour des lois ce qui n’en est que la description, les gouvernements finissent par se persuader qu’il n’est rien de plus facile que de modifier les nations qui leur sont soumises, et qu’ils n’ont qu’à parler pour qu’elles pensent, agissent et sentent selon qu’il convient à leurs intérêts ou à leurs désirs. Ce ne sont plus alors les livres qui doivent représenter le tableau de l’ordre social, ou renfermer la description méthodique des lois suivant lesquelles les peuples procèdent lorsqu’ils tendent vers leur prospérité : ce sont, au contraire, les peuples qui doivent représenter ce qui se trouve dans les livres, et les livres doivent représenter ce qui s’est passé dans l’esprit de ceux qui les ont fait écrire ; rien de si commun que de voir des ministres, des princes, et même des philosophes, qui croient que le genre humain doit être la représentation exacte de ce qui se passe dans leur cerveau. Montesquieu, en exposant quel a été de tout temps, et dans tous les pays, l’esprit des lois, a prouvé que telle a toujours été la pensée des gouvernements. Rousseau avait la même idée que Montesquieu attribue aux gouvernements, lorsqu’il a écrit que celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple, doit se sentir en état de changer la nature humaine, c’est-à-dire de la façonner de telle manière, qu’elle ne soit plus que l’expression de sa pensée. Enfin, les jurisconsultes, presque sans exception, sont dans la même croyance ; il n’en est presque aucun qui ne s’imagine que, pour déterminer comment on doit agir dans un cas douteux, on doit consulter, non la nature de l’homme, mais la pensée du législateur ; il faut que la conduite et les mœurs des nations soient l’expression de cette pensée, eût-elle été conçue par un imbécile comme Claude, ou par une bête féroce comme Néron. C’est là, dit-on, ce qui fait le bonheur des États, la grandeur et la dignité des peuples [76].
Ce système n’est que celui de l’esclavage réduit à l’expression la plus simple, et porté aussi loin qu’il peut s’étendre : l’esclave le plus docile, celui qui est doué de l’organisation la plus flexible, ne peut s’annuler d’une manière plus complète qu’en devenant l’expression de la pensée de son maître ; et le maître le plus despotique ne saurait exiger rien de plus de l’esclave le plus soumis. Il est si vrai que ce système n’est que celui d’un esclavage sans limites, qu’il suffit de substituer le mot de maître à celui de législateur, pour ne plus apercevoir de différence : cette substitution ne change rien au fond des choses, puisque les deux mots désignent également un homme. Ce système n’a pu naître et se propager que chez des nations formées dès longtemps à l’esclavage, chez des nations qui ont rejeté les mots propres à la servitude, et qui en ont conservé les mœurs. Il est naturel que, chez de tels peuples, les uns aspirent à être maîtres, et proclament les maximes du despotisme, sous le nom de législateurs, et que les autres ne voient, dans leurs propres personnes, que des esclaves sous le nom de sujets ou de citoyens ; que les premiers prétendent que leurs pensées sont le modèle suivant lequel les nations doivent se former, et que les seconds admettent une telle prétention comme une règle de conduite.
Il est sans doute indispensable que les citoyens se conforment aux dispositions des lois ; pour s’y conformer, ils ont besoin de les connaître ; ils ne peuvent souvent les connaître que par la description qui leur en est donnée ; et cette description ne peut être que l’expression de la pensée de celui qui en est l’auteur. Mais, si la description n’est qu’un intermédiaire entre l’individu qui la consulte et la pensée du législateur, la pensée du législateur elle-même ne peut être qu’un intermédiaire passager entre la nature des choses et la description. Un peintre fixe ses regards sur un paysage ; l’idée s’en trace aussitôt dans son esprit : il prend ses pinceaux, et rend sur la toile l’impression qu’il a reçue ; en d’autres termes, il exprime sa pensée. Que feront maintenant les personnes qui voudront connaître le même paysage ? Elles étudieront le tableau qui en aura été fait ; et si cela ne leur suffit pas, si elles trouvent la représentation incomplète ou inexacte, elles étudieront l’objet même que le peintre a prétendu représenter. Chercheront-elles à connaître quelle est la pensée du peintre ? Ce serait une folie ; cette pensée n’a été qu’une modification de l’individu ; cette modification peut être effacée par l’oubli, même par la mort de celui qui l’avait éprouvée. Il ne reste donc, entre la chose décrite, et l’individu qui veut la connaître ; que le tableau, ou la description qui la représente ; il n’y a plus rien au monde qui soit la pensée du peintre. Mais les pensées d’un homme qui décrit des faits ou des actions, ont-elles plus de durée que les pensées d’un homme qui décrit des paysages ? Les pensées de l’un sont-elles moins susceptibles que les pensées de l’autre, d’être modifiées, effacées, détruites ? Nous reste-t-il autre chose des jurisconsultes romains, par exemple, que les descriptions qu’ils nous ont laissées ? Si nous trouvons ces descriptions obscures, fausses ou incomplètes, avons-nous d’autres moyens de nous éclairer que de procéder comme ils procédaient eux-mêmes, c’est-à-dire d’étudier la nature des choses ? Resterait-il, sur la terre, un être qui soit leur esprit, leur pensée, et que nous puissions interroger comme les Grecs interrogeaient leurs oracles ? Si cet être mystérieux qu’on appelle leur pensée, existe quelque part ; s’il s’est conservé entier et invariable depuis deux mille ans, qui nous a fait un devoir de le consulter et de nous modeler sur lui ?
Mais, quelles que soient les opinions des gouvernements, des législateurs, des philosophes et des nations elles-mêmes, sur la flexibilité, ou, si je puis m’exprimer ainsi, sur la ductibilité du genre humain, il ne faut pas croire qu’on transporte les lois d’un peuple chez un autre, ou qu’on ressuscite des lois qui ont péri avec les peuples auxquels elles appartenaient, aussi facilement qu’on peut en transporter ou en refaire la description. Un gouvernement, persuadé qu’il est en sa puissance de changer la nature, peut tenter, soit de faire revivre des lois éteintes, soit de transplanter la législation d’un peuple chez un autre, comme on transplante des arbres, soit de créer des lois, pour réaliser un peuple imaginaire qui s’est formé dans son esprit ; il peut décrire, avec exactitude, les dispositions des lois qu’il se propose de transplanter, de ressusciter ou de créer ; il peut ensuite appliquer la puissance qu’il a dans les mains, à donner de la réalité à ses descriptions, et à modifier, par la violence, la population qui lui est soumise ; ses efforts ne servent guère qu’à produire quelques mots nouveaux, des actes de violence plus ou moins multipliés, de la fausseté ou de l’hypocrisie avec le jargon qui en est inséparable ; mais le fond des choses reste le même, ou ne tarde pas à se rétablir, si, en effet, il a été altéré. Pour donner à un peuple des lois qui ne conviennent ni à ses mœurs, ni à ses idées, ni à l’état de civilisation auquel il est parvenu, il faut détruire ses mœurs, ses idées, sa civilisation, et même les ouvrages qui en sont ou l’expression ou la cause. Il faut se rendre maître de lui par la conquête, asservir les générations déjà formées, et s’emparer des générations naissantes, pour les façonner à son gré. Mais, si on laisse exister entre elles quelque communication, les idées et les mœurs passeront d’une génération à l’autre par tradition ; les actions resteront les mêmes, et le gouvernement qui aura cru changer une partie du genre humain, finira par être renversé, s’il ne renonce à ses violences.
Il existe, ainsi qu’on l’a vu précédemment, trois genres de descriptions. Les premières ont pour objet de faire connaître les dispositions des lois depuis longtemps établies, et d’en faciliter ainsi l’exécution ; telles sont celles qui renferment l’exposé des lois coutumières. Les secondes ont pour objet de faire connaître les dispositions des lois qui s’établissent actuellement ; ce sont celles dont se chargent ordinairement les gouvernements. Les troisièmes ont pour objet le perfectionnement des lois existantes ; ce sont celles dont s’occupent les savants. Toutes ces descriptions sont susceptibles des mêmes vices ; toutes peuvent être obscures, incomplètes, fausses. J’ai fait voir, dans le livre précédent, quelles sont les conséquences des descriptions faites par les savants, et des vices qui s’y rencontrent. On a vu, dans ce chapitre, quelles sont les conséquences générales des autres genres de descriptions. Il ne me reste que deux réflexions à faire sur les descriptions que donnent les gouvernements lorsqu’ils établissent ou prétendent établir de nouvelles lois.
Il n’est pas rare que l’autorité publique s’imagine faire des lois nouvelles, lorsqu’elle ne fait que décrire les dispositions des lois déjà existantes, ou reproduire d’anciennes descriptions. Le code auquel Napoléon avait imposé son nom, et auquel on a rendu le nom primitif de Code civil, ne renferme la description de presque aucune disposition de loi nouvelle. Non seulement la plupart des dispositions dont il renferme la description existaient, mais presque toutes avaient été décrites. Ce qui a fait la popularité de ce code, c’est, en premier lieu, parce qu’il n’a presque rien établi de nouveau, et qu’il a respecté les mœurs ou les habitudes nationales ; c’est, en second lieu, parce que les descriptions qu’il a données, ont été conçues dans un langage plus simple, plus concis, plus intelligible que le langage de celles qui existaient déjà ; c’est, enfin, parce qu’il a présenté, dans un espace peu étendu et avec méthode, des descriptions éparses dans une multitude de volumes. Mais, si l’on excepte un très petit nombre de descriptions de lois nouvelles et quelques formes qui n’existaient pas auparavant, il n’y a rien dans ce code qui ne pût être accompli par des personnes privées tout aussi bien que par des conseillers en habit de cour. Il suffisait de connaître les lois existantes, de savoir classer ses idées, et s’exprimer avec précision.
Les descriptions des dispositions des lois existantes, données par un savant, n’ont pas tous les avantages de celles données par un gouvernement ; mais aussi elles n’en ont pas les dangers. Un savant est obligé de décrire les choses telles qu’elles existent réellement ; s’il se trompe, ses erreurs peuvent être réparées ; s’il est volontairement infidèle, il tombe dans le mépris, et il est bientôt oublié. Mais un gouvernement qui se charge de faire la description générale des dispositions des lois qui régissent un pays, profite souvent de cette occasion, soit pour détruire des lois utiles, soit pour en établir de funestes. En décrivant la disposition d’une loi utile qui est depuis longtemps établie, et dont ils s’attribuent la gloire, ils placent à côté la description d’une loi qu’ils établissent dans la vue d’accroître leur pouvoir, et la première description fait passer la seconde. Cette pratique est souvent mise en usage dans les temps de trouble ; Napoléon Bonaparte l’a employée non seulement pour anéantir tout ce que pouvait renfermer d’utile la constitution qu’il trouva établie lorsqu’il usurpa l’autorité publique, mais pour détruire presque toutes les garanties qui étaient nées de la Révolution.
[I-342]
Il semble qu’un gouvernement ne peut jamais donner une description complètement fausse, puisque, si la chose décrite n’existe pas encore, la description en produit l’établissement. Rien n’est cependant plus commun ; et ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que ceux qui font de fausses descriptions sont quelquefois de la meilleure foi du monde. Si ce que j’ai dit précédemment ne suffisait pas pour démontrer cette vérité, j’engagerais les incrédules à lire toutes les constitutions que la France a eues depuis le commencement de la Révolution jusqu’à ce jour, et à comparer les belles descriptions qu’elles renferment, avec l’état réel dans lequel la société s’est trouvée à toutes les époques ; s’ils ne trouvent aucune ressemblance entre ces deux choses, il faudra bien qu’ils avouent que les descriptions ont été purement imaginaires. La manière dont on procédait rendait cela presque inévitable : on commençait par décrire l’état de choses dont on désirait l’établissement, et lorsqu’on en possédait la description, on croyait n’avoir presque plus rien à désirer. On disait : la liberté individuelle est inviolable, la liberté de la presse est garantie, les ministres sont responsables ; et on croyait que cela était ainsi. Les législateurs procédaient comme la divinité : Fiut lux, et lux facta fuit. Ces déclarations produisaient sur l’état de la société un effet à peu près semblable à celui que produirait sur le bien-être des citoyens la déclaration que tous les hommes sont bien portants, qu’ils vivent dans l’abondance, et sont exempts de soucis. Ce sont là de fort bonnes choses, sans doute ; mais il ne suffit pas de dire qu’elles sont ou qu’elles seront, pour qu’elles se réalisent.
[I-344]
CHAPITRE III.↩
Distinction entre un régime arbitraire et un régime légal. De ce qui constitue la différence.
En considérant, dans leur propre nature, les lois qui régissent les peuples, on ne peut y voir que des forces composées d’une multitude d’éléments divers. Le siège de ces forces ne peut se trouver que dans les hommes ou dans les choses ; et il est impossible de bien les connaître autrement que par l’observation. Il faut, pour en avoir connaissance, étudier les diverses manières dont les hommes agissent les uns à l’égard des autres ; les causes qui sont les principes de leurs actions, et les conséquences que ces actions produisent. Il faut étudier, de plus, l’action générale que les choses exercent sur les hommes, celles que les hommes exercent à leur tour sur les choses, et les divers effets qui résultent de ces actions.
Lorsqu’on procède ainsi, on est nécessairement conduit à distinguer dans une loi quatre choses : les divers éléments de puissance dont elle se compose ; le résultat immédiat de cette puissance, ou ce qu’on nomme vulgairement la disposition de la loi ; les diverses manières dont les hommes et les choses sont affectés par ce résultat ou par cette disposition ; et enfin la description des éléments de la loi, de l’action qu’elle exerce, ou des autres effets qu’elle produit. Les trois premières parties sont essentielles à l’existence de toute loi ; la dernière ne l’est point, puisque ce n’est que fort tard, ainsi que nous l’avons vu, que les dispositions des lois ont commencé à être décrites.
Dans tous les pays et dans toutes les positions, les individus dont le genre humain se compose, sont soumis les uns à l’action des autres : ils у sont soumis dans leurs relations de mari ou de femme, d’enfant ou de père, de maître ou d’esclave, de gouvernant ou de gouverné ; dans tous les pays et dans toutes les positions, ils sont également soumis à l’action des choses, et à leur tour ils agissent continuellement sur elles, soit pour les rendre propres à satisfaire immédiatement leurs besoins, soit pour s’en faire des instruments. Il nous est donc impossible de nous soustraire aux forces qui agissent continuellement sur nous, et qui ont leur principe ou dans nos semblables, ou dans les choses au milieu desquelles nous sommes placés, ou dans notre propre nature. Ces forces sont des lois auxquelles nous ne saurions échapper : nous les jugeons bonnes ou mauvaises, non par le degré d’intensité ou de puissance qui est en elles, mais par la nature des effets qui en résultent.
On a distingué les peuples soumis à des pouvoirs arbitraires, de ceux soumis à des pouvoirs légaux ; et les gouvernements despotiques, des gouvernements qui agissent conformément aux lois. Il y a souvent entre les uns et les autres moins de différences qu’on n’est généralement porté à le croire : une nation peut passer d’un régime arbitraire, à un régime qu’on nomme légal, sans être pour cela beaucoup mieux. Voici en quoi consiste la différence ; il est essentiel de l’observer, parce qu’elle nous servira à nous faire de justes idées de la nature des lois, et de l’influence qu’exerce la description de leurs dispositions.
Les lois, avons-nous dit, sont des puissances qui se composent d’éléments divers, et qui agissent de telle ou telle manière sur les hommes. Au nombre des éléments dont se composent ces puissances, nous avons compris les idées, les préjugés, les besoins, les passions des classes les plus influentes de la population, et particulièrement des hommes qu’on désigne sous les noms de princes, de ministres, de soldats, de magistrats, et de beaucoup d’autres. Ces éléments de puissance ne sont pas également nombreux chez tous les peuples : mais, à la différence près du plus et du moins, on les trouve partout, et partout ils agissent plus ou moins sur les nations. Si ces éléments de force sortent du sein du peuple, et sont le produit des idées, des besoins ou des passions du plus grand nombre, on peut dire que c’est la population qui agit sur elle-même, au moyen d’instruments qu’elle a choisis. Mais il ne faut pas conclure de là que l’action qu’elle exerce, lui est nécessairement salutaire : une population ignorante et passionnée peut se nuire comme se nuit un individu. Si les mêmes éléments de force sont formés par un prince et par sa cour, ou par les individus qui les dirigent, cela ne suffit pas non plus pour établir que le résultat en est malfaisant : ce résultat est salutaire ou funeste, selon les lumières et les intentions de ceux par qui ces forces sont mises en mouvement.
Puisque c’est la force ou la puissance qui forme la loi, il s’ensuit que partout où nous trouvons une partie de la population agissant constamment sur une autre, nous trouvons également des lois. Les Russes, les Turcs, les Égyptiens, les Persans, sont donc soumis à des lois, aussi bien que les Français et les Anglais ; car, chez les uns comme chez les autres, on rencontre la plus grande partie des éléments de force dont les lois se composent. Mais il existe entre les uns et les autres une différence remarquable : l’action qui résulte, chez les premiers, de l’exercice de la puissance, n’est presque jamais décrite : chez les seconds, au contraire, elle est décrite dans la plupart des cas où elle doit s’exercer. Il résulte de cette différence que, chez les uns, cette action est sujette à toutes les variations instantanées qu’éprouve la puissance qui la produit, et que, par conséquent, elle est souvent irrégulière et désordonnée : tandis que, chez les autres, la description de l’action de la puissance ou de la loi, contribue à rendre cette action plus uniforme et plus régulière.
Quelques exemples feront mieux sentir la différence : je suppose qu’un sultan et un empereur d’Autriche ont tous les deux besoin de lever un impôt sur leurs sujets, pour faire une guerre, pour asservir ou exterminer une nation. L’un et l’autre sont mus par un même principe ; ils tendent au même but ; ils disposent des mêmes forces : leurs sujets ont également à livrer une partie de leurs moyens d’existence. De part et d’autre, nous trouvons des commis ayant des mains pour recevoir ou pour prendre l’argent des sujets ; des gens armés disposés à prêter main-forte aux commis ; de part et d’autre, nous trouvons des receveurs ayant des caisses pour mettre cet argent, et des soldats pour le garder ; nous trouvons, de plus, des ministres qui attirent cet argent à eux, et qui le distribuent selon leur plaisir ou selon la direction qui leur est donnée ; de part et d’autre, enfin, nous trouvons un maître qui donne ou qui est censé donner le mouvement à la machine entière.
Tous ces éléments de force, dont la réunion forme la loi, se ressemblent dans les deux pays : il n’existe de différence entre l’un et l’autre, qu’en ce que, dans l’un, l’action de cette puissance ou de cette loi a été décrite, dans tous les cas où elle doit s’exercer ; tandis qu’elle ne l’a pas été dans l’autre. Dans celui des deux pays où l’action de la puissance a été décrite d’avance, chacun des éléments de force dont elle se compose, depuis le dernier commis jusqu’au premier ministre, règle son action sur la description qui lui a été donnée ; et chacun des sujets n’éprouve de cette action que la portion qui lui a été assignée par la description. Dans celui des deux pays où l’action de la puissance n’a pas été décrite d’avance, les mouvements en sont plus désordonnés : chacun des éléments dont cette puissance est formée, agit avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins de partialité.
Le gouvernement qui agit sans avoir décrit d’avance les divers genres d’action qu’il tend à exercer, pourrait être comparé à une machine à vapeur, qui serait destituée de régulateur ; les mouvements en sont irréguliers, lents ou brusques tour à tour. Le gouvernement qui n’agit, au contraire, qu’après avoir décrit les actions qu’il veut produire, marche d’une manière égale : la description qu’il publie est, en quelque sorte, le régulateur qui donne de l’uniformité à ses mouvements. Mais il faut bien se garder de croire que l’addition du régulateur à la machine du gouvernement, en change la nature ou les effets ; si elle est montée pour attirer la subsistance du peuple vers les hommes du pouvoir, plus elle sera régulière dans ses mouvements, mieux elle remplira son office ; elle en sera plus durable et plus [I-350] énergique. Un peuple peut donc avoir des lois décrites et des autorités qui les observent ; il peut avoir un gouvernement dont l’action soit uniforme, et être néanmoins excessivement opprimé. On peut mettre de la régularité dans le pillage et dans le partage du butin, comme on peut en mettre en toute autre chose ; mais il ne faut pas croire que, pour cela, les individus qui sont pillés en soient plus heureux ; il y seulement plus d’uniformité dans les extorsions.
Les lois qui régissent les peuples, sont une puissance, et cette puissance peut produire de mauvais effets comme elle peut en produire de bons. Dire d’un peuple qu’il est soumis à un régime arbitraire, ce n’est donc pas dire autre chose, si ce n’est qu’il est soumis à une force irrégulière et désordonnée. Si, par sa nature, cette force est malfaisante, le mal qu’elle fait n’est pas également grave dans tous les cas qui se ressemblent. Affirmer, d’un autre côté, qu’un peuple est soumis à un régime légal, c’est dire tout simplement que la force ou la puissance à laquelle il obéit, agit d’une manière égale dans tous les cas semblables. Si cette force est malfaisante, elle fait à tous ceux qu’elle atteint et qui se trouvent dans la même position, un mal qui est à peu près le même. Voilà les principales différences qu’on peut observer, dans un grand nombre de cas, entre ce qu’on nomme le régime arbitraire et le régime légal ; ils sont quelquefois aussi mauvais l’un que l’autre ; peut-être même n’est-il pas impossible que tel régime arbitraire ne soit préférable à tel régime qui se dit légal. Se soumettre aux lois d’un État, c’est se soumettre à la puissance qui y règne ; c’est obéir à la nécessité : mais cette soumission n’est pas nécessairement un bien.
Il est des écrivains qui ont exagéré jusqu’au ridicule les avantages du régime qu’ils nomment légal. Ces avantages, en effet, sont immenses pour les peuples qui ne sont soumis qu’à de bonnes lois ; mais ils sont nuls pour les peuples soumis à des lois qui sont malfaisantes. Un propriétaire peut mettre de la régularité dans l’exploitation d’une ferme ; il peut tracer à chacun de ses agents, les règles qu’ils doivent suivre dans l’administration de ses troupeaux ; il peut déterminer les heures auxquelles on les mènera paître, les époques auxquelles ils seront tondus, le temps auquel il sera permis de les accoupler, et même l’âge auquel ils seront livrés au boucher. S’il a des esclaves, il peut faire, pour eux, des règlements analogues à ceux qu’il aura faits pour ses troupeaux ; il peut déterminer les heures de travail qu’ils devront par jour, la quantité d’aliments qui leur sera laissée, le nombre des coups de fouet qu’on leur donnera dans des circonstances déterminées ; il peut faire, en un mot, un règlement aussi bien écrit et aussi prévoyant que le code le plus admiré. Lorsque tout aura été ainsi réglé, les bêtes et les hommes seront soumis à un régime légal ; c’est-à-dire que l’action de la puissance à laquelle ils seront soumis, aura été décrite d’avance ; mais faut-il en conclure qu’ils s’en trouvent beaucoup mieux ? Auront-ils, pour cela, une somme de liberté plus grande ? Si, pour être libre et pour être bien, il suffisait de n’être soumis qu’à des lois dont les dispositions seraient décrites, il ne vaudrait pas la peine de disputer : les gouvernements les moins complaisants pourraient y consentir, sans rien perdre de leur puissance. La question ne peut donc pas être si l’on ne sera soumis qu’aux lois, mais si l’on ne sera soumis qu’à de bonnes lois.
Les lois n’étant que de la force, on ne peut bien les juger qu’en examinant les diverses manières dont elles agissent sur les hommes, soit qu’elles les affectent directement, soit qu’elles ne les affectent que d’une manière indirecte, en agissant sur les choses qui sont à leur usage. Il faut donc, pour en connaître les effets, exposer comment elles peuvent atteindre les hommes qui y sont assujettis.
[I-353]
CHAPITRE IV.↩
Des divers éléments de puissance qui constituent les lois ; ou des causes générales de l’action que les hommes exercent les uns sur les autres.
Une grande partie des forces qui composent la puissance des lois, sont dans la nature même de l’homme ; et cependant c’est principalement sur des hommes que l’action de cette puissance se manifeste ; si elle agit sur les choses, ce n’est que dans les rapports qu’elles ont avec nous.
Pour connaître la manière dont les lois agissent, les éléments de force dont elles se composent, et les conséquences qui résultent de leur action, il faut donc considérer les hommes, tour à tour, comme agents et comme sujets. Il faut examiner, d’une part, quelles sont les causes qui les déterminent à agir sur eux-mêmes ou sur leurs semblables ; et, d’un autre côté, quelles sont les causes qui les obligent à céder à l’action qui est exercée sur eux.
On a déjà fait observer que les divisions et les classifications ne sont que des méthodes propres à faciliter les opérations de notre esprit ; je reproduis ici cette observation, afin qu’on ne s’imagine pas qu’en considérant l’homme sous des points de vue divers, je suppose qu’il y a en lui autant d’êtres distincts qu’il y a de points sous lesquels on peut l’envisager.
Afin de mettre de l’ordre dans mes idées, je considérerai les hommes sous trois points de vue différents : dans leurs organes physiques, dans leurs facultés intellectuelles, et dans leurs facultés morales ou dans leurs affections. Ces diverses parties d’eux-mêmes, ne sont pas séparées dans la nature, comme elles le sont dans notre esprit. On peut même se diviser sur le nom qu’il convient de donner à chacune d’elles ; mais, pour me faire entendre, je n’ai pas besoin ici d’une plus grande précision.
Chacun comprend fort bien ce que je désigne par les mots organes physiques ; ce sont les parties matérielles de notre être, internes ou externes : tels sont les organes du tact, de la vue, de l’ouïe, du goût, et autres.
Par nos facultés morales, j’entends les affections ou les sentiments dont nous sommes susceptibles : l’amour, la haine, la vengeance, l’espérance, la crainte, en un mot toutes nos passions quelle qu’en soit la nature.
J’entends par nos facultés intellectuelles les diverses opérations de l’esprit, que nous désignons sous les noms de perception, de comparaison, de raisonnement, d’imagination et autres, et les organes dans lesquels ou au moyen desquels ces opérations s’exécutent.
Comprenant, dans ces trois parties, l’homme tout entier, il nous est impossible de trouver les causes de l’action qu’une partie du genre humain exerce sur une autre, à moins de la chercher dans des besoins physiques, dans des passions, dans des idées ou des jugements. Il faut que nous trouvions également, dans une de ces parties de l’homme, les causes qui le déterminent à céder à l’action qui est exercée sur lui par ses semblables.
Je ne me propose pas, dans ce moment, d’exposer les causes diverses sous l’influence desquelles les organes physiques et les facultés intellectuelles de l’homme se développent, ou restent sans développement. Je ne veux pas exposer non plus les circonstances sous lesquelles certaines affections se manifestent de préférence à d’autres ; ce sont des sujets que je traiterai dans les livres suivants. Le seul objet que je me propose ici, est de faire voir quelles sont les causes générales qui déterminent une partie du genre humain à agir sur une autre, et les causes qui obligent celle-ci à obéir ou à se dérober à l’action de celle-là. Ce n’est qu’en nous faisant de justes idées de ces causes, que nous saurons quels sont les divers éléments dont se composent ces puissances auxquelles nous donnons le nom de lois.
Nous n’avons la conscience de notre existence et des divers objets qui nous environnent, que par ce qui se passe en nous, ou par les impressions que les objets extérieurs ont faites sur nos organes. Nous ne pourrions savoir que nous existons, ou que quelque chose existe hors de nous, si aucun objet intérieur ou extérieur ne faisait sur nous aucune impression.
Une impression qui ne produirait en nous ni plaisir, ni espérance de plaisir, ni douleur, ni crainte de douleur, serait pour nous comme non existante ; elle ne pourrait ni nous faire exécuter une action qui ne nous conviendrait pas, ni nous empêcher d’en exécuter une vers laquelle nous nous sentirions porté. Il faut, pour nous déterminer à agir, que nous soyions affectés ou par des sentiments agréables, ou par des sentiments pénibles.
Chacun de ces deux genres de sensations se divise en plusieurs espèces ; on peut en faire autant de classes, que nous avons compté dans l’homme de parties diverses. L’homme peut être affecté dans ses organes physiques, dans ses sentiments moraux, et dans ses facultés intellectuelles.
On donne le nom de plaisirs ou de peines physiques, aux sensations agréables ou douloureuses produites immédiatement sur quelqu’un de nos organes matériels, par le contact d’un objet quelconque, par la jouissance ou par la privation d’une chose nécessaire à notre existence, ou par la lésion de quelqu’un de nos organes.
On donne le nom de peines ou de plaisirs moraux, aux sensations douloureuses ou agréables que nous ressentons en nous-mêmes, sans que nous puissions les attribuer à aucun organe particulier, et qui sont le résultat de l’impression qu’ont faite sur notre imagination les objets extérieurs, tels que les plaisirs ou les souffrances éprouvés par des êtres pour lesquels nous nous sentons de la sympathie ou de l’antipathie.
On donne le nom de plaisirs ou de maux intellectuels à ceux qui affectent notre intelligence : ainsi, la lecture d’un bon ouvrage, la recherche, et surtout la découverte d’une vérité, la solution d’un problème difficile, la réfutation d’une erreur dangereuse, sont autant de jouissances qui sont propres à l’intelligence.
Toutes les parties de l’homme, ne formant qu’un système, agissent continuellement les unes sur les autres ; il en est de même de ses affections. Une douleur physique produit souvent une douleur morale ; et une douleur morale, pour si peu qu’elle soit forte ou prolongée, ne tarde pas à produire des maux physiques. La douleur que nous causent la perte d’une personne qui nous est chère, la perte de notre fortune ou de notre réputation, peut produire en nous des désordres physiques assez graves pour nous donner la mort. De même, des douleurs purement physiques peuvent affecter notre caractère moral, au point de le rendre méconnaissable. Elles peuvent détruire nos espérances, nous inspirer des craintes, affaiblir même les sentiments que nous avons pour nos amis ou pour nos proches.
Si des maux physiques amènent souvent à leur suite des peines morales, et se confondent avec elles, les plaisirs physiques qui prennent leur source dans une bonne constitution, produisent souvent aussi des plaisirs moraux. Un homme dont tous les organes remplissent avec facilité les diverses fonctions auxquelles la nature les a destinés, qui a satisfait tous ses besoins, et qui éprouve ce genre de contentement que donnent la santé et l’absence de toute peine, s’abandonne bien plus facilement à l’espérance et à toutes les affections douces et bienveillantes, qu’il ne le ferait dans une situation différente ; sa vie est plus expansive ; il s’identifie davantage avec ses semblables. En général, un homme heureux est un homme bon : un homme méchant est un homme misérable, dans le sens propre du mot. Cela peut nous faire juger des plaisirs dont jouissent les tyrans, et des mœurs des peuples qu’on rend misérables pour en faire des instruments plus dociles [77].
Les peines ou les douleurs physiques n’engendrent cependant pas toujours des peines morales correspondantes : il arrive, au contraire, fort souvent, qu’on se procure des plaisirs moraux, par les peines physiques qu’on se donne ; celles-ci sont, en quelque sorte, la monnaie avec laquelle on achète ceux-là. C’est par un travail pénible et assidu, qu’on acquiert son indépendance, et qu’on assure à ses enfants des moyens d’existence ou une bonne éducation.
Les plaisirs physiques produisent quelquefois des jouissances morales ; mais ils n’en produisent pas toujours. Il n’est pas rare, au contraire, qu’ils produisent une multitude de maux. Des excès habituels d’aliments ou de boisson, quels que soient les plaisirs qui les accompagnent, ne tardent pas à être suivis de douleurs de tous les genres.
Les jouissances morales, de même que les plaisirs physiques, engendrent souvent des peines de même nature. Ainsi, l’individu qui satisfait une affection morale, telle que la haine, l’envie, la colère, ou la vengeance, éprouve certainement un plaisir au moment où il se livre à une de ces passions ; mais le plaisir est toujours suivi de peines morales plus ou moins graves, plus ou moins durables ; telles que la crainte, le repentir, le mépris de soi-même, le déshonneur.
Il n’est, en un mot, aucun genre de plaisirs ou de peines, qui ne puisse engendrer d’autres plaisirs ou d’autres peines ; et non seulement pour celui qui s’y livre, mais pour une foule immense d’individus. Une grande découverte peut produire des plaisirs très vifs et très durables pour celui qui en est l’auteur ; mais elle en produira aussi pour la plupart des hommes qui viendront après lui.
Les peines ne se propagent ni avec moins de rapidité, ni avec moins d’étendue que les plaisirs : les jouissances que se donnèrent César et ses successeurs, furent payées par les malheurs d’une multitude de nations.
La distinction des divers genres de plaisirs et de peines que noussommes susceptibles d’éprouver, est fort importante en morale et enlégislation. C’est pour ne l’avoir pas faite, que l’on s’est livré à tant dedisputes sur les véritables causes des actions et des jugements des hommes, etqu’on a souvent laissé impunis des faits punissables. Des philosophes ont dit que,dans ses actions et dans ses jugements, l’homme n’est conduit que par les sentimentsagréables ou douloureux qu’il éprouve, par des plaisirs ou par des peines ; etils ont entendu par là tous les genres d’affections dont nous sommessusceptibles ; non seulement nos jouissances ou nos douleurs physiques, maisaussi nos douleurs et nos jouissances morales et intellectuelles, nos craintes,nos espérances, et tous les sentiments qui naissent de la sympathie et de l’antipathie.D’autres écrivains, restreignant le sens des mots plaisirs et peines, aux peines et auxplaisirs purement physiques, ont prétendu avec raison que l’homme n’était pastoujours conduit par le plaisir ou par la douleur ; et, pour justifier leuropinion, les exemples ne leur ont pas manqué : ils ont accusé les premiers decalomnier le genre humain et de corrompre la morale ; et, afin de rendre leshommes meilleurs, ils ont tâché de les faire croire à des effets sans causes,et de leur persuader qu’ils devaient s’imposer des privations ou se soumettre àdes douleurs sans motifs.
Les erreurs dans lesquelles on est tombé en législation, n’ont été ni moins nombreuses, ni moins graves. Quelquefois on a prétendu que, pour apprécier le bonheur d’un peuple, il ne fallait tenir aucun compte de ses jouissances physiques, et que la nation la plus heureuse était celle qui avait le moins de besoins à satisfaire, comme si le bonheur ne se composait que de négations. Quelquefois aussi on a prétendu que les jouissances et les douleurs physiques étaient les seules qu’il fallût prendre en considération ; qu’un peuple qui avait les moyens d’apaiser sa soif, de rassasier son appétit, et de se mettre à l’abri de l’intempérie des temps, était les plus heureux des peuples et n’avait plus rien à désirer, mettant ainsi les hommes au niveau des stupides animaux qu’on n’engraisse que pour les livrer au boucher. Quelquefois, enfin, on a prétendu que si les peuples pouvaient aspirer à des jouissances morales ou intellectuelles, les gouvernements étaient les juges suprêmes de la qualité et de la quantité qui devaient leur en être permises. On a bien admis que les hommes pouvaient, sans danger, être juges de la qualité et de la quantité d’aliments exigés par les besoins de leur estomac ; mais on n’a pas admis également qu’ils pussent, sans danger, être juges de la qualité et de la quantité d’instruction exigée par leur esprit.
[I-362]
On est allé plus loin ; on a tenté de soumettre leurs affections morales aux mêmes règles que leurs facultés intellectuelles : on a prétendu qu’il fallait aimer tels individus, jusqu’au point de se faire tuer pour eux ; tels autres jusqu’au point seulement de se faire leurs esclaves et de travailler pour leur service ; tels autres pour leur acheter exclusivement leurs marchandises, même quand elles sont chères et de mauvaise qualité ; tels autres, enfin, jusqu’au point seulement de leur livrer son superflu, et de les empêcher de mourir de faim. Les antipathies ont été réglées comme les sympathies ; et elles l’ont été avec le même esprit.
Nous n’avons pas à examiner ici ces différents systèmes : la seule chose que je me proposais de faire observer, c’est que, pour connaître les causes et les effets de l’action que les hommes exercent les uns sur les autres, il faut examiner les divers genres d’affections dont ils sont susceptibles ; il faut examiner tous les plaisirs et toutes les peines, quelle qu’en soit la nature, qui sont la cause ou le résultat de cette action.
[I-363]
CHAPITRE V.↩
Des peines et des plaisirs physiques considérés comme éléments de la puissance des lois. — Des jugements qui ont été portés des plaisirs et des peines de ce genre, par des sectes religieuses et par des sectes philosophiques.
Si nous observons quelles sont les causes qui déterminent une partie du genre humain à agir sur d’autres parties, nous trouverons, au nombre des principales, le désir d’obtenir des jouissances physiques, et le désir d’éviter des peines de même nature. C’est pour se soustraire aux peines qu’exige le travail, et pour obtenir des subsistances abondantes, des vêtements agréables et des habitations commodes, que des hommes en possèdent d’autres à titre d’esclaves. C’est pour la même fin que, chez toutes les nations, une partie de la population domine, ou cherche à dominer sur les autres ; et c’est pour ne pas s’exposer à des maux physiques plus ou moins graves, que les hommes désignés sous les noms de gouvernés, de sujets ou d’esclaves, obéissent à l’action qui est exercée sur eux. L’histoire du genre humain, en un mot, ne se compose que des luttes auxquelles a donné naissance le désir d’accaparer les jouissances physiques de toutes les espèces, et de rejeter sur d’autres toutes les peines du même genre.
Si nous faisions l’analyse de toutes les lois, nous trouverions que l’aversion pour les douleurs physiques, et le désir des jouissances de même nature, sont un des principaux éléments de puissance dont chacune d’elles se compose. Il n’est pas ici question d’examiner si cette double tendance est un bien ou un mal ; il me suffit de faire observer qu’elle existe, qu’elle est dans la nature de l’homme, et que, par conséquent, il n’est en la puissance de personne de la détruire. Les nations ont toujours considéré comme un bien les jouissances physiques qu’on leur a procurées, et comme un mal les douleurs qu’on a fait tomber sur elles.
Les jugements qu’on a portés sur les jouissances et sur les peines de cette nature, paraissent cependant n’avoir pas toujours été uniformes chez tous les individus. Dans tous les temps, il s’est trouvé des personnes qui se sont fait une gloire de supporter ou même d’affronter un certain genre de douleurs, et de mépriser un certain genre de plaisirs, et ces personnes ont été généralement admirées. On est même allé jusqu’à réduire en système le mépris des sensations physiques, agréables ou douloureuses : il n’est personne qui ne connaisse les maximes des stoïciens, et de quelques sectes de dévots, à cet égard. Ces maximes ayant été admirées par un grand nombre de personnes, devons-nous croire que les hommes qui ont fait à leurs semblables un devoir d’éviter les plaisirs, et de s’exercer à la douleur, ont voulu imprimer au genre humain un mouvement contraire à sa nature ? Ou faut-il considérer comme étant vicieux par lui-même le penchant qui nous porte à rechercher ce qui nous flatte, et à éviter ce qui nous blesse ?
Lorsqu’un système est adopté par un nombre considérable d’hommes qui n’ont entre eux aucune liaison d’intérêt ; lorsque, parmi ceux qui l’ont adopté, il s’en trouve plusieurs qui ne sont pas moins remarquables par leur capacité que par la pureté de leurs mœurs ; lorsque enfin ce système passe d’une génération à l’autre, et se rencontre chez des peuples qui n’ont entre eux aucune ressemblance, et qui paraissent même ne pas avoir la même origine, on peut être assuré que, si l’ensemble n’en est pas vrai, il y a au moins, dans le fond, des vérités importantes qui frappent les esprits, et qui les empêchent d’apercevoir les erreurs qui s’y trouvent mélangées : tel est le système qui fait reposer la morale sur le mépris des jouissances et des douleurs physiques ; système qui a été adopté par des dévots et par des philosophes, qui a été admis parmi les peuples de l’antiquité comme parmi les modernes, qui se trouve chez les Asiatiques et chez les Européens, et que nous rencontrons jusque chez les sauvages.
Nous admettons, sur nos théâtres, qu’on nous représente des personnages heureux par leurs jouissances morales ou intellectuelles : un père qui retrouve des enfants qu’il a cru perdus, une mère qui jouit du bonheur de sa fille, un amant qui retrouve sa maîtresse, nous inspirent une vive sympathie ; nous prenons part à leur joie, comme nous avons pris part à leurs douleurs. Mais nous ne supporterions pas des personnages qui ne seraient heureux que par leurs jouissances physiques : quelque vif que fût le plaisir qu’éprouvât un héros à faire un bon repas, à savourer des mets exquis, des vins délicieux, nous ne saurions prendre part à ses jouissances ; plus même elles seraient vives, et plus elles nous inspireraient de dégoût. Le spectacle des plaisirs physiques ne nous semble tolérable que lorsque ces plaisirs sont produits par des causes qui nous paraissent, en quelque sorte, immatérielles ; un air pur, des odeurs suaves, des sons harmonieux.
Nous mettons la même différence entre les douleurs physiques et les douleurs morales. Nous prenons part aux douleurs d’Andromaque, au désespoir de Clytemnestre ; mais une héroïne qui se plaindrait de la migraine ou d’un mal de dents, ne saurait nous toucher, quelque vives que fussent ses souffrances. Nous n’admettons qu’on nous représente des maux physiques, que lorsqu’ils servent à rendre plus graves des peines morales ; telles que des blessures qui mettent un homme dans l’impossibilité de porter des secours à son fils ou à son ami, ou de repousser une injure. Nous admettons aussi qu’on nous donne le spectacle des douleurs physiques, pourvu que l’individu qui en est affecté, les méprise et les compte pour rien. Le Romain qui place sur un brasier la main qui a manqué l’ennemi de sa patrie, nous cause de l’étonnement et de l’admiration. Si cette main était brûlée en vertu des ordres de Porsenna, et par les soldats de ce prince, un tel spectacle ne nous causerait que de l’horreur. Nous admirons le sauvage qui, au milieu des tourments, brave son ennemi, et l’excite à la vengeance ; mais il nous paraîtrait un monstre, s’il bravait les douleurs morales comme il brave les douleurs physiques ; si, au spectacle du supplice de ses enfants, de sa femme ou de son père, il manifestait les sentiments qu’il témoigne au moment de sa propre destruction [78].
L’admiration que nous cause le mépris des jouissances et des douleurs physiques, ne peut être un effet de l’éducation et des préjugés particuliers à un peuple ou à une époque ; car nous la trouvons chez toutes les nations, à tous les degrés de civilisation, et sous toutes les religions. Nous voyons que, dans tous les pays, le moyen le plus infaillible de gagner la confiance et d’exciter l’admiration de la multitude, a été d’affecter du mépris pour les plaisirs et pour les douleurs physiques, ou même d’éviter les uns et de courir au-devant des autres. Plusieurs prêtres de l’Inde s’imposent volontairement des privations, et se soumettent à des peines qui nous paraissent excéder ce que peut supporter la nature humaine ; et le respect, la vénération qu’ils inspirent, sont en raison des jouissances qu’ils se refusent, et des rigueurs auxquelles ils se soumettent. Dans la religion chrétienne, on n’a mis au nombre des élus que les hommes qui ont renoncé aux plaisirs des sens, et qui ont su braver la douleur : jamais l’église de Rome n’eût placé sur le catalogue des saints le nom d’un homme voluptueux, cet homme eût-il été le bienfaiteur du monde. Les stoïciens ont, en général, condamné les jouissances physiques, et recommandé le mépris de la douleur, avec non moins de zèle que les dévots ; et si les philosophes modernes sont, à quelques égards, moins austères, ils n’en méprisent pas moins les individus qui se montrent passionnés pour les jouissances de ce genre, et ils accordent toujours leur estime à ceux qui savent se montrer supérieurs à la douleur.
Quels sont les faits qui ont servi de base à ces opinions ? Les douleurs physiques seraient-elles de leur nature utiles au genre humain, et faudrait-il dire, avec quelques stoïciens, qu’elles ne sont point un mal ? Les plaisirs de même espèce seraient-ils, par eux-mêmes, réellement funestes, et faudrait-il ne pas les considérer comme un bien ?
Nous devons observer d’abord que, quoique les hommes, en général, manifestent de l’admiration pour ceux de leurs semblables qui méprisent les douleurs et les jouissances physiques, la tendance universelle du genre humain est d’éviter les premières et de rechercher les secondes. Partout, les hommes tendent à se garantir du froid, de la faim, des maladies ; partout ils aspirent à obtenir des habitations commodes, des aliments sains et abondants, et des vêtements chauds ou légers, selon la saison ou le climat ; la tendance des individus qui admirent qu’on méprise les plaisirs et les peines, n’est pas moins forte que celle du reste des hommes.
Nous devons observer, en second lieu, que le mépris des peines et des plaisirs physiques ne nous cause de l’admiration que lorsque l’individu qui éprouve ce mépris, ne l’étend pas aux peines et aux plaisirs physiques des autres. L’homme qui, après avoir admis en principe que la douleur n’est point un mal, et que nous devons la mépriser, en tirerait la conséquence qu’il peut laisser mourir de faim ses enfants ou sa femme ; celui qui se fonderait sur le même principe pour faire l’éloge de Tibère ou de Charles IX, ne serait admiré par aucune secte philosophique ou religieuse. On n’admirerait pas davantage celui qui se fonderait sur son mépris des jouissances physiques, pour priver de plaisirs de ce genre les individus sur le sort desquels il aurait quelque influence.
Si les peuples honorent les individus qui méprisent les douleurs physiques, ils honorent encore plus ceux qui les en délivrent. Un sauvage doit savoir chanter dans les tourments et mourir comme un homme, pour être admiré même de ses ennemis ; mais il sera plus admiré encore, si, par sa valeur, il préserve du supplice quelqu’un de ses compagnons. Un homme, pour obéir aux préceptes de sa religion, doit savoir supporter la faim et la soif, et mépriser les sensualités de tous les genres ; mais il sera fort approuvé, même dans sa religion, s’il donne à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, et s’il leur procure ainsi les jouissances physiques les plus vives que puisse éprouver un homme dans une telle situation.
Il n’y a rien de contradictoire dans ces deux opinions ; l’une est, au contraire, une conséquence de l’autre. Nous voulons que nos semblables méprisent les douleurs qui n’atteignent qu’eux, afin qu’ils prennent la peine de nous délivrer de celles qui peuvent tomber sur nous ; nous voulons qu’ils méprisent les jouissances qui ne seraient senties que par eux, afin que notre part soit un peu plus grande. Nous consentons à leur payer en estime les peines qu’ils prennent à notre service, ou les plaisirs auxquels ils renoncent pour nous obliger. Un peuple admirant dans un individu le mépris qu’il témoigne des jouissances physiques, ressemble à une multitude qui vanterait le mépris des richesses à un avare, et qui attendrait le moment de lui voir répandre ses trésors pour se précipiter dessus. Nul ne doit, à cet égard, se plaindre de fausseté ou d’injustice, puisque ce que les autres admirent en nous, nous l’admirons chez les autres, et qu’ainsi tout est parfaitement égal entre les hommes. Il résulte de cette double disposition que, chez aucun peuple, ni dans aucune secte, les peines physiques n’ont été considérées comme désirables en elles-mêmes, ni les jouissances de même nature comme étant essentiellement funestes. Il ne peut donc être question que de rechercher quelles sont les circonstances qui ont influé ou qui influent encore sur l’appréciation des unes et des autres.
Un homme qui serait destitué de toute intelligence et de toute affection, et qui posséderait une grande force, n’en retirerait aucun avantage ; il ne suffit pas, pour agir avec utilité, de posséder de la force ; il faut de plus un désir qui lui imprime le mouvement, et une intelligence qui la dirige. De même, celui qui serait pourvu d’intelligence et qui éprouverait des désirs, ne saurait par lui-même exercer aucune action, s’il était dépourvu de forces, s’il n’avait aucun instrument pour exécuter ce qu’il aurait conçu et désiré. Or, les premiers instruments de l’homme, ce sont ses membres, ses organes physiques ; et plus ces instruments ont de force, de souplesse, d’agilité, de perfection, en un mot, mieux il peut tirer parti de ses facultés intellectuelles et morales.
Un homme doué d’une bonne organisation physique, a sur un homme mal constitué, toutes choses étant égales d’ailleurs, une multitude d’avantages : quel que soit le genre d’occupations auquel il s’adonne, il peut travailler mieux et plus longtemps : s’il est ouvrier ou artisan, il fait plus d’ouvrage, et le fait avec plus de perfection ; s’il est militaire, il supporte mieux les fatigues de la guerre, commande avec plus de facilité, attaque et se défend avec plus d’avantage ; s’il est artiste, ses organes ayant plus de souplesse, plus de délicatesse, il a, par cela même, plus d’habileté ; s’il est savant, magistrat, il est capable d’une attention plus soutenue, et la faculté de supporter de plus longues fatigues lui donne le moyen de se livrer à plus de travaux, et de faire plus de progrès ; enfin, il peut rendre plus de services à sa famille, à ses amis, à son pays, et par conséquent à lui-même ; ayant plus de confiance en lui, il en inspire davantage aux autres ; la sécurité dont il jouit se communique à ceux dont l’existence repose sur la sienne.
Mais une bonne organisation physique ne peut s’acquérir et se conserver par une continuité de privations et de souffrances. Elle ne s’acquiert qu’en faisant usage d’aliments sains et abondants ; en respirant un air salubre ; en se mettant à l’abri des excès de froid et de chaleur ; en se livrant à un exercice modéré ; en jouissant de la sécurité pour soi-même et pour les personnes auxquelles on s’intéresse ; en accordant, en un mot, à la nature tout ce qu’elle demande pour développer nos forces, ou pour les réparer quand elles s’épuisent. C’est donc par une continuité de jouissances physiques que l’homme développe ses organes, qu’il leur donne la perfection dont ils sont susceptibles, et qu’il met au service de son intelligence et de ses facultés morales les instruments qui peuvent leur donner le plus d’utilité. Il est remarquable que plus les facultés physiques d’un individu ont reçu de perfection, plus les jouissances qui naissent de la satisfaction de ses besoins ont de vivacité ; et que plus il met de modération dans ses jouissances, et plus longtemps il conserve la faculté de les renouveler. Il arrive donc que celui dont les organes ont reçu le plus de perfection et qui les a conservés le mieux et le plus longtemps, est aussi celui qui, à tout prendre, a éprouvé la somme la plus considérable de jouissances physiques.
Si les causes qui produisent et qui conservent une bonne organisation, sont en même temps productives de jouissances, les causes qui produisent une constitution faible ou vicieuse, sont aussi productives de douleurs. Un individu qui souffre habituellement de la soif ou de la faim, qui ne se nourrit que d’aliments malsains, qui respire un air insalubre, qui est exposé tantôt à des excès de froid, et tantôt à des excès de chaleur, qui passe alternativement d’une oisiveté absolue à un travail excessif, ne peut qu’avoir une constitution faible, et être assailli de continuelles souffrances. Les mêmes causes qui le font souffrir le font dépérir, et il n’est pas plus possible de séparer le dépérissement de la douleur, que de rendre l’effet indépendant de la cause. Une continuité de souffrances physiques produit donc l’affaiblissement de nos organes, comme la continuité du bien-être en produit le développement. À mesure qu’ils s’affaiblissent ou se dégradent, la vivacité des sensations s’affaiblit, et le nombre de services que l’individu peut rendre décroît dans la même proportion. D’où il suit que plus un individu a été assailli, pendant le cours de sa vie, de privations et de douleurs physiques, et moins il a pu être utile à ses semblables. D’où il suit encore que plus les individus dont un peuple se compose deviennent misérables, plus ils se trouvent isolés les uns des autres, et on peut dire des nations ce que je dis des individus.
Puisque la continuité du bien-être physique accroît les moyens que possède un homme d’être utile à ses semblables, et puisque les douleurs du même genre affaiblissent ces moyens, comment est-il arrivé que les peuples ont honoré de leur estime les individus qui ont méprisé le plaisir et bravé la douleur ? Avaient-ils pour objet d’encourager ce qui produit la dégradation et la décadence du genre humain ?
Observons d’abord que, chez aucun peuple, dans aucune religion, dans aucune secte, on ne s’est fait un devoir d’affronter toute espèce de douleurs physiques. Un individu qui se livrerait à l’intempérance dans l’espoir d’être tourmenté de la goutte sur la fin de ses jours, qui se surchargerait l’estomac pour se procurer les souffrances d’une indigestion, ou qui se livrerait à tout autre vice pour recueillir les infirmités qui en sont la suite, ne serait un objet de vénération pour personne ; en pareil cas, nul ne lui saurait gré de son mépris pour la douleur. On estimerait également peu un individu qui s’exposerait gratuitement à une souffrance physique dont il ne saurait résulter aucun bien pour personne. S’exercer à la douleur dans la vue d’apprendre à résister à des tentations funestes, ou de s’exposer à un grand danger dans un cas où cela nous serait commandé pour l’intérêt de nos semblables, peut être considéré comme un exercice honorable ; mais s’exposer à la douleur pour elle-même, est un acte d’insensé dans tous les pays.
Les hommes sont particulièrement disposés à honorer ceux de leurs semblables qui méprisent les douleurs physiques, dans trois circonstances : dans l’état sauvage, dans l’état de servitude domestique, et dans l’état d’asservissement politique. Les mêmes causes produisent, dans ces trois états, des effets semblables.
Dans l’état sauvage, les hommes ne peuvent se conserver qu’en se soumettant à des peines continuelles et à des travaux excessifs, et en se rendant terribles à leurs ennemis. Pour se procurer leur subsistance par la chasse ou la pêche, surtout dans la mauvaise saison, il faut qu’ils se livrent à des fatigues et à des douleurs sans mesure ; qu’ils poursuivent le gibier à travers des forêts impénétrables ; qu’ils prennent le poisson dans des lacs couverts de glace, et quelquefois qu’ils restent plusieurs jours sans subsistance. Celui qui supporte alors le plus aisément la faim et la fatigue, et qui peut poursuivre sa proie avec le plus de constance, doit être nécessairement le plus honoré. On estime en lui des qualités qui le préservent de la destruction ; savoir choisir, entre deux maux, celui qui est le moins funeste, quoiqu’il soit le plus prochain, est un acte de sagesse. C’est d’après la même règle qu’on estime celui qui, étant pris par les ennemis, montre le plus de courage dans les tourments : sa fermeté devient la sauvegarde de ses compatriotes, en devenant un objet de terreur pour ceux qui assistent à son supplice.
L’esclavage domestique produit sur les individus qui sont asservis, un effet analogue à celui que produit sur les sauvages l’état misérable dans lequel ils vivent. Obligés d’exécuter des travaux dont ils ne peuvent pas cueillir le fruit, livrés sans défense à l’arbitraire et aux caprices de leurs maîtres, il ne leur reste qu’un moyen de conserver quelque indépendance, et de goûter quelques plaisirs fugitifs, au milieu des calamités qui les environnent : c’est de se montrer insensibles à la douleur, et de mépriser la mort. L’esclave qui voit dans sa propre destruction un moyen de s’affranchir, se sent protégé par l’avidité de son maître. Aussi les noirs, que les chrétiens d’Europe tiennent enchaînés sous les tropiques, montrent-ils, au milieu des supplices, un courage qui excède même la cruauté de leurs bourreaux.
Les mêmes dangers et les mêmes besoins développent des sentiments semblables, sous tous les gouvernements despotiques. Savoir souffrir et mourir, est la dernière vertu qui reste à des hommes asservis ; et, sous quelque forme que l’esclavage s’établisse, cette vertu se développe. Elle est la même à Constantinople et à Saint-Pétersbourg ; elle fut à Rome, sous les premiers empereurs, ce qu’elle est encore aujourd’hui en Perse, et sous tous les despotes de l’Asie. Les hommes accommodent toujours leurs maximes à leur position, et le résumé de ces maximes se réduit à tirer de cette position le parti le moins mauvais possible. Tant que les Romains furent pauvres et libres, la vertu fut de vaincre les peuples, et d’enrichir la république de leurs dépouilles ; quand ils furent les esclaves de leurs empereurs, ou, pour mieux dire, de leurs affranchis, et qu’ils ne purent échapper aux maux que le despotisme enfante, la vertu fut de braver la douleur, et de mépriser des plaisirs et des richesses qui leur échappaient.
On a accusé les stoïciens de n’avoir condamné les plaisirs, et de n’avoir méprisé les peines que par envie.
« D’où vient, dit Diderot, l’intolérance des stoïciens ? De la même source que celle des dévots outrés ; ils ont de l’humeur parce qu’ils luttent contre la nature, qu’ils se privent et qu’ils souffrent ; s’ils voulaient s’interroger de bonne foi sur la haine qu’ils portent à ceux qui professent une morale moins austère, ils s’avoueraient qu’elle naît de la jalousie secrète d’un bonheur qu’ils envient, et qu’ils se sont interdit, sans croire aux récompenses qui les dédommagent de leur sacrifice [79] ».
Quoique cette opinion sur les stoïciens ait été adoptée par un savant philosophe [80], je ne puis la croire fondée. Je ne saurais me persuader que Caton d’Utique a porté envie aux plaisirs d’Antoine, Épictète aux plaisirs d’Épaphrodite, et Marc-Aurèle, aux jouissances de Vitellius. Les stoïciens ont mesuré la valeur des peines et des plaisirs physiques exactement sur la même échelle que nous les mesurons nous-mêmes, et l’ordre social dans lequel ils vivaient, est plus que suffisant pour rendre raison de leurs doctrines.
Quelque sanglantes qu’aient été les révolutions et les guerres qui ont eu lieu chez les modernes, on se ferait une fausse idée de l’ordre social des anciens, si l’on jugeait de leur état par le nôtre. Dans les guerres civiles, la victoire d’une faction livrait le parti vaincu à une destruction presque complète : les plus faibles étaient bannis ou mis à mort par les plus forts, et leurs biens étaient confisqués ; souvent même la vengeance s’étendait sur la famille entière, sur les vieillards, les enfants et les femmes.
« Nous avons parmi nous, disait Appius Claudius au sénat de Rome, en parlant de la population qui s’était retirée de la ville ; nous avons parmi nous des gages qui appartiennent aux rebelles, et nous ne pourrions en souhaiter de plus précieux. Nous sommes maîtres de leurs femmes, de leurs pères et mères, et de toute leur postérité ; et il ne tiendra qu’à nous de les égorger en leur présence, s’ils ont l’audace de nous attaquer, et de leur faire connaître qu’ils doivent s’attendre eux-mêmes à un pareil traitement [81]. »
Ce n’étaient pas là de vaines menaces, c’étaient les maximes du droit public des peuples d’alors [82].
[I-380]
Dans une guerre étrangère, la défaite faisait des vaincus la propriété des vainqueurs ; elle livrait les villes au pillage et à l’incendie, les terres étaient confisquées, les femmes, les enfants, les vieillards étaient amenés en esclavage et vendus comme de vils troupeaux, sans distinction de rang, ni de condition ; le savant était exposé aux mêmes dangers que l’ignorant : Platon pouvait être vendu à côté d’une marchande d’herbes, et Aristote figurer dans l’inventaire d’un marchand de poisson. Nul ne pouvait donc avoir de sécurité, ni pour ses biens, ni pour sa famille, ni pour sa personne. Les dangers auxquels on se voyait exposé, s’étaient surtout multipliés en Grèce, durant les guerres du Péloponnèse, et dans les troubles civils qui les accompagnèrent ou les suivirent. Ce fut dans ces circonstances que naquit la secte des stoïciens.
Les mêmes circonstances qui l’avaient produite en Grèce, en firent adopter les maximes à Rome. Quel est, en effet, l’homme doué de quelque prévoyance, qui pouvait croire à la sûreté de sa fortune, de sa famille, de sa vie, ou seulement de sa réputation, après les proscriptions de Marius, de Sylla, des triumvirs, et après les règnes de Tibère et de Néron ! Tous les genres de maux étant devenus vraisemblables, il fallait se préparer à tous, pour n’en être ni surpris, ni accablé. Il fallait prévoir l’exil, la confiscation, la perte de sa famille et la proscription, comme on prévoit les événements les plus simples, dans le cours ordinaire de la vie. Les maximes d’Épictète ne conviendraient pas moins à un esclave de nos modernes colons, qu’à un sujet de Néron. « Si j’aime mon corps, si je suis attaché à mon bien, dit-il, me voilà esclave ; j’ai fait connaître par où je puis être pris. » Ces maximes pourraient aussi convenir à un individu qui, ayant été condamné à mort, attend avec patience que les caprices d’un favori lui fassent accorder sa grâce, ou fixent l’heure de son supplice. Les stoïciens ont dit aux misérables : ne soyez pas effrayés des maux qui vous menacent ; ils ne sont pas aussi terribles que l’imagination vous les représente ; vous les trouverez supportables, si vous vous y êtes préparés. Mais ils n’ont pas dit aux tyrans : exilez, proscrivez des hommes, car l’exil ni la proscription ne sont point un mal.
Les religions qui ont fait un précepte du mépris de la douleur, et qui ont enseigné à l’homme à supporter les calamités qui se multiplient sous les mauvais gouvernements, se sont également formées dans des circonstances où les peuples avaient à lutter contre des calamités qu’il n’était pas en leur puissance de surmonter. Il y a, entre un grand nombre des maximes du christianisme et les principes des stoïciens, une identité parfaite, et il faudrait nous étonner qu’il en fût autrement, puisque ces principes et ces maximes ont pris naissance à la même époque, et ont été adressés aux mêmes hommes.
Le mépris des douleurs physiques n’a donc jamais été un motif d’estime, que parce que les hommes ont toujours eu pour la douleur une aversion invincible. Toutes les fois qu’un individu s’est trouvé placé entre deux sommes de maux également inévitables, et qu’il a donné la préférence à la somme la plus petite, quoique la plus prochaine, cet individu a été honoré par ses semblables. On a également honoré celui qui, ne pouvant délivrer les hommes de certaines calamités, leur a enseigné le moyen de les adoucir. Mais le principe ou la cause de cet honneur a été, non l’amour de la douleur, mais l’aversion qu’on a eue pour elle, ou le penchant que les hommes ont pour le plaisir ; car ils n’estiment pas moins l’individu qui se soumet à des peines pour leur procurer des jouissances, qu’ils n’estiment celui qui s’y soumet pour leur épargner des douleurs.
La même cause qui a rendu estimables les hommes qui ont su mépriser les douleurs physiques, a fait honorer ceux qui ont méprisé les plaisirs de même genre. Ce mépris peut avoir été porté jusqu’à l’excès ; on peut en avoir mal exposé la cause ; mais il a eu un fondement plus solide que l’envie ou la jalousie, auxquelles on l’a attribué.
Nos organes ne peuvent se développer, acquérir et conserver le degré de perfection dont ils sont susceptibles, qu’autant que nous satisfaisons les besoins qui sont dans notre propre nature. Nous ne pouvons pas nous abstenir de satisfaire ces besoins sans qu’il en résulte des souffrances ; et il nous est impossible de les satisfaire, sans que la satisfaction produise des jouissances. Tant qu’un individu se borne à des jouissances de cette nature, tant qu’il ne se donne que les plaisirs qui sont nécessaires à son développement ou à sa conservation, ou qui du moins ne peuvent pas y nuire, il n’est point un objet de blâme, si d’ailleurs il ne nuit à personne. Mais, lorsqu’il veut renouveler ses jouissances sans attendre que les besoins se renouvellent, et réunir, dans le plus court espace de temps possible, les plaisirs que la nature n’a voulu nous donner que par intervalles et en les répandant sur le cours entier de la vie, alors l’antipathie commence. On le méprise ou on le hait, non parce qu’on lui porte envie, mais par la raison qu’on le considère comme un insensé qui se détruit et se rend inutile à ses semblables, ou parce que les plaisirs qu’il se donne sont achetés par le malheur d’autrui.
[I-384]
L’homme est un être borné dans les douleurs qu’il peut supporter, et dans les plaisirs dont il est susceptible : lorsque les souffrances arrivent à un certain degré, il meurt ou devient insensible. Les jouissances produisent sur lui un effet semblable : lorsqu’elles ont un degré d’intensité ou de durée que ne comporte point sa nature, elles le rendent insensible ou le détruisent. En réduisant à un espace de temps très court, toutes les peines ou les souffrances qu’un homme est destiné à éprouver dans le cours d’une longue vie, on lui donnerait probablement la mort. Un homme ne ruinerait pas moins sa constitution, s’il voulait concentrer dans un espace de quelques heures, de quelques jours, ou même d’un petit nombre d’années, toutes les jouissances qu’il pourrait éprouver dans le cours d’une longue vie. L’art de distribuer les plaisirs et les peines, de manière que celles-ci nous affectent le moins, et que ceux-là se prolongent le plus, n’est au fond que l’art de la morale.
Lorsque des jouissances trop vives et trop souvent répétées ont usé les organes, on ne peut leur rendre la sensibilité que par des moyens artificiels et toujours nouveaux. Alors, les besoins n’ont plus de bornes, et les plaisirs d’un individu peuvent exiger le sacrifice du bien-être d’une nation. Un homme que les jouissances physiques ont usé, n’éprouve plus de plaisir à satisfaire les besoins les plus naturels ; il ne peut plus être ému que par les moyens les plus énergiques : pour éprouver quelques sensations, Tibère a besoin des débauches de Caprée, et Néron de l’incendie de Rome.
Cinq circonstances peuvent concourir à déterminer les hommes à concentrer dans l’espace de temps le plus court, le plus de jouissances possible : 1° l’oisiveté d’esprit et de corps, qui fait un besoin continuel de sensations physiques ; 2° le défaut de développement intellectuel, qui ne permet pas de voir les conséquences éloignées des actions auxquelles on se livre ; 3° l’absence d’affections bienveillantes, qui empêche de s’imposer aucune privation dans l’intérêt de ses semblables ; 4° des richesses ou une puissance qui donnent le moyen de se livrer à toutes ses passions, en même temps qu’elles dispensent de toute occupation ; 5° enfin, le danger continuel de perdre la vie ou la fortune, danger qui peut ne pas laisser le temps de profiter des privations auxquelles on se soumet ; il est naturel que celui qui croit n’avoir que quelques moments à vivre, cherche à concentrer dans ce peu de moments tous les plaisirs qu’il pourrait espérer dans le cours ordinaire de la vie.
Presque toutes ces circonstances se sont rencontrées, lorsque les doctrines des stoïciens et celles de certaines sectes religieuses se sont répandues. La multiplication des esclaves avait rendu odieux et vils aux yeux des hommes libres, tous les travaux qui n’avaient pas la domination pour but ou pour résultat : le travail de l’homme sur la nature était exclusivement abandonné à la population asservie. Lorsque les Romains n’eurent plus de nations à combattre, et que la république eût été renversée, il ne resta, pour la classe des maîtres, aucun sujet d’exercice physique ou intellectuel. Les hommes de cette classe ne purent plus sentir leur existence que par une continuité de jouissances physiques : la sensualité fut pour eux une distraction et un besoin.
Il ne faut pas juger de l’intelligence des peuples anciens par celle d’un petit nombre d’hommes extraordinaires qui ont paru à certaines époques, dans un temps surtout où l’imprimerie ne donnait point aux nations les moyens de s’instruire. Si l’on excepte les connaissances relatives à l’art de la guerre, il ne pouvait exister une nation plus ignorante ou plus superstitieuse que la population romaine, même dans les temps les plus florissants de la république. Un savant écrivain, qui avait fait une étude particulière des mœurs des peuples anciens et des mœurs des sauvages, a été frappé de l’analogie qui existe entre le tableau des mœurs romaines et celui des murs iroquoises [83]. Il est impossible, en effet, de passer de la lecture des anciens historiens à l’étude des voyages qui ont été faits dans l’intérieur des forêts américaines, sans être frappé de cette ressemblance.
L’absence d’affections bienveillantes était dans la même proportion que le défaut de développement intellectuel, et elle était produite en grande partie par les mêmes causes. Toutes les passions haineuses avaient un degré d’énergie inconnu parmi nous. La cruauté, la vengeance, et surtout la perfidie, étaient des caractères distinctifs des peuples de ce temps. Ce caractère ne se manifestait pas seulement à l’égard des nations étrangères ; il était le même à l’égard des étrangers et des citoyens. Le mot vertu n’a jamais signifié, chez les Romains, que le courage militaire [84].
Plusieurs siècles de guerres et de pillage, avaient concentré dans Rome toutes les richesses du monde civilisé ; mais ces richesses étaient réparties d’une manière fort inégale. Les généraux, les magistrats, les gouverneurs des provinces, avaient des fortunes immenses. La masse de la population était plongée dans une affreuse misère, et n’avait aucun moyen d’en sortir ; car les métiers, les arts, le commerce, étaient exercés au profit des grands par leurs esclaves [85].
Des richesses immenses, toutes acquises par le pillage et par l’oppression, et un mépris excessif pour tous les genres de travaux utiles, inspiraient aux Romains, pour les jouissances physiques, une passion qui allait jusqu’à la fureur ; et cette passion était encore augmentée par les dangers de la guerre et par la crainte de la proscription. S’il est vrai, comme on le dit, que Néron désira que le peuple romain n’eût qu’une tête, pour pouvoir le détruire d’un seul coup, on serait tenté de croire que les grands désiraient de concentrer, dans une seule jouissance, tous les plaisirs que pouvaient donner une immense fortune et une longue vie, afin de ne pas rester exposés au danger d’en perdre un seul.
La satiété des plaisirs innocents leur faisait chercher des jouissances féroces. Les femmes, après avoir éteint tout sentiment de pudeur, allaient chercher au cirque des émotions plus vives, et se plaisaient à voir couler le sang des gladiateurs. Les repas publics avaient lieu au milieu des proscriptions ; et, pour rendre les sensations plus fortes, on portait sur les tables les têtes des proscrits [86]. Dans des festins auxquels présidait la débauche, des consuls, pour donner à des favoris un spectacle agréable, faisaient trancher la tête à des esclaves [87]. Enfin, jusque dans les conspirations, ils mêlaient la cruauté aux jouissances ; ils immolaient des victimes humaines ; ils en buvaient le sang ; ils en dévoraient la chair [88].
En voyant l’état d’abrutissement et de férocité auquel l’abus des jouissances physiques avait amené les grands de l’empire, faut-il s’étonner que les stoïciens aient tenté de mettre un frein aux jouissances de cette nature ? Faut-il être surpris qu’ils aient quelquefois dépassé le but ? Pour ramener les hautes classes à des plaisirs innocents et simples, il eût fallu un pouvoir qui n’appartenait alors à aucun homme. Lorsque les stoïciens ont condamné les plaisirs physiques, ils n’ont généralement entendu que les plaisirs funestes ; lorsqu’ils ont manifesté du mépris pour les richesses, ils n’ont voulu désigner que les richesses mal acquises.
« Amasse du bien, me dit-on, afin que nous en ayons aussi. Si je puis en avoir en conservant la pudeur, la modestie, la fidélité, la magnanimité, montrez-moi, disait Épictète, le chemin qu’il faut prendre pour devenir riche, et je le serai ; mais si vous voulez que je perde mes véritables biens, afin que vous en acquériez de faux, voyez vous-même combien vous tenez la balance inégale [89]. »
Les mêmes causes qui ont fait condamner l’abus des plaisirs physiques par les philosophes de l’antiquité, les ont fait condamner aussi par les religions diverses ; mais il n’est pas plus en la puissance d’une religion quelconque de rendre l’homme insensible au plaisir, que de le rendre insensible à la douleur ; et ce serait une contradiction d’imposer des devoirs aux hommes les uns envers les autres, et de vouloir en même temps qu’ils ne fussent pas heureux.
Loin que les stoïciens aient pensé que, par elles-mêmes, les peines physiques étaient désirables, et que les jouissances devaient toujours être évitées, ils ont pensé, au contraire, que l’homme devait repousser les premières, et rechercher les secondes.
Tout animal, selon Zénon, a été recommandé à ses propres soins par la nature ; il a été doué de l’amour de soi-même, afin qu’il pût se conserver, lui et chacune des parties dont il se compose, dans tout l’état de perfection dont elles sont susceptibles.
Dans l’homme, l’amour de soi embrasse son corps et chacun de ses membres, son esprit et les différentes parties dont il se compose, et le désir même de les tenir dans l’état le plus parfait. Tout ce qui tend à conserver ainsi l’homme, lui est indiqué par la nature comme devant être adopté, et tout ce qui tend à le détruire comme devant être repoussé.
Ainsi, la santé, l’agilité, le bien-être du corps, et ce qui peut les procurer ; la richesse, la puissance, les honneurs, l’estime de ceux avec qui nous vivons, nous sont indiqués par notre nature comme devant être recherchés, et la possession doit en être préférée au besoin.
[I-391]
D’un autre côté, la maladie, les infirmités, les peines corporelles et ce qui les fait naître, la pauvreté, le défaut d’autorité, le mépris et la haine de ceux avec qui nous vivons, nous sont indiqués comme devant être évités.
Zénon examine l’importance de chacune de ces choses, et il mesure le degré d’aversion ou d’amour que l’homme leur doit, par la quantité de mal ou de bien qu’elles peuvent produire. La vertu consiste à savoir faire un bon choix, et à le suivre : c’est là ce qu’il nomme vivre selon la nature.
Mais dans ces calculs, il ne faut pas avoir égard seulement aux plaisirs et aux peines d’un seul individu :
« La nature nous a enseigné, dit-il, que la prospérité de deux est préférable à la prospérité d’un seul, et que la prospérité d’un grand nombre est préférable à la prospérité de deux. Ainsi, nous devons préférer le bien-être de notre famille à celui de notre individu, et celui du genre humain à celui de l’État [90]. »
Il n’est donc pas exact de dire que les stoïciens ont condamné les plaisirs en eux-mêmes, et qu’ils ont recommandé les peines, comme étant désirables par leur propre nature ; ils ont fait tout le contraire. Affronter la douleur, ne point tenir à la vie, ne pouvait être un mérite à leurs yeux, que dans le cas où l’on se proposait d’être utile aux hommes ; il n’entrait sans doute pas dans leur esprit, qu’un individu qui bravait la mort pour satisfaire des passions malfaisantes, fût un homme estimable. Le mépris des peines est un vice ou une vertu, selon l’objet qu’on se propose, et le résultat qu’on en obtient : c’est un vice, chez le malfaiteur qui brave les châtiments infligés par la justice ; c’est une vertu, chez le citoyen qui remplit ses devoirs, malgré les menaces et les violences de la tyrannie.
Cette digression sur les stoïciens, et sur les causes qui ont amené leur doctrine, peut nous faire apercevoir aisément comment l’amour des jouissances physiques, et l’aversion des peines de même nature, sont un des principaux éléments de puissance dont les lois se compensent, et comment les lois se modifient, selon que ces passions sont plus ou moins énergiques.
Il est évident, en premier lieu, que si une population qui n’a aucune influence sur sa propre destinée, ou qui est privée de toute liberté politique, se trouve, vis-à-vis de ceux qui la gouvernent, dans la même position où se trouvaient les esclaves d’un maître qui mettait quelque ordre dans l’exploitation de ses domaines, les hommes qu’on désigne sous le nom de gouvernants, se trouvent dans la même position que des possesseurs d’esclaves ; ils n’ont à se livrer à aucun exercice intellectuel ou physique, si ce n’est pour maintenir leur domination.
[I-393]
N’ayant à se livrer à aucun exercice de corps ni d’esprit, et pouvant par conséquent s’abandonner à une oisiveté absolue, ils n’ont la conscience de leur existence, que par une continuité de sensations physiques. La facilité que leur donne leur puissance de satisfaire leurs passions, et l’habitude de s’y livrer en accroissent l’énergie. Tous les hommes qui participent à la puissance, comme auxiliaires ou comme instruments, sont mus par les mêmes besoins. Or, la collection de tous ces besoins, forme, dans plusieurs États, un des principaux éléments de force d’un grand nombre de lois, et particulièrement de celles qui tiennent à l’organisation politique.
Il est évident, d’un autre côté, qu’une population qui n’a ni maîtres, ni esclaves, et qui peut disposer librement de sa destinée, ne peut vivre et se perpétuer que par les produits de son industrie ; et que, par conséquent, elle est obligée d’exercer continuellement ses facultés intellectuelles et ses organes physiques ; elle ne peut donc pas avoir la sensualité qu’on rencontre généralement chez les possesseurs d’hommes. Cependant, si elle ne livre aux hommes qu’elle charge du gouvernement, qu’autant de richesses qu’il en faut pour les indemniser de leurs peines ; si elle s’organise de manière à rester toujours maîtresse d’elle-même, et à mettre les chefs qu’elle a choisis, dans l’impuissance de rien leur ravir, ses lois seront encore, en grande partie, l’expression de ses besoins physiques, ou pour mieux dire ce seront ces besoins qui formeront en partie la puissance dont elles se composeront.
Dans tous les cas possibles, les plaisirs et les peines purement physiques, sont donc au nombre des éléments de force qui constituent une loi ; mais ce ne sont pas toujours les peines et les jouissances des mêmes classes de personnes. Chez les peuples qui sont complètement libres, c’est-à-dire chez lesquels on ne rencontre ni maîtres, ni esclaves, ce sont les besoins physiques de la masse de la population, qui forment la plus grande partie des puissances auxquelles on donne le nom de lois. Chez les peuples qui sont possédés par des maîtres, sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, ce sont les passions ou les besoins physiques des possesseurs et de leurs instruments, qui forment un des principaux éléments des mêmes puissances, et particulièrement de celles qu’on désigne sous le nom de lois politiques.
[I-395]
CHAPITRE VI.↩
Des peines et des plaisirs moraux considérés comme éléments de la puissance des lois.
Les lois sont des puissances composées de divers éléments de force ; mais, dans toutes, ces éléments ne sont pas de même nature, et n’existent pas dans la même proportion. La loi ou la puissance qui détermine les pères à nourrir et à élever leurs enfants, n’est pas composée des mêmes éléments de force qu’une loi en vertu de laquelle on enrégimente ces enfants pour en faire des instruments d’oppression ou de pillage. Une loi en vertu de laquelle on enlève à la partie laborieuse de la population, le tiers ou la moitié de ses moyens d’existence, n’est pas composée des mêmes éléments de force qu’une loi qui met les propriétés de chacun à l’abri du vol. Une loi qui repousse des frontières d’un État les marchandises étrangères, n’est pas composée des mêmes éléments de puissance qu’une loi qui garantit à chacun la disposition des produits de son industrie. Les principaux éléments de force de quelques-unes de ces lois, se trouvent dans la masse entière de la population, et sont inhérents à la nature de l’homme. Les principaux éléments de force des autres se trouvent chez les hommes qui sont en possession du pouvoir.
On a vu, dans les diverses révolutions que la France a éprouvées, des moments où un gouvernement avait perdu toute sa puissance, avant qu’un autre l’eût remplacé. Dans ces courts intervalles, les femmes restaient unies à leurs maris, les enfants obéissaient à leurs pères, les pères nourrissaient leurs enfants, les ouvriers travaillaient pour les maîtres, les maîtres payaient les ouvriers, en un mot, toutes les opérations nécessaires à l’existence d’un peuple, continuaient à s’exécuter. Pourquoi ? Par la raison que les principaux éléments de force des lois sociales, existaient dans le sein même de la population ; ils existaient dans ses besoins, dans ses affections, dans ses jugements ou dans ses idées.
Mais si, dans le nombre des lois établies, il s’en trouvait quelques-unes dont les principaux éléments de force n’existassent que dans les besoins, dans les passions ou dans les préjugés de la partie gouvernante du peuple, celles-là étaient suspendues ou détruites aussitôt que les éléments de force dont elles se composaient, étaient dispersés. Si elles avaient pour objet d’empêcher les hommes de manifester publiquement certaines opinions, d’arborer certains signes, d’invoquer certains noms, d’abandonner certains drapeaux, de reparaître dans certains lieux, chacun pouvait librement faire ce qu’elles avaient empêché jusque-là : les peines les plus sévères qu’elles avaient prononcées, restaient inefficaces, et nul ne songeait même à en demander l’application.
Les lois, quelle que soit la partie de la population dans laquelle résident les principaux éléments de force dont elles se composent, ne peuvent se trouver que dans les besoins physiques, dans les affections morales, ou dans les opinions de la partie de la population qui gouverne, ou de celle qui est assujettie. Dans le chapitre précédent, j’ai exposé comment la passion ou l’amour des jouissances physiques, et l’aversion des peines de même nature, sont au nombre des éléments de force qui constituent les lois. Je dois exposer maintenant comment les affections morales forment une autre partie de la même puissance, et comment les lois varient en même temps que ces affections.
On observe qu’en général, à mesure que la passion des jouissances physiques se développe, les affections généreuses se restreignent, et qu’au contraire les personnes qui sont les plus sévères pour elles-mêmes, sont celles dont les affections bienveillantes embarrassent une plus grande partie du genre humain. Les stoïciens, qui se faisaient une gloire de mépriser les plaisirs sensuels et de s’exercer à la douleur, sont les premiers qui ont proclamé qu’il fallait préférer le bonheur d’une famille à celui d’un individu, le bonheur d’une nation à celui d’une famille, et le bien-être du genre humain au bien-être d’une nation. Les tyrans les plus féroces ont été des hommes adonnés aux plaisirs des sens ; et leur cruauté a suivi, dans son accroissement, la même progression que leur sensualité. S’ils avaient fait une théorie de morale, ils auraient renversé la doctrine des stoïciens : ils auraient préféré leur nation au genre humain, leur famille à leur nation, et leur individu à tout le reste. Les seuls empereurs dont Rome ait pu s’honorer, Marc-Aurèle, Antonin, Julien, ont été des hommes austères. Les mêmes causes qui concourent à développer la passion des jouissances physiques, concourent donc à restreindre les affections bienveillantes, et à étendre ou à fortifier les passions contraires. D’où il suit que plus un peuple donne à ceux qui dominent sur lui, le moyen de se procurer, sans travail, des jouissances physiques, et plus il peut être assuré qu’ils seront pour lui sans pitié.
Soit que les hommes qui gouvernent, aient été élus par la majorité d’un peuple, soit qu’ils tiennent leur pouvoir de leurs prédécesseurs, on trouve dans les dispositions des lois dont ils font la principale force, l’expression de la plupart de leurs affections morales. S’ils sont généreux, confiants, les dispositions des lois portent l’empreinte de leur confiance et de leur générosité : elles laissent à chacun la liberté de ses opinions et de ses actions, en tout ce qui ne nuit point à autrui, et n’infligent de peines qu’autant qu’elles sont nécessaires pour réprimer des actions malfaisantes. S’ils sont timides, soupçonneux, vindicatifs, on trouve, dans les dispositions des lois, l’expression de leurs craintes, de leurs soupçons, de leur vengeance : elles préviennent ou répriment la manifestation des pensées, étouffent la publicité, tiennent les citoyens dans un état d’isolement, assurent aux hommes du pouvoir le moyen d’atteindre et de frapper ceux qu’ils supposent leurs ennemis. Enfin, s’ils sont crédules, superstitieux, on trouve, dans les dispositions des lois, l’expression de leur superstition et de leur crédulité.
Il n’est, en un mot, aucune passion qui, lorsqu’elle domine chez les hommes investis de l’autorité publique, ne finisse par se manifester dans les dispositions de lois : l’ambition ou la passion des conquêtes se manifeste dans les lois sur le service militaire, et sur l’organisation sociale ; l’orgueil, dans les lois sur les titres et la distinction des rangs ; la vanité, dans les lois sur les livrées des valets de toutes les classes. Ces diverses passions peuvent se rencontrer, et elles se rencontrent même souvent, dans les hommes sortis des classes les plus humbles, aussi bien que dans les hommes qui sont nés au faîte du pouvoir. Il ne faut ni s’étonner ni se plaindre de ce que les choses sont ainsi ; les hommes ne peuvent agir autrement qu’ils ne sentent, et ils seraient destitués de tout principe d’action, s’ils n’en trouvaient pas un dans leurs besoins, dans leurs affections ou dans leurs jugements.
[I-400]
J’ai cité des passions malfaisantes, comme étant au nombre des éléments de force dont une loi se compose ; mais ce cas, qui n’est pas rare, n’est cependant pas le plus commun, chez les peuples civilisés. Il est une multitude de lois qui tirent leur principale force d’affections bienfaisantes, telles sont celles qui déterminent les rapports entre les membres des familles, qui règlent la transmission des biens, qui assurent l’exécution des contrats, qui garantissent les propriétés, qui maintiennent la tranquillité publique, et un grand nombre d’autres.
La plupart des affections morales étant au nombre des éléments de force dont les lois se composent, il ne faut pas être surpris si les lois varient avec les passions. Il fut un temps, par exemple, où la population se divisait, en France, en deux fractions également fanatiques : la passion dominante des plus forts, était la loi, et cette loi commandait la proscription des plus faibles. Le refroidissement du fanatisme a produit la liberté des cultes, mais si la même passion reprenait son ancienne énergie, et si elle était également répandue, elle se convertirait en loi, et amènerait les mêmes résultats.
L’impuissance de satisfaire une passion, quelle qu’en soit la nature, est une peine ; la satisfaction d’une passion, quelle qu’elle soit, est une jouissance. C’est donc comme peines et comme plaisirs, que les passions sont au nombre des éléments dont se forme la puissance des lois. Mais ces plaisirs et ces peines ne sont pas toujours suivis des mêmes résultats. L’homme qui satisfait la passion de la pitié, en secourant un malheureux, se donne un plaisir ; celui qui se venge de son ennemi, s’en donne un autre. Mais les deux actions ont des conséquences immédiates ou éloignées fort différentes, soit pour l’individu qui les exécute, soit pour ceux qui en sont l’objet. J’exposerai plus loin en quoi ces conséquences diffèrent, et comment elles influent sur le jugement que nous portons de la cause qui les produit.
Si j’avais à exposer ici quelle est la portion de force que donne à chaque loi, chacune des passions dont l’homme est susceptible, il faudrait écrire un ouvrage qui aurait un grand nombre de volumes. Il ne faudrait pas un ouvrage moins considérable, si l’on voulait exposer comment certaines lois varient avec les passions des hommes qui sont investis de l’autorité publique. Pour être convaincu que les passions des hommes qui gouvernent sont un des principaux éléments dont se composent certaines lois, il suffit de comparer les changements qui s’opèrent dans ces hommes à ceux qui s’opèrent dans les lois. Depuis le commencement de la Révolution française jusqu’à ce jour, nous avons vu passer le pouvoir dans des hommes agités par des passions diverses et souvent opposées. Nous avons vu successivement l’assemblée constituante, l’assemblée législative, le directoire, l’empire, et la restauration. Chacune de ces époques a été marquée par des lois particulières, et nous pourrions trouver, dans la plupart de ces lois, les affections diverses qui ont agité les hommes dont l’influence était la plus étendue.
Les passions des hommes dans lesquels réside l’autorité, sont quelquefois contrariées par les passions d’une partie de la population. Alors, les premières se manifestent avec plus ou moins d’énergie, elles passent plus ou moins dans les dispositions des lois, selon que les secondes opposent plus ou moins de résistance. Il est des hommes qui ont fait consister tout le talent de gouverner, dans l’art de vaincre cette résistance, soit en divisant les citoyens, soit en leur ravissant l’élection de tous leurs magistrats, soit en les privant de la faculté de manifester leurs opinions. Lorsque les affections ou les sentiments populaires sont ainsi individualisés, les affections des hommes qui gouvernent, et de ceux qui leur servent d’instruments, prennent aussitôt le caractère de lois, et règnent sans obstacle.
Lorsque j’exposerai l’état des peuples à divers degrés de civilisation, on verra comment leurs lois ont varié avec leurs passions : il me suffit d’avoir fait observer ici que, quel que soit l’état auquel un peuple est arrivé, les affections morales qu’il éprouve, qu’elles soient agréables ou douloureuses, forment un des principaux éléments de puissance de ses lois, et que l’action qui est exercée sur lui, peut l’atteindre dans ces affections, aussi bien que dans ses organes physiques.
[I-404]
CHAPITRE VII.↩
Des opinions ou des idées des diverses classes de la population, considérées comme éléments de la puissance des lois.
Ayant exposé comment les affections physiques et morales des diverses classes de la population sont au nombre des éléments des puissances auxquelles nous donnons les noms de lois, peut-être quelques personnes trouveront-elles qu’il n’était pas nécessaire de parler de la puissance des opinions ou des idées. Il est possible, en effet, que nos opinions n’agissent sur nous, ou ne nous déterminent à agir sur les autres, qu’en réveillant quelqu’une de nos passions, en nous inspirant des craintes ou des espérances, en excitant des sentiments de sympathie ou d’antipathie. Ceux qui croiraient que les hommes ne peuvent être mus que par leurs affections physiques ou morales, et qu’il est impossible de les affecter en bien ou en mal, autrement que dans leurs organes physiques ou dans leurs sentiments moraux, peuvent considérer ce chapitre comme une suite des précédents.
Les jurisconsultes et les écrivains politiques sont, en général, disposés à considérer les opinions et les pensées des hommes qui gouvernent, comme un des principaux éléments des lois, et presque comme le seul ; quand ils ont exposé ce qu’ils appellent la pensée ou l’esprit du législateur, ils croient n’avoir plus rien à dire. Les hommes qui sont investis de l’autorité publique ne trouvent pas mauvais que l’on considère les lois comme l’expression de leur pensée ou de celle de leurs prédécesseurs. Ils sont flattés, au contraire, de cette manière de juger, parce qu’elle est une preuve de leur puissance. Est-il une plus belle prérogative que celle d’imprimer aux nations telle direction que l’on veut, par la seule force de sa pensée ? Enfin, les nations elles-mêmes se plaisent à croire qu’elles n’obéissent qu’à une puissance intellectuelle et invisible : cette manière de considérer la puissance, leur donne un air de liberté, qui peut tenir lieu de la réalité. J’ai donc peu à craindre d’être contredit, si je dis que les opinions ou les pensées, soit des hommes qui gouvernent, soit des autres classes de la population, sont un des éléments dont la loi se compose.
Pourquoi les philosophes, les peuples et les gouvernements se plaisent-ils à considérer les dispositions des lois comme l’expression de la pensée de tels ou tels hommes, plutôt que comme l’expression de leurs besoins physiques, ou de leurs affections morales ? Si l’on dit que telle disposition de la loi a été l’expression de la pensée de tel prince, de Claude ou de Néron, par exemple, nul ne trouvera cette manière de s’exprimer injuste ou offensante. Mais si l’on disait qu’elle a été l’expression de sa sensualité, de son appétit, de son luxe, de son orgueil, de ses craintes ou de son mépris pour le genre humain, on blesserait une multitude de vanités et de préjugés. Une pensée paraît une autorité neutre et en quelque sorte impartiale ; un besoin ou une passion sont des puissances actives et partiales, qui portent toujours avec elles des idées de plaisirs ou de peines.
Un peuple pourra ne pas être offensé qu’on lui démontre qu’une partie des dispositions de ses lois, celles qui tiennent à l’organisation politique, par exemple, ont été conçues par des esprits faux. Mais on blessera singulièrement son amour-propre, si on lui fait voir que les principaux éléments de force dont ces lois se composent, se trouvent dans les besoins et dans les passions de la classe d’hommes qui domine sur toutes les autres : si on lui démontre que les éléments de telle puissance, à laquelle il donne le nom de loi, se trouvent dans la faim, la soif, la luxure, la paresse, le luxe, la vanité, l’orgueil, la haine, la crainte de telle ou telle classe d’individus. Ces individus, qui n’auraient pas trouvé mauvais qu’on présentât les lois comme l’expression de leurs pensées, seraient fâchés, à leur tour, qu’on y vit l’expression de leurs besoins ou de leurs passions ; les hommes même les plus sensuels veulent passer pour platonistes, aussitôt qu’ils sont en possession du pouvoir ; ils veulent qu’on s’imagine qu’ils ne sont gouvernés et ne gouvernent que par leurs idées et par celles de leurs agents, Soumettant à l’esprit la partie animale, Dont l’appétit grossier aux bêtes nous ravale.
Les peuples qui ont sur leurs lois politiques la plus grande influence, ne se laissent pas moins diriger par leurs besoins physiques et par leurs passions, que les gouvernements les plus impopulaires. La principale différence qui existe entre les uns et les autres, c’est que, dans un cas, les besoins physiques et les affections de tous, deviennent un des principaux éléments des lois, tandis que, dans l’autre, ce sont les besoins et les passions d’un petit nombre. Les peuples cependant ne tiennent pas moins que les gouvernements absolus, à ne voir, dans les dispositions de leurs lois, que l’expression de leurs pensées. Ne pouvant se dissimuler qu’ils ont des besoins et des passions, il semble qu’ils voudraient se dissimuler du moins que ces besoins et ces passions sont des puissances auxquelles ils obéissent.
En exposant ce phénomène, c’est un fait que je fais observer, et non une critique à laquelle je me livre ; ce fait est dans la nature de l’homme, et par conséquent il est indestructible. En disant d’ailleurs que les besoins physiques et les affections de telle ou telle classe de la population, sont au nombre des éléments de puissance dont les lois se composent, je ne prétends pas dire que ces affections ou ces besoins sont malfaisants par leur propre nature. Il est des affections bienveillantes, comme il en est de malveillantes, et les premières ont quelquefois plus d’énergie que les secondes. Il ne peut donc pas être question d’empêcher que les unes et les autres forment un des éléments de la puissance des lois ; tout ce qu’on peut se proposer, c’est de faire que les unes dominent à l’exclusion des autres.
Mais comment les idées ou les opinions forment-elles une partie de la puissance des lois ? Par l’influence qu’elles exercent sur la nature et la force des affections, sur l’étendue des besoins, et sur les moyens de les satisfaire. J’ai fait voir précédemment comment, en soumettant à l’observation, la nature, les causes et les conséquences des habitudes et des actions humaines, on parvient à modifier les unes et les autres ; et il est évident que cette modification ne s’opère que par celle qui a lieu dans les opinions et les jugements.
Lorsqu’une loi s’établit, les éléments de force dont elle se compose se trouvent dans les idées, les besoins, les affections de la partie de la population qui est alors la plus influente. Il semble donc qu’elle devrait s’affaiblir et s’éteindre à mesure que les hommes qui ont eu ces idées, ces besoins ou ces affections, disparaissent. C’est en effet ce qui arriverait si ces hommes n’étaient pas remplacés par d’autres ayant exactement les mêmes besoins, les mêmes sentiments, les mêmes idées : les éléments dont les lois se composent, n’ont une force réelle qu’autant qu’ils sont vivants.
On a dit quelquefois qu’il ne faut voir que les institutions, et ne tenir aucun compte des individus : on aurait pu dire avec autant de vérité, qu’il ne faut tenir compte que des hommes, et ne pas regarder aux institutions. Tout ce qu’on peut attendre des institutions, c’est d’amener à la tête d’un gouvernement telle classe d’hommes, de préférence à telle autre. Mais, en définitive, ce sont toujours les passions, les besoins, les idées de telle ou telle classe qui dominent, et qui forment une partie des lois. Il n’est pas de combinaison au monde qui pût faire sortir des magistrats intègres et éclairés, du sein d’une population ignorante et barbare : cela est tout aussi impossible, qu’il le serait de faire sortir de l’or d’une boîte où l’on n’aurait enfermé que du plomb.
On peut considérer les idées et les opinions qui existent chez un peuple, dans les hommes les plus influents de la société, et dans les individus qui sont soumises au gouvernement. Lorsqu’on les considère chez les premiers, elles sont une des parties de la loi et forment un des éléments de puissance dont elle est composée ; lorsqu’on les considère chez les seconds, elles sont souvent un des produits de cette puissance. Si donc il arrive que, par suite de quelque révolution, les hommes des derniers rangs se trouvent portés au premier, ce sont en grande partie les mêmes idées qui règnent et qui sont un des éléments des lois.
Je ferai voir ailleurs quelles sont les circonstances diverses qui ont formé les idées des hommes que la naissance, ou les hasards de la fortune ou de la guerre ont rendus maîtres des nations. Il me suffit d’avoir fait observer ici, d’une manière générale, que les idées des diverses classes de la population sont un des principaux éléments dont les lois se composent.
[I-411]
CHAPITRE VIII.↩
Des éléments de puissance dont se composent les lois de la morale ; et de l’influence qu’exerce la connaissance de ces éléments sur les jugements que nous portons des actions et des habitudes humaines.
On a vu précédemment que les conséquences qui résultent de nos actions ou de nos habitudes, se composent d’un mélange de biens et de maux ; que ces biens et ces maux se répandent presque toujours sur un nombre plus ou moins grand de personnes ; qu’ils se manifestent à des intervalles plus ou moins éloignés, et ne se répartissent que d’une manière inégale ; on a vu aussi comment les mœurs et les lois se perfectionnent à mesure que l’on connaît mieux les divers phénomènes qui résultent des institutions et des habitudes humaines.
J’ai à exposer maintenant quelles sont les circonstances sur lesquelles il est nécessaire de porter successivement son attention, si l’on veut avoir une connaissance complète de chacun de ces phénomènes. On verra encore ici comment les jugements des hommes varient à mesure que leurs idées s’étendent, et comment les variations qu’on observe dans leurs opinions, sont toujours le résultat d’un même principe. Afin de rendre cette observation plus frappante, qu’on me permette de prendre pour exemple un fait auquel ne se rattache aucun jugement de louange ou de blâme.
Un homme cueille un fruit inconnu, le porte à sa bouche, et est frappé d’une impression agréable ; cette impression se renouvelle toutes les fois qu’il renouvelle l’action qui l’a produite. Si l’expérience n’a jamais appris à cet homme que la même chose qui produit un plaisir actuel, produit quelquefois un mal éloigné, comment jugera-t-il ce fruit ? Par la sensation immédiate qu’il en aura reçue : il le déclare bon, aussi longtemps qu’aucun phénomène nouveau ne sera venu modifier son jugement. Si ce fruit, quoique agréable au goût, est malfaisant, s’il produit des douleurs de tête ou d’estomac, cela suffira-t-il pour en faire porter un jugement contraire ? Non, si l’on n’aperçoit pas la liaison qui existe entre la douleur et la cause qui l’a produite. Le fruit fût-il mortel, on continuera de le considérer comme salutaire, aussi longtemps qu’on ignorera qu’il donne la mort. Mais aussitôt qu’on le jugera, non seulement par l’effet immédiat, mais encore par les effets éloignés qui en résultent, on en portera un jugement tout différent. Dans le premier cas, on n’avait observé qu’un effet ; dans le second, on en possède deux, le bien présent et le mal à venir ; et comme ils ont l’un et l’autre la même certitude, et que le second surpasse de beaucoup le premier en intensité et en durée, ce sera celui-là qui déterminera le jugement.
[I-413]
Si, au lieu de produire un effet agréable au goût, le fruit produit un effet désagréable, on le déclarera mauvais ; on persistera dans cette opinion, aussi longtemps qu’aucune observation nouvelle n’aura modifié le premier jugement. Mais, si le hasard fait découvrir que ce fruit rend la force à des organes affaiblis, qu’il détruit ou prévient certaines maladies, ou qu’au moyen de certaines précautions, il peut être converti en un aliment agréable et salutaire, on en prendra une opinion toute différente. On ne le jugera pas seulement par la sensation désagréable qu’il produit à l’instant même où l’on en fait usage, on le jugera aussi par les effets avantageux, mais éloignés, qui en sont le résultat. Une première expérience n’avait donné lieu qu’à une observation ; des expériences répétées donneront lieu à un plus grand nombre. Il est donc naturel qu’on arrive à une conclusion différente.
Il pourrait arriver que, dans les deux cas que je viens de supposer, les effets éloignés n’eussent pas toujours la même certitude ; que les effets éloignés du fruit qui flatte le goût, ne fussent pas constants, et ne fussent produits que dans des circonstances particulières ; que les bons effets de celui qui produit d’abord une impression désagréable fussent également incertains, et qu’on n’eût pas le moyen de déterminer les circonstances où ils arrivent. Il est clair que le plus ou moins de certitude des résultats influerait sur le jugement qu’on porterait de la cause : on hésiterait à la déclarer bonne ou mauvaise, aussi longtemps qu’on en trouverait les conséquences incertaines.
Les hommes procèdent, dans l’appréciation des actions ou des habitudes morales, exactement de la même manière que dans l’appréciation d’un objet matériel. Il nous sera facile de nous en convaincre, en examinant successivement les divers phénomènes que produisent les habitudes dites vicieuses, et celles qui sont qualifiées de vertueuses. Pour exposer ces phénomènes, qu’on me permette de prendre un exemple que j’ai déjà donné, parce que c’est un de ceux dont on peut le mieux suivre les conséquences.
Supposons qu’un ouvrier, ayant une femme et des enfants qui subsistent au moyen de son travail, reçoive, le samedi, le prix des six journées de travail de la semaine, et qu’au lieu d’employer la somme qu’il a reçue à l’entretien de sa famille, il aille en dépenser la plus grande partie dans un cabaret. Cette action produira évidemment des plaisirs et des peines : voyons en quoi les uns et les autres consistent.
Elle produira d’abord un plaisir physique pour un seul individu : ce plaisir pourra avoir cinq ou six heures de durée, un peu plus ou un peu moins ; l’intensité qu’il aura, sera en raison de la sensualité de l’individu.
Elle produira, d’un autre côté, des douleurs physiques pour la femme et pour les enfants ; ces douleurs consisteront dans celles qui résultent de la privation d’aliments, de vêtements, de propreté, de chauffage, de remèdes en cas de maladie.
Elle produira, de plus, diverses douleurs morales ; elles résulteront du spectacle réciproque de la misère, de l’idée de l’abandon, des espérances trompées, des craintes de l’avenir, de la perte de la confiance, de l’affaiblissement ou de l’extinction des affections de famille, et du contraste même de leurs souffrances avec les jouissances de celui qui devait être leur appui.
Le nombre des personnes sur lesquelles ces douleurs physiques et morales se répandent, sera égal à celui des membres dont se compose la famille, et des individus qui s’intéressent à elle. La moindre durée qu’elles puissent avoir excédera quinze ou vingt fois la durée des plaisirs que l’intempérance aura produits ; elle pourra être égale à la vie de plusieurs des membres de la famille.
La même action, après avoir produit, pour un seul individu, des jouissances physiques, produira pour lui des douleurs de divers genres : elle l’affectera dans ses facultés intellectuelles, morales et physiques ; elle le privera d’abord des jouissances que donnent les affections de famille ; elle le rendra mécontent de lui, et par conséquent des autres ; si elle se répète, elle éteindra son jugement, le rendra incapable de travail, lui donnera divers genres d’infirmités, et le plongera dans la misère, après lui avoir fait perdre les moyens d’en sortir. L’intensité et la durée de ces maux excédera, de beaucoup, la durée des plaisirs, puisque la passion et les douleurs qu’elle aura enfantées, pourront longtemps survivre aux moyens de satisfaire même les besoins de première nécessité.
Je n’ai pas fait entrer dans ce calcul les avantages qui sont résultés pour le marchand, de la vente de ses denrées. Cela n’était pas nécessaire, puisque si l’ouvrier avait employé la somme qu’il lui a payée, à pourvoir aux besoins de sa famille, cette somme aurait également passé dans les mains de ceux qui auraient fourni les choses nécessaires à la satisfaction de ces besoins ; elle se serait même répandue d’une manière plus égale chez plusieurs classes de la société, et elle eût été par conséquent plus utilement dépensée.
Il résulte de cette comparaison que les douleurs produites par l’intempérance excèdent les plaisirs, par le genre, par le nombre des personnes qu’elles atteignent, par l’intensité et par la durée qu’elles ont. Les plaisirs sont un peu plus immédiats ou un peu plus rapprochés que les peines, et ils ont, par conséquent, un léger degré de certitude de plus ; mais cette différence est si petite, qu’elle est inappréciable.
Si l’on veut se donner la peine de rechercher quelles sont les conséquences des habitudes ou des actions auxquelles les peuples civilisés donnent le nom de vicieuses, on rencontrera partout les mêmes éléments de calcul ; on verra que toutes les fois qu’une action produit sur les organes physiques, sur les affections morales, ou sur les facultés intellectuelles des hommes, une somme de maux plus considérable que celle des biens, cette action est mise au rang des actions vicieuses ou criminelles ; on verra que, pour calculer la somme des uns et la somme des autres, tous les peuples éclairés ont pris en considération l’intensité du bien et du mal produit, le nombre de personnes qui en sont affectées, la durée des jouissances et des peines, leur proximité ou leur éloignement, leur plus ou moins de certitude.
Ainsi, l’on donne le nom de vice à l’habitude qu’a une personne de se livrer à des actions qui produisent immédiatement un plaisir physique, mais qui est suivie de peines morales plus étendues, par la durée, par l’intensité, ou par le nombre des personnes qu’elles affectent. On donne la même qualification à l’habitude de s’exposer à des maux considérables pour obtenir des avantages qui ont moins de certitude ou moins d’étendue ; c’est dans ce sens qu’on dit que la passion du jeu est une passion vicieuse. On donne enfin la même qualification à l’habitude de sacrifier à un individu ou à un petit nombre, les intérêts d’un nombre plus considérable : sous ce rapport, il n’est point de passion plus vicieuse que celle d’un homme qui, pour sa satisfaction personnelle, fait massacrer des milliers d’hommes dans ces boucheries qu’on nomme des batailles, ou qui asservit des populations nombreuses à ses caprices et à ceux de ses courtisans.
Les actions qui produisent immédiatement des jouissances pour les personnes qui s’y livrent, mais qui sont suivies de maux éloignés plus graves, sont donc considérées comme innocentes et même comme honorables, aussi longtemps que la liaison entre ces maux et la cause qui les produit, n’est pas clairement aperçue. Par la même raison, les actions qui causent à ceux qui s’y livrent des peines immédiates et actuelles, et qui produisent des avantages éloignés, mais plus considérables, sont méprisées, aussi longtemps qu’on ne voit pas d’une manière bien distincte comment ces avantages sont des conséquences de ces mêmes actions. Le travail et l’économie sont méprisés chez tous les peuples sauvages ou barbares. Chez ces peuples, les hommes honorent la guerre et la chasse, parce qu’ils voient clairement le profit qu’ils peuvent en retirer, et qu’ils peuvent consommer leur butin ou leur proie aussitôt qu’ils s’en sont emparés. Mais ils laissent les travaux méprisés de l’agriculture aux femmes et aux esclaves, parce que les produits en sont éloignés et incertains, et que leurs champs peuvent être ravagés avant qu’ils en aient recueilli les fruits. Tant que les propriétés mobilières ont été exposées à être la proie des armées étrangères, ou des pillards de l’intérieur, nobles ou autres, gouvernants ou non gouvernants, ces propriétés et ceux qui les produisaient, ont été l’objet du mépris, chez les peuples anciens comme chez les peuples modernes. On a honoré alors le privilège du brigandage, parce qu’il n’y avait d’assurées que les jouissances de ceux qui l’exerçaient ; on n’a accordé quelque respect aux propriétés territoriales, que parce qu’il était moins facile de ravir une terre ou un château, qu’une bourse ou qu’une balle de marchandises. Mais, lorsque les produits du travail et de l’économie ont été assurés, lorsqu’il a été démontré que les jouissances qui pouvaient être acquises par ces moyens, étaient aussi certaines et plus étendues que les peines au moyen desquelles il fallait les acheter, le travail et l’économie sont devenus des vertus, et l’on n’a plus méprisé les personnes qui s’y sont livrées. Les profits du pillage étant devenus incertains, ils ont été moins honorés ; le brigandage est devenu méprisable le jour où les brigands ont commencé à être pendus. Cela nous explique le respect qu’ont encore les peuples pour les conquérants, les usurpateurs et les ministres concussionnaires ; cela nous indique, en même temps, quels sont les seuls moyens propres à avilir les usurpations et les concussions.
Les éléments de calcul qui entrent dans l’appréciation d’une habitude ou d’une action jugée vertueuse, chez une nation civilisée, sont donc exactement les mêmes que ceux qui entrent dans l’appréciation d’une habitude jugée vicieuse ; il n’y a de différence que dans les résultats. Dans le premier cas, la somme des maux excède celle des biens ; dans le second, c’est celle des biens qui excède celle des maux. Pour démontrer cette vérité, je prendrai pour exemple l’habitude de l’économie, et pour rendre le calcul plus facile, je supposerai un homme placé exactement dans les mêmes circonstances que celui dont j’ai précédemment parlé.
L’effet immédiat que produit un acte d’économie est une privation ou une peine. L’intensité de cette peine est en raison de la force de la tentation qu’on éprouve de consommer la chose qu’on met à l’écart. Cette peine a nécessairement la même durée que la tentation, et elle peut s’accroître à mesure que les actes d’économie se multiplient. Mais ces mêmes actes produisent des effets d’un autre genre : examinons en quoi ils consistent.
Un ouvrier actif et intelligent, ayant une femme et des enfants, gagne, je suppose, vingt-cinq francs par semaine. Vingt francs et quelques petits bénéfices que fait sa femme, lui suffisent pour les dépenses de son ménage. Il lui reste donc, toutes les semaines, une somme de cinq francs qu’il peut dépenser au cabaret, au jeu, au spectacle, ou en passant une journée dans l’oisiveté. Au lieu de la dépenser ainsi, il la porte à la caisse d’épargne, et passe la journée du dimanche avec sa famille. La privation qu’il s’impose toutes les semaines est un mal dont l’intensité et la durée égalent, ainsi que je l’ai déjà fait observer, la force et la durée des tentations qu’il éprouve. Ce mal devient cependant de plus en plus faible, par la raison que les désirs s’éteignent par l’habitude d’y résister, toutes les fois que les choses qu’on désire ne sont pas nécessaires à notre existence. Le mal qui résulte de la privation, n’est ressenti que par un individu, et il n’altère ni ses facultés physiques, si ses facultés intellectuelles, ni ses affections morales.
En mettant de côté 5 francs par semaine, notre ouvrier aura porté au bout de l’année 260 francs à la caisse d’épargne. Cette somme, placée à cinq pour cent, produira annuellement un revenu de 13 francs. Au bout de dix ans, et au moyen des intérêts composés, il sera possesseur d’une valeur de 3 250 francs, et de 7 800 francs au bout de vingt ans.
Ce capital, par cela seul qu’il existe, et sans qu’il soit nécessaire d’y toucher, ni même d’en consommer les intérêts, produit plusieurs sortes de biens. Le premier est la sécurité ; celui à qui il appartient, ni les membres de sa famille n’ont plus à craindre qu’une suspension de travail, causée par une maladie ou par d’autres accidents, les réduise à la dernière nécessité. Ce bien de la sécurité commence à être senti à l’instant même où l’ouvrier fait sa première épargne, et il s’accroît à mesure que les valeurs épargnées s’accumulent.
Le second bien est l’accroissement de force qu’il donne aux affections de famille. Un homme qui s’impose des privations pour assurer l’avenir de ses enfants, et de sa femme si elle lui survit, leur est beaucoup plus cher qu’il ne le serait s’il se contentait de pourvoir à leur existence journalière, ayant le moyen de faire davantage. De son coté, il a plus d’affection pour eux, par la raison même qu’il leur fait de plus grands sacrifices : les jouissances qui naissent de ces affections, sont plus pures, parce qu’elles sont dégagées des craintes et des anxiétés inséparables d’une existence précaire.
Le troisième bien est celui de l’espérance : les parents qui, par leurs économies, préparent à leurs enfants un heureux avenir, jouissent d’avance de tous les biens qu’ils doivent posséder un jour ; cette jouissance s’accroît à mesure que l’espérance est plus près de se réaliser.
Le quatrième bien est celui de l’indépendance : un bon ouvrier qui a amassé un petit capital, n’est pas obligé de recevoir la loi de celui qui l’emploie ; il traite, en quelque sorte, avec lui d’égal à égal ; s’il n’est pas satisfait du marché qu’on lui offre, il peut attendre, ou se transporter dans un lieu où le travail est mieux payé.
L’éducation des enfants est le quatrième avantage qui résulte de l’économie. Un ouvrier qui n’a fait aucune épargne n’a aucun moyen d’élever ses enfants ; il est obligé de les laisser dans les derniers rangs de la société. Celui qui a accumulé un petit capital, peut faire entrer les siens dans une classe plus éclairée et plus aisée : il peut les placer d’une manière plus honorable et plus lucrative.
La consommation des revenus du capital accumulé, produira des jouissances de divers genres, non seulement pour celui qui l’aura formé par ses épargnes, et pour les membres de sa famille, mais pour tous ceux qui leur succéderont à l’infini, aussi longtemps que le capital ne sera point détruit.
Je n’ai parlé que des avantages que produit l’économie pour celui qui s’en fait une habitude et pour les membres de sa famille. Mais elle en produit aussi pour d’autres personnes dont je n’ai pas parlé. Il est dans la société une multitude d’individus qui ne peuvent exister et faire exister leurs familles qu’au moyen de leur industrie, et nulle industrie ne peut être exercée sans capital. Faire des épargnes ou créer un capital, c’est donc créer des moyens de mettre en activité l’industrie d’une partie de la population, et par conséquent lui créer des moyens d’existence ; c’est la mettre à même de faire à son tour des économies.
Les effets de l’habitude, dont je viens de faire l’analyse, se composent donc d’un mélange de peines et de jouissances ; mais la somme des dernières excède la somme des premières par la multiplicité des genres, par le nombre des personnes qu’elles affectent, par l’intensité, et surtout par la durée.
Les jouissances excèdent les peines par le nombre des genres ; puisqu’on trouve au nombre des premières des jouissances morales, des jouissances intellectuelles et des jouissances physiques, tandis qu’on ne trouve parmi les secondes que des privations de ce dernier genre. Les jouissances excèdent les peines par le nombre des personnes qu’elles affectent ; celles-ci ne sont éprouvées que par un seul individu ; celles-là se répandent non seulement sur lui, mais sur chacune des personnes de sa famille, et sur beaucoup d’autres membres de la société.
Les jouissances excèdent les peines en intensité ; les seuls plaisirs physiques que peuvent acheter les intérêts du capital cumulé, excèdent ceux qu’on aurait pu se procurer avec les petites sommes dont ce capital a été formé.
Les jouissances excèdent les peines en durée ; celles-ci sont momentanées et ne peuvent pas s’étendre au-delà de la vie d’un individu ; celles-là sont de tous les instants, et peuvent passer aux générations les plus reculées.
Les peines ont un léger degré de certitude de plus que les jouissances, même dans les États les plus civilisés, puisqu’il n’est pas impossible qu’un capital cumulé périsse, quelque soin que prenne le capitaliste de le bien placer ; mais ce risque, qu’il est aisé d’apprécier, se réduit à fort peu de chose dans un pays où la justice est bien administrée.
Les peines sont aussi un peu plus rapprochées que les plaisirs ; mais la distance qui les sépare n’est pas grande, ainsi qu’on a pu le voir dans ce qui précède.
L’économie a donc été mise au rang des vertus, à cause des avantages qui en résultent pour les hommes ; et, si l’on veut rechercher quelles sont les conséquences des autres habitudes que l’on considère comme vertueuses, on verra que partout on a pris pour base de ses opinions, les mêmes éléments de calcul. Toutes les fois que les peuples ont procédé de cette manière, ils ont marché vers leur prospérité ; lorsqu’ils ont suivi un procédé contraire, ils ont marché vers la décadence.
Il est donc aisé de se faire une idée générale des habitudes auxquelles on donne le nom de vertus. On donne ce nom à l’habitude qu’a une personne de s’exposer ou de se soumettre à une peine actuelle, pour éviter des peines éloignées, mais plus graves, ou pour acquérir des avantages plus considérables. On donne le même nom à l’habitude ou à la disposition de se soumettre à des privations ou à des peines individuelles, pour procurer à un nombre plus ou moins grand de personnes, des avantages plus considérables, ou pour les délivrer des maux dont ils sont atteints ou menacés. On évalue la grandeur de la vertu, en comparant les biens obtenus, aux maux au prix desquels on les achète : l’excédent en bien mesure la valeur de la vertu, comme l’excédent en mal mesure le degré de haine que doit inspirer le vice [91].
Toutes les fois que les hommes sont portés à exécuter certaines actions, ou à s’en abstenir par des forces inhérentes à la nature humaine, et sans l’intervention des gouvernements, on donne à ces forces le nom de lois morales, ou plus simplement de morale ; ainsi, blesser les lois de la morale, c’est se livrer à des actions funestes que l’autorité publique ne réprime pas : dans ce sens, il est très vrai de dire qu’il ne suffit pas qu’une chose n’ait pas été défendue par un gouvernement, pour être licite.
Tous les peuples ne s’accordent point pour donner aux mêmes actions des noms semblables : celles que quelques-uns considèrent comme honorables et vertueuses, sont considérées par d’autres comme honteuses ou vicieuses. La raison de cette différence est facile à voir : tous calculent de la même manière ; mais tous n’aperçoivent pas les mêmes biens et les mêmes maux. Un philosophe peut s’exposer aux persécutions les plus violentes pour propager une opinion ; un moine peut se déchirer la peau à coups de fouet, pour obéir aux directions de son confesseur. Chacun d’eux est vertueux à sa manière : le premier ne doute pas que le mal auquel il se soumet, ne soit plus que compensé par les biens que produira, pour le genre humain, l’opinion qu’il publie ; le second n’est pas moins persuadé que les intelligences célestes prennent un plaisir infini à voir un moine qui se fesse, et qu’elles le récompenseront, par des siècles de félicité, du spectacle agréable qu’il leur donne. De part et d’autre, c’est le même calcul de plaisirs et de peines ; quel est celui des deux qui se trompe ? Cette question est étrangère à notre sujet.
Dans l’exposition que je viens de faire, je me suis borné à suivre le procédé qu’a suivi M. Bentham dans ses traités de législation : c’est au moyen de ce procédé qu’il a porté la lumière dans plusieurs branches de cette science ; et ce n’est qu’en le suivant qu’on peut espérer d’avancer.
[I-428]
CHAPITRE IX.↩
Des effets particuliers à chacun des principaux éléments de force dont une loi se compose ; et de l’influence qu’exerce la connaissance de ces effets, sur le jugement des causes qui les produisent.
Une loi, dans le sens le plus général du mot, est une puissance qui se compose de la réunion de plusieurs forces diverses, et qui agit de la même manière, dans tous les cas semblables. Dans ce sens, on peut dire que l’économie est une loi chez une nation éclairée, où la justice est administrée d’une manière impartiale. Les forces dont cette loi se compose, sont, d’une part, tous les avantages qui résultent de cette habitude : ce sont les récompenses attachées à l’observation. Elles sont, d’un autre côté, les privations et les souffrances qui marchent à la suite de la prodigalité : ce sont les châtiments attachés à la violation. Les peines et les récompenses dont le concours forme la loi, sont aussi infaillibles dans ce cas, qu’elles puissent l’être dans aucun. Elles se distribuent sur tous les membres de la société, sans distinction de rang ni de naissance, d’ignorance ni d’instruction. Nul n’a à craindre ni les lenteurs de la chicane, ni la partialité des magistrats : la justice et l’égalité règnent sans opposition et sans obstacle.
Mais, dans le langage usuel, on ne donne pas au mot loi un sens aussi général ; c’est bien une réunion de forces analogues à celles dont je viens de parler, et dont le concours tend à former nos habitudes ; mais, pour que ces forces prennent le nom de loi, dans le sens qu’on donne ordinairement à ce mot, il faut que d’autres forces viennent s’y joindre : ce sont celles qui résultent de l’action régulière du gouvernement, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu. Ainsi, les mêmes forces dont la réunion forme nos habitudes morales, deviennent une partie de la loi, toutes les fois que le gouvernement lui prête son appui ; l’économie, par exemple, serait une loi dans le sens vulgaire de ce mot, si la force de l’autorité publique était employée à obliger les citoyens à faire des épargnes ; la prodigalité serait une loi, si la même force était employée à rendre plus actives les causes qui agissent en faveur de cette habitude.
Il résulte de là que les éléments de calcul qui entrent dans l’appréciation d’une loi, ne peuvent pas être différents de ceux qui entrent dans l’appréciation d’une habitude ou d’une action : ce sont exactement les mêmes phénomènes à considérer, plus ceux qui résultent de l’application de la force de l’autorité publique. Supposons, par exemple, qu’un gouvernement fasse un devoir de l’économie ; qu’il ordonne que tout individu jouissant de telle fortune, sera obligé de prélever annuellement sur ses revenus une telle somme, et de la déposer dans une caisse d’épargne : il est clair que, pour apprécier cette loi, on n’aura qu’à prendre tous les éléments qui entrent dans l’appréciation de l’habitude de l’économie, et à y ajouter les biens et les maux qui résultent de l’emploi de la force publique. Le calcul serait encore plus simple, si l’on mettait de côté les plaisirs et les peines qui sont le résultat naturel de l’habitude, et si l’on calculait séparément la somme de biens et de maux qui résultent exclusivement de l’application des forces dont le gouvernement dispose. Ces deux procédés doivent évidemment conduire au même résultat ; le dernier est cependant le plus simple et le plus sûr.
Les forces diverses dont la réunion forme la puissance à laquelle nous donnons le nom de loi, peuvent ne pas produire toutes une quantité égale de biens et de maux ; les unes peuvent produire un peu plus de bien, les autres un peu plus de mal. Nous avons vu, par exemple, quels sont les résultats naturels de l’économie, lorsque aucune force artificielle ne les dérange ; les plaisirs excèdent les peines dans une proportion immense. Supposons qu’ils soient comme vingt est à cinq, le bénéfice sera de quinze ; si le gouvernement vient ajouter ses forces à celles qui tendent naturellement à former la même habitude, le bien que produira cet accroissement de force, pourra n’être que de deux, tandis que le mal pourra être de douze ; la perte sera alors de dix, et les quinze qu’on avait de bénéfice seront réduits à cinq. Cependant, si l’on considère comme seule cause agissante la force du gouvernement, si l’on attribue à cette cause tous les biens et tous les maux, on la jugera encore salutaire, puisque les premiers seront aux seconds comme vingt-deux est à dix-sept ; ainsi, l’on attribuera un bénéfice de cinq à une mesure qui, en réalité, produit une perte de dix. Comme cette distinction entre les biens et les maux produits par les intérêts ou par les penchants naturels à l’homme, et les biens et les maux produits par la force publique, à l’aide de laquelle on seconde ou l’on contrarie ces intérêts ou ces penchants, est de la plus haute importance, je vais tâcher de la faire mieux comprendre par un exemple remarquable.
Les lois de tous les peuples de l’Europe font un devoir aux parents de nourrir, d’entretenir, d’élever leurs enfants ; elles punissent l’infanticide de peines très sévères. Ces lois, comme toutes les autres, sont une puissance qui se compose d’une multitude de forces ; et, au nombre de ces forces, nous devons compter celles que le gouvernement emploie à rendre les autres plus efficaces. En considérant les effets généraux que ces lois produisent, on les trouve immenses ; ils se composent d’une multitude de maux et de biens. Les maux consistent dans les peines que les parents sont obligés de se donner pour élever leurs enfants ; les biens consistent dans les jouissances que les uns et les autres éprouvent durant le cours de leur vie. On pourrait même dire, en termes plus généraux, que tous les maux auxquels les hommes sont assujettis, et tous les biens dont ils jouissent, sont les conséquences de ces lois ; puisque, si l’espèce n’était pas conservée, il n’existerait ni bien ni mal pour les individus.
Mais, dans ces deux sommes immenses de biens et de maux, quelle est la part des uns et des autres qu’il faut attribuer à la portion de forces qui est inhérente à la nature humaine, et qui agit indépendamment du gouvernement ? Quelle est la portion qui appartient à l’action directe et immédiate qu’exerce l’autorité publique sur les parents, soit pour les obliger à prendre soin de leurs enfants, soit pour empêcher qu’ils les détruisent ? Les personnes qui s’imaginent que rien ne marche dans la société que par l’impulsion de l’autorité publique, et que l’objet des actes auxquels elles donnent exclusivement le nom de lois, est de réprimer les penchants les plus forts de l’homme, ne douteront pas que la portion de forces qui appartient au gouvernement, ne soit la plus active et la plus puissante. On ne pourrait pas opposer à ces personnes le petit nombre de cas dans lesquels il est nécessaire de recourir à l’action de l’autorité publique, pour obliger les parents à avoir soin de leurs enfants, ou pour réprimer les atteintes qu’ils portent à leur sûreté ou à leur vie ; puisqu’elles répondraient qu’il suffit que l’action de la force publique soit employée dans un seul cas, pour empêcher que ce cas ne se renouvelle. Il faut donc juger de l’influence de cette action, non par ce qui se passe dans les pays où elle est exercée, mais par ce qui a lieu dans les pays où elle n’a pas été admise [92].
En étudiant l’histoire de la législation, on s’aperçoit que les excès commis par des parents sur leurs enfants, ont été les derniers que les gouvernements ont senti le besoin de réprimer. L’action des parents sur leurs enfants n’a pas eu, pendant longtemps, d’autres limites que celles que leur donnaient leurs affections et leurs forces. Non seulement aucune autorité publique ne veille à leur conservation chez les peuples barbares, mais chez des peuples même que nous sommes habitués à considérer comme civilisés, ce n’est que fort tard que les magistrats ont cru nécessaire d’intervenir pour régler les relations qui doivent exister entre les parents et les enfants. Un Romain, du temps de la république, pouvait disposer de ses descendants d’une manière aussi absolue que d’aucune espèce de propriété ; il pouvait les vendre, les donner, les tuer, sans que l’autorité y trouvât à redire. Son pouvoir n’avait pas plus de limites à cet égard que n’en a le pouvoir du barbare Africain, qui vend son fils au trafiquant, non moins barbare, de l’Europe, toutes les fois que celui-ci consent à lui en payer le prix. Nous ne voyons pas cependant que l’abus de ce pouvoir ait été un obstacle à l’accroissement de la république romaine, à la conservation et à la prospérité des familles. Les premières atteintes portées au pouvoir paternel ont été des envahissements du despotisme. Les empereurs se sont substitués aux parents, et les peuples sont loin d’y avoir gagné [93].
En Chine, aucune limite n’est mise par le gouvernement à l’autorité paternelle ; aucun acte n’y réprime l’exposition des enfants, chacun peut abandonner les siens et les laisser périr de misère. Suivant les documents les plus exacts que nous avons sur ce pays, la capitale seule renferme trois millions d’habitants [94], et la population entière de l’empire s’élève à trois cent cinquante-trois millions [95]. Des officiers de police parcourent, tous les matins, les rues de Pékin, pour en enlever les enfants qui ont été exposés pendant la nuit, et comme tous ces enfants sont portés dans le même lieu, pour y être voués à la destruction, rien n’a été plus facile que d’en constater le nombre. À Pékin seulement, ce nombre s’élève, un jour dans l’autre, à vingt-quatre, environ neuf mille dans le cours de l’année. Le nombre de ceux qui sont exposés dans le reste de l’empire, n’est évalué qu’à un nombre égal ; de sorte que les trois millions de la capitale fournissent un nombre pareil à celui que donnent les trois cent cinquante millions qui habitent les provinces [96].
Le nombre des enfants exposés annuellement dans toute la Chine est donc évalué à dix-huit mille. Mais, dans ce nombre, il faut comprendre les enfants morts-nés, ceux qui meurent dans l’accouchement, ceux qui meurent dans les premiers mois de leur naissance et que les parents n’ont pas le moyen ou ne veulent pas se donner la peine de faire enterrer, ceux qui naissent mal conformés, et que les soins des parents ne pourraient pas conserver, ceux, enfin, qui appartiennent à des parents tellement pauvres, qu’ils mourraient de misère peu d’instants après leur naissance, quand même ils ne seraient pas exposés [97]. Il ne faut pas douter que le plus grand nombre des enfants abandonnés ne soit dans un de ces cas : cela ne saurait être autrement dans un pays où les dernières classes de la population vivent dans la plus affreuse misère, dévorant les restes d’animaux putréfiés qui sont jetés à la voierie ou dans les rivières, les chrysalides des vers à soie, les vers et les larves des insectes qu’ils cherchent dans la terre, et jusqu’à la vermine dont ils sont eux-mêmes rongés [98].
Supposons maintenant que le gouvernement chinois, au lieu de laisser aux parents un pouvoir discrétionnaire sur leurs enfants, imite les gouvernements européens ; qu’il déclare que le père et la mère sont tenus de nourrir, d’entretenir, d’élever leurs enfants ; qu’il prononce des peines sévères contre l’exposition ; qu’il établisse même la peine de mort contre l’infanticide ; qu’il emploie la force dont il dispose, à faire mettre à exécution les déclarations qu’il aura faites, les peines qu’il aura créées : quelles seront la somme de bien et la somme de mal qu’il faudra attribuer à l’emploi de son autorité ou de sa force en pareille circonstance ?
Tous les enfants de l’empire chinois seront-ils mieux nourris, mieux vêtus, mieux élevés ? Non assurément ; car la déclaration du gouvernement et la force dont, en cette occasion, il fera usage, n’accroîtront pas d’un grain de blé ou d’un fil de lin, les revenus des parents ; et sans un accroissement de revenu, ils ne sauraient vivre plus à l’aise. En Chine, comme en Europe, le bien-être des enfants est en raison de la fortune, des lumières et des dispositions morales de leurs parents, et non en raison de la surveillance et de la force de l’autorité publique. Quand un enfant manque de vêtements, d’aliments, de médicaments, un père consulte les ressources qu’il possède pour savoir ce qu’il faut faire, mais il s’informe peu de ce que lui prescrivent les ordonnances du prince. Si, en pareille circonstance, il ne fait pas tout ce qu’il peut, il n’est pas possible qu’un magistrat y supplée ; puisqu’il ne peut à chaque instant être juge, ni des ressources du père, ni des besoins des enfants. La déclaration et la force du gouvernement ne saurait donc avoir aucune influence sur le bien-être des enfants que les parents ont résolu de conserver s’ils en ont les moyens. Elles ne sauraient avoir non plus aucune influence sur leur conservation, puisqu’on les conserve sans que le gouvernement s’en mêle.
Les bienfaits de l’autorité publique doivent donc se restreindre aux dix-huit mille environ que les parents exposent annuellement. Mais ces bienfaits sont encore nuls pour ceux qui sont morts avant que de naître, pour ceux qui meurent dans le travail de l’accouchement, pour ceux qui ne naissent pas viables ou qui ne survivent que de peu de jours à leur naissance. En évaluant aux deux tiers le nombre des enfants qui se trouvent dans quelques-uns de ces cas, c’est rester de beaucoup au-dessous de la vérité, puisque, toute proportion gardée, ce nombre serait beaucoup plus grand en Europe ; il reste donc environ six mille individus en faveur desquels la protection du gouvernement puisse être bonne à quelque chose.
Mais il faut encore distraire de ce nombre, ceux dont les parents n’ont pas le moyen de soutenir l’existence ; ordonner, en pareil cas, à des parents de nourrir et d’élever leurs enfants, et ne pas leur en fournir le moyen, c’est donner un ordre inutile ; autant vaudrait ordonner à des malades de se bien porter, ou à des mendiants, auxquels on refuse l’aumône, d’avoir de bons habits, des aliments sains et des logements commodes. La défense de l’exposition, en pareil cas, ne peut pas avoir d’autre effet que de changer de place un lit de mort : l’enfant qui aurait péri sur des haillons devant la porte d’une maison, périra sur des haillons dans l’intérieur. Le nombre de ceux que la misère condamne ainsi à la mort dès leur naissance, doit être fort grand, dans un pays où la population est immense, où la dernière classe est excessivement nombreuse et misérable, et où il n’existe pas d’hôpitaux pour recevoir les enfants dont les mères meurent en couches, ou peu de temps après l’accouchement, et dont les pères n’ont pas le moyen de payer une nourrice. Enfin, il faut distraire du nombre de ceux pour lesquels l’action du gouvernement serait utile, tous ceux qui seraient exposés ou détruits malgré les défenses de l’autorité publique. Ce nombre serait encore assez grand, comparativement au nombre de ceux que les parents voudraient ne pas élever, dans un pays où une population immense est réunie sur un espace très resserré, où la recherche et la découverte des délits serait, par conséquent, très difficile, où les magistrats auraient fort peu d’intérêt à les rechercher, et où la misère et le despotisme affaiblissent beaucoup la crainte des châtiments [99].
Le bienfait résultant de l’action du gouvernement se resserre ainsi dans un nombre excessivement petit, comparativement au nombre total de la population. Pour apprécier ce bienfait, quatre choses sont à considérer : les maux qui sont, pour les enfants, la conséquence de l’exposition, et dont l’autorité publique les délivre ; le nombre probable d’années qu’ils ont à vivre ; les biens et les maux qui seront leur partage dans le cours de la vie ; les peines et les jouissances qui résultent, pour leurs parents, de leur conservation.
Les peines qui sont la suite naturelle de l’exposition, sont purement physiques ; car un enfant naissant ne peut avoir ni prévoyance, ni crainte, ni affection. L’intensité de ces peines ne peut se mesurer que par le degré et par la durée de la sensibilité : s’il est difficile d’évaluer le degré de sensibilité, il est facile, au moins, d’en mesurer la durée. Les Chinois ne paraissent estimer ni l’une ni l’autre très haut :
« L’habitude, dit lord Macartney, semble avoir appris à croire que la vie ne devient vraiment précieuse, et le défaut d’attention pour elle criminel, qu’après qu’elle a duré assez longtemps pour donner à l’âme et aux sentiments le temps de se développer ; mais que l’existence, à son aurore, peut être sacrifiée sans scrupule, encore qu’elle ne soit pas sans répugnance [100]. »
La probabilité de la durée de la vie doit se calculer par la faiblesse de la constitution que les enfants apportent en naissant, et par les maladies qu’ils tiennent de leurs parents. Cette faiblesse et ces maladies doivent être considérables, si l’on en juge par la constitution des auteurs de leurs jours. Chez les classes les plus pauvres, chez les pêcheurs, la misère s’annonce par la maigreur, la pâleur, les maladies scrofuleuses [101]. Des individus si malsains et si faibles ne sauraient donner le jour à des enfants robustes. La probabilité de la durée de la vie doit se calculer, de plus, par l’influence qu’exercent, sur des enfants malsains et mal constitués, les maladies naturelles à l’enfance, des aliments peu abondants, et souvent malfaisants, le défaut d’attention, de propreté et de médicaments. Les disettes ne sont pas rares en Chine, et les premiers individus que de telles calamités emportent, dans tous les pays, sont toujours ceux qui sont les plus faibles, les plus mal constitués et les plus pauvres. La mortalité produite parmi les enfants par cette seule cause, doit être plus grande, dans ce pays, que dans aucun des pays de l’Europe, puisque le nombre des pauvres y est immense, que la mendicité y est inconnue, et que nul secours n’est accordé aux malheureux, si ce n’est par les membres de leurs familles [102].
Les peines et les jouissances des individus qui ne sont pas emportés, dans les premières années de leur enfance, par ces diverses causes de mortalité, peuvent s’évaluer par les plaisirs et par les douleurs qui, dans les grandes villes de l’Europe, sont le partage des classes les plus misérables. Il est permis, au moins, de douter si la somme des jouissances qu’ils éprouvent et qu’ils font éprouver, excède la somme des maux auxquels ils sont assujettis ou qu’ils occasionnent à d’autres, et si, par conséquent, leur existence est un bien ou un mal.
Les peines attachées à la conservation forcée d’un enfant qu’on croit n’avoir pas le moyen ou la force d’élever, sembleraient excéder les plaisirs qui doivent en être la conséquence, si l’on s’en rapportait au jugement des individus sur lesquels l’action du gouvernement est nécessaire. Mais ce serait un mauvais moyen d’appréciation : l’individu sur lequel agit l’autorité publique, peut être effrayé des peines et des difficultés immédiates auxquelles il est obligé de se soumettre, et ne pas apercevoir les jouissances éloignées qui en seront la suite. Les affections de famille, comme les affections de tous les genres, se développent et se fortifient en même temps que les individus qui en sont l’objet ; mais lorsque les peines qu’elles occasionnent, deviennent excessives, et qu’on les croit en même temps infructueuses, elles en diminuent de beaucoup l’intensité et souvent même la durée.
Ainsi, en calculant les avantages que produirait dans un pays tel que la Chine, peuplé de trois cent cinquante-trois millions d’habitants, l’action du gouvernement employée, soit à contraindre les parents à nourrir et élever leurs enfants, soit à réprimer l’exposition et l’infanticide, on trouve que ces avantages seraient sentis tout au plus par quelques centaines d’individus de la classe la plus misérable. Ce bien se réduirait à une simple prolongation d’existence, prolongation qui serait presque toujours accompagnée de plus de maux que de biens. Ce bien ne serait peut-être pas ressenti par un seul individu sur deux cent mille, et il se réduirait à presque rien [103].
Tels sont les avantages que pourrait produire l’action du gouvernement si elle venait se joindre aux divers sentiments qui agissent sur les hommes, et qui les déterminent à veiller à la conservation de leur espèce. Il reste à savoir quelle est la somme de mal au prix de laquelle ce bien serait acheté, et sans laquelle il n’y aurait pas moyen de l’obtenir.
Les codes de tous les peuples de l’Europe déclarent que les pères et les mères sont tenus de nourrir et d’élever leurs enfants, suivant leurs moyens ; mais, dans tous les pays, l’action du gouvernement est complètement nulle aussi longtemps que les enfants ne peuvent, par eux-mêmes, faire aucune réclamation. Il est, je crois, sans exemple qu’un magistrat se soit jamais introduit dans l’intérieur d’une famille, pour examiner si les enfants étaient nourris, logés, vêtus, élevés conformément aux facultés de leurs parents. Les magistrats peuvent rencontrer fort souvent des enfants mal vêtus, et se nourrissant de mauvais aliments ; aucun ne s’est encore avisé de traduire un père ou une mère en justice pour les faire condamner à raccommoder leurs habits, ou à leur donner de meilleur pain. Si donc les déclarations des gouvernements ne font aucun bien, elles ne font non plus aucun mal, et nous sommes à cet égard aussi libres que les Chinois. L’action de l’autorité ne commence que lorsqu’il s’agit de réprimer l’infanticide, la suppression ou la supposition d’état d’enfant légitime ; ainsi, c’est uniquement le mal produit par cette action qu’il s’agit d’évaluer.
Pour faire cette évaluation, supposons que le gouvernement chinois établisse contre l’infanticide et l’exposition des enfants, des peines semblables ou analogues à celles qui existent dans la plupart des États européens. Il faudra d’abord donner à des magistrats la faculté de rechercher et de poursuivre les délits, de faire arrêter les individus qu’ils croient coupables, d’appeler, d’interroger des témoins. Il faudra instituer des procédures, juger les accusés, infliger un châtiment aux condamnés.
Le premier mal qui résultera d’un tel établissement, est une diminution de sécurité pour toutes les personnes qui seront dans le cas d’être accusées, ou seulement soupçonnées. L’intensité et l’étendue de ce mal, sera en raison du plus ou moins de corruption des magistrats, de leur partialité ou de leur ignorance ; en raison de la corruption ou de la partialité des individus capables d’être appelés comme témoins, et enfin, en raison des vices plus ou moins graves de la procédure. Ce mal pourra affecter plus ou moins toute la partie de la population, douée de quelque prévoyance.
Le second mal consistera dans celui qui sera produit par les erreurs, les caprices, l’arbitraire des magistrats ; et les mêmes circonstances qui aggraveront le premier, serviront à rendre le second plus grave. Ce second genre de mal sera senti d’autant plus vivement qu’il tombera sur des individus plus développés ; il se répandra sur leurs parents, sur leurs amis, et pourra même affecter la société entière, s’il s’élève des doutes sur leur culpabilité.
Le troisième genre de mal sera dans les peines souffertes par les accusés qui seront réellement coupables, par les membres de leur famille et par leurs amis ; il se répandra particulièrement sur les enfants et sur les ascendants qui vivront encore.
Le dernier genre de mal consistera dans les peines, les pertes de temps auxquelles seront assujettis les magistrats, les agents judiciaires et les témoins, si leurs fonctions sont gratuites, ou dans les impôts qu’il faudra établir, s’ils reçoivent une indemnité proportionnée aux sacrifices qui leur sont imposés.
Je n’ai point parlé des maux accidentels qu’occasionnent toutes les procédures, tels que parjures, faux témoignages, corruption et prévarication des magistrats, procédures et peines que ces maux rendent nécessaires, et qui sont d’autant plus considérables que la population est plus corrompue.
Ainsi, pour faire l’analyse de la puissance qui veille à la conservation du genre humain, et à laquelle nous donnons le nom de loi, il est nécessaire de décomposer cette puissance, et de considérer séparément les effets bons et mauvais qui résultent de chacune des forces dont elle se compose. Il existe dans l’homme des forces qui le déterminent à nourrir, à élever ses enfants ; ces forces agissent sur les individus de toutes les races, sous toutes les formes de gouvernement, sous toutes les températures ; elles existent en Asie comme en Europe, et partout elles produisent un mélange de biens et de maux ; mais elles n’agissent pas, dans toutes les circonstances, avec une égale énergie ; elles sont quelquefois paralysées par des forces contraires. Si, pour leur donner plus d’énergie, un gouvernement vient y ajouter ses propres forces, il produira sans doute un accroissement de biens et de maux ; mais il n’est pas sûr que la somme des premiers excède celle des derniers ; la somme de ceux-là pourra n’être que de deux, tandis que la somme de ceux-ci sera de dix ; il y aura alors une perte de huit, quoique le résultat général de toutes les forces soit avantageux. Si le gouvernement chinois, par exemple, établissait des peines pour empêcher l’exposition des enfants et réprimer l’infanticide, on peut mettre en doute, sans le calomnier, si la somme de bien qu’il produirait, ne serait pas excédée par la somme de mal qui serait une conséquence inévitable de ses mesures.
J’aurais pu appliquer à d’autres lois ou même à des institutions politiques, les observations que j’ai faites sur la loi qui détermine les parents à prendre soin de leurs enfants, et, dans beaucoup de cas, les résultats auraient été les mêmes. J’ai choisi de préférence un exemple où l’action de l’autorité publique tend à seconder les forces qui portent le genre humain vers sa conservation. On a vu combien est petite, dans ce cas, l’influence de cette action sur la prospérité des peuples ; c’est un grain de sable porté sur les bords de la mer pour en resserrer les limites. Le résultat aurait été bien différent, si j’avais choisi un exemple où les forces de l’autorité tendent à seconder les mauvaises inclinations, et se trouvent en opposition avec les forces qui portent le genre humain vers sa prospérité. On aurait vu alors que les gouvernements, si faibles quand ils veulent faire le bien, possèdent quelquefois une influence immense pour faire le mal. D’où l’on pourrait tirer la conséquence que moins ils se font sentir et plus les peuples prospèrent.
On a vu que, pour juger de la nature et des effets d’une loi, il faut la décomposer, examiner séparément chacune des forces dont elle est formée, et rechercher les conséquences qui sont propres à chacune de ces forces. Ces conséquences ne peuvent être que des biens ou des maux ; la question est de savoir si, dans l’appréciation des uns et des autres, les peuples, quand ils sont éclairés, font entrer les mêmes éléments de calcul que nous avons rencontrés dans l’appréciation de nos actions morales. Pour résoudre cette question, nous n’avons qu’à suivre la méthode que nous avons précédemment employée pour découvrir les éléments qui entrent dans l’appréciation de nos habitudes ; c’est-à-dire que nous devons examiner d’abord les effets d’une loi autrefois jugée bonne, et abandonnée plus tard comme mauvaise, et exposer ensuite les conséquences d’une loi qui se soit établie et affermie à mesure que les peuples sont devenus plus éclairés.
Afin de mieux faire comprendre comment il est nécessaire de décomposer une loi, pour juger des effets qui sont propres à chacun des principaux éléments dont elle est formée, j’ai pris pour exemple le cas où le gouvernement d’un peuple immense n’a pas jugé qu’il fût nécessaire d’ajouter sa force à celle qui porte les parents à élever leurs enfants. Je prendrai maintenant pour exemple un cas où plusieurs gouvernements ont pensé, au contraire, qu’ils devaient seconder, par leur force, une tendance qui porte les peuples vers leur prospérité.
Plusieurs gouvernements anciens et modernes, frappés des avantages de l’économie, et des maux qu’entraîne la prodigalité, ont voulu ajouter les forces qui leur sont propres à celles qui se trouvent dans la nature de l’homme, et qui le dirigent vers la prospérité de son espèce. Ils ont tenté de combattre le penchant qui porte les peuples vers la dissipation et la ruine : ils ont, en conséquence, interdit à certaines classes de la population, des aliments, des vêtements, des logements qu’ils ont jugé trop dispendieux ; ils ont établi ce qu’on a appelé des lois somptuaires.
Nous ne pouvons juger des effets que produisent [I-450] les lois de ce genre, qu’en décomposant, ainsi que nous l’avons fait précédemment, les forces diverses dont elles se composent, et en examinant séparément les conséquences qui appartiennent à chacune de ces forces. La quantité de richesses dont la conservation doit être attribuée aux précautions que prend le gouvernement pour empêcher que les propriétaires ne les consomment, et la quantité de celles que les individus conservent de leur propre mouvement, ne peuvent pas être constatées avec la même exactitude que le nombre des enfants dont la conservation est due à l’action directe du gouvernement, et le nombre de ceux que les parents conservent sans que l’autorité s’en mêle. Il nous est cependant aisé de nous convaincre que la proportion est à peu près la même dans les deux cas.
Plusieurs gouvernements de la Grèce avaient tenté de réprimer les dépenses des particuliers, pour les obliger à conserver leurs richesses. Les Romains suivirent leur exemple, et leurs lois somptuaires existaient encore sur la fin de la république. Ce fut en vertu de ces lois que César défendit à plusieurs classes de citoyens, l’usage des litières, de la pourpre et des perles, qu’il fit saisir dans les marchés et apporter chez lui par ses espions, les denrées prohibées, et qu’il les envoyait même saisir dans le domicile des citoyens par des soldats ou par des licteurs [104].
[I-451]
Presque tous les gouvernements d’Europe ont pris jadis des mesures analogues pour veiller à la conservation des richesses de leurs États. Charles VII avait défendu de servir, dans un repas, plus de deux plats avec le potage. Louis XII défendit l’usage de l’orfèvrerie ; mais il fut obligé de révoquer son ordonnance. François Ier défendit les étoffes d’or et de soie. Sous Henri II, les habits et les souliers de soie furent permis seulement aux évêques, aux princes et aux princesses [105]. Des règlements semblables ont été faits en temps divers par le gouvernement d’Angleterre [106].
Enfin, le gouvernement de la Chine croit encore, de nos jours, que ses soins sont indispensables pour que ses sujets ne dissipent pas leurs richesses en folles dépenses. Il interdit au plus grand nombre d’entre eux, les grands hôtels, les jardins, les voitures, et toute espèce d’éclat et de magnificence extérieure [107].
Quelle est la portion de richesses dont la conservation est due aux avantages qui résultent naturellement de l’économie, et aux maux qui sont la suite naturelle de la dissipation ? Quelle est la portion dont la conservation doit être attribuée aux prohibitions des gouvernements ? En d’autres termes, quels sont les biens qui résultent de l’action des gouvernements, et les maux au prix desquels ces biens sont achetés ?
Au moment où les gouvernements crurent nécessaire de restreindre les dépenses de leurs sujets pour les obliger à conserver leurs biens, il existait sans doute déjà une quantité fort considérable de richesses qu’on avait conservées sans que l’autorité s’en mêlât ; et depuis que ces règlements sont abolis dans toute l’Europe, on n’a pas observé que les peuples soient devenus plus pauvres. Un auteur du quatorzième siècle se plaint déjà des progrès de la dissipation ; il regrette le temps où, à Milan, la bougie était inconnue ; où la chandelle était un luxe ; ou, chez les meilleurs citoyens, on se servait de morceaux de bois sec allumés pour s’éclairer ; où on ne mangeait de la viande chaude que trois fois par semaine ; où les chemises étaient de serge et non de lin ; où la dot des bourgeoises les plus considérables était de cent livres tout au plus.
Le linge de table, dit Voltaire, était alors très rare en Angleterre ; le vin ne s’y vendait que chez les apothicaires, comme un cordial : toutes les maisons des particuliers étaient d’un bois grossier, recouvert d’une espèce de mortier qu’on appelle torchis ; les portes basses et étroites, les fenêtres petites et presque sans jour : se faire traîner en charrette dans les rues de Paris, à peine pavées et couvertes de fange, était un luxe ; et que trois fois ce luxe fut défendu par Philippe-le-Bel aux bourgeoises [108].
Les règlements qui avaient pour objet d’obliger les individus à restreindre leurs dépenses, et de conserver ainsi leurs richesses, sont tombés depuis des siècles dans tous les États de l’Europe. Aujourd’hui, chacun peut jouir et disposer de ses propriétés de la manière la plus absolue ; et la faculté qu’a toute personne parvenue à l’âge de majorité, de dissiper sa fortune en folles dépenses, n’a pas plus ruiné les nations européennes, que la faculté qu’ont les parents chinois d’exposer leurs enfants, n’a dépeuplé la Chine. Les Européens sont aussi jaloux d’accroître et de conserver leur fortune, que les Chinois peuvent l’être de multiplier et de conserver leurs enfants : les uns ne sentent pas plus que les autres les besoins de l’action du gouvernement.
Il n’est pas impossible, cependant, que plusieurs individus ne se ruinent par des profusions ou par des dépenses mal entendues. Les exemples n’en sont pas très nombreux, comparativement à la population de chaque pays ; mais il en existe cependant plusieurs. Supposons donc qu’un gouvernement, pour prévenir les malheurs de ce genre, renouvelle les règlements qui ont existé jadis, et tente de mettre des bornes aux dépenses que font les particuliers. Comme il est possible de se ruiner par une multitude de moyens, il faudra que l’autorité publique détermine quels sont les aliments dont il sera permis de se nourrir, les vêtements dont on pourra se couvrir, les maisons qu’on pourra habiter. Supposons tout cela déterminé, et examinons quels seront les éléments de calcul qui entreront dans l’appréciation de ce règlement [109].
Il ne serait pas plus raisonnable d’attribuer à un tel règlement la conservation de toutes les richesses existantes, qu’il ne serait raisonnable d’attribuer la conservation du genre humain aux peines prononcées contre les individus convaincus d’infanticide. Le bien se restreindrait dans la conservation des richesses qui auraient été follement dépensées si l’autorité publique n’en eût pas empêché la dissipation. La difficulté consiste à évaluer ces richesses, et il est beaucoup plus aisé de dire en quoi elles ne consistent pas, que de déterminer en quoi elles consistent. Le gouvernement ne peut guère exercer son influence que sur les jouissances d’ostentation ; mais, lorsque celles-là deviennent impossibles, on les remplace par des jouissances secrètes, qui ne sont ni moins dispendieuses, ni plus morales ; l’individu qui ne peut pas consommer ses richesses sous une forme, les consomme sous une autre. Les lois somptuaires des Romains n’empêchaient pas qu’un poisson ne se vendît plus cher qu’un bœuf, lorsqu’il se trouva des gens qui eurent le moyen de le payer et envie de l’acheter [110] ; et les Chinois, auxquels il est défendu de consommer leurs richesses en jardins et en voitures, les consomment en plaisirs secrets [111]. La somme de richesses qu’une loi somptuaire est capable de conserver, est donc infiniment petite, si même elle n’est pas nulle. Ce serait l’exagérer beaucoup que de la porter à la millième partie de celle qui se conserve par la seule force des mœurs ou des intérêts personnels. Le bien est donc infiniment petit ; il est, de plus, incertain et en quelque sorte inappréciable ; enfin, il ne se présente que dans l’éloignement, puisqu’il n’est pas ressenti par ceux auxquels l’action du gouvernement est inutile, et que ceux sur lesquels elle s’exerce, n’en éprouvent que des privations.
Les maux, au contraire, se répandent sur la société tout entière ; et ils sont très graves, puisque personne ne peut plus être en sûreté chez lui, et échapper à l’arbitraire des magistrats. Ils consistent dans les inquiétudes inspirées à tous les citoyens ; dans la nécessité d’exposer l’état de leur fortune pour justifier leurs dépenses ; dans les poursuites injustes auxquelles peuvent donner lieu les erreurs, les préventions, la malveillance, la cupidité des magistrats et de leurs agents ; dans les poursuites et dans les peines qui sont appliquées aux accusés, toutes les fois qu’ils ont enfreint les défenses de l’autorité ; dans la création de magistratures nouvelles, et dans les peines et les dépenses qui en sont la suite. Il faut mettre aussi sur le compte du même règlement, la tendance qu’il donne vers les jouissances secrètes, toujours plus susceptibles de devenir vicieuses que celles qui ne peuvent avoir lieu que publiquement.
Ainsi, les maux excèdent les biens dans une proportion immense par le nombre des personnes qu’ils atteignent, par l’intensité, par la certitude, par la proximité, et même par la durée, puisqu’ils agissent d’une manière constante, et que quelques-uns peuvent se faire sentir encore quand la cause qui les a produits a cessé d’exister. Ces règlements ou ces lois ont donc été proscrits comme vicieux, et ils l’ont été par la raison que la somme de mal qu’ils produisaient, excédait la somme de bien qui pouvait en être la suite.
En cherchant à distinguer, parmi les effets d’une loi, ceux qui doivent être attribués à la seule force des mœurs, et ceux qui appartiennent à l’action du gouvernement, j’ai pris à dessein deux exemples où ces forces et cette action tendent vers le même but : la conservation et la prospérité des nations. J’ai été déterminé dans ce choix par deux motifs. Le premier a été de n’avoir pas à m’occuper de l’intention des gouvernements ou de leurs vues secrètes. Le second a été de faire voir que leur action peut quelquefois être funeste, même lorsqu’elle tend à seconder les penchants les plus utiles au genre humain. Cela fera comprendre l’étendue du mal qu’elle peut causer, lorsqu’elle tend à renforcer des inclinations vicieuses ; cela fera voir aussi qu’il est des maux que les gouvernements doivent savoir tolérer, s’ils ne veulent pas en causer de plus graves. Un gouvernement qui voudrait extirper par la force tous les maux, ne serait guère moins oppresseur que celui qui ne voudrait souffrir aucun bien [112].
Il ne nous reste maintenant qu’à examiner quels sont les éléments de calcul qui entrent dans l’appréciation d’un acte de l’autorité jugé utile. Un gouvernement, je suppose, ordonne la perception de tel impôt pour payer les appointements des magistrats chargés de rendre la justice, et des officiers chargés d’assurer l’exécution de leurs jugements, et de veiller au maintien de l’ordre public. Cet acte ou cette loi produira un mal ; elle enlèvera à chaque individu une petite partie de ses revenus. Ce mal aura une intensité proportionnée aux privations que chacun devra s’imposer pour payer sa part de l’impôt. Il se renouvellera toutes les années, et se fera sentir aussi longtemps que ces mêmes privations ; il aura tout le degré de certitude possible ; il suivra de près la formation de la loi. Il atteindra presque tout le monde, puisque chacun devra payer selon l’étendue de ses facultés.
Mais cette loi produira plusieurs genres de bien : elle concourra à garantir à chacun la sûreté de sa personne et de ses propriétés, et la sécurité qui résultera de cette garantie sera un bien infiniment plus grand que le mal au prix duquel il aura été acheté. Si cette sécurité n’existait pas, non seulement toutes les autres jouissances seraient troublées, mais on n’aurait pas même la certitude de voir naître ou de recueillir la petite portion de ses revenus, à l’aide de laquelle on paie ses contributions. Si le bien a infiniment plus d’intensité que le mal, il s’étend aussi sur un plus grand nombre de personnes : ceux qui n’ont aucun moyen de payer l’impôt, et ceux qui n’y sont pas obligés, comme étrangers, n’en jouissent pas moins que les citoyens. Le bien a aussi plus de durée ; on ne songe plus au sacrifice qu’on a fait, lorsqu’on a payé un léger impôt ; mais on jouit de la sécurité à chaque instant de la vie, et même pendant le sommeil. La certitude est égale des deux côtés ; il suffit, pour s’en convaincre, de comparer l’état d’un pays où la justice est mal administrée, à un pays où elle l’est régulièrement. Enfin, le bien est égal au mal en proximité ; il est même quelquefois plus rapproché, puisqu’on suspend quelquefois le paiement de l’impôt, sans cesser de jouir de la sécurité que donne une bonne administration de la justice [113].
Nous trouvons donc ici, dans l’appréciation d’une loi ou d’un acte de gouvernement, les éléments que nous avons rencontrés dans l’appréciation de nos habitudes ou de nos actions : les conséquences qui en résultent, se composent d’un mélange de biens et de maux ; mais les premiers excèdent les seconds par l’intensité, par la durée, et par le nombre des personnes sur lesquelles ils se répandent ; les premiers égalent au moins les seconds en certitude et en proximité.
On voit, par ce qui précède, qu’il est impossible de bien apprécier une loi, si l’on ne considère pas séparément chacun des éléments de force dont elle se compose, et si l’on n’examine pas quels sont les effets propres à chacune de ces forces. Mais aussi, lorsqu’on suit ce procédé, on est étonné du peu de bien que l’action directe et immédiate de l’autorité publique produit, comparativement à celui qui résulte de la puissance des mœurs. Si l’on soumettait à une pareille épreuve la plupart des lois qui existent chez une nation, on serait surpris de la petitesse des résultats qu’on obtient à l’aide d’immenses contributions, d’une multitude d’officiers publics, d’innombrables armées, et de tout ce qui constitue la force matérielle de l’autorité publique ; peut-être arriverait-on à cette conséquence, qu’un peuple déjà civilisé n’a besoin, pour être heureux, que de ne pas être pillé, et d’être abandonné à lui-même. Il ferait mieux par la seule force de ses mœurs, par l’instinct qui le porte vers sa conservation et sa prospérité, que ne peuvent faire nos savants politiques, avec leurs systèmes soutenus par leurs armées et par leurs innombrables agents.
Si nous appliquons maintenant à l’action de l’autorité publique ce que nous avons dit des habitudes privées, et si nous donnons à cette action le nom de loi, il nous sera facile de voir ce qui distingue une loi vicieuse d’une bonne loi : il suffira de transporter ici les définitions qui se trouvent dans le chapitre précédent, et de substituer les mots loi ou institution, au mot habitude.
[I-461]
Ainsi, une loi vicieuse est celle qui produit un avantage immédiat, mais qui est suivie de maux considérables quoique éloignés : telle fut la loi qui établit en Angleterre un impôt en faveur de tous les pauvres indistinctement. Une loi est vicieuse, lorsqu’elle produit des maux certains, pour obtenir des avantages douteux et éloignés ; ou bien lorsqu’elle sacrifie l’intérêt d’un nombre considérable de personnes à l’intérêt d’un nombre moins grand. Enfin, une loi est vicieuse lorsque, pour obtenir un bien passager, elle produit un mal égal en intensité, et plus considérable en durée.
Une loi utile ou avantageuse, est celle dans laquelle on rencontre des circonstances contraires : c’est celle, par exemple, par laquelle un peuple ou un gouvernement se soumet à un mal actuel pour éviter des maux plus graves quoique éloignés, ou pour acquérir des avantages plus considérables ; c’est celle qui, au prix de quelques maux individuels, produit un bien pour la société tout entière ; c’est celle, en un mot, dont les effets en bien surpassent les effets en mal, en donnant à ces mots le sens le plus étendu.
En faisant l’analyse des effets que produisent les habitudes, les actions, les institutions humaines, sur nos facultés physiques, morales, intellectuelles ; en faisant voir quelles sont les causes qui déterminent les peuples dans le jugement qu’ils portent de ces habitudes ou de ces actions, j’ai voulu simplement exposer la manière dont les choses se passent. Si, par exemple, l’économie, la tempérance, la générosité, la probité, la sincérité, produisent, pour le genre humain, une somme de bien infiniment plus considérable que la somme de mal qui en résulte, et si les peuples honorent ces habitudes, toutes les fois qu’ils en aperçoivent les conséquences, ce n’est point parce qu’il a plu à tel ou tel individu de leur en faire un devoir, c’est parce qu’il n’est pas dans leur nature de faire autrement. De même, si la prodigalité, l’intempérance, la vengeance, la perfidie, l’improbité, produisent pour le genre humain une somme de maux plus considérable que la somme de biens qui peut en résulter, et si les peuples qui voient les conséquences de ces habitudes, les flétrissent par des qualifications déshonorantes, ce n’est point parce que les moralistes, les philosophes ou les ministres des diverses religions l’ont ainsi voulu, c’est parce qu’il est dans la nature de l’homme de sentir et de juger de cette manière.
Ainsi, nous pouvons dire, avec les stoïciens, que les hommes les plus vertueux sont ceux qui vivent de la manière la plus conforme aux lois de leur propre nature ; et que ceux, au contraire, qui ont le plus de vices, sont ceux qui violent le plus fréquemment ces lois, et qui en attirent les peines, soit sur eux-mêmes, soit sur les autres.
[I-463]
CHAPITRE X.↩
De la puissance qui appartient à chacun des éléments de force dont une loi se compose ; de l’étendue des lois morales, et des limites posées, par la nature même de l’homme, à l’action des gouvernements.
À chaque instant, nous exécutons des actions utiles, ou nous nous abstenons d’exécuter des actions funestes, sans être excités ou retenus par l’action de l’autorité publique ; nous agissons, ou nous nous abstenons d’agir, par la seule raison que ces actions nous paraissent bonnes ou mauvaises. Nul n’a besoin de nous commander de prendre des aliments quand la faim nous presse ; et, lorsque nous sommes atteints d’une maladie, nous avons recours au médecin, sans attendre l’ordre du magistrat. Toutes les fois que le bien et le mal d’une action ne s’étendent pas au-delà de celui qui l’exécute ou qui s’en abstient, on peut s’en rapporter, pour la conservation de l’espèce, au besoin qu’éprouve chacun de conserver son individu, si d’ailleurs il en a le moyen.
Notre conduite est la même dans beaucoup de cas où elle a, sur le sort des autres hommes, une influence plus ou moins étendue. Un fermier laboure, sème et moissonne son champ, sans que personne lui en ait donné l’ordre ; un manufacturier ouvre ses ateliers, et un marchand ses magasins, sans qu’un commissaire de police les у invite ; un médecin visite et soigne ses malades, sans être conduit auprès d’eux par la gendarmerie. Leur inaction pourrait cependant être funeste à d’autres hommes ; si les fermiers ne cultivaient pas leurs terres, la famine ne tarderait pas à se faire sentir ; si les manufacturiers fermaient leurs ateliers, et les marchands leurs boutiques, des multitudes d’ouvriers mourraient de faim, et nous manquerions des choses les plus nécessaires ; si les médecins refusaient de visiter leurs malades, beaucoup de gens seraient exposés à périr. Comment les peuples n’ont-ils pas redouté des calamités de ce genre ? Les habitants des villes ne doivent-ils pas craindre que, pour leur jouer un mauvais tour, les habitants des campagnes ne laissent leur champ en friche, et ne cessent de porter du blé au marché ? Les habitants des campagnes ne doivent-ils pas craindre, de leur côté, que les habitants des villes ne leur ferment leurs magasins ? Les malades, que les médecins ne se coalisent pour les priver des secours de leur art ?
Nulle part de semblables craintes n’existent, et il n’est pas difficile d’en voir la raison ; c’est que, dans chacun de ces cas, l’action porte avec elle sa récompense, et l’inaction son châtiment. Le bien qui résulte de la culture des terres se répand sans doute sur la société entière ; mais la partie de ce bien la plus immédiate et la plus considérable, est recueillie par le cultivateur. Le mal qui résulterait du défaut de culture, tomberait infailliblement sur tous ; mais la portion la plus considérable de ce mal tomberait d’abord sur le premier qui voudrait laisser ses terres en friche.
Nous pouvons en dire autant du fabricant, du marchand, et même du médecin ; car les malades ne sont pas moins nécessaires à la prospérité des médecins, que les médecins à la guérison des malades. Ainsi, en même temps que chacun sent qu’il ne peut pas se passer des autres, il est convaincu que les autres ne peuvent pas se passer de lui. Il ne craint pas un mal qu’ils ne peuvent lui faire qu’en se faisant à eux-mêmes un mal beaucoup plus considérable. Il se sent protégé contre eux par l’intérêt même de leur conservation et de leur prospérité. Sa sécurité n’exige donc rien de la part du gouvernement ; l’établissement d’une loi pénale serait une addition de mal dans la société, mais ne procurerait aucun bien.
Il est une multitude d’autres circonstances où les hommes n’ont besoin, pour bien agir, que d’être éclairés, et d’être livrés à l’impulsion que leur donnent leurs sentiments ou leurs intérêts. On a vu précédemment que même dans des pays où il existe peu de lumières, beaucoup de misères et beaucoup de vices, les parents soignent et élèvent leurs enfants, sans que l’autorité publique s’en mêle, et qu’on peut même raisonnablement douter si l’action directe de cette autorité, exercée dans la vue de seconder l’affection naturelle des parents, ne produirait pas plus de mal que de bien. On a vu également que les causes qui produisent l’habitude de l’économie, ont suffi pour créer et conserver toutes les richesses que possèdent les nations ; et que les règlements auxquels on a donné le nom de lois somptuaires, n’ont jamais produit que de la gêne et des souffrances : l’action de l’autorité n’a pas été seulement inutile ; elle a été funeste.
Il est beaucoup d’autres cas où l’action du gouvernement paraît très grande, et où cependant elle se réduit à presque rien. Il est des pays où, après avoir décrété que les pères nourriraient et élèveraient leurs enfants, on a décrété aussi qu’ils leur laisseraient leurs biens après leur décès. De là, on peut être porté à conclure que si les enfants succèdent aux pères, c’est principalement parce que c’est ainsi que l’a voulu l’autorité publique. Mais pour savoir à quoi se réduit, à cet égard, l’influence de cette autorité, il faut examiner ce qui se passe dans les pays où les parents jouissent, comme aux États-Unis, de la faculté illimitée de disposer de leurs biens même par acte de dernière volonté ; on verra que, sur cent mille individus, il n’y en a peut-être pas un qui ne laisse ses biens à ses enfants, pouvant les en priver. Si l’on faisait une loi pour empêcher les biens de sortir des familles, l’influence de l’autorité publique, comparée à l’influence qu’exerce l’esprit de conservation, ne serait donc pas dans la proportion de cent mille à un ; et, dans le cas où cette autorité serait exercée, il pourrait encore être douteux s’il est bon qu’elle le soit [114].
Les forces qui dirigent les hommes dans les cas précédents, les dirigent aussi dans la plupart des relations qui existent entre eux. Une multitude de conventions se forment et s’exécutent sans le concours d’aucune force autre que celle des besoins, des intérêts, de la probité des parties contractantes. À chaque instant, on fait des traités ou des conventions qu’on pourrait rompre sans aucune crainte des tribunaux ; on les exécute cependant, parce qu’autrement on ne saurait vivre. Non seulement on les exécute sans que l’autorité publique exerce aucune influence ; mais, dans le plus grand nombre de cas, on les exécuterait quand même elle voudrait s’y opposer. Nous paierions le boulanger qui nous aurait livré du pain, le boucher qui nous aurait livré de la viande, lors même que cela nous serait défendu par elle ; parce que nous tiendrions moins à lui obéir qu’à ne pas manquer de pain et de viande. Si donc les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce n’est point par la raison que tel code l’a dit ; mais tel code l’a dit, parce que cela est, et que cela ne pouvait pas être autrement.
[I-468]
En faisant l’analyse de toutes les bonnes lois qui existent dans un pays, nous trouverions que les actions qu’elles commandent ou qu’elles interdisent, sont commandées ou interdites par les intérêts, les sentiments ou les habitudes d’une partie plus ou moins considérable de la population. Nous arriverions à un résultat semblable, si nous faisions l’analyse des lois vicieuses ; nous trouverions qu’elles sont l’expression des intérêts, des passions, des préjugés de la partie la plus influente de la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’action de l’autorité n’a pas d’autre effet que de généraliser des actions déjà très communes ; de faire exécuter forcément par quelques-uns, ce que d’autres exécutent volontairement et par choix. Si l’autorité publique n’exerçait aucune influence, les mêmes actions seraient donc exécutées ; mais elles le seraient d’une manière moins générale ; un plus grand nombre d’individus adopteraient une autre manière d’agir.
Dans toute loi, il y a donc, ainsi que nous l’avons vu précédemment, des forces de deux espèces : d’un côté, nous comptons les sentiments, les intérêts, les opinions, les préjugés, les habitudes de la population, considérée sous un point de vue général ; nous comptons, d’un autre côté, les forces diverses dont le gouvernement dispose, et les volontés qui leur donnent le mouvement. Pour simplifier le langage, qu’on me permette de donner aux premiers, le nom de forces morales, et aux secondes le nom de forces matérielles. Tout ce qui est réglé par les forces de la première classe, forme les mœurs d’un peuple, ou ses lois morales ; tout ce qui est réglé par les forces réunies de la première et de la seconde classe, forme ses lois civiles. Il résulte de là que le champ de la législation est beaucoup moins étendu que celui de la morale : le premier ne circonscrit que les actions qui sont le produit commun des deux espèces de force ; le second circonscrit ces mêmes actions, plus toutes celles qui arrivent indépendamment de l’autorité publique.
J’ai fait voir, par exemple, que les forces de la première classe, les forces morales, déterminent les parents à nourrir leurs enfants, à les élever, à leur transmettre leurs biens ; qu’elles déterminent les hommes à créer, à multiplier, à conserver leurs richesses ; qu’elles les déterminent aussi à exécuter la plupart de leurs conventions. Si les forces par lesquelles ces effets sont produits, ne cessent pas d’agir même lorsque l’autorité publique les contrarie, il est évident que leur action ne doit pas cesser lorsqu’elle les seconde. L’action des lois morales s’étend donc aussi loin que l’action de l’autorité publique ; mais quoique l’action de l’autorité publique puisse s’étendre fort loin, elle ne peut jamais aller aussi loin que l’action des lois morales : Il est une foule de faits que l’autorité publique n’a aucun moyen de faire exécuter ; il en est un nombre non moins grand qu’elle ne saurait empêcher.
[I-470]
Il ne suffit pas, pour que des faits soient produits par l’action de l’autorité publique, qu’ils soient commandés dans un livre de lois ; il faut de plus que cette action puisse produire chacun de ces faits, dans tous les cas où ils doivent avoir lieu. Des gouvernements ont essayé de régler, par exemple, les rapports qui existent entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. Ils ont dit : la femme doit obéissance à son mari ; le mari doit protection à sa femme ; les enfants doivent respecter leurs parents. La pratique de ces maximes et d’autres semblables peut être le résultat des forces morales ; mais elle ne saurait être une conséquence de l’action exercée par l’autorité publique. Nul ne saurait, en effet, déterminer d’une manière précise, soit les faits individuels qui constituent l’obéissance, la protection ou le respect, soit le moment où chacun de ces faits doit être exécuté. Or puisque l’autorité publique ne peut exercer aucune action, il est évident que les faits doivent être produits par des forces autres que les siennes. Un gouvernement ne peut agir que lorsqu’il est question d’ordonner ou de punir un fait précis et bien déterminé.
Les forces morales règlent chacun des mouvements auxquels nous nous livrons ; elles nous gouvernent même lorsque nous croyons devoir rester inactifs. Les forces de l’autorité publique ne règlent qu’un petit nombre de nos actions ; elles n’agissent qu’à de longs intervalles. Dans un état civilisé, un homme peut quelquefois arriver au terme d’une longue carrière, sans avoir été dirigé une seule fois par leur influence directe. Il peut s’être abstenu de toute action punissable, sans avoir été retenu par la crainte d’aucun châtiment légal ; il peut avoir rempli toutes ses obligations, par la seule considération de ses devoirs et de son intérêt. Mais, quoique les forces morales aient une grande puissance, surtout dans un état avancé dans la civilisation, on ne peut espérer qu’elles agissent dans tous les cas, et sur tous les membres de la société, avec une égale énergie. La question est de savoir quelles sont les actions utiles ou funestes qui ne peuvent être produites ou réprimées qu’avec le concours de la force publique. Celles-là seulement appartiennent au domaine du gouvernement ; les autres restent sous l’empire exclusif des forces morales.
Nous avons vu, au commencement de ce chapitre, qu’il est des actions utiles que l’homme exécute, et des actions funestes dont il s’abstient, sans y être contraint autrement que par ses propres sentiments, ou par le bien ou le mal qui en résultent pour lui-même. Si nous examinons quelles sont les actions de ce genre, nous verrons que ce sont d’abord celles dont il est tout à la fois l’objet et l’agent. Tant qu’un individu n’agit que sur lui, ou sur les choses qui sont à lui, les abus de pouvoir de sa part sont peu à craindre. S’il se gouverne bien, il en est récompensé par les avantages qui en résultent ; s’il se gouverne mal, c’est sur lui que tombent d’abord les châtiments. Il est vrai qu’il ne peut guère se nuire sans nuire en même temps à d’autres ; en diminuant sa capacité ou en dissipant sa fortune, il prive plusieurs de ses semblables des services qu’il leur devait, ou qu’ils pouvaient attendre de lui. Mais, en même temps, il se prive lui-même des services qu’il pouvait attendre d’eux, et le mal qu’il se fait, et qui se concentre particulièrement sur sa personne, est une peine réprimante assez forte pour le retenir, s’il a l’intelligence assez développée pour voir les conséquences de sa conduite.
Lorsqu’au lieu d’agir sur lui ou sur les choses qui sont à lui, un homme agit sur ses enfants ou sur les choses qui leur appartiennent, le bien et le mal qui résultent de ses actions, peuvent être sentis par eux avant que de l’être par lui, et les affecter plus vivement qu’ils ne l’affectent lui-même. En général, un père souffre lorsqu’il punit ses enfants ; il éprouve du plaisir, lorsqu’il leur cause quelque jouissance. Il n’est cependant pas impossible que, dans le cas du châtiment, la douleur de l’enfant ne soit plus vive et plus immédiate que celle du père, et qu’il en soit de même dans le cas d’une récompense. Aussi, nous voyons que les gouvernements qui n’ont pas cru nécessaire de mettre des bornes au pouvoir qu’un homme a sur lui-même et sur ses propriétés, ont cru utile de mettre des limites au pouvoir des pères sur leurs enfants et sur les choses qui leur appartiennent. Tous ne se sont pas cru cependant dans cette nécessité : il en est plusieurs, au contraire, qui n’ont pas supposé qu’il fût plus dangereux de laisser sans limites le pouvoir d’un père sur ses enfants, que de ne pas borner celui qu’il a sur sa propre personne. Il n’est jamais résulté de ce pouvoir des inconvénients bien graves, dans les pays au moins où les sentiments naturels de l’homme n’ont pas été étouffés par le despotisme ou par une fausse religion. La raison en est que l’homme n’est guère moins attaché à la conservation de sa postérité qu’à sa conservation personnelle ; il l’est même quelquefois davantage. C’est le sentiment que la nature a donné à toutes les espèces animées, sentiment sans lequel elles ne se seraient point conservées. Un homme qui voit ses enfants éprouver du plaisir ou de la peine, n’éprouve pas le même genre de plaisir ou de peine qu’eux ; mais il est affecté en bien ou en mal dans ses affections morales ; et puisque nos facultés morales sont aussi bien une partie de nous-mêmes que nos facultés physiques, il s’ensuit que la même puissance qui protège un individu contre lui-même, protège aussi ses enfants contre les abus de son pouvoir : les mêmes motifs qui le déterminent à veiller à ses intérêts, agissent avec non moins de force en faveur des intérêts de ses descendants [115].
[I-474]
Mais, lorsque l’action d’un individu se porte sur d’autres que sur lui et ses enfants, il peut être affecté d’une manière différente que la personne même sur laquelle il agit. S’il exerce sur elle une vengeance, s’il lui ravit sa propriété, il peut éprouver, au moins dans le moment, une certaine jouissance, tandis qu’elle éprouvera une douleur. S’il paie une dette, s’il exécute une obligation, il peut éprouver une peine, tandis que la personne envers laquelle il s’acquitte éprouvera un plaisir. Ainsi, quoique les actions qu’un homme exerce sur lui-même et quelquefois même sur ses enfants, n’aient besoin, pour être bien réglées, que d’être abandonnées à sa propre direction, il n’en est pas de même dans le cas où c’est sur d’autres personnes qu’il agit. Il faut alors que les forces dont l’autorité publique dispose, puissent, au besoin, le contraindre soit à exécuter certains faits, soit à s’abstenir de certaines actions. Mais quels sont les cas où il est utile que la contrainte soit employée ? Faut-il en faire usage pour réprimer tous les penchants funestes, et pour seconder tous les penchants utiles ?
Si nous observons attentivement tous les hommes, nous verrons qu’il n’en est aucun chez lequel il n’existe deux sortes d’inclinations : les unes, bonnes ou vertueuses ; les autres, mauvaises ou vicieuses. L’individu que nous jugeons le plus estimable, n’est pas celui dont tous les penchants sont portés vers le bien ; car, à cette condition, nous ne pourrions estimer personne ; c’est celui dont les bonnes inclinations ont toujours plus de force que les mauvaises. De même, celui qui nous inspire le plus de mépris ou d’aversion, n’est pas celui qui n’a que des penchants vicieux, puisque l’existence d’un tel individu n’est peut-être pas possible ; c’est celui dont les mauvais penchants l’emportent habituellement sur les bons. Le degré d’estime que nous accordons à un homme est en raison de la faiblesse des inclinations funestes qui sont en lui, et de la force de ses inclinations vertueuses. Le degré de mépris ou d’aversion qu’il nous inspire, est, au contraire, en raison de la force de ses penchants vicieux, et de la faiblesse de ses bonnes inclinations. Tous les biens et tous les maux qui résultent des actions humaines, sont produits par l’un ou l’autre de ces deux genres de penchants [116].
[I-476]
Il ne s’est jamais rencontré de gouvernement qui ait imaginé que l’action de l’autorité publique devait être employée à seconder toutes les bonnes inclinations de l’homme, ou à réprimer tous ses penchants vicieux. Un individu peut former la résolution de suivre tel genre de vie, ou de donner à ses enfants telle ou telle éducation ; s’il n’a pas la force d’exécuter ce qu’il a résolu, si ses désirs, quelque utiles qu’ils soient, n’ont pas assez de puissance pour déterminer sa conduite, il ne trouvera hors de lui-même aucune force qui vienne le seconder. De même, si ces inclinations le portent à la paresse, à l’intempérance, à l’avarice ou à d’autres actions qui nuisent à son individu ou à sa fortune, ses mauvais penchants ne seront pas réprimés par la force de l’autorité publique. Cette force ne réprimera pas davantage sa vanité, son orgueil ou son indiscrétion, quoique ces vices puissent lui causer divers préjudices, et qu’ils soient quelquefois offensifs pour plusieurs membres de la société.
[I-477]
Plusieurs peuples ont tenté cependant de fortifier les inclinations vertueuses, et de combattre les inclinations vicieuses par la force de l’autorité publique. La censure, chez les Romains, n’avait pas d’autre objet. « Un censeur, dit Plutarque, a loi d’enquérir sur la vie, et de réformer les mœurs d’un chacun, parce que les Romains ont estimé qu’il ne fallait pas qu’il fût loisible à chacun, soi marier, engendrer enfants, vivre chez soi en privé, ni faire festins et banquets à sa volonté, sans craindre d’en être repris [117]. » Ce régime pouvait être tolérable pour un peuple militaire qui avait besoin d’être soumis à la discipline et à l’arbitraire des camps, jusque dans l’intérieur de la vie domestique ; mais il eût été aussi inutile qu’insupportable chez une nation industrieuse et civilisée. L’effet qu’il produisit relativement aux mœurs, fut complètement nul ; car il est douteux qu’il ait jamais existé une nation qui ait eu plus de vices que le peuple de Rome. Les tentatives qui ont été faites chez les nations modernes, pour réformer les mœurs par l’action directe de l’autorité publique, n’ont pas été moins vaines. Les peines quelquefois excessives qui ont été prononcées contre certaines actions vicieuses, les règlements à l’aide desquels on a tenté de mettre des bornes aux dépenses privées, n’ont produit aucun bien, et on a été obligé d’y renoncer.
[I-478]
Si l’on recherche les causes qui ont fait renoncer à soutenir toutes les inclinations vertueuses, et à réprimer toutes les actions malfaisantes, par l’action de l’autorité publique, on verra d’abord qu’en général on y a renoncé par l’impuissance de réussir ; on verra, en second lieu, que la somme de mal produite par cette action a toujours excédé la somme de bien.
Toutes les fois que l’action ou l’inaction d’un individu ne s’étend pas au-delà de lui-même, il n’y a pas moyen de l’atteindre, puisqu’il n’y a aucun moyen de le convaincre. Il faudrait ou empêcher les hommes de se trouver dans un état d’isolement, ou avoir autant de surveillants qu’il existerait d’individus. Il n’est guère plus facile de réprimer les actions qui ont lieu entre deux personnes de leur commun accord, lorsqu’un tiers n’en est affecté qu’en raison des maux qu’elles se font à elles-mêmes. Les actions qui se passent dans l’intérieur des familles, sont également hors de l’atteinte des magistrats, à moins qu’elles ne laissent à leur suite des marques auxquelles on peut évidemment les reconnaître, telles que des violences graves [118].
[I-479]
L’action qu’un homme exerce sur les choses qui sont à lui, est dans certains cas plus facile à constater, que l’action qu’il exerce sur lui-même. Aussi, dans les pays mêmes où l’on a renoncé à réprimer par la force publique certaines actions vicieuses, on a cru qu’il n’était pas impossible d’empêcher un homme de consommer ses biens en folles dépenses. Il existe, en France, des lois qui menacent les prodigues d’interdiction ; qui leur défendent de contracter des dettes ou d’aliéner certaines propriétés. Mais, si l’on veut se donner la peine d’examiner quels sont, en réalité, les effets de ces prétendues lois, on sera convaincu qu’ils sont complètement nuls. Si un homme qui n’est pas atteint de folie, et qui a la disposition de ses biens, a résolu de se ruiner, il est aussi impossible de l’en empêcher, qu’il est impossible de l’empêcher de se donner la mort, s’il en a le désir et la puissance. Les peines prononcées contre le suicide ne sont plus à craindre quand on les a encourues ; il en est à peu près de même de celles au moyen desquelles on a prétendu mettre des bornes à la prodigalité : le mal est consommé quand le magistrat arrive, et l’action de l’autorité n’a pas même l’avantage d’être un épouvantail.
Les actes des gouvernements qui ont voulu opérer par l’emploi de la force publique, ce qui ne peut être opéré que par la force des mœurs, ont été jugés par les mêmes règles que toutes les habitudes et les actions humaines : on les a condamnés, toutes les fois qu’on s’est aperçu que la somme des maux qui en résultait excédait la somme des biens, en prenant en considération l’intensité, la durée, la certitude et la proximité des uns et des autres, et surtout le nombre des personnes qui en sont affectées.
Il résulte de là qu’il est des maux qu’il ne faut pas espérer de détruire par l’emploi de la force, et des biens qu’un tel moyen ne saurait produire. Il est des actions ou des habitudes funestes qu’on est obligé de tolérer, à moins qu’on ne veuille produire un mal plus grave que celui qui résulte de ces habitudes ou de ces actions. D’un autre côté, il est des actions ou des habitudes avantageuses qu’on ne peut pas exiger par l’emploi de la force, à moins qu’on ne veuille perdre des biens plus grands que celui qu’il est possible d’obtenir par ce moyen.
J’ai dit précédemment que l’action des lois morales peut s’étendre beaucoup plus loin que l’action de l’autorité publique ; et de là on tire la conséquence que le point où l’action du gouvernement ne peut plus s’exercer sans produire plus de mal que de bien, est le point qui sépare la législation de la morale. Cela est incontestable, en effet, toutes les fois qu’on ne voit dans la législation que l’art d’appliquer aux hommes ou aux choses, l’action de l’autorité publique. Mais lorsque l’on considère la législation comme une science, c’est-à-dire comme la connaissance de l’enchaînement des faits d’un certain ordre, il n’est plus possible de se restreindre dans de telles limites. On ne connaîtrait une loi que de la manière la plus imparfaite, si l’on ignorait, d’un côté, la portion de force ou de puissance qu’elle reçoit des mœurs ou des opinions, et si l’on ignorait, d’un autre côté, l’action qu’elle exerce sur les facultés physiques, intellectuelles et morales des diverses classes de la population.
[I-482]
CHAPITRE XI.↩
De l’action des lois de la morale, et des obstacles que cette action rencontre quelquefois dans celle des gouvernements, dans des institutions publiques, ou dans des erreurs populaires.
Nous avons vu qu’il existe dans l’homme deux sortes d’habitudes ; les unes qui sont favorables au genre humain ; les autres qui lui sont contraires. Nous avons vu aussi que l’action de l’autorité publique peut être appliquée à seconder un certain nombre des premières, comme à seconder un certain nombre des secondes. Enfin, nous avons vu qu’il est des actions utiles au genre humain que l’autorité publique ne peut pas exiger, et des actions funestes qu’elle ne peut pas réprimer, sans produire plus de mal que de bien. Ces dernières actions se trouvent en dehors de l’autorité des gouvernements, et restent dans le domaine de la morale.
L’amour du travail, par exemple, est une des inclinations les plus utiles au genre humain ; elle est une des principales causes de nos progrès. L’amour de l’oisiveté est, au contraire, une inclination essentiellement funeste ; si celle-ci l’emportait sur celle-là, les nations les plus florissantes tomberaient rapidement dans la décadence. Un gouvernement ne peut cependant exercer aucune action directe sur les citoyens pour les obliger au travail : s’il voulait les y contraindre par des peines, il serait obligé de les traiter en esclaves ; s’il voulait les y déterminer par des récompenses, il ne pourrait donner que ce qu’il aurait déjà pris ; le découragement qu’il produirait d’un côté, serait plus grand que l’encouragement qu’il donnerait de l’autre ; il lui serait d’ailleurs impossible d’avoir une mesure exacte d’appréciation, soit pour les récompenses, soit pour les châtiments.
Si le mal qui résulte d’une action funeste, se faisait immédiatement sentir à celui qui en est l’auteur, et s’il se concentrait tout entier sur lui, on aurait peu besoin de s’en occuper ; il serait sur-le-champ repoussé par le besoin que chacun éprouve de veiller à sa propre conservation ; jamais un gouvernement n’eut besoin de faire des lois pour empêcher les hommes de se laisser mourir de faim ou de trop s’approcher du feu. Il serait également inutile de s’occuper des actions productives de bien, si l’effet suivait immédiatement la cause, et si cet effet se concentrait entièrement sur l’auteur de l’action ; il n’a pas été plus nécessaire de faire des lois pour obliger les hommes à faire usage d’aliments agréables et sains, qu’il n’a été nécessaire d’en faire pour les empêcher de se crever les yeux.
Mais tous les mauvais effets d’une action ou d’une habitude funeste n’en sont pas des conséquences immédiates, et ne tombent pas exclusivement sur l’individu qui a commis cette action ou contracté cette habitude. Nous avons vu, au contraire, que les actions auxquelles on donne le nom de vicieuses sont, en général, suivies d’un plaisir immédiat pour celui qui s’y livre, et que le mal en est éloigné ou se répand sur d’autres personnes que sur lui. De même, tous les bons effets d’une action ou d’une habitude utile, n’arrivent pas à l’instant même où cette action est exécutée, et ne sont pas sentis uniquement par celui qui en est l’auteur. Les résultats utiles des actions ou des habitudes auxquelles on donne le nom de vertueuses, sont, au contraire, ou éloignés, ou éprouvés par d’autres que par ceux qui ont ces habitudes.
Supposons, par exemple, qu’un homme possédant un capital plus ou moins considérable employé dans une entreprise industrielle, le consomme en folles dépenses ou en vaines prodigalités ; sur qui tomberont les funestes conséquences de ces vices ? Elles tomberont d’abord sur lui. Outre les maux qui seront la suite immédiate de ses mauvaises habitudes, et qui varieront selon les vices qu’il aura contractés, il éprouvera tous les maux qui sont des conséquences de la misère quand elle est méritée : l’impossibilité de satisfaire ses besoins, le mépris, le délaissement. Elles tomberont, en second lieu, sur sa femme, sur ses enfants, sur les divers membres de sa famille ; et celles-là seront en partie de même nature que celles qu’il éprouvera lui-même. Elles tomberont, en troisième lieu, sur les diverses classes de la population qui trouvaient, dans le capital dissipé, le moyen d’exercer leur industrie, et par suite des moyens d’existence. L’incendie des ateliers d’un fabricant jette dans la misère les ouvriers qui y étaient employés, et expose leurs femmes, leurs enfants, à mourir de faim ; s’ils trouvent ailleurs de l’emploi, ce n’est qu’en portant sur le marché une nouvelle quantité de travail et en faisant baisser les salaires. Les souffrances gagnent en étendue ce qu’elles perdent en intensité : le même nombre de personnes doivent vivre sur une plus petite quantité de produits. Or, une folle consommation détruit un capital productif aussi infailliblement qu’un incendie. Enfin, les funestes conséquences qui résulteront d’une mauvaise habitude, seront senties, dans ce cas, par toutes les personnes qui trouvaient, dans les produits du même capital, le moyen d’échanger leurs propres produits et de satisfaire leurs besoins. Un capital productif anéanti, est un débouché fermé presque pour toutes les classes de producteurs. Ainsi, les funestes conséquences des vices d’un individu, pourront être senties par des milliers de personnes, tandis que les plaisirs n’auront été éprouvés que par lui ou par un petit nombre de ses amis.
Les bons effets d’une habitude vertueuse se répandent sur les membres de la société exactement de la même manière que les mauvais effets d’une habitude vicieuse. Il est clair, par exemple, que celui qui, par ses travaux et ses économies, parvient à former un capital qu’il livre à la production, produit des effets diamétralement opposés à ceux que j’ai fait observer dans le cas précédent. Il éprouve d’abord lui-même des privations et des fatigues ; mais les biens sont ensuite sentis par lui, par les divers membres de sa famille, par les diverses classes de la société auxquelles il fournit le moyen d’exercer leur industrie, et par les individus auxquels il livre ses produits, en échange de ceux qu’il reçoit d’eux.
Nous trouverions les mêmes résultats si nous faisions l’analyse de quelque habitude vertueuse ou vicieuse que ce soit, même de celles dont les effets paraissent le plus se renfermer dans les personnes par lesquelles ces habitudes ont été contractées. Qu’un homme, par exemple, consacre la moitié de sa vie à l’étude des lois de son pays, et qu’il devienne un habile jurisconsulte ou un bon magistrat, il est évident qu’il ne pourra être utile à lui-même et à sa famille, qu’en raison de l’utilité dont il sera pour les autres. Il pourra jouir d’une grande considération, et quelquefois même acquérir une fortune considérable ; mais il ne les acquerra que par un échange de services ; qu’en devenant le conseil ou le guide de ceux qui manqueront de connaissances pour diriger leurs affaires ; qu’en administrant la justice avec impartialité et promptitude, et en inspirant ainsi la sécurité à une portion plus ou moins considérable des membres de la société.
Si, au lieu de supposer un homme qui, par ses travaux et par son intégrité, est parvenu à se rendre utile à lui-même, aux membres de sa famille, et à un nombre plus ou moins considérable de ses concitoyens, nous supposons un homme qui, après avoir acquis des connaissances étendues, contracte des habitudes vicieuses, nous arriverons à un résultat opposé. Un médecin, par exemple, qui contracterait l’habitude de l’intempérance ou tel autre vice qui lui ferait perdre la confiance publique, ne nuirait pas seulement à lui-même et aux membres de sa famille ; il nuirait aussi à toutes les personnes qui avaient besoin de ses services, et même à tous ceux qui s’intéressaient à ces personnes. Un père était persuadé que tel médecin aurait guéri son fils de telle maladie ; mais ce médecin, par une habitude vicieuse qu’il a contractée, est devenu incapable. On s’abstient de l’appeler, ou, s’il est appelé, il tue le malade. Les funestes conséquences du vice ne s’arrêtent pas sur l’individu qui meurt ; elles tombent sur ses parents, sur ses amis, sur tous ceux qui s’intéressaient à son sort, et même sur tous ceux qui peuvent craindre de se trouver dans un cas semblable.
Tous les vices, quelle qu’en soit la nature, produisent pour les personnes qui s’y livrent, un mélange de plaisirs et de peines, quoique la somme des peines soit plus grande que celle des plaisirs ; mais ils produisent en même temps, pour un nombre plus ou moins grand de personnes, une quantité considérable de maux qui ne sont compensés par aucune espèce de jouissances. Une fille qui abandonne ses parents pour suivre un individu qui l’a séduite, peut trouver dans quelques plaisirs fugitifs une compensation aux misères auxquelles elle s’expose ; mais la honte et la douleur qu’éprouvent son père, sa mère, ses sœurs et ses frères, et les craintes qu’un tel événement répand dans les familles, sont des maux sans aucun mélange de biens.
Toutes les habitudes vertueuses produisent également, pour ceux qui les ont contractées, un mélange de biens et de maux ; mais elles produisent en même temps, pour d’autres personnes, une certaine quantité de biens qu’aucun mélange de mal n’altère. Une femme qui consacre la plus grande partie de sa vie aux soins de son ménage et à l’éducation de ses enfants, se soumet à des peines qui sont beaucoup plus que compensées par les jouissances qui en sont la suite ; mais les conséquences qui résultent de sa conduite pour son mari, pour ses enfants, pour les divers membres de sa famille et pour les personnes à qui sa conduite sert d’exemple, sont des biens dont ils jouissent sans les payer par aucune peine ou par aucun sacrifice.
[I-489]
La conduite de chaque individu, soit bonne, soit mauvaise, influe donc en bien ou en mal sur le sort d’une multitude d’autres individus. Nous avons vu cependant que l’action de l’autorité publique ne peut être utilement employée à réprimer tous les penchants funestes qui existent dans les hommes, ou à rendre leurs penchants utiles toujours dominants. Il ne reste donc, pour réprimer les habitudes vicieuses ou pour fortifier les habitudes vertueuses, que les forces qui sont inhérentes à la nature même de l’homme, et qui sont des conséquences de son organisation. Mais en quoi consistent ces forces ? Quels sont les moyens qui peuvent les rendre triomphantes, ou qui tendent à les paralyser ? C’est là une des questions les plus importantes de la législation et de la morale : on verra, dans la suite de cet ouvrage, à quelles funestes conséquences ont été conduits les peuples qui ne l’ont pas aperçue, ou qui l’ont mal résolue.
Un vice produit des maux pour un grand nombre de personnes, ainsi que nous l’avons vu précédemment ; mais la part la plus considérable de ces maux tombe naturellement sur l’individu qui est atteint de ce vice ; c’est la peine réprimante qu’y attache l’auteur de notre nature. Une vertu produit du bien pour un nombre plus ou moins considérable de personnes ; mais la part la plus considérable de ces biens est, en général, dévolue à celui à qui cette vertu appartient, ou aux personnes auxquelles il s’intéresse le plus ; c’est la récompense au moyen de laquelle les actions vertueuses sont produites. Ainsi, nous sommes garantis des funestes conséquences des vices d’autrui, non par l’action de l’autorité publique, mais par les châtiments que la nature elle-même prend soin d’infliger aux gens vicieux. Un individu ne peut nous nuire au moyen d’une habitude vicieuse, sans se nuire encore plus à lui-même ; c’est là notre unique garantie. Les avantages qui résultent pour nous des bonnes habitudes des autres, ne nous sont pas non plus garanties par la force du gouvernement ; ils ne le sont que par les biens qui résultent de ces habitudes pour ceux qui les ont contractées, et pour les personnes qu’ils affectionnent ; en pareil cas, le bien qu’on fait à autrui est ou la cause ou l’effet de celui qu’on se fait à soi-même.
Les peines que produit un vice pour l’individu qui s’y livre, et que nous pouvons assimiler au châtiment qu’infligent les tribunaux aux criminels pour diminuer le nombre des crimes, sont de divers genres et varient comme les vices dont elles sont des conséquences ; mais elles affectent toujours l’individu, ou dans ses organes physiques, ou dans ses facultés intellectuelles, ou dans ses affections morales. Souvent elles l’affectent dans toutes ces parties : quelquefois elles l’affectent dans quelques-unes seulement. Si un vice produit la misère, comme la passion du jeu, l’intempérance, la prodigalité, et quelquefois même la paresse, il est assez commun que l’individu qui en est atteint, soit affecté par les peines qui en sont la suite, dans toutes les parties de son être ; qu’il souffre des douleurs physiques, par l’impossibilité de satisfaire ses besoins ou par les maladies qu’il a contractées ; qu’il souffre des douleurs morales, par le spectacle des maux qu’il a attirés sur sa famille, par la décadence où il la voit tomber, et par le mépris ou la haine dont il est devenu l’objet ; enfin, qu’il soit même atteint dans ses facultés intellectuelles, par le décroissement de son intelligence, ou par l’impossibilité de la cultiver. Il est des vices qui ne produisent, pour les individus qui s’y livrent, aucun mal physique immédiat, tels sont l’ambition, l’orgueil, la perfidie, la vengeance, la cruauté et quelques autres. Les peines qui résultent de ces vices, pour ceux qui les ont contractés, sont toutes morales ; s’ils en produisent de physiques, comme cela arrive souvent, ce n’est jamais d’une manière immédiate : les maux physiques, en pareil cas, ne sont engendrés que par les peines morales.
Nous pouvons faire, sur les habitudes vertueuses, les mêmes observations que nous venons de faire sur les habitudes vicieuses. Il en est plusieurs dont les bons effets affectent les personnes qui les ont contractées, dans leurs organes physiques, dans leurs affections morales et dans leurs facultés intellectuelles. De ce nombre sont celles qui multiplient ou conservent pour les hommes des moyens d’existence : telles que le travail, l’économie, l’amour de l’ordre, la tempérance. Il en est d’autres qui ne produisent directement pour ceux qui les possèdent, que des jouissances morales : telles sont la bienveillance, la générosité, la sincérité et quelques autres.
Puisque les peines physiques, morales et intellectuelles que produit un vice pour l’individu qui s’y abandonne, sont la seule garantie que nous ayons contre l’existence de ce vice ; et puisque les jouissances physiques, morales ou intellectuelles que produit une habitude vertueuse pour la personne qui l’a contractée, sont également la seule garantie que nous ayons de l’existence et de la durée des habitudes de ce genre, quel est le moyen le plus sûr, soit de diminuer le nombre des actions vicieuses, soit de multiplier le nombre des actions vertueuses ? Ce moyen est le même que celui que mettent en usage les gouvernements de tous les peuples civilisés, soit pour multiplier le nombre des bonnes actions, soit pour diminuer le nombre des délits ou des crimes. Il n’existe de différence qu’en un seul point : les peines et les récompenses au moyen desquelles les gouvernements tendent à réprimer ou à provoquer certaines actions, sont fixées par eux ; tandis que les peines et les récompenses qui tendent à proscrire les habitudes vicieuses ou à multiplier les habitudes vertueuses, sont fixées par l’auteur même de notre nature, ou par les peuples eux-mêmes.
[I-493]
Ces peines et ces récompenses ne peuvent être efficaces qu’autant qu’elles réunissent les conditions exigées pour l’efficacité des récompenses et des peines distribuées par l’autorité des gouvernements. Il faut qu’elles soient publiques, afin que nul n’agisse ou ne s’abstienne d’agir par ignorance ; qu’elles soient certaines, afin que nul ne se livre à un vice dans l’espérance d’en éviter le châtiment, ou ne s’abstienne d’une action vertueuse dans la crainte de ne point en recueillir les fruits ; enfin, qu’elles soient proportionnées à la gravité du vice ou à la grandeur de la vertu, afin qu’on ne soit pas entraîné par les jouissances qui accompagnent une habitude vicieuse, et qu’on ne soit pas retenu par les peines ou par les sacrifices qu’exige une bonne action
Les peines que produit le vice pour celui qui s’y livre, et les avantages qui résultent d’une conduite vertueuse pour celui qui la suit, peuvent être rendues publiques de deux manières. Elles peuvent l’être, d’abord, par l’enseignement de la morale, qui expose les conséquences bonnes ou mauvaises de toutes les actions humaines ; c’est, si je puis parler ainsi, la promulgation de la loi. Elles peuvent l’être, en second lieu, par l’exposition des faits qui se passent journellement dans la société ; c’est l’exécution de la loi. Lorsqu’un tribunal a infligé une peine à un individu coupable d’une mauvaise action, c’est au grand jour et en face du public qu’on exécute la sentence ; on cherche à garantir la société de crimes nouveaux, en retenant par la crainte des supplices ceux qui seraient tentés de les exécuter. Pour donner aux lois de la morale la même efficacité, il faudrait, si cela était possible, que celui qui les a enfreintes en subît le châtiment aux yeux de tous ceux qui pourraient avoir la tentation de suivre son exemple. Lorsqu’un gouvernement veut multiplier un certain genre d’actions, c’est publiquement qu’il les récompense ; il veut que chacun aperçoive, aussi nettement qu’il est possible, la liaison qui existe entre la récompense et l’action au moyen de laquelle on l’a obtenue. C’est de la même manière que les hommes auraient besoin de voir la liaison qui existe entre des habitudes vertueuses et les conséquences dont elles sont suivies, pour les individus qui les pratiquent : c’est là une partie essentielle de la publicité que doivent avoir les lois, celles de la morale comme les autres.
La certitude des peines est une condition non moins nécessaire à leur efficacité que la publicité elle-même. Ce qui multiplie le nombre des délits, ce n’est pas l’insuffisance ou la faiblesse des peines, c’est l’incertitude de leur application. Dans tous les pays, les hommes craignent presque également la prison, les fers, la mort ; mais, dans tous les pays, il ne règne pas la même certitude sur l’application de ces peines. Le malfaiteur le plus déterminé n’exécuterait pas un vol en présence de témoins, et sous la main de la force publique ; pour se rendre coupable, il a besoin de croire ou qu’il ne sera pas découvert, ou qu’il ne pourra être convaincu, ou qu’il aura quelque moyen de s’échapper, ou que sa grâce lui sera accordée. Les individus qui offensent les lois de la morale font exactement les mêmes calculs ; ils ne les enfreignent que parce que les châtiments attachés à l’infraction leur paraissent manquer de certitude. L’incertitude des récompenses produit un effet analogue relativement aux habitudes vertueuses : on ne prend pas une peine dont on n’est pas sûr de recueillir le fruit, ou de le voir recueillir par les personnes auxquelles on s’intéresse.
La proportion qui doit exister entre les peines et la gravité des vices qui les produisent, ou entre les récompenses et la grandeur des vertus dont elles sont le résultat, a été fixée par la nature elle-même ; mais cette proportion est souvent altérée par l’ignorance et par les faux calculs des gouvernements ou des peuples. Les peines que produit un vice pour celui qui en est atteint, et les avantages qui résultent d’une bonne habitude pour celui qui la pratique, ne peuvent être efficaces qu’autant que les premières excèdent les plaisirs pour lesquels on s’y expose, et que les secondes excèdent les sacrifices au prix desquels on les achète. Mais, comme les effets éloignés d’une action ont toujours plus d’incertitude que ceux qui l’accompagnent ou la suivent immédiatement, les peines que la nature a destinées à réprimer le vice, et les récompenses au moyen desquelles elle produit la vertu, ne peuvent avoir de l’efficacité qu’autant qu’elles gagnent en durée et en intensité ce qui peut leur manquer du côté de la certitude.
La nature n’a laissé aux peuples que le choix des maux : s’ils veulent réprimer ceux qui résultent des délits ou des crimes, il faut qu’ils laissent agir ceux qui constituent la répression ; il faut qu’ils établissent des tribunaux, des procédures, des prisons, des gibets ; il faut qu’ils donnent à un petit nombre d’hommes le pouvoir de poursuivre, d’arrêter, d’emprisonner, même de tuer les individus qu’ils croient coupables ; il résulte de là beaucoup de souffrances, non seulement pour les criminels qui sont poursuivis et convaincus, pour leurs parents et pour leurs amis ; mais aussi pour ceux qui sont poursuivis ou condamnés quoique innocents, et pour ceux qui craignent de l’être. Si jamais un peuple voulait se délivrer de tous les maux de ce genre, il n’aurait pas d’autre moyen que de se soumettre à tous les maux infiniment plus graves qui sont la suite naturelle d’un brigandage sans frein.
Les peuples sont exactement dans la même position, relativement aux habitudes vicieuses ; il faut qu’ils choisissent entre deux genres de maux ; il faut qu’ils laissent aux peines physiques, morales, ou intellectuelles que la nature a destinées à la répression du vice, et qu’elle fait tomber sur l’individu vicieux, la publicité, la certitude, la durée et l’énergie qui sont propres à ces divers genres de peines, ou qu’ils souffrent la multiplication des maux que le vice produit pour les personnes même qui en sont innocentes : s’ils ne veulent pas le mal de la répression, il faut qu’ils se soumettent au mal de l’impunité. Une habitude vicieuse produit, pour celui qui l’a contractée, des plaisirs et des peines ; elle produit, pour une multitude d’autres personnes, des peines sans mélange de plaisirs. Supprimez les peines qu’elle engendre pour l’individu vicieux, il ne restera pour lui que des plaisirs ; cet individu n’aura par conséquent plus de frein, et les autres personnes auxquelles ses vices sont funestes, se trouveront sans garantie. Elles se trouveront, relativement à lui, dans une position plus désavantageuse encore que ne seraient les membres de la société envers les malfaiteurs qu’une autorité quelconque mettrait à l’abri des poursuites et des peines judiciaires ; car il n’est pas impossible de repousser les attaques d’un malfaiteur, mais on n’a aucun moyen d’empêcher un individu de s’abandonner au vice.
Un vice produit naturellement pour celui qui l’a contracté, diverses peines physiques, telles que celles qui résultent de la misère ; il produit divers genres de maladies ; il produit, de plus, des peines morales, le mépris, l’abandon, l’antipathie, le chagrin de voir éteindre ou déchoir sa race ; il produit l’incapacité intellectuelle et les maux qui l’accompagnent. Or, tout acte par lequel un individu, une société ou un gouvernement, diminuent la publicité, l’intensité, la durée, ou la certitude de quelqu’une de ces peines, est une atteinte aux bonnes mœurs. Un tel acte a pour effet d’affaiblir la seule garantie que chacun de nous possède contre les vices d’autrui ; il agit, relativement aux habitudes vicieuses, comme agirait, relativement aux actions que l’autorité réprime, l’existence d’une société qui, par humanité, se ferait un devoir d’aller briser les portes des prisons. Quelques exemples rendront cette vérité plus sensible.
Il n’est aucun genre de vice qui soit plus funeste pour une femme, et plus humiliant pour sa famille, que celui qui la conduit à la prostitution. Ce vice produit pour la femme qui en est atteinte, un certain nombre de plaisirs ; mais il produit aussi un grand nombre de peines, l’extinction de toute affection morale pure, la certitude du mépris et de l’abandon, l’expulsion de toute société qui se respecte, la difficulté et presque l’impossibilité d’élever ses enfants, la privation des secours et de l’appui de leur père, la misère et les souffrances inséparables d’un tel état, les mépris et les mauvais traitements des seuls individus avec lesquels elle puisse avoir quelques rapports, des maladies funestes qui peuvent devenir mortelles, la perspective de voir ses enfants dans le plus bas échelon de l’ordre social, et une vieillesse, en supposant qu’on y arrive, terminée dans la plus affreuse misère, et employée à faire les plus vils métiers.
[I-499]
Tel est le lot de misère attaché à ce genre de vice pour la personne qui s’y livre ; lot très considérable en lui-même, mais qui n’est pas plus grand qu’il ne faut pour la répression du vice, si l’on considère la puissance de la séduction, la facilité avec laquelle on se procure d’abord des moyens d’existence, l’absence de tout genre de travail et même de toute contrainte, l’éloignement dans lequel se présentent les peines, et par conséquent l’incertitude qui y semble attachée.
Le lot de peines qui tombent sur les vieux parents est moins considérable ; mais aussi ce sont des maux qui arrivent immédiatement, et auxquels aucun genre de bien ne se mêle : la honte, l’abandon, des espérances trompées ; une partie de ces maux se répand sur les frères, les sœurs, et sur d’autres membres de la famille ; le mal peut se répandre même sur des familles étrangères, par l’influence ou seulement par la crainte de l’exemple. Je ne parle pas des divers genres de maux que peut causer directement, par ses liaisons, l’individu dont il est question ; les personnes qu’elle peut entraîner dans la même route par ses conseils ou par ses séductions.
Supposons maintenant qu’un peuple se propose de réprimer, chez lui, le vice de la prostitution, et qu’il soit convaincu de l’impossibilité de faire utilement usage des lois pénales ; quels sont les moyens qui doivent se présenter naturellement à son esprit ? Il n’en est que deux : l’un de diminuer, ou [I-500] même de détruire, s’il était possible, les jouissances attachées au vice ; l’autre, de donner aux peines qui en sont la conséquence naturelle pour l’individu vicieux, tout le degré de publicité, de proximité, de certitude et de durée dont elles sont susceptibles. Le premier moyen n’étant point praticable, il ne reste que le second ; mais comment le mettre en usage ? En ne troublant pas l’ordre de la nature ; en abandonnant à elles-mêmes les personnes vicieuses, et en faisant voir aux autres ce que celles-là sont devenues.
Mais si, tout à coup, il se forme, au sein de la population, une société qui ait pour objet de diminuer le nombre des maux que ce vice engendre pour ceux qui en sont atteints ou pour leur postérité, et qui établisse à ses dépens des maisons où elle promet de recevoir gratuitement toutes les femmes qui voudront y faire leurs couches, elle rend, par cela même, la carrière du vice plus aisée ; elle en diminue les peines, non pour les individus qui en sont innocents ; celles-là restent les mêmes ; elle les diminue seulement pour les personnes vicieuses, sans diminuer en rien les attraits que le vice a pour elles.
S’il se présente ensuite une autre société qui se charge de recevoir, de nourrir, d’entretenir à ses frais, tous les enfants nés hors mariage, dont les mères pourraient être embarrassées, et dont les pères ne voudraient pas prendre soin, la carrière du vice sera plus aisée encore. Les peines que ce vice produit, resteront les mêmes pour toutes les personnes auxquelles il est étranger ; les jouissances resteront aussi les mêmes pour les personnes vicieuses ; mais les maux décroîtront pour elles dans une proportion immense. Les soins, les embarras, et quelquefois les maladies inséparables de la maternité, si pénibles même dans des familles qui ne manquent pas de moyens d’existence, lui seront ôtés ; elle n’aura nul besoin de suspendre le cours de ses mauvaises habitudes. Je ne parle pas du sort des enfants ; on verra ailleurs combien petit est le bien qu’on obtient à cet égard, en comparaison des maux au prix desquels on l’achète.
S’il se présente une troisième société qui établisse une maison pour recevoir et traiter à ses dépens celles de ces personnes qui, en se livrant à leurs habitudes vicieuses, ont contracté des maladies dangereuses, la peine du vice est encore affaiblie, non pour les personnes qui en souffrent sans en être atteintes, mais pour la personne qui en a seule éprouvé les jouissances ; les plaisirs qui entraînent vers le vice conservent toute leur puissance ; les seules peines qui peuvent le réprimer perdent de la leur.
Enfin, s’il se forme une quatrième société qui ait pour but de mettre les personnes qui se sont ainsi engagées dans une carrière vicieuse, à l’abri des funestes conséquences qu’entraînent à leur suite le mépris et l’abandon ; qui offre un asile aux prostituées sous le nom de repentantes ; qui leur fournisse des aliments, des vêtements, quand elles prennent en dégoût leur infâme métier ; qui cherche à leur rendre l’estime qu’elles ont perdue et à les faire rentrer dans la société d’où elles ont été exclues, les conséquences funestes du vice restent toujours les mêmes pour les personnes qui en sont innocentes ; mais elles semblent s’évanouir pour celles qui en sont coupables ; et comme l’affaiblissement des peines ne produit aucune diminution dans les jouissances, il n’y a presque plus de raison pour que, dans certaines classes, le vice ne se multiplie pas à l’infini [119].
Il s’est établi, dans une ville d’Angleterre, vers la fin de l’année 1824, une société d’environ trente ou quarante individus, dans la vue de supporter, en commun, les dépenses que chacun des membres encourrait pour l’entretien des enfants bâtards dont il pourrait être déclaré le père. Cette société, ayant son président, son trésorier, son secrétaire, a été dénoncée à l’opinion publique par les journaux, comme ayant pour objet évident l’encouragement du vice ; on l’a menacée de publier le nom de chacun des membres dont elle était composée, si elle ne se dissolvait pas [120].
Il est impossible de ne pas reconnaître, en effet, qu’une telle société est un encouragement pour le vice. Mais comment cela ? En ce qu’elle a pour effet de réduire en petites fractions une des peines que la loi concentre sur le seul individu qui est coupable. Si la déclaration de paternité, par exemple, est suivie de l’obligation de payer annuellement une somme de trois cents francs, l’association, en ne la supposant composée que de trente personnes, réduit cette somme, pour l’individu coupable, à une somme de dix francs. La crainte d’être obligé de payer toutes les années une somme de trois cents francs, aurait pu mettre un frein à ses passions ; la crainte de payer dix francs sera sur lui sans influence. Il est vrai que, si la trentième partie seulement de la peine qu’il aura encourue, tombe sur lui, il aura à supporter la trentième partie de la peine encourue par chacun de ses associés. S’il a à payer dix francs pour son compte, il aura à payer deux cent quatre-vingt-dix francs pour le compte d’autrui ; mais cette dernière partie de la peine, quoique la plus considérable, sera sans influence sur sa conduite, puisqu’elle n’en sera pas une conséquence.
Cette société, évidemment immorale, puisqu’elle réduit à un trentième, pour l’individu coupable, une des principales peines qui tendent à réprimer ses vices, et qu’elle fait retomber sur d’autres individus les vingt-neuf trentièmes qui restent, est cependant moins immorale dans ses effets, que les associations dont j’ai précédemment parlé, et qui existent, sous des noms divers, dans toutes les grandes villes de l’Europe, et particulièrement en Angleterre. Supposons, en effet, que les membres de cette société, après avoir convenu qu’ils supporteraient en commun les condamnations encourues par eux individuellement, eussent ajouté qu’ils fourniraient également en commun aux femmes séduites par quelqu’un d’entre eux, les moyens de faire leurs couches dans une maison commode, leur association n’eût-elle pas été un nouvel encouragement au vice ? Cet encouragement ne serait-il pas devenu plus grand encore, s’ils eussent ajouté qu’ils feraient traiter à leurs frais, et dans des maisons à eux, toutes les maladies qui seraient le produit du vice ; qu’ils délivreraient les mères de tous les soins de la maternité, et qu’ils en supporteraient les frais en commun ? La séduction ne serait-elle pas devenue plus puissante, s’ils avaient ajouté qu’un asile serait ouvert à leurs frais aux femmes qui, après avoir mené avec eux une vie licencieuse, voudraient rentrer dans le sein de la société, et qu’on ne négligerait aucun moyen pour leur procurer une existence honorable ?
Mais que n’aurait-on pas dit si, après avoir formé une semblable association, on l’avait annoncée publiquement et avec ostentation ; si l’on avait sollicité des souscripteurs d’y prendre part ; si l’on s’était adressé aux âmes bienveillantes et charitables ; si l’on avait ouvert de vastes établissements pour mettre à exécution de si magnifiques projets, et que toutes les femmes de toutes les classes, de toutes les conditions, eussent été appelées à lire, sur le frontispice, les encouragements qu’on leur eût donnés ? Les membres d’une telle association eussent été certainement accusés d’être les corrupteurs de la morale publique, et condamnés par tout tribunal jaloux de faire respecter les bonnes mœurs. Quelles sont cependant les différences qu’il y aurait entre une société telle que je la suppose, et celles qui existent dans la plupart des villes de l’Europe ? Une seule : dans le cas que je suppose, les associés ne donnent de l’encouragement qu’à leurs propres vices et aux vices des personnes qui consentent à devenir leurs complices et à profiter de leurs bienveillantes institutions ; le nombre des femmes qui peuvent être séduites est nécessairement limité par le nombre des hommes qui peuvent les séduire ; mais, dans les établissements qui existent réellement, l’appel fait au vice est universel pour les deux sexes. Il est vrai que ces établissements ont été faits dans de bonnes intentions ; mais quelle influence peut avoir, sur une institution vicieuse, l’intention de celui qui l’a fondée ?
Si les institutions, au moyen desquelles on espère diminuer pour les personnes vicieuses, les peines qui tombent uniquement sur elles, et qui sont le seul moyen de répression que nous connaissions, produisaient les effets qu’on en espère, elles seraient essentiellement mauvaises, puisqu’elles multiplieraient les vices en les encourageant, et que de tous les maux qui en seraient les conséquences, il n’y aurait d’adoucie que la part qui tomberait sur les personnes vicieuses. Mais, ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’elles produisent le premier de ces deux effets, sans produire le second. Elles n’ont qu’un résultat bien évident ; c’est de rendre incertaines les peines répressives des vices, sans presque rien leur enlever de leur réalité. Elles agissent dans le même sens que les loteries : elles donnent des espérances à tous ceux qui veulent courir quelque risque ; mais, pour un individu qu’elles sauvent d’une ruine complète, elles causent la perte d’une multitude.
On a observé que le nombre de femmes publiques qui existent à Londres excède de beaucoup le nombre de celles qui existent à Paris, même toute proportion de population gardée. Paris est cependant le séjour d’une multitude d’étrangers oisifs ; le nombre de militaires qui s’y trouvent, et particulièrement d’officiers, est très considérable ; toutes les grandes écoles y sont établies ; enfin, dans aucune partie de l’Europe on ne trouve réuni, sur un espace aussi étroit, un nombre aussi considérable de jeunes gens ou de célibataires ; tandis qu’à Londres on ne voit qu’un petit nombre d’étrangers que leurs affaires y attirent ; que le petit nombre de militaires qui s’y trouvent, sont la plupart mariés, même les simples soldats ; qu’il n’y existe point d’université ; que les parents en éloignent leurs enfants le plus qu’ils peuvent ; et qu’à l’exception des spectacles, il n’y a presque point de réunion publique pour les deux sexes. La capitale de France renferme cependant un nombre assez considérable d’institutions propres à encourager le vice ; mais elle en possède beaucoup moins que la capitale de l’Angleterre, et les maux que le vice engendre pour ceux qui en sont infectés, inspire aux Anglais bien plus de pitié qu’aux Français. En France, une femme publique et une femme perdue sont deux expressions parfaitement synonymes : aussi, le nombre n’en est-il pas très grand, comparativement à ce qui en existe dans d’autres pays. En Angleterre, il n’y a point de femmes perdues ; et c’est ce qui fait qu’il y a une multitude immense de femmes publiques [121].
Il est plusieurs genres de vices dont le principal effet est de produire la misère pour l’individu qui les a contractés ; une institution qui a pour objet de mettre à l’abri de la misère toute sorte de personnes, sans distinction des causes qui l’ont produite, a donc pour résultat d’encourager tous les vices qui conduisent à la pauvreté. Les tribunaux ne peuvent condamner à l’amende les individus qui sont coupables de paresse, d’intempérance, d’imprévoyance, ou d’autres vices de ce genre ; mais la nature, qui a fait à l’homme une loi du travail, de la tempérance, de la modération, de la prévoyance, a pris sur elle d’infliger aux coupables les châtiments qu’ils encourent. Rendre ces châtiments vains en donnant droit à des secours à ceux qui les ont encourus, c’est, comme dans les cas précédents, laisser au vice tous les attraits qu’il a ; c’est laisser agir, de plus, les maux qu’il produit pour les individus auxquels il est étranger, et affaiblir ou détruire les seules peines qui peuvent le réprimer. Les lois qui établissent en Angleterre un impôt en faveur de tous les pauvres indistinctement ; celles qui, dans quelques parties de la Suisse, mettent à la charge des paroisses ou des communes tous les habitants indigents, quelle que soit la cause de leur indigence ; enfin, celle qui, dans les États-Unis, établissent des dispositions semblables, ont donc pour effet de multiplier un grand nombre de vices [122].
Tous les vices ne produisent pas pour les individus qui en sont atteints, la même quantité, ni le même genre de peines : il en est plusieurs, ainsi que je l’ai déjà fait observer, qui ne produisent que des peines morales, telles que le mépris, l’aversion, l’exclusion de certaines sociétés, et autres analogues. Ces peines amènent quelquefois à leur suite des peines physiques très graves ; mais quand on paralyse les premières, les secondes ne sont plus à craindre.
Ici, plusieurs questions intéressantes se présentent : quels sont les vices qui ne produisent pour les individus qui en sont atteints, que des peines morales ? Quelles sont les conséquences de ces vices pour les individus autres que ceux qui en sont atteints ? Quels sont les actes des gouvernements, des associations privées, ou des peuples qui diminuent, pour les individus vicieux, la publicité, l’intensité, la durée, la certitude des peines morales propres à réprimer ces vices ? Quels sont, pour le public, les effets de cet affaiblissement de peines ? La solution complète de toutes ces questions exigerait un ouvrage fort étendu : pour ne rien laisser à dire, il faudrait faire un traité de morale et présenter en même temps l’histoire des gouvernements. Je me bornerai à les éclaircir par quelques explications.
On a plusieurs fois tenté de produire ou de réprimer, par la force de l’autorité publique, des actions ou des habitudes qui ne peuvent être produites ou réprimées que par la force de la morale : j’ai fait voir pourquoi ces tentatives ont toujours mal réussi. Mais il est beaucoup d’actions qui sont restées sous l’empire exclusif de la morale, et qui auraient dû être réprimées par la force de l’autorité publique.
Il s’est trouvé des princes qui ont porté assez d’intérêt à leurs sujets pour vouloir régler leurs dépenses privées et réprimer, par des lois pénales, le vice de la dissipation ou de la prodigalité. Il ne s’en est encore rencontré aucun qui ait imaginé qu’il était nécessaire de réprimer, par le même moyen, l’avidité, la bassesse ou l’orgueil de ses courtisans, les dilapidations ou les concussions de ses ministres, l’ineptie des gens en place, les attentats portés par les agents de son gouvernement au bien-être des individus ou des nations. Dans tous les États de l’Europe, sans en excepter l’Angleterre, tous ces faits sont restés dans le domaine de la morale ; je pourrais même dire dans le monde entier, si j’exceptais les États-Unis d’Amérique, dont les institutions ne souffrent pas les vices de ce genre.
La bassesse, la cupidité, l’orgueil, l’ambition, la perfidie, la vengeance, la cruauté, la rapacité, ne sont pas des vices qui, dans nos pays prétendu civilisés, produisent des maux physiques pour les individus qui en sont atteints, lorsque ces individus se trouvent dans les hauts rangs de la société. Les mêmes vices, dans les rangs inférieurs, peuvent conduire au vol, à l’outrage, à l’assassinat, et attirer sur les individus chez lesquels ils se trouvent, des peines physiques très graves, soit qu’elles leur soient infligées dans le moment de l’action par les personnes qu’ils offensent, soit qu’elles leur soient infligées en vertu d’une condamnation légale ; en produisant le mépris et l’aversion, ces vices produisent souvent la misère, qui est elle-même très féconde en douleurs de tous les genres. Lorsqu’ils se trouvent dans les rangs élevés, ils conduisent rarement devant les tribunaux les individus qui les ont contractés ; il est plus commun qu’ils soient une source de richesses, et par conséquent de jouissances physiques. Si Louvois fût né dans les rangs d’où sortit Cartouche, il eût fait brûler, par sa bande, les maisons de quelques magistrats ; il eût péri sur le bûcher ou sur la roue, et Bossuet n’eût pas fait son oraison funèbre. Si Cartouche fût né dans les rangs d’où sortit Louvois, il eût, sans doute, fait piller le Palatinat, mais il est probable qu’il ne l’eût pas fait brûler. Il eût joui en paix du produit de ses déprédations ; et eût emporté, en mourant, les regrets des gens de bien et les bénédictions de l’Église.
Il est donc des actions vicieuses, et, si l’on veut, des crimes qui ne produisent pour ceux qui en sont les auteurs, aucune douleur physique ; ils ont pour effet, au contraire, de produire beaucoup de plaisirs du même genre ; et puisque aucune peine légale ne les réprime, ils ne peuvent être réprimés que par des peines morales : par le mépris, par l’aversion, par la haine qu’ils inspirent au public, contre ceux qui en sont les auteurs, et contre ceux qui en profitent. Les peines de ce genre en produisent une autre qui est la plus puissante ; c’est l’absence de toute sécurité, et la certitude d’être abandonné ou accablé dans les revers. Un homme dont les vices ou les crimes ont fait le malheur d’une ou de plusieurs nations, se sent livré, sans défense, aux courtisans qui l’environnent, s’il est roi ; ou à l’arbitraire du maître qu’il a servi, s’il est sujet. Les courtisans de Néron se délivrent, par la mort, de la crainte qu’il leur cause ; Néron, pour se délivrer des terreurs que lui inspirent ses ennemis, appelle sur son propre sein le poignard de son affranchi.
Les vices qui ne sont réprimés par aucune peine physique produisent donc pour ceux qui les ont contractés et pour ceux qui en sont les instruments, un mélange de plaisirs physiques et de peines morales ; mais ils produisent, pour une immense multitude de personnes, des peines de tous les genres, sans aucun mélange de plaisir : ils produisent la servitude, l’absence de toute sécurité, la misère, l’ignorance, les persécutions, les guerres, les massacres, et toutes les calamités que le despotisme traîne à sa suite.
Les peuples n’ayant pas d’autres garanties contre ces maux, que les peines morales que les vices produisent pour les individus vicieux et pour ceux qui profitent de leurs vices, quels sont les moyens par lesquels on peut accroître ou diminuer la publicité, l’intensité, la durée, et la certitude de ces peines ?
Le moyen le plus sûr d’ôter à la peine sa publicité, c’est d’empêcher qu’il puisse se former aucune opinion publique, et d’enlever à chacun tout moyen d’exprimer son opinion individuelle : soumettre à une censure préalable et arbitraire tous les écrits destinés à être publiés ; empêcher toute réunion publique dans laquelle les citoyens pourraient se communiquer leurs sentiments ; punir toute personne qui oserait appeler l’aversion ou le mépris sur un homme qui, par ses actes, se serait rendu odieux ou méprisable : des sentiments qui ne peuvent pas se manifester, sont considérés, par la plupart des hommes, comme s’ils n’existaient pas.
Les mêmes actes qui portent atteinte à la publicité de la peine, en diminuent l’intensité ; le mépris et l’aversion qui restent ensevelis dans le fond des âmes, sont un châtiment moral moins sévère que le mépris et l’aversion qu’on manifeste publiquement. Ces actes en diminuent aussi la certitude et la durée : on doute de l’existence de sentiments que rien ne manifeste, et le temps affaiblit ou éteint ceux qu’on n’a aucun moyen de mettre au jour. Il n’est aucun gouvernement qui, voulant établir le règne d’un certain nombre de vices, n’ait senti le besoin d’affaiblir les peines répressives de ces mêmes vices, et qui n’ait cherché à détruire la publicité de ces peines.
Le moyen le plus sûr d’en diminuer la certitude, est d’attacher l’estime ou le mépris à des signes de convention dont l’autorité se réserve la distribution arbitraire. Un homme fait une action utile à son pays, on lui donne le signe convenu, et le public honore le signe à cause du mérite de la personne. Un autre fait quelque bassesse, devient le complice heureux de quelque concussion ou de quelque trahison, on lui donne le même signe ; et comme, dans le premier cas, le public a honoré le signe à cause du mérite de l’homme, dans le second, il honore l’homme à cause de l’honneur qu’il a accordé au signe. C’est ainsi qu’on peut faire servir les hommages que les peuples accordent aux vertus, à rendre incertains les châtiments que la nature a destinés à la répression des vices. Cela nous explique comment il s’est trouvé des hommes qui ont repoussé les prétendus honneurs qu’on daignait leur accorder. Ils n’ont pas voulu que l’estime dont le public les environnait, pût être représentée par un signe qui, au besoin, servirait à couvrir les vices de l’individu le plus infâme. Ces signes consistent quelquefois dans un sobriquet, quelquefois dans un morceau d’or ou d’argent, quelquefois dans une broderie, dans un morceau de ruban, ou même dans une jarretière. Quelquefois aussi on considère la fortune comme le signe infaillible du mérite d’un individu ; alors il ne s’agit plus que d’avoir part au pillage d’un peuple, pour être estimé de lui. D’autres fois, le mérite consiste dans la manifestation d’une opinion ; alors chacun est estimé en raison de son talent pour l’hypocrisie.
Il est impossible de multiplier les vices sans décroître dans la même proportion le nombre des vertus. Toutes les fois donc qu’on diminue la publicité, l’intensité, la certitude ou la durée d’une peine destinée à la répression d’une habitude vicieuse, on affaiblit, par cela même, l’habitude contraire. Il arrive cependant quelquefois qu’au lieu d’attaquer indirectement les habitudes vertueuses, on les attaque d’une manière directe, en diminuant la publicité, l’intensité, la certitude ou la durée des avantages qui en sont la conséquence naturelle. Si un homme, par exemple, rend un service important à une nation, et qu’il en soit récompensé par des honneurs particuliers ou par des richesses, l’acte qui empêchera la publicité de la récompense, ou qui en ravira le fruit à celui auquel elle aura été accordée, ou qui en menacera les auteurs de quelque peine, sera un acte essentiellement immoral. Lorsqu’un gouvernement parvient à rendre stérile le dévouement des hommes aux intérêts de leur pays ou de l’humanité, on ne trouve pas longtemps des citoyens dévoués [123].
[I-516]
Nous pouvons tirer de ce qui précède trois conséquences générales. La première, qu’il est des actions malfaisantes que les lois pénales ne peuvent pas atteindre, et des actions bienfaisantes qu’elles ne peuvent pas commander. La seconde, que les premières de ces actions ne peuvent être réprimées que par les peines physiques, morales ou intellectuelles qu’elles engendrent pour ceux qui en sont les auteurs ; et que les secondes ne peuvent être produites qu’au moyen des récompenses qui en sont la suite naturelle. La troisième est que tout acte au moyen duquel on diminue la publicité, l’intensité, la certitude ou la durée de la peine que le vice produit pour l’individu vicieux, est un acte immoral, un acte dont l’effet est de multiplier les vices ; et qu’un acte qui a pour effet de diminuer la publicité, l’intensité, la certitude ou la durée des avantages qui sont la conséquence des habitudes vertueuses, est également contraire aux bonnes mœurs, puisqu’il a pour résultat de diminuer le nombre des bonnes actions.
En disant qu’il est des souffrances que l’intérêt de l’humanité nous défend de soulager, et des avantages dont il faut laisser la jouissance exclusive à ceux à qui la nature l’a attribuée, j’offenserai, je n’en doute pas, les sentiments de plus d’un lecteur. La religion et l’humanité ne nous ordonnent-elles pas de soulager toutes les personnes qui souffrent ? Tous les hommes ne sont-ils pas frères ? Ne doivent-ils pas partager les biens et les maux qu’ils tiennent de leur auteur commun ? Est-il permis à l’homme de se montrer inexorable et sans pitié envers quelqu’un de ses semblables ?
Je ne dis point qu’il ne faut pas soulager les personnes qui souffrent ; je dis seulement que l’individu qui, pour diminuer la souffrance d’une personne, cause à d’autres des souffrances plus graves, ne fait pas une bonne action. Un homme imprudent tombe dans la mer ; si l’on ne peut le sauver qu’en perdant l’équipage, c’est une triste nécessité, mais il faut le laisser périr. La religion nous ordonne de secourir les personnes souffrantes, de consoler les affligés ; sans doute, mais elle nous défend aussi de produire des souffrances et des afflictions. Un homme souffre de la faim ; la religion ordonne de lui donner à manger ; mais si on ne le pouvait qu’en affamant une ville, la religion ordonnerait-elle de le secourir ?
On éprouve, sans doute, un sentiment pénible à voir des êtres souffrants, et à ne pas leur donner des secours dont on peut disposer ; mais quand, dans la vue de réprimer les crimes, la justice frappe les coupables, faut-il, par humanité, s’insurger contre elle ? Faut-il affranchir les condamnés de leurs peines ? Penserait-on que les lois établies par les gouvernements pour la répression des crimes, sont plus justes que celles que la nature elle-même a établies pour la répression des vices ? Les jugements de nos tribunaux nous paraîtraient-ils plus infaillibles que les lois mêmes de notre propre nature ? Si l’utilité du pouvoir de faire grâce a pu être mise en question, même avec nos lois défectueuses et nos tribunaux sujets à prévention et à erreur, qui osera prendre sur lui-même de faire grâce à quelqu’un, de la peine destinée à la répression de ses vices ? Si le vice est constant, qui osera dire que la peine est mal appliquée ou excessive ? Pense-t-on qu’il existerait quelque justice sur la terre, si la faculté d’exercer le pouvoir de faire grâce appartenait indistinctement à tous, et si chacun en faisait usage ?
Dans tous les États de l’Europe, la disposition des peuples à affaiblir, pour les individus vicieux, les peines répressives du vice, est en raison directe du besoin même qu’ils ont de la répression. Si une mauvaise habitude produit peu de jouissances pour celui qui l’a contractée, et si elle est en même temps productive de misère, de maladies physiques et de douleurs morales, les peuples seront assez disposés à se montrer sans pitié : ils laisseront agir, dans toute leur rigueur, les châtiments que la nature a réservés à la répression des vices de cette espèce. Mais, si un vice qui produit d’effroyables calamités pour le genre humain, produit, pour celui qui l’a contracté, de grandes richesses, et par conséquent beaucoup de plaisirs physiques, chacun sera disposé à faire grâce, à l’individu vicieux, des peines morales qui auraient pu le réprimer. On dissimulera le mépris, l’aversion qu’on aura pour lui ; et s’il se trouve un homme qui ait assez de courage et de probité pour exprimer hautement sa pensée, on l’accusera de manquer de politesse ou de savoir-vivre, peut-être même d’être un homme grossier et mal élevé.
Après avoir aplani les voies à la prostitution, après avoir publiquement promis aux femmes qui voudraient entrer dans cette carrière, de les débarrasser des dépenses et des soins de la maternité, de les traiter dans leurs maladies, de leur donner asile en cas d’abandon, de les rétablir, autant que possible, dans l’estime publique, et même de leur assurer des moyens d’existence pour la fin de leurs jours, on paraît avoir cru qu’il fallait établir aussi un pénitentiaire pour les prostitués des gouvernements. Si, après avoir été l’instrument de quelque trahison ou de quelque bassesse ; après avoir, par cupidité, par vengeance ou seulement par vanité, plongé dans la désolation des populations entières ; après avoir appelé la proscription sur une multitude de familles innocentes, et fait livrer au supplice les hommes les plus estimables de leur pays, quelque grand coupable est repoussé comme un vil instrument par les individus dont il a servi les projets, il n’a qu’à débiter quelques phrases, et à protester de ses bonnes intentions, et aussitôt des âmes charitables et bienveillantes accourent pour soigner ses blessures, pour lui donner des consolations, pour le rétablir dans l’estime publique.
[I-520]
N’est-ce donc pas une erreur de dire que la nature elle-même a attaché une peine à chaque vice, afin de le réprimer ? S’il est une multitude de vices qui ne sont suivis, pour ceux qui les ont contractés, d’aucune peine physique, et si les peuples eux-mêmes prennent soin de rendre nulles les peines morales, en cachant ou en étouffant le mépris et la haine que leur inspirent naturellement les grands malfaiteurs, quel est donc le châtiment qui leur est réservé ?
En disant que tout vice entraîne pour celui qui en est atteint, une somme de maux plus ou moins considérable, je n’ai pas affirmé que ces maux arrivaient toujours ; j’ai fait voir, au contraire, que les peuples avaient le moyen de les affaiblir, et j’ai montré à quel prix ils pouvaient y porter remède. Les peuples se trouvent relativement aux habitudes vicieuses, exactement dans la même position où ils sont relativement aux actions criminelles : il faut qu’ils optent entre les maux de la répression et les maux de l’impunité. Juges ignorants ou corrompus, ils peuvent absoudre un tyran et ses satellites de leurs crimes ou de leurs bassesses ; mais ils seront châtiés eux-mêmes de leur ignorance ou de leur corruption ; ils le seront par la multiplication même des tyrans et de leurs satellites. Ils peuvent laisser dans l’oubli, et persécuter même les hommes qui se sont dévoués à leur défense ; mais ils seront punis de leur ingratitude ou de leur iniquité, par l’extinction de tout sentiment généreux, et par l’abandon sous la verge de leurs bourreaux. Les crimes ou les vices de quelques grands coupables peuvent rester impunis ou ne l’être qu’imparfaitement ; mais les vices qui produisent l’impunité restent-ils aussi sans châtiment ? Les supplices que les forts ont toujours réservés aux lâches auraient-ils des charmes pour ceux qui les éprouvent ?
Il n’est point de vice, quand il devient général, qui ne prenne quelque nom honorable. Tant qu’un homme jouit d’un grand pouvoir, on n’oserait dire ce qu’on pense de ses vices ou de ses crimes ; ce serait manquer de prudence, et oublier d’ailleurs ce qu’on doit aux rangs et aux dignités. Lorsqu’il chancèle dans sa puissance, ou qu’il en est déchu, il y aurait de la lâcheté à l’attaquer. Lorsqu’il a cessé de vivre, il ne peut plus se défendre, et ce serait manquer de générosité d’attaquer des hommes auxquels la défense est impossible ; cela ne peut convenir à des peuples braves et généreux.
On dirait, à entendre un pareil langage, qu’il n’y a, sur la terre, de jugements justes que ceux qui se décident en champ clos ou sur les champs de bataille. Mais comment ceux qui parlent ainsi, ne l’adressent-ils pas aussi à la justice ? Ce misérable que l’on expose sur une place publique, désarmé, les bras attachés, environné d’une force militaire imposante, n’est-il pas aussi un être faible et sans défense ? Que ne demandez-vous, ayant qu’un fer brûlant imprime sur lui la marque de sa flétrissure, qu’on lui rende la liberté, qu’on le laisse s’armer de son poignard, et appeler autour de lui une bande armée de complices ? Un combat corps à corps entre les malfaiteurs et les magistrats chargés de rendre la justice ne serait-il pas digne d’une nation brave, généreuse, loyale ? Tacite a flétri Séjan et Tibère, et Séjan et Tibère ne pouvaient plus se défendre. La flétrissure qui s’attache au nom ou à la mémoire des grands criminels, est la seule peine que reconnaissent les hommes qui jouissent d’une grande puissance. Plus cette peine est rapprochée du crime, et plus elle a de certitude et d’intensité ; plus, par conséquent, elle est efficace. Il vaut mieux qu’un tyran et ses satellites soient flétris pendant le cours de leur règne, que de l’être seulement lorsqu’ils ont été déchus du pouvoir. Mais il vaut encore mieux qu’ils le soient aussitôt qu’ils ont perdu leur puissance, que s’ils ne l’étaient qu’après leur mort. En un mot, toutes les fois qu’un certain genre de vices ou de crimes ne peuvent être réprimés que par des peines morales, par le mépris, l’aversion, le délaissement, tous actes, toutes maximes qui tendent à diminuer la proximité, la certitude, l’intensité et la durée de ces peines, tendent, par cela même, à la multiplication de ces crimes. Tous actes ou toutes maximes qui tendent, au contraire, à augmenter la proximité, la certitude, l’intensité et la durée de ces mêmes peines, tendent à l’extirpation des mêmes crimes et des mêmes vices.
[I-523]
Il n’est pas difficile d’apercevoir les causes qui déterminent les jugements des nations, relativement à certains vices ou à certains crimes. Les actions vicieuses ou criminelles qui ne peuvent être réprimées que par des peines morales, sont, en général, celles qui appartiennent à des hommes investis d’une grande puissance ; mais ces hommes ne peuvent être malfaisants sans avoir de nombreux complices, et sans partager avec eux les avantages que le vice ou le crime leur rapporte. Lorsqu’ils tombent, ceux-ci restent debout, et ont un double intérêt à ce que le châtiment ne suive pas de très près l’offense. D’abord, ce châtiment tomberait en partie sur eux ; et en second lieu, il leur ravirait l’espérance qu’ils peuvent avoir de servir quelque autre grand coupable.
« Comme le plus grand supplice des tyrans est la peur, dit Montesquieu, le plus grand crime dont on puisse se rendre coupable envers eux, est de leur faire peur. » Ce que cet illustre écrivain a dit des tyrans, nous pouvons le dire de tous leurs complices. Il résulte de ce sentiment de crainte, que presque tous les hommes qui ont été investis d’un grand pouvoir, ont cherché à fausser le jugement des nations, sur les vices et les crimes qui sont particuliers à certains rangs. Dans tous les pays, ce sont les maîtres qui ont façonné l’entendement des esclaves, et ils l’ont toujours façonné dans l’intérêt de l’esclavage et des vices qui en sont tour à tour la cause et le résultat. Les dernières réformes auxquelles un peuple songe, ce sont celles de ses préjugés et de ses idées ; même lorsque l’excès de sa misère le contraint à secouer le joug, il continue, pendant longtemps, à rendre des jugements tels que les avait dictés l’intérêt de ses oppresseurs ; et c’est en cédant à une fausse pitié qu’il se prépare des calamités nouvelles.
Tout homme, en venant au monde, trouve devant lui deux carrières : celle des vertus et des belles actions, et celle des vices et des crimes ; il faut, autant qu’il est possible, jeter sur l’une et sur l’autre la plus vive lumière ; mais, après les avoir éclairées et avoir montré où chacune d’elles conduit, il ne reste qu’une sauvegarde aux nations : c’est de placer à l’entrée de la dernière cette inscription terrible de l’enfer du Dante :
PER ME SI VA NELLA CITTA DOLENTE :
PER ME SI VA NELL’ ETERNO DOLORE :
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.
GIUSTIZIA MOSSE ‘L MIO ALTO FATTORE.
……………………………………………….
LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ ENTRATE.
FIN DU PREMIER VOLUME.
Notes↩
[1] Si quelques personnes consultaient encore ce que j’ai écrit dans le Censeur, ce sont, en général, les parties relatives à l’organisation ou à la distribution des pouvoirs politiques, qu’elles devraient consulter avec le moins de confiance.
[2] De Montlosier, De la monarchie française depuis la restauration jusqu’à la fin de 1816.
[3] Voici les propres paroles de Rousseau : « Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l’État quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement les lois, la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu’un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu’il soit puni de mort, il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois. » Du Contrat social, liv. IV, ch. 8.
On voit clairement ici que Rousseau attache la peine de bannissement, non à une mauvaise action, mais à un défaut de croyance ; il attache la peine de mort, non à un fait déterminé, mais à la présomption d’un mensonge relatif à cette croyance. Je dis à la présomption, car il n’est pas rare qu’un homme agisse contre sa croyance actuelle, et surtout contre la croyance qu’il a eue à une époque antérieure.
[4] Le principe de l’utilité, que M. Jérémie Bentham a fait servir de base à ses traités de législation, a été fortement attaqué soit en Angleterre, soit en France ; et ce qu’il y a de singulier, c’est qu’il a été attaqué, dans ce dernier pays, par un écrivain qui a eu presque toujours pour but dans ses écrits de faire triompher l’utilité publique sur l’utilité particulière (Voyez la préface de l’ouvrage de M. Benjamin Constant sur la religion). On a considéré le principe de M. Bentham comme une nouveauté dangereuse ; cependant au temps où Grotius écrivait, cette nouveauté avait déjà plus de deux mille ans d’existence ; et, depuis Grotius jusqu’à nos jours, il n’est presque point de publicistes qui ne l’aient adoptée. Ce qui est véritablement nouveau, ce sont les attaques dont ce principe a été l’objet en théorie : les plus anciennes datent de la publication des ouvrages de M. Bentham.
[5] Une nation plus éclairée qu’une autre peut avoir cependant une législation plus vicieuse, si elle a le malheur d’être voisine de nations barbares qui influent sur la marche de son gouvernement. Ainsi quelques États de l’Europe, tels par exemple que ceux d’Italie et la France, peuvent, sous certains rapports, être moins avancés que les États-Unis d’Amérique sans être moins éclairés.
[6] Il est des écrivains qui considèrent les erreurs, les préjugés, les vices des peuples, comme les causes uniques de leurs mauvaises lois, de leurs mauvais gouvernements et de leur misère, et qui conseillent en conséquence à ces peuples d’être éclairés, industrieux, et vertueux, s’ils veulent avoir de bonnes lois, être bien gouvernés, et vivre heureux. Ces maximes sont plus faciles à donner qu’à pratiquer ; elles sont justes, s’il est en la puissance de tous les hommes d’être éclairés, et si les vices de chaque individu sont la cause première des maux qu’il souffre. Mais si ces vices sont les effets d’un ordre de choses donné, et si l’on n’a pas la puissance de changer cet ordre de choses, comment est-il possible de les détruire ? Qu’un prédicateur, par exemple, aille dire aux nègres dont les Européens ont fait des instruments de culture : « L’esclavage dans lequel vous êtes nés et qui vous rend si misérables, est l’effet de votre ignorance et de vos mauvaises mœurs ; les vices que vous reprochez à vos maîtres sont des résultats de vos propres vices, et la justice veut que vous en portiez la peine. Si des armées de blancs viennent se placer à côté de vos possesseurs pour rendre leur force insurmontable, c’est encore vous qui avez présidé à la formation de ces armées ; ce sont vos vices qui leur ont mis les armes à la main et qui les ont appelées. Vous êtes ignorants, parce qu’il ne vous plaît pas de vous instruire ; vous êtes paresseux, parce que vous ne comprenez pas les avantages du travail ; vous êtes faux et menteurs, parce que vous êtes des lâches ; vous êtes des lâches, parce que vous ne savez pas être les plus forts ; et vous ne savez pas être les plus forts, parce que vous avez des vices. » Si, dis-je, un missionnaire tenait ce discours aux esclaves de nos colonies, pense-t-on qu’il n’y aurait rien à lui objecter ? Pense-t-on que les raisons que les nègres pourraient donner, ne pourraient pas être données par un peuple de blancs ? Dans toutes les positions, un homme ou même un peuple ne peut pas être industrieux, éclairé et vertueux impunément.
[7] On ne détruit bien une idée fausse qu’au moyen d’une idée juste ; et quand la première a disparu, la seconde reste.
[8] On peut objecter contre cette méthode qu’elle nécessite des longueurs et qu’elle oblige l’esprit à s’arrêter sur des vérités triviales. Cela est vrai ; mais ce sont des objections qu’on peut faire contre toutes les sciences. Qu’y a-t-il de plus simple et de plus trivial que les descriptions que les botanistes nous donnent des plantes ? Qu’y a-t-il de plus commun que des vérités telles que celles-ci : 2 et 2 sont 4 ; qui de 3 ôte 2 reste 1 ? Ce n’est cependant qu’après avoir passé par des vérités de cette nature qu’on peut arriver à résoudre les problèmes les plus difficiles. Il en est de même dans les sciences morales ; c’est en observant les phénomènes les plus simples qu’on arrive à des résultats qu’on n’avait jamais soupçonnés.
[9] Il résulte de ces observations, que les personnes qui ont reçu la meilleure éducation morale, doivent être souvent au nombre de celles qui croient que, pour juger du mérite d’une action ou d’une habitude, il ne faut que consulter ses sentiments. Ces personnes, en effet, n’ont pas besoin d’autre chose pour bien juger et pour bien se conduire ; mais elles ne remarquent pas que, si leurs sentiments, et les habitudes de leur esprit, les dirigent avec tant de sûreté et sans qu’elles aient besoin de réflexion, ce n’est que parce qu’elles ont été élevées avec beaucoup de jugement et de réflexion ; elles tombent dans une erreur semblable à celle que commettrait un habile musicien qui aurait oublié les leçons qu’il aurait reçues, et qui s’imaginerait que les doigts et l’ouïe de l’homme sont naturellement habiles à exécuter et à juger de la musique.
[10] La contradiction entre les deux systèmes est plus apparente que réelle. Je ferai voir plus loin que ce n’est qu’une dispute de mots.
[11] Heinneccius, récit. lib. 1, tit. 2, § 40.
[12] Delvincourt, Instit. de droit civil, titre préliminaire.
[13] Esprit des lois, livre I, ch. 3.
[14] Lois civiles, ch. II, § 6.
[15] Esprit des lois, liv. 26, ch. 4.
[16] Esprit des lois, liv. 1, ch. 2.
[17] Ibid.
[18] Les jurisconsultes considèrent les lois naturelles comme étant éternelles et immuables, et les lois positives comme temporaires et révocables à volonté ; mais cela ne les empêche pas de faire résulter une loi naturelle d’une loi positive. L’esclavage domestique, par exemple, ne peut exister qu’en vertu d’une loi positive ; il est condamné par la loi naturelle. (L. 4 Dig. de just. et jur. L. 32, Dig. de reg. jur.) Cependant ce sont les lois de la nature qui sanctionnent les obligations des affranchis envers leurs patrons : Naturâ enim opera patrono libertus debet. Dig. lib. 12, tit. 6, l. 26, §. 2.
[19] Essai sur l’entendement humain, liv. I, ch. 2.
[20] Histoire et description générale du Japon, par Charlevoix, liv. préliminaire, ch. 2 et 9, et supplément ch. 8.
[21] Voyez l’Essai sur l’entendement humain, liv. 1, ch. 2, §. 9.
[22] Traité de législation civile et pénale, tome I, ch. 13, n. 10.
[23] Traité de législation civile et pénale, ch. 13, n. 10, t. 1, p. 137.
[24] Delvincourt, Institutes du droit civil français, tome I, p. 2 et 3. — Ce jurisconsulte aurait dû nous expliquer ce qu’il entend par le passé relativement à des lois qui, suivant lui, sont éternelles.
[25] Traité de législation civile et pénale, ch. 13, n. 10, t. I, pag. 133-136.
[26] M. Bentham, en considérant les peines et les plaisirs comme sanctions des lois, divise les biens et les maux en quatre classes : physiques, moraux, politiques, religieux. Il dit ensuite que les peines et les plaisirs qu’on peut éprouver ou attendre dans le cours ordinaire de la nature, agissant par elles-mêmes sans intervention de la part des hommes, composent la sanction physique ou naturelle. Mais comment n’a-t-il pas conclu de l’existence de la sanction qui agit sans intervention de la part des hommes, et qu’il nomme naturelle, l’existence même de la loi ? On aperçoit encore ici l’erreur, qui consiste à ne considérer comme naturel rien de ce qui est le résultat de l’ordre social. Voyez les Traités de législation civile et pénale, t. I, ch. 7, p. 46-47.
[27] Le mensonge et l’erreur sont les seuls moyens qui puissent produire un tel effet.
[28] De toutes les puissances, la plus naturelle, la plus incontestable et la plus bienfaisante, est celle d’un père sur ses enfants : celle-là du moins n’est le résultat ni de la violence ni de l’usurpation, ni de la fraude ; on peut en dire autant de la puissance du mari sur sa femme. Il est remarquable cependant qu’en reconnaissant et en consacrant ces deux puissances, les législateurs ne les ont pas considérées comme des droits ; cela résulte du titre même des lois où il en est question. La conversion de l’autorité des magistrats en droits, est le signe le plus infaillible de la tyrannie : c’est le caractère auquel on peut reconnaître qu’un peuple est considéré comme une possession.
[29] Certains philosophes s’accordent avec quelques hommes qui poussent jusqu’à la manie l’amour du despotisme, à faire intervenir la religion dans la formation des lois ; ils diffèrent en un seul point : ceux-ci veulent que les lois protègent Dieu et qu’elles en soient protégées à leur tour ; ceux-là veulent qu’elles soient l’expression de la volonté des dieux, ou qu’elles soient sanctionnées par eux. Suivant Raynal, les lois pénales tombent en désuétude, à moins que le code ne soit sous la sanction des dieux. Pourquoi des dieux ? Les écrivains qui veulent faire du mensonge le fondement de la morale et de la législation, emploieraient-ils le pluriel de peur de passer pour des hommes crédules s’ils employaient le singulier ? Penseraient-ils que, la religion chrétienne ne faisant plus de miracles, il faut en faire faire par les dieux d’Homère et de Virgile ?
[30] Contrat social, liv. 1, ch. 8 et 9.
[31] Ibid. liv. 2, ch. 6.
[32] Contrat social, liv. 1, ch. 6.
[33] Contrat social, liv. 1, ch. 3.
[34] Contrat social, liv. 2, ch. 3.
[35] Ibid. ch. 6.
[36] On a souvent comparé un peuple à un individu ; on a parlé en conséquence de son enfance, de sa jeunesse, de sa maturité, de sa vieillesse, et même de sa taille, et l’on a gravement raisonné sur ces mots comme s’ils représentaient quelque chose. Ce n’est pas là le moins absurde des systèmes.
[37] Contrat social, livre 2, ch. 8.
[38] Ibid, liv. 2, ch. 2, note.
[39] Contrat social, liv. 4, ch. 2.
[40] Contrat social, liv. 2, ch. 1.
[41] Contrat social, liv. 4, ch. 2.
[42] Contrat social, liv. 1, ch. 4, 8, et 9.
[43] Contrat social, liv. 1, ch. 7.
[44] Ibid, liv. 2, ch. 5.
[45] Contrat social, liv. 2, ch. 6.
[46] Rousseau aurait-il pensé que, sous les gouvernements asiatiques, les lois sont l’expression de la volonté générale ? On pourrait être tenté de le croire, si on en jugeait par l’admiration qu’il a manifestée pour les Turcs dans plusieurs parties de ses ouvrages, et surtout par ce qu’il dit à la fin du chapitre Ier du livre 2 du Contrat social. « Ce n’est point, dit-il, que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le souverain libre de s’y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel, on doit présumer le consentement du peuple. » D’où l’on peut conclure que, dans l’empire turc, les volontés du sultan sont l’expression de la volonté générale jusqu’au jour où on l’étrangle. Il est vrai que, l’imprimerie étant inusitée en Turquie, il et difficile que des idées se répandent d’une manière assez régulière pour former ure volonté générale. Mais l’imprimerie n’est point nécessaire pour cela, et le gouvernement turc, qui en a défendu l’usage, a rendu service aux mœurs et à la liberté. Ainsi du moins le pensait Rousseau.
[47] Contrat social, liv. 2, ch. 6, 7 et 8.
[48] On verra plus loin ce qui arrive lorsque les législateurs s’avisent de régler les devoirs moraux des membres de la société.
[49] Th. Raynal pensait, à cet égard, comme Rousseau.
[50] Quand Figen, empereur du Japon, voulut faire enseigner la morale dans ses états, les bonzes lui opposèrent une si forte résistance et en furent si irrités, que, pour ne pas être la victime de leur zèle sacré, il fut obligé d’abdiquer. Charlevoix, Histoire générale du Japon, livre préliminaire, ch. 9.
[51] Voyez le Traité des garanties individuelles, par M. Daunou.
[52] Un théologien célèbre, saint Augustin, a prétendu que les gouvernements ne s’étaient emparés de la religion que pour disposer plus facilement des peuples (de Civitate Dei, cap. 32) ; et il est certain, en effet, qu’il n’y a pas de despotisme plus terrible que celui d’un gouvernement qui a joint au pouvoir civil et militaire l’autorité religieuse. Mais ne peut-on pas dire des prêtres qui envahissent le pouvoir civil, ce que saint Augustin dit des chefs des gouvernements, qui se font un instrument de la religion ? Que le magistrat s’arroge l’autorité du prêtre, ou que le prêtre s’arroge l’autorité du magistrat, n’est-ce pas exactement la même chose pour le public ? Ne sont-ce pas toujours des hommes qui réunissent les deux pouvoirs dans leurs personnes ?
[53] Jean-Jacques Rousseau admire beaucoup les législateurs qui ont fait de la religion la base de la morale et des lois. « Mahomet, dit-il, eut des vues très saines, il lia bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un, et bon en cela. » Ailleurs, il approuve la religion des Japonais ; la raison qu’il en donne est que « C’est une espèce de théocratie, dans laquelle on ne doit point avoir d’autre pontife que le prince, ni d’autres prêtres que les magistrats. Alors mourir pour son pays, c’est aller au martyre ; violer les lois, c’est être impie ; et soumettre un coupable à l’exécration publique, c’est le dévouer au courroux des dieux. » La religion chrétienne parait, au contraire, à Rousseau destructive de l’ordre social ; et, après en avoir fait le plus grand éloge, il cherche à prouver qu’elle est de toutes la plus mauvaise. Il résume ces observations en ces termes : « Mais je me trompe en disant une république chrétienne ; chacun de ces deux mots exclut l’autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie, pour qu’elle n’en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves ; ils le savent et ne s’en émeuvent guère : cette courte vie a trop peu de prix à leurs yeux. » Contrat social, liv. 4, ch. 8.
Pour compléter le parallèle qu’a fait Rousseau des diverses religions, il ne lui manquait plus que de prouver que les hommes avaient fait bien plus de progrès au Japon et dans l’empire de Mahomet, que chez les peuples chrétiens de France, d’Angleterre ou des États-Unis d’Amérique. S’il eût entrepris de prouver que les arts, les sciences, le commerce, les mœurs et les lois, étaient plus avancés chez les Japonais et chez les Turcs que chez aucun peuple chrétien, il n’eût manqué ni de raisons, ni d’admirateurs ; il eût trouvé bien plus de morale et de liberté à Constantinople qu’à Philadelphie.
[54] Bentham. (B. M.)
[55] On reconnaît volontiers, au moins en paroles, que le bien public ou l’utilité générale doit être le résultat de la législation ; mais chacun entend par bien public ou par utilité générale, l’utilité ou le bien exclusif de la nation dont il fait partie. Un Anglais, par exemple, dira, de très bonne foi, que les ministres de son roi, avant de proposer une loi au parlement, doivent calculer les biens et les maux qui en résulteront pour la nation anglaise, et se déterminer pour le parti qui produira le plus de bien ; mais, fut-il président d’une société biblique, il se moquera de vous, si vous lui dites que ses ministres doivent faire entrer dans leurs calculs les biens et les maux que la même loi produira pour les autres nations. Demandez-lui cependant pourquoi les ministres doivent consulter autre chose que leur intérêt personnel et immédiat, ou pourquoi ils ne doivent pas consulter l’intérêt de tous les hommes en général ? Il ne saura que répondre, à moins d’avoir recours au contrat social, à des conventions primitives, ou à d’autres absurdités de ce genre. Ainsi, même lorsqu’on admet le principe de l’utilité générale comme base de la législation, on d’entend qu’une utilité privée relativement au genre humain ; d’où il résulte que la morale n’a point de base, et que tout se réduit à savoir quel est le plus fort dans un moment donné. J’ai cité de préférence un Anglais, parce que c’est un des peuples qui raisonnent le mieux sur la législation ; mais j’aurais pu tout aussi-bien prendre mon exemple en France ou même en Amérique.
[56] Il suit évidemment de là que la législation et la morale ne peuvent faire des progrès durables et assurés, que par une grande diffusion de lumières, et par l’action générale du genre humain sur les individus ou sur les collections d’individus qui cherchent leur bien particulier dans les maux du grand nombre, et qui se sentent dispensés à demander pourquoi le bonheur public doit être l’objet du législateur. Je me trouve ici en opposition avec un écrivain dont on peut ne pas partager toujours les opinions, mais dont on ne saurait du moins contester ni l’esprit, ni les talents, ni la persévérance à défendre la liberté : c’est M. Benjamin Constant. Voici comment il s’exprime :
« Depuis que les hommes d’État de l’Europe ont adopté pour maxime que toute amélioration doit venir du pouvoir seul, être accordée exclusivement par lui, et n’être accordée que lorsque les peuples n’ont fait aucune tentative pour imposer des conditions ou tracer des limites à l’autorité, personne, ce semble, ne doit intervenir dans ce qui touche au gouvernement ; personne ne le peut sans affronter des périls inutiles, et, ce qui est plus grave, sans appeler sur sa tête une responsabilité morale qui me paraît un trop lourd fardeau.
« En effet, n’est-il pas incontestable qu’en démontrant l’existence d’un abus, la nécessité d’une réforme, on s’expose à en faire naître le désir dans l’esprit d’une multitude qui souffre de cet abus, ou qui gagnerait à cette reforme ? Et qui peut prévoir le résultat d’un désir né de la conviction, et devenu plus ardent par les obstacles mêmes ? Mais si ce désir entraîne les nations à des réclamations trop hardies, ou à des actes irréguliers, il s’ensuivra qu’elles seront privées pour un temps beaucoup plus long des biens qu’elles sollicitent. C’est à ce triste résultat que je ne veux contribuer d’aucune manière.
« Je ne m’exagère point l’influence qu’exercent les écrivains : je ne la crois point aussi étendue que les gouvernements la supposent ; mais cette influence existe pourtant. C’est à elle qu’on a dû l’abolition des rigueurs religieuses, la suppression des entraves du commerce, l’interdiction de la traite des noirs, et beaucoup d’améliorations de divers genres.
« Dans tout autre temps cette conviction, eût ajouté au courage, elle arrête maintenant la conscience. Il est établi que d’en haut seulement doit venir la lumière. Les vœux que celle qui viendrait d’en has suggérerait aux peuples seraient une raison pour que l’accomplissement de ces vœux fut indéfiniment ajourné, pour peu que leur manifestation fut imprudente.
« Je me tairai donc sur la politique. Le pouvoir a réclamé pour lui seul la totalité de nos destinées » Commentaires sur l’ouvrage de Filangieri, par M. Benjamin Constant, II° partie, ch. Ier.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans les opinions de M. Benjamin Constant sur le sujet qui nous occupe, c’est qu’après avoir démontré la nécessité de ne point éclairer le public de peur qu’il ne manifeste imprudemment le désir d’obtenir de bonnes institutions, l’auteur démontre la nécessité de donner de l’énergie au sentiment religieux, afin que la cause de la liberté ne manque pas de martyrs ; d’où l’on pourrait conclure que le fanatisme dépourvu de lumières, est ce qu’il y a au monde de plus propre pour réformer de mauvaises lois ou pour en établir de bonnes. Voy. la préface de l’ouvrage intitulé : De la Religion.
[57] La Politique d’Aristote, liv. 3, chap. 4, § 7, et chap. 5, §§ 1 et 4.
[58] Cic. de Off., lib. I, c. 25.
[59] Voici les propres expressions de Grotius : « Sed sicut cujusque civitatis jura utilitatem suæ civitatis respiciunt, ita inter civitates aut omnes aut plerasque ex consensu jura quædam nasci potuerunt, et nata apparet, quæ utilitatem respicerent non cætrum singulorum, sed magnæ illius universilatis. » De jure pacis ac belli, prolegomena, pag. 2 et 3 de l’édition d’Amsterdam de 1660.
[60] Wolff, Instit jur. nat. et gent., § 12. — Vattel a adopté les principes de Wolff dans ses Questions de droit naturel.
[61] Fundamenta jurisprudentiæ naturalis, § 19, p. 5.
[62] La Politique, liv. 3, chap. 7, § 267.
[63] Fundamenta jurisprudentiæ naturalis, §. 1. 267.
[64] Les hommes mêmes qui ont établi les systèmes les plus funestes ont eu ou ont dit avoir pour but l’utilité. Hobbes ne cherche à établir le despotisme qu’en se fondant sur ce principe. J.-J. Rousseau, dans son Contrat Social, dit, en commençant son système, qu’il tâchera d’allier toujours dans ses recherches ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées. Enfin, il n’y a pas jusqu’à ceux qui ont combattu le principe de l’utilité et de l’intérêt bien entendu, qui n’aient pris ce principe pour base de leurs raisonnements ; ils ont voulu remplacer le système de l’utilité par un système plus utile, et substituer à l’intérêt bien entendu un intérêt mieux entendu. C’est à cela que se réduit tout le système de M. Benjamin Constant sur le sentiment religieux.
[65] L’objection dont je parle ici, n’est pas une vaine supposition. Discutant un jour avec un de mes amis sur le fondement des lois et de la morale, je prétendais qu’il n’y avait pas de fondement plus solide que celui que M. Bentham a si bien développé : l’utilité générale. Ce principe, me répondit-il, est bon pour nous qui nous croyons soumis à des devoirs ; mais comment prouverons-nous à des législateurs qui se moquent du public, et qui ne croient pas à l’enfer, que le bonheur public doit être leur objet, ou que l’utilité générale doit être le principe de leurs raisonnements ? Pour des hommes semblables, le mot devoir a-t-il une signification ? Cette objection faite par un homme d’un sens profond et d’un sentiment moral très délicat, me laissa, je l’avoue, sans réponse. Il a fallu у réfléchir longtemps pour me convaincre qu’une vaste diffusion de lumières est le seul moyen de faire faire à la législation et même à la morale des progrès assurés. Il faut que les peuples deviennent assez éclairés, pour que les hommes investis du pouvoir, qui mettent des intérêts individuels au-dessus de l’utilité générale, et qui ne croient pas à un autre monde, trouvent au moins leur enfer dans celui-ci.
[66] Quelquefois on considère les lois suivant lesquelles un peuple existe et se perpétue, comme étant des conséquences ou des développements d’un acte établi par un prince ou par une assemblée. On dit alors que cet acte, auquel on donne le nom de charte ou de constitution, est une loi fondamentale qui sert de base à l’ordre social tout entier, et à laquelle ou ne peut porter atteinte sans que la société tombe en ruine. On dirait qu’il en est des peuples comme de ces édifices construits aux frais du public, dont certains magistrats prétendent poser la première pierre, par la raison qu’ils regardent faire les maçons. Il est vrai que ces lois fondamentales et éternelles sont fort souvent détruites sans que les peuples s’en trouvent plus mal ; quelquefois même ils en sont beaucoup mieux.
« La loi fondamentale de tout pays, dit Voltaire, est qu’on sème du blé, si l’on veut avoir du pain ; qu’on cultive le lin ou le chanvre, si l’on veut avoir de la toile ; que chacun soit le maître de son champ, soit que ce champ appartienne à un garçon ou à une fille ; que le Gaulois demi-barbare tue tout autant de Francs, entièrement barbares, qui viendront des bords du Mein, pour s’emparer de ce champ qu’ils ne savent pas cultiver, ravir ses moissons et ses troupeaux, sans quoi le Gaulois deviendra serf du Franc, ou sera assassiné par lui.
« C’est sur ce fondement que porte l’édifice. L’un bâtit son fondement sur un roc, et la maison dure ; l’autre sur du sable, et elle s’écroule. » Dictionnaire philosophique. LOI SALIQUE.
[67] Nous sommes si disposés à étendre notre existence, en nous reportant à une époque où nous n’existions pas encore, ou à une époque à laquelle nous aurons, depuis longtemps, cessé d’exister, que nous considérons souvent comme nous étant personnelles les actions honorables qui ont appartenu à nos ancêtres, ou que nous supposons devoir être exécutées par nos descendants. Nous parlons des victoires que nous avons remportées il y a des siècles, sur nos ennemis, des trahisons ou des cruautés qu’ils avaient commises contre nous, comme si ces peuples existaient encore, comme si notre existence individuelle avait trois ou quatre siècles de durée. C’est par une suite de ce sentiment que les vengeances se transmettent de génération à génération, chez les peuples barbares, et que, chez les peuples civilisés, nous voyons des hommes si ridiculement vains de ce qui a été fait, dit ou écrit, il y a plusieurs siècles, par d’autres que par eux. C’est ce ridicule qu’a si bien exprimé Shakespeare dans une de ses meilleures comédies. Abraham Slender, énumérant les titres de son cousin Robert Shallow : « Esquire, in the county of Gloster, justice of peace, and coram » ajoute : « And a gentleman born, who writes himself, armigero, in any bill, warrant, quittance or obligation, armigero. »
À quoi Shallow répond : « Ay, that we do, and have done any time those three hundred years. » (The Merry Wives of Windsor.)
C’est sur une illusion de ce genre, qu’est fondé tout l’orgueil nobiliaire.
[68] Les jurisconsultes ont distingué deux sortes de lois : les lois écrites et les lois non écrites. Ils se seraient exprimés d’une manière plus juste, s’ils avaient dit que les peuples ont des lois non décrites et des lois dont on a fait la description. En considérant les codes comme de simples descriptions, on aurait compris que, pour transporter les lois d’une nation chez une autre, il ne suffisait pas d’y transporter ou d’y faire réimprimer un livre. La facilité avec laquelle les peuples d’Europe se sont appropriés le code de Justinien, me fait croire que la plupart de ces lois existaient déjà, et qu’on avait besoin seulement qu’elles fussent bien décrites. L’état de barbarie dans lequel étaient alors la plupart des langues modernes, et la clarté, la précision et même l’élégance avec laquelle les jurisconsultes romains décrivaient les faits qui se passaient sous leurs yeux, suffiraient pour expliquer l’admiration que leurs décisions excitèrent, et qu’elles inspirent encore à ceux qui les étudient. J’aurai occasion de démontrer ailleurs que les peuples d’Europe n’adoptèrent pas de lois nouvelles, en s’emparant du recueil publié par ordre de Justinien, et que ce recueil n’obtint un si grand succès, que parce qu’il renfermait une description exacte de ce qui se passait dans la société, et qu’il fournissait le moyen de satisfaire des besoins préexistants. Les jurisconsultes romains avaient décrit les actes de la vie civile, comme Hippocrate les symptômes des maladies ; et ce qui a fait le succès du dernier a fait le succès des premiers : l’exactitude des descriptions, la justesse des observations.
[69] C’est faute d’avoir compris cela que les peuples ont vu quelquefois des garanties dans des promesses dont rien n’assurait l’exécution, pas même la bonne foi des promettants. Qu’un gouvernement, par exemple, dise à un peuple, Je garantis à chacun la liberté de publier ses opinions ; cela constituera-t-il une garantie contre lui-même ou contre les exécuteurs de ses volontés ? Non assurément, puisque la garantie sera inutile tant qu’il ne la rendra pas lui-même nécessaire, et qu’on ne la trouvera plus, aussitôt qu’on en sentira le besoin. Suivant Hume, les rois d’Angleterre ont confirmé la grande charte trente fois. Que de temps et de violences il a fallu à la nation anglaise, pour lui faire comprendre que des déclarations, des confirmations, des promesses et même des serments ne sont absolument rien, aussi longtemps qu’il n’existe pas dans la société une puissance indépendante qui ait le désir et la force de les faire respecter par ceux qui en sont les auteurs !
[70] L’action qu’exercent les peuples sur eux-mêmes par l’intermédiaire de leur gouvernement, et qui constitue un des éléments de la loi, est celle que les mauvais gouvernements subissent avec le plus d’impatience. Il n’y a pas un individu, vivant ou aspirant à vivre aux dépens du public, qui ne considère comme une calamité, et presque comme un crime, toute tentative par laquelle une nation cherche à agir sur sa propre destinée, en agissant sur les idées ou sur les passions de ceux qui la gouvernent.
[71] Voyez Montesquieu, Esprit des lois.
[72] Des révolutions de ce genre, dont on a vu des exemples dans quelques pays, ne sont guère possibles dans un pays libre où tous les magistrats sont élus par le peuple, comme aux États-Unis d’Amérique.
[73] Les esprits même les plus judicieux, les plus exempts de préjugés, n’ont pas toujours évité l’erreur qui consiste à prendre la description pour la chose décrite. « Londres n’est devenue digne d’être habitée, dit Voltaire, que depuis qu’elle fut réduite en cendres. Les rues, depuis cette époque, furent élargies et alignées : Londres fut une ville pour avoir été brulée. Voulez-vous avoir de bonnes lois ? Brûlez les vôtres et faites-en de nouvelles. » Diction. philosoph. V° Loi Salique.
C’est comme si l’un disait à un homme qui se plaindrait de sa laideur : Voulez-vous avoir une belle figure ? Brûlez votre portrait et faites-en faire un autre. On peut brûler des livres ; mais on ne peut pas plus brûler les lois d’un peuple, qu’on ne peut brûler ses passions, ses erreurs, ses préjuges, et les diverses classes de la population qui maintiennent les autres dans l’état où elles se trouvent. Avant le règne de Charles VII, aucune des nombreuses lois coutumières suivant lesquelles la France se régissait, n’avait encore été décrite. Si un philosophe avait dit aux peuples qui existaient alors, vos lois sont mauvaises, jetez-les au feu, ils auraient eu de la peine à comprendre comment il était possible de brûler des lois.
[74] Lorsque la cour de Cassation fut établie, la France n’était pas encore régie par une législation uniforme, et il fut ordonné que, dans cette cour, il у aurait des juges pris dans toutes les cours d’appel. Mais alors toutes les coutumes avaient été déjà décrites ; il existait un grand nombre de lois générales, et la France touchait au moment où elle allait être soumise à une législation uniforme.
[75] Il est assez commun aux philosophes de décrire des lois imaginaires, et de les présenter ensuite aux nations sous le nom de constitutions ou de codes : c’est ainsi que nous avons eu des républiques, des monarchies constitutionnelles, etc. Il est douteux si les maux qu’ont produit ces codes imaginaires, n’ont pas excédé les biens qui en sont résultés.
[76] Si une loi est conforme à l’intérêt du genre humain, il suffira sans doute pour bien l’entendre de connaître et de consulter cet intérêt ; mais si elle a été faite dans la vue de favoriser quelques individus aux dépens du public, si elle est oppressive ou tyrannique, comment peut-on espérer de bien l’entendre et de bien l’exécuter, si l’on ne recherche pas l’esprit ou la pensée du législateur ? Cette objection est fondée ; mais il reste à démontrer qu’il est du devoir des peuples de bien entendre des lois tyranniques, et de les appliquer dans l’esprit qui les a dictées ; il reste à démontrer que les hommes sont obligés, en conscience, de conformer leur conduite aux idées d’un despote ou d’un esprit faux, même lorsqu’ils ont la puissance de se conduire autrement. Si une loi est bonne, on l’entendra bien en consultant l’intérêt public ; si elle a été faite dans de mauvais desseins, il faut encore consulter l’intérêt public, car il est bon qu’elle soit détruite. Dans tous les cas, la pensée du législateur est hors de la question.
[77] Un homme qui est agité de passions malfaisantes, est un homme qui souffre, parce que de telles passions engendrent la douleur ; mais il ne s’ensuit pas qu’un homme qui souffre, soit toujours agité de passions malfaisantes. On dit souvent d’un homme pauvre, c’est un misérable ; mais on ne dirait pas d’un homme qui est misérable : c’est un homme pervers.
[78] Si nous n’avons pas la même sympathie pour un individu qui éprouve un plaisir ou une peine physique, que pour celui qui éprouve une jouissance ou une peine morale, il est aisé de voir les motifs de la différence. Un plaisir physique ne peut se répandre hors de l’individu qui l’éprouve ; on peut se procurer des plaisirs de ce genre, non seulement sans que personne en soit plus heureux, mais en faisant le malheur d’un grand nombre d’individus. Mais une jouissance morale ne peut, en général, exister qu’autant que plusieurs personnes sont heureuses en même temps, il faut, pour qu’elle soit réelle, qu’elle soit produite par des affections bienveillantes, par celles qui engendrent des plaisirs pour d’autres personnes. Les peines et les jouissances morales sont plus sociales, et appartiennent plus spécialement à l’homme ; les jouissances physiques tendent plus à l’isolement : elles peuvent être le partage des animaux les plus solitaires et les plus grossiers.
[79] Diderot, Vie de Sénèque.
[80] Jérémie Bentham, Traité de législation.
[81] Denys d’Halicarnasse, liv. 6, § 62.
[82] Lorsque le sénat envoya des députés à Marcius pour l’exhorter à ne pas faire la guerre à Rome, ces députés le menacèrent d’égorger à ses yeux sa mère, sa femme et ses deux enfants. « Si vous assiégez nos remparts, lui dirent-ils, on n’épargnera personne de votre famille ; il n’y aura point d’opprobre et de supplice par où on ne les fasse passer. » Denys d’Halicarnasse, liv. 8, § 28.
Lorsque Cassius fut mis à mort comme ayant aspiré à la tyrannie, ses biens furent confisqués, sa maison rasée, et il fallut un décret particulier du sénat pour exempter du supplice ses jeunes enfants ; jusqu’à cette époque, on avait égorgé les enfants toutes les fois que les pères avaient été trouvés coupables. Denys d’Halicarnasse, liv. 8, § 80.
[83] Volney.
[84] Plutarque, Vie de Coriolan.
[85] J’exposerai ailleurs la nature, les causes et les effets de l’esclavage, chez les anciens et chez les modernes.
[86] Plutarque, Vies de Marius et de Sylla.
[87] Plutarque, Vies de Caton le censeur et de Flaminius.
[88] Plutarque, Vies de Publicola et de Cicéron. — Voyez les Vies de Marius, de Sylla, de César, de Pompée, d’Antoine, de Cicéron et de Caton d’Utique.
[89] Les stoïciens avaient, pour inspirer le mépris des richesses, une raison que je n’ai pas développée ici, c’est qu’elles exposaient le possesseur à être proscrit, et le tenaient dans un état d’alarmes continuel. Quand Sénèque suppliait Néron de reprendre les riches présents qu’il lui avait faits, il lui demandait, en termes polis, de lui rendre la sécurité dont il l’avait privé.
[90] On peut voir le système de morale des stoïciens dans la théorie des sentiments moraux d’Adam Smith. — Cette doctrine est exactement la même que celle de M. Bentham.
[91] Si l’on avait toujours jugé les actions humaines par les effets qu’elles produisent, se serait-on jamais avisé de dire que c’est l’opinion des peuples qui rend leurs actions vertueuses ou vicieuses ? Un philosophe eût-il jamais écrit le passage que voici : « Peut-on trouver nulle part des nuances intermédiaires entre la fidélité conjugale, imposée par nos mœurs, et la prostitution honorée chez les peuplades disséminées sur le grand Océan ? Il est donc des vertus et des vices, comme il est une beauté et une laideur, de localité et de convention : changez de latitude, la laideur se change en beauté, le vice est changé en vertu » ? Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, t. 1, ch. 3, p. 238.
Les lois de la morale ne sont pas plus arbitraires que les lois du monde physique ; mais on peut ignorer les premières comme les secondes, et l’ignorance n’en suspend pas les effets.
[92] Le système qui suppose que tout le bien et tout le mal qui arrivent dans la société sont produits par l’action du gouvernement, est au fond le même que celui de Hobbes ; il n’en diffère qu’en un seul point ; Hobbes suppose qu’un individu qui commande va toujours droit, et que la population va toujours de travers ; dans le système où l’on prétend que tout le bien se fait par le gouvernement, on place dans une assemblée ou dans un conseil le privilège que Hobbes place dans un individu ; mais, dans l’un comme dans l’autre, le genre humain est considéré sous le même point de vue.
[93] Un législateur de l’antiquité jugea qu’il ne devait pas faire de lois pour réprimer le parricide. Nos gouvernements ont été plus prévoyants, et sans doute ils ont eu raison. Je ne suis pas très convaincu cependant que leur imprévoyance à cet égard et à quelques autres, eût beaucoup plus troublé la sécurité publique parmi nous, que ne la troubla chez les Athéniens l’imprévoyance de Solon.
[94] Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, t. 2, сh. 4, p. 378. — Barrow, Voyage en Chine, t. 3, ch. 13, p. 94 et 95.
[95] Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, t. 4, ch. 3, p. 209.
[96] Barrow, Voyage en Chine, t. 1, ch. 4, p. 283 et 286.
[97] Id. p. 295.
[98] Barrow, Voyage en Chine, t. 1, ch. 2, p. 126 et 127, et ch. 4, p. 286 et 287 ; t. 3, p. 280. — Macartney, t. 3, ch. 4, p. 299 et 329.
[99] Lorsque l’on compare le nombre des enfants qui sont abandonnés par leurs parents dans les États de l’Europe, et particulièrement dans les grandes villes, au nombre de ceux qui sont abandonnés dans l’empire de la Chine, et que l’on prend, en même temps, en considération les différences de population et de richesse, on est surpris de trouver, sous ce rapport, un immense avantage en faveur des mœurs chinoises. On croirait que nombre des enfants exposés annuellement dans une ville de trois millions d’habitants est beaucoup plus grand que ne le disent les voyageurs, s’ils ne nous apprenaient pas que tous ces enfants sont portés dans un même lieu ; que les missionnaires jésuites s’y rendent tous les matins pour administrer le baptême à ceux qui respirent encore, ou pour les conserver, et que c’est de ces missionnaires eux-mêmes qu’ils tiennent les faits qu’ils rapportent.
[100] Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, t. 2, chap. 4, p. 382.
[101] Barrow, Voyage en Chine, t. 3, ch. 12, p. 56.
[102] Id. t. 2, ch. 8, p. 194 et 195. — Macartney, Voy. en Chine et en Tartarie, t. 2, ch. 4, p. 318 et 319 ; et t. 3, ch. 4, p. 231.
[103] Les voyageurs nous font des tableaux effrayants des effets que produit en Chine le défaut de tout acte de gouvernement, qui réprime l’infanticide et l’exposition des enfants, et qui oblige les parents à nourrir et à élever ceux auxquels ils donnent le jour. Mais lorsqu’on réduit à leur juste valeur les faits qu’ils rapportent, on tombe dans une surprise extrême en voyant combien est petite la somme de bien que peut produire à cet égard l’action du gouvernement, à laquelle on donne cependant exclusivement le nom de loi. Dans les États de l’Europe, où certes les gouvernements ne manquent ni d’activité ni de surveillance, où l’on décrète que les pères et mères nourriront leurs enfants, où l’on punit de mort l’infanticide, où l’on punit de peines qui ne sont guère moins sévères, les suppressions et les suppositions d’état, où l’on se vante de posséder une religion pure et une morale éclairée, il y a, toute proportion gardée, dix fois plus d’expositions ou d’infanticides qu’il n’y en a dans l’empire chinois où le gouvernement croit ne devoir jamais se placer entre les parents et leurs enfants pour mettre obstacle à l’action des premiers sur les seconds. Les Chinois auraient-ils désespéré de trouver, pour protéger les enfants, des magistrats plus attentifs, plus surveillants, plus affectionnés que les pères ?
[104] Suétone, Vie de César, ch. 44.
[105] Voltaire, Essai sur les mœurs, ch. 81 et 121, tom. 11, p. 233 et 484, édit. de Lefèvre.
[106] Tomlins’ law dictionary, v° Luxury.
[107] J. Barrow, Voyage en Chine, t. I, ch. 4, p. 250.
[108] Voltaire, Essai sur les mœurs des nations, ch. 81.
[109] Je ne donne pas à un tel règlement le nom de loi, par la raison qu’il ne peut produire le résultat désiré.
[110] Plutarque, Vie de M. Caton, p. 404.
[111] J. Barrow, Voyage en Chine, t. 1, ch. 4, p. 250.
[112] Les gouvernements se sont tellement considérés comme les conservateurs du genre humain, qu’ils ont paru croire qu’il était nécessaire d’employer la force pour obliger les peuples à vivre et à se reproduire : ils ont fait des lois pour obliger les hommes à se marier, et à perpétuer ainsi leur espèce ; ils en ont fait ensuite pour déclarer que les pères et mères nourriraient leurs enfants, et pour les empêcher de les détruire ; ils en ont fait d’autres pour leur enjoindre de ne pas se ruiner en folles dépenses, et ne pas s’exposer à mourir de faim ; enfin ils en ont fait même pour leur enjoindre de supporter la vie, et de ne pas se laisser mourir volontairement. Il fallait que les peuples fussent bien misérables, puisque leurs gouvernants ou leurs maîtres croyaient avoir besoin d’employer une force artificielle pour les empêcher de se détruire eux-mêmes ; car je ne pense pas que les princes ou les ministres par lesquels ces lois ont été faites, jugeassent tous les hommes d’après eux-mêmes, et éprouvassent la tentation de renoncer à leur budget, d’étrangler leurs enfants, et de se pendre.
[113] Je n’ai pas fait entrer dans le calcul des maux, les inconvénients inséparables de l’établissement de tout ordre judiciaire ; mais ces inconvénients dépendent de tant de circonstances, que je serais entraîné trop loin si je voulais les indiquer. On peut en juger, au reste, par ce que j’en ai dit précédemment, pages 445 et 446.
[114] Je ne parle ici que de la conservation des biens dans la famille, et non de la distribution qui a lieu entre les membres dont elle se compose ; c’est un sujet que je traiterai ailleurs.
[115] L’identité était si bien établie aux yeux des jurisconsultes romains, que la famille tout entière ne faisait en quelque sorte qu’un individu dont la volonté résidait dans la personne du père. Si le père mourait, ses enfants étaient considérées comme une continuation de lui-même.
[116] Il est assez commun que les sophistes profitent de l’existence de ces deux genres d’inclinations pour recommander de grands scélérats à l’estime publique, ou pour flétrir les plus beaux caractères. Si un tyran ou quelques-uns de ses satellites laissent échapper une de ces lueurs qui annoncent qu’ils appartiennent encore à l’humanité ; si, après avoir plongé dans le deuil et la désolation des populations entières, ils donnent quelques faibles marques de bienveillance à un petit nombre d’individus qu’ils oublient l’instant qui suit ; si, après avoir réduit des nations à l’état de servitude le plus intolérable, ils donnent une ombre de liberté à quelqu’un de leurs esclaves, on oublie tous les crimes présents et passés, pour ne présenter aux yeux des peuples que ces actes d’une bienveillance extraordinaire. Mais aussi, si un homme qui a rendu à l’humanité les plus grands services, qui a répandu la lumière sur son siècle, ou qui n’a signalé sa vie que par des bienfaits, a le malheur de montrer un moment de faiblesse, de laisser échapper quelques mouvements de vanité, d’impatience ou de mauvaise humeur, cela suffit pour flétrir tout le bien qu’il a fait. On justifie les crimes des premiers par la supposition de bonnes intentions qu’ils n’ont pas eues ; on condamne les belles actions des seconds, en les attribuant à de mauvais motifs qui leur sont étrangers.
[117] Vie de Caton.
[118] En Angleterre, les lois prononcent encore des peines contre le suicide ; mais les jurés en éludent toujours l’application au moyen d’un mensonge : dans tous les cas, ils déclarent que la mort a été le résultat de la folie, insanity. Nous avons vu en France, sous le gouvernement impérial, des décrets qui punissaient la mutilation de soi-même, et l’expatriation : c’était une conséquence de l’esclavage. Un gouvernement est jugé, quand ses sujets croient de pouvoir se conserver que par la fuite ou par le sacrifice de leurs membres.
[119] Une loi de Justinien voulait qu’une femme de mauvaise vie fût considérée comme n’ayant jamais failli, du moment qu’elle revenait à la vertu. Cod. lib. 5, tit. 4, 1. 23.
[120] The Times, december 31, 1824.
[121] Paris n’a qu’un hôpital où l’on reçoive les femmes qui ne peuvent ou ne veulent pas faire leurs couches chez elles : Londres en compte onze, et dans ces onze on reçoit annuellement quatre mille personnes, sans compter les secours qu’ils donnent à l’extérieur. Londres compte plus de quatre maisons où sont reçues les femmes que leur mauvaise conduite a jetées hors de la société : Magdalen hospital, London female penitentiary, the Asylum, Refuge for the destitute, sans compter beaucoup d’autres établissements dont l’effet moral ne vaut pas mieux. Plusieurs dispositions de la législation anglaise, dont j’aurai occasion de parler ailleurs, concourent à rendre encore plus certains les mauvais résultats de ces établissements.
[122] Les conséquences de ces lois sont si étendues que je serai oblige d’en parler ailleurs.
[123] Les Américains, par les honneurs qu’ils ont rendus à M. de Lafayette, ont fait plus pour leur indépendance, que s’ils avaient hérissé les États-Unis de places fortes. Quand une nation accorde des honneurs semblables aux hommes qui l’ont servie, et qu’elle transmet de génération en génération la mémoire des services qu’elle a reçus, on peut être assuré qu’elle ne manquera jamais d’hommes qui se dévouent à sa défense.