JEAN-BAPTISTE SAY,
Traité de l'économie politique (1803)
Tome 1
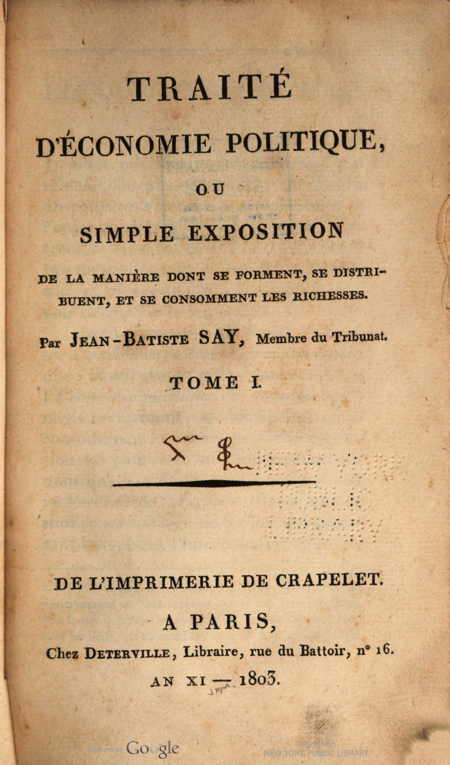 |
[Created: 20 November, 2023]
[Updated: 31 December, 2023 ] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Traité d’Économie Politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses. Par Jean-Baptiste Say, Membre du Tribunat (De L’imprimerie De Crapelet. À Paris, An XI —1803). Vol. 1.http://davidmhart.com/liberty/Books/1803-Say_TEP/Say_TraiteEP1-1803-ebook.html
Jean-Baptiste Say, Traité d’Économie Politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses. Par Jean-Baptiste Say, Membre du Tribunat (De L’imprimerie De Crapelet. À Paris, An XI —1803). Two volumes.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- reformatted margin notes to float within the paragraph
- inserted Greek and Hebrew words as images
TABLE DES CHAPITRES contenus dans ce premier volume
- Discours préliminaire p. v
- LIVRE PREMIER. DE LA PRODUCTION.
- Chapitre Ier. Des différentes sortes d’industries. p. 1
- Chapitre II. Des opérations communes à toutes les industries. p. 5
- Chapitre III. Ce que c’est qu’un capital, et de quelle manière les capitaux concourent à la production. p. 12
- Chapitre IV. Des capitaux improductifs. p. 17
- Chapitre V. Des fonds de terre. p. 19
- Chapitre VI. Ce qu’il faut entendre par production. p. 23
- Chapitre VII. Comment se joignent l’industrie, les capitaux et les fonds de terre pour produire. p. 32
- Chapitre VIII. Du travail de l’homme et du travail de la nature. p. 38
- Chapitre IX. Des machines qui suppléent au travail de l’homme. p. 42
- Chapitre X. Comment la division du travail multiplie les produits et les perfectionne. p. 54
- Chapitre XI. Comment le producteur et le consommateur profitent l’un et l’autre des avantages résultants de la division du travail. p. 61
- Chapitre XII. Des bornes que la nature des choses met à la division du travail. p. 67
- Chapitre XIII. Des inconvénients attachés à une trop grande subdivision dans les travaux. p. 78
- Chapitre XIV. De quelle manière se forment les capitaux. p. 83
- Chapitre XV. De quelle manière s’entretiennent les capitaux productifs. p. 107
- Chapitre XVI. Que l’industrie agricole exige de moins grands capitaux que les autres industries. p. 114
- Chapitre XVII. Quelle est la plus productive de la grande ou de la petite culture. p. 117
- Chapitre XVIII. Qu’une nation qui n’a point d’industrie agricole n’est pas plus qu’une autre une nation salariée. p. 124
- Chapitre XIX. D’un certain génie favorable à l’industrie. p. 131
- Chapitre XX. Des essais dans l’industrie, de leurs effets, et par qui doivent en être supportés les frais. p. 141
- Chapitre XXI. Des différentes manières de faire le commence. p. 147
- Chapitre XXII. Des débouchés. p. 152
- Chapitre XXIII. Comment le commerce extérieur concourt à la production intérieure. p. 156
- Chapitre XXIV. Comment le commerce de transport concourt à la production intérieure. p. 167
- Chapitre XXV. De ce qu’on nomme balance du commerce. p. 173
- Chapitre XXVI. Des voyages et de l’expatriation par rapport à la richesse nationale. p. 182
- Chapitre XXVII. Des compagnies et principalement de celles qui ont des privilèges exclusifs. p. 191
- Chapitre XXVIII. Du produit des colonies. p. 203
- Chapitre XXIX. Du commerce colonial et de ses produits. p. 230
- Chapitre XXX. Si le gouvernement doit prescrire la nature des productions. p. 241
- Chapitre XXXI. Des primes d’encouragement. p. 252
- Chapitre XXXII. Des brevets d’invention. p. 262
- Chapitre XXXIII. De l’effet des entraves mises à l’importation des marchandises étrangères. p. 266
- Chapitre XXXIV. Des entraves de province à province. p. 280
- Chapitre XXXV. Des circonstances où il convient de mettre des droits d’entrée sur les marchandises étrangères. p. 282
- Chapitre XXXVI. Du commerce des grains. p. 293
- Chapitre XXXVII. Des apprentissages, des maîtrises et des règlements. p. 313
- Chapitre XXXVIII. Quels règlements sont utiles. p. 325
- Chapitre XXXIX. S’il convient que le gouvernement concoure à la production. p. 333
- Chapitre XL. En quoi l’autorité publique travaille efficacement à la richesse nationale. p. 340
- Chapitre XLI. Si la prospérité d’une nation nuit à celle des autres. p. 350
- Chapitre XLII. Des produits immatériels, ou qui sont consommés au moment de leur production. p. 360
- Chapitre XLIII. Que les produits immatériels sont le fruit d’une industrie et d’un capital. p. 366
- Chapitre XLIV. Des capitaux productifs d’utilité ou d’agrément. p. 371
- Chapitre XLV. Des terrains productifs d’agrément. p. 380
- Chapitre XLVI. De la production dans ses rapports avec la population. p. 385
- Chapitre XLVII. De la production dans ses rapports avec la distribution des habitants. p. 404
- LIVRE SECOND. DES MONNAIES.
- Réflexion préliminaire. p. 413
- Chapitre Ier. De la nature et de l’usage des monnaies. p. 415
- Chapitre II. Du choix de la marchandise qui sert de monnaie. p. 422
- Chapitre III. De la valeur que la qualité d’être monnaie ajoute à une marchandise. p. 428
- Chapitre IV. De l’utilité de l’empreinte des monnaies, et des frais de fabrication. p. 436
- Chapitre V. De l’altération des monnaies. p. 449
- Chapitre VI. Que la monnaie n’est ni un signe, ni une mesure. p. 466
- Chapitre VII. D’une attention qu’il faut avoir en évaluant les sommes dont il est fait mention dans l’histoire. p. 483
- Chapitre VIII. Qu’il n’y a point de rapport fixe entre la valeur d’un métal et la valeur d’un autre métal. p. 491
- Chapitre IX. Ce que devraient être les monnaies. p. 496
- Chapitre X. De la monnaie de cuivre et de billon. p. 509
- Chapitre XI. De la meilleure forme des pièces de monnaies. p. 515
- Chapitre XII. Par qui doit être supportée la perte qui résulte du frai des monnaies. p. 518
- Endnotes for Volume 1
TRAITÉ D’ÉCONOMIE POLITIQUE. TOME I.
[I-i]
DISCOURS PRÉLIMINAIRE.↩
Il n’est pas inutile aux progrès d’une science, de bien déterminer le champ où peuvent s’étendre ses recherches et l’objet qu’elles doivent se proposer ; autrement on saisit çà et là un petit nombre de vérités sans en connaître la liaison, et beaucoup d’erreurs sans en pouvoir découvrir la fausseté.
Jusqu’au moment où Smith a écrit, on a confondu la Politique proprement dite, la science du gouvernement, avec l’Économie politique qui montre comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses. Cette confusion est peut-être née uniquement du nom qu’on a donné mal à propos aux recherches de ce genre. Parce que le mot économie signifie les lois qui régissent la maison, l’intérieur, [1] et que le mot politique semble appliquer cette idée à la famille politique, à la cité, on a voulu que l’économie politique s’occupât de toutes les lois qui régissent l’intérieur de la famille politique. Il fallait donc alors n’y point mêler de recherches sur la formation des richesses. Les richesses sont indépendantes de la nature du gouvernement. Sous toutes les formes de gouvernement, un État peut prospérer s’il est bien administré. On a vu des monarques absolus enrichir leur pays, et des conseils populaires ruiner le leur. Les formes mêmes de l’administration publique n’influent qu’indirectement, accidentellement, sur la formation des richesses, qui est presqu’entièrement l’ouvrage des individus.
L’étude des causes de la prospérité publique et particulière, est donc indépendante des considérations purement politiques ; et en les mêlant on a embrouillé bien des idées au lieu de les éclaircir. C’est le reproche qu’on peut faire à Steuart, qui a intitulé son premier chapitre : Du gouvernement du genre humain ; c’est le reproche qu’on peut faire à la secte des Économistes, et à J.J. Rousseau dans l’Encyclopédie.
Il me semble que depuis Smith, on a constamment distingué ces deux corps de doctrine : qu’on a réservé le nom d’Économie politique à la science qui traite des richesses des nations, et celui de Politique seul, à désigner les rapports qui existent entre le gouvernement et le peuple, et ceux des gouvernements entre eux.
Smith et ceux qui l’ont suivi, ne se sont pas de même tenus en garde contre une autre sorte de confusion qui demande à être expliquée.
En économie politique, comme en physique, comme en tout, on a fait des systèmes avant d’établir des vérités, car un système est plutôt bâti qu’une vérité n’est découverte. Mais cette science a profité des excellentes méthodes qui ont tant contribué aux progrès des autres sciences. Elle n’a plus admis que des conséquences rigoureuses de faits bien observés, et a rejeté tout à fait ces préjugés, ces autorités, qui, en science comme en morale, en littérature comme en administration, venaient toujours naguère s’interposer entre l’homme et la vérité.
Mais on n’a peut-être pas assez remarqué qu’il y a deux sortes de faits. Il y a des faits généraux, ou constants, et des faits particuliers, ou variables. Les faits généraux sont le résultat de l’action des lois de la nature dans tous les cas semblables ; les faits particuliers sont bien aussi le résultat de l’action des lois de la nature, car elles ne sont jamais violées, mais ils sont le résultat d’une ou de plusieurs actions modifiées l’une par l’autre, dans un cas particulier. Les uns ne sont pas moins incontestables que les autres, même lorsqu’ils semblent se contredire : en physique c’est un fait général que les corps graves tombent vers la terre ; cependant nos jets d’eau s’en éloignent. Le fait particulier d’un jet d’eau est un effet où les lois de l’équilibre se combinent avec celles de la pesanteur, sans les détruire.
Dans le sujet qui nous occupe la connaissance de ces deux ordres de faits, forme deux sciences distinctes : l’Économie politique et la Statistique. [2]
La première montre comment la richesse naît, se répand, se détruit ; les causes qui favorisent son accroissement et amènent sa décadence ; ses rapports nécessaires avec la population, la puissance des États, le bonheur ou le malheur des peuples.
La seconde expose l’état des productions et des consommations d’une ou de plusieurs nations, à une époque désignée, ou à plusieurs époques successives, de même que l’état de sa population, de ses forces, des actes ordinaires qui s’y passent et qui peuvent se soumettre à l’appréciation du calcul. C’est une géographie fort détaillée.
Il y a entre l’économie politique et la statistique la même différence qui existe entre la politique et l’histoire.
Elles doivent à la vérité se prêter mutuellement de grands secours. Il est impossible de bien observer les États sous le rapport économique, sans connaître les principes sur lesquels se fonde l’économie politique ; et il est impossible de posséder ces principes sans avoir tiré des conséquences communes d’une foule de faits particuliers. C’est sans doute la raison pour laquelle on les a confondues jusqu’à ce moment. L’ouvrage de Smith n’est qu’un assemblage confus des principes les plus sains de l’économie politique appuyés d’exemples lumineux ; et des notions les plus curieuses de la statistique mêlées de réflexions instructives ; mais ce n’est un traité complet ni de l’une ni de l’autre. Son livre est un vaste chaos d’idées justes, pêlemêle avec des connaissances positives.
Nos connaissances en économie politique peuvent être complètes, c’est-à-dire que nous pouvons parvenir à découvrir tous les faits généraux dont l’ensemble compose cette science ; il n’en saurait être de même de nos connaissances en statistique. La statistique, comme l’histoire, est une science qui sera toujours plus ou moins incertaine, plus ou moins incomplète. On ne peut donner que des essais détachés et très imparfaits sur la statistique des temps qui nous ont précédés et des pays éloignés. Quant au temps présent il est bien peu d’observateurs placés de manière à pouvoir recueillir des notions certaines sur une grande étendue de pays ; l’inexactitude et l’incapacité des hommes à qui l’on est obligé de s’en rapporter ; la défiance inquiète de certains gouvernements ; la mauvaise volonté et l’insouciance de beaucoup d’autres, opposeront toujours de grands obstacles aux efforts qu’on fera pour recueillir des particularités exactes sur les différents États ; et parvînt-on à les avoir, elles ne seraient vraies qu’un instant ; aussi Smith avoue-t-il qu’il n’ajoute pas grande foi à l’arithmétique politique.
L’économie politique au contraire est établie sur des fondements solides du moment que les principes qui lui servent de base sont des déductions rigoureuses de faits généraux incontestables. Les faits généraux sont à la vérité fondés sur l’observation des faits particuliers, mais ce sont des résultats qu’on a trouvés constamment les mêmes chaque fois qu’on les a observés ; un nouveau fait particulier ne suffit même point pour détruire un fait général ; car on ne peut s’assurer qu’une circonstance inconnue n’ait pas produit la différence qu’on remarque entre les résultats de l’un et de l’autre. Je vois une plume légère voltiger dans les airs et s’y jouer quelquefois longtemps avant de retomber à terre : en conclurai-je que la gravitation n’existe pas pour elle ? J’aurais tort. En économie politique, c’est un fait général que l’intérêt de l’argent se proportionne au risque que court le prêteur ; conclurai-je que le principe est faux pour avoir vu prêter de l’argent à bas intérêt dans des occasions très hasardeuses ? Le prêteur pouvait ignorer son risque, la reconnaissance lui com 15. mander des sacrifices : que sais-je ? mille circonstances pouvaient troubler l’action de la loi principale, jusqu’à rendre méconnaissable cette action qui était pourtant réelle, et qui reprenait son empire du moment que les causes de perturbation, qui elles-mêmes étaient l’effet de quelqu’autre loi générale, cessaient d’agir. Enfin, combien peu de faits particuliers sont complètement avérés ! combien peu sont observés avec toutes leurs circonstances ! Et en les supposant bien avérés, bien observés et bien décrits, combien n’y en a-t-il pas qui ne prouvent rien, ou qui prouvent le contraire de ce qu’on veut qu’ils prouvent ?
C’est ainsi qu’il n’y a pas d’opinion extravagante qui n’ait été appuyée sur des faits, et qu’avec des faits on a bien souvent égaré l’autorité publique. Sans doute il faut connaître les faits ; mais de plus il faut connaître tous les rapports qu’ils peuvent avoir avec d’autres faits, c’est-à-dire les lois générales qu’on appelle des principes du moment qu’il s’agit de leur application. Les connaissances positives, lorsqu’elles ne sont pas alliées avec les connaissances des principes, ne sont que le savoir d’un commis de bureau. Ce sont les principes seuls qui montrent le degré de leur importance et l’utilité de leur emploi ; ce sont les principes seuls qui donnent à l’administrateur public cette marche assurée au moyen de laquelle on se dirige vers ce qui est utile et bon, et l’on y arrive.
L’économie politique, comme les sciences exactes, se compose d’un petit nombre de principes fondamentaux, et d’un grand nombre de corollaires ou conséquences de ces principes. Ce qu’il y a d’important pour les progrès de la science, c’est d’établir solidement les principes : chaque auteur multiplie ensuite, ou réduit à son gré le nombre des conséquences selon le but qu’il s’est proposé. Celui qui voudrait déduire toutes les conséquences, donner toutes les explications, ferait un ouvrage colossal et nécessairement incomplet. Pour cette raison, j’ai dû me borner à celles qui étaient fort importantes en elles-mêmes, ou qui prêtaient un nouvel appui aux principes.
L’économie politique ne considère l’agriculture, les arts mécaniques, le commerce, les finances publiques, l’économie privée, etc., que dans leurs rapports avec la richesse générale et particulière, et non dans les procédés qui leur sont propres. Il n’est pas une de ces matières qui ne soit l’objet de plusieurs traités particuliers où l’on démontre leurs procédés ; la partie de ces traités qui s’occupe à rechercher l’influence de chacune d’elles sur les valeurs, doit être fondée sur les principes de l’économie politique.
Ces principes ne sont point l’ouvrage des hommes ; ils dérivent de la nature des choses ; on ne les établit pas : on les trouve. Ils gouvernent les législateurs et les princes qui jamais ne les violent impunément. L’analyse et l’observation les font découvrir. Si l’on a tardé à les découvrir, si on les conteste encore tous les jours, c’est une prérogative qu’ils partagent avec les fondements de presque toutes les sciences. Il n’y a pas vingt ans qu’on est parvenu à analyser l’eau qui soutient notre vie, l’air où nous sommes constamment plongés ; et tous les jours encore on conteste les expériences qui fondent cette doctrine, quoiqu’elles aient été mille fois répétées, dans divers pays, et par les hommes de l’Europe les plus instruits.
Mais de la même manière que les hommes ont longtemps fort bien vécu sans savoir de quoi l’eau était composée, beaucoup d’États ont longtemps subsisté et même prospéré, sans savoir à quoi tenait la prospérité publique. Les anciens, et même les modernes jusqu’à ces derniers temps, paraissent n’avoir pas même soupçonné l’existence des principes dont la réunion forme ce que nous nommons l’économie politique. Les Économiques de Xénophon ne sont qu’un traité d’économie privée, c’est-à-dire, montrent comment il faut s’y prendre pour ménager et accroître son bien. On trouve il est vrai dans son Discours sur les revenus d’Athènes, quelques vues sur la nature des richesses et sur leur production ; mais ces vues mêmes découvrent combien les anciens étaient loin d’avoir là-dessus des idées nettes.
Elles ne paraissent pas être entrées davantage dans leurs conseils. On sait que les Romains regardaient comme vils les arts qui sont le fondement du bienêtre des hommes, en exceptant, on ne sait pourquoi, l’agriculture. Leurs opérations sur les monnaies sont au nombre des plus mauvaises qui se soient faites.
Les modernes pendant longtemps n’ont pas été plus avancés, même après s’être décrassés de la barbarie du Moyen-âge. Henri IV accordait à ses favoris et à ses maîtresses, comme des faveurs qui ne lui coûtaient rien, la permission d’exercer mille petites exactions, et de percevoir à leur profit mille petits droits sur différentes parties du commerce ; il autorisa le comte de Soissons à lever un droit de 15 sous sur chaque ballot de marchandise qui sortirait du royaume ! [3]
Depuis Sully, les ministres des principaux États de l’Europe savaient à la vérité, mais vaguement, que l’agriculture et le commerce étaient les deux mamelles de l’État ; mais ce n’était pas pour eux une vérité démontrée. Vauban, philosophe à l’armée et militaire ami de la paix, affligé de l’état de dépérissement où la vaine grandeur de Louis XIV plongeait la France, proposa dans sa Dîme royale, d’excellents moyens de féconder les différentes sources des richesses ; mais ce fut, de même, par le sentiment confus d’un cœur droit et d’un esprit juste, et non par la connaissance sûre de la marche ordinaire des richesses.
À la cour du Régent, toutes les idées se brouillèrent. Les billets de la banque, où l’on croyait voir une source inépuisable de prospérité, ne furent qu’un moyen de dévorer des capitaux, de dépenser ce qu’on ne possédait pas, de faire banqueroute de ce qu’on devait. La modération et l’économie furent tournées en ridicule. Les courtisans du prince, moitié par persuasion, moitié par perversité, l’excitaient à la profusion ; c’est là que fut réduite en système cette maxime, que le luxe enrichit les États : on soutint ce paradoxe en prose ; on l’habilla en beaux vers ; on crut de bonne foi mériter la reconnaissance de la nation en dissipant ses trésors ; et l’ignorance du prince conspira avec ses flatteurs, sa dissolution et sa vanité, pour ruiner l’État. La France se releva un peu sous la longue paix maintenue par le cardinal de Fleury, ministre faible pour le mal comme pour le bien, et dont l’administration insignifiante prouva du moins qu’à la tête d’un gouvernement, c’est déjà faire beaucoup de bien, que de ne pas faire de mal.
En tout genre, les exemples ont précédé les préceptes. La prospérité incontestablement croissante de la plupart des États de l’Europe, et même les vicissitudes qu’ils avaient éprouvées, favorisaient la recherche des causes de la prospérité des États en général. La marche plus grave et plus philosophique des idées, depuis la même époque, accéléra ces progrès. L’étude de l’homme en société prit le pas sur d’autres études moins importantes ; et plusieurs écrivains contribuèrent aux progrès de l’économie politique, par leurs travaux, par leurs systèmes, par leurs disputes.
Montesquieu, dont le génie embrassait plus d’objets qu’il n’en pouvait étudier, semait de brillantes erreurs dans son Esprit des lois ; mais on a l’obligation à ce grand écrivain d’avoir porté la philosophie dans la législation, et sous ce rapport il est peut-être, en économie politique, le maître des écrivains anglais qui passent pour être les nôtres, de même que Voltaire a été le maître de leurs bons historiens, qui sont dignes eux-mêmes maintenant de servir de modèles.
Vers le milieu du siècle, quelques principes sur la source des richesses, mis en avant par le docteur Quesnay, firent un grand nombre de prosélytes. L’enthousiasme de ceux-ci pour leur fondateur, le scrupule avec lequel ils ont toujours depuis suivi les mêmes dogmes, leur chaleur à les défendre, les ont fait considérer comme une secte, et ils ont été appelés du nom d’Économistes. Au lieu d’observer d’abord la nature des choses, de classer leurs observations, et d’en déduire des généralités, ils commencèrent par poser des généralités, ils cherchèrent à y ramener tous les faits particuliers, et ils en tirèrent des conséquences ; ce qui les engagea dans la défense de maximes évidemment contraires au bon sens et à l’expérience des siècles, ainsi qu’on le verra dans plusieurs endroits de cet ouvrage. Leurs antagonistes ne s’étaient pas formé des idées plus claires des choses sur lesquelles ils disputaient. Avec beaucoup de connaissances et de talents de part et d’autre, on avait tort, on avait raison par hasard : on contestait les points qu’il fallait accorder ; on convenait de ce qui était faux ; on se battait dans les ténèbres. Voltaire, qui savait très bien trouver le ridicule partout où il était, se moqua du système des Économistes dans son Homme aux quarante écus ; mais en montrant ce que l’ennuyeux fatras de Mercier de la Rivière, ce que l’Ami des Hommes de Mirabeau avaient de ridicule, il ne pouvait pas dire en quoi leurs auteurs avaient tort.
Il est indubitable que les Économistes ont produit du bien en proclamant quelques vérités importantes, et en dirigeant l’attention sur des objets d’utilité publique ; mais il n’est pas moins certain qu’ils ont fait beaucoup de mal en décriant plusieurs vérités utiles, et en faisant croire par leur esprit de secte, par le langage dogmatique qui régnait dans la plupart de leurs écrits, par leur ton d’inspiration, qu’ils n’étaient qu’une société de rêveurs courant après une perfection chimérique.
Ce que personne n’a refusé aux Économistes, et ce qui suffit pour leur donner des droits à la reconnaissance et à l’estime générale, c’est que leurs écrits ont tous été favorables à la plus sévère morale et à la liberté que doivent avoir les hommes de disposer de leurs personnes et de leurs biens ; liberté sans laquelle le bonheur social et la propriété sont de vains mots. Je ne crois pas qu’on puisse compter parmi eux un homme de mauvaise foi, ni un mauvais citoyen.
C’est sans doute pour cette raison que presque tous les écrivains français de quelque réputation, et qui se sont occupés de matières analogues à l’économie politique, depuis 1760 jusque vers 1780, sans marcher positivement sous les bannières des économistes, se sont néanmoins laissés dominer par leurs opinions ; tels que Raynal, Condorcet, et plusieurs autres. On peut même compter parmi eux Condillac, quoiqu’il ait cherché à se faire un système à lui. Il y a quelques bonnes idées à recueillir parmi le babil ingénieux de son livre [4] ; mais il passe à côté des vérités les plus fécondes sans les apercevoir. Comme les Économistes, il fonde presque toujours un principe sur une supposition gratuite ; or une supposition peut bien servir d’exemple, mais non de vérité fondamentale. L’économie politique ne s’est élevée au rang des sciences, que depuis qu’elle a fait comme les autres, l’étude seulement de ce qui est.
On a fait tort à Turgot en le représentant comme un des coryphées de la secte des Économistes. Il était trop bon citoyen pour ne pas estimer beaucoup d’aussi bons citoyens ; et lorsqu’il fut puissant, il crut utile de les soutenir. ceux-ci, à leur tour, trouvaient leur compte à faire passer un homme aussi éclairé et un ministre d’État, pour un de leurs adeptes. La vérité est que Turgot avait des idées à lui, et sentait bien souvent en quoi péchaient celles de ses amis ; mais il avait de commun avec eux l’amour du bien public.
Suivant l’observation judicieuse de Duclos : « C’est à tort qu’on regarde comme épuisés les sujets dont on a beaucoup parlé et comme éclaircis ceux dont on a vanté l’importance ». En 1776, Adam Smith, sorti de cette école écossaise qui a donné tant de littérateurs, d’historiens, de philosophes et de savants du premier ordre, publia son livre intitulé : Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Quand on lit cet ouvrage, on s’aperçoit qu’il n’y avait pas d’économie politique avant Smith. Je ne doute pas que les écrits des Économistes ne lui aient été fort utiles ; de même que les conversations qu’il a eues, dans ses voyages à Paris, avec les hommes de France les plus recommandables et les plus éclairés ; mais entre la doctrine des Économistes et la sienne, il y a la même distance qui sépare le système de Ticho-Brahé de la physique de Newton. Avant Smith, on avait avancé plusieurs fois des principes très vrais ; il est le premier qui ait montré la liaison qu’ils ont entre eux, et comment ils sont des conséquences nécessaires de la nature des choses ; or on sait qu’une vérité appartient, non pas au premier qui la dit, mais au premier qui la prouve. Il a fait plus qu’établir des vérités : il a donné la vraie méthode de signaler les erreurs. Il ne se permet pas une seule assertion, pas une seule supposition, qui ne soient conformes aux faits les plus constants. Son ouvrage est une suite de démonstrations qui ont élevé plusieurs propositions au rang de principes incontestables, et en ont plongé un bien plus grand nombre dans ce gouffre où les systèmes, les idées vagues, les imaginations extravagantes, se débattent un instant, avant de s’engloutir pour toujours.
L’économie politique a commencé comme la chimie, qui n’étant encore que de l’alchimie, avait ses adeptes, et promettait de changer les métaux en or ; mais qui réduite par des esprits justes à devenir une science de faits et d’observations, influe si puissamment de nos jours sur le perfectionnement de tous les arts.
On a dit que Smith avait de grandes obligations à Steuart qu’il n’a pas cité une seule fois, même pour le combattre. Ces obligations ne me paraissent nullement évidentes : Smith a conçu son sujet bien autrement que Steuart ; il plane au-dessus d’un terrain où l’autre se traîne. Steuart a soutenu un système précédemment adopté par Colbert, par le gouvernement anglais, constamment suivi par la plupart des États de l’Europe, et qui fait dépendre les richesses d’un pays, non du montant de ses productions, mais du montant de ses ventes à l’étranger. Les Économistes sont venus qui fondaient à leur tour les richesses sur les seules productions de l’agriculture. Il y a du bon dans l’un et dans l’autre système, mais de grands inconvénients à les adopter exclusivement. Smith a réfuté leurs principes, leurs conséquences et leurs moyens, par l’expérience et par le raisonnement ; il a montré les véritables fondements de la richesse. Les obligations qu’on lui a sont beaucoup plus évidentes que celles qu’il a aux autres. S’il n’a pas réfuté Steuart en particulier, c’est que Steuart n’est pas chef d’école, et qu’il s’agissait de combattre l’opinion générale d’alors, plutôt que celle d’un écrivain qui n’en avait point qui lui fût personnelle. [5]
Depuis Smith, on a fait, soit en Angleterre, soit en France, sur l’économie politique, un grand nombre de brochures, dont quelques-unes ont plusieurs volumes sans en être moins des brochures ; c’est-à-dire, sans qu’on ait plus de motifs de les conserver comme dépôts d’une instruction solide. La plupart sont des écrits polémiques où les principes ne sont posés que pour servir d’appui à une thèse donnée ; je n’en connais aucun qui contienne un corps complet de doctrine sur l’économie politique. Ce qui n’a pas été fait, j’ai tâché de le faire. Mon ouvrage était-il nécessaire ? Doit-il produire quelque bien ? Je l’ai cru, puisque j’ai eu le courage de l’entreprendre et de le terminer.
Je me suis plu à rendre justice à Smith, que je n’ai jamais vu rabaisser que par des personnes absolument hors d’état de le comprendre ; mais je n’ai point fermé les yeux sur ce qu’il laisse à désirer. Il manque de clarté dans quelques endroits, et de méthode presque partout. Pour le bien entendre, il faut être habitué soi-même à coordonner ses idées, à s’en rendre compte, et ce travail le met hors de la portée de la plupart des lecteurs, du moins dans quelques-unes de ses parties ; tellement que des personnes éclairées d’ailleurs, faisant profession de le connaître et de l’admirer, ont écrit sur des matières qu’il a traitées, sur l’impôt par exemple, sur les billets de banque comme supplément à la monnaie, sans avoir entendu le premier mot de sa théorie sur ces matières, laquelle forme cependant une des plus belles parties de son ouvrage. Ainsi, dans les circonstances même où j’ai marché soutenu par Smith, mon travail peut n’être pas inutile. J’ai eu souvent de la peine à bien concevoir sa pensée jusqu’au fond, à me la rendre propre, et ensuite à l’exprimer avec la concision, et néanmoins avec la clarté qui convenaient à mon plan et à mes lecteurs.
On a encore reproché à Smith, avec raison, ses longues digressions. Sans doute l’histoire d’une loi, d’une institution est intéressante et instructive en elle-même, comme un dépôt de faits ; mais dans un livre consacré surtout au développement des principes généraux, les faits particuliers, quand ils ne servent pas uniquement d’exemples et d’éclaircissements, ne font que surcharger inutilement l’attention. Indépendamment des détails de faits, Smith se jette quelquefois avec complaisance dans des discussions étendues, qui ne se rattachent que par un fil à son sujet, et parmi lesquelles il s’en trouve qui sont dépourvues d’intérêt pour d’autres que pour les Anglais ; telle est la longue estimation des avantages que recueillerait la GrandeBretagne, si elle admettait toutes ses possessions à se faire représenter dans le parlement. L’excellence d’un ouvrage se compose autant de ce qui ne s’y trouve pas, que de ce qui s’y trouve. Tant de détails grossissent le livre, non pas inutilement, mais inutilement pour son objet principal, qui est le développement des principes de l’économie politique : on sent que comme ouvrage de statistique, il serait trop incomplet. Ce serait donc déjà avoir rendu un service à la science, même quand je ne l’aurais pas fait avancer d’un seul pas, que de l’avoir dégagée des discussions parasites qui empêchent d’en saisir l’ensemble et d’en lier les parties.
« Il en est des théories, dit Raynal, comme des machines qui commencent toujours par être très compliquées et qu’on ne débarrasse qu’avec le temps des rouages inutiles qui en multipliaient les frottements ».
Ces considérations n’eussent pas suffi néanmoins pour m’engager à écrire sur ce sujet ; j’y ai été conduit par d’autres motifs encore. Ils rendent nécessaires quelques développements ; et ces développements serviront à justifier la forme donnée à l’ouvrage.
On a presque toujours considéré l’économie politique comme servant au plus à éclaircir quelques questions en faveur d’un petit nombre d’hommes qui s’occupent des affaires de l’État ; on n’a pas assez remarqué que presque tout le monde concourant à la formation des richesses, et tout le monde, sans exception, concourant à leur consommation, il n’était personne dont la conduite n’influât, peu ou beaucoup, sur sa propre richesse et sur la richesse générale ; et, par conséquent, sur son sort particulier et sur le sort de l’État ; on n’a point assez vu dans l’économie politique ce qu’elle est réellement, même chez les peuples soumis au pouvoir arbitraire : l’affaire de tout le monde.
Je sais que les lumières des personnes élevées en dignités, importent plus que celles des simples particuliers, parce que leurs décisions influent sur un bien plus grand nombre de destinées, mais les personnes puissantes elles-mêmes, peuvent-elles être véritablement éclairées, lorsque les simples particuliers ne le sont pas ? Cette question vaut la peine d’être faite. C’est dans la classe mitoyenne, loin des soucis et des plaisirs de la grandeur, loin des angoisses de la misère ; c’est dans la classe où se rencontrent les fortunes honnêtes, les loisirs mêlés à l’habitude du travail, les libres communications de l’amitié, le goût de la lecture et des voyages ; c’est dans cette classe, dis-je, que naissent les lumières ; et c’est de là qu’elles se répandent chez les grands et chez le peuple ; car les grands et le peuple n’ont pas le temps de méditer ; ils n’adoptent les vérités que lorsqu’elles leur parviennent sous la forme d’axiomes, et qu’elles n’ont plus besoin de preuves. Et quand même un monarque et ses principaux ministres seraient familiarisés avec les principes sur lesquels se fonde la prospérité des nations, que feraient-ils de leur savoir, s’ils n’étaient secondés dans tous les degrés de l’administration par des hommes capables de les comprendre, d’entrer dans leurs vues et de réaliser leurs conceptions ? La prospérité d’une ville, d’une province, dépend quelquefois d’un travail de bureau, et le chef d’une très petite administration en provoquant une décision importante exerce bien souvent une influence supérieure à celle du législateur lui-même.
Enfin en supposant que tous ceux qui prennent part à la gestion des affaires publiques, dans tous les grades, pussent être habiles dans l’économie politique sans que la nation le fût, ce qui est tout à fait improbable, quelle résistance n’éprouverait pas l’accomplissement de leurs meilleurs desseins ? Quels obstacles ne rencontreraient-ils pas dans les préjugés de ceux mêmes que favoriseraient le plus leurs opérations ?
Pour qu’une nation jouisse des avantages d’un bon système économique, il ne suffit pas que ses chefs soient en état d’adopter les meilleurs plans en tout genre ; il faut encore que la nation soit en état de les recevoir.
C’est encore le seul moyen d’éviter les vacillations, les changements perpétuels de principes qui empêchent de profiter même de ce qu’un mauvais système peut avoir de bon. L’esprit de suite est un des principaux éléments de la prospérité des nations ; témoin l’Angleterre, devenue riche et plus puissante que ne le comporte son étendue, en suivant constamment le système, fâcheux à plusieurs égards, d’étendre constamment son commerce extérieur. Mais pour suivre constamment la même route, il faut être en état d’en choisir une qui ne soit pas trop mauvaise ; sans cela on rencontre des difficultés insurmontables qu’on n’avait pu prévoir, et l’on est contraint de changer de marche, même sans versatilité.
C’est peut-être à cette cause qu’il faut attribuer les variations perpétuelles qui ont travaillé la France depuis deux siècles, c’est-à-dire depuis qu’elle s’est vue à portée d’atteindre le haut point de prospérité où l’appelaient son sol, sa position, et le génie de ses habitants. Semblable à un vaisseau voguant sans boussole et sans carte, selon le caprice des vents et des vagues, ne sachant d’où il part, ni où il veut arriver, elle avançait au hasard parce qu’il n’y avait point dans la nation d’opinion arrêtée sur les causes de la prospérité publique. Une semblable opinion aurait étendu son influence sur plusieurs administrateurs successifs : ne l’eussent-ils pas partagée, ils ne l’auraient pas du moins heurtée trop ouvertement, et le vaisseau français n’aurait pas été exposé à ces changements de manœuvre dont il a tant souffert.
Afin de mieux faire comprendre ce que j’entends par cette opinion arrêtée, qu’on me permette de citer pour exemple celle qu’on a sur un sujet fort différent.
Quoiqu’il y ait une très grande diversité d’opinion sur le mérite des pièces de théâtre et sur ce qui constitue la perfection dans l’art dramatique, cependant en France on est attaché à de certains principes de composition théâtrale dont on ne s’écarte guère ; on convient par exemple que chaque scène d’une pièce de théâtre, chaque caractère doivent concourir au développement de l’action principale ; qu’il ne faut transporter le spectateur, durant le cours d’une même pièce, ni d’un lieu dans un autre lieu éloigné, ni d’un temps dans un autre ; que l’auteur doit s’arranger de manière que les spectateurs sachent par quels motifs les personnages paraissent et se retirent. De ces conventions généralement, ou presque généralement reçues, qu’est-il résulté ? C’est que notre théâtre, depuis les chefs-d’œuvre de Racine jusqu’aux farces du boulevard, n’offre point de disparates trop choquantes, et que nos plus mauvais drames, à défaut d’autre mérite, ont au moins celui d’être conformes à ces règles puisées dans la nature de l’homme, ou de s’en écarter peu.
Pourquoi faut-il que l’art d’amuser les hommes ait acquis plus de stabilité que celui de les rendre heureux ! Quand on professera les principes les plus sains de l’économie politique dans les divers ordres de la société, chez le cultivateur, chez le négociant, chez le magistrat, de même qu’on professe, relativement à l’art dramatique, les mêmes principes au parterre et aux loges, alors on aura un plan général d’administration qu’on verra suivi, quelles que soient les révolutions qu’on éprouve. Mais il faudra auparavant que les vérités reçues parmi les gens instruits le soient de tout le monde ; il faudra, pour employer une métaphore qu’autorise mon sujet, qu’elles soient changées en monnaie courante.
Ce n’est qu’alors qu’on parviendra à s’entendre dans les conversations et dans les écrits. On ne sera jamais d’opinion pareille : ce serait folie de l’espérer ; mais on partira de quelques bases communes ; on se battra sur le même élément. Ce n’est qu’alors que les écrivains, lorsqu’ils toucheront à ces matières, pourront se garantir de ce qui n’est que du pur bavardage ; enfin les particuliers eux-mêmes auront quelques moyens de plus pour juger sainement de leur position personnelle, pour en tirer le meilleur parti possible, ou bien pour en changer.
J’ai cherché à concourir à ce but, en réunissant en un corps de doctrine, disposé avec méthode, ce qui dans l’économie politique est à l’usage de tous les hommes, qu’ils soient fonctionnaires publics ou simples citoyens. Il est bon que chacun connaisse la place qu’il occupe dans le mécanisme social, qu’il sache si son rouage est utile au jeu de la machine ; que si, loin de contribuer à son action, il la surcharge et l’embarrasse, il en rougira peut-être, et ce sera déjà beaucoup.
Des connaissances utiles pour tous devaient être à la portée de tous, et même des personnes peu instruites, pourvu qu’elles voulussent m’accorder leur attention. Il fallait pour cela conduire le lecteur de propositions simples en propositions simples jusqu’aux vérités les plus abstraites de l’économie politique. Mes peines pour y parvenir ne seront appréciées que des personnes très instruites elles-mêmes. Je les supplie de me pardonner d’avoir répété des choses qu’elles savent fort bien, en faveur des lecteurs qui ne les savent pas, et de n’être pas surprises si je ne franchis pas sans les exprimer, certaines idées intermédiaires qui ne leur sont point nécessaires à elles, mais sans lesquelles je ne serais pas suivi par une intelligence ordinaire. Pouvais-je d’ailleurs, dans un ouvrage que j’ai cherché à rendre complet, du moins quant aux points principaux, passer sous silence des principes devenus communs ; et regardera-t-on comme tout à fait superflu, le classement d’un principe ou d’un fait connu qu’on n’avait peut-être pas encore attaché à un système lié dans toutes ses parties ? Je dirai aussi quelquefois des choses si simples qu’on sera étonné qu’elles n’aient pas déjà été dites, quoique rien ne soit plus vrai.
En commençant cet ouvrage, je me suis tracé un plan ; mais j’ai écarté tout système : que voulais-je prouver ? Rien. Bien poser les questions, en déduire les conséquences nécessaires, a été toute mon ambition, persuadé que la plupart des fautes que les hommes commettent dans leurs actions publiques et privées viennent de ce qu’ils ignorent le véritable état de la question et les résultats nécessaires de ces mêmes actions. Il y a peu de solutions épineuses quand les questions sont bien posées.
Je ne me suis pas attaché à relever les erreurs qui ont été mises en avant sur presque tous les points de l’économie politique. La tâche aurait été grande, car il y a peu de sujet sur lequel on se soit plus donné carrière pour déraisonner. Je n’ai combattu que les erreurs accréditées et les auteurs qui se sont fait un nom. Quel mal peut faire une sottise décriée ? Les erreurs des grands hommes sont les seules dangereuses, parce que l’autorité de leur réputation peut balancer celle de la raison qu’il faut respecter pardessus tout. Quand il m’est arrivé de combattre l’opinion des grands écrivains, j’ai eu soin, toutes les fois que cela a été nécessaire, de faire connaître leurs motifs en même temps que les miens, ne pouvant supposer que je fusse plus infaillible qu’eux. Je réparerai avec empressement les erreurs qui me seront échappées à moi-même, soit dans les choses de fait, soit dans les raisonnements, aussitôt qu’on me les fera remarquer. Le même courage qui m’a porté à établir des principes directement opposés à quelques préjugés très généralement répandus, me portera toujours, j’espère, à sacrifier mon amour-propre à l’intérêt de la vérité.
Quoique ce livre excède les bornes que je voulais lui donner, j’espère qu’on me saura gré de ma concision si l’on considère que presque tous les points que j’ai traités provoquent des développements étendus et des applications nombreuses, dont chacune est susceptible d’être modifiée par une infinité de circonstances. Tous ces points ont été l’objet de controverses où l’on pouvait, même sans regarder sa peine comme entièrement inutile, tenir la balance entre les diverses opinions et les rapprocher des bases de la doctrine. C’est ce que j’ai fait dans un petit nombre de cas ; dans les autres j’ai laissé au lecteur le soin de faire les applications. Il n’y a pas un de mes chapitres dont je n’eusse pu faire un volume, et ce n’a pas été un de mes moindres travaux que de découvrir, en chaque matière, ce qui était fondamental, pour m’y réduire. peut-être serai-je ainsi parvenu à donner une vue nette de l’ensemble de l’économie politique et de la relation de ses différentes parties.
Que si quelqu’un se plaint de ne trouver dans cet ouvrage que ce qui se voit et que ce qui se fait tous les jours, je tiendrai ces paroles pour un grand éloge ; elles prouveront en effet que mon livre ne contient point une vaine théorie, mais bien une doctrine fondée sur l’expérience. Que fait l’astronomie autre chose que nous dire ce qui se passe tous les jours dans l’étendue des cieux ? Que fait la physique expérimentale autre chose que nous découvrir les propriétés des corps dont nous sommes entourés ? De même l’économie politique n’est pas l’histoire de ce que tels ou tels ont rêvé, ou de ce qu’on a rêvé soi-même, mais la simple exposition de la manière dont chacun voit tous les jours se former, se distribuer et se consommer les richesses.
Et il ne faut pas qu’on s’imagine que parce qu’on connaît quelques faits généraux qui sautent aux yeux de tout le monde, on possède pour cela cette science. Beaucoup de gens savent ce que c’est qu’un triangle ; mais combien peu connaissent toutes les propriétés du triangle, et l’usage qu’on en peut faire pour la mesure de la terre ! Tout le monde sait de même, que l’agriculture et le commerce font la richesse et la force des gouvernements ; mais tout le monde ne sait pas comment ces sources deviennent fécondes, ni comment elles s’épuisent.
Il ne paraîtra pas aisé de rendre ces notions communes, si l’on considère que, de même que les sciences mathématiques, l’économie politique est fondée sur une abstraction ; dans les premières on s’occupe des grandeurs, dans la seconde des valeurs. Les valeurs étant susceptibles de plus ou de moins, sont du domaine des mathématiques, mais comme soumises à l’action des facultés, des besoins et de la volonté des hommes, elles rentrent dans celui de la morale. Et ceci, pour le dire en passant, montre combien il est superflu d’appliquer les formules algébriques aux démonstrations de l’économie politique. Aucune quantité n’y est susceptible d’une appréciation rigoureuse.
De ce que l’économie politique est l’affaire de tout le monde, naît un autre genre de difficulté : c’est qu’on a pour juges, non seulement ceux qui se sont occupés de ces matières, mais encore ceux qui n’y entendent rien. Comme chacun a donné quelques soins aux valeurs dont sa fortune est composée, chacun se croit en droit d’avoir une opinion sur les valeurs, une opinion qui se trouve exaltée par la vanité personnelle (comme toutes les opinions) et de plus par l’intérêt personnel, qui, à notre insu, exerce tant d’empire sur nos jugements. Quand un médecin écrit sur l’art de guérir, il peut, sans risque, partir de ce principe, qu’il faut, autant qu’on peut, laisser agir la nature ; mais quiconque se hasarderait d’avancer que pour faire prospérer une ville, une province, il faut, le moins qu’on peut, se mêler de leurs affaires, aurait à vaincre les cris de cent sortes de gens, et à réfuter dix à douze systèmes.
Je n’ai prétendu donner aucun conseil : les meilleurs principes ne sont pas toujours applicables ; l’essentiel est qu’on les connaisse ; on en prend ensuite ce qu’on peut, ou ce qu’on veut. Nul doute qu’une nation neuve, et qui pourrait les consulter en tout, ne parvînt promptement à un très grand éclat ; mais une nation peut néanmoins atteindre un degré de prospérité satisfaisant, en les violant à plusieurs égards. Les excès de la jeunesse, les accidents, les blessures auxquels le corps humain est exposé, ne surmontent pas toujours l’action puissante de la force vitale.
La sécheresse ou l’obscurité des livres qu’on a faits sur l’économie politique, ont beaucoup diminué la facilité de l’étudier. Mais n’est-ce point la faute des professeurs, plutôt que celle de la science ? Les observations qui lui servent de base sont à la portée de tout le monde : les conséquences qu’on en tire, à la portée de tous ceux qui veulent prendre la peine de suivre un raisonnement. Elle peut donc être amenée au même degré de clarté que les autres sciences ; et comment trouverait-on aride celle qui parle aux hommes de leurs productions : c’est-à-dire des miracles de leur industrie ; et de leurs consommations : c’est-à-dire de leurs jouissances ?
Il serait fâcheux qu’on s’occupât avec découragement ou avec dédain des progrès de l’économie politique. Quoique plusieurs nations de l’Europe soient dans une situation assez florissante en apparence, et qu’il y en ait, comme l’Angleterre, qui dépensent jusqu’à quatorze cent millions par an pour leurs dépenses publiques seulement, il ne faut cependant pas croire que leur situation ne laisse rien à désirer. Un riche Sybarite, habitant à son choix son palais de ville ou son palais de campagne, goûtant à grands frais, dans l’un comme dans l’autre, toutes les recherches de la sensualité, se transportant commodément et avec rapidité partout où ses caprices l’appellent, disposant des bras et du talent d’un nombre considérable de serviteurs et de complaisants, et crevant dix chevaux pour satisfaire une fantaisie, peut trouver que les choses vont assez bien, et que l’économie publique est portée à sa perfection. Mais si l’on considère que dans les pays les plus prospères, il n’y a pas un individu sur cent mille à qui il soit donné d’accumuler toutes ces jouissances, qu’on voit partout l’exténuation de la misère à côté de l’embonpoint de l’opulence, le travail forcé des uns compenser l’oisiveté des autres, des masures et des colonnades, les haillons de la misère mêlés aux enseignes du luxe, en un mot, les plus inutiles profusions au milieu des besoins les plus urgents, on ne pourra pas regarder comme superflues les re 62. cherches faites dans le but de connaître les causes de ces maux, et les remèdes dont ils sont susceptibles.
Quelques personnes qui ont attrapé une assez bonne part dans cet ordre de choses, ne manquent pas d’arguments pour le justifier aux yeux de la raison. peut-être que s’il fallait, dès demain, tirer de nouveau les lots qui leur assignent leur place dans la société, elles y trouveraient beaucoup à reprendre.
Il en est d’autres dont l’esprit n’ayant jamais entrevu un meilleur état social, affirment qu’il ne peut exister. Elles conviennent des maux de l’ordre social tel qu’il est, et s’en consolent en disant qu’il n’est pas possible que les choses soient autrement. Ceci rappelle cet empereur du Japon, qui pensa étouffer de rire, lorsqu’on lui dit que les Hollandais n’avaient point de rois. Les Iroquois et les Algonquins ne conçoivent pas qu’on puisse faire la guerre sans rôtir ses prisonniers.
Le temps est un grand maître. C’est à lui seul qu’il appartient de démontrer les avantages qu’on peut retirer de l’application des principes de l’économie politique à la législation positive. La résistance que leur opposent les préjugés et l’intérêt national et privé mal entendu, n’a rien qui doive surprendre ni effrayer. La physique de Newton, unanimement rejetée en France durant cinquante années, est maintenant enseignée dans toutes nos écoles.
Nous commençons un siècle destiné à recueillir une gloire qu’il ne partagera avec aucun autre. Que les nations qu’on dit civilisées sont encore ignorantes et barbares ! Parcourez des provinces entières, questionnez cent personnes, mille, dix mille, à peine sur ce nombre en trouverez-vous deux, une peut-être qui ait quelque teinture de ces connaissances si relevées dont le siècle se glorifie. On n’en ignore pas seulement les hautes vérités (ce qui n’aurait rien de surprenant), mais les éléments les plus simples, les plus applicables à la position de chacun. Quoi de plus rare même que les qualités nécessaires pour s’instruire ! Qu’il est peu de gens capables seulement d’observer ce qu’ils voient tous les jours, et qui sachent douter de ce qu’ils ne savent pas !
Les hautes connaissances sont donc bien loin encore d’avoir procuré à la société les avantages qu’on en doit attendre, et sans lesquels elles ne seraient que de vaines difficultés ; et peut-être est-ce au dix-neuvième siècle qu’il est réservé d’en perfectionner les applications. On verra des esprits supérieurs, après avoir reculé les bornes de leurs théories, découvrir des méthodes qui mettront les vérités importantes à la portée des esprits médiocres. Alors dans les occurrences ordinaires de la vie, dans les arts les plus usuels, on sera guidé, non par des lumières transcendantes, mais par des notions saines ; le négociant, l’administrateur, l’artisan lui-même, sauront, non pas tout, mais tout ce qu’ils doivent savoir ; et l’on aura moins souvent l’affligeant spectacle de ces sottises, de ces fausses opérations, si fatales au bonheur des particuliers et à la prospérité des nations.
LIVRE PREMIER.
DE LA PRODUCTION.
[I-1]
CHAPITRE PREMIER.
Des différentes sortes d’industries.↩
Parmi les choses qui satisfont aux besoins de l’homme, ou qui contribuent à l’agrément de sa vie, il en est que la nature lui fournit gratuitement et avec une abondance qui surpasse ordinairement ses désirs ; telles sont l’eau, l’air, la lumière.
Ce qu’on peut se procurer sans frais, n’a point de valeur ; ce qui n’a point de valeur ne saurait être une richesse. Ces choses ne sont pas du domaine de l’économie politique.
Il en est d’autres qui n’existent pour nous qu’autant que l’industrie humaine a provoqué, secondé, achevé les opérations de la nature. Nous les devons :
Tantôt à une industrie qui les a recueillies des mains de la nature ;
Tantôt à une industrie qui les a mélangées, façonnées suivant nos besoins ;
Tantôt enfin à une industrie qui les a amenées d’un lieu où elles se trouvaient, au lieu où nous sommes et où elles ne se seraient pas trouvées sans cela.
On nomme la première de ces industries : industrie agricole ; la seconde, industrie manufacturière ; la troisième, industrie commerçante.
Les choses qui sont à l’usage de l’homme et qui ne lui sont pas données gratuitement et sans mesure par la nature, sont le produit d’une, ou bien de deux de ces industries, ou de toutes les trois ensemble.
Une table est un produit de l’industrie agricole et de l’industrie manufacturière. L’une a fait pousser, ou au moins abattu, l’arbre dont elle est faite ; l’autre l’a façonnée.
Le quinquina est pour l’Europe un produit de l’industrie agricole et de l’industrie commerçante réunies. Sans le commerçant qui va chercher cette drogue au Pérou, elle ne serait pas entièrement produite pour nous, et nous serions éternellement privés du secours que nous en tirons.
Des choses que l’homme recueille des mains de la nature, les unes ont été formées par la nature abandonnée à elle-même, comme les animaux que nous nous procurons par la chasse ou la pêche, les métaux que nous trouvons au sein de la terre. Notre industrie se borne alors aux travaux nécessaires pour nous en emparer. Il en est d’autres que la nature ne fournit que sollicitée par nos soins et notre prévoyance, comme les grains et les autres produits de l’agriculture. On range dans une même classe tous ces différents travaux, et on leur donne le nom d’industrie agricole, parce que l’agriculture est de beaucoup le plus important d’entre eux et qu’il nous manque un mot pour les désigner tous à la fois.
On regarde même comme une branche de l’industrie agricole certaines préparations de matières brutes [6] qui ne peuvent être faites commodément que sur les lieux mêmes où on les a recueillies. C’est ainsi que le travail de presser le raisin et de manipuler le vin, est considéré comme faisant partie de l’industrie du cultivateur de la vigne, quoiqu’il tienne plus des arts mécaniques que des arts agricoles. C’est encore ainsi que l’art de sécher la morue, d’exprimer l’huile des baleines, est considéré comme faisant partie de l’industrie de ceux qui les pêchent.
[I-5]
CHAPITRE II.
Des opérations communes à toutes les industries.↩
Nous venons de voir quels sont les trois genres d’industrie au moyen desquels l’homme obtient tous les produits dont il se sert. Si nous examinons chacune de ces industries en particulier, nous nous apercevrons qu’elle se compose de trois opérations distinctes, et qu’il est bon de considérer séparément si l’on veut savoir jusqu’à quel point chacune d’elles concourt à la production.
Pour obtenir un produit quelconque, il a fallu d’abord étudier la marche et les lois de la nature relativement à ce produit. Comment aurait-on fabriqué une serrure, si l’on n’était parvenu à connaître les propriétés du fer, et par quels moyens on peut le tirer de la mine, l’épurer, l’amollir et le façonner ?
Il a fallu ensuite appliquer ces connaissances à un usage utile, juger qu’en façonnant le fer d’une certaine façon, on pourrait clore une porte pour tout le monde, excepté pour celui qui en aurait la clé.
Enfin il a fallu exécuter le travail manuel indiqué par les deux opérations précédentes ; c’est-à-dire forger et limer les différentes pièces dont se compose une serrure.
Il est rare que ces trois opérations soient exécutées par la même personne. Le plus souvent un homme étudie la marche de la nature. C’est le savant.
Un autre profite de ces connaissances pour créer des produits utiles. C’est l’agriculteur, le manufacturier ou le commerçant.
Un autre enfin travaille suivant les directions données par les deux premiers. C’est l’ouvrier.
Qu’on examine successivement tous les produits : on verra qu’ils n’ont pu exister qu’à la suite de ces trois opérations.
S’agit-il d’un sac de blé ou d’un tonneau de vin ? Il a fallu que le naturaliste ou l’agronome connussent la marche que suit la nature dans la production du grain ou du raisin, le temps et le terrain favorables pour semer ou pour planter, et quels sont les soins qu’il faut prendre pour que ces plantes viennent à maturité. Le fermier ou le propriétaire ont appliqué ces connaissances à leur position particulière, ont rassemblé les moyens d’en faire éclore un produit utile, ont écarté les obstacles qui pouvaient s’y opposer. Enfin le manouvrier a remué la terre, l’a ensemencée, a lié et taillé la vigne. Ces trois genres d’opérations étaient nécessaires pour que le blé ou le vin fussent entièrement produits.
Veut-on un exemple fourni par le commerce extérieur ? Prenons l’indigo. La science du géographe, celle du voyageur, celle de l’astronome, nous font connaître le pays où il se trouve et nous montrent les moyens de traverser les mers. Le commerçant arme des vaisseaux, et l’envoie chercher. Le matelot, le voiturier travaillent mécaniquement à cette production.
Que si l’on considère l’indigo seulement comme une des matières premières d’un autre produit, d’un drap bleu, on s’aperçoit que le chimiste fait connaître la nature de cette substance, la manière de la dissoudre, les mordants qui la font prendre sur la laine. Le manufacturier rassemble les moyens d’opérer cette teinture ; et l’ouvrier suit ses ordres.
Partout l’industrie se compose de la théorie, de l’application, de l’exécution. Ce n’est qu’autant qu’une nation excelle dans ces trois genres d’opérations, qu’elle est parfaitement industrieuse. Si elle est inhabile dans l’une ou dans l’autre, elle ne peut se procurer des produits qui sont tous le résultat de toutes les trois. Dès lors on aperçoit l’utilité des sciences qui, au premier coup d’œil, ne paraissent destinées qu’à satisfaire une vaine curiosité.
Les nègres de la côte d’Afrique ont beaucoup d’adresse : ils réussissent dans tous les exercices du corps et dans le travail des mains ; mais ils sont incapables des deux premières opérations de l’industrie. Aussi sont-ils obligés d’acheter des Européens les étoffes, les armes, les parures dont ils ont besoin. Leur pays est si peu productif, que les vaisseaux qui vont chez eux pour s’y procurer des esclaves, n’y trouvent pas même les provisions nécessaires pour les nourrir pendant la route, et sont obligés de s’en pourvoir d’avance, quoique la terre, en beaucoup d’endroits, annonce par ses productions naturelles une très grande fertilité. [7]
Il ne suffit même pas à une nation, pour être industrieuse, de posséder les lumières directement utiles à l’industrie qu’elle exerce ; il faut encore que son ignorance ou ses préjugés à d’autres égards, ne détruisent pas l’effet des lumières qu’elle a. L’ignorance attribue par exemple, à une cause surnaturelle, un fléau, une épidémie qui dépendent souvent de circonstances faciles à changer. Elle se livre à des pratiques superstitieuses, lorsqu’il faudrait prendre des précautions ou apporter des remèdes.
Et d’un autre côté, les qualités intellectuelles ne suffisent pas. Quels succès aura dans les choses d’industrie, une nation instruite dans les sciences, habile pour les combinaisons commerciales, ma 95. nufacturières et agricoles, si ses ouvriers sont lourds et maladroits ; s’ils sont avides de plaisirs, et incapables d’assiduité et de soins ?
C’est au moyen seulement de l’industrie que les hommes peuvent être pourvus avec quelqu’abondance des choses qui leur sont nécessaires.
La nature, abandonnée à elle-même, ne pourvoirait qu’imparfaitement à l’existence d’un petit nombre d’hommes. On a vu des pays fertiles, mais déserts, ne pouvoir nourrir quelques infortunés que la tempête y avait jetés par hasard, tandis que sur le sol le plus ingrat, dans l’île de Malte, par exemple, on voit, grâce à l’industrie humaine, subsister à l’aise une nombreuse population.
Grace à l’industrie, le plus mince habitant de nos villes jouit d’une infinité de douceurs dont un monarque de sauvages est obligé de se passer. Les vitres seules qui laissent entrer dans sa chambre la lumière en même temps qu’elles le préservent des intempéries de l’air, les vitres sont le résultat admirable d’observations, de connaissances recueillies, perfectionnées depuis plusieurs siècles. Il a fallu savoir quelle espèce de sable était susceptible de se transformer en une matière étendue, solide et transparente ; par quels mélanges, par quels degrés de chaleur, on pouvait obtenir ce produit. Il a fallu connaître la meilleure forme à donner aux fourneaux. La charpente seule qui recouvre tout cet appareil, est le résultat des connaissances les plus relevées sur la force des bois et sur les moyens de l’employer avec avantage.
Ces connaissances ne suffisaient pas. Elles pouvaient n’exister que dans la mémoire de quelques personnes, ou dans des livres ; il a fallu qu’un manufacturier vînt avec les moyens de les mettre en pratique. Il a commencé par s’instruire de ce qu’on savait sur cette branche d’industrie ; il a rassemblé des constructeurs, des ouvriers ; et il a assigné à chacun son emploi.
Enfin l’adresse des ouvriers, dont les uns ont construit l’édifice et les fourneaux, dont les autres ont entretenu le feu, opéré le mélange, soufflé le verre, l’ont coupé, étendu, assorti, posé ; cette adresse, dis-je, a complété l’ouvrage ; et l’utilité, la beauté du produit qui en est résulté, passe tout ce que pourraient imaginer des hommes qui ne connaîtraient point encore cet admirable présent de l’industrie humaine.
[I-12]
CHAPITRE III.
Ce que c’est qu’un capital, et de quelle manière les capitaux concourent à la production.↩
En continuant à observer les produits destinés à notre usage, on ne tardera pas à s’apercevoir que l’industrie seule, abandonnée à elle-même, n’aurait jamais suffi pour les produire. Il a fallu que l’homme industrieux possédât en outre des produits déjà existants, sans lesquels son industrie, quelqu’habile qu’on la suppose, serait toujours demeurée dans l’inaction. Ces choses sont :
1°. Les outils, les instruments des différents arts. Le cultivateur ne saurait rien faire sans sa pioche ou sa bêche, le tisserand sans son métier, le navigateur sans son vaisseau.
2°. Les productions qui doivent fournir à l’entretien de l’homme industrieux, jusqu’à ce qu’il ait achevé sa portion de travail dans l’œuvre de la production. Le produit dont il s’occupe, ou la valeur qu’il en tirera, doit à la vérité rembourser cet entretien ; mais il est obligé d’en faire l’avance.
3°. Les matières brutes que son industrie doit transformer en produits complets. Il est vrai que ces matières lui sont quelquefois données gratuitement par la nature ; mais le plus souvent elles sont des produits déjà créés par l’industrie, comme des semences que l’agriculture a fournies, des métaux que l’on doit à l’industrie du mineur et du fondeur, des drogues que le commerçant apporte des extrémités du globe. L’homme industrieux qui les travaille est de même obligé de faire l’avance de leur valeur.
Toutes ces choses composent ce qu’on appelle un capital productif.
Il faut encore considérer comme un capital productif toutes les constructions, toutes les améliorations répandues sur un bienfonds et qui en augmentent le produit annuel, les bestiaux, les usines, qui sont des espèces de machines propres à l’industrie.
Les monnaies sont encore un capital productif toutes les fois qu’elles servent aux échanges sans lesquels la production ne pourrait avoir lieu. Semblables à l’huile qui adoucit les mouvements d’une machine compliquée, les monnaies répandues dans tous les rouages de l’industrie humaine facilitent des mouvements qui ne s’obtiendraient point sans elles. Mais comme l’huile qui se rencontre dans les rouages d’une machine arrêtée, l’or et l’argent ne sont plus productifs, dès que l’industrie cesse de les employer. Il en est de même au reste de tous les autres outils dont elle se sert.
On voit que ce serait une grande erreur de croire que le capital de la société ne consiste que dans sa monnaie. Un commerçant, un manufacturier, un cultivateur ne possèdent ordinairement sous la forme de monnaie que la plus petite partie de leurs capitaux ; et même, plus leur entreprise prospère, plus la portion de leurs capitaux qu’ils ont en numéraire, est petite relativement au reste. Si c’est un commerçant, ses fonds sont en marchandises sur les routes, sur les mers, dans des magasins répandus partout ; si c’est un fabricant, ils sont principalement sous la forme de matières premières à différents degrés d’avancement, sous la forme d’outils, d’instruments, de provisions pour ses ouvriers ; si c’est un cultivateur, ils sont sous la forme de granges, de bestiaux, de clôtures. Tous évitent de garder de l’argent au-delà de ce que peuvent en occuper les usages courants.
Ce qui est vrai d’un individu, de deux individus, de trois, de quatre, l’est de la société toute entière. Le capital d’une nation se compose de tous les capitaux des particuliers ; et plus la nation est industrieuse et prospère, plus son capital en argent est peu de chose comparé avec la totalité de ses capitaux. Necker évalue à 2 milliards 200 millions la valeur du numéraire circulant en France vers 1784, et cette évaluation paraît fort exagérée par des raisons qui ne peuvent trouver leur place ici ; mais qu’on estime la valeur de toutes les constructions, clôtures, bestiaux, usines, machines, vaisseaux, marchandises et provisions de toute espèce, appartenant à des Français ou à leur gouvernement dans toutes les parties du monde ; qu’on y joigne les meubles et les ornements, les bijoux, l’argenterie et tous les effets de luxe ou d’agrément, qu’ils possédaient à la même époque, et l’on verra que les 2 milliards 200 millions de numéraire ne sont qu’une assez petite portion de toutes ces valeurs.
Beeke, l’un des derniers auteurs qui aient écrit sur ces matières et dont les calculs sont faits pour inspirer de la confiance, évalue la totalité des capitaux de l’Angleterre à 2 milliards 300 millions sterling [8] (plus de 55 milliards de nos francs) et la valeur totale du numéraire qui circule en Angleterre, suivant les personnes qui l’ont porté le plus haut, n’excède pas 47 millions sterling, [9] c’est-à-dire la 50e partie de son capital environ. Smith ne l’évalue qu’à 18 millions : ce ne serait pas la 127e partie du capital.
Les capitaux que possède le gouvernement d’une nation, font partie des capitaux de cette nation.
Nous verrons plus loin comment les capitaux productifs, qui s’usent sans cesse, sont perpétuellement reproduits avec avantage par l’action même de l’industrie qui les emploie. Contentonsnous quant à présent de bien concevoir que sans eux l’industrie ne produirait rien. Il faut, pour ainsi dire, qu’ils travaillent de concert avec elle.
[I-17]
CHAPITRE IV.
Des capitaux improductifs.↩
L’argent qu’on tient enfermé dans des coffres ou qu’on cache sous terre, les provisions amassées au-delà des besoins qu’on en a, les trésors que la superstition accumule sur les autels, et en général tous les produits qui se conservent sans servir à la consommation et sans contribuer à la création de quelques autres produits, sont des capitaux improductifs.
Quand on considère l’indispensable nécessité dont les capitaux sont pour la production, on s’afflige en songeant à la foule de ceux qui pourraient être employés au profit de l’humanité et que la négligence, la crainte ou les préjugés tiennent oisifs. Les productions des États soumis à la domination ottomane seraient bien plus considérables, si les particuliers n’y cachaient pas une partie de leurs biens et si les pachas ne conservaient pas des trésors pour les trouver au moment du besoin. Les riches ornements des madones et des saints de l’Italie et de l’Espagne ne fécondent point d’entreprises agricoles ou manufacturières. Avec les capitaux qui les couvrent et le temps qu’on perd à les solliciter, on se procurerait réellement les biens que ces images n’ont garde d’accorder à de stériles prières. On voit moins de travaux que de capitaux perdus pour la production. Un capital oisif n’expose pas à une perte actuelle, immédiate ; s’il n’engendre pas de nouvelles valeurs, il ne perd pas du moins de celle qu’il a ; tandis que le travail est une peine, une avance, et qu’on sent, au moment où l’on prend cette peine, toute l’étendue du sacrifice que l’on fait.
On verra dans la suite qu’il est une autre sorte de capitaux productifs, non de choses matérielles mais d’utilité ou d’agrément. Les meubles, les choses de goût ou d’ostentation font partie de ces capitaux. Comme ils ne sont véritablement pas improductifs, ce n’est pas ici le lieu d’en parler.
[I-19]
CHAPITRE V.
Des fonds de terre.↩
Il y a beaucoup d’analogie entre un fonds de terre et un capital.
Un fonds de terre n’est qu’une machine, machine admirable à la vérité, mais qui concourt, de même que tout autre instrument, avec l’industrie de l’homme et avec ses capitaux, à fournir des produits qui font sa richesse. Or une machine, un instrument productif sont des portions d’un capital.
Un fonds de terre peut comme un capital être productif ou ne l’être pas. Il est productif quand il est cultivé : c’est un capital qui travaille. Il est improductif quand il est en friche : c’est un capital oisif.
Il peut encore, comme un capital, être indirectement productif, c’est-à-dire fournir les moyens de produire, sans produire lui-même, comme le terrain employé en routes, en canaux ; il est alors analogue aux monnaies d’or et d’argent par le moyen desquelles toutes les propriétés passent facilement d’une main dans une autre, mais qui ne sont point autrement utiles.
Un fonds de terre est quelquefois, comme certains capitaux, productif non de choses échangeables, mais d’utilité ou de plaisirs personnels, comme lorsqu’il est occupé par des maisons d’habitation ou des jardins d’agrément.
Il peut enfin être cultivé par son propriétaire ou bien être loué à une autre personne : il en est de même d’un capital que son possesseur peut faire valoir ou prêter, à son choix.
Souvent même le fonds de terre et le capital qui y est répandu en améliorations sont tellement confondus, qu’on peut bien apprécier leur valeur totale, mais qu’il est tout à fait impossible de distinguer la valeur de chacun d’eux. Les améliorations se louent ou se vendent avec la terre sans que personne puisse dire quelle portion du prix sert à payer la valeur des unes ou de l’autre.
Il semblerait donc qu’un fonds de terre et un capital pourraient sans inconvénient se confondre, vu l’analogie de leur nature et de leurs fonctions ; mais ce qui établit entre eux une grande différence, c’est qu’un fonds de terre n’est susceptible ni d’être agrandi par l’accumulation, ni d’être diminué par la dissipation, comme un capital. Un fonds de terre existe invariable indépendamment du pouvoir de l’homme, et il en résulte quelques différences relativement à sa puissance productive et au parti qu’en peut tirer son propriétaire, ainsi que nous le verrons plus tard.
Dans un ouvrage d’économie politique il est convenu que le fonds de terre d’une nation se compose de son territoire et des richesses naturelles qu’embrassent ses limites et même l’étendue de son pouvoir. Ainsi ses mines et ses pêcheries font, dans le langage de cette science, partie de son fonds de terre, à cause de l’analogie de leurs produits, quoique ses mines soient quelquefois fort au-dessous de la surface de son sol, et ses pêcheries situées à plusieurs centaines de lieues de ses frontières.
Par la même raison tous les secours que cette nation tire directement de la puissance de la nature, comme de la force du vent, du courant de l’eau, font encore partie de ce que je nommerai son fonds de terre, malgré l’impropriété de l’expression, et faute d’en avoir une meilleure. Toutes ces choses servent aux hommes précisément de la même manière ; mais de toutes ces choses, c’est la terre cultivable dont l’usage lui est le plus précieux. C’est pour cela qu’on les range dans la classe des fonds de terre, comme on nomme industrie agricole l’industrie qui en tire les produits immédiats.
Un fonds est quelquefois la propriété de quelqu’un, et quelquefois il est à l’usage de tous et n’est la propriété de personne. Les mers, les airs, les rivières qui font partie du fonds général d’une nation et même du monde entier, ne sont la propriété de personne en particulier ; mais, dans ce fonds général, les terres cultivables étant susceptibles d’appropriation, c’est-à-dire de pouvoir appartenir à quelqu’un, sont toutes devenues des propriétés dans les pays civilisés.
[I-23]
CHAPITRE VI.
Ce qu’il faut entendre par PRODUCTION↩
On a vu dans ce qui précède comment l’industrie, les capitaux, les fonds de terre concourent à donner des produits, c’est-à-dire toutes les choses qui servent aux besoins ou aux plaisirs de l’homme.
Avant d’aller plus loin il convient de faire une observation qui préviendra de très grandes erreurs. Seule elle jette un jour étonnant sur le sujet qui nous occupe ; elle peut seule affermir notre marche dans le chemin qui nous reste à parcourir.
La masse des matières dont se compose le monde n’augmente ni ne diminue jamais. Il ne se perd pas un atome : il ne s’en crée pas un seul. Les choses ne sont donc pas produites, mais seulement reproduites sous d’autres formes, et ce que nous appelons production, n’est, dans le fait, qu’une reproduction.
Je sème un grain de blé : il en produit vingt. Il ne les tire pas du néant ; il détermine une opération de la nature par laquelle différentes substances, auparavant répandues dans la terre, dans l’eau, dans l’air, se changent en grains de blés. Ces différentes substances, toutes séparées, n’étaient d’aucun usage ; elles en acquièrent un en devenant grains de blé.
Ceci indique comment il faut entendre le mot production dans tout le cours de cet ouvrage. Production n’est point création ; c’est production d’utilité. [10]
La production, ou si l’on veut la reproduction, n’étant point production de matière, mais seulement production d’utilité, ne se mesure pas suivant la longueur, le volume, ou le poids du produit, mais suivant le degré de son utilité.
Pour mesurer exactement la production, il faudrait donc avoir une mesure exacte du degré d’utilité de chaque chose. Mais comment mesurer l’utilité ? Ce qui paraît nécessaire à une personne, semble fort superflu à une autre.
Néanmoins, quelle que soit la variété qui se trouve dans les goûts et les besoins des hommes, il se fait entre eux une estimation générale de l’utilité de chaque objet en particulier, estimation dont on peut se faire une idée au moyen de la quantité d’autres objets qu’ils consentent à donner en échange de celui-là.
Je peux juger, par exemple, que l’utilité d’un habit est trois fois plus grande que celle d’un chapeau, si je trouve qu’on consent en général à donner trois chapeaux en échange d’un habit.
Et, pour plus de commodité, si nous observons la quantité qu’on donne d’un même produit, la quantité d’écus par exemple, qu’on donne en échange de deux objets différents, nous pourrons nous former une idée de la proportion qui existe entre la valeur échangeable de l’un de ces objets et la valeur de l’autre.
Ainsi je dirai qu’une quantité de blé pouvant s’échanger, ou si l’on veut se vendre, contre cent écus, est un produit égal à une quantité de toile dont on trouverait cents écus. Je dirai qu’un mètre de drap qui peut se vendre 30 francs, est un produit vingt fois plus considérable qu’un mètre de toile d’emballage qui se vendrait à peine 30 sols.
Je me sers d’une évaluation en argent, parce qu’elle est la plus commode et la plus usitée ; mais l’estimation de la valeur échangeable des choses pourrait se faire en tout autre produit. L’estimation en monnaie d’argent est même sujette à de nombreuses inexactitudes, ainsi qu’on le verra au livre des monnaies : elle suffit cependant dans la plupart des cas dont s’occupe l’économie politique.
Je prie qu’on fasse attention que le prix des choses en argent n’est ici considéré que comme un moyen imparfait de comparer la valeur échangeable des choses, et que la valeur échangeable des choses n’est donnée que comme une évaluation, la moins vague qu’on peut trouver du degré de leur utilité ; mais que c’est le degré d’utilité seul qui constitue véritablement la production. Autrement en faisant monter les prix par des moyens violents, par des taxes, des prohibitions, etc., on augmenterait la production. La valeur échangeable des choses et leur prix en argent ne peuvent donc donner une idée approchée de la production, que dans les cas où ce prix et cette valeur sont abandonnés à eux-mêmes, comme un baromètre n’indique la pesanteur de l’atmosphère qu’autant que le mercure y est laissé en liberté.
Ce qui précède nous explique comment les diverses industries, bien qu’elles ne tirent rien du néant, donnent cependant des produits ; et comment l’industrie manufacturière et l’industrie commerçante sont productives précisément dans le même sens que l’industrie agricole. Elles donnent une valeur à des matières brutes ou bien accroissent une valeur déjà existante ; et que fait l’agriculture autre chose sinon qu’à l’aide d’un outil puissant elle donne une valeur à des matières déjà existantes dans la nature ?
C’est pour avoir méconnu ce principe que la secte des Économistes, qui comptait dans son sein des écrivains d’ailleurs très éclairés, est tombée dans de graves erreurs. Matières brutes et richesses étaient pour elle des mots synonymes ; et l’industrie agricole étant la seule qui tirât les matières brutes des mains de la nature, était, suivant elle, la seule qui produisît des richesses. Les Économistes ne sentaient pas que la richesse ne consiste pas dans la matière, mais bien dans la valeur de la matière ; qu’une matière rendue propre à l’usage, est une plus grande richesse qu’une matière brute, et qu’un homme qui possède dans son magasin un quintal de laines fabriquées en beaux draps, est plus riche que celui qui possède un quintal de laines en balles.
L’industrie commerçante produit de même que l’industrie manufacturière, en élevant la valeur d’un produit par son transport d’un lieu dans un autre. C’est une façon qu’elle donne aux marchandises ; une façon qui rend propres à l’usage, des choses qui ne l’étaient pas ; une façon non moins utile, non moins compliquée, et non moins hasardeuse qu’aucune de celles que donnent les deux autres industries :
Ainsi lorsque Raynal [11] a dit du commerce, en l’opposant à l’agriculture et aux arts : Le commerce ne produit rien par lui-même, il ne s’était pas formé une idée complète du phénomène de la production. Raynal a fait dans cette occasion, relativement au commerce, la même erreur que les Économistes faisaient relativement au commerce et aux manufactures. Ils disaient l’agriculture seule produit ; Raynal prétend que l’agriculture et les arts industriels seuls produisent. Il se trompe un peu moins, mais se trompe encore.
Condillac s’égare aussi lorsqu’il veut expliquer de quelle manière le commerce produit. Il prétend que toutes les marchandises, valant moins pour celui qui les vend que pour celui qui les achète, elles augmentent de valeur par cela seul qu’elles passent d’une main dans une autre. C’est une erreur ; car une vente étant un échange où l’on reçoit une marchandise, de l’argent, par exemple, en retour d’une autre marchandise, la perte qui se ferait sur l’une des deux, compenserait le gain qui se ferait sur l’autre, et il n’y aurait point de valeur produite. Lorsqu’on achète à Paris du vin d’Espagne, on donne bien réellement valeur égale pour valeur égale : l’argent qu’on paie et le vin qu’on reçoit valent autant l’un que l’autre ; mais le vin ne valait pas autant avant d’être parti d’Alicante ; sa valeur s’est véritablement accrue entre les mains du commerçant, par le transport, et non pas seulement au moment de l’échange ; le vendeur ne fait point un métier de fripon, ni l’acheteur un métier de dupe, et Condillac n’est point fondé à dire que si l’on échangeait toujours valeur égale pour valeur égale, il n’y aurait point de gain à faire pour les contractants . [12]
Les hommes ne peuvent se servir des produits sans les détruire ; c’est ainsi qu’un aliment, lorsqu’il est mangé, un habit, lorsqu’il est entièrement usé, ont cessé d’être ; cette destruction se nomme consommation.
Comme la production n’est pas une création, mais seulement une production d’utilité, de même la consommation n’est pas une destruction, mais seulement une destruction d’utilité qui entraîne une destruction de valeur. Nous ne pouvons pas plus anéantir une chose que la créer ; mais nous pouvons la réduire à n’être plus d’aucun usage, à n’avoir plus aucune valeur pour l’homme. C’est cela qu’on appelle consommer.
Le consommateur est la dernière personne entre les mains de qui passe un produit ; c’est celle qui en fait usage, qui le consomme. Ainsi consommer se dit non seulement des choses qui servent à la nourriture, mais encore de ce qui sert au vêtement, aux plaisirs ; il se dit de toutes les choses, en un mot, dont la valeur s’altère quelque peu que ce soit, par l’usage qu’on en fait ; ainsi l’on consomme des boucles d’argent, comme un chapeau, comme un dîner, quoique plus lentement.
Je réserve pour le Ve livre de cet ouvrage, l’examen des diverses manières de consommer, et des effets qui en sont la suite. L’objet de ce premier livre est de rechercher comment s’opère la production dans le sens que nous avons vu qu’il faut donner à ce mot. peut-être ce chapitre devait-il être le premier de l’ouvrage ; mais tout le monde l’aurait-il bien compris ? Fallait-il commencer par une abstraction ?
[I-32]
CHAPITRE VII.
Comment se joignent l’industrie, les capitaux et les fonds de terre pour produire.↩
Nous avons vu de quelle manière l’industrie, les capitaux et les fonds de terre concourent chacun en ce qui les concerne, à la production ; nous avons vu que ces trois choses sont toutes indispensables pour qu’il y ait des produits créés ; mais pour cela, il y n’est point nécessaire qu’elles appartiennent à la même personne.
Une personne industrieuse peut prêter son industrie à celle qui ne possède qu’un capital et un fonds de terre.
Le possesseur d’un capital peut le prêter à une personne qui n’a qu’un fonds de terre et de l’industrie.
Le propriétaire d’un fonds peut le prêter à la personne qui ne possède que de l’industrie et un capital.
Soit qu’on prête de l’industrie, un capital, ou un fonds de terre, ces choses concourant à créer une valeur, leur usage a une valeur aussi, et se paie pour l’ordinaire.
Le paiement d’une industrie prêtée se nomme un salaire.
Le paiement d’un capital prêté se nomme un intérêt.
Le paiement d’un fonds de terre prêté se nomme un fermage.
Le fonds, le capital et l’industrie se trouvent quelquefois réunis dans les mêmes mains. Un homme qui cultive à ses propres frais le jardin qui lui appartient, possède le fonds, le capital et l’industrie. Il fait, lui seul, le bénéfice du propriétaire foncier, du capitaliste et de l’homme industrieux.
Le rémouleur qui exerce une industrie pour laquelle il ne faut point de fonds de terre, porte sur son dos tout son capital, et toute son industrie dans ses doigts : il est à la fois entrepreneur, capitaliste et ouvrier.
Il est rare qu’il y ait des entrepreneurs si pauvres, qu’ils ne possèdent pas en propre une portion au moins de leur capital. L’ouvrier lui-même en fournit presque toujours une partie : le maçon ne marche point sans sa truelle ; le garçon tailleur se présente muni de son dé et de ses aiguilles ; le compositeur d’imprimerie, de son composteur. Tous sont vêtus, plus ou moins bien ; leur salaire doit suffire, à la vérité, à l’entretien constant de leur habit ; mais enfin ils en font l’avance.
Lorsque le fonds n’est la propriété de personne, comme de certaines carrières où l’on puise des pierres, comme les rivières, les mers, où l’industrie va chercher du poisson, des perles, du corail, etc., alors on peut obtenir des produits avec de l’industrie et des capitaux seulement.
L’industrie et le capital suffisent également, lorsque l’industrie travaille sur des produits d’un fonds étranger, et qu’on peut se procurer avec des capitaux seuls, comme lorsqu’elle fabrique chez nous des étoffes de coton, et beaucoup d’autres choses. Ainsi, à considérer chaque nation en particulier, on peut dire que toute espèce de manufacture donne des produits, pourvu qu’il s’y trouve industrie et capital ; le fonds n’est pas absolument nécessaire, à moins qu’on ne donne ce nom au local où sont placés les ateliers, et qu’on n’appelle fermage, le loyer qu’on paie pour en jouir, ce qui serait juste à la rigueur. Mais si l’on appelle un fonds le local où s’exerce l’industrie, on conviendra du moins que sur un bien petit fonds, on peut exercer une bien grande industrie, pourvu qu’on ait un gros capital.
On peut tirer de là cette conséquence, c’est que l’industrie d’une nation n’est point bornée par l’étendue de son territoire, mais bien par la grandeur de ses capitaux. Un fabricant de bas, avec un capital que je suppose égal à cent mille francs, peut avoir sans cesse en activité dix métiers à faire des bas. S’il parvient à avoir un capital de deux cent mille francs, il pourra mettre en activité vingt métiers ; c’est-à-dire qu’il pourra acheter dix métiers de plus, payer un loyer double, se procurer une double quantité de soie ou de coton propres à être ouvrés, faire les avances qu’exige l’entretien d’un nombre double d’ouvriers, etc., etc.
Toutefois la partie de l’industrie agricole qui s’applique à la culture des terres est nécessairement bornée par l’étendue du territoire. Les particuliers et les nations ne peuvent rendre leur territoire ni plus étendu, ni plus fertile que la nature ne le leur a donné ; mais ils peuvent sans cesse augmenter leurs capitaux ; par conséquent mettre en activité une plus grande masse d’industrie ; par conséquent multiplier leurs produits, ou si l’on veut leurs richesses.
On a vu des peuples, comme les Genevois, dont le territoire ne produisait pas la vingtième partie de ce qui était nécessaire à leur subsistance, vivre néanmoins dans l’abondance. L’aisance habite dans les gorges infertiles du Jura, surtout du côté de la Suisse ; c’est qu’on y exerce plusieurs arts mécaniques, l’horlogerie, la serrurerie ; on y fait des planches, des chars. L’étendue et la fertilité du territoire d’une nation tiennent à son bonheur. Son industrie et ses capitaux tiennent à sa conduite. Toujours il dépend d’elle de perfectionner l’une et d’accroître les autres.
La France a toujours eu trop peu de capitaux pour mettre en jeu l’industrie de ses habitants, qui est fort grande. Aussi a-t-on vu constamment les procédés les plus ingénieux, après y avoir pris naissance, trouver leur application dans des pays mieux pourvus de capitaux. On n’a vraiment commencé qu’en Angleterre à tirer parti du métier à bas qui fut inventé en France.
Les nations qui ont peu de capitaux ont un désavantage dans la vente de leurs produits : elles ne peuvent pas accorder de longs termes à leurs acheteurs. Celles qui ont moins de capitaux encore, ne sont pas toujours en état de faire même l’avance de leurs matières premières et de leur travail. Voilà pourquoi on est obligé, aux Indes et en Russie, d’envoyer quelquefois le prix de ce qu’on achète, six mois et même un an avant le moment où les commissions peu vent être exécutées. Il faut que ces nations soient bien favorisées à d’autres égards, pour faire des ventes si considérables malgré ce désavantage.
[I-38]
CHAPITRE VIII.
Du travail de l’homme et du travail de la nature.↩
Quelle que soit l’espèce d’industrie que l’on veuille considérer, on sentira qu’elle ne peut être mise en activité que par le moyen du travail.
J’appelle travail l’action suivie à laquelle on se livre pour exécuter une des opérations de l’industrie, ou seulement une partie de ces opérations.
Quelle que soit celle de ces opérations à laquelle le travail s’applique, il est productif, puisqu’il concourt à la création d’un produit. Ainsi le travail du savant qui fait des expériences et des livres, est productif ; le travail de l’entrepreneur, bien qu’il ne mette pas immédiatement la main à l’œuvre, est productif ; enfin, le travail du manouvrier, depuis le journalier qui bêche la terre, jusqu’au matelot qui conduit un navire, est encore productif.
Il est rare qu’on se livre à un travail qui ne soit pas productif, c’est-à-dire qui ne concoure pas aux produits de l’une ou de l’autre industrie. Le travail, tel que je viens de le définir, est une peine ; et cette peine ne serait suivie d’aucune compensation, d’aucun salaire ; quiconque la prendrait ferait une sottise ou une extravagance. Quand cette peine est employée à dépouiller, par force ou par adresse, une autre personne des biens qu’elle possède, ce n’est plus une extravagance : c’est un crime.
L’homme force la nature à travailler de concert avec lui à la création des produits. Quand je dis la nature, j’entends tous les êtres matériels qui composent le monde. Chacun a ses propriétés ; tous ou presque tous ont la faculté de pouvoir concourir à créer des produits utiles à l’homme. C’est ainsi que le feu amollit les métaux, que le vent fait tourner nos moulins, que l’eau, l’air et la terre forment les plantes, les bois, qui nous sont utiles.
L’élasticité de l’acier nous permet de faire des ressorts qui font marcher des horloges ; la pesanteur des corps nous sert au même usage ; nous tournons à notre profit toutes les lois du monde physique. Nous sommes presque toujours en communauté de travail avec la nature.
Maintenant il est facile de s’apercevoir que dans cette communauté, l’homme gagne doublement à rejeter sur la nature la plus grande partie possible des travaux productifs.
Il y gagne soit une exemption de travail, ce qui est une exemption de peine, soit une augmentation de produits, et souvent ces deux avantages ensemble. Les anciens ne connaissaient pas les moulins. [13] De leur temps, c’étaient des hommes qui broyaient le froment pour faire du pain. Il fallait bien vingt hommes pour broyer autant de blé qu’un moulin à vent en peut moudre. Or un seul meunier, deux au plus, suffisent pour alimenter et surveiller le moulin. Ces deux hommes, à l’aide de cette ingénieuse machine, donnent un produit égal au produit que donnaient vingt hommes au temps de César. Nous forçons donc le vent, dans chacun de nos moulins, à faire l’ouvrage de dix-huit hommes. Or les dix-huit hommes que les anciens employaient de plus que nous à ce travail, peuvent de nos jours trouver à se nourrir comme autrefois, puisque le moulin n’a pas diminué les produits de la société, et en même temps leur industrie peut s’appliquer à créer d’autres produits, et à multiplier nos richesses.
[I-42]
CHAPITRE IX.
Des machines qui suppléent au travail de l’homme.↩
Il y a bien peu de produits que l’homme puisse se procurer sans faire usage de quelque instrument, sans ajouter au bout de ses doigts, qui sont des outils naturels, d’autres outils créés par son industrie.
Plusieurs de ces outils sont fort simples comme les aiguilles à tricoter ; d’autres sont des machines très compliquées comme le métier pour faire des étoffes brochées ; mais simples ou compliquées, des aiguilles à tricoter et le métier pour les étoffes de soie sont deux machines précisément du même genre : l’une et l’autre sont indispensablement nécessaires à l’homme pour qu’il puisse faire des bas et des étoffes. Partout où l’on veut avoir ces deux produits, il n’existe pas d’autre moyen plus simple de se les procurer que celui que présentent ces instruments.
Il est des machines d’une autre espèce : celles-ci font ce que l’homme pourrait faire sans elles ; mais elles rendent le travail plus facile, ou l’abrègent considérablement. Tel est le moulin à filer le coton. On peut sans doute filer du coton sans son entremise, mais il parvient au même but bien plus rapidement. Telle est encore la charrue, la plus utile de toutes les machines. On peut, à la rigueur, s’en passer pour labourer la terre ; mais combien ne rendelle pas facile, expéditif cet indispensable travail !
Quant aux machines de la première espèce, leur emploi ne peut donner lieu à aucune difficulté : si l’on veut jouir des produits qu’elles seules peuvent exécuter, il faut bien en faire usage ; elles procurent à l’homme de nouvelles commodités, de nouvelles richesses, et soit qu’on en doive la découverte au hasard ou bien à des hommes de génie, les pays où elles prennent naissance, celui où elles s’introduisent, l’univers entier doit s’en réjouir ; même les pays où l’usage ne s’en propage pas, où leur produit seul peut pénétrer. Il existe pour ceux-là une richesse de plus dans le monde, qui ne leur fait aucun mal, si elle ne leur convient pas, et qu’ils sont libres d’acheter avec leurs propres produits, si elle leur convient.
Relativement aux machines de la seconde espèce (celles qui peuvent être remplacées par le labeur de l’homme), il s’élève une question délicate et importante par son influence sur la prospérité des États, et sur la condition de la classe ouvrière. On se demande : Les avantages qu’elles procurent balancent-ils l’inconvénient de priver les ouvriers qu’elles remplacent du travail qui les faisait vivre ?
Il est évident qu’elles augmentent la masse des produits généraux de l’État, sans augmenter dans la même proportion la masse de ses consommations. Je renvoie à l’exemple du moulin cité dans le chapitre précédent.
Mais voici l’inconvénient. Les produits de la machine vont se joindre aux profits de l’entrepreneur à qui elle appartient ; tandis que les produits du travail des ouvriers composaient leurs profits et servaient à leurs consommations. L’introduction d’une nouvelle machine paraît donc au premier coup d’œil favoriser celui qui fait déjà les meilleurs profits, et écraser les travailleurs qui ne font que des profits médiocres.
Ce n’est pourtant pas là, exactement, l’effet qu’elles produisent.
D’abord ce n’est pas l’entrepreneur qui profite de l’avantage des machines, si ce n’est pendant le temps qu’il peut les tenir secrètes : c’est le consommateur. La concurrence ramène les profits qu’on fait sur le travail des machines, au niveau du profit qu’on faisait sur le travail des ouvriers. La mouture du blé ne rapporte probablement pas plus aux meuniers d’à présent, qu’à ceux qui se chargeaient de moudre le grain du temps de César ; mais la mouture coûte moins. [14]
En second lieu, les machines, pour être tenues en activité, n’exigent pas autant de capitaux que les hommes. Si un moulin que nous avons supposé faire autant d’ouvrage que dix-huit hommes, emploie de la matière première, c’est-à-dire du grain, en même quantité, du moins n’exige-t-il point d’avances pour sa nourriture, pour son vêtement ; ou s’il occasionne quelques frais d’entretien, ces frais n’égalent point ceux que dix-huit hommes exigeraient. Une partie du capital qui alimentait cette industrie peut donc employer au moins une partie des dix-huit ouvriers que la machine a laissés sans ouvrage. Elle doit nécessairement les employer ; autrement ce capital demeurerait oisif et causerait une perte à son propriétaire.
Mais si une partie des ouvriers sont de cette manière réemployés, soit dans la même production, soit dans une autre, il en est toujours parmi eux qui ne peuvent trouver de l’ouvrage, à moins qu’il ne se présente un nouveau capital prêt à mettre leur industrie en œuvre ; et s’il ne s’en présente point, leur sort est vraiment déplorable.
L’État n’y perd rien, car ses produits restent les mêmes ; il y gagne au contraire la consommation des infortunés qui, ne travaillant plus, ne peuvent plus consommer ; mais des êtres vivants, des êtres sensibles, sont sacrifiés à la prospérité générale.
Dans une société où les capitaux vont en croissant, l’invention des machines nouvelles est sujette à peu d’inconvénients. Elles multiplient, il est vrai, le nombre des êtres travaillants, animés ou non-animés ; mais dans un tel pays, de nouveaux capitaux permettent de faire travailler les nouveaux êtres travaillants qui se présentent. Car ce n’est pas le défaut de consommateurs qui arrête l’essor de l’industrie : il naît des consommateurs partout où il naît des produits ; c’est le défaut de capitaux. Quand les capitaux ne manquent pas, nul être capable de travail ne reste désœuvré malgré lui.
Mais les capitaux manqueraient, le mal serait aussi grand qu’on peut le supposer, il n’est jamais que local et momentané, tandis que le bien qui résulte d’une fabrication plus abondante et plus prompte est général et durable.
« Eh ! quelle est l’innovation, dit à ce sujet Steuart, quelque raisonnable, quelque profitable qu’elle soit, qui n’ait ses inconvénients... ! Faut-il ne pas conclure un traité de paix, parce qu’il entraînera le licenciement d’une partie de l’armée et laissera beaucoup de gens sans emploi ? »
Remarquons qu’une administration habile trouve encore des moyens d’adoucir ce mal momentané et local. Elle peut restreindre dans les commencements l’emploi d’une nouvelle machine à de certains cantons où les bras sont rares et réclamés par d’autres branches d’industrie. Elle peut préparer d’avance de l’emploi pour les bras inoccupés, en formant à ses propres frais des entreprises d’utilité publique, comme celle d’un canal, d’une route, d’un grand édifice. Elle peut enfin provoquer une colonisation, une translation de population d’un lieu dans un autre.
L’emploi des bras qu’une machine laisse sans ouvrage est d’autant plus facile à trouver, que ce sont pour l’ordinaire des bras accoutumés au travail, des bras plus ou moins exercés aux procédés des arts.
Ce serait bien vainement, au surplus, que vous chercheriez à éviter le mal passager qui peut accompagner l’invention d’une machine nouvelle, en défendant d’en faire usage. Elle est ou sera exécutée quelque part, dans l’étranger ; ses produits seront moins chers que ceux que vos ouvriers continueront à créer laborieusement, et leur bon marché enlèvera toujours nécessairement à ces ouvriers leurs consommateurs et leur ouvrage. Si les fileurs de coton de la Normandie, qui brisèrent en 1789 les machines à filature qui s’introduisaient alors dans cette province, avaient continué sur le même pied, il aurait fallu renoncer à fabriquer chez nous des étoffes de coton ; on les aurait toutes tirées d’Angleterre, et les fileurs de Normandie seraient demeurés encore plus dépourvus d’ouvrage.
Toutes les fois qu’on parvient au contraire à surmonter les difficultés qui accompagnent l’introduction des nouvelles machines, on en retire non seulement les avantages généraux que j’ai indiqués, mais encore des avantages particuliers pour la classe qui, dans les commencements, avait de quoi se plaindre. L’expérience de tous les temps offre une foule de preuves de cette assertion ; mais un des plus frappants nous est fourni par la machine qui sert à multiplier rapidement les copies d’un même écrit : je veux dire de l’imprimerie.
Je ne parlerai pas de l’influence qu’a eue l’imprimerie sur le perfectionnement des connaissances humaines et sur la civilisation du globe ; je ne veux la considérer que comme manufacture et sous ses rapports économiques. Au moment où elle fut d’abord employée, une foule de copistes durent rester sans emploi, car on peut estimer qu’un seul ouvrier imprimeur fait autant de besogne que 200 copistes. [15] Il faut donc croire que 199 ouvriers sur 200 restèrent sans ouvrage. Eh bien, la facilité de lire les ouvrages imprimés plus grande que pour les ouvrages manuscrits, le bas prix auquel les livres tombèrent, l’encouragement que cette circonstance donna aux auteurs pour en composer en bien plus grand nombre, soit d’instruction, soit d’amusement, tout cela fit qu’au bout de très peu de temps il y eut plus d’ouvriers imprimeurs employés, qu’il n’y avait auparavant de copistes. Et si à présent on pouvait calculer exactement, non seulement le nombre des ouvriers imprimeurs, mais encore des ouvriers que l’imprimerie fait travailler, comme graveurs de poinçons, fondeurs de caractères, fabricants de papiers, voituriers, correcteurs, relieurs, libraires, on trouverait peut-être que le nombre des personnes occupées par la fabrication des livres est cent fois plus grand que celui qu’elle occupait avant l’invention de l’imprimerie.
J’ai dit au commencement de ce chapitre que les machines pouvaient être divisées en deux classes, relativement à l’usage dont elles sont : savoir, de concourir à des produits qu’on n’obtiendrait point sans elles, ou bien de faciliter et d’abréger la production, de manière qu’on parvienne au même but en employant moins de temps et moins de bras. Nous avons reconnu que l’on n’avait jamais trouvé aucun inconvénient à l’emploi des premières ; et nous avons remarqué les avantages et les inconvénients qui suivent l’emploi des secondes.
Maintenant il est un autre point de vue sous lequel on peut considérer cette question.
Et d’abord il faut se demander : Est-il bien vrai qu’il y ait des machines qui se bornent à faciliter, à abréger l’ouvrage ? Ne donnent-elles pas au produit une perfection qu’il n’aurait point sans elles ? N’en font-elles pas un autre produit, et par conséquent ne rentrent-elles pas toutes, ou presque toutes, dans la première classe que nous avons distinguée, de machines absolument nécessaires dans la supposition qu’on veuille avoir un tel produit ?
En effet le coton se file avec les doigts et avec des machines ; mais les doigts ne peuvent jamais donner au fil un degré de finesse et d’égalité suffisant pour faire de belles mousselines ou de beaux basins. Les machines à filer le coton ont donc l’avantage non seulement de faire incomparablement plus d’ouvrage que des fileuses, mais de faire un ouvrage que toutes les fileuses du monde ne feraient jamais précisément de la même manière.
Des peintres pourraient exécuter au pinceau les dessins qui ornent nos indiennes, nos papiers pour tentures ; mais les planches d’impression qu’on emploie pour cet effet donnent au dessin une régularité, aux couleurs une mêmeté qui ne s’obtiendrait point sans cela.
En poursuivant cette recherche dans la plupart des arts industriels, on verra qu’il est bien peu de machines qui n’aient d’autre avantage que de remplacer purement et simplement le travail de l’homme ; il en est bien peu par conséquent que le travail de l’homme puisse remplacer entièrement ; et l’on peut supposer que les machines qui s’inventent chaque jour et qui s’inventeront dans la suite seront à peu près dans le même cas. Par conséquent, repousser une machine nouvelle, c’est repousser un produit nouveau jusqu’à un certain point ; et quant à celles (qui se réduisent réellement à un très petit nombre) dont l’effet n’est autre que d’épargner le temps et les bras, nous avons vu quels sont leurs inconvénients passagers, leurs avantages durables : c’est aux chefs de l’administration des États à atténuer leurs inconvénients et à laisser à l’intérêt personnel le soin de tirer parti de leurs avantages.
[I-54]
CHAPITRE X.
Comment la division du travail multiplie les produits et les perfectionne.↩
Nous avons déjà remarqué que ce n’était pas ordinairement la même personne qui se chargeait des différentes opérations dont l’ensemble compose une même industrie. Ces opérations exigent pour la plupart des talents divers, et des travaux assez considérables pour occuper un homme tout entier. Il est même telle de ces opérations qui se partage en plusieurs branches, dont une seule suffit pour occuper tout le temps et toute l’attention d’une personne. C’est ainsi que l’étude de la nature se partage entre le chimiste, le botaniste, l’astronome et plusieurs autres classes de savants.
C’est ainsi que lorsqu’il s’agit de l’application des connaissances de l’homme à ses besoins, dans l’industrie manufacturière par exemple, les étoffes, les faïences, les meubles, les quincailleries, etc., nous offrent des produits qui occupent autant de différentes classes de fabricants.
Enfin dans le travail manuel de chaque industrie il y a souvent autant de classes d’ouvriers qu’il y a de travaux différents. Pour faire le drap de mon habit, il a fallu occuper des fileuses, des tisseurs, des fouleurs, des tondeurs, des teinturiers et plusieurs autres sortes d’ouvriers. Le célèbre Adam Smith a le premier fait remarquer que nous devions à cette division du travail une augmentation prodigieuse dans la production et une plus grande perfection dans les produits.
Il cite, comme un exemple entre beaucoup d’autres, la fabrication des épingles. Chacun des ouvriers qui s’occupent de ce travail ne fait jamais qu’une partie d’une épingle. L’un passe le laiton à la filière, un autre le coupe, un troisième aiguise les pointes ; la tête seule de l’épingle exige deux ou trois opérations distinctes, exécutées par autant de personnes différentes.
Au moyen de cette séparation d’occupations diverses, une manufacture assez mal montée, et où dix ouvriers seulement travaillaient, fabriquait chaque jour, au rapport de Smith, quarante-huit mille épingles.
Si chacun de ces dix ouvriers avait été obligé de faire des épingles les unes après les autres, en commençant par la première opération et en finissant par la dernière, il n’en aurait peut-être terminé que vingt dans un jour ; et les dix ouvriers n’en auraient fait que deux cents au lieu de quarante-huit mille.
Smith attribue ce prodigieux effet à trois causes.
Première cause. L’esprit et le corps acquièrent une habileté singulière dans les occupations simples et souvent répétées. Dans de certaines fabrications, la rapidité avec laquelle sont exécutées de certaines opérations, passe tout ce qu’on peut attendre de la dextérité de l’homme.
Deuxième cause. On évite le temps perdu à passer d’une occupation à une autre, et cette perte est beaucoup plus grande qu’on ne serait tenté de le croire. Chaque fois qu’on entame une besogne nouvelle, il faut du temps pour se mettre en train ; il faut donner à ce qu’on fait une plus grande dose d’attention, et l’esprit n’est pas moins paresseux que le corps. Il y a des préparations qui exigent de grands déplacements, comme de passer d’un atelier dans un autre, ou du bord d’une rivière à l’intérieur d’une maison ; enfin n’y a-t-il pas même du temps perdu à changer fréquemment de position, à quitter un outil pour prendre un outil différent ?
Troisième cause. C’est la séparation des occupations qui a fait découvrir les meilleures méthodes, soit pour acquérir des connaissances, soit pour les communiquer. C’est elle qui a donné naissance aux machines qui facilitent et abrègent tant le travail de l’homme. Elle a naturellement réduit chaque opération à une tâche fort simple et sans cesse répétée ; or ce sont de pareilles tâches qu’on parvient plus aisément à faire exécuter par des machines.
Les hommes d’ailleurs trouvent bien mieux les manières d’atteindre un certain but, lorsque ce but est proche et que leur attention est constamment tournée du même côté. Dans les premières pompes à feu qu’on établit, c’était l’occupation d’une personne d’ouvrir le robinet d’eau froide qui sert à condenser la vapeur lorsque le piston est suffisamment soulevé. Cet emploi était confié à un jeune garçon. Un jour un de ces jeunes gens, tourmenté du désir d’aller jouer avec ses camarades, s’aperçut qu’il suffirait, pour que le robinet s’ouvrît et se fermât, d’attacher au manche qu’on lui avait donné à gouverner, une ficelle qui répondît au bras du piston. Dès lors le piston par son mouvement remplit les fonctions d’une personne, et l’un des plus utiles perfectionnements de cette belle machine fut dû à l’envie qu’avait un enfant de se divertir.
La plupart des découvertes même que les savants ont faites doivent être attribuées à la division du travail, puisque c’est par une suite de cette division que des hommes se sont occupés à étudier de certaines branches de connaissances exclusivement à toutes les autres ; ce qui leur a permis de les suivre beaucoup plus loin. Entre leurs découvertes il en est un grand nombre sans doute dont on n’a l’obligation qu’au hasard ; il n’est pas moins vrai de dire qu’en thèse générale les connaissances nécessaires à la production sont d’autant plus parfaites et d’autant plus étendues, qu’on s’en occupé avec plus de soin ; et l’on s’en occupe avec d’autant plus de soin, qu’on s’en occupe plus exclusivement.
Ainsi les connaissances nécessaires pour la prospérité de l’industrie commerçante, par exemple, sont bien plus perfectionnées quand ce sont des hommes différents qui étudient :
L’un la géographie, pour connaître la situation des États et leurs produits ;
L’autre la politique, pour connaître ce qui a rapport à leurs lois, à leurs mœurs, et quels sont les inconvénients ou les secours auxquels on doit s’attendre en trafiquant avec eux ;
L’autre la géométrie, la mécanique, pour déterminer la meilleure forme des vaisseaux, des chars, des machines ;
L’autre l’astronomie, la physique, pour naviguer avec succès, etc.
S’agit-il de la partie de l’application dans la même industrie commerçante ? on sentira qu’elle sera plus parfaite lorsque ce seront des négociants différents qui feront le commerce d’une province à l’autre, le commerce de la Méditerranée, celui des Indes Orientales, celui d’Amérique, le commerce en gros, le commerce en détail, etc., etc.
Toutefois la nature des choses et l’intérêt des hommes mettent des bornes à une division du travail qui serait poussée trop loin. Ce ne sont point deux négociants différents qui transportent dans un pays les produits que ce pays consomme et qui en rapportent les produits qu’il fournit, parce que l’une de ces opérations n’exclut pas l’autre, et qu’elles peuvent au contraire être exécutées en se prêtant un appui mutuel.
On peut s’en rapporter à l’intérêt particulier du soin de cumuler les opérations qui se prêtent de l’appui, et de séparer celles qui se nuisent.
[I-61]
CHAPITRE XI.
Comment le producteur et le consommateur profitent l’un et l’autre des avantages résultants de la division du travail.↩
La division du travail, en multipliant les produits relativement aux frais de productions, les procure à meilleur marché. Le producteur, obligé par la concurrence d’en baisser le prix de tout le montant de l’économie qui en résulte, en profite beaucoup moins que le consommateur. Et lorsque le consommateur met obstacle à cette division, c’est à lui-même qu’il porte préjudice.
Un tailleur qui voudrait faire non seulement ses habits, mais encore ses souliers, se ruinerait infailliblement.
On voit des personnes qui font, pour ce qui les regarde, les fonctions du commerçant, afin d’éviter de lui payer les profits ordinaires de son industrie ; elles veulent, disent-elles, mettre ce bénéfice dans leur poche. Elles calculent mal : la division du travail permet au commerçant d’exécuter pour elles ce travail à moins de frais qu’elles ne peuvent le faire elles-mêmes.
Comptez la peine que vous avez prise, le temps que vous avez perdu, les faux frais, toujours plus considérables à proportion dans les petites opérations que dans les grandes ; et voyez si ce que tout cela vous coûte n’excède pas 2 ou 3 pour cent que vous épargnerez sur un chétif objet de consommation, en supposant encore que ce bénéfice ne vous ait pas été ravi par la cupidité de l’agriculteur ou du manufacturier avec qui vous avez traité directement et qui ont dû se prévaloir de votre inexpérience.
Il ne convient pas même à l’agriculteur et au manufacturier, si ce n’est dans des circonstances très particulières, d’aller sur les brisées du commerçant et de chercher à vendre sans intermédiaire leurs denrées au consommateur.
Je me promenais une fois de très bon matin dans les environs d’une grande ville. Je vis tous les habitants d’un village des environs, apporter au marché, les uns des légumes, les autres du fruit, du beurre, du lait, des œufs, de la volaille. Ces pauvres gens, au lieu de dormir pendant la nuit toute entière, se privaient de la moitié de leur repos ; ils avaient cultivé et cueilli la veille jusqu’au soir, et dès minuit ils étaient partis pour vendre à la ville les fruits de leurs pénibles travaux. Aussi remarquais-je en eux la contenance de gens fatigués par un travail excessif : les jeunes avaient l’air vieux ; les mieux portants semblaient malades ; dans les traits des femmes on ne retrouvait plus rien de la délicatesse et des grâces de leur sexe.
Vingt ans se passent. Je me promène de nouveau sur le même chemin, à la même heure. Je ne vois plus mes villageois, mais à leur place, des chariots traînés par de bons chevaux, qui portaient toute la récolte du même village.
Je vais dans ce village. Je m’informe. J’apprends qu’on ne s’y lève plus au milieu de la nuit, mais au point du jour. Je vois des hommes bien nourris remuant la terre d’un bras robuste ; l’intérieur des maisons m’offre des ménages bien tenus, des enfants soignés, des femmes dont la physionomie n’était pas dépourvue d’une expression agréable.
D’où venait ce changement ?
Il s’était établi une espèce de commerçants qui achetaient les denrées de tout le canton pour les aller vendre à la ville. Un petit nombre de chariots voituraient ce qu’auparavant le village presqu’entier transportait dans des hottes ou sur des ânes. Le premier qui entreprit cette nouvelle industrie excita contre lui un soulèvement général : « Il vient, disaient ces pauvres et ignorants villageois, nous voler une partie des bénéfices déjà si minces que nous faisons ». Et au bout de quelque temps, ils éprouvèrent cependant que le temps et les forces qu’ils usaient pour se procurer auparavant ce petit bénéfice, pouvaient être employés plus utilement pour eux-mêmes. Leurs travaux y gagnèrent ; les produits du village furent plus grands ; leur aisance s’accrut, et ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni eux-mêmes, ne furent plus excédés par des travaux forcés.
C’est par une erreur semblable que dans certains pays, l’aversion populaire poursuit tous ceux qui se livrent au commerce des grains. Certes, s’il en est qui cherchent à faire un gain monopole sur une denrée si généralement nécessaire, ils doivent être vus avec horreur ; mais le peuple a tort quand il confond dans la même haine les commerçants qui font sur cette denrée, en l’achetant pour la revendre, les bénéfices ordinaires du commerce.
Le peuple s’imagine que leur profit sur le blé est en augmentation du prix qu’il le paie. Il ne fait pas attention que si le négociant ne prenait pas la peine nécessaire pour rassembler des grains, pour les porter au lieu où l’on en a besoin, il faudrait que ce fût le propriétaire ou le fermier qui la prissent. Or il est impossible, en vertu de l’avantage résultant de la division du travail, que le fermier et le propriétaire exécutent ce travail à aussi bon marché que le négociant. Ils se détourneraient de leur ouvrage accoutumé, ils perdraient un temps que d’autres occupations réclament ; ils seraient obligés d’entretenir à cet effet des chevaux, des voitures autres que ceux qui servent à la culture, et l’augmentation qu’ils seraient forcés en con 233.séquence de mettre au prix de leur blé, surpasserait infailliblement le bénéfice du négociant.
Je suis persuadé que le bas prix du sucre à la Chine tient, en partie, à ce que la division du travail dans la production de cette denrée y est poussée plus loin que dans les colonies européennes d’Amérique.
« La fabrication du sucre à la Chine, dit Macartney [16] est une entreprise dont ne se mêle point celui qui cultive les cannes ; les fabricateurs se transportent dans les plantations avec l’appareil qui leur est nécessaire, et que les planteurs des Antilles regarderaient comme insuffisant et digne de leurs mépris ».
Je sais que les nombreux canaux dont la Chine est traversée présentent pour cela des facilités que n’ont point nos îles à sucre ; néanmoins je soupçonne que, dans ces dernières, ce genre d’industrie n’est point ce qu’il devrait être pour fournir cette denrée au meilleur marché possible.
[I-67]
CHAPITRE XII.
Des bornes que la nature des choses met à la division du travail.↩
On ne peut jouir des avantages attachés à la division du travail, que lorsque la consommation des produits s’étend au-delà d’un certain point.
Dix ouvriers peuvent fabriquer 48 mille épingles dans un jour ; mais ce ne peut être que là où il se consomme chaque jour un pareil nombre d’épingles. Car pour que la division s’étende jusque-là, il faut qu’un seul ouvrier ne s’occupe absolument que du soin d’en aiguiser les pointes pendant que chacun des autres ouvriers s’occupe d’une autre partie de la fabrication. Si l’on n’avait besoin que de 24 mille épingles par jour, il faudrait donc qu’il perdît une partie de sa journée ou qu’il changeât d’occupation. Dès lors la division du travail ne serait plus aussi grande.
Par cette raison, elle ne peut être poussée à son dernier terme que lorsque les produits sont susceptibles d’être transportés au loin, pour y trouver des consommateurs ; ou lorsqu’elle s’exerce dans une grande ville qui offre par elle-même une grande consommation ; c’est par la même raison que plusieurs sortes de travaux, qui doivent être consommés en même temps que produits, sont exécutés par une même main dans les lieux où la population est bornée.
Dans une petite ville, dans un village, c’est souvent le même homme qui fait l’office de barbier, de chirurgien, de médecin et d’apothicaire ; tandis que dans une grande ville, non seulement ces occupations sont exercées par des hommes différents, mais l’une d’entre elles, celle de chirurgien, par exemple, se subdivise en plusieurs autres, et c’est là seulement qu’on trouve des dentistes, des oculistes, des accoucheurs ; lesquels n’exerçant qu’une seule partie d’un art étendu, y deviennent beaucoup plus habiles qu’ils ne pourraient jamais l’être sans cette circonstance.
Il en est de même relativement à l’industrie commerçante. Voyez un épicier de village : la consommation bornée de ses denrées l’oblige à être en même temps marchand de merceries, marchand de papier, cabaretier, que sais-je ? écrivain public peut-être ; tandis que dans de grandes villes la vente, non pas des seules épiceries, mais même d’une seule drogue, suffit pour faire un commerce. À Amsterdam, à Londres, à Paris, il y a des boutiques où l’on ne vend autre chose que du thé, ou des huiles, ou des vinaigres ; aussi chacune de ces boutiques est bien mieux assortie dans ces différentes denrées que les boutiques où l’on vend en même temps un grand nombre d’objets différents.
C’est ainsi que dans un pays riche et populeux, le voiturier, le marchand en gros, en demi-gros, en détail, exercent différentes parties de l’industrie commerçante, et qu’ils y portent et plus de perfection et plus d’économie. Plus d’économie, bien qu’ils gagnent tous ; et si les explications qui en ont été données ne suffisaient pas, l’expérience nous fournirait son témoignage irrécusable ; car c’est dans les lieux où toutes les branches de l’industrie commerciale sont divisées entre plus de mains, que le consommateur achète à meilleur marché. À qualités égales on n’obtient pas dans un village une denrée venant de la même distance à un aussi bon prix que dans une grande ville ou dans une foire.
Le peu de consommation des bourgs et villages non seulement oblige les marchands à y cumuler plusieurs occupations, mais elle est même insuffisante pour que la vente de certaines denrées y soit constamment ouverte. Il y en a qu’on n’y trouve que les jours de marchés ; il s’en achète ce jour-là seul tout ce qui s’en consomme dans la semaine ou dans l’année. Les autres jours le marchand va faire ailleurs son commerce ou bien s’occupe d’autre chose. Dans un pays très riche et très populeux, les consommations sont assez fortes pour que le débit d’un genre de marchandise occupe une profession pendant tous les jours de la semaine. Les foires et les marchés appartiennent à un état encore peu avancé de prospérité publique, de même que le commerce par caravanes appartient à un état encore peu avancé de relations commerciales ; mais ce genre de relations vaut encore mieux que rien.
Non seulement nos marchés de campagne indiquent que la consommation de certains objets est languissante, mais il suffit de les parcourir pour voir combien le nombre des produits qu’on y vend est borné et leur qualité grossière. Les grains, les bestiaux, et la plupart des produits ruraux ne présentent en général que la matière première de produits parfaits ; indépendamment de ces produits on n’y voit guère que quelques outils, quelques étoffes, quelques merceries et quincailleries des qualités les plus inférieures. Dans un état de prospérité plus avancé, on y verrait quelques-unes des choses qui contribuent à satisfaire aux besoins d’une vie un peu plus raffinée, des meubles plus commodes et moins dépourvus d’élégance, des étoffes plus fines et plus variées, quelques denrées de bouche un peu plus chères, soit par leur préparation, soit par la distance dont elles seraient amenées, quelques objets d’instruction ou d’amusement délicats, des livres, etc., etc. Dans un état encore plus avancé la consommation de toutes ces choses serait assez courante, assez étendue, pour qu’on y trouvât des boutiques constamment ouvertes et assorties en ces différents genres. On voit en quelques parties de l’Europe des exemples de ce degré de richesse, notamment dans quelques cantons de l’Angleterre et de la Hollande.
De ce qu’il faut nécessairement une consommation considérable pour que la division du travail soit poussée à son dernier terme, il résulte qu’elle ne peut pas s’introduire dans la fabrique des produits qui par leur haut prix ne sont qu’à la portée d’un petit nombre de personnes. Elle se réduit à peu de chose dans la bijouterie, surtout dans la bijouterie recherchée. Et comme nous avons vu qu’elle est une des causes de la découverte et de l’application des procédés ingénieux, il arrive que c’est précisément dans les productions d’un travail exquis que de tels procédés se rencontrent plus rarement. En visitant l’atelier d’un lapidaire on sera ébloui de la richesse des matières, de la patience et de l’habileté de l’ouvrier ; mais c’est dans les ateliers où se préparent en grand les choses d’un usage commun qu’on sera frappé d’une méthode heureusement imaginée pour expédier la fabrication et la rendre plus parfaite. En voyant un bijou, on s’imagine aisément les outils et les procédés par lesquels on est parvenu à le faire ; mais en voyant un lacet de fil, il est peu de personnes qui se doutent qu’il ait été fabriqué par un cheval ou par un courant d’eau ; ce qui est pourtant vrai. [17]
L’industrie agricole est celle des trois qui admet le moins de division dans les travaux. Un grand nombre de cultivateurs ne sauraient se rassembler dans un même lieu pour concourir tous ensemble à la fabrication d’un même produit. La terre qu’ils travaillent est étendue sur tout le globe et les force à se tenir à de grandes distances les uns des autres. De plus, l’agriculture n’admet pas la continuité d’une même opération. Un même homme ne saurait labourer toute l’année, tandis qu’un autre récolterait constamment. Enfin il est rare qu’on puisse s’adonner à une même culture dans toute l’étendue de son terrain et la continuer pendant plusieurs années de suite. La terre ne la supporterait pas, et si la culture était uniforme sur toute une propriété, les façons à donner aux terres et les récoltes tomberaient aux mêmes époques, tandis que dans d’autres instants les ouvriers resteraient oisifs.
La nature des travaux et des produits de la campagne veut encore qu’il convienne au cultivateur de produire lui-même les légumes, les fruits, les bestiaux, et même une partie des instruments et des constructions qui servent à la consommation de sa maison, quoique ces productions soient d’ailleurs l’objet des travaux exclusifs de plusieurs professions.
Mais si l’agriculture est privée jusqu’à un certain point des avantages qui suivent une grande subdivision des travaux, du moins profite-t-elle, relativement à ses consommations, de celle qui s’introduit dans les autres arts.
Dans bien des cas la division du travail est bornée par l’étendue des capitaux. Elle multiplie le nombre des ouvriers qui travaillent pour un même produit, et oblige par conséquent à faire les avances de l’entretien d’un plus grand nombre de personnes. Elle travaille une plus grande quantité de matière à la fois et occupe en conséquence une portion plus considérable de capital sous cette forme. Si 18 ouvriers ne faisaient que 20 épingles chacun, c’est-à-dire 360 épingles à la fois pesant à peine une once, une once de cuivre suffirait continuellement pour les occuper. Mais si, au moyen de la séparation des occupations, les 18 ouvriers font par jour 86 400 épingles, la portion de capital qui passe entre les mains des ouvriers, sera constamment égale à 15 livres de 16 onces.
Enfin la séparation des occupations ne peut avoir lieu qu’au moyen de plusieurs instruments et machines de même sorte qui sont eux-mêmes une partie importante du capital. Aussi voit-on fréquemment dans les pays pauvres le même travailleur commencer et achever toutes les opérations qu’exige un même produit, faute d’un capital suffisant pour bien séparer les occupations.
Mais les produits procurés par la division du travail sont tellement considérables, que si on les compare avec les capitaux qui ont servi à les créer, on trouvera que ces capitaux, quoique forts, sont proportionnellement moindres que ceux qu’il aurait fallu pour obtenir des produits sans séparation d’occupations. La masse des matières qu’on travaille est bien toujours en proportion des produits ; pour faire 86 400 épingles, qui sont 240 fois 360 épingles, il faut 15 livres de cuivre qui sont 240 fois une once ; mais il ne faut pas entretenir 240 fois le nombre de 18 ouvriers.
De ce que dans certains cas la division du travail ne peut s’établir qu’au moyen de capitaux considérables, on a conclu qu’elle ne favorisait que les gros capitalistes, les compagnies commerçantes, et qu’elle tendait à accroître l’inégalité des fortunes ; on a dit qu’elle n’était propre qu’à arrêter l’essor de l’industrie modeste et privée.
L’observation est fondée jusqu’à un certain point, et cependant n’admet point les conséquences qu’on en tire. Il ne faut indispensablement de gros capitaux que quand le produit doit recevoir tous les degrés de sa confection dans la même fabrique ; mais ce cas-là est rare ; il est bien plus commun de voir de très petits fabricants, petits capitalistes, ne donner qu’une seule des façons requises pour terminer un produit. Toutes les façons d’une paire de bottes ne sont pas données avec les capitaux du bottier seulement, mais aussi avec ceux du nourrisseur de bestiaux, du mégissier, du corroyeur, et de tous ceux qui fournissent de près ou de loin quelque matière ou quelque outil propres à la fabrication des bottes ; et quoiqu’il y ait une assez grande subdivision de travail dans la confection de ce produit, la plupart des producteurs y concourent avec de fort petits capitaux.
[I-78]
CHAPITRE XIII.
Des inconvénients attachés à une trop grande subdivision dans les travaux.↩
Après qu’Adam Smith eut fait voir les brillants résultats de la division du travail et sa grande influence sur la richesse des nations, on crut ne pouvoir trop vanter ce moyen de prospérité ; on enchérit sur l’idée de Smith, qui déjà peut-être s’était un peu exagéré cette influence ; et comme tout effort dans un certain sens est toujours suivi d’une réaction dans un sens contraire, le même auteur a été ensuite attaqué plus légèrement encore qu’il n’avait été approuvé. Le mieux est, ce me semble, de prendre la division du travail pour ce qu’elle est, pour une meilleure, une plus habile distribution des forces de l’homme, et de convenir que, comme toutes les bonnes méthodes, elle a des inconvénients, surtout dans son excès.
Un homme qui ne fait pendant toute sa vie qu’une même opération, parvient à coup sûr à l’exécuter mieux et plus promptement qu’un autre homme ; mais en même temps il devient moins capable de toute autre occupation, soit physique, soit morale ; ses autres facultés s’éteignent, et il en résulte une dégénérescence dans l’homme considéré individuellement. C’est un triste témoignage à se rendre que de n’avoir jamais fait que la dix-huitième partie d’une épingle ; et qu’on ne s’imagine pas que ce soit uniquement l’ouvrier qui toute sa vie conduit une lime ou un marteau qui dégénère ainsi de la dignité de sa nature, c’est encore l’homme qui par état exerce les facultés les plus déliées de son esprit. C’est bien par une suite de la division du travail, que près des tribunaux il y a des procureurs dont l’unique occupation est de représenter les plaideurs, et de suivre pour eux tous les détails de la procédure. On ne refuse pas en général à ces hommes de loi l’adresse ni l’esprit de ressources dans les choses qui tiennent à leur métier. Cependant il est tel procureur, même parmi les plus habiles, qui ignore les plus simples procédés des arts dont il fait usage à tout moment ; s’il faut qu’il raccommode le moindre de ses meubles, il ne saura par où s’y prendre, et il lui sera impossible même d’enfoncer un clou, sans faire sourire de pitié le plus médiocre apprenti.
Qu’on le mette dans une situation plus importante ; qu’il s’agisse de sauver la vie d’un ami qui se noie, de préserver sa ville des embûches de l’ennemi, il sera bien autrement embarrassé ; tandis qu’un paysan grossier, l’habitant d’un pays demi-sauvage se tirera avec honneur d’une semblable difficulté.
Dans la classe des ouvriers, cette incapacité pour plus d’un emploi, rend plus dure, plus fastidieuse et moins lucrative la condition des travailleurs. Ils ont moins de facilité pour réclamer une part équitable dans la valeur totale du produit. L’ouvrier qui porte dans ses bras tout un métier, peut aller partout exercer son industrie et trouver des moyens de subsister ; l’autre n’est qu’un accessoire qui, séparé de ses confrères, n’a plus ni capacité, ni indépendance, et qui se trouve forcé d’accepter la loi qu’on juge à propos de lui imposer. C’est en Angleterre que ce mal se fait particulièrement sentir, d’abord parce que les règlements en cette partie y sont vexatoires, mais aussi sans doute parce que la division du travail y est poussée plus loin que partout ailleurs. On lit dans les rapports des sociétés de bienfaisance de ce pays, que dans certains cantons, un journalier qui a de la famille ne peut plus y subsister de son travail. L’entrepreneur, et le gouvernement qui taxe l’entrepreneur, prélèvent en général en Angleterre une portion trop forte dans les produits généraux de la société ; cela les oblige ensuite à de fortes restitutions à la classe ouvrière sous la forme de secours, ce qui est pour beaucoup de raisons une mauvaise distribution des produits annuels. Un pays dont les lois favoriseraient une distribution équitable des produits annuels, et tendraient par conséquent à répandre sur toutes les classes plus d’aisance et de ressources, se préserverait en grande partie des maux qui résultent de la division du travail. L’aisance permet des loisirs, et les loisirs se remplissent toujours d’occupations étrangères au travail habituel Le manouvrier pourrait alors consacrer des instants à son instruction et aux plaisirs de l’entendement [18] ; et par la même raison l’homme de plume se livrerait plus souvent à des occupations étrangères à son état ; il cultiverait son jardin, s’essaierait aux exercices du corps, et chercherait quelques distractions dans l’étude des beaux-arts.
[I-83]
CHAPITRE XIV.
De quelle manière se forment les capitaux.↩
Les denrées dont on se nourrit pendant qu’on exerce une industrie, les matières qu’on travaille, les outils dont on fait usage, sont des résultats de l’industrie de l’homme unie à la puissance de la nature. Les capitaux productifs sont donc eux-mêmes des produits. Mais les premiers capitaux comment ont-ils pu être créés, puisqu’il fallait pour cela d’autres capitaux qui n’existaient point encore ? C’est une difficulté qu’il n’a pas été donné à l’homme de résoudre.
Ce qu’on peut affirmer c’est que si des hommes se trouvaient jetés absolument nus et sans provisions dans une île déserte, quelqu’industrieux qu’on se plaise à les supposer, ils y périraient infailliblement, à moins que les fruits naturels de cette île ne fussent propres à la nourriture de l’homme, qu’ils ne se trouvassent à leur point de maturité et en quantité suffisante pour que les nouveaux venus pussent, au moyen de cette nourriture, attendre les nouveaux secours qu’ils pourraient ensuite tirer de leur industrie ; pourvu enfin que la nature leur offrît d’elle-même quelques outils grossiers, comme des pierres tranchantes, des arêtes de poissons, ou d’autres instruments semblables, avec lesquels ils pussent ensuite en fabriquer de moins imparfaits. Toutes ces choses réunies seraient déjà un commencement de capital.
Les nouveaux habitants de l’île s’occuperaient sans doute ensuite à replanter les graines pareilles à celles qu’ils auraient reconnues pour être les meilleures ; et afin d’augmenter la quantité de leurs provisions et de les varier, ils chercheraient à se rendre maîtres, soit de force, soit par adresse, de plusieurs animaux qui jusqu’alors seraient restés sauvages. Ils consacreraient les uns à leur nourriture ; les autres, plus susceptibles de s’accoutumer à la société de l’homme et couverts d’un poil long et soyeux, ou bien féconds en laitage, seraient gardés, soignés, multipliés.
Que chaque lecteur continue la supposition ; qu’il admette que cette île soit assez grande et assez fertile pour fournir (toujours à l’aide d’un capital précédemment formé et amassé), une autre portion de capital plus considérable, propre à la création de nouveaux produits, et l’on parviendra successivement à l’état dans lequel nous voyons actuellement les peuples les plus policés.
Ce qu’il importe de remarquer, c’est que l’accroissement du capital de cette société naissante ne peut avoir lieu qu’autant que son industrie produit plus de choses que sa consommation n’en détruit.
Si elle consomme la totalité de la récolte qu’elle aura semée, si elle mange la totalité des animaux qu’elle aura pris à la chasse, et ainsi du reste, elle se trouvera toujours dans la même indigence et au point d’où elle est partie.
Je dis qu’il est important de remarquer ce fait, parce que c’est précisément de la même manière qu’une société toute formée, comme celle où nous vivons, augmente ou diminue son capital.
La nature des besoins de chaque nation, sa position géographique et le génie de ses habitants, déterminent communément la forme sous laquelle s’amassent ses capitaux. La plus grande partie des accumulations d’une société naissante consiste en constructions, en outils d’agriculture, en bestiaux, en améliorations de son fonds de terre ; la plupart de celles d’une nation manufacturière consiste en matières brutes, ou qui sont dans un état plus ou moins ouvré entre les mains de ses fabricants. Ses capitaux se composent encore des usines et machines propres à façonner les produits.
Chez une nation commerçante, la plus grande partie des capitaux est en marchandises brutes ou manufacturées que les négociants ont achetées et qu’ils se proposent de revendre.
Une nation qui cultive à la fois l’industrie agricole, l’industrie manufacturière, et l’industrie commerçante, voit son capital composé de produits de toutes ces différentes sortes.
Ce n’est point à dire que chaque nation ait précisément produit et mis en réserve les choses qui composent son capital ; elle a pu mettre en réserve des valeurs quelconques qui, par la voie des échanges, ont pris la forme qui lui convenait le mieux. Un boisseau de blé épargné peut nourrir également un maçon et un brodeur.
De cette manière tous les produits, toutes les valeurs, sous une forme quelconque, qu’un particulier et par suite une nation, mettent en réserve, sont une addition à son capital. Quand un agriculteur a épargné dans le cours d’une année mille francs sur son revenu, que ces mille francs aient été épargnés sur sa consommation personnelle, sur ses semences, fût-ce même en partie sur la nourriture des plus vils animaux de sa bassecour, il n’en a pas moins au bout de l’année mille francs, ou, ce qui revient au même, une valeur de mille francs à placer, soit à intérêts, soit en améliorations sur sa terre ; améliorations qui, à moins de le supposer inepte, lui rapporteront un excédent de revenus, qui sera pour lui l’intérêt de son capital. Rien ne s’oppose même à ce que ce capital ne soit accumulé sans avoir été un seul instant sous la forme de monnaie d’argent. Un des produits qu’il a épargnés peut fort bien être planté ou semé avant d’avoir subi d’échange ; le bois qui aurait inutilement chauffé des appartements superflus peut se montrer en palissades, en charpente, et d’une portion de revenu qu’il était au moment de la coupe, devenir portion de capital en concourant à la reproduction.
Dans l’industrie manufacturière ou commerçante, les objets sont autres, la marche est la même : qu’un manufacturier, un négociant épargnent sur leur revenu annuel, quelle qu’en soit la source, une valeur quelconque, leur capital s’augmente de la même valeur qui est ajoutée soit à leur mobilier, soit aux marchandises qui sont la matière de leur industrie. Dans le premier cas, elle leur produit annuellement une augmentation de jouissances ; dans le second une augmentation de profits.
On voit avec quelle facilité les personnes qui exercent une industrie quelconque peuvent ranger dans leur capital productif leurs épargnes quelque légères qu’elles soient. Les capitalistes ont à peu près la même facilité ; ils peuvent augmenter leur capital placé, de tout le montant de leurs épargnes. Mais les propriétaires de terres affermées, et les personnes qui vivent de leurs rentes ou du salaire de leur main-d’œuvre, n’ont pas la même facilité, et ne peuvent placer utilement un capital qu’autant qu’il se monte à une certaine somme. Beaucoup d’épargnes sont, par cette raison, consommées, qui seraient allées grossir les capitaux particuliers et par conséquent la masse du capital national. Les caisses et les associations qui se chargent de recevoir, de réunir, et de faire valoir les petites épargnes des particuliers, sont en conséquence (toutes les fois qu’elles offrent une sûreté parfaite) très favorables à la multiplication des capitaux.
Il est bon de remarquer que les capitaux amassés sont dissipés non par la consommation, car ils se consomment comme les autres, mais par la consommation improductive, par la consommation qui n’est suivie et remplacée par aucune production. Sans doute un indienneur consomme une certaine valeur en drogues, en couleurs, en provisions de toute espèce pour sa fabrique, mais il ne dissipe pas cette valeur : il la met sous différentes formes, mais sous ces formes diverses elle se converse, et même s’augmente. Le mot de consommation, tout court, sans explication, ne peut donc convenablement s’appliquer qu’aux consommations stériles, aux consommations qui ne procurent pas une valeur égale ou supérieure à celles qu’elles détruisent. Et par une conséquence du même raisonnement, accumuler un capital n’est pas entasser sans consommer, mais retrancher sur les consommations stériles pour ajouter aux consommations productives.
La faculté d’amasser des capitaux ou si l’on veut maintenant des valeurs, est, ce me semble, une des causes de la très grande supériorité de l’homme sur les animaux. Les capitaux, considérés en masse, sont un outil puissant dont l’usage est réservé à lui seul. Il peut diriger vers un emploi quelconque, des forces accumulées, accrues de père en fils depuis des siècles. L’animal ne peut disposer que du petit nombre de choses que l’individu a recueillies, et même seulement de celles qu’il a recueillies depuis quelques jours, depuis une saison tout au plus, ce qui n’est jamais bien considérable ; ainsi en lui supposant même le degré d’intelligence qu’il n’a pas, cette intelligence demeurerait à peu près sans effets, faute d’instruments assez puissants pour la mettre en œuvre.
Remarquez en outre qu’il est impossible d’assigner une borne à la puissance qui résulte pour l’homme de la faculté de former des capitaux, car les capitaux qu’il peut amasser avec le temps, l’épargne et son industrie, n’ont point de bornes.
La formation des capitaux est lente de sa nature, parce que les produits dont seulement on peut faire des capitaux, ne se terminent et ne s’amassent que lentement ; d’autant plus qu’il faut toujours en consommer une partie tandis qu’on produit et qu’on amasse. C’est ce qu’ont senti bien vivement nos compatriotes qui ont occupé momentanément l’Égypte. Leur activité, leur intelligence, leur ingéniosité, si l’on me permet cette expression, ne laissaient rien à désirer ; mais une partie des choses qu’ils avaient apportées avec eux fut perdue ; tout moyen d’en tirer d’autres de la France leur fut ôté ; ils se trouvèrent à peu près réduits aux ressources du pays où ils s’établirent ; mais là se trouvaient peu d’outils, d’ustensiles, de constructions, de provisions en matières premières, en combustibles, en étoffes : de capitaux, en un mot. À chaque instant la production était arrêtée par cette pénurie, et la lenteur des accumulations s’accommodait mal avec les besoins pressants des Français et leur prodigieuse industrie.
On vient de voir comment les épargnes faites sur les revenus se résolvent en capitaux. De même toute consommation faite par qui que ce soit au-delà de ses revenus, est nécessairement une valeur ôtée au capital de cette personne et de la société. L’un et l’autre y perdent les profits annuels de cette portion de capital, et la société y perd, de plus, les profits que les personnes industrieuses auraient faits sur les travaux mis en activité par cette portion de capital. Rien n’est plus commun que d’entendre dire : l’argent qui se dépense n’est pas perdu ; il reste dans le pays. En effet ce n’est pas l’argent qui est perdu ; mais l’argent n’est que la forme passagère sous laquelle se trouve une valeur : quand on dépense, on le transforme en une denrée qu’on consomme ; si la valeur n’a pas été détruite tandis qu’elle était sous forme d’argent, elle l’a été sous sa forme suivante ; et quand cette valeur était une portion de capital, c’est une portion de capital qui a été détruite.
Au surplus c’est une erreur de croire qu’on ne fasse point sortir d’argent d’un pays par la consommation qu’on fait des denrées de ce pays même. Cette portion du capital de la société qui s’appelle argent ou monnaie a des fonctions comme toute autre partie du même capital. Ces fonctions sont de servir à la circulation des différents produits qui composent le capital et les revenus de la nation. Une portion de numéraire surabondante serait aussi inutile que des meules dont le nombre excéderait celui que peuvent employer tous les moulins d’un pays ; en conséquence les propriétaires de cette portion du capital ne pouvant l’employer utilement dans l’intérieur, l’enverraient au-dehors, pour y prendre une forme dont ils pussent tirer un meilleur parti. En d’autres termes, la disette des denrées, fruit d’une consommation démesurée, obligerait d’en faire rentrer à prix d’argent. On n’empêche pas plus l’argent de sortir quand on manque de denrées, qu’on ne l’empêche d’entrer lorsqu’on a plus de denrées qu’on n’en peut consommer.
L’accumulation des capitaux ne consiste donc pas dans l’accumulation des monnaies d’or et d’argent seulement, mais dans l’accumulation des produits quels qu’ils soient. Les métaux précieux sont même un des produits qu’il convient le moins de mettre en réserve et dont l’accumulation reste en arrière chez une nation qui prospère. Dans le temps où l’Europe était misérable, la moitié peut-être de son capital était en or et en argent ; tandis qu’à présent, l’or et l’argent qui se trouvent dans un pays très riche comme l’Angleterre, ne forment pas la centième partie de la valeur de son capital tout entier. [19] Quand l’agriculture, les manufactures, le commerce sont presque nuls, il y a très peu de valeurs placées en défrichements, en constructions, en machines et en marchandises.
Comme l’industrie d’une nation s’étend toujours en proportion de ses capitaux productifs, que plus il y a de capitaux productifs et plus il y a de gens qui peuvent gagner leur vie, c’est-à-dire contribuer à produire et consommer leur part des produits auxquels ils ont concouru, toute épargne, tout accroissement de capital prépare un gain annuel, non seulement à celui qui en retire les intérêts, mais à tous les gens dont l’industrie est mise en mouvement par cette portion de capital.
Aussi le célèbre Adam Smith compare-t-il un homme frugal qui augmente ses fonds productifs, ne fût-ce que dans une seule occasion, au fondateur d’une maison d’industrie où une société d’hom 281.mes laborieux seraient nourris à perpétuité des fruits de leur travail ; et un prodigue, au contraire, qui mange une partie de son capital, à l’administrateur infidèle qui dilapiderait les biens d’une fondation pieuse, et laisserait sans ressources, non seulement ceux qui y trouvaient leur subsistance, mais tous ceux qui l’y auraient trouvée par la suite. Il n’hésite pas à nommer le dissipateur un fléau public, et tout homme frugal et rangé un bienfaiteur de la société [20] .
Il est heureux que l’intérêt personnel veille sans cesse à la conservation des capitaux des particuliers ; il ne peut en aucun temps distraire un capital d’un emploi productif sans se priver d’un revenu proportionné. La conservation des capitaux appartenant au public n’est garantie que par les lois ; aussi sont-ils en général beaucoup plus fréquemment dissipés ; on les entretient à la vérité sans cesse par de nouvelles levées sur les revenus des particuliers ; mais il n’en résulte pas moins que les capitaux formés de cette manière sont toujours plus dissipés que ceux que les particuliers auraient formés pour leur compte avec le montant de ces levées. Il convient donc que dans chaque nation le capital appartenant au public en commun soit le moindre qu’il est possible ; il s’en perd moins et son entretien est moins onéreux.
Smith pense qu’en tout pays, la profusion ou l’impéritie de certains particuliers et des administrateurs de la fortune publique, est plus que compensée par la frugalité de la majorité des citoyens et leur sensibilité dans ce qui touche à leurs intérêts [21] . Il paraît certain du moins que de notre temps, presque toutes les nations européennes croissent en opulence ; ce qui ne peut avoir lieu sans que chacune, prise en masse, ne consomme moins qu’elle ne produit. Les révolutions modernes même, n’ayant pas été suivies d’invasions générales, de ravages prolongés, comme les anciennes, et d’un autre côté ayant détruit certains préjugés, aiguisé les esprits et renversé d’incommodes barrières, semblent avoir été favorables plutôt que contraires aux progrès de l’opulence. Mais cette frugalité dont Smith fait honneur aux particuliers, n’est-elle pas forcée chez la classe la plus nombreuse ? Est-il bien sûr que sa part des produits soit exactement proportionnée à la part qu’elle prend à la production ? Dans les pays qu’on regarde comme les plus riches, combien d’individus vivent dans une disette perpétuelle ! Combien de ménages, dans les villes comme dans les campagnes, dont la vie entière se compose de privations, et qui entourés de tout ce qui est capable d’exciter les désirs, sont réduits à ne pouvoir satisfaire que leurs besoins les plus grossiers, comme s’ils vivaient dans un temps de barbarie, au milieu des nations les plus indigentes !
J’en conclus que quoiqu’il y ait incontestablement, dans presque tous les États de l’Europe, des produits épargnés chaque année, cette épargne ne porte pas en général sur les consommations inutiles, ainsi que le voudraient la politique et l’humanité, mais sur des besoins véritables ; ce qui accuse le système économique de beaucoup de gouvernements. Smith pense encore que les richesses des modernes sont dues plutôt à l’étendue des économies qu’à l’accroissement de la production. Je sais bien que certaines profusions folles ne se voient plus comme autrefois ; mais qu’on fasse attention au petit nombre de personnes à qui de semblables profusions étaient permises ; qu’on prenne la peine de considérer combien les jouissances d’une consommation plus abondante et plus variée se sont répandues, surtout parmi la classe mitoyenne de la société ; on trouvera, ce me semble, que les consommations et les économies se sont accrues en même temps ; ce qui n’est pas contradictoire : combien d’entrepreneurs en tous les genres d’industrie produisent assez dans les temps prospères pour augmenter à la fois leurs dépenses et leurs épargnes ! Ce qui est vrai d’une entreprise particulière peut l’être de la majeure partie des entreprises d’une nation. Les richesses de la France s’accrurent pendant les quarante premières années du règne de Louis XIV, malgré les profusions du gouvernement et des particuliers excitées par le faste de la cour. On ne peut pas dire que ce fussent les épargnes du règne précédent qu’on dépensait : les troubles de la minorité, l’avidité de Mazarin [22] et de sa famille, n’avaient rien laissé. Ce n’étaient pas non plus les épargnes des particuliers qu’on levait par les contributions : il y avait de gros propriétaires terriens, mais peu de riches capitalistes, car jusqu’à cette époque l’industrie avait été presque toute en Hollande, à Venise, à Gênes, et dans quelques villes d’Allemagne et de Flandres. Mais le mouvement imprimé à la production par Colbert multipliait les ressources plus vite encore que la cour ne les dissipait. Quelques personnes s’imaginent qu’elles se multipliaient par la raison que la cour les dissipait ; c’est une erreur grossière, et la preuve en est qu’après la mort de Colbert, les profusions de la cour allant du même pas, et la production ne pouvant plus les suivre, le royaume tomba dans un épuisement affreux. Rien ne fut plus triste que la fin de ce règne.
Depuis la mort de Louis XIV les dépenses publiques et particulières ont encore augmenté [23] , et il me paraît incontestable que les richesses de la France ont augmenté de même : Smith lui-même en convient ; et ce qui est vrai de la France, l’est, à différents degrés, de la plupart des autres États de l’Europe.
Turgot partage l’opinion de Smith [24] . Il croit qu’on épargne plus qu’on ne faisait autrefois, et fonde cette opinion sur le raisonnement suivant : le taux de l’intérêt, en temps ordinaire, est, dans la plupart des pays de l’Europe, plus bas qu’il n’ait jamais été ; cela indique qu’il y a plus de capitaux qu’il n’y en a jamais eu ; donc on a plus épargné pour les amasser, qu’on ne l’a fait à aucune autre époque.
Cela prouve ce dont on convient : c’est-à-dire qu’il y a plus de capitaux qu’autrefois ; mais cela ne prouve rien sur la manière dont ils ont été acquis, et je viens de montrer qu’ils peuvent l’avoir été par une production supérieure, aussi bien que par une économie plus grande.
Je ne nie pas au surplus qu’on n’ait, à beaucoup d’égards, perfectionné l’art d’épargner comme l’art de produire. On n’aime pas à se procurer moins de jouissances qu’autrefois ; mais on sait se les procurer à moins de frais. Quoi de plus joli, par exemple, que les papiers-tentures qui ornent les murs de nos appartements ? La grâce des dessins y reçoit un nouveau lustre de la fraîcheur des nuances. Autrefois on n’avait parmi les mêmes classes de la société qui font maintenant usage de papiers peints, que des tapisseries en point d’Hongrie, ou bien d’autres également laides et d’un prix supérieur à la plupart de nos tentures actuelles.
L’art d’épargner est dû aux progrès de l’industrie qui, d’une part a découvert un grand nombre de méthodes économiques, et qui, de l’autre, a partout réclamé des capitaux et offert aux capitalistes, petits et grands, de meilleures conditions et des chances plus sûres. Dans les temps où il n’y avait encore que peu d’industrie, un capital ne portant aucun profit, n’était presque jamais qu’un trésor enfermé dans un coffre-fort ou caché dans la terre, et qui se conservait pour le moment du besoin ; que ce trésor fût considérable ou non, il ne donnait pas un profit plus ou moins grand, puisqu’il n’en donnait aucun ; ce n’était autre chose qu’une précaution plus ou moins grande. Mais quand le trésor a pu donner un profit proportionné à sa masse, alors on a été doublement intéressé à le grossir ; et ce n’était pas en vertu d’un intérêt éloigné, d’un intérêt de précaution, mais d’un intérêt actuel, sensible à tous les instants, puisque le profit donné par le capital pouvait, sans y rien ôter, être consommé et procurer de nouvelles jouissances. Dès lors on a plus étroitement songé qu’on ne le faisait auparavant à se créer un capital productif quand on n’en avait point, à l’augmenter quand on en avait un ; et l’on a considéré des fonds portant intérêt, comme une propriété aussi lucrative et quelquefois aussi solide qu’une terre rapportant un fermage.
L’encouragement le plus réel qu’un gouvernement puisse donner à l’augmentation des capitaux, c’est de les respecter inviolablement et de ne gêner, en aucunes façons, les particuliers dans l’emploi qu’ils veulent en faire. Si ceux-ci peuvent être certains qu’une épargne, sous quelque forme qu’elle soit faite, en blé comme en argent, ne les exposera à aucun désagrément, à aucune surcharge arbitraire ; s’ils peuvent être assurés d’en pouvoir disposer au moment et de la manière qui leur conviendra, le désir d’améliorer leur sort sera un motif suffisant pour les engager à ménager, à se préparer une augmentation de revenus pour le présent et des ressources pour l’avenir.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que dans quelques mains que s’accumulent les capitaux, les avantages qu’en retirent l’industrie et la nation sont les mêmes, pourvu qu’ils s’accumulent dans des mains qui les fassent valoir et les mettent ainsi dans la classe des capitaux productifs. Le placement à intérêt suffit pour garantir qu’ils sont dans cette classe, car nul ne pourrait longtemps payer l’intérêt d’un capital, s’il ne l’avait mis sous une forme productive, pour le faire travailler.
On pourrait élever contre l’accumulation des capitaux une singulière objection. Quels sont, dirait-on, parmi les capitaux des particuliers, ceux qui s’accroissent avec le plus de facilité ? Les gros capitaux, sans doute ; car on peut d’autant mieux faire des réserves sur les profits qu’ils rapportent, que ces profits sont plus considérables. L’argent appelle l’argent. Encourager l’épargne des gros revenus, c’est confirmer, augmenter l’inégalité des fortunes, et l’immoralité, les maux qui en sont la suite,
Mais qu’on prenne la peine d’observer que si l’accumulation tend sans cesse à accroître les grandes fortunes, la marche de la nature tend sans cesse à les diviser. Un homme qui a augmenté son capital et celui de son pays, finit par mourir, et il est rare qu’une succession ne devienne pas le partage de plusieurs héritiers ou légataires, si ce n’est dans les pays où les lois reconnaissent des substitutions et des droits de primogéniture. Hors les pays où de pareilles lois exercent leur funeste influence et partout où la marche bienfaisante de la nature n’est pas contrariée, elle répand sa sève nourricière dans toutes les ramifications de l’arbre social, et porte la vie et la santé jusqu’à ses extrémités les plus éloignées. C’est ainsi qu’un gros capital se distribue naturellement entre plusieurs personnes ; si ces personnes, à leur tour, accroissent leur portion, et que leur portion accrue se partage entre plusieurs autres, on sent que par cela seul l’aisance devient plus générale, et que le capital total du pays s’augmente en même temps que les fortunes particulières se divisent.
On doit donc (excepté pourtant dans les pays de substitutions et de primogéniture), non seulement voir sans jalousie, mais regarder comme une source de prospérité générale, l’enrichissement d’un homme, toutes les fois que son bien, acquis légitimement, s’emploie d’une façon productive. Je dis acquis légitimement, car une fortune, fruit de la rapine, n’est pas un accroissement de fortune pour l’État ; c’est un bien qui était dans une main et qui passe dans une autre, sans qu’il mette en jeu plus d’industrie qu’auparavant. Il est même, au contraire, assez commun qu’un capital mal acquis soit mal dépensé.
[I-107]
CHAPITRE XV.
De quelle manière s’entretiennent les capitaux productifs.↩
Nous avons vu de quoi se composent les capitaux, et comment ils concourent à la production. Il est bien nécessaire de ne pas perdre de vue que les capitaux sont, non pas seulement des sommes d’argent, mais des valeurs réservées, accumulées, et qui peuvent exister sous différentes formes. Tout produit destiné à la reproduction est une portion de capital égal à sa valeur. Le capital consiste dans la valeur, et non dans la forme matérielle où elle se trouve fixée. Des outils, des machines, des matières premières, pour une valeur de mille francs, sont un capital égal à un sac de mille francs en écus. L’un et l’autre, dans le cours d’une production, se trouvent transformés, tourmentés de mille manières, et la production achevée, il en sort une valeur qui, à moins qu’on ne soit en perte, est égale à la valeur originairement appliquée à cette production, et de plus fournit de quoi payer les profits du capital employé, et les profits de l’industrie qui l’a mis en œuvre.
Toute production qui ne couvrirait pas tous ces frais, cesserait d’être avantageuse, et personne ne voudrait l’entreprendre.
La valeur des produits rétablit donc la valeur du capital dans son intégrité ; mais chaque produit ne paie que la valeur capitale consommée pendant sa production. Elle paie la totalité de la valeur des produits qui ont été totalement consommés, et une portion seulement de la valeur des produits qui ont été partiellement consommés ; la totalité de la valeur des matières premières, par exemple, qui ont été totalement employées à la confection d’un produit, et une portion seulement de la valeur des instruments qui n’ont été usés qu’en partie par cette même confection. Ainsi un distillateur retrouve sur la vente de ses produits annuels, la valeur non seulement de toutes les matières que son art a employées, mais aussi celle de tous les vases qui se sont cassés pendant l’année, dans le cours de ses opérations, et qu’il a dû remplacer pour que son capital conservât toujours la même valeur.
Ainsi encore, en supposant qu’un métier à faire des bas soit complètement usé au bout de vingt ans de service, et que durant cet espace de temps il ait servi à fabriquer douze mille paires de bas, il faut que chaque paire de bas paie 1/12 000e de la valeur du métier, indépendamment de tous les autres frais, même de l’intérêt du prix du métier pendant qu’il a été employé à cette paire de bas.
Quant aux capitaux qui se trouvent sous la forme d’améliorations faites sur un bienfonds, comme des bâtiments, des clôtures, des défrichements, etc., s’ils ne sont nullement susceptibles de s’user, comme des défrichements, les produits (à moins de circonstances particulières et étrangères au capital en lui-même) les produits, dis-je, n’en paient que l’intérêt, et ne rétablissent point le principal, dont le remboursement ne s’opère qu’à la vente du bienfonds.
S’ils se trouvent de nature à s’user comme une construction quelconque, les produits (à moins que le propriétaire du capital ainsi engagé ne soit en perte) doivent rembourser une partie de ce capital, de manière qu’il se trouve entièrement remboursé à l’époque où la construction a achevé son service. Si la vente du fonds s’opère avant la consommation totale de la construction, la vente ne paie qu’une portion de sa valeur, équivalente au service qu’on en peut encore attendre.
En général les capitaux engagés dans les fonds de terre sont les plus solidement acquis à une nation. Un négociant peut facilement transporter son capital dans l’étranger : il lui suffit d’acheter et d’emporter des marchandises dont l’extraction est permise. Mais un défrichement, un dessèchement, sont un avantage, une valeur qui reste. On ne voit plus de traces de la brillante existence de plusieurs villes hanséatiques, riches de leur grand commerce, tandis que la Lombardie, tandis que la Flandre, malgré les guerres prolongées dont elles ont été si souvent le théâtre, sont encore au nombre des contrées les mieux cultivées et les plus populeuses de l’Europe.
Telles sont les lois générales suivant lesquelles les capitaux perpétuellement occupés, tourmentés, usés pendant la production, s’en tirent, lorsqu’elle est terminée, avec leur valeur entière, et sont susceptibles de reparaître soit sous la forme d’une somme d’argent lorsqu’ils ont originairement été prêtés sous cette forme, soit sous toute autre forme favorable à la production, mais toujours dans leur intégrité. Il n’est point nécessaire qu’un capital soit réalisé et transformé en numéraire, pour reparaître dans son intégrité ; la plupart des négociants et des manufacturiers réalisent tout au plus au moment où ils quittent les affaires ; et ils n’en savent pas moins chaque fois qu’ils veulent le savoir, au moyen d’un inventaire de toutes les valeurs qu’ils possèdent, si leur capital est diminué ou s’il est augmenté.
Je crois devoir faire remarquer ici que la valeur des produits qui non seulement fournit à l’entretien des capitaux, mais qui en paie les intérêts, ne paie les intérêts que pour le temps où la confection des mêmes produits a occupé les capitaux. Dans les manufactures où trois mois suffisent pour changer une matière brute en un produit complet, ce produit, en remboursant le capital entier employé à sa confection, ne paie que trois mois d’intérêt de ce même capital. Si ce produit payait une année entière d’intérêt, 5 pour cent par exemple, le même capital pouvant servir dans le cours de l’année quatre fois successivement aux mêmes opérations, rapporterait 20 pour cent [25] . Un tel emploi serait bientôt préféré aux autres ; et l’affluence des capitaux pour cet emploi en ramènerait infailliblement les intérêts au taux ordinaire.
Souvent un capital ne donne un produit qu’au bout d’une année entière, comme dans presque toutes les parties de l’industrie agricole, où l’ordre des saisons ne permet ordinairement qu’une récolte par an. Quelquefois même il faut plusieurs années pour que le capital puisse être remboursé, comme dans le commerce de l’Inde où un capital ne peut rentrer qu’après deux ou trois années.
L’art du tanneur offre dans l’industrie manufacturière un exemple à peu près pareil, vu le long séjour que les cuirs doivent faire dans les fosses. Chaque cuir coûte en conséquence, outre les autres frais, l’intérêt de sa valeur première pendant un ou deux ans. Ceci montre que si le procédé nouvellement découvert pour tanner en peu de jours réussissait complètement, le prix des cuirs pourrait baisser de tout l’intérêt de leur valeur pendant un très long terme, sans que le manufacturier ni personne y perdît. Au contraire, la société générale y gagnerait une augmentation dans la quantité de ses produits, car une partie des capitaux auparavant occupés de cette manière pourrait être dirigée vers d’autres branches de productions.
[I-114]
CHAPITRE XVI.
Que l’industrie agricole exige de moins grands capitaux que les autres industries.↩
Pour donner un produit égal, il faut un moins grand capital dans l’industrie agricole que dans les deux autres.
Le nombre des ouvriers qu’elle emploie est peu considérable, relativement à ses produits. Un produit agricole croît, sans exiger les soins continuels d’un ouvrier, qui peut dès lors en donner à plusieurs produits à la fois. Le même homme qui a sarclé la vigne, bat le grain pendant que le raisin pousse. Dans les villes, le salaire des ouvriers doit nécessairement être assez élevé pour que la plupart d’entre eux soient en état de nourrir une femme et des enfants ; c’est une charge. À la campagne, il y a des occupations pour la femme, pour les enfants, pour les vieillards ; ce sont des secours : ils suppléent, jusqu’à un certain point, au travail des ouvriers. Enfin, une partie des produits agricoles font eux-mêmes l’office d’ouvriers : tels sont les animaux. Le bœuf, qui nous prépare des richesses par sa chair, sa peau, ses cornes, aide en même temps l’homme à creuser ses sillons. La brebis engraisse nos champs de son fumier, tandis qu’elle se couvre d’une laine précieuse.
Les avances qu’exige l’entretien des ouvriers sont donc moins considérables.
L’agriculture exige un moins grand nombre d’instruments, et des instruments, en général, moins coûteux que les autres industries. La plupart des outils champêtres sont fort simples et peu dispendieux. Une petite portion de capital seulement est employée de cette manière.
L’avantage qu’a l’industrie agricole de procurer toutes les matières premières, par conséquent tous les produits de première nécessité, et de pouvoir être exercée avec des capitaux moindres que les autres industries, explique pourquoi elle est la première cultivée, et comment elle peut exister chez des nations où les autres industries sont encore dans un état de grossièreté.
Les capitaux de l’industrie agricole (comme, au reste, ceux qu’emploient les autres industries) n’appartiennent pas toujours à un même maître. La portion du capital qui est sous la forme de constructions, d’amendements majeurs du terrain, appartient au propriétaire foncier, et le fermage se compose alors du revenu foncier, plus de l’intérêt des capitaux répandus sur le fonds.
La partie du capital qui est en outils et en animaux, ou qui passe successivement sous différentes formes, comme les semences, les salaires d’ouvriers qui se transforment en grains, en fruits et ensuite en argent, pour subir de nouvelles métamorphoses, cette portion, dis-je, appartient communément au fermier ; et il faut, pour qu’il ne perde pas, que ses profits lui en paient les intérêts, en même temps qu’ils paient les salaires de son industrie.
[I-117]
CHAPITRE XVII.
Quelle est la plus productive de la grande ou de la petite culture.↩
On nomme pays de grande culture, ceux où les entreprises d’agriculture se font en grand, où de gros fermiers, de gros propriétaires cultivent chacun un grand nombre d’arpents.
Les pays de petite culture, au contraire, sont ceux où de petits propriétaires et de petits fermiers cultivent des terrains peu étendus.
L’un et l’autre genre de culture a ses avantages.
Dans la grande culture, le propriétaire ou le fermier, étant à la tête d’une entreprise considérable, fait de plus gros profits et peut plus aisément mettre de côté, grossir son capital et l’employer en bonifications. Les dépenses et la consommation sont relativement moindres. On y fait plus communément usage des machines expéditives qui abrègent le travail, comme de la charrue, des voitures, etc. De vastes et solides bâtiments d’exploitation coûtent moins d’entretien et de réparation qu’une foule de petits [26] . L’excédent des produits sur les consommations est donc plus considérable dans les grandes cultures que dans les petites.
D’un autre côté celles-ci admettent mieux de certaines améliorations. Un petit agriculteur met le terrain plus à profit. Chez lui l’on voit un rang de fèves à côté d’un rang de vigne ; il soutient avec précaution la branche trop chargée d’un arbre fruitier et présente avec soin toutes les ramifications d’un espalier aux rayons du midi.
Une grosse ferme entretient des animaux de bassecour ; une multitude de petits cultivateurs en élèvent peut-être davantage sur une égale étendue de terrain. Il en est peu qui ne soit entouré de différentes volailles, de l’utile cochon, du lapin prolifique, et même d’une vache quand il peut la nourrir de l’herbe de son verger et de la taille de ses arbustes. Il n’y a pas un brin de mauvaise herbe qu’il n’arrache, et pas un de ceux qui sont arrachés qui ne serve à la nourriture de quelqu’animal.
Enfin la petite culture est plus sous les yeux du cultivateur, mieux surveillée par lui, soumise à ses soins plus immédiats. Elle ne laisse jamais un coin de terre oisif, et multiplie les pouvoirs productifs du sol en variant les manières de le solliciter.
Elle a un autre avantage qui bien qu’indifférent, du moins immédiatement, pour la production, n’en mérite pas moins d’être compté pour quelque chose ; c’est qu’un pays de petite culture est plus joli, plus riant qu’un autre. Qui ne préférerait parcourir, habiter ces cantons charmants du pays de Caux, où chaque héritage bien planté est entouré de haies vives, et où chaque habitation se perd dans un bouquet de verdure, à ces plaines nues de la Beauce ou de l’ancienne Picardie, chargées de froment à la vérité, mais dégarnies, du moins pour l’œil, de fruits, d’ombrages et d’habitants ?
À ces avantages se joignent ceux qui naissent en général d’une plus égale subdivision des propriétés, car la petite culture est ordinairement compagne des petits patrimoines.
Un gros propriétaire possédant déjà tout autant qu’il faut pour satisfaire à tous ses besoins et même à ses fantaisies, n’a pas cet active sollicitude avec laquelle un petit propriétaire cherche à multiplier ses ressources. Il emploie des agents encore moins zélés que lui. Or si le maître et ses agents travaillent aussi peu d’esprit et de corps à la bonification de la culture, peut-on croire que les produits de cette culture seront portés aussi loin que ceux d’une culture conduite par un propriétaire d’une fortune médiocre, travaillant pour lui-même et pour ses enfants, et exerçant toutes les facultés de ses bras et de son esprit pour augmenter son revenu ?
Les Économistes, qui se sont beaucoup occupés du produit net des terres, ont trouvé que les pays de grandes cultures en donnaient un plus grand. Ce n’est pas qu’ils soient plus productifs ; c’est parce qu’une moins grande quantité de leurs produits est consommée sur les lieux.
Prenons pour exemple deux étendues égales de terres de qualités pareilles.
L’une, cultivée en grand, donnera 10 000 fr. de produit brut, et 12 hommes suffiront pour la cultiver ;
L’autre, partagée en petites cultures, donnera 11 000 fr. de produits bruts ; mais sa culture occupera 16, 17, et peut-être 18 hommes.
Supposons 18 hommes. On voit que cette étendue de terrain a dû nourrir 6 hommes plus que la première, c’est-à-dire une moitié en sus, et que le surplus de son produit n’a été que d’un dixième.
Si les 12 cultivateurs ont consommé dans leur année 4 000 fr. sur les produits qu’ils ont fait croître, les 18 hommes en auront consommé une moitié plus, c’est-à-dire 6 000 fr. Il restera dès lors à vendre, et pour servir à la consommation des gens étrangers au terrain :
Dans le premier cas, pour 6 000 fr. de denrées ;
Dans le second cas, pour 5 000 fr. seulement.
Donc il sortira moins de denrées d’un canton cultivé en petite culture que d’un canton cultivé en grand, quoiqu’il ait produit réellement davantage.
Continuons à nous servir du même exemple, et voyons quelle est celle des deux cultures qui est plus favorable à la population générale
Si 4 000 fr. consommés sur la terre cultivée en grand, ont nourri 12 hommes, nous pouvons supposer que les 6 000 fr. de denrées qu’elle a à vendre en nourriront 18. Cette terre nourrira donc
| Sur la terre même, | 12 hommes, |
| Hors la terre, | 18. |
| Total | 30. |
D’un autre côté, en suivant les mêmes proportions, la terre cultivée en petite culture consommant pour 6 000 fr. de denrées pour nourrir les hommes qui la cultivent, et envoyant pour 5 000 fr. de denrées au-dehors, nourrira
| Sur la terre même, | 18 hommes, |
| Hors la terre, | 15. |
| Total | 33. |
La terre cultivée en petite culture nourrira donc une population de 33 hommes, tandis que la même terre en grande culture n’en nourrira que 30. L’une en nourrit un dixième plus que l’autre ; pourquoi ? c’est qu’elle produit un dixième plus que l’autre ; c’est-à-dire pour 11 mille fr. au lieu de 10 mille.
Le résultat de tout ceci, est qu’un pays cultivé en petite culture sera plus peuplé, mais que le nombre des cultivateurs y sera proportionnellement plus grand ; il y aura plus d’habitants de la campagne et de moins grandes villes.
Au surplus, il est avantageux qu’il y ait de grandes cultures et de petites. Les unes sont favorables à de certains produits, les autres à d’autres. L’exploitation du chanvre s’accommode fort bien, par exemple, des petits cultivateurs qui ont, dans la morte saison, beaucoup de bras à occuper, et elle ne convient pas aux grands cultivateurs qui, pour faire travailler, dépenseraient en salaires plus que la denrée ne pourrait leur rapporter.
[I-124]
CHAPITRE XVIII.
Qu’une nation qui n’a point d’industrie agricole n’est pas plus qu’une autre une nation salariée.↩
Les Économistes ont prétendu que les personnes qui exercent l’industrie manufacturière ou l’industrie commerçante ne produisent point, et qu’elles ne peuvent passer que pour être salariées par les seules personnes qui produisent, c’est-à-dire par les agriculteurs.
Ils en disent autant des nations commerçantes et manufacturières, et des nations agricoles. Ils nomment les premières des nations salariées.
« Je pardonne aux hommes, dit Mercier de la Rivière [27] , d’avoir pris pour des réalités les faux produits de l’industrie ; mais je ne leur pardonne pas leurs contradictions. Ils auraient dû, d’après leur illusion, défendre chez eux l’usage de tout ouvrage qui n’exigeait pas la main-d’œuvre la plus chère. Au moyen de cette police, ils se seraient ménagé le brillant avantage de ne consommer que des choses d’un grand prix. Oh ! qu’ils auraient été riches, s’ils avaient été conséquents ! »
De ce que la main-d’œuvre a une valeur quand elle donne un produit utile, il ne s’ensuit pas qu’elle ait une valeur quand elle a un résultat inutile, ou quand elle s’occupe à détruire un produit déjà créé. Le travail n’est pas productif parce qu’il est travail : il est productif quand il produit. On pourrait répondre à Mercier de la Rivière :
« Vous dites que l’industrie agricole est productive ; en conséquence, les cultivateurs n’ont qu’à labourer leur terre vingt fois par an, et la semer autant de fois : ils seraient bien riches, si vous étiez conséquent ! »
Dupont, dans sa Physiocratie (page 238), pour soutenir le même système (que les produits de l’agriculture seuls enrichissent, et que le travail des manufactures appauvrit), cite pour exemple Colbert, qui, selon lui, ruina la France en protégeant les manufactures aux dépens de l’agriculture. Il est de fait, au contraire, que, sous l’administration de Colbert, la France sortit de la misère où l’avaient plongée deux régences et un mauvais règne. Elle fut, à la vérité, ensuite ruinée de nouveau ; mais c’est au faste et aux guerres de Louis XIV qu’il faut imputer ce malheur ; et les dépenses mêmes de ce prince prouvent l’étendue des ressources que Colbert lui avait procurées. Elles au 344.raient, à la vérité, été plus grandes encore, s’il eût protégé l’agriculture autant que les autres industries.
Les Économistes poursuivent et disent : L’artisan qui a fait un ouvrage n’a rien apporté de nouveau dans la masse des richesses sociales. — Il y a apporté une valeur, valeur très réelle, puisqu’en échange de cette valeur, on peut obtenir partout, dans l’intérieur et au-dehors, des denrées très substantielles. — Mais il a consommé pour une valeur égale à celle qu’il a produite, partant il n’y a point d’excédent, point de produit net. — Il a produit d’excédent, au moins l’intérêt du capital dont il s’est servi ; car il est de fait que tout capital rapporte à son maître 5, 6, 7 pour cent par an, plus ou moins, sans que le capitaliste se donne aucune peine. Le capitaliste vit sur les produits de son capital, comme le propriétaire foncier sur le revenu de sa terre, comme l’homme industrieux sur les profits de son industrie. Mais quand chacun d’eux consommerait la totalité de ce qu’ils gagnent ainsi, il n’y aurait pas moins eu des produits, quoiqu’il ne restât point d’excédent ou de produit net à la fin de l’année.
Une nation qui exerce l’industrie manufacturière ou commerçante, n’est donc ni plus ni moins salariée qu’une autre qui exerce l’industrie agricole. Chacune de ces industries donne des produits divers, à la vérité, quant à leurs usages, mais aussi réels les uns que les autres quant à leur valeur. Deux valeurs égales se valent l’une l’autre, quoiqu’elles proviennent de deux industries différentes. Et quand la Pologne change sa principale production qui est du blé, contre la principale production de la Hollande, qui se compose de marchandises des deux Indes, ce n’est pas plus la Pologne qui salarie la Hollande, que ce n’est la Hollande qui salarie la Pologne.
Cette Pologne qui exporte pour dix millions de blé par an, fait précisément ce qui, selon les Économistes, enrichit le plus une nation ; et cependant elle reste pauvre et dépeuplée. C’est parce que ces dix millions de blé lui sont enlevés par d’autres États qui produisent les denrées manufacturées dont elle a besoin, et qu’elle devrait plutôt tâcher de produire elle-même. Elle est salariée pour fabriquer, si je peux m’exprimer ainsi, chaque année pour dix millions de blé. Elle n’est pas moins dépendante que les nations qui lui achètent son blé ; car elle a autant besoin de le vendre que ces nations ont besoin de l’acheter.
La nation la plus dépendante est celle (agricole, manufacturière ou commerçante) qui manque de capitaux pour exercer son industrie ; car, sans capitaux, point d’industrie en aucun genre. On peut posséder un territoire fertile, on peut acquérir assez promptement des talents industriels à un certain degré, mais les capitaux s’accumulent lentement, par de longues épargnes et une constante activité.
On n’a jamais vu de nations, ni de particuliers, acquérir en peu d’années de vastes capitaux, si ce n’est lorsqu’ils se sont emparés des capitaux des autres, comme firent les Romains, et comme font les particuliers qui s’enrichissent par des moyens illicites.
Mais quant aux hommes et aux nations qui ne veulent posséder que ce qu’ils ont gagné légitimement, ce qu’ils ont véritablement produit, ce sont les capitaux qu’ils peuvent le moins suppléer quand ils en manquent. C’est la privation de capitaux qui les retient le plus rigoureusement dans l’indigence. Sans capitaux à quoi leur sert leur industrie ? Ils vont l’offrant partout. À quoi leur servent même leurs terres ? Elles manquent de constructions, d’amendements, de bestiaux, d’instruments aratoires. Si les terres seules suffisaient pour la production, les ÉtatsUnis n’en vendraient point à vil prix, et l’on ne trouverait pas sur le globe tant de vastes terrains fertiles et dépeuplés.
La nation la plus dépendante est donc celle qui manque de capitaux, car elle ne peut se procurer de quoi vivre. Il est vrai qu’une nation qui n’aurait que des capitaux (s’il pouvait y en avoir de telles), ne parviendrait à produire, et à jouir de sa part des produits, que par l’intermédiaire des fonds de terre et de l’industrie des autres nations ; mais si les autres nations venaient à lui manquer, elle aurait toujours la ressource de manger ses capitaux, lorsque les autres n’auraient de ressources d’aucune espèce.
[I-131]
CHAPITRE XIX.
D’un certain génie favorable à l’industrie.↩
Les nations se distinguent, comme les particuliers, par un génie qui leur est propre. Les unes sont portées à la guerre ; les autres à la culture des beaux-arts, des sciences, des lettres ; d’autres enfin réussissent mieux dans les opérations qu’exigent les différentes branches de l’industrie.
Les Anglais, si attachés à certains préjugés nationaux, sont néanmoins le plus souple des peuples lorsqu’il s’agit d’approprier les produits de leur industrie aux goûts et aux circonstances des pays où ils veulent s’ouvrir des débouchés. Ils fournissent, par exemple, de chapeaux l’Italie, l’Espagne, le Portugal et leurs colonies. Ils en fournissent aussi le Nord. C’est qu’ils savent faire, pour les pays du Sud où il ne pleut pas, des chapeaux minces, légers ; et pour le Nord, des chapeaux forts et compactes, que la pluie ne saurait pénétrer.
Ceux que font les Français sont trop forts pour le Midi, et trop légers pour le Nord.
Il vient à l’esprit d’un Anglais, soit pour perfectionner la fabrication, soit pour la faire avec plus d’économie, des idées qui ne viennent point dans d’autres pays ; ou qui, si elles y viennent, n’y font pas fortune. Il suffit de remarquer les cuves où se feutrent ces mêmes chapeaux. En France elles sont étroites et longues. Plusieurs ouvriers, de chaque côté, travaillent péniblement et mal, parce qu’ils sont gênés. Leur travail étant pénible, ils font moins d’ouvrage dans le même espace de temps. Le salaire de la journée n’en est pas moindre, donc le prix de la main-d’œuvre est proportionnellement plus cher.
En Angleterre, cette même cuve a une forme ronde qui permet aux ouvriers l’usage de leurs mouvements sans se nuire réciproquement. Le feu rassemblé dans un foyer peu étendu qui occupe le centre, s’entretient avec moins de bois, et il se dissipe moins de chaleur que dans un foyer allongé. La fumée même de leur fourneau n’est point perdue. Le tuyau qui la conduit traverse une pièce au-dessus de l’atelier, et sa chaleur en fait une étuve où les chapeaux sèchent plus vite.
Ce n’est pas tout. Les Anglais, qui réussissent moins bien que les Français dans les arts de goût, dans l’architecture, la peinture, la sculpture, surpassent, en général, les Français dans le choix des formes, des dessins et des couleurs dont les arts industriels font leur profit. Ils possèdent, mieux que ceux-ci, cette partie de l’industrie qui consiste dans l’application des connaissances acquises aux besoins de la vie. Ils n’ont pas, dans la mécanique théorique, dans la chimie, de savants à opposer aux Laplace, aux Prony, aux Monge, aux Berthollet, etc. Mais dans l’application de ces connaissances aux arts industriels, les Français ne les atteignent point encore. Ils évitent tour à tour deux écueils opposés, contre lesquels les derniers échouent trop souvent : la routine et la versatilité.
Et non seulement ils savent tirer un parti étonnant des connaissances assez médiocres qu’ils ont dans les arts de goût, mais ils donnent à tout ce qui sort de leurs manufactures l’irrésistible attrait de la commodité. Leurs étoffes, leurs ustensiles, ne sont pas seulement agréables dans leurs formes, dans leurs dessins, dans leurs couleurs, ils sont aussi ceux dont le service est le plus agréable. Ailleurs on croira avoir tout fait en donnant à une théière, à une aiguière, la forme d’un vase antique ; chez les Anglais, il faudra de plus qu’elle soit maniable, qu’elle verse facilement, que l’orifice en soit assez ouvert pour qu’on puisse la nettoyer sans peine ; pour eux l’anse n’aura point de grâces si elle manque de commodité. Ailleurs on fait des étoffes charmantes : eux les font comme on les préfère. Ailleurs on fait des chefs-d’œuvre d’industrie qui ne peuvent convenir qu’aux grands, aux riches, aux cabinets des curieux ; les Anglais font ce qui est partout de mise, ce que tout le monde peut avoir, et ce qu’on n’a que pour en jouir.
Il n’est point de nation qui doive désespérer d’acquérir, en ce genre, ce qui peut lui manquer. De même que le génie des peuples varie suivant les temps, dans ce qui tient à la guerre, aux lettres et aux beaux-arts, il varie dans les choses qui ont rapport à l’industrie. Il y a cent cinquante ans que l’Angleterre elle-même était si peu industrieuse, qu’elle tirait de la Belgique la plupart de ses étoffes ; et il n’y en a pas quatre-vingts que l’Allemagne fournissait des quincailleries à une nation qui, maintenant, en fournit au monde entier [28] .
Même observation sur la manufacture des cotons. Il ne s’en fabriquait point dans le XVIIe siècle : on voit, par les registres des douanes anglaises, qu’en 1705 la quantité de coton brut fabriqué en Angleterre n’était que de 1 170 881 livres pesant. En 1781 cette quantité n’était encore que de 5 101 920 livres pesant ; et en 1799 elle s’est élevée à 30 434 000 livres pesant. On peut supposer que la façon donnée aux cotons, l’une portant l’autre, en quadruple au moins la valeur. Le produit brut de cette industrie doit donc (en évaluant le coton à 2 fr. la livre l’un dans l’autre) excéder actuellement, en Angleterre, 240 millions de nos francs.
Il y a aussi, dans le consommateur, des goûts plus ou moins favorables à ce qui constitue le mérite des produits, la perfection et le bon marché.
En Angleterre chacun n’a pas son caprice dans les petites choses. Toutes les tables à manger, toutes les portes, toutes les serrures d’un emploi pareil, sont faites de même, ou du moins l’on n’y voit qu’un petit nombre de variétés. Qu’exigent les consommateurs anglais ? que chaque chose aille à son but et soit de bonne qualité. Ils sont en conséquence bientôt d’accord sur la forme et sur la matière ; et une fois d’accord ils ont peu d’envie de changer. Dès lors on peut fabriquer en grand, jeter au moule, pour ainsi dire, la plupart des produits ; y porter au dernier degré la division du travail, qui ne peut avoir lieu que lorsqu’il s’agit de créer un grand nombre de produits pareils. Il en résulte qu’ils sont en général plus parfaits, plus exacts, mieux finis, et incomparablement meilleur marché.
Lorsqu’au contraire chacun veut avoir, non la chose qui lui convient le mieux, mais celle qui est selon sa fantaisie, ou qui flatte le plus sa vanité ; lorsque c’est une raison de ne pas vouloir une chose de voir que tout le monde s’en sert, alors le producteur ne peut préparer que des exemplaires isolés de chaque produit ; ils sont nécessairement alors moins parfaits et plus chers. Les meubles de bois d’acajou qu’on fait en France sont plus magnifiques et plus variés que ceux des Anglais. Nos consommateurs veulent en avoir, non pour l’usage qu’ils en tirent, mais pour attester leur bon goût, ou satisfaire leur faste ; dès lors il ne doit pas s’en faire deux absolument pareils, car les goûts varient avec chaque personne, et il en est de même des facultés pécuniaires et de la vanité. L’un veut une forme un peu plus recherchée que l’autre, plus d’ornements en bronze, plus de sculpture ; qu’arrive-t-il ? c’est qu’en France les jolis meubles ne sont qu’à l’usage d’un fort petit nombre de gens aisés, tandis qu’en Angleterre il est peu de ménage assez indigent pour n’avoir pas une table d’acajou. Qu’arrive-t-il encore ? c’est que, malgré la beauté de nos meubles, ils ne sont point faits avec cette précision qui en augmente la commodité et qui en assure la durée. Il ne se passe pas un an sans qu’il s’y trouve quelque chose à refaire. Qu’arrive-t-il encore ? c’est que la valeur totale de cette production est fort supérieure en Angleterre à ce qu’elle est en France, la valeur que nous mettons en magnificence sur un petit nombre de meubles, n’atteignant pas, même de loin, celle qu’ils mettent en commodité sur l’immense quantité des leurs.
Le même désavantage se rencontre dans les objets d’ajustement. La valeur totale des modes qui se fabriquent à Paris est bien loin d’atteindre la valeur totale des cotonnades qui se fabriquent à Manchester.
Les vrais perfectionnements de l’industrie sont donc ceux qui tendent, non à obtenir un raffinement extrême en quelques points, mais ceux qui tendent à répandre l’usage des produits qui sont à la portée du plus grand nombre, à les perfectionner, à les rendre plus communs par leur bas prix. Ce sont aussi ces perfectionnements qui ont le plus besoin des encouragements de l’autorité publique ; les produits à l’usage des riches sont toujours assez promptement perfectionnés ; non seulement parce que le riche est plus en état de payer les frais du perfectionnement, mais aussi parce qu’il est plus en état de le goûter. Une grande fortune laisse le loisir nécessaire pour songer en quoi un objet pourrait être plus commode ou plus agréable ; l’éducation soignée, qui est ordinairement donnée aux riches, les éclaire sur ce qui a été fait de mieux en différents pays et en différents temps ; ils ont donc tout ce qu’il faut pour exciter et récompenser tous les genres de perfectionnements. Il est vrai qu’ils suivent souvent la mode plutôt que le bon sens ; mais le bon sens se rencontre quelquefois sur le chemin de la mode ; on connaît par hasard son mérite, et l’on écoute par occasion ses avis.
Le pauvre, au contraire, surtout celui des campagnes, étranger aux variations de l’usage, étranger aux connaissances des riches, demeure étranger aux perfectionnements de l’industrie. Nos femmes des villes ont adopté les chapeaux de paille, ajustement gracieux et commode ; et nos femmes de la campagne, qui auraient bien plus besoin d’en avoir, ne savent pas s’en servir, du moins dans les trois quarts de la France. C’est pourtant un produit qui s’accommoderait bien avec leurs facultés, et dont les villageoises se trouvent fort bien dans plusieurs pays.
Les fabricants de poterie pourraient, sans augmentation de frais, sans diminution de solidité, donner des formes plus gracieuses et plus légères aux poteries qu’ils destinent à l’usage des indigents ; mais ils n’ont garde de changer pour le mieux : ils perdraient leurs pratiques.
La routine et l’habitude ayant plus d’empire sur la classe la plus commune, et néanmoins les perfectionnements des produits qui sont à son usage étant les plus importants pour les nations, un gouvernement sage les protégera de préférence.
[I-141]
CHAPITRE XX.
Des essais dans l’industrie, de leurs effets, et par qui doivent en être supportés les frais.↩
Il est dangereux de faire des expériences, surtout en agriculture. Pour que sur dix tentatives, il y en ait une dont l’issue soit précisément telle qu’on l’avait espéré, il faut les faire avec un esprit bien prudent et bien éclairé. En agriculture chaque expérience coûte, outre les capitaux qu’on y emploie, la rente du terrain qu’elle occupe, pendant une année, et quelquefois plus ; ce qui pour dix expériences suppose une perte de dix ans. Or quel succès en agriculture peut balancer la perte du fermage et des capitaux pendant dix années, ou seulement pendant quatre ?
Il est vrai qu’un essai qui réussit se répète, et donne ensuite annuellement de plus gros bénéfices que la méthode routinière. Mais, dès ce moment-là, tout le monde peut partager les mêmes bénéfices, et la concurrence les réduit bientôt à peu de chose au-dessus des bénéfices anciens. La société, en général, y a gagné soit un produit nouveau, soit un adoucissement sur le prix d’un produit déjà connu ; mais l’inventeur, dans la plupart des cas, y gagne peu, et souvent il se ruine.
Dans l’industrie commerçante, un négociant essaie de transporter le produit d’un certain pays dans un autre où il est inconnu. C’est ainsi que vers le milieu du XVIIe siècle, des Hollandais faisant le commerce de la Chine essayèrent d’apporter une feuille sèche dont les Chinois faisaient une infusion chez eux d’un grand usage ; de là le commerce du thé, dont il a été acheté en 1795 par les nations d’Europe près de 30 millions de livres pesant [29] .
De telles expériences seraient plus hasardeuses encore que des expériences agricoles : navires à armer, retours de plusieurs années à attendre, succès fort incertain, souvent perte sèche, totale. Aussi de tels essais se font-ils pour l’ordinaire tandis que le négociant conduit un autre commerce, un commerce connu et dont les résultats sont assurés. Tourmentés d’une humeur audacieuse, les Portugais et les Hollandais, vers la fin du quinzième siècle et au commencement du seizième, firent des entreprises grandes, neuves, incertaines, et réussirent ; mais des circonstances pareilles se présentent rarement dans l’espace des temps. À l’époque dont je parle, le monde s’agrandit tout à coup du côté du levant et du côté du couchant, et dans l’immense quantité d’objets nouveaux que présentaient deux hémisphères dont l’un n’était qu’imparfaitement connu et dont l’autre ne l’était pas du tout, il n’y avait pour ainsi dire qu’à aller, pour trouver de quoi prendre, échanger, revendre et beaucoup gagner.
Il ne faut pas oublier non plus que les tentatives audacieuses des particuliers furent précédées, secondées par celles des gouvernements.
Dans l’industrie manufacturière, les expériences sont moins hasardeuses.
1°. Elles reposent sur des calculs plus sûrs.
2°. On peut les tenter sur des quantités plus petites et par conséquent s’exposer à une moindre perte.
3°. On peut ordinairement les répéter plusieurs fois dans le cours d’une année ; elles occupent moins longtemps les capitaux.
4°. Enfin quand elles réussissent, on jouit plus longtemps exclusivement de leurs succès ; le secret des procédés est moins exposé aux regards, et chez quelques nations leur emploi exclusif est garanti par un brevet d’invention.
Aussi les produits de l’industrie manufacturière se multiplient ils, se varient-ils rapidement à l’infini. Cependant, même dans l’industrie manufacturière, je crois que les essais ont ruiné plus de particuliers qu’ils n’en ont enrichi, quand les entrepreneurs ont été assez peu sages pour fonder sur eux seuls leurs revenus ordinaires, et lorsqu’ils ont en conséquence consacré à cet emploi et leur travail et leurs capitaux.
Faut-il donc laisser au seul hasard le soin de découvrir de meilleurs procédés et des routes nouvelles ? Non ; mais (hors un petit nombre de cas où l’avantage est frappant et le succès assuré), il ne faut pas employer à ces recherches un travail et des capitaux qui peuvent être appliqués à donner des produits certains. Il faut y consacrer des revenus qu’on aurait pu, sans faire tort à sa fortune et à son pays, employer à ses jouissances ; il faut y consacrer un temps qu’on aurait pu donner à l’oisiveté ou à l’amusement.
Honneur aux hommes qui ont cherché leurs plaisirs dans de si nobles travaux ! honneur aux hommes qui ont dépensé leurs revenus dans de si utiles consommations ! Je ne crois pas qu’il y ait un plus digne, un plus noble emploi de la richesse et du loisir. Ces hommes font à leurs concitoyens, au monde entier, des présents qui surpassent de beaucoup la valeur de ce qu’ils donnent, et même leur fortune quelque grande qu’elle soit. Leurs bienfaits se propagent et renaissent avec les siècles, et leur nom ne circule jamais qu’entouré de bénédictions. Tel est le nom d’Olivier de Serres, le père de l’agriculture française, le premier particulier, que je sache, qui ait eu une ferme expérimentale ; tels sont plus récemment Duhamel et Malesherbes, à qui la France est redevable de tant de végétaux utiles qui seront désormais naturalisés parmi nous.
L’inventeur de la charrue est inconnu ; mais grâce à l’imprimerie, les grands bienfaits, de même que les grands crimes, ne peuvent plus rester ignorés ; que ceux qui prétendent à une honorable célébrité y prennent garde : elle ne s’attachera désormais qu’aux noms dont le son rappellera des actions utiles.
Un gouvernement éclairé, paternel, et qui dispose de ressources vastes, ne laisse pas aux particuliers toute la gloire des découvertes industrielles. Les dépenses que causent les essais, quand le gouvernement les fait, ne sont pas prises sur les capitaux de la nation, mais sur ses revenus, puisque les impôts ne sont, ou du moins ne devraient jamais être, levés que sur les revenus. La portion des revenus qui par cette voie se dissipe en expériences, est peu sensible, parce qu’elle est répartie sur un grand nombre de contribuables ; et les avantages qui résultent des succès, étant des avantages généraux, il n’est pas contraire à l’équité que les sacrifices au prix desquels on les a obtenus, soient supportés par tout le monde.
[I-147]
CHAPITRE XXI.
Des différentes manières de faire le commence.↩
Toutes les denrées ne viennent pas indifféremment partout. Celles qui sont le produit du sol, dépendent des qualités du sol et du climat qui varient d’un endroit à l’autre. Celles qui sont le produit de l’industrie ne viennent elles-mêmes que dans de certains lieux plus favorables à leur fabrication. De là l’utilité du commerce [30] .
Le marchand en gros fait acheter la marchandise aux lieux qui la produisent et la fait venir aux lieux où elle se consomme.
Le marchand en détail l’achète au marchand en gros, l’expose dans sa boutique et la vend au consommateur en aussi petites portions que celui-ci le désire.
Le roulier fournit ses voitures et ses chevaux pour la transporter.
Si elle doit venir de par-delà les mers, l’armateur fournit ses vaisseaux.
Le courtier rapproche les vendeurs des acheteurs.
Le banquier, le changiste, fournissent des lettres de changes, payables dans d’autres lieux que ceux où l’on est, ou des monnaies étrangères nécessaires pour payer le prix des achats, etc.
Tous font le commerce.
Le commerce en gros a pour objet soit d’apporter les marchandises produites dans l’intérieur du pays, soit celles qui sont produites au-dehors ; de là le commerce intérieur et le commerce extérieur.
Le commerce extérieur est exercé, soit par des négociants étrangers qui viennent vendre ce qui se produit chez eux, soit par des nationaux qui vont acheter au-dehors ce qu’ils vendent dans l’intérieur.
Chaque pays nomme importation, l’action par laquelle on lui apporte des marchandises du dehors, que ce soient des nationaux ou bien des étrangers qui s’en chargent ; et exportation, l’action par laquelle des marchandises produites dans son intérieur s’en vont au-dehors.
Les choses que j’ai appelées jusqu’à présent produits, sont des marchandises lorsqu’elles ne font que passer entre les mains du manufacturier et du commerçant, et toutes les fois qu’on les achète pour les revendre.
Aux yeux du consommateur ce ne sont plus que des denrées.
Comme le manufacturier, le commerçant sont en même temps des consommateurs, certaines choses sont pour eux denrée et marchandise, selon leur destination. Le drap qu’un marchand drapier achète pour le revendre, est une marchandise ; celui qu’il achète pour s’habiller est une denrée.
Le commerce, soit avec les places de l’intérieur, soit avec les places du dehors, étant perpétuellement occupé à comparer la différence des valeurs des marchandises, en différents lieux, pour les faire passer du lieu où elles valent moins, au lieu où elles valent plus, il ne faut pas être surpris que les prix courants des marchandises soient une circonstance à laquelle les négociants donnent une si grande attention.
Le négociant qui fait tous les genres de spéculations, en cherchant quels sont les articles où il y a quelques profits à faire, porte perpétuellement son industrie et ses capitaux là où se font de trop gros profits ; et sa concurrence ne tarde pas à les réduire à leur taux naturel. Ainsi c’est à tort que le consommateur regarde le négociant spéculateur comme un commerçant parasite dont les profits font renchérir les denrées ; son industrie tend, au contraire, à les réduire à leur plus bas prix.
L’industrie, manufacturière ou commerçante, qui fonde ses revenus sur la consommation étrangère, est, de toutes, la plus précaire, la plus dépendante des hommes et des événements. Elle oblige les nations qui y sont vouées à se mêler des affaires des autres peuples, et jamais pour l’avantage de ceux-ci. Elle ne voit en eux que les profits qu’on en peut tirer. Elle les considère avec une sorte de mépris, parce qu’on s’accoutume à juger inférieurs en intelligence et en puissance des peuples qui ne sont pas en état de fabriquer eux-mêmes ce qu’on leur fournit. Elle regarde les bénéfices qu’elle fait avec eux comme un tribut qu’ils lui paient. L’orgueil national dont ces nations se vantent quelquefois, n’est pas la juste fierté d’une âme élevée et libre, qui s’allie fort bien avec l’amour des hommes et les égards qu’on doit aux autres nations : c’est l’insolence du traitant qui se croit en droit de mépriser le peuple et de l’éclabousser, parce qu’il s’est engraissé de ses sueurs.
[I-152]
CHAPITRE XXII.
Des débouchés.↩
Chaque producteur produit d’une certaine marchandise une quantité fort supérieure à sa consommation. Le fermier récolte plus de grains que sa nourriture et celle de sa maison n’en exigent ; le chapelier fabrique bien plus de chapeaux qu’il ne lui en faut pour son usage ; l’épicier en gros fait venir beaucoup plus de sucre qu’il n’en peut consommer. Tous ont besoin de plusieurs autres denrées pour vivre avec douceur. Les échanges qu’ils parviennent à faire de leurs produits avec ceux des autres offrent à ces produits ce qu’on nomme des débouchés.
La monnaie sert dans cette opération à peu près de la même manière que les affiches et les feuilles d’avis qui, dans une grande ville, opèrent le rapprochement des gens qui sont dans le cas de faire des affaires ensemble. Au bout de l’année chaque producteur a manié une très grande quantité d’argent, mais sauf quelques soldes de peu de conséquence, il ne lui reste ordinairement pas entre les mains plus d’argent comptant à la fin de l’année qu’il n’en avait au commencement. L’essentiel est ce qu’il achète avec cet argent, c’est-à-dire les produits des autres qu’il a échangés avec les siens, et dont il a consommé une partie et conservé l’autre, selon ses besoins, son économie et l’état de sa fortune.
Ceci montre, j’espère, que ce n’est point tant l’abondance de l’argent qui rend les débouchés faciles, que l’abondance des autres produits en général. C’est une des vérités les plus importantes de l’économie politique.
Qu’on se représente un homme très industrieux, ayant tout ce qu’il faut pour produire : le talent et les capitaux ; qu’on se le représente seul industrieux, au milieu d’une peuplade qui, sauf quelques nourritures grossières, ne sait rien créer ; que fera-t-il de ses produits ? Il en achètera la quantité de nourriture grossière nécessaire à ses besoins. Que fera-t-il du surplus ? rien. Mais si les productions du pays viennent à se multiplier, à se varier, dès lors ses produits peuvent tous se placer, c’est-à-dire s’échanger contre les choses dont il peut avoir besoin soit pour jouir de plus de douceurs, soit pour placer les accumulations qu’il juge à propos de faire.
Ce que je viens de dire d’un seul homme industrieux peut se dire de cent mille. Leur nation leur offrira d’autant plus de débouchés qu’elle peut payer plus de choses, et elle peut payer plus de choses à proportion de ce qu’elle en produit davantage. L’argent ne remplit qu’un office passager dans ce double échange. Les échanges terminés, il se trouve qu’on a payé des produits avec des produits.
En conséquence, quand une nation a trop de produits dans un genre, le moyen de les écouler est d’en créer d’un autre genre. C’est quand on ne peut plus produire aucun objet d’échange, que l’exportation devient avantageuse. Elle l’est encore lorsqu’elle est un moyen d’acheter des produits que l’intérieur ne saurait fournir, comme les fruits d’un autre climat. Mais les ventes les plus profitables sont celles qu’une nation se fait à elle-même ; puisqu’elles n’ont pu s’opérer qu’autant qu’il y a eu deux valeurs produites : celle qu’on vend, et celle qui achète [31] .
Forbonnais tombe dans la même erreur, lorsqu’il dit qu’un État gagne le montant des ventes qu’il fait à l’étranger, et qu’il perd le montant des achats qu’il fait à l’étranger (Éléments du commerce, chap. I.). La marchandise que l’étranger vous vend, vaut autant que celle avec quoi on l’achète, fût-ce de l’argent ; car personne n’est disposé à donner plus pour recevoir moins.
Il ne faut donc considérer l’exportation que comme un supplément à la consommation intérieure, moins avantageuse que n’est celle-ci.
[I-156]
CHAPITRE XXIII.
Comment le commerce extérieur concourt à la production intérieure.↩
Dans le commerce de nation à nation, comme dans celui d’homme à homme, l’une ne donne jamais à l’autre une marchandise qu’elle n’en reçoive l’équivalent en une autre marchandise, ou en argent, qui est une marchandise aussi. Ce que les individus d’une nation donnent à ceux de l’autre par générosité ou ce qu’ils perdent par des fautes, est toujours peu considérable. On peut s’en rapporter à cet égard à l’intérêt personnel.
Si les importations et les exportations se balancent nécessairement, s’il entre dans un pays une valeur toujours équivalente à celle qui en sort, ce ne sont pas les exportations ou les importations qui augmentent ou diminuent les richesses d’un pays.
Plus les produits d’un pays sont considérables et plus il peut en envoyer au dehors, plus il peut recevoir de valeurs en échange. Ce qui enrichit un État comme un particulier, c’est donc de produire ; mais il ne faut pas perdre de vue que produire c’est créer une valeur échangeable, une valeur en échange de laquelle on puisse obtenir une autre valeur équivalente.
Si les importations et les exportations se balancent toujours, on peut demander ce que gagne une nation à faire un commerce extérieur. Le voici.
Elle y gagne d’abord de se procurer des productions étrangères à son sol et dont elle ne jouirait pas sans cela, en échange de productions qui, bien qu’également utiles, excèdent ce qui est nécessaire pour son usage. Ce n’est pas tout : elle augmente réellement la masse des valeurs, c’est-à-dire des richesses intérieures. C’est ce que je ferai mieux comprendre par un exemple que par un raisonnement.
Je suppose que la France envoie en Hollande des taffetas, et qu’elle reçoive de Hollande, en retour, des toiles. Les taffetas qu’elle lui enverra vaudront 4 fr. à Lyon et 6 fr. à Amsterdam. Les toiles qu’elle en recevra vaudront 4 fr. à Amsterdam et 6 fr. à Paris. Portons, toujours par supposition, la quantité de taffetas expédiée à cent aunes. Que sera-t-il arrivé ?
400 francs de taffetas arrivés à Amsterdam seront élevés à une valeur de 600 fr., lesquels, transformés en toiles, auront procuré 150 aunes de toile à 4 fr. Les 150 aunes de toile arrivées à Paris y vaudront, à 6 fr., 900 fr. Voilà donc une valeur de 400 fr. transformée en une valeur de 900 fr., c’est-à-dire un gain de 500 fr.
J’ai forcé les prix et supposé des sommes rondes pour simplifier la chose qui se modifie de mille manières dans l’application. Il me suffit qu’on entende le principe.
Or le principe qui n’aurait pas été si bien compris, si je l’avais énoncé avant l’exemple, est ceci :
Les profits que fait une nation dans son commerce extérieur, viennent de ce qu’elle augmente la valeur des objets qu’elle porte au-dehors, où ils ont une valeur plus grande, et en même temps la valeur des objets qu’elle rapporte en retour et qu’elle choisit naturellement parmi ceux qui ont au dedans une valeur supérieure à celle qu’ils ont au dehors.
Quelquefois ce sont des négociants différents, et même des négociants de l’un et de l’autre pays qui emploient leurs capitaux et leur industrie à ce commerce. Les profits alors s’en partagent entre eux. C’est le négociant de Lyon qui envoie des étoffes de soie en Allemagne, et c’est le négociant allemand qui envoie en retour des merceries et des quincailleries en France. Ils se paient mutuellement avec des lettres de change.
Mais fût-ce la même nation qui fît les bénéfices de l’expédition et ceux du retour, l’autre n’y perdrait rien. Quand les Français seuls feraient le commerce de la France avec l’Allemagne, les Allemands ne donneraient jamais aux Français, soit en marchandises, soit en argent, qu’une valeur égale à celle qu’ils en auraient reçue. La seule opération qui pût appauvrir les Allemands serait de consommer chez eux une valeur supérieure à celle qu’ils produisent, soit que cette valeur vînt du dehors ou de l’intérieur de l’Allemagne.
Dupont de Nemours veut [32] qu’on ne fasse point baisser le prix des marchandises dans l’intérieur parce qu’il vaut mieux selon lui que l’étranger paie chèrement celles qu’il achète chez nous. C’est s’arracher un cil pour éborgner son voisin ; car ce que l’étranger paiera chèrement sera payé de même par les nationaux. C’est, de plus, éloigner les étrangers de votre marché, car ils s’adressent là où on leur fait les meilleures conditions.
Le même écrivain [33] dit avec toute la secte des Économistes :
« Exportez vos matières premières pour encourager votre agriculture, et recevez en échange des ouvrages manufacturés qui auront occupé des mains étrangères d’une manière improductive ».
Steuart, dont le système a presque toujours été suivi par son gouvernement, soutient un avis absolument contraire.
« Exportez, dit-il, vos produits manufacturés qui ont peu de valeur intrinsèque, et recevez en échange des matières premières sur lesquelles s’exercera votre industrie, et qui vous procureront de nouveaux gains ».
Il me semble que la raison éclairée laissera ces deux systèmes se débattre ensemble, et dira :
« Exportez les produits dont vous pouvez vous passer ; importez ceux qui vous manquent ; mais, préférablement, cultivez, fabriquez et vendez le plus que vous pourrez dans votre propre pays ; car il vaut mieux ne dépendre des étrangers ni pour ses gains, ni pour sa consommation ».
Ici il s’élève une question.
Convient-il à une nation, à la France, par exemple, d’acheter au dehors ce qu’elle ne pourrait produire pour le même prix ? Assurément, si l’objet rendu au lieu de la consommation est encore moins cher que s’il était produit en France. Pourquoi dépenserait-on plus pour fabriquer un produit, si l’on peut l’avoir exactement pareil, en dépensant moins ? Mais, dira-t-on, la nation qui le vend y gagne. Tant mieux pour elle. Trouvez les moyens de créer le même produit à aussi bon marché qu’elle ; alors vous pourrez, sans inconvénient pour vous-même, lui ôter le gain qu’elle fait, puisque vous regardez le gain d’un autre comme un malheur. Mais jusque-là vous supporteriez une perte. Faut-il qu’un homme du monde fabrique sa chaussure et son vêtement chez lui pour éviter de faire gagner le cordonnier et le tailleur ? S’il est jaloux du gain de ces deux ouvriers, il peut faire leur ouvrage pour peu que cela lui plaise ; mais il y perdra.
Quelques personnes qui n’auront pas bien suivi les raisonnements qui ont précédé, diront peut-être que ce qui est dépensé dans le pays pour produire, n’est pas perdu comme ce qu’on dépense pour faire venir une chose du dehors. Je les renvoie au livre V, pour voir avec plus de développements comment ce qui est dépensé est consommé, comment ce qui est consommé est détruit, et comment ce qui est détruit est aussi bien perdu pour la nation que si cela allait au dehors.
L’exemple vulgaire que je viens d’indiquer suffirait pour le démontrer.
En effet, qu’un particulier fasse la folie de vouloir fabriquer son habit en entier. La laine qu’il achète, les outils qu’il use, sa nourriture, son temps, l’usage de ses capitaux ravis à d’autres occupations plus profitables, etc., ne sont-ils pas perdus pour lui aussi complètement que s’il jetait la valeur de toutes ces choses là dans la rivière ? Ce qui est folie dans un particulier, dit Smith, ne saurait être sagesse dans une nation.
« Il est possible, dit ailleurs Smith [34] , d’obtenir en Écosse, au moyen de serres chaudes et de soins assidus, de très bons raisins et d’excellent vin. Il ne reviendrait guère qu’à 30 fois la valeur de celui qu’on fait venir de France, et il n’est personne qui ne sente combien il serait absurde d’en faire les frais. Or si c’est une absurdité de vouloir produire une denrée qui coûterait 30 fois plus de produits qu’on ne serait obligé d’en donner pour la faire venir, n’est-ce pas une absurdité pareille, quoique moins manifeste, de vouloir en produire une qui coûterait dans ce cas, ne fût-ce que la 30e, la 100e partie de sa valeur, de plus que si on la faisait venir ? Que les avantages d’un pays sur l’autre soient naturels, ou bien qu’ils soient acquis, l’effet est exactement le même ».
Montesquieu [35] établit qu’une nation fait toujours ou le commerce de luxe, ou le commerce d’économie ; que le commerce de luxe consiste à faire venir de l’étranger ce qui sert à satisfaire le besoin des nationaux, et que le commerce d’économie consiste à fournir à l’étranger ce qui est propre à la consommation de l’étranger.
Tout cela ne signifie absolument rien.
Ce que Montesquieu entend par faire le commerce de luxe, c’est tout bonnement acheter pour consommer plus ou moins fastueusement ; ce n’est pas faire le commerce : c’est manger son revenu, et quelquefois son capital.
Ce qu’il entend par faire le commerce d’économie, ce n’est pas économiser : c’est produire, et ensuite vendre ses produits.
Le même auteur, qui trop souvent s’égare et égare les autres en poursuivant les éclairs de sa belle imagination, dit encore au sujet des produits du commerce :
« Non seulement un commerce qui ne donne rien peut être utile, un commerce même désavantageux peut l’être. J’ai ouï dire en Hollande que la pêche de la baleine en général ne rend presque jamais ce qu’elle coûte, mais ceux qui ont été employés à la construction du vaisseau, ceux qui ont fourni les agrès, les apparaux, les vivres, sont aussi ceux qui prennent le principal intérêt à cette pêche : perdissent-ils sur la pêche, ils ont gagné sur les fournitures, etc. [36] ».
Tout cela veut dire qu’un commerce qui donne de la perte peut donner du bénéfice. Qu’est-ce que des frais qui donnent des bénéfices ? Qu’est-ce que des fournisseurs qui gagnent sur les fournitures et qui perdent sur les seuls produits qui peuvent payer les fournitures ? Il y a ici confusion dans les objets et dans les personnes.
En Hollande, comme partout, les fournisseurs d’apparaux ne sont pas ordinairement des entrepreneurs de pêche. Les fournisseurs d’apparaux gagnent sur leurs fournitures, cela est indubitable ; ce gain est payé par les entrepreneurs de la pêche, cela est encore indubitable ; mais ce qui ne l’est pas moins, c’est que les entrepreneurs ne feraient pas ces fraislà si les produits de la pêche ne devaient pas les payer [37] .
Rien ne m’a plus fortement excité à écrire, je l’avoue, que la confusion des idées qu’on retrouve dans ce qui a rapport à l’économie politique jusque chez nos plus grands écrivains. Quand un auteur, parlant de ces choses, se forme une vue si peu nette de leur vraie nature, si, par hasard, il vient à rencontrer une vérité utile, et s’il lui arrive de donner un bon conseil, c’est fort heureux.
[I-167]
CHAPITRE XXIV.
Comment le commerce de transport concourt à la production intérieure.↩
Le transport par mer est un travail qui tient à l’industrie commerçante et qui a pour atelier l’univers.
Les gains de cette industrie, c’est-à-dire la portion du salaire et des profits du capital qui n’est pas dépensée au-dehors et qui ne tombe pas au fond de la mer, enrichit la patrie du navigateur.
Le commerce de transport maritime se fait soit par les gens de la nation qui produit la marchandise, soit par les gens de la nation qui la consomme, soit par des gens étrangers à l’une et à l’autre. C’est principalement alors qu’il prend le nom de commerce de transport.
Les Hollandais font souvent le transport d’un port qui leur est étranger à un autre qui l’est également. C’est qu’ils le font à meilleur marché que d’autres ; c’est-à-dire que la marchandise qu’ils vont acheter hors de chez eux, ils sont en état de la revendre, dans le lieu où elle se consomme, à meilleur marché que ne pourrait le faire le peuple producteur ou le peuple consommateur. Ce qui tient à plusieurs causes :
1°. Les capitaux nécessaires pour mettre en activité cette industrie s’empruntent chez eux à meilleur marché que partout ailleurs ; un armateur hollandais peut emprunter, pour armer un vaisseau, sur le pied de 3 pour cent par an ; et par conséquent il peut se contenter d’un bénéfice moindre qu’un armateur de France ou d’Espagne, où l’intérêt est plus cher.
C’est en partie le haut intérêt de l’argent en Turquie qui empêche les Turcs de faire le commerce de transport, même d’un de leurs ports à l’autre. Avant la guerre c’étaient nous qui en faisions la plus grande partie, nos armateurs pouvant se procurer des capitaux à un intérêt beaucoup moindre que celui des Levantins.
2°. Les bâtiments hollandais dans leur large ventre contiennent beaucoup de marchandises ; ils sont manœuvrés par peu d’hommes ; ces hommes ont de la frugalité ; trois autres sources d’économie.
Quand des étrangers peuvent transporter les marchandises qui sortent de nos ports et celles qui y entrent, à meilleur marché que nous ne pourrions le faire nous-mêmes, nous convient-il de leur en laisser la faculté ?
Si l’on a bien entendu ce qui a été dit sur le commerce, on résoudra facilement cette question.
S’agit-il de marchandises que nous envoyons dans l’étranger ? Si le transport est à meilleur marché que nous ne pourrions le faire nous-mêmes, alors la marchandise s’établit dans l’étranger à un prix plus bas ; ce qui lui fait donner la préférence sur d’autres, et par conséquent est favorable à l’extension de notre commerce extérieur.
S’agit-il des marchandises que nous importons du dehors ? L’effet d’un transport moins coûteux sera de les faire payer moins cher à nos compatriotes qui doivent les consommer. Si nous interdisons à tout étranger de les apporter, ce seront des Français qui nous les apporteront ; mais nous les paierons plus cher. Cette mesure sera un monopole en faveur des armateurs français, dont les consommateurs français seront victimes, et ce qu’elle fera payer de plus aux consommateurs pourra excéder même le bénéfice que feront les armateurs sur cette opération.
Rendons cela plus sensible par un exemple.
Le transport des chanvres de Riga au Havre revient à un navigateur hollandais à 35 fr. par tonneau. Nul autre ne pourrait les transporter si économiquement ; je suppose qu’il le peut. Il propose au gouvernement français, qui est consommateur de chanvre de Russie, de se charger de ce transport pour 40 fr. par tonneau. Il se réserve comme on voit un bénéfice de 5 fr. Je suppose encore que le gouvernement français voulant favoriser les armateurs de sa nation, préfère d’employer des vaisseaux français auxquels le même transport reviendra à 50 fr. et qui pour se ménager le même bénéfice le feront payer 55 fr. Qu’en résultera-t-il ? Le gouvernement aura fait un excédent de dépense de 15 fr. par tonneau pour en faire gagner 5 à ses compatriotes ; et comme ce sont des compatriotes également qui paient les contributions sur lesquelles se prennent les dépenses publiques, cette opération aura coûté 15. fr. à des Français pour faire gagner 5 fr. à d’autres Français.
D’autres données donneront d’autres résultats, mais telle est la méthode à suivre dans ce calcul.
Il n’est pas besoin d’avertir que je n’ai considéré jusqu’à ce moment l’industrie nautique que dans ses rapports avec la richesse publique ; elle en a d’autres avec la sûreté de l’État. L’art de la navigation qui sert au commerce, sert encore à la guerre. La manœuvre d’un bâtiment de mer est une évolution militaire ; de sorte qu’une nation qui possède beaucoup d’ouvriers marins, est militairement plus puissante qu’une nation qui en possède peu. Il en est résulté que toujours on a vu des considérations militaires et politiques se mêler aux vues industrielles et commerciales dans ce qui a eu rapport à la navigation ; et lorsque l’Angleterre, par son acte de navigation, a interdit à tout bâtiment dont les armateurs et l’équipage ne seraient pas au moins pour les trois quarts anglais, de faire le commerce de transport pour elle, son but a été non pas autant de recueillir le bénéfice qui en pouvait résulter, que d’augmenter ses forces navales et de diminuer celles des autres puissances, particulièrement de la Hollande, qui faisait alors, comme elle fait aujourd’hui, un grand commerce de transport, et qui était à cette époque le principal objet de la jalousie anglicane.
On ne peut nier que cette vue ne soit celle d’une habile administration, en supposant toutefois qu’il convient de dominer sur les mers par la force plutôt que par l’ascendant d’une convenance réciproque.
Contre une telle mesure il ne reste aux autres peuples de ressource que d’en prendre une exactement semblable à l’égard de l’Angleterre seule, en lui ôtant la faculté de faire pour eux le commerce de transport. Si, du reste, ils abolissent entre eux de telles entraves, la puissance qui continuerait à les laisser subsister dans ses rapports avec toutes les autres ne tarderait pas à en être punie ; car le commerce prend toujours son cours principal du côté où, avec une égale sécurité, il trouve moins d’entraves. Cette puissance verrait ainsi lui échapper le commerce du monde par les moyens même dont elle se servait pour l’accaparer.
[I-173]
CHAPITRE XXV.
De ce qu’on nomme balance du commerce.↩
Quand j’ai dit qu’au moment où une marchandise sort d’un pays, on peut être certain qu’il y est entré, ou qu’il y entrera une valeur équivalente, soit en denrées, soit en argent, je n’ai point fait de différence entre l’argent et les autres denrées. Beaucoup de gens en font une fort grande. Ils comptent pour rien, ou pour peu de chose, les marchandises qui rentrent en retour de celles qui sortent ; ils comptent pour tout les métaux précieux qui reviennent en échange. Et comme il rentre d’autant plus de métal précieux qu’il rentre moins d’autres marchandises, ils attachent un grand prix à connaître et à comparer la valeur de toutes les marchandises envoyées à l’étranger, et la valeur de toutes celles qu’on en a tirées.
C’est cette comparaison qu’on nomme balance du commerce. Elle montre quel est l’excédent payé en argent par l’étranger ou à l’étranger. (J’appelle ici marchandise ce qui n’est pas or ou argent, quoique ces métaux, même lorsqu’ils sont frappés en monnaie, soient de véritables marchandises.)
On dit que la balance du commerce est contraire à une nation, lorsque cette nation a importé plus de marchandises qu’elle n’en a exporté, parce qu’alors elle est obligé de payer l’excédent en argent. On dit que la balance du commerce lui est favorable, quand au contraire elle a plus envoyé de marchandises qu’elle n’en a reçu ; car alors l’excédent des marchandises qu’elle a envoyées lui est payé en argent.
La balance du commerce peut être favorable à une nation dans son commerce avec un certain pays, et défavorable dans son commerce avec tel autre pays. C’est ainsi qu’en 1787 la France a reçu de la Hollande, suivant Arnould, une solde de 19 millions 880 mille livres en espèces, et a payé une solde de 6 millions 473 mille livres au Portugal.
De l’ensemble des tableaux particuliers de la balance du commerce de la France avec chacune des autres nations, se forme le tableau général qui montre ce qu’en somme elle gagne ou perd en argent dans l’année.
Remarquez bien ce mot, en argent ; car encore une fois, il entre une valeur égale à celle qui sort ; tout ce que je considère ici, c’est la portion de ce qui rentre qui est en argent.
Est-ce un avantage pour un pays que la balance du commerce soit en sa faveur ?
Cette question équivaut à celle-ci :
Est-il plus avantageux pour un pays de recevoir cinquante millions, plus ou moins, en métaux précieux, plutôt qu’en toute autre denrée ?
Il ne faut pas perdre de vue que, soit en argent, soit en denrée, la valeur qu’on reçoit n’a rien de plus illusoire d’une façon que de l’autre. Cette valeur se compose de toutes les valeurs particulières dues aux individus ; or il n’est aucun individu de ceux à qui l’on doit, qui ne veuille recevoir en valeurs réelles et solides la totalité de ce qui lui est dû. Si au lieu de recevoir une somme de 25 mille francs en argent, il consent à la recevoir en marchandises, il ne se contentera pas d’une quantité de marchandises qui ne vaudrait que 20 mille fr. On voit que c’est la nation qui reçoit qui est juge de la valeur, et que si elle reçoit cinquante millions en denrées, ils valent bien cinquante millions en argent.
Or, à valeur égale, lequel vaut le mieux de l’argent ou de toute autre denrée ? Voilà en seconde analyse à quoi se réduit la même question.
Certainement l’argent a quelques avantages, parce qu’il est plus facilement échangeable, en tous lieux, contre les choses diverses dont on peut avoir besoin. C’est ce qui fait qu’en général dans la vie commune lorsqu’il y a un échange de marchandise contre de l’argent, bien que la marchandise vaille son prix, on considère celui qui, dans ce troc, reçoit l’argent, comme plus heureux que celui qui reçoit la marchandise.
Mais il ne faut pas estimer cet avantage au-delà de ce qu’il vaut, surtout de nation à nation. Si un particulier, quelque riche qu’il soit, n’a nul besoin d’avoir en caisse plus d’argent que n’en exigent ses affaires du moment, une nation en a moins de besoin encore. Car un particulier peut avoir intérêt à mettre sa fortune sous une forme telle qu’il puisse en disposer promptement selon que la circonstance ou son caprice en décident ; tandis qu’une nation dont les capitaux sont engagés, dispersés sous mille formes différentes, n’est jamais dans le cas de faire ce qu’un particulier appelle réaliser.
Je vais plus loin, et je dis que, quelle que soit la balance du commerce, il n’entrera pas dans un pays plus de métaux précieux qu’il n’est nécessaire d’une part pour fabriquer les meubles d’orfèvrerie et de bijouterie qu’elle veut se donner ; et d’autre part pour servir, sous la forme de numéraire, à la circulation des propriétés ; par la raison que toute quantité d’or et d’argent que l’on a au-delà de ce qui est ainsi employé, est un capital dormant, et que personne n’est disposé à perdre les intérêts d’une portion de son capital.
Nous avons même vu, en traitant des capitaux, que plus un pays est riche et plus la portion de son capital qui est en or ou en argent, est petite relativement au reste. Lorsqu’un pays a de cette façon la quantité de métaux précieux qu’il peut employer, il n’y a pas de lois ni de surveillance, si sévères qu’elles soient, qui empêchent le surplus de sortir, parce que les métaux précieux sont une des marchandises les plus aisées à passer en fraude, et que l’intérêt personnel excite puissamment à les porter du lieu où ils valent relativement moins, au lieu où ils valent relativement plus. Il est défendu de sortir de l’argent d’Espagne, et l’Espagne fournit de l’argent à toute l’Europe.
De quoi servent donc tous les soins que prennent les gouvernements pour faire pencher en faveur de leur nation la balance du commerce ? À peu près à rien, si ce n’est à former de beaux tableaux démentis par les faits [38] ; heureusement que ces faits-là ne sont point des malheurs. Quand une nation a la quantité de numéraire nécessaire à la circulation de ses biens, il n’en vient pas davantage, parce que les particuliers n’ont aucun intérêt à le faire venir ; et si les particuliers n’ont aucun intérêt à le faire venir, la totalité des particuliers, c’est-à-dire la nation, n’y est pas plus intéressée.
La nation est intéressée à produire beaucoup, à vendre beaucoup de productions au-dehors, afin de recevoir une grande quantité de productions en échange des siennes ; du reste peu lui importe qu’on la paie en argent ou en marchandises. Si l’argent vient à manquer chez elle, il en entrera naturellement, parce que l’argent s’élèvera à un prix tel, qu’il sera plus lucratif d’y envoyer cette denrée-là qu’une autre. Si l’argent n’y manque pas, pourquoi le rechercher à l’exclusion des autres denrées ? Ne vaut-il pas mieux que la nation reçoive du blé, du vin, des agrès, des étoffes, ou toute autre chose dont elle a un plus grand besoin ? Sans doute il ne convient pas à un fabricant de soieries de recevoir d’Allemagne, en paiement de ses étoffes, des quincailleries, parce qu’il n’en est pas marchand ; mais il lui convient de recevoir une lettre de change payable par le quincaillier, qui gagne de son côté sur son commerce.
Tous les gouvernements, sans exception, ont méconnu ces principes ; ils se sont tous dirigés d’après l’idée où ils étaient, en premier lieu que les métaux précieux étaient la seule richesse désirable, et en second lieu qu’on en pouvait faire entrer par des moyens forcés [39] .
Le gouvernement anglais particulièrement a poussé au dernier degré le soin de faire pencher en faveur de son pays la balance du commerce. Il n’a point rendu la monnaie métallique plus abondante, bien au contraire ; mais plusieurs actes de l’administration publique, le génie de la nation et un concours de circonstances très remarquables, ont constamment augmenté les productions de l’Angleterre, et par conséquent ses richesses ; ce qui lui a fourni les moyens de faire, soit au-dedans, soit au-dehors, d’immenses consommations, et de frapper les regards de la terre du spectacle de son opulence.
Que ces consommations aient été assez bien entendues pour avoir beaucoup contribué au bonheur et à la gloire de la nation anglaise en général, c’est ce qui paraît infiniment plus douteux.
[I-182]
CHAPITRE XXVI.
Des voyages et de l’expatriation par rapport à la richesse nationale.↩
Un voyageur qui apporte son argent dans un pays et qui l’y mange, produit le même effet pour ce pays, que si ce pays exportait la denrée que le voyageur y consomme. Il fait pencher d’autant la balance du commerce, ou plutôt du numéraire, en faveur du pays qu’il vient visiter. Mais il n’augmente pas pour ce pays la masse des produits, c’est-à-dire des richesses ; car s’il apporte et laisse dans le pays pour dix mille francs de produits, soit en argent soit en marchandise, il consomme ou emporte des produits pour une valeur égale. Quand son voyage est fini, il ne reste donc pas dans le pays plus de valeurs que lorsqu’il y est entré. Il y laisse des guinées ou des piastres, ou toute autre chose qu’il lui a plu d’y apporter ; mais il y a détruit du vin, de la volaille, en un mot tout ce qu’il lui a plu d’y consommer.
Si le vin, si la volaille, et toutes les autres choses que l’étranger a consommées n’eussent pas été produites sans la circonstance de son voyage, la nation se trouve à la vérité plus riche de tout le montant de cette production. Comme une nation qui ne fournissant rien à ses voisins et qui viendrait tout à coup à fabriquer et à leur vendre un produit nouveau, se trouverait plus riche de tout ce produit nouveau. Ce n’est pas la circonstance de vendre ce qu’on a produit, mais de le produire, qui augmente la masse des richesses. L’étranger a été utile en provoquant cette production ; mais si cette production avait été provoquée par d’autres habitants du même pays, c’est-à-dire si d’autres habitants avaient produit de leur côté assez pour acheter ce que l’étranger a acheté, l’effet aurait été plus favorable encore, puisque la nation aurait eu double production, celle qui aurait été vendue d’abord et celle avec quoi on l’aurait achetée.
Ainsi se présente le fait considéré sous le point de vue principal. Mais il est ordinairement accompagné de quelques accessoires qui en changent un peu les résultats.
Un étranger qui ne connaît bien ni la langue, ni les valeurs, et qui souvent a la faiblesse de vouloir imposer par le faste et la dépense, donne en effet plus de valeurs qu’il n’en reçoit. Tantôt il se livre à des libéralités gratuites, tantôt il est dupé faute de précautions et de connaissances. Or ce qui sort de sa poche de cette manière, que la chose soit gagnée légitimement ou non, n’en est pas moins un gain réel pour l’individu qui en profite et pour la nation.
En second lieu, un étranger paie des avantages qui ne coûtent rien à la nation, ou dont elle aurait fait la dépense sans cela. Tels sont les spectacles, les fêtes, et même les curiosités de la nature et des arts dont elle ne permet pas une jouissance purement gratuite.
En voilà assez pour faire considérer la visite des étrangers comme profitable, et tout ce qui peut les attirer comme des objets précieux. Aussi les Italiens regardent-ils avec raison les beaux débris de l’Antiquité qui couvrent leur territoire, comme très productifs pour eux, et le calcul de l’intérêt entre pour le moins autant que l’amour des arts, dans les soins qu’ils mettent à les conserver.
Cependant, qu’on y prenne garde, il faut faire peu de sacrifices uniquement dans le but d’attirer des étrangers. Ces sacrifices atteignent et surpassent bien vite l’avantage qu’ils procurent. On prétend que les courtisans de Louis XIV lui représentaient les énormes dépenses qu’il faisait en fêtes, comme balancées par ce que les étrangers curieux de ces fêtes laissaient en France. J’ai bien peur que Louis XIV et tous ses ministres ne fissent un mauvais calcul. Ce qu’il y a de plus clair dans le résultat de ces fêtes, c’est d’abord l’énorme consommation de valeurs de tout genre qui s’y faisait en un petit nombre d’instants. Quant aux gains, il ne faut pas sans doute compter pour tels l’argent qu’un provincial y venait dépenser ; c’était une perte pour la nation et non pas un profit. Il en est qui venaient y dissiper en trois jours ce qui aurait suffi à l’entretien de leur famille pendant une année. Restent donc les valeurs que des étrangers du dehors avaient apportées, ou plutôt l’excédent de ces valeurs sur leurs consommations ; or on conviendra que c’était un faible dédommagement des millions que le roi dépensait dans ces fêtes. Des fêtes pareilles peuvent être des choses fort agréables comme divertissement ; mais ce sont assurément des choses fort ridicules comme calcul. Que penserait-on d’un marchand qui ouvrirait un bal dans sa boutique, paierait des bateleurs, et distribuerait des rafraîchissements pour faire aller son commerce ?
D’ailleurs est-il bien sûr qu’une fête, un spectacle, quelque magnifiques qu’on les suppose, amènent beaucoup d’étrangers du dehors ? Les étrangers ne sont-ils pas plutôt attirés, ou par le commerce, ou par de riches trésors d’antiquités, ou par de nombreux chefs-d’œuvre des arts qui ne se trouvent nulle part ailleurs, ou par un climat, des eaux singulièrement favorables à la santé, ou bien encore par le désir de visiter des lieux illustrés par de grands événements, et d’apprendre une langue fort répandue ? Je serais assez tenté de croire que la jouissance de quelques plaisirs futiles n’a jamais attiré de bien loin beaucoup de monde. Un spectacle, une fête font faire quelques lieues, mais rarement font entreprendre un voyage. Il n’est pas vraisemblable que l’envie de voir l’opéra de Paris soit le motif pour lequel tant d’Allemands, d’Anglais, d’Italiens viennent visiter cette grande capitale, qui a heureusement de bien plus justes droits à la curiosité générale. Les Espagnols regardent leurs combats de taureaux comme excessivement curieux ; cependant je ne pense pas que beaucoup de Français aient fait le voyage de Madrid pour en avoir le divertissement. Ces sortes de jeux sont fréquentés par les étrangers qui sont attirés dans le pays pour d’autres causes, mais ce n’est pas celle-là qui détermine leur déplacement.
Melon, dans son Essai politique sur le commerce, dit que « les spectacles ne sauraient être trop grands, trop magnifiques, et trop multipliés ; que c’est un commerce où la France reçoit toujours sans donner ». Elle donne les consommations qu’elle y fait : voilà une chose certaine ; quant au bénéfice qu’elle en retire, il est fort douteux. On fait fort bien de dépenser beaucoup en spectacles, si l’on y trouve son plaisir ; mais je n’aime pas qu’on représente cette dépense comme un gain.
Une acquisition vraiment profitable pour une nation, c’est celle d’un étranger qui vient s’y fixer en transportant avec lui sa fortune. Il lui procure à la fois deux sources de richesses : de l’industrie et des capitaux. Cela vaut des champs ajoutés à son territoire ; sans parler d’un accroissement de population précieuse quand il apporte en même temps de l’affection et des vertus.
« À l’avènement de Fréderic Guillaume à la régence, dit le roi de Prusse dans son Histoire de Brandebourg [40] , on ne faisait dans ce pays ni chapeaux, ni bas, ni serges, ni aucune étoffe de laine. L’industrie des Français nous enrichit de toutes ces manufactures. Ils établirent des fabriques de draps, d’étamines, de petites étoffes, de bonnets, de bas tissus au métier ; des chapeaux de castor, de poil de lapin et de lièvre ; des teintures de toute espèce. quelques-uns de ces réfugiés se firent marchands, et débitèrent en détail l’industrie des autres. Berlin eut des orfèvres, des bijoutiers, des horlogers, des sculpteurs ; et les Français qui s’établirent dans le plat pays y cultivèrent le tabac, et firent venir des fruits excellents dans des contrées sablonneuses qui par leurs soins devinrent des potagers admirables ».
Mais si l’expatriation accompagnée d’industrie, de capitaux et d’affection est un pur gain pour la patrie adoptive, nulle perte n’est plus sèche et plus complète pour la patrie abandonnée [41] .
Et qu’on ne croie pas que des lois coercitives puissent prévenir ce malheur. On ne retient point un concitoyen par force, à moins de le mettre en prison. On retient encore moins sa fortune mobilière s’il veut la faire sortir. Sans parler de la fraude qu’il est souvent impossible d’empêcher, ne peut-il pas convertir son avoir en marchandises dont la sortie est tolérée, encouragée, et les adresser, ou les faire adresser au-dehors ? Cette exportation n’est-elle pas une perte réelle de valeur ? Quel moyen un gouvernement a-t-il pour deviner qu’elle n’entraînera point de retour ? La meilleure manière de retenir les hommes et de les attirer, c’est d’être juste et bon envers tous, et d’assurer à tous la jouissance des droits qu’ils regardent comme les plus précieux : la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens, la faculté d’aller, de venir, de rester, de parler, de lire et d’écrire avec une entière sûreté.
[I-191]
CHAPITRE XXVII.
Des compagnies et principalement de celles qui ont des privilèges exclusifs.↩
Lorsqu’une entreprise commerciale exige des capitaux qui excèdent les facultés d’un seul particulier, alors plusieurs particuliers se réunissent, et forment entre eux un capital suffisant pour faire aller l’entreprise. On se partage ensuite les produits en proportion des fonds qu’on a avancés, ou, si l’on veut, des actions qu’on a prises.
J’ai principalement en vue les associations en commandite [42] , les autres n’entraînant pas d’autres effets que les entreprises individuelles.
Au moyen des compagnies, une nation peut étendre son commerce dans des lieux qui lui seraient demeurés étrangers. Mais on aurait tort de croire que ce soit toujours, et incontestablement, un avantage pour un pays d’acquérir un nouveau commerce. Tel commerce peut procurer des gains à un négociant, à une compagnie, et occasionner des pertes à la nation, ainsi qu’on le verra tout à l’heure. Tel genre d’entreprises peut convenir à une nation et ne point convenir à une autre. Smith a prouvé [43] que le commerce des Indes, par exemple, était préjudiciable à la Suède et au Danemark, dont l’industrie intérieure est languissante faute de capitaux, et que les compagnies des Indes établies dans ces pays, en attirant une partie des capitaux vers ces spéculations lointaines qui les occupent plusieurs années, causent à cet État un dommage que les profits qu’elles donnent sont bien loin de couvrir. En général, de tous les capitaux, ceux qui sont le plus mal employés pour les intérêts d’une nation, sont ceux qui se trouvent engagés dans un commerce lointain. Dans un tel commerce, une seule affaire occupe une portion de capital pendant trois ou quatre ans. Dans un commerce rapproché et dans le même espace de temps, le même capital servirait à terminer six, huit, dix affaires et même davantage, et mettrait par conséquent en activité beaucoup plus d’industrie. D’ailleurs les capitaux, c’est-à-dire les richesses nationales, sont bien plus hasardés dans les entreprises lointaines, où l’on est si souvent dupe des hommes et des éléments.
Il ne faut pas non plus s’imaginer légèrement qu’un certain commerce ne puisse absolument être fait que par une compagnie ; cela a été dit bien souvent de celui de l’Inde, et cependant plus d’un siècle durant, les Portugais l’ont fait sans compagnie, avec plus de succès qu’aucune autre nation.
D’un autre côté il n’est pas du tout nécessaire, ainsi que nous l’avons déjà vu (chapitres 7 et 12), que les capitaux dont on a besoin pour cultiver une branche d’industrie se trouvent mis en œuvre par des personnes unies d’intérêt. Outre qu’une maison de commerce estimée dispose, par son seul crédit, de sommes qui surpassent dix fois son avoir, des négociants libres peuvent se partager naturellement les fonctions d’un commerce étendu. Les uns vont s’établir aux Indes, et rassemblent pour la saison du départ les marchandises dont on sait que les armateurs d’Europe s’accommoderont ; d’autres négociants, en Europe, achètent les cargaisons à leur arrivée, ou procurent les pacotilles pour de nouvelles expéditions. Chacun se voue à la partie qui convient à son caractère, à ses talents, à sa fortune ; et quand un commerce est ainsi abandonné à lui-même, on peut être assuré qu’il ne s’en fait que ce qui convient à la situation actuelle, aux circonstances politiques, aux capitaux de la nation et des particuliers.
Mais quand des faveurs spéciales, et des faveurs toujours accordées aux dépens du public, engagent une certaine masse de capitaux et d’industrie à se diriger d’un côté où ils ne seraient point allés sans cela, dès lors il y a des inconvénients à redouter ; et notamment celui de déterminer une direction de capitaux et d’industrie qui n’est pas la plus favorable, puisqu’elle a eu besoin de cet encouragement.
Ce n’est pas tout :
Quelquefois le gouvernement, séduit par les bénéfices que les compagnies promettent, veut y être intéressé ; et comme un gouvernement est le plus mauvais de tous les commerçants, il y dissipe les fonds du Trésor public loin de les accroître, fait échouer l’entreprise seulement pour avoir voulu s’en mêler, et finit par ruiner ses associés.
D’autres fois la compagnie, faisant envisager au gouvernement l’avantage qu’elle retirera d’un certain commerce, comme un avantage pour la nation, demande que la nation paie cet avantage en lui accordant un privilège exclusif.
L’intérêt personnel a fait valoir beaucoup de raisons en faveur des compagnies privilégiées.
Quand on veut commercer avec certains peuples, il y a des précautions à prendre, qui ne peuvent être bien prises, diton, que par des compagnies. Tantôt ce sont des forts, une marine à entretenir ; mais faut-il faire le commerce à main armée ? et dans cette supposition, les forces nationales ne sont-elles pas destinées à protéger le commerce national ? Tantôt ce sont des ménagements diplomatiques à avoir. Les Chinois, par exemple, sont un peuple si attaché à de certaines formes, si soupçonneux, si indépendant des autres nations par l’éloignement, l’immensité de son empire et la nature de ses besoins, que ce n’est que par une faveur spéciale, et qu’il serait facile de perdre, qu’on peut trafiquer avec eux. Il faut nous passer de leur thé, de leurs soies, de leurs nankins, ou bien prendre les précautions qui seules peuvent continuer à nous les procurer. Or des relations particulières risqueraient de troubler l’harmonie nécessaire au commerce qui se fait entre les deux nations.
Ces motifs ne sont point sans force et méritent d’être soigneusement pesés, quand il s’agit d’accorder ou de refuser un privilège exclusif. Mais en même temps il convient d’observer qu’il y a peu de nations, qu’il n’y en a point peut-être à laquelle ce raisonnement puisse s’appliquer, si ce n’est la nation chinoise, la seule que je sache qui possède exclusivement des denrées devenues nécessaires pour nous. En second lieu, est-il bien sûr que les agents d’une compagnie, souvent très hautains et qui se sentent protégés par les forces militaires, soit de leur nation, soit de leur compagnie ; est-il bien sûr, dis-je, qu’ils soient plus propres à entretenir des relations de bonne amitié, que des particuliers nécessairement plus soumis aux lois des peuples qui les reçoivent, des particuliers à qui l’intérêt personnel interdit tout mauvais procédé à la suite duquel leurs biens et peut-être leurs personnes pourraient être exposés. Enfin, mettant les choses au pis, et supposant que sans une compagnie privilégiée le commerce de la Chine fût impossible, serait-on pour cela privé des produits de cette contrée ? Non, assurément. Le commerce des denrées de Chine se fera toujours, par la raison que ce commerce convient aux Chinois et à la nation qui le fera. Paierait-on ces denrées un prix extravagant ? on ne doit pas le supposer, quand on voit les trois-quarts des nations d’Europe qui n’envoient pas un seul vaisseau à la Chine, et qui n’en sont pas moins bien pourvues de thé, de soies et de nankin, à des prix fort raisonnables.
Un autre argument plus généralement applicable, et dont on a tiré plus de parti, est celui-ci : Une compagnie achetant seule dans les pays dont elle a le commerce exclusif, n’y établit point de concurrence d’acheteurs, et par conséquent en obtient les données à meilleur marché.
D’abord il n’est pas exact de dire que le privilège écarte toute concurrence. Il écarte à la vérité la concurrence des négociants nationaux, qui serait fort utile à la nation ; mais il n’exclut pas du même commerce les compagnies privilégiées, ni les négociants libres des autres États.
En second lieu, il est beaucoup de denrées dont les prix n’augmenteraient pas en raison de la concurrence qu’on affecte de redouter, et qui au fond est assez peu de chose.
S’il partait de Marseille, de Bordeaux, de l’Orient, des vaisseaux pour aller acheter du thé à la Chine, il ne faut pas croire que les armateurs de tous ces navires réunis achetassent plus de thé que nous n’en avons besoin ; ils auraient trop de peur de ne pouvoir s’en défaire. Or, s’ils n’en achètent pour nous que ce qui s’en achète pour nous par d’autres négociants, le débit du thé en Chine n’en sera pas augmenté : cette denrée n’y deviendra pas plus rare. Pour que nos négociants le payassent plus cher, il faudrait qu’il renchérît pour les Chinois eux-mêmes ; et dans un pays où il se vend mille fois plus de thé que n’en consomment tous les Européens ensemble, ce ne serait pas l’enchère de quelques négociants de France qui en ferait monter sensiblement le prix.
Il est à la vérité dans l’Orient, qui nous sert en ce moment d’exemple, des sortes de marchandises que la concurrence européenne pourrait faire renchérir ; mais pourquoi serait-ce un motif d’intervertir, à l’égard de ces contrées seulement, les règles que l’on suit partout ailleurs ? Afin de payer moins cher aux Allemands les quincailleries et les merceries que nous leur achetons, donne-t-on à une compagnie le privilège exclusif d’aller les acheter en Allemagne et de les revendre parmi nous ?
Si l’on suivait avec l’Orient la marche qu’on suit avec toutes les autres contrées étrangères, le prix de certaines marchandises n’y resterait pas longtemps au-dessus du taux où les portent naturellement les frais de leur production ; car ce prix trop élevé exciterait à les produire, et la concurrence des vendeurs se mettrait bien vite au niveau de celle des acheteurs.
Mais supposons que l’avantage d’acheter à bon marché fût aussi réel qu’on le représente, il faudrait du moins que la nation participât à ce bon prix, et que les consommateurs nationaux payassent moins cher ce que la compagnie paie moins cher. Or c’est exactement le contraire qui arrive, et la raison en est simple : la compagnie, qui n’est réellement pas débarrassée de concurrents dans ses achats, l’est effectivement dans ses ventes, puisque ses compatriotes ne peuvent acheter que d’elle les marchandises qui font l’objet de son commerce, et que les marchandises de même sorte qui pourraient être apportées par des négociants étrangers sont écartées par des droits très forts ou par une prohibition absolue. Elle est maîtresse des prix, surtout lorsqu’elle a soin, comme son intérêt l’y invite, de tenir le marché non complètement approvisionné, understocked, comme disent les Anglais ; de manière que la demande se trouvant un peu supérieure à la provision, la concurrence des acheteurs soutienne le prix de la marchandise.
C’est ainsi que les compagnies, non seulement font un gain usuraire sur le consommateur, mais qu’elles lui font encore payer les dégâts et les fraudes inévitables dans une si grande machine, gouvernée par des directeurs et des agents sans nombre, dispersés aux deux bouts de la terre. Le commerce interlope [44] et la contrebande peuvent seuls mettre des bornes aux énormes bénéfices des compagnies privilégiées ; et sous ce rapport, le commerce interlope et la contrebande ne sont pas sans quelqu’utilité, quoiqu’excessivement blâmables sous d’autres rapports.
Or ce gain, tel qu’il vient d’être analysé, est-il un gain pour la nation qui a une compagnie privilégiée ? Nullement. Il est en entier levé sur cette nation ; toute la valeur que le consommateur paie au-delà du prix où le commerce le plus libre porterait la marchandise, n’est plus une valeur produite ; c’est une valeur dont le gouvernement gratifie le commerçant, aux dépens du consommateur ; c’est une valeur qui passe de la poche d’un citoyen dans celle d’un autre.
Au moins, ajoutera-t-on peut-être, ce gain reste au sein de la nation, et s’y dépense. — Fort bien ; mais qui est-ce qui le dépense ? Cette question vaut la peine d’être faite. Si, dans une famille, un des membres s’emparait du principal revenu, se faisait faire les plus beaux habits, et mangeait les meilleurs morceaux, serait-il bien venu à dire aux autres individus de la même famille : Que vous importe que ce soit vous ou moi qui dépensions ? Au total, ne dépensons-nous pas le même revenu ? Tout cela revient au même ?...
Ce gain tout à la fois exclusif et usuraire procurerait aux compagnies privilégiées des richesses immenses, s’il était possible que leurs affaires fussent bien gérées ; mais la cupidité des agents, la longueur des entreprises, l’éloignement des comptables, l’incapacité des intéressés, sont pour elles des causes sans cesse agissantes de ruine. L’activité et la clairvoyance de l’intérêt personnel sont encore plus nécessaires dans les affaires longues et délicates que dans toutes les autres. Et quelle surveillance active et clairvoyante peuvent exercer des actionnaires qui sont quelquefois au nombre de plusieurs centaines, et qui ont presque tous des intérêts ou des plaisirs plus chers à soigner ? On se souvient qu’un des directeurs de la compagnie des Indes, demandant à La Bourdonnais comment il avait mieux fait ses affaires que celles de la compagnie, celui-ci répondit : C’est que je règle ce qui me concerne selon mes lumières, et que je suis obligé de suivre vos instructions pour ce qui concerne la compagnie.
Telles sont les suites des privilèges accordés aux compagnies commerçantes, et je vous prie de remarquer que ce sont des conséquences nécessaires, résultant de la nature de la chose, tellement que certaines circonstances peuvent les modifier, non les détruire. C’est ainsi que la compagnie anglaise des Indes n’a pas été si mal que les trois ou quatre compagnies françaises qu’on a essayé d’établir à différentes époques [45] . Elle est en même temps souveraine, et les plus détestables souverainetés peuvent subsister plusieurs siècles ; témoin celle des Mamelouks sur l’Égypte.
Quelques autres inconvénients d’un ordre inférieur marchent à la suite des industries privilégiées. Souvent un privilège exclusif fait fuir et transporte à l’étranger des capitaux et une industrie qui ne demandaient qu’à se fixer dans le pays.
Dans les derniers temps du règne de Louis XIV, la Compagnie des Indes ne pouvant se soutenir malgré son privilège exclusif, en céda l’exercice à quelques armateurs de Saint-Malo, moyennant une légère part dans leur bénéfice. Ce commerce commençait à se ranimer sous l’influence de la liberté, et l’année 1714, époque où expirait entièrement le privilège de la compagnie, lui aurait donné toute l’activité que comportait la triste situation de la France ; mais la compagnie sollicita une prolongation de privilège et l’obtint, tandis que des négociants avaient déjà commencé des expéditions pour leur compte. Un vaisseau marchand de Saint-Malo, commandé par un breton nommé Lamerville, arriva sur les côtes de France revenant de l’Inde. Il voulut entrer dans le port ; on lui dit qu’il n’en avait pas le droit, et que ce commerce n’était plus libre. Il fut contraint de poursuivre son chemin jusqu’au premier port de la Belgique. Il entra dans celui d’Ostende où il vendit sa cargaison. Le gouverneur de la Belgique, instruit du profit immense qu’il avait fait, proposa au même capitaine de retourner dans l’Inde avec des vaisseaux qu’on équiperait exprès. Lamerville fit en conséquence plusieurs voyages pour différents individus, et ce fut là l’origine de la compagnie d’Ostende [46] . Nous avons vu que les consommateurs ne pouvaient que perdre à ce monopole, et certainement ils y perdirent ; mais du moins les intéressés devaient y gagner ; ils y perdirent aussi, malgré le monopole du tabac et celui des loteries, et d’autres encore que le gouvernement leur accorda [47] .
« Enfin, dit Voltaire [48] , il n’est resté aux Français dans l’Inde que le regret d’avoir dépensé pendant plus de quarante ans des sommes immenses pour entretenir une compagnie qui n’a jamais fait le moindre profit, qui n’a jamais rien payé aux actionnaires ni à ses créanciers du produit de son négoce, et qui dans son administration indienne n’a subsisté que d’un secret brigandage. »
Le privilège exclusif d’une compagnie est justifiable quand il est l’unique moyen d’ouvrir un commerce tout neuf avec des peuples éloignés ou barbares. Il devient alors une espèce de brevet d’invention dont l’avantage couvre les risques d’une entreprise hasardeuse et les frais de première tentative ; les consommateurs ne peuvent pas se plaindre de la cherté des produits, qui seraient bien plus chers sans cela, puisqu’ils ne les auraient pas du tout. Mais, de même que les brevets d’invention, ce privilège ne doit durer que le temps nécessaire pour indemniser complètement les entrepreneurs de leurs avances et de leur risque. Passé ce terme, il ne serait plus qu’un don qu’on leur ferait gratuitement aux dépens de leurs concitoyens, qui ont reçu de la nature le droit de se procurer les denrées qui leur sont nécessaires où ils peuvent, et au plus bas prix possible.
On pourrait faire sur les privilèges relatifs aux manufactures à peu près les mêmes raisonnements que sur ceux relatifs au commerce. Ce qui fait que les gouvernements se laissent entraîner si facilement dans ces sortes de mesures, c’est d’une part qu’on leur présente le gain sans s’embarrasser de rechercher comment et par qui il est payé, et d’une autre part que ces prétendus gains peuvent être, bien ou mal, à tort ou à raison, appréciés par des calculs numériques ; tandis que l’inconvénient, tandis que la perte, affectant plusieurs parties du corps social et l’affectant d’une manière indirecte, compliquée et générale, échappe entièrement au calcul. On a dit qu’en économie politique il ne fallait s’en rapporter qu’aux chiffres. Quand je vois qu’il n’y a pas d’opération détestable qu’on n’ait soutenue et déterminée par des calculs arithmétiques, je croirais bien plutôt que ce sont les chiffres qui tuent les États. Ce sont eux bien évidemment qui ont accéléré la chute de l’ancienne monarchie française, et qui en entraîneront encore d’autres.
[I-208]
CHAPITRE XXVIII.
Du produit des colonies.↩
Les colonies sont des établissements formés dans des pays lointains par une nation plus ancienne, qu’on nomme la métropole. Quand cette nation veut étendre ses relations dans un pays populeux, déjà civilisé, et dont elle ne serait pas bien venue à envahir le territoire, elle se borne à y établir un comptoir, un lieu de négoce, où ses facteurs trafiquent conformément aux lois du pays, comme les Européens ont fait en Chine, au Japon. Quand les colonies secouent l’autorité du gouvernement de la métropole, elles cessent de porter le nom de colonies, et deviennent des États indépendants [49] .
Une nation fonde ordinairement des colonies quand sa nombreuse population se trouve à l’étroit dans son ancien territoire, et quand le caractère inquiet et entreprenant de ses citoyens excite les moins fortunés d’entre eux à chercher sous un autre ciel une subsistance plus facile. Ce motif paraît être celui qui portait les peuples anciens à fonder des colonies. Les peuples modernes en ont eu d’autres encore. L’art de la navigation, perfectionné dans leurs mains, leur a ouvert de nouvelles routes, leur a découvert des pays inconnus. Ils sont allés jusque dans un autre hémisphère, et sous des climats inhospitaliers, non pour s’y fixer eux et leur postérité, mais pour y recueillir des denrées précieuses, et rapporter dans leur patrie les fruits d’une production précipitée et considérable.
Il convient de remarquer ces motifs divers ; car ils entraînent deux systèmes coloniaux très différents dans leurs effets. Je serais tenté d’appeler le premier système colonial des anciens, et l’autre système colonial des modernes, quoique chez les anciens il y ait eu, à ce qu’il semble, quelques entreprises pareilles à celles qui ont eu tant d’éclat au XVIe siècle, telles que la navigation des Argonautes et quelques établissements formés par les Carthaginois ; et que chez les modernes il y ait eu des colonies fondées sur les mêmes principes que celles des anciens, notamment dans l’Amérique septentrionale.
La production dans les colonies formées suivant le système des anciens, n’est pas d’abord fort grande, mais elle s’accroît avec rapidité. On ne choisit guère de patrie adoptive que là où le sol est fertile et le climat favorable ; c’est pour l’ordinaire un pays tout neuf, soit qu’auparavant il fût complètement inhabité, soit qu’il n’eût pour habitants que des peuplades grossières, par conséquent peu nombreuses, et hors d’état d’épuiser les facultés productives du sol. Un peuple plus avancé aurait produit beaucoup, se serait multiplié en proportion, et l’on n’aurait pas aisément envahi son territoire.
Des familles élevées dans un pays civilisé qui vont s’établir dans un pays nouveau, y portent les connaissances théoriques et pratiques qui sont un des principaux éléments de l’industrie. Elles y portent l’habitude du travail par le moyen duquel ces facultés sont mises en œuvre, et l’habitude de la subordination si nécessaire au maintien de l’ordre social ; elles y portent quelques capitaux, non pas en argent, mais en outils, en provisions variées ; enfin elles ne partagent avec aucun propriétaire les fruits d’un terrain vierge dont l’étendue surpasse pendant longtemps ce qu’elles sont en état de cultiver. À ces causes de prospérité, on doit ajouter peut-être la plus grande de toutes, c’est-à-dire le désir qu’ont tous les hommes d’améliorer leur condition, et de rendre le plus heureux possible le sort qu’ils ont définitivement embrassé.
L’accroissement des produits, quelque rapide qu’il ait paru dans toutes les colonies fondées sur ce principe, aurait été plus remarquable encore, si les colons avaient porté avec eux de vastes capitaux ; mais, nous l’avons déjà observé, ce ne sont pas les familles favorisées de la fortune qui s’expatrient : il est rare que les hommes qui sont en état de disposer d’un capital suffisant pour vivre avec quelques douceurs dans le pays où ils sont nés, et où ils ont passé les années de leur enfance qui l’embellissent tant à leurs yeux, renoncent à leurs habitudes, à leurs amis, à leurs parents, pour courir les chances toujours incertaines, et supporter les rigueurs toujours inévitables d’un établissement nouveau. Voilà pourquoi les colonies, dans leurs commencements, manquent de capitaux, et en partie pourquoi l’intérêt de l’argent y est si élevé.
À la vérité les capitaux s’y forment plus vite que dans les États anciennement civilisés. Il semble que les colons, en quittant leur pays natal, y laissent une partie de leurs vices. Ils renoncent au faste, à ce faste qui coûte si cher dans notre Europe, et qui sert si peu. Là où ils vont, on est forcé de ne plus estimer que les qualités utiles, et l’on ne consomme plus que ce qu’il faut pour vivre. Or la consommation nécessaire pour vivre et même pour bien vivre, n’est pas si considérable qu’on le croit. Ils ont peu de villes, et surtout n’en ont point de grandes ; la vie agricole qu’ils sont en général contraints de mener est la plus économique de toutes ; enfin leur industrie est proportionnellement la plus productive et celle qui exige le moins de capitaux [50] .
Le gouvernement de la colonie participe aux qualités qui distinguent les particuliers. Il s’occupe de son affaire, dissipe fort peu, et ne cherche querelle à personne ; aussi les contributions y sont-elles très faibles, quelquefois nulles, et prenant peu de chose ou rien sur les revenus des administrés, leur permettent d’autant mieux de croître en prospérité. C’est ainsi que, même avec peu de capitaux, les produits annuels des colonies excèdent de beaucoup leurs consommations. De là cet accroissement rapide de richesses et de population qu’on y remarque. Car à mesure qu’il se forme des capitaux, le travail industriel de l’homme y devient recherché ; et l’on sait que les hommes naissent partout où il en est besoin [51] .
On peut maintenant s’expliquer pourquoi les progrès des colonies grecques furent si rapides. Éphèse et Milet dans l’Asie mineure, Tarente en Italie, Syracuse et Agrigente en Sicile, paraissent avoir surpassé en peu de temps leurs métropoles. Les colonies anglaises de l’Amérique septentrionale, qui dans nos temps modernes ressemblent le plus aux colonies des Grecs, ont offert un spectacle de prospérité peut-être moins éclatant, mais non moins digne de remarque.
Je passe aux colonies formées suivant le système colonial des modernes.
Ceux qui les fondèrent furent pour la plupart des aventuriers qui cherchèrent, non une patrie adoptive, mais une fortune qu’ils pussent rapporter, pour en jouir dans leur ancien pays [52] .
Les premiers d’entre eux trouvèrent d’un côté aux Antilles, au Mexique, au Pérou et plus tard au Brésil, et d’un autre côté aux Indes orientales, de quoi satisfaire leur cupidité toute grande qu’elle était. Ceux qui leur ont succédé ont trouvé moins d’or et d’argent, mais ils se sont aperçu que le sol de plusieurs colonies était susceptible de produire beaucoup d’autres denrées précieuses et moins susceptibles de s’épuiser, telles que le sucre, l’indigo, le coton, le café, etc. Ces derniers venus ont un peu participé au génie de leurs prédécesseurs ; cependant les progrès de la civilisation européenne et l’autorité des gouvernements de leurs métropoles ont jusqu’à un certain point régularisé l’action de leur industrie. La propriété des terres y a été consacrée ; de grands capitaux sont devenus nécessaires pour leur exploitation ; mais toujours ils ont conservé plus ou moins l’esprit de retour, le désir, non de vivre dans l’aisance sur leurs terres et d’y laisser en mourant une famille heureuse et une réputation sans tache, mais le désir d’y gagner beaucoup pour aller jouir ailleurs de leurs immenses profits ; ce motif y a introduit des moyens violents d’exploitation, au premier rang desquels il faut placer l’esclavage.
Quel est l’effet de l’esclavage relativement à la production ?
Je ne doute aucunement qu’il ne l’augmente beaucoup, ou du moins que dans le travail de l’esclave, l’excédent des produits sur les consommations ne soit plus grand que dans le travail de l’homme libre. Le travail du premier n’a de bornes que le pouvoir de ses facultés ; le maître ou son commandeur ont soin qu’il fasse autant d’ouvrage qu’il peut en faire sans dépérir sensiblement. Le travail de l’homme libre a pour bornes ses facultés aussi, et, de plus, sa volonté. C’est en vain qu’on dirait que sa volonté est toujours de travailler le plus possible pour gagner le plus possible ; on sait trop qu’il n’en va pas ainsi, et que l’amour du gain est souvent subordonné à celui de la paresse et de la dissipation. L’homme libre a souvent peu de besoins pour le présent et peu de prévoyance pour l’avenir, et il ne regarde pas comme nécessaire de travailler au-delà de ce que réclament cette prévoyance et ces besoins. L’esclave travaille pour un besoin illimité : la cupidité de son maître ; et l’indolence de celui-ci, son amour pour les plaisirs ne font qu’aggraver son labeur.
L’entretien de l’esclave est aussi chétif que ses fatigues sont grandes [53] . Peu importe à son maître qu’il jouisse de la vie ; il lui suffit qu’il la conserve. Aux Antilles, un pantalon et une chemise ou un gilet, composent toute la garderobe d’un nègre ; son logement est une case sans aucun meuble ; sa nourriture, du manioc, auquel on ajoute de temps en temps, chez les bons maîtres, un peu de morue sèche.
Une population d’ouvriers libres prise en bloc est obligée d’entretenir des femmes, des enfants, des infirmes. Les liens de la parenté, de l’amitié, de l’amour, de la reconnaissance, y multiplient les consommations. Chez les esclaves, les consommations sont réglées par l’intérêt personnel ; on est ingénieux à supprimer, ou du moins à beaucoup réduire celles dont il ne résulte aucun profit. Les fatigues de l’esclave homme mûr affranchissent trop souvent le planteur de l’entretien du vieillard esclave. Les femmes, les enfants y jouissent peu des privilèges de leur faiblesse, et le doux penchant qui réunit les sexes y est soumis aux calculs d’un maître.
Ces considérations générales reçoivent une nouvelle force des résultats de l’expérience.
L’entretien annuel d’un nègre des Antilles, dans les habitations où ils sont tenus avec le plus d’humanité, ne revient pas à plus de 300 fr. ; joignons-y l’intérêt de son prix d’achat, et portons cet intérêt à dix pour cent, parce qu’il est viager. Le prix d’un nègre ordinaire étant de 2 000 fr. environ, l’intérêt sera de 200 liv. calculé au plus haut. Ainsi on peut estimer que chaque nègre coûte par an à son maître 500 francs. Maintenant comparons cette consommation annuelle d’un nègre, avec celle d’un manouvrier libre dans les mêmes colonies. Les plus grossiers, c’est-à-dire ceux dont la capacité n’est pas supérieure à celle du nègre esclave, se font payer leur journée sur le pied de cinq, six, sept francs, et quelquefois davantage. Prenons six francs pour terme moyen, et ne comptons que trois cents jours ouvrables dans l’année ; cela donnera, pour la somme de leurs gains annuels, 1 800 fr. En Europe, le salaire de la classe purement manouvrière excède de fort peu ses consommations : on en verra les raisons plus loin. Aux îles, où il y a moins de concurrence entre les manouvriers, accordons que leur consommation reste fort en arrière de leurs gains, et qu’un simple manouvrier qui a de la conduite mette tous les ans 800 fr. de côté. Il restera pour le montant de sa consommation 1 000 fr. ; et les gens qui ont habité les îles conviendront qu’il ne peut guère vivre à moins. Nous avons vu que celle d’un esclave ne va qu’à 500 fr.
Ainsi, en supposant que le travail forcé et constant de l’esclave ne produise rien de plus que celui du simple manouvrier, ce qui, je crois, est une supposition modérée, il résulterait toujours du rapprochement qui précède, que l’excédent du produit du travail d’un esclave sur sa consommation, surpasse de 500 fr. l’excédent du produit du travail d’un homme libre sur sa consommation.
L’expérience et le raisonnement se prêtent comme on voit un appui mutuel pour établir cette vérité. Comment est-il donc arrivé que Steuart, Turgot et Smith, se soient réunis pour affirmer que le travail de l’esclave revenait plus cher que celui de l’homme libre ? J’avoue que quand j’ai vu trois hommes aussi habiles soutenir cette opinion, je me suis fort défié de la mienne ; et dans ce moment même, je soumets l’une et l’autre au lecteur. Les raisonnements de ces trois auteurs se réduisent à ceci : un homme qui ne travaille pas et ne consomme pas pour son propre compte, travaille le moins et consomme le plus qu’il peut ; il n’a aucun intérêt à mettre dans ses travaux l’intelligence et le soin qui peuvent en assurer le succès ; le travail excessif dont on le surcharge abrège ses jours et oblige son maître à des remplacements coûteux ; enfin le serviteur libre a l’administration de son propre entretien, tandis que le maître a l’administration de l’entretien de son esclave ; et comme il est impossible que le maître administre avec autant d’économie que le serviteur libre, le service de l’esclave doit lui revenir plus cher [54] .
Je réponds qu’on peut s’en rapporter aux planteurs du soin d’employer à profit les facultés de leurs esclaves ; ils ont des surveillants très actifs, et s’il y a quelqu’abus sur ce point, c’est plutôt dans l’excès que dans le défaut du travail. L’esclave à la vérité n’est pas ingénieux dans le choix des méthodes qui perfectionnent et multiplient les produits ; mais on n’a pas besoin qu’il le soit ; cette partie de l’industrie est le fait du chef d’entreprise, et ce n’est que pour le travail manuel qu’on a besoin de l’esclave [55] . Si un excès de cupidité ou si la fureur et l’opiniâtreté d’un maître sont quelquefois cause de la mort prématurée de l’esclave, on peut dire qu’en général les planteurs entendent trop bien leurs intérêts pour s’exposer souvent à des pertes de ce genre ; ils tirent de l’esclave un travail forcé en ce qu’il excède pour l’ordinaire celui qu’il ferait s’il travaillait pour son propre compte ; mais ils sont intéressés à ne point pousser ce travail au point de détruire ses facultés et d’abréger ses jours, du moins les jours de son âge viril. Quant aux morts naturelles, elles se calculent ; et leur remplacement fait partie des dépenses annuelles de l’habitation, de même que le remplacement des outils et des machines ; et dans mon calcul j’en ai tenu compte, en mettant au rang des frais d’entretien de l’esclave, l’intérêt viager de son prix d’achat. Si en thèse générale les affaires particulières d’un serviteur sont mieux gérées par lui-même que par son maître, ce principe n’est point applicable ici. Quel est le motif qui balance, dans chaque personne, le penchant à satisfaire ses besoins et ses goûts ? C’est sans doute le soin de ménager ses ressources. Les besoins portent à étendre la consommation : l’économie tend à la réduire ; et, quand ces deux motifs agissent dans le même individu, on conçoit que l’un soit capable de servir de contrepoids à l’autre. Mais entre le maître et l’esclave la balance doit nécessairement pencher du côté de l’éco 543.nomie : les besoins, les désirs sont du côté du plus faible ; les raisons d’économie sont du côté du plus fort. Celui qui décide des consommations n’est jamais (dans ce qui regarde l’entretien de l’esclave) dominé par ses goûts : il l’est toujours par son intérêt. Écoutez les colons des îles : ils sont unanimement d’avis que la liberté des nègres rend leur travail beaucoup moins assidu et leurs consommations bien plus coûteuses. L’opiniâtreté seule qu’ils mettent à défendre l’esclavage, prouve contre l’opinion de Steuart, de Turgot et de Smith, contre une opinion que l’humanité paraît avoir inspirée à ces hommes respectables, et qu’ils ont voulu justifier par le raisonnement. Les colons seraient-ils si invinciblement attachés à cet ordre de choses, si l’expérience, si l’instinct ne leur disaient pas que leurs profits diminueraient et que leurs dépenses augmenteraient à le changer ? Il était reconnu à Saint-Domingue que le produit net d’une plantation payait en six années son prix d’achat ; tandis qu’en Europe le produit net n’est guère que le 25e, le 30e du prix d’achat, et quelquefois moins. Smith lui-même, dans un autre endroit, rapporte que les colons des îles anglaises conviennent que le rhum et la mélasse suffisent pour payer tous les frais d’une sucrerie, et que le sucre est tout profit. C’est, dit-il, comme si nos fermiers d’Europe payaient leurs dépenses et leurs fermages avec la paille seule, et que le grain tout entier formât le bénéfice net. Y a-t-il, je le demande, beaucoup de produits qui excèdent autant les frais de production ?
Je crois donc pouvoir affirmer que le travail de l’esclave est moins coûteux que celui de l’homme libre ; je crois pouvoir affirmer de même qu’il est plus productif, pourvu qu’il soit dirigé par des hommes libres. C’est là qu’est la source des gros profits des habitants des Antilles ; ils savent très bien ce qu’ils font, quand ils soutiennent que leurs îles ne peuvent être cultivées que par des esclaves ; cela veut dire que les terres ne peuvent y rendre de quinze à dix-huit pour cent de leur prix que par ce moyen. Il reste à savoir si l’avantage de procurer à quelques particuliers dix-huit pour cent par an de leurs fonds, suffit pour autoriser le plus infâme commerce dont les hommes se soient jamais avisés, celui de leurs semblables. C’est en faveur de ce profit qu’on prive un million d’hommes du privilège inappréciable de suivre leurs penchants et d’user à leur choix de leurs facultés naturelles, et qu’on réduit leurs consommations au-dessous de ce qu’elles devraient être pour assurer leur bonheur. La nourriture du nègre n’est ni assez abondante, ni assez variée, son logement, son coucher sont dépourvus de toute recherche ; il est privé des communes douceurs de la vie ; il éprouve le dénuement du sauvage sans jouir de son loisir, et il est exposé à plus de fatigues encore que l’homme civilisé, sans avoir part à ses jouissances. Telle est la vie qu’on lui fait acheter par les rigueurs d’un passage de mer dont les détails font frémir. C’est le chemin de l’Averne qui conduit aux enfers.
Je sais que si les profits des planteurs étaient moins considérables, il en est peu qui voulussent braver un climat incommode, insalubre même, et s’expatrier pour nous procurer du sucre, du café et de l’indigo. Je sais que les îles deviendraient ce qu’elles seront inévitablement un jour, des colonies pareilles à celles des anciens, de véritables patries adoptives, où l’on n’irait plus pour faire une fortune, mais pour y vivre, y élever sa famille et y mourir. Alors peut-être on ne les choisirait qu’à défaut de climats plus favorables ; alors peut-être on leur ferait produire beaucoup plus les denrées nécessaires à leur propre consommation, que les denrées qu’on appelle maintenant coloniales.
Manquerions-nous de sucre pour cela ? Je ne le pense pas. Le sucre et la plupart des autres denrées coloniales croissent beaucoup plus près de nous, sur les côtes d’Afrique, en Égypte et même dans le midi de l’Europe. Les paierions-nous plus cher ? Je ne le pense pas. L’économie qui résulte du travail de l’esclave entre dans la poche du planteur en vertu du privilège à peu près exclusif qu’il a de vendre à la métropole ; le consommateur n’en profite pas, et il aurait les mêmes denrées à meilleur marché, dût-il les tirer de plus loin, si le commerce en était libre. Il paraît que les Anglais commencent à apporter du sucre de l’Inde, et qu’il leur revient à meilleur marché que celui d’Amérique. Suivant mon respectable compatriote Poivre [56] , qui, comme on sait, a vu par lui-même et voyait bien, le sucre blanc de première qualité se vend à la Cochinchine à raison de 3 piastres, ou 15 francs de notre monnaie le quintal cochin-chinois, qui équivaut à 150 de nos livres, poids de marc ; ce qui fait 1 décime (ou 2 sous) la livre pris sur les lieux. À ce prix la Chine en tire plus de quarante mille tonneaux toutes les années. En supposant qu’il fallût y ajouter 400 pour cent pour les frais et les bénéfices du commerce qui nous apporterait ce sucre, ce qui assurément est bien honnête, il ne nous reviendrait qu’à 5 décimes (10 sous) la livre.
Les gouvernements ne peuvent manquer de sentir tôt ou tard, que c’est une sottise, même dans leurs intérêts actuels [57] , d’enrichir quelques particuliers aux dépens d’une nation, de laquelle après tout ils tirent leurs revenus, et d’appeler cela favoriser le commerce. Alors on pourra acheter des denrées coloniales où l’on voudra, et peut-être les achètera-t-on partout ailleurs qu’aux Antilles. C’est ce qui m’a fait dire, il y a peu d’instants, que les Antilles deviendraient tôt ou tard des colonies formées suivant le système des anciens. Ce sera un grand bonheur pour leurs métropoles et pour les nègres de la côte d’Afrique.
Il me semble que les anciens seuls ont bien entendu le principe de la colonisation. Les Grecs, les Romains se faisaient, par leurs colonies, des amis par tout le monde alors connu ; les peuples modernes n’ont su s’y faire que des sujets, c’est-à-dire des ennemis. Les gouverneurs envoyés par la métropole ne regardant pas le pays qu’ils administrent comme celui où ils doivent passer leur vie entière, goûter le repos et jouir de la considération publique, n’ont aucun intérêt à y faire germer le bonheur et la vraie richesse. Ils savent qu’ils seront considérés dans la métropole en proportion de la fortune qu’ils y rapporteront, et non en raison de la conduite qu’ils auront tenue dans la colonie. Qu’on y ajoute le pouvoir presque discrétionnaire qu’on est obligé d’accorder à qui va gouverner à de grandes distances, et l’on aura tous les principes dont se composent en général les plus mauvaises administrations.
[I-230]
CHAPITRE XXIX.
Du commerce colonial et de ses produits.↩
L’éloignement des colonies, la difficulté de communiquer avec elles, et les longueurs de cette communication, doivent les faire considérer, par rapport aux productions et aux relations commerciales, sous le même point de vue que des pays étrangers ; mais l’autorité que le gouvernement de la métropole y exerce en fait des pays étrangers dont la législation est aussi favorable qu’on veut à la métropole.
Les colonies sont ordinairement un sujet de très fortes dépenses pour les gouvernements ; car indépendamment de leur administration civile et judiciaire, leur défense oblige, dans le système politique des modernes, à construire des forts, à les garnir de troupes, et surtout à entretenir une marine nombreuse et formidable. Les contributions payées par la colonie ne suffisent point pour couvrir ces frais ; il y a communément un gros excédent que le peuple de la métropole paie en augmentation d’impôts.
Il s’agit de savoir si les gains que fait le peuple de la métropole, à cause de la colonie, valent plus que ce qu’elle lui coûte [58] .
Et d’abord remarquons que la métropole ferait des gains avec la colonie, quand même celle-ci ne serait qu’une nation purement étrangère. De sorte qu’il ne faut pas comparer ce que la colonie coûte avec les gains qu’on fait avec elle ; mais seulement avec la portion de ces gains qu’on ne ferait pas si la colonie était étrangère. En d’autres termes, il faut comparer ce qu’elle coûte, avec les seuls avantages qu’on retire de l’influence qu’on exerce sur elle.
Que chaque nation fasse un tel calcul pour ce qui la concerne, et elle verra si elle gagne ou si elle perd à garder ses colonies.
Lorsque Poivre fut nommé intendant de l’ÎledeFrance, cette colonie était fondée depuis cinquante ans seulement, et il se convainquit que sa conservation avait déjà coûté à la France 60 millions, continuait de lui occasionner de grandes dépenses, et ne lui rapportait absolument rien [59] .
Il est vrai que les sacrifices qu’on avait faits alors, et qu’on a faits depuis pour conserver l’Ile-de-France, avaient aussi pour but de conserver les établissements des Indes orientales ; mais quand on saura que ceux-ci ont coûté encore bien davantage, soit au gouvernement, soit aux actionnaires de l’ancienne et de la nouvelle compagnie, alors on sera forcé de conclure qu’on a payé cher à l’Ile-de-France l’avantage de faire de grosses pertes au Bengale et au Coromandel.
On peut appliquer le même raisonnement aux positions purement militaires qu’on a prises dans les trois autres parties du monde. En effet, si l’on prétendait que tel établissement a été conservé à grands frais, non pour en tirer du profit, mais pour étendre et assurer la puissance de la métropole, on peut de même répondre : cette puissance n’est utile que pour assurer la possession des colonies ; et si les colonies elles-mêmes ne sont pas un avantage, pourquoi en achèterait-on si chèrement la conservation ?
Dans tout ce qui vient d’être dit, on a supposé que les avantages du commerce colonial sont aussi grands qu’on se plaît à les représenter. Examinons maintenant en quoi ils consistent véritablement pour une nation.
Le pouvoir que la métropole exerce sur les colons les oblige à ne vendre leurs denrées qu’à elle, c’est-à-dire à meilleur marché, et à n’acheter que d’elle ce qu’ils achètent, c’est-à-dire à le payer plus cher. C’est tout simplement un monopole, soit pour la vente, soit pour l’achat, en faveur de la métropole, au préjudice des colons. C’est un impôt mis sur la colonie pour en gratifier les négociants de la métropole ; et comme les uns et les autres sont également sujets de la même puissance, c’est tirer de l’argent d’une partie de la nation pour le donner à l’autre.
Remarquez que je dis que ce sont les seuls négociants, et non les consommateurs de la métropole, qui profitent du prix auquel les colons sont obligés de livrer leurs denrées. Si les colons ne peuvent vendre qu’aux négociants de la métropole, ceux-ci peuvent revendre des denrées coloniales à tous ceux qui veulent en acheter, nationaux ou étrangers. Les prix auxquels les négociants achètent, sont réduits en vertu du privilège qu’ils ont d’acheter seuls ; les prix auxquels les consommateurs achètent, ne sont réduits par rien : ils vont aussi loin que la concurrence les porte. Le consommateur paie les denrées coloniales tout aussi cher ; mais le colon les vend moins bien.
Si l’on défendait aux propriétaires des premiers crus de Bordeaux de vendre leurs vins à d’autres qu’à des Français, qu’arriverait-il ? Que la concurrence des acheteurs venant à diminuer, ils seraient contraints de vendre sur le pied de 2 francs, peut-être, une bouteille qu’ils vendent 3 francs. Les négociants français qui l’achèteraient, la revendraient, soit aux étrangers, soit aux nationaux, 3 francs, que je suppose être le prix établi par la concurrence générale des acheteurs ; par conséquent ces négociants mettraient dans leur poche un tiers de la valeur totale, lequel serait arraché aux propriétaires cultivateurs. Il en résulterait un gain pour les négociants, mais non pas un gain pour la nation ; car ce même tiers de bénéfice aurait été fait par les propriétaires, s’il ne l’avait été par le négociant. Cette mesure, si on l’adoptait, n’aurait rien de plus ridicule que le système que suivent la plupart des États d’Europe relativement à leurs colonies. Elle est même plus raisonnable ; car si elle empêchait que les cultivateurs bordelais ne pussent vendre leurs vins ce qu’ils valent, elle ferait au moins jouir quelques consommateurs français qui s’approvisionneraient directement, du monopole d’achat attribué aux Français ; tandis qu’il est impossible au consommateur de sucre et d’indigo d’éviter de passer par les mains du négociant en denrées coloniales.
Le monopole de la vente produit un effet exactement pareil à celui de l’achat ; il produit une hausse dans le prix des marchandises européennes aux colonies, hausse qui est tirée de la poche d’un compatriote pour entrer dans celle d’un compatriote. Je sais bien que les colons qui supportent cette perte et la précédente, en sont bien dédommagés par des gains très forts sur leur culture, et dont j’ai fait voir la source dans le dernier chapitre ; je sais que les habitants des colonies et des ports de mer qui sont tour à tour, et souvent tout ensemble, planteurs et négociants, participent à ces gains tantôt sous une qualité, tantôt sous une autre : il en résulte que le commerce des colonies, tel qu’il est établi, est à la vérité très lucratif pour les négociants et les planteurs ; mais leurs gains n’en sont pas moins fondés en partie sur une perte supportée par la nation.
Tout ceci n’est applicable qu’aux temps ordinaires ; car en temps de troubles et de guerres, les prix sont encore bien plus tourmentés ; le consommateur paie non seulement pour le monopole, mais pour l’assurance des risques auxquels est exposé le commerçant, assurance qui se monte encore plus haut quand il est obligé de commercer frauduleusement.
Mais les gains que fait une nation avec ses colonies, fussent-ils aussi grands qu’ils le paraissent quand on ne calcule que les gains faits par les négociants, il resterait toujours le malheur d’acheter ces gains beaucoup plus qu’ils ne valent, par les frais qu’entraîne la conservation des colonies.
« Les habitants de Paris et de Londres, dit Franklin, paient leur sucre bien plus cher que les habitants de Vienne, encore que ceux-ci soient presqu’à trois cents lieues de la mer. Une livre de sucre coûte aux premiers, non seulement le prix qu’ils donnent pour l’avoir, mais aussi les impôts nécessaires pour soutenir les flottes et les armées destinées à défendre les pays qui les produisent [60] ».
Je suppose qu’on insiste et qu’on dise : les colonies fournissent de certaines denrées qui ne croissent que là. Si vous ne possédez aucun coin de ce territoire privilégié par la nature, vous serez à la merci de la nation qui s’en emparera ; elle aura la vente exclusive des produits coloniaux, et vous les fera payer ce qu’elle voudra.
J’ouvre le livre de l’expérience, et je n’y vois pas que les pays qui, comme l’Allemagne et l’Italie, ne possèdent point de colonies, paient les denrées coloniales plus cher que ne le comporte leur position géographique, c’est-à-dire qu’ils paient au-delà des frais qu’ils seraient obligés de supporter dans toutes les suppositions.
De tous les commerces coloniaux, le plus exclusif, sans contredit, est celui que les Hollandais ont fait de leurs épiceries. Ils possédaient seuls les seules îles qui en produisissent et n’en laissaient approcher personne. L’Europe a-t-elle manqué de ces produits ? Les a-t-elle payés au poids de l’or ? Devons-nous regretter de n’avoir pas acheté au prix de deux cents ans de guerres, de vingt batailles navales, de quelques centaines de millions, et du sang de cinq cent mille hommes, l’avantage de payer le poivre et le girofle quelques sous de moins ?
Il est bon d’observer que l’exemple que j’ai choisi est le plus favorable de tous au système colonial. Il est difficile de supposer que la fourniture du sucre, d’un produit qui croît dans la majeure partie de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique, pût être accaparée comme celle des épiceries. Et encore cette dernière même est-elle à la veille d’être enlevée à l’avidité des possesseurs des Moluques, sans coup férir !
On aurait tort de croire, au surplus, qu’une nation, comme la France, par exemple, qui déclarerait ses colonies indépendantes, les livrât par cela même à une autre puissance, telle, par exemple encore, que l’Angleterre. Ce serait supposer que la France, en renonçant au pouvoir militaire et civil dans ses colonies, perdrait toute influence dans la politique de l’Europe ; ce qu’on ne saurait soutenir, surtout lorsqu’on a vu qu’après avoir perdu de fait toutes ses colonies durant la dernière guerre, elle y est rentrée par le seul ascendant de son influence continentale. Elle peut donc toujours stipuler l’indépendance d’une nation aux Antilles, en Afrique, en Asie. Elle peut unir ses forces à celles de la nation coloniale. L’alliance d’une colonie avec sa métropole a tous les avantages de la dépendance sans en avoir les inconvénients ; et les liens naturels de parenté, de commerce, les habitudes communes, le langage pareil, sont un gage plus sûr de sa fidélité que la force elle-même. Croit-on qu’elle deviendrait toujours une proie facile pour l’ennemi ? N’avons-nous pas vu les îles de France et de la Réunion (indépendantes par le fait de la métropole) résister aux Anglais qui avaient tant d’intérêt à s’en emparer pour assurer leur route vers l’Orient, et leur résister sans recevoir aucun secours de la France ? Que dis-je ! leur résister ! les harceler et répandre l’effroi jusque vers l’embouchure du Gange ?
Les temps où nous vivons sont féconds en grands exemples. La perte que l’Angleterre a faite de ses colonies de l’Amérique septentrionale a été un gain pour elle. C’est un fait que je n’ai vu contesté nulle part. Or pour tenter de les conserver, elle a supporté pendant la guerre d’Amérique une dépense extraordinaire et inutile de plus de dix-huit cent millions de francs. Quel déplorable calcul ! Elle pouvait faire le même gain, c’est-à-dire rendre ses colonies indépendantes, ne pas dépenser un sou pour cela, épargner le sang de ses braves, et se donner aux yeux de l’Europe et de l’histoire les honneurs de la générosité.
[I-241]
CHAPITRE XXX.
Si le gouvernement doit prescrire la nature des productions.↩
Il n’est à vrai dire aucun acte du gouvernement qui n’ait quelqu’influence sur la production ; je me contenterai de parler dans ce chapitre et dans ceux qui le suivront, des actes qui ont pour but principal d’y influer, me réservant de parler des effets du système monétaire, des emprunts, des impôts, quand je traiterai de ces matières.
L’intérêt d’un gouvernement et d’une nation, en général, est de voir se multiplier les produits ; plus il s’en forme, et plus le gouvernement a de facilité pour lever des contributions, et par ce moyen pourvoir au bienêtre des citoyens, à la sûreté et à la gloire de l’État. Les épargnes annuelles sont plus considérables, les capitaux s’accroissent, l’industrie s’étend, et toutes les sources de prospérité deviennent plus abondantes.
Mais quelqu’intéressés que soient une nation et un gouvernement à la multiplication des produits, les particuliers, par le moyen desquels ces produits se multiplient, y sont encore plus immédiatement intéressés, puisque la raison et les lois établissent chez tous les peuples policés que chacun a la jouissance et la libre disposition des produits de son industrie, de ses capitaux ou de ses terres, ou au moins de la plus forte partie de ces produits.
Or, si tout particulier producteur est plus immédiatement, plus complètement intéressé à multiplier ses productions, et à moins de frais possibles, que sa nation ne peut l’être, l’autorité publique, qui stipule pour la nation en général, ne saurait mieux faire que de laisser à sa libre disposition le choix des productions et la manière de produire.
Que l’autorité publique ne dise pas : Nous avons moins besoin d’un grand produit que de tel produit. — Le produit le plus grand est toujours le meilleur. Le vin a beau être abondant et le blé rare, une valeur de cent francs en vin est toujours préférable à une valeur de cinquante francs en blé ; avec le premier de ces produits on pourra se procurer deux fois le second. Un gouvernement qui force à récolter pour 50 francs de blé, là où il serait venu pour 100 fr. de vin, n’obtient donc, même en blé, que la moitié de la quantité qu’il pouvait avoir, et diminue la masse générale des productions d’une valeur de 50 fr.
Mais, continuera-t-on, le blé étant rare et cher, l’espace où il serait venu pour cent francs de vin, produirait pour 300 francs de blé. En ce cas est-il besoin de donner l’ordre d’en semer ? Si cela doit être ainsi, le propriétaire, ou le fermier, est plus intéressé que personne à substituer la culture du blé à celle du vin. Si au contraire la valeur du blé qui viendra sur ce terrain doit être inférieure à celle du vin, il convient à l’État, quel que puisse être son besoin de blé, qu’il y vienne du vin ; puisqu’une valeur supérieure en vin lui procurera toujours une valeur inférieure en blé, dût-on l’aller chercher en Afrique.
peut-être que, tout en convenant que l’intérêt du producteur et l’intérêt de l’État sont les mêmes, puisque l’un et l’autre doivent désirer que le produit soit le plus grand possible, croira-t-on que l’État fait sagement de subvenir à l’ignorance du producteur, et de lui prescrire ce qu’il a à faire. Je ne sais, mais j’ai bien de la peine à croire que le gouvernement, occupé de vastes intérêts, et souvent trompé par ses agents, soit un meilleur arbitre de la capacité d’un terrain, que le propriétaire ou le fermier qui vit sur ce terrain, l’étudie, l’interroge, et qui est plus intéressé que qui que ce soit à en tirer le meilleur parti possible.
Ce qui est vrai par rapport à l’industrie agricole, l’est à plus forte raison par rapport aux deux autres, et surtout par rapport à l’industrie commerçante, qui se fonde toute entière sur les échanges et sur les comparaisons des valeurs diverses.
Le soin d’augmenter les valeurs des marchandises embrasse des considérations si nombreuses et si compliquées que ce n’est pas trop de toutes les connaissances du négociant, éclairées par l’intérêt personnel, pour démêler ce qui est vraiment productif dans cette industrie. Il est telle marchandise qui, après avoir causé une perte d’argent par son importation, procure en se réexportant un profit plus grand que cette perte.
Telles sont les marchandises de Chine pour l’Angleterre. L’Angleterre les fait venir au prix de beaucoup d’argent ; mais elle les revend avec de grands bénéfices et fait ainsi entrer chez elle plus d’argent qu’il n’en était sorti. Ses manufactures de Manchester ne lui donnent pas à proportion un si grand profit.
Cet avantage des importations de l’Asie est trop connu pour qu’on puisse croire que jamais les gouvernements européens les défendent ; mais il est d’autres importations dont les résultats sont du même genre, quoique moins évidents. Quelquefois ce n’est que très indirectement et après avoir subi plusieurs métamorphoses qu’un produit importé fait rentrer plus de valeurs qu’il n’en a fait sortir. Fénélon compare le commerce à certaines sources qu’on tarit lorsqu’on veut détourner leur cours.
Lorsque la Convention nationale mit des restrictions à l’entrée des cuirs bruts d’Espagne, sous prétexte qu’ils faisaient concurrence à nos cuirs bruts qu’on croyait et qui étaient en effet suffisants à notre consommation, elle ne fit pas attention que nous réexportions en Espagne des cuirs tannés en quantité à peu près égale à celle que nous en tirions en vert ; de sorte que cette mesure fit perdre à la France :
1°. Le profit du tannage, que la France faisait sans courir aucun risque.
2°. Le droit qu’on aurait pu mettre, soit à l’entrée des cuirs bruts, soit à la sortie des cuirs tannés, lequel droit, étant léger, n’aurait point anéanti ce commerce et aurait été supporté en totalité par le consommateur étranger.
3°. La France perdit enfin, et cette perte est déplorable, les ouvriers tanneurs dont l’industrie n’était plus suffisamment alimentée, et qui passèrent en Espagne pour y préparer, à moins de frais pour les Espagnols, les mêmes cuirs qu’ils préparaient en France ; ce qui nous a fait perdre, sans espoir de retour, et les profits pécuniaires de cette classe d’ouvriers, et la force politique résidant dans une portion de population industrieuse.
Les lois qui assujettissent l’industrie manufacturière à créer telle sorte de produits plutôt que telle autre, telle qualité de marchandise plutôt que telle autre, ne sont pas moins fâcheuses. Le législateur a d’autant plus de peine à s’en défendre, qu’elles sont toujours vivement sollicitées par l’intérêt personnel qui voudrait qu’on proscrivît toutes les industries qui entrent en concurrence avec celles qu’on exerce, et que les richesses publiques n’arrivassent point par d’autres portes que celles dont on a les clés.
Lorsqu’on commença à fabriquer des cotonnades en France, le commerce tout entier des villes d’Amiens, de Reims, de Beauvais, etc., se mit en réclamation, et représenta toute l’industrie de ces villes comme détruite. Il ne paraît pas cependant qu’elles soient moins industrieuses ni moins riches qu’elles ne l’étaient il y a un demi-siècle ; tandis que l’opulence de Rouen et de la Normandie a reçu un grand accroissement des manufactures de coton.
Ce fut bien pis quand la mode des toiles peintes vint à s’introduire : toutes les chambres de commerce se mirent en mouvement. De toutes parts il y eut des convocations, des délibérations, des mémoires, des députations, et beaucoup d’argent répandu. Rouen peignit à son tour la misère qui allait assiéger ses portes, les enfants, les femmes, les vieillards dans la désolation, les terres les mieux cultivées du royaume, restant en friche, et cette belle et riche province devenant un désert.
La ville de Tours fit voir les députés de tout le royaume dans les gémissements, et prédit une commotion qui occasionnera une convulsion dans le gouvernement politique, d’où doit résulter la consternation générale. Reims présenta sa requête signée de plus de cinquante maisons de commerce, qui disaient qu’on voulait leur ôter leur pain. Lyon ne voulut point se taire sur un projet qui répandait la terreur dans toutes les fabriques [61] . Paris ne s’était jamais présenté aux pieds du trône, que le commerce arrosait de ses larmes, pour une affaire aussi importante. Amiens regarda la permission du port et usage des toiles peintes ou teintes, comme le tombeau dans lequel toutes les manufactures du royaume devaient être anéanties. Son mémoire délibéré au bureau des marchands des trois corps réunis, et signé de tous les membres, était ainsi terminé : Au reste il suffit, pour proscrire à jamais l’usage des toiles peintes, que tout le royaume frémit d’horreur quand il entend annoncer qu’elles vont être permises. VOX POPULI, VOX DEI.
« Or existe-t-il maintenant, dit à ce sujet Roland de la Platière, qui avait recueilli ces plaintes comme inspecteur général des manufactures, existe-t-il un seul homme assez insensé pour dire que les manufactures de toiles peintes n’ont pas répandu en France une main-d’œuvre prodigieuse, par la préparation et la filature des matières premières, le tissage, le blanchiment, l’impression des toiles ? Ces établissements ont plus hâté le progrès des teintures en peu d’années, que toutes les autres manufactures en un siècle, et ont conservé à la France des millions qui en sortaient chaque année, pour l’achat de ces toiles que la fantaisie, qui se joue des règlements, savait se procurer malgré eux.
Je prie qu’on s’arrête un moment à considérer ce qu’il faut de fermeté dans une administration et de vraies lumières sur ce qui fait la prospérité de l’État, pour résister à une clameur qui paraît si générale, et qui était appuyée auprès des agents principaux de l’autorité, par d’autres moyens encore que des motifs d’utilité publique…
Nous avons vu par quelles raisons il ne convient pas à l’État de prescrire aux particuliers la nature des productions dont ils doivent s’occuper. Il lui convient encore moins de se déclarer pour l’agriculture plutôt que pour les manufactures et le commerce, ou pour le commerce plutôt que pour l’agriculture. Les capitaux et l’industrie ne rapportent jamais plus que dans les branches auxquelles ils s’appliquent de leur plein gré ; et le sage Sully a bien raison quand il regarde comme une circonstance funeste pour l’État la prédilection ou l’aversion du prince par rapport à certaines professions ou à certaines entreprises ; en un mot, ses systèmes.
Il faut convenir cependant que, dans quelques circonstances extrêmement rares, le gouvernement seul, par la vue qu’il a de l’ensemble des relations intérieures et étrangères, et par son influence sur les évènements futurs, peut tirer parti d’une prévoyance qui passe la portée des particuliers. C’est sur des considérations de ce genre que l’ancien gouvernement français se fonda, lorsque, prévoyant d’abord nos brouilleries avec l’Angleterre, et ensuite que les forces des Anglais seraient suffisantes pour bloquer nos ports de l’Océan, il voulut modérer la production des vins qui trouvent ordinairement leur débouché par cette mer, et défendit la plantation des vignobles dans tous les terrains susceptibles de produire du grain.
Dans ces cas-là le gouvernement ne doit ordonner que ce que feraient les particuliers s’ils avaient les connaissances que lui seul possède. Et cet exemple même fait connaître avec quelle défiance de lui-même il doit s’y prendre ; car la mesure dont il est ici question ne produisit pas à beaucoup près l’effet qu’on en attendait.
« Quelques pauvres diables, dit à cette occasion Mirabeau le père, furent persécutés ; d’autres achetèrent des permissions ; le plus grand nombre fit des exposés faux, et d’après le résultat des requêtes faites à certaines intendances, il se trouva prouvé par bons certificats que le territoire entier de la généralité était impropre à porter autre chose que des vignes. »
[I-252]
CHAPITRE XXXI.
Des primes d’encouragement.↩
J’appelle prime une gratification donnée à celui qui crée, qui importe, ou qui exporte un certain produit désigné.
Le gouvernement anglais, dont tout le système consiste à vendre au dehors beaucoup de produits de son industrie, et surtout de son industrie commerçante et manufacturière, accorde souvent à l’exportateur de certaines marchandises une gratification, afin que ces marchandises puissent, dans l’étranger, obtenir la préférence sur d’autres marchandises de la même espèce, en faveur du bon marché. On comprend que le commerçant qui reçoit une gratification à la sortie, peut, sans perte pour lui-même, donner dans l’étranger sa marchandise à un prix inférieur à celui auquel elle lui revient une fois transportée là.
« Nous ne pouvons, dit Smith à ce sujet [62] , forcer les étrangers à acheter les objets de leur consommation des mains de nos compatriotes exclusivement ; en conséquence nous les payons pour qu’ils nous accordent cette faveur. »
En effet, si une certaine marchandise envoyée par un négociant anglais en France y revient à ce négociant, en y comprenant le profit de son industrie, à 100 francs, et si ce prix n’est pas au-dessous de celui auquel on peut se procurer la même marchandise en France, il n’y aura pas de raison pour qu’il vende la sienne exclusivement à tout autre. Mais si le gouvernement anglais accorde, au moment de l’exportation, une prime de 10 francs, et si, au moyen de cette prime, la marchandise est donnée pour 90 francs au lieu de 100 qu’elle vaudrait, elle obtient la préférence ; mais n’est-ce pas un cadeau de 10 francs que le gouvernement anglais fait au consommateur français ?
On conçoit que le négociant puisse trouver son compte à cet ordre de chose. Il fait le même profit que si la nation française payait la chose selon sa pleine valeur ; mais la nation anglaise perd, à ce marché, dix pour cent avec la nation française. Celle-ci n’envoie qu’un retour de la valeur de 90 fr. en échange d’une marchandise qui en vaut 100.
Quand une prime est accordée, non au moment de l’exportation, mais dès l’origine de la production, le produit pouvant être vendu aux nationaux de même qu’aux étrangers, c’est un cadeau dont profitent les consommateurs nationaux comme ceux de l’étranger.
Si, comme cela arrive quelquefois, le producteur la met dans sa poche, et n’en maintient pas moins la marchandise à son prix naturel, alors c’est un cadeau fait par le gouvernement au producteur, qui est en outre payé du profit ordinaire de son industrie.
Quand une prime engage à créer, soit pour l’usage intérieur, soit pour l’usage de l’étranger, un produit qui n’aurait pas lieu sans cela, il en résulte une production fâcheuse, car elle coûte plus qu’elle ne vaut.
Qu’on suppose une marchandise qui, terminée, puisse se vendre 24 francs et rien de plus ; supposons encore qu’elle coûte (en y comprenant toujours le profit de l’industrie qui la produit) 27 francs. Il est clair que personne ne voudra se charger de la fabriquer, afin de ne pas supporter une perte de 3 francs. Mais si le gouvernement, pour encourager cette branche d’industrie, consent à supporter cette perte, c’est-à-dire s’il accorde sur la fabrication de ce produit une prime de 3 francs, alors la fabrication aura lieu, et le Trésor public, c’est-à-dire la nation, aura supporté une perte de 3 francs.
On voit, par cet exemple, le bel avantage qui résulte d’un encouragement donné à une branche d’industrie quelconque qui ne peut pas se tirer d’affaire elle-même.
S’il y a quelque bénéfice à retirer d’une industrie, elle n’a pas besoin d’encouragement. S’il n’y a point de bénéfice à en retirer, elle ne mérite pas d’être encouragée. Ce serait en vain qu’on dirait que l’État peut profiter d’une industrie qui ne donnerait aucun bénéfice aux particuliers : comment l’État peut-il faire un profit, si ce n’est par les mains des particuliers ? On avancera peut-être que le gouvernement retire plus en impositions sur tel produit, qu’il ne lui coûte en encouragements ; mais alors il paie d’une main pour recevoir de l’autre ; qu’il diminue l’impôt de tout le montant de la prime, l’effet sera le même pour la production, et l’on épargnera les frais de l’administration des primes et partie de ceux de l’administration des impôts.
Quoique les primes soient une chose coûteuse, et qui diminue la masse des richesses que possède une nation, il est cependant des cas où il lui convient de supporter cette perte ; comme celui, par exemple, où l’on veut s’assurer des produits nécessaires à la sûreté de l’État, dussent-ils coûter au-delà de leur valeur. Louis XIV, voulant remonter la marine française, accorda 5 francs par chaque tonneau [63] à tous ceux qui équiperaient des navires. Il fit bien : il voulait créer des matelots.
Tel est encore le cas où la prime n’est que le remboursement d’un droit précédemment payé. C’est ainsi que les Anglais accordent, à l’exportation du sucre raffiné, une prime qui n’est au fond que le remboursement des droits d’entrée payés par les cassonades et les sucres bruts.
peut-être un gouvernement fait-il bien encore d’accorder quelques encouragements à une production qui, bien que donnant de la perte dans les commencements, doit pourtant donner évidemment des profits au bout de peu d’années. Smith n’est pas de cet avis.
« Il n’est aucun encouragement, dit-il, qui puisse porter l’industrie d’une nation au-delà de ce que le capital de cette nation peut en mettre en mouvement. Il ne peut que détourner une portion de capital d’une certaine production pour la diriger vers une autre, et il n’est pas à supposer que cette production forcée soit plus avantageuse à la société que celle qui aurait été naturellement préférée… L’homme d’État qui voudrait diriger les volontés des particuliers quant à l’emploi de leur industrie et de leurs capitaux, se chargerait non seulement d’un inutile soin, mais encore d’un soin qu’il serait très malheureux de voir confier à un seul homme, à un conseil, quelque sages qu’on veuille les supposer, et qui surtout ne saurait être en de plus mauvaises mains que dans celles d’administrateurs assez fous pour imaginer qu’ils sont capables de le prendre… Quand même la nation, faute de tels règlements, devrait ne jamais acquérir une certaine branche d’industrie, elle n’en serait pas plus pauvre à l’avenir, puisque c’est une preuve que même dans l’avenir elle a pu employer ses capitaux d’une manière plus avantageuse [64] . »
Smith a certainement raison au fond ; mais il est des circonstances qui peuvent modifier cette proposition, généralement vraie, que chacun est le meilleur juge de l’emploi de son industrie et de ses capitaux.
Smith a écrit dans un temps et dans un pays où l’on était, et où l’on est encore fort éclairé sur ses propres intérêts et fort peu disposé à négliger les profits qui peuvent résulter des emplois de capitaux et d’industrie quels qu’ils soient. Mais toutes les nations ne sont pas encore parvenues au même point. Combien n’en est-il pas où, par des préjugés que le gouvernement seul peut vaincre, on est éloigné de plusieurs excellents emplois de capitaux ? Combien n’y a-t-il pas de villes et de provinces, où l’on suit routinièrement les mêmes usages pour les placements d’argent ? Ici on ne sait placer qu’en rente sur des terres, là qu’en maisons, plus loin que dans les charges et les emprunts publics. Toute application neuve de la puissance d’un capital est, dans ces lieuxlà, un objet de méfiance ou de dédain ; et la protection accordée à un emploi de travail et d’argent vraiment profitable peut devenir un bienfait pour un pays.
Enfin telle industrie peut donner de la perte à un entrepreneur qui la mettrait en train sans secours, et qui pourtant est destinée à procurer de très gros bénéfices, quand les ouvriers y seront façonnés et que les premiers pas auront été aplanis.
Nous jouissons actuellement en France des plus belles manufactures de soieries et de draps qu’il y ait au monde. peut-être les devons-nous aux sages encouragements de Colbert. Il avança 2 000 francs aux manufacturiers par chaque métier battant ; et, pour le remarquer en passant, cette espèce d’encouragement avait un avantage tout particulier : communément le gouvernement lève sur les produits de l’industrie privée des contributions dont le montant est perdu pour la production. Ici une partie des contributions était réemployée d’une manière productive. C’était une partie du revenu des particuliers qui allait grossir les capitaux productifs du royaume. À peine aurait-on pu espérer autant de la sagesse et de l’intérêt personnel des particuliers eux-mêmes [65] .
Ce n’est pas ici le lieu d’examiner combien les encouragements, en général, ouvrent d’entrées aux dilapidations, aux faveurs injustes et à tous les abus qui s’introduisent dans les affaires des gouvernements. Un homme d’État habile, après avoir conçu le plan le plus évidemment bon, est souvent retenu par les vices qui doivent nécessairement se glisser dans son exécution. Un de ces inconvénients est d’accorder, comme cela arrive presque toujours, les encouragements et les autres faveurs dont les gouvernements disposent, non à ceux qui sont habiles à les mériter, mais à ceux qui sont habiles à les solliciter.
Je ne prétends point, au reste, blâmer les distinctions, ni même les récompenses accordées publiquement à des artistes ou à des artisans pour récompenser une exertion extraordinaire de leur génie ou de leur adresse. Les encouragements de ce genre excitent l’émulation et accroissent la masse des lumières générales, sans détourner l’industrie et les capitaux de leur emploi le plus avantageux. Ils occasionnent d’ailleurs une dépense peu considérable auprès de ce que coûtent, en général, les autres encouragements. La prime pour encourager l’exportation des blés a coûté à l’Angleterre, dans certaines années, plus de 7 millions de nos francs. Je ne crois pas que jamais le gouvernement anglais, ni aucun autre, ait dépensé, en prix d’agriculture, la cinquantième partie de cette somme dans une année.
[I-262]
CHAPITRE XXXII.
Des brevets d’invention.↩
En Angleterre, quand un particulier invente un produit nouveau, ou bien découvre un procédé inconnu, il obtient un privilège exclusif de fabriquer ce produit, ou de se servir de ce procédé.
Comme il n’a point de concurrents dans cette production, il peut en porter le prix fort au-dessus de ce qui serait nécessaire pour le rembourser de ses avances avec intérêts, et pour payer les profits de son industrie. C’est une récompense que le gouvernement accorde aux dépens des consommateurs du nouveau produit ; et dans un pays aussi prodigieusement productif que l’Angleterre et où, par conséquent, il y a beaucoup de gens à gros revenus et à l’affût de tout ce qui peut leur procurer quelque nouvelle jouissance, cette récompense est souvent très considérable.
Il y a peu d’années qu’un homme inventa un ressort en spirale qui, placé entre les courroies des soupentes des voitures, en adoucit singulièrement les mouvements. Un privilège exclusif a fait la fortune de cet homme.
Qui pourrait raisonnablement se plaindre d’un semblable privilège ? Il ne détruit ni ne gêne aucune branche d’industrie précédemment connue. Les frais n’en sont payés que par ceux qui le veulent bien ; et quant à ceux qui ne jugent pas à propos de les payer, leurs besoins, de nécessité ou d’agrément, n’en sont pas moins complètement satisfaits qu’auparavant.
Cependant comme tout gouvernement doit veiller à améliorer sans cesse le sort de sa nation, il ne peut pas priver à jamais les producteurs de l’avantage de consacrer une partie de leurs capitaux et de leur industrie à cette production, ni les consommateurs de celui de s’en pourvoir au prix où la concurrence peut la faire descendre.
Les nations étrangères sur lesquelles il n’a aucun pouvoir, admettraient sans restrictions cette branche d’industrie, et seraient ainsi plus favorisées que la nation où elle aurait pris naissance.
Les Anglais, qui en cela ont été imités par nous [66] , ont donc fort sagement établi que de tels privilèges ne durent qu’un certain nombre d’années, au bout desquelles la fabrication de la marchandise qui en est l’objet est mise à la disposition de tout le monde.
Quand le procédé privilégié est de nature à pouvoir demeurer secret, le même acte statue que le terme du privilège expiré, il sera rendu public. Le producteur privilégié (qui, dans ce cas, semblerait n’avoir aucun besoin de privilège) y trouve cet avantage, que si quelqu’autre personne venait à découvrir le procédé secret, elle ne pourrait néanmoins en faire usage avant l’expiration du privilège.
Il n’est aucunement nécessaire que l’autorité publique discute l’utilité du procédé, ou sa nouveauté. S’il n’est pas utile, tant pis pour l’inventeur. S’il n’est pas nouveau, tout le monde est admis à prouver qu’il était connu et que chacun avait le droit de s’en servir ; tant pis encore pour l’inventeur qui a payé inutilement les frais du brevet d’invention.
Le public n’est donc point lésé par ce genre d’encouragement et il peut en recueillir de grands avantages. Il a complètement réussi dans la pratique.
[I-266]
CHAPITRE XXXIII.
De l’effet des entraves mises à l’importation des marchandises étrangères.↩
Un gouvernement qui défend absolument l’introduction de certaines marchandises étrangères établit un monopole en faveur de ceux qui produisent cette marchandise dans l’intérieur, contre ceux qui la consomment. C’est-à-dire que ceux de l’intérieur qui la produisent, ayant le privilège exclusif de la vendre, peuvent en élever le prix au-dessus du taux naturel ; et que les consommateurs de l’intérieur, ne pouvant l’acheter que d’eux, sont obligés de la payer plus cher.
Il n’y a pas toujours défense absolue d’introduire dans un pays une marchandise étrangère ; quelquefois elle est seulement assujettie à un droit d’entrée plus ou moins fort.
Dans ce cas le monopole n’est pas absolu. Il ne peut élever le prix de la marchandise au-dessus du prix auquel revient la marchandise étrangère chargée du droit d’entrée. Ainsi, en supposant qu’une aune de satin français pût se vendre à Londres, franche de tout droit d’entrée, pour 8 fr., si le satin français est chargé d’un droit de moitié, ou de 50 pour cent, l’aune sera portée au prix de 12 fr. ; et le satin de même qualité, produit en Angleterre, ne pourra pas se vendre au-delà de 12 francs. Les producteurs anglais n’ont le privilège exclusif de la vente qu’autant qu’ils maintiennent leur prix à ce taux ou au-dessous.
En supposant qu’ils le portent à 12 fr., les consommateurs de satin, qui sans le droit auraient pu se procurer cette denrée pour 8 fr., la paieront 50 pour cent plus cher.
Si la prohibition du satin est absolue comme elle l’est en ce moment, les fabricants anglais pourront en porter le prix au taux qu’ils voudront, et ne seront arrêtés que par leur concurrence mutuelle, les facultés de leurs acheteurs, et l’introduction de la même marchandise en fraude.
Les consommateurs de satin étant en petit nombre et dans l’aisance, cet inconvénient est peu grave ; mais quand les droits embrassent presque tous les objets de consommation et pèsent ainsi sur presque toutes les classes de la société, on ne peut nier que ce ne soit un grand mal.
« Le nombre des marchandises dont l’importation est prohibée dans la GrandeBretagne, soit totalement, soit au moyen de certaines restrictions, dit Smith, surpasse de beaucoup ce que présument ceux qui ne sont pas initiés dans les mystères de la douane. [67] ».
On dira peut-être qu’il est bon que la nation supporte l’inconvénient de payer plus cher la plupart des denrées, pour jouir de l’avantage de les produire.
Distinguons.
Si elle peut produire les marchandises prohibées au même prix ou au-dessous du prix auquel l’étranger peut les fournir toutes rendues, les siennes seront probablement préférées et elle aura l’avantage de les produire, sans qu’il soit besoin de prohibitions. Les consommateurs ne vont pas chercher au loin ce qu’ils ont près d’eux dans les mêmes qualités et dans les mêmes prix.
Si la nation ne peut pas les produire au même prix, ce n’est point un avantage pour elle de les produire, ainsi qu’on l’a vu lorsqu’il a été question du commerce extérieur (chapitre 23) ; et son industrie, de même que ses capitaux, peuvent être employés d’une manière plus avantageuse pour elle. C’est encore ici le cas du particulier qui voudrait faire lui-même ses souliers et ses habits. Que dirait-on si à la porte de chaque maison on établissait un droit d’entrée sur les souliers et sur les habits, tel que le prix de ces denrées fût élevé par ce droit au-dessus de ce qu’elles coûteraient au propriétaire s’il les produisait lui-même ; le tout, afin de lui procurer l’avantage de les fabriquer à grands frais ? Ce serait exactement le même système, mais seulement poussé plus loin.
On s’étonnera que chaque nation soit si empressée à solliciter des prohibitions, s’il est vrai qu’elle n’en recueille point de profit ; et, se fondant sur ce que le propriétaire d’une maison n’a garde de solliciter pour sa maison une pareille faveur, on en voudra conclure peut-être que les deux cas ne sont pas parfaitement semblables.
La seule différence vient de ce que le propriétaire est un être unique, qui ne saurait avoir deux volontés, et qui est encore plus intéressé, comme consommateur de ses habits, à acheter à bon marché les denrées dont il a besoin, qu’il n’est intéressé comme fabricant à les faire payer au-dessus de leur valeur.
Qui est-ce qui sollicite des prohibitions ou de forts droits d’entrée dans un État ? Ce sont les producteurs de la denrée dont il s’agit de prohiber l’introduction, et non pas ses consommateurs. Ils disent : c’est pour l’intérêt de l’État ; mais il est clair que c’est pour le leur uniquement. N’est-ce pas la même chose, continuentils, et ce que nous gagnons n’est-il pas autant de gagné pour notre pays ? — Point du tout : ce que vous gagnez de cette manière est tiré de la poche de votre voisin, d’un habitant du même pays. Et si l’on pouvait compter l’excédent de dépense fait par les consommateurs en conséquence de votre monopole, on trouverait qu’il est égal au gain que le monopole vous a valu.
On insiste et l’on dit : « L’intérêt est élevé chez nous et il est bas chez l’étranger ; il faut donc balancer l’avantage qu’a l’étranger sur nos producteurs, par un droit d’entrée ». Je réponds que le capitaliste est un de nos producteurs ; que le gros intérêt qu’on lui paie est en partie une suite du monopole dont jouit le produit auquel il concourt, et que la destruction de ce monopole est un des moyens de diminuer le gain usuraire qu’il fait. Car il ne faut pas croire que ce soit le fabricant et l’ouvrier qui profitent le plus du monopole qu’ils jugent leur être si favorable : c’est bien plutôt le capitaliste. D’ailleurs, l’intérêt de l’argent restât-il élevé, c’est un malheur auquel il n’en faut pas joindre un autre, celui de payer cher des produits que nous pourrions acheter à bon marché.
Ce serait à tort qu’on craindrait que notre pays consommant des denrées étrangères, nos travailleurs restassent sans emploi. La quantité de travail mise en action est, par tous pays, proportionnée à la quantité de capitaux productifs qui s’y trouvent ; il n’y a que la difficulté d’emprunter qui empêche de former des entreprises industrielles ; or l’abolition des prohibitions ne fait pas fuir les capitaux ; et le bon marché des consommations est très propre au contraire à les augmenter.
On peut dire en faveur des prohibitions que la plupart des consommateurs étant producteurs, ils gagnent sous cette dernière forme ce qu’ils perdent sous l’autre ; que le producteur qui fait un gain-monopole sur l’objet de son industrie, est victime d’un gain de la même espèce fait sur les denrées qui sont l’objet de sa consommation, et qu’ainsi la nation se compose de dupeurs et de dupés qui n’ont plus rien à se reprocher. Et il est bon de remarquer que chacun se croit plutôt dupeur que dupé ; car, quoique chacun soit consommateur en même temps qu’il est producteur, les profits excessifs qu’on fait sur une seule espèce de denrée, celle qu’on produit, sont bien plus sensibles que les pertes multipliées, mais petites, qu’on fait sur cent espèces de denrées différentes qu’on consomme. Qu’on mette un droit d’entrée sur les toiles de coton, c’est, pour un citoyen d’une fortune médiocre, une augmentation de dépense de 10 à 12 francs par an, tout au plus, augmentation de dépense qui n’est même pas, dans son esprit, bien claire et bien assurée, et qui le frappe peu, quoiqu’elle soit répétée, plus ou moins, sur chacun des objets de sa consommation. Tandis que si ce citoyen est fabricant de chapeaux, et qu’on mette un droit sur les chapeaux étrangers, il saura fort bien que ce droit enchérira les chapeaux de sa manufacture, et augmentera annuellement ses profits peut-être de plusieurs milliers de francs.
C’est ainsi que l’intérêt personnel (même en supposant tout le monde frappé dans sa consommation plus encore que favorisé dans sa production), se déclare en faveur des prohibitions.
Mais, même sous ce point de vue, le système prohibitif est fécond en injustices.
Premièrement. Tous les producteurs ne sont pas à portée de profiter du système de prohibition que j’ai supposé général, mais qui ne l’est pas ; et qui, quand il le serait par les lois, ne le serait pas par le fait. Qu’on prenne la peine d’en suivre la démonstration.
Tout produit qui serait moins cher venant du dehors et qu’on empêche d’entrer, est frappé par la prohibition ; tout produit qui est naturellement moins cher fabriqué dans le pays, quand même l’introduction en est défendue, se trouve dans la classe de ceux qui ne sont pas prohibés. Celui-là est écarté par un moyen violent ; celui-ci l’est naturellement.
Le producteur intérieur du premier de ces produits peut en élever le prix jusqu’où le droit d’entrée porte le même produit venant du dehors ; ou au moins jusqu’où le porte la concurrence des acheteurs de l’intérieur, qui ne peuvent pas se le procurer ailleurs. Ce producteur jouit de la prohibition.
Le producteur intérieur du second produit ne peut pas élever le prix plus haut que si l’introduction n’en était pas défendue, puisque, fût-elle permise, il n’en viendrait point. Il ne jouit pas de la prohibition. Qu’on défende, par exemple, l’introduction des bêtes à cornes ; il n’en viendra pas une de moins, puisqu’il n’en vient déjà point. Le nourrisseur de bêtes à cornes ne jouira donc point, en vertu de cette défense, d’un gain plus considérable. Elle ne lui procurera pas les moyens d’élever le prix de sa denrée
C’est ce qui arrive surtout en Angleterre. Là on a poussé très loin le système des prohibitions ; mais, par différentes causes que j’examine ailleurs, une grande partie des produits prohibés, ne le fussent-ils pas, reviendraient plus cher que les produits intérieurs. L’État ne souffre point de cette prohibition ; mais aussi les particuliers producteurs de ces sortes de marchandises ne partagent pas les gains monopoles que font d’autres producteurs.
Secondement. Tous les particuliers d’une nation ne sont pas producteurs ; ou du moins ne sont pas producteurs de produits transportables, tellement qu’ils n’ont point à craindre que les produits étrangers viennent se mettre en concurrence avec les leurs ; ceux-là participent aux inconvénients des prohibitions sans partager les profits du monopole.
Je sais bien qu’il faut mettre les propriétaires fonciers et les capitalistes dans la classe des producteurs qui en profitent, et que s’ils paient leurs consommations plus cher, le loyer de leurs terres et de leurs capitaux leur est payé plus cher en raison du monopole établi dans la vente des produits. Mais il est plusieurs classes dont le revenu ne reçoit aucune influence de la production, tels sont les rentiers sur l’État et sur les particuliers, les avocats, les médecins, les prêtres et notamment les personnes dont se compose le gouvernement et l’administration publique dans toutes ses branches. Il peut être piquant de remarquer à ce sujet que les personnes qui établissent les prohibitions sont au nombre de celles sur qui leur poids tombe principalement et qui sont les plus intéressées à les abolir.
En 1599, des fabricants de Tours demandèrent à Henri IV de défendre l’entrée des étoffes de soie, d’or et d’argent, que jusqu’à cette époque on avait en totalité tirées de l’étranger. Ils flattaient le gouvernement qu’ils fourniraient à toute la consommation qui se faisait en France de ces étoffes. Henri, beaucoup trop facile, sur ce point comme sur plusieurs autres, leur accorda tout ce qu’ils voulurent. Mais les consommateurs jetèrent les hauts cris. On leur faisait payer plus cher des étoffes qu’ils achetaient auparavant à meilleur marché. L’édit fut révoqué au bout de six mois [68] ; et l’on ne doit pas s’étonner que dans cette occasion le mal fût si promptement réparé : les étoffes de soie, d’or et d’argent, étaient à l’usage des courtisans et des grands du royaume. Ils parvinrent aisément à faire cesser une incommodité qui tombait principalement sur eux. Si l’inconvénient avait pesé sur d’autres classes de la nation moins voisines du pouvoir, il est permis de douter que l’abus eût été si promptement redressé.
Troisièmement. Les gains du monopole ne se partagent pas équitablement entre tous ceux qui concourent à la production ; les chefs d’entreprises soit agricoles, soit manufacturières, soit commerçantes, exercent un monopole non seulement à l’égard des consommateurs, mais encore, et par d’autres causes, à l’égard des ouvriers et de plusieurs agents de la production, ainsi qu’on le verra au liv. IV ; de manière que ceux-ci participent au désavantage qu’ils partagent avec tous les consommateurs, et ne participent pas aux gains forcés des producteurs.
Quelquefois les prohibitions non seulement blessent les intérêts pécuniaires des consommateurs, mais elles les soumettent à des privations pénibles. Dans ces dernières années, j’ai honte de le dire, n’a-t-on pas va les fabricants de chapeaux de Marseille solliciter la prohibition d’entrée des chapeaux de paille venant de l’étranger, sous prétexte qu’ils nuisaient au débit de leurs chapeaux de feutre [69] ! C’était vouloir priver les gens de la campagne, ceux qui cultivent la terre sous le soleil brûlant de nos provinces méridionales, d’une coiffure légère, fraîche, peu coûteuse et qui les garantit bien, lorsqu’au contraire il serait à désirer que l’usage s’en propageât et s’étendît par toute la France.
Tels sont les principaux inconvénients des entraves mises à l’importation et qui sont portés au plus haut degré par les prohibitions absolues. On voit des nations prospérer même en suivant ce système, parce que chez elles les causes de prospérité sont plus fortes que les causes de dépérissement. Les nations ressemblent au corps humain ; il existe en nous un principe de vie qui rétablit sans cesse notre santé que nos excès tendent à altérer sans cesse. La nature cicatrise les blessures et guérit les maux que nous attirent notre maladresse et notre intempérance. Ainsi les États marchent, souvent même prospèrent, en dépit des plaies de tous genres qu’ils ont à supporter de la part de leurs amis et de leurs ennemis. Remarquez que ce sont les États naturellement les mieux constitués qui peuvent le mieux supporter ces outrages. Il est vrai qu’on ne les épargne pas.
[I-280]
CHAPITRE XXXIV.
Des entraves de province à province.↩
Nous venons de voir quelle est l’espèce de tort que reçoit un pays des entraves qui empêchent les denrées étrangères de pénétrer dans son intérieur. J’ai jugé superflu de faire remarquer le tort que les mêmes entraves causent au pays dont on prohibe les marchandises. Celui-là est senti de tout le monde. On le prive des profits de son industrie agricole, manufacturière et commerçante, que de telles relations lui auraient procurés ; on le prive de l’avantage de varier ses jouissances, en lui ôtant la faculté de recevoir les produits qui lui manquent, en échange de ceux avec lesquels il aurait pu les payer. Quand on établit dans l’intérieur d’un même pays de pareilles entraves, comme il y en avait en France avant la Révolution, on fait supporter à la fois à ce pays, et les dommages que reçoit la nation qui prohibe les marchandises étrangères, et les dommages qui retombent sur celle dont les marchandises sont prohibées.
Je ne parle point de plusieurs autres inconvénients très graves, tel que celui de créer un crime de plus, la contrebande ; c’est-à-dire de rendre criminelle par les lois une action qui est innocente en elle-même, et d’avoir à punir des gens qui, dans le fait, travaillent à la prospérité générale.
[I-282]
CHAPITRE XXXV.
Des circonstances où il convient de mettre des droits d’entrée sur les marchandises étrangères.↩
Smith admet deux circonstances qui peuvent déterminer un gouvernement sage à avoir recours aux droits d’entrée :
La première est celle où il s’agit d’avoir une branche d’industrie nécessaire à la défense du pays et pour laquelle il ne serait pas prudent de ne pouvoir compter que sur des approvisionnements étrangers. C’est ainsi qu’un gouvernement peut prohiber l’importation de la poudre à canon, si cela est nécessaire à l’établissement des poudrières de l’intérieur ; car il vaut mieux payer cette denrée plus cher, que de s’exposer à en être privé au moment du besoin.
La seconde est celle où un produit intérieur, d’une consommation analogue, est déjà chargé de quelque droit. On sent qu’alors un produit extérieur par lequel il pourrait être remplacé, et qui ne serait chargé d’aucun droit, aurait sur le premier un véritable privilège. Faire payer un droit dans ce cas, ce n’est point détruire les rapports naturels qui existent entre les diverses branches de production : c’est les rétablir. Il ne reste plus, relativement à ces doubles droits, que les inconvénients qui accompagnent tous les impôts ; inconvénients dont je m’occuperai plus tard.
Ce sujet touche à l’un des points les plus délicats de l’économie politique. Les impôts mis dans l’intérieur sur les objets de première nécessité, font hausser les prix non seulement des choses imposées, mais de plusieurs autres produits, de presque tous les autres produits. Fautil, en conséquence, pour rétablir l’équilibre entre les avantages naturels des produits du dedans et de ceux du dehors, fautil, dis-je, taxer tous ceux du dehors ?
Smith ne le pense pas ; voici en très peu de mots ses motifs auxquels il donne un très long développement. (Rich. des nat. Liv. IV, ch. 2.)
D’abord existe-t-il un moyen de savoir à quel point un impôt mis dans l’intérieur sur un produit de première nécessité influe sur le prix de chacun des autres produits ? Et s’il est impossible de le savoir quel moyen aurait-on de proportionner les droits d’entrées sur chacune des denrées venant du dehors, à cette augmentation de prix dans l’intérieur ?
En second lieu, les impôts sur les nécessités de la vie sont un malheur absolument du même genre qu’un mauvais sol on un mauvais climat. Elles font qu’avec le même travail et la même dépense on obtient moins de produits que si les circonstances accidentelles étaient plus favorables. Or à ce malheur naturel que l’habitant supporte en sa qualité de producteur, faut-il en ajouter un second qui serait de lui faire payer plus cher comme consommateur une partie des denrées dont il a besoin ?
Les impôts sur les objets de première nécessité sont un mal. Les droits d’entrée sur les objets d’importation en sont un autre.
Telle est sur ce point la doctrine de Smith ; mais il écrivait en Angleterre, où les impôts directs, les impôts qui portent sur les choses de première nécessité, et qui, comme on le verra au livre V, font le plus hausser les produits de l’intérieur, sont les plus modérés. Les impôts qui se perçoivent sur les denrées au moment de leur consommation, ou fort près de là, tombant à la fois et sur les produits du dedans et sur ceux du dehors, ne changent rien à leurs rapports entre eux. Un cabaretier qui paie fort cher la faculté de vendre du vin, fait payer cet impôt à ses pratiques, soit qu’il leur vende des vins du pays, soit qu’il leur vende des vins étrangers ; et il le leur fait payer probablement en proportion de la valeur de ces vins. Or la majeure partie des contributions anglaises étant du genre de celle-là, frappent les productions étrangères comme celles du dedans. D’un autre côté, les impôts qui portent sur les produits intérieurs sont restitués pour la plupart sous le nom de drawbacks (remboursements de droits) ou de primes, quand les produits vont à l’étranger ; de sorte que les marchandises que l’Angleterre exporte sont pour ainsi dire dégrevées de presque toutes contributions.
Il en résulte qu’en France l’abolition des droits d’entrée placerait tous les produits de l’intérieur sous l’influence d’un désavantage réel par rapport aux produits anglais. La rareté des capitaux en France, et la nature de la plupart des impôts, exercent sur la valeur de la totalité des marchandises indigènes une influence qui ne pèse pas de même sur les marchandises étrangères. Les droits d’entrées ne sont donc, pour la plupart de ces dernières, qu’un équivalent des impôts dont les premières sont grevées. Une marchandise anglaise qui viendrait, sans payer aucune entrée, se faire consommer en France, esquiverait et les droits de première production qui n’existent pas en Angleterre, et les droits sur la consommation qui n’existent pas en France ; et, au milieu de deux nations grevées d’impôts, ferait ainsi le chemin de sa naissance à sa destruction avec un avantage que n’ont point les marchandises nées et consommées dans un de ces deux pays.
Toutefois, les impôts qui enchérissent notre production ayant des bornes, les droits d’entrée qui servent à les balancer doivent en avoir également ; autrement on rompt, dans un autre sens, l’équilibre qu’il convient de tenir entre les intérêts du producteur et ceux du consommateur. C’est alors que les inconvénients du régime prohibitif reparaissent dans toute leur force.
Les droits sur les exportations, joints aux précédents, et les prohibitions absolues, portent le mal causé par ce genre d’opérations aussi loin qu’il peut aller. Une prohibition absolue prive, autant qu’il est en elle, les nations des avantages du commerce réciproque, qui sont l’augmentation des profits et des jouissances.
On a presque toujours considéré les droits d’entrée et les prohibitions comme une représaille : Votre nation met des entraves à l’introduction des produits de la nôtre ; ne sommesnous pas autorisés à charger des mêmes entraves les produits de la vôtre ? Tel est l’argument qu’on fait valoir le plus souvent, et qui sert de base à la plupart des traités de commerce. Mais on se trompe sur l’objet de la question. Les nations sont autorisées à se faire tout le mal qu’elles peuvent ; on le sait bien. Il ne s’agit pas ici de leurs droits, qui sont fort incertains et bien peu respectés. Il s’agit de leurs intérêts, qui à la vérité ne le sont guère davantage.
Une nation qui vous prive de la faculté de commercer chez elle, vous fait incontestablement un tort réel. Elle vous prive des avantages du commerce extérieur par rapport à elle ; et en conséquence, si en lui faisant craindre pour elle-même un tort pareil, vous pouvez la déterminer à renverser les barrières qu’elle vous oppose, sans doute on peut approuver un tel moyen, comme une mesure purement politique. Mais cette représaille, qui est préjudiciable à votre rivale, est aussi préjudiciable à vous-même. Ce n’est point une défense de vos propres intérêts que vous opposez à une précaution intéressée prise par vos rivaux : c’est un tort que vous vous faites pour leur en faire un autre. Il ne s’agit plus que de savoir à quel point vous chérissez la vengeance, et combien vous consentez qu’elle vous coûte. Lorsque Philippe II, devenu maître du Portugal, défendit, en 1594, à ses nouveaux sujets tous rapports avec les Hollandais qu’il détestait, qu’en arriva-t-il ? Les Hollandais, qui allaient chercher à Lisbonne les denrées de l’Inde dont ils procuraient au Portugal un immense débit, voyant cette ressource manquer à leur industrie, allèrent chercher ces mêmes marchandises aux Indes, dont ils finirent par chasser les Portugais ; et cette malice faite dans le dessein de leur nuire fut l’origine de leur grandeur.
Malgré les inconvénients des prohibitions de denrées étrangères, il serait sans doute téméraire de les abolir brusquement. Un malade ne se guérit pas en un jour. Une nation veut être traitée avec de semblables ménagements, même dans le bien qu’on lui fait. Que de capitaux, que de mains industrieuses employées dans des fabrications monopoles, quoiqu’elles soient des abus ! Ce n’est que peu à peu que ces capitaux et cette main-d’œuvre peuvent trouver des emplois plus avantageusement productifs pour leur nation, quoiqu’en procurant à leurs propriétaires des gains peut-être moins forts.
Cependant l’inconvénient de supprimer un monopole déjà établi, bien que réel, n’est pas si grave que beaucoup de gens sont intéressés à le représenter.
Dans un grand nombre de cas, l’effet de la suppression du monopole ne serait pas la destruction d’une branche d’industrie, mais seulement la réduction de ses gains. Si l’on permettait par exemple la libre importation des chevaux anglais, il n’est pas probable que la production des chevaux normands vînt à cesser. peut-être les marchands de chevaux normands seraient-ils obligés de réduire leurs profits. Les mêmes capitaux, la même main-d’œuvre, à très peu de chose près, resteraient employés dans la même industrie ; les salaires de la classe ouvrière n’en seraient probablement pas affectés, parce qu’ils sont, en général, malgré les monopoles, fixés aussi bas qu’ils peuvent l’être, par les raisons que nous verrons au livre IV.
Il en serait de même de beaucoup de branches d’industrie ; car il ne faut pas perdre de vue que l’industrie étrangère ne peut rivaliser avec l’industrie nationale, qu’autant que ses produits peuvent supporter, outre les frais de première production, les frais du commerce qui les amène. La vente est une espèce de prix que les denrées gagnent à la course ; et les produits étrangers partent de plus loin. En second lieu, les capitaux que l’abolition d’un monopole forcerait décidément à quitter une branche d’industrie, iraient en féconder d’autres, sous peine de rester oisifs. Or ces autres branches réclameraient des bras et fourniraient de l’emploi aux industrieux que la première aurait laissés sans ouvrage. L’effet d’une liberté d’importation ressemble beaucoup à celui qui résulte de l’invention d’une machine nouvelle ; et l’on a vu dans le chapitre 9 de ce livre I, que les inconvénients qu’une machine nouvelle entraîne sont passagers et ne peuvent en aucune façon en balancer les avantages.
Je n’ai pas cependant prétendu soutenir que l’abolition d’entraves funestes n’entrainât quelques maux affligeants. Une partie des capitaux peut aller animer au loin une industrie étrangère ; à la vérité la nation n’y perd rien en intérêts, puisque le capitaliste sait bien se les faire payer ; mais une partie des mains industrieuses que ces capitaux faisaient travailler peuvent rester improductives pour l’État et pour elles-mêmes, et souffrir le besoin. Quoique des mains façonnées à une industrie soient plus propres à se livrer à une autre industrie que celles qui sont façonnées à l’oisiveté, il est pourtant de vieux ouvriers et même des entrepreneurs agricoles, manufacturiers ou commerçants, qui ne peuvent changer de profession sans éprouver un tort considérable. peut-être n’est-ce pas trop de toute l’habileté d’un grand homme d’État pour cicatriser les plaies qu’occasionne l’extirpation de cette loupe dévorante qu’on appelle système réglementaire et exclusif ; et quand on considère mûrement le tort qu’il cause quand il est établi, et les maux auxquels on peut être exposé en l’abolissant, on est conduit naturellement à cette réflexion : s’il est si difficile de rendre la liberté à l’industrie, combien ne doit-on pas être réservé lorsqu’il s’agit de l’ôter !
[I-293]
CHAPITRE XXXVI.
Du commerce des grains.↩
On s’étonnera qu’après des principes aussi bien établis que ceux qui précèdent, je me croie obligé d’en faire une application particulière au commerce des grains. Il semble qu’ils doivent être pour cette marchandise ce qu’ils sont pour toutes les autres ; mais le blé a comme marchandise des propriétés particulières et qui méritent toute notre attention.
Il y a des pays où les propriétés du blé conviennent à d’autres denrées, telles que le riz, les châtaignes, les patates, le manioc, les dattes, le fruit de l’arbre à pain, etc. ; on peut si l’on veut appliquer à ces diverses nourritures ce que j’ai à dire du blé.
D’abord c’est de toutes les denrées la plus abondante, celle dont la production annuelle dans nos climats se monte à la plus grande valeur.
C’est en outre la denrée la plus généralement consommée ; tellement qu’en chaque pays, on aurait peut-être de la peine à trouver une seule personne qui n’en consommât pas. Elle a non seulement pour consommateurs tous les individus, mais elle fait le fond de la nourriture du plus grand nombre, la classe ouvrière dans les trois genres d’industrie (de beaucoup la plus nombreuse), se nourrissant principalement de blé. De ces deux circonstances, il en résulte une troisième ; c’est que dans la disette de cette denrée, il est impossible de la suppléer par une autre. Elle est à la fois indispensable et, jusqu’à un certain point, irremplaçable.
De là il résulte encore que son prix influe sur celui de tous les autres produits. Un chef d’entreprise, fermier, manufacturier ou négociant, emploie un certain nombre d’ouvriers qui tous ont besoin de consommer une certaine quantité de blé. Si le prix du blé augmente, il est obligé d’augmenter dans la même proportion le prix de ses produits.
C’est par toutes ces raisons que nulle denrée n’a été le sujet de plus violentes disputes entre les économistes et les partisans du système commercial. Les premiers n’étaient point fâchés que le prix du blé fût élevé, parce que le produit net de la culture devait alors, selon eux, être plus considérable. On verra plus loin (Liv. III, De la cherté et du bon marché) s’ils se faisaient de justes idées du prix des choses ; qu’il nous suffise d’observer ici que si le prix du blé influe sur celui de tous les autres produits, le cultivateur paie en proportion du prix qu’il vend son blé, toutes les choses dont il a besoin, sans en excepter le blé lui-même, car, quand le blé est cher, il paie celui que sa maison consomme, au même prix qu’il aurait pu le vendre.
Les partisans du système commercial voulaient au contraire maintenir le blé à bas prix ; et c’était avec grande raison ; mais prenaient-ils de bons moyens pour cela ? C’est de quoi il est permis de douter.
Je ne m’arrêterai pas à faire sentir les inconvénients des entraves mises à la circulation des grains de province à province, dans un même État. Elles sont tellement absurdes qu’il ne me paraît pas nécessaire d’en combattre le système. Quand des portions de peuples se sont permis d’arrêter la marche des grains, non seulement elles ont fait une action contraire à leurs véritables intérêts, mais une action hautement coupable envers le reste de la nation, et que les gouvernements ont sagement fait de réprimer. Quel est l’effet de la liberté du commerce intérieur des grains, si ce n’est de l’acheter là où il est à bon marché et où par conséquent on a besoin de vendre, pour le porter là où il est cher, et où par conséquent on a besoin d’acheter ?
L’ignorance populaire a presque toujours eu en horreur ceux qui ont fait le commerce des grains ; et à cet égard les gouvernements ont trop souvent partagé les préjugés et les terreurs populaires ; cependant ce commerce est aussi utile que tout autre ; il est le plus utile, si l’on regarde l’approvisionnement en grains comme le plus important de tous. Quand on n’a pas accusé les marchands d’accaparer les blés, on a du moins été persuadé que les gains qu’ils faisaient n’avaient d’autre effet que de faire renchérir la marchandise et de lever une contribution gratuite sur le consommateur ; aussi a-t-on cherché à supprimer, autant qu’on a pu, tout intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Tel a été le but d’une infinité de lois, de règlements et d’ordonnances, rendues en tout pays et souvent sollicitées par la clameur publique.
Le peuple et les gouvernements ont agi en cela directement contre leur but et leurs intérêts.
Et d’abord, de toutes les marchandises de produit intérieur, il n’y en a pas qui soit plus difficile à accaparer que les blés. Il faut, pour un tel accaparement, des capitaux immenses, car c’est, même dans les plus mauvaises années, la denrée dont la valeur totale est le plus considérable, au moins chez les nations d’Europe que j’ai principalement en vue en ce moment. C’est la denrée dont la production a lieu sur le plus de points différents, qui occupe le plus d’espace, et qui est entre les mains de plus de gens ; de sorte qu’elle ne peut être accaparée sans établir des pratiques sur presque toute l’étendue d’un territoire et au moyen d’une multitude d’agents ; ce qui entraîne des frais et des risques considérables. C’est de plus une des denrées les plus volumineuses, une des denrées par conséquent dont le voiturage et l’emmagasinement sont le plus difficiles et plus dispendieux. Enfin c’est une denrée qui n’est pas de garde, qui exige des soins pour la conserver et qui est exposée à des altérations qui causent à son propriétaire des pertes sèches, d’autant plus considérables qu’il spécule sur de plus grandes quantités.
Rien ne décourage la production commerçante ou agricole autant que l’injustice et la violence, et rien n’est plus trompeur que les avantages momentanés qu’on en retire. Cependant, on ne s’est pas contenté de prendre des mesures violentes contre les négociants en blé, sous prétexte d’accaparements ; on a taxé le prix des blés, ce qui a toujours fait disparaître ceux que l’injustice et la violence n’amenaient pas au marché. Le mépris et le danger qu’on a attiré sur les spéculateurs en blé, ont livré ce commerce aux trafiquants du plus bas étage, soit pour les sentiments, soit pour les facultés, et il en est résulté ce qui arrive toujours : c’est que le même trafic s’est fait, mais obscurément, mais beaucoup plus chèrement, parce qu’il fallait bien que les gens à qui il était abandonné se fissent payer les inconvénients et les dangers de leur industrie.
On a excité, forcé les fermiers à porter leurs blés au marché ; on a mis les consommateurs dans la nécessité de courir les campagnes pour s’approvisionner. On a cru épargner le profit qu’aurait fait le marchand, le spéculateur, et l’on dépensait davantage. La façon nécessaire pour que le blé qui est destiné, par exemple, à la consommation d’une grande ville, soit rassemblé, apporté, distribué aux particuliers, boulangers, pâtissiers ou consommateurs, exige des soins, un travail, une industrie en un mot, et des capitaux ; ce travail et ces capitaux ne peuvent s’obtenir de personne à meilleur marché que du marchand de blé, par la raison que nul n’exécute mieux et à si bon compte une besogne, que celui qui s’en occupe exclusivement. S’il faut que le fermier soit marchand de blé, il sera forcé de diviser ses capitaux, d’en employer une partie à sa culture, et l’autre à former des magasins pour la vente ; il sera forcé de négliger en partie son occupation principale, pour faire des voyages, tenir des écritures, se procurer des moyens de transport. Ce sont ces capitaux, ce temps, cette peine que le consommateur paiera plus cher qu’il ne les paierait au marchand. Si l’acheteur est obligé de prendre lui-même une partie de ces soins et de faire une partie de ces avances, il y perdra plus que par le profit, proportionné à sa consommation, qu’il aurait payé au marchand. Les frais qu’on fait soi-même, ou qu’on paie au producteur pour éviter de passer par les mains des marchands, sont supérieurs au profit du marchand, d’autant plus qu’ils ne sont pas, comme celui-ci, soumis à la concurrence qui existe toujours entre personnes faisant le même commerce.
On a encore, pour prévenir les accaparements et pour assurer à un prix modéré des blés au consommateur, formé des greniers d’abondance, où l’on a mis en réserve le grain lorsqu’il était à bon marché, pour le revendre lorsqu’il deviendrait cher. Mais que font les marchands autre chose ? — Ils le font pour gagner, dira-t-on, et outre les frais ils se ménagent un bénéfice considérable. — Un bénéfice, d’accord ; pour considérable, cela n’est pas possible dès lors que tout le monde a la faculté d’en faire autant. Mais Turgot a fort bien prouvé, dans ses Lettres sur le commerce des grains, que les frais de l’administration, en ces sortes d’affaires, excèdent toujours les frais joints au bénéfice du marchand. Jamais on n’a vu une administration servie à bon marché, tout le monde étant intéressé à grossir ses frais et personne ne l’étant à les diminuer. Les marchands ne sont-ils pas d’ailleurs plus promptement avertis des besoins que qui que ce soit, et plus à portée d’y pourvoir ? C’est leur métier, et ce n’est pas celui de l’administration. Qu’un législateur considère d’un peu haut les marchands, grands et petits : il les verra s’agiter en tout sens et sur toute l’étendue du territoire, à l’affût des bons marchés, à l’affût des besoins, rétablissant, par leur concurrence, les prix là où ils sont trop bas pour la reproduction, et là où ils sont trop élevés pour la commodité de la consommation. De quel administrateur pourra-t-on attendre une activité si utile et si grande ? Ce sont toutes ces considérations qui ont sans doute fait dire à Smith qu’après l’industrie du cultivateur, nulle n’est plus favorable à la production des blés que celle des marchands de blé.
Les marchands, dira-t-on encore, inspirés par leurs intérêts, et même sans se communiquer, retiendront la marchandise entre leurs mains, pour ne la revendre que lorsqu’elle sera montée à un prix exorbitant.
Cela n’est pas si facile qu’on le suppose. Il faut qu’un marchand ait bien peu besoin de ses capitaux et en attende un bien gros bénéfice pour pouvoir les laisser longtemps dans des magasins ; et quand plusieurs négociants prendraient ce parti, il y en aurait toujours quelques-uns aux vues et aux facultés desquels il ne saurait convenir. Mais que dirait-on, si ce calcul même, tout affreux qu’on se le représente, se trouvait utile à la distribution la plus favorable des approvisionnements, et par conséquent conforme aux véritables intérêts du consommateur ? Ceci demande une explication.
La consommation augmente avec le bon marché ; le renchérissement au contraire met chacun sur ses gardes ; les petits consommateurs surtout, qui réunis font la plus grosse consommation, y trouvent des motifs d’épargne et de frugalité ; on se retranche une partie de la nourriture qui renchérit ; on n’en laisse perdre aucune parcelle ; on tâche de la remplacer par d’autres nourritures.
Qu’on daigne suivre ce raisonnement que j’emprunte à Smith[70] .
Quelle époque un spéculateur en grain choisit-il pour faire ses achats ? Celle, sans doute, où le grain n’étant pas rare encore, il prévoit qu’il doit le devenir. Sa prévoyance est la plus éclairée de toutes. Son intérêt lui ordonne de rassembler toutes les informations, de combiner toutes les possibilités. À cette époque, les achats qu’il fait diminuent l’abondance et occasionnent un renchérissement qui en préviendra d’autres, qui préviendra la famine peut-être, pire que tous les renchérissements ; car dès ce moment et pendant que l’abondance existe encore, il réduit la consommation, ainsi qu’on vient de le voir ; et quand survient la véritable rareté, c’est alors qu’il rend à la circulation ce qu’il avait mis en réserve. La plus haute prudence produirait à peine d’aussi bons effets.
Mais si l’administration consent à supporter des pertes, et donne le grain au prix où elle l’a acheté, ou même au-dessous, ne produit-elle pas plus de bien encore que l’intérêt personnel des marchands ?
Il faudrait pour cela que l’administration, ce qui n’est pas praticable, subvînt seule, dans le moment d’une disette, aux besoins de tout le pays ; car si les ventes qu’elle fait font baisser le prix du grain au-dessous du taux naturel où l’établissent sa rareté et les autres circonstances, elle arrête toute espèce d’approvisionnement libre : personne n’est disposé comme elle à faire le commerce pour y perdre. Je ne sais d’ailleurs ce que c’est que les générosités de l’administration. Quelles générosités peut-elle faire, si ce n’est aux dépens des administrés ? Et que gagnent ceux-ci à payer leur grain au-dessous du cours, s’il faut qu’ils paient la différence sous la forme de contributions ?
Pendant la disette qui eut lieu en 1775 dans diverses parties de la France, la municipalité de Lyon et quelques autres, pour fournir aux besoins de leurs administrés, faisaient acheter du blé dans les campagnes, et le revendaient à perte dans la ville. En même temps elles obtinrent, pour payer les frais de cette opération, une addition aux octrois, ou droits d’entrée à leurs portes. La disette augmenta ; et il y avait de bonnes raisons pour cela. On n’offrait plus aux marchands qu’un marché où les denrées se vendaient au-dessous de leur valeur, et on leur faisait acheter aux portes le droit de les y apporter !
Plus une denrée est nécessaire, et moins il convient d’en faire tomber le prix au-dessous de son taux naturel.
On conçoit maintenant, j’espère, comment les mesures mêmes qu’on a prises, en différents temps, pour faire trop baisser le prix des grains, ont précisément été celles qui l’ont trop fait monter, soit à l’instant même, soit un peu plus tard. Or je prie qu’on considère que le renchérissement est sur le chemin de la disette, que la disette est sur celui de la famine, et qu’à chaque point de cette route, tout effort qui tend à produire une plus grande rareté est un acheminement direct vers le plus grand des malheurs : aussi ne m’étonné-je point que Smith ait dit qu’une des principales causes de famine ait été les soins mêmes qu’on a pris pour s’en garantir. Un renchérissement accidentel dans le prix du blé est une circonstance fâcheuse sans doute, mais qui tient à des causes qu’il n’est pas ordinairement au pouvoir de l’homme d’écarter ; il ne faut pas qu’à ce malheur il en ajoute un autre par son impéritie, et fasse de mauvaises lois parce qu’il a eu une mauvaise récolte. La famine est comme la peste, la guerre et la plupart des autres fléaux, d’autant plus redoutable qu’on la redoute plus.
Si l’on ne juge pas à propos de s’en rapporter à l’intérêt personnel du soin d’approvisionner de grain une nation, comment s’en rapporte-t-on à lui de la plus importante des précautions nécessaires pour cela : celle d’ensemencer les terres ?
Les choses abandonnées à leur cours naturel, la famine serait une calamité bien rare. La population d’un pays ne s’élève point au-delà de ce que les produits nourrissants ordinaires de ce pays peuvent en faire subsister ; et par produits nourrissants ordinaires, j’entends non seulement ceux qui croissent sur son sol, mais encore ceux que fait entrer chez lui son industrie. Pour qu’il y ait famine, il faut donc qu’il y ait un vide notable dans l’une ou l’autre de ces productions ; un vide peu considérable, comme il y en a fréquemment, à cause de la variation dans les produits d’une nation d’une année à l’autre, ne mérite pas le nom de famine. De même que la plupart des hommes vivraient encore en mangeant, pendant une certaine année entre autre, un dixième, et peut-être un cinquième de moins que l’année précédente, une nation peut ne pas se dépeupler en consommant un peu moins de denrées nourrissantes une année que l’autre. J’ai déjà dit comment le renchérissement seul de ces denrées introduit la réserve et la frugalité dans leur consommation.
La disette des denrées nourrissantes peut provenir, ou des mauvaises récoltes, ou de circonstances contraires aux productions qui sont le fruit du commerce extérieur.
Pour ce qui est des mauvaises récoltes, il est rare qu’un pays, surtout s’il est vaste, soit partout affligé de ce malheur en même temps. Il y a toujours des cantons favorisés pendant que d’autres sont mal 706.traités ; et comme le blé croît dans les terrains secs et dans les terrains humides, la disposition de l’atmosphère qui a été contraire aux uns a dû être favorable pour les autres. Je remarquerai, à l’égard des approvisionnements procurés par le commerce, que d’après des observations qui paraissent bien faites, ce qui s’exporte de blé dans chaque pays, ou ce qui s’y consomme de blés étrangers, est peu de chose comparativement avec sa consommation totale. Suivant Steuart [71] , le pays à blé le meilleur du monde n’a jamais produit de quoi nourrir au-delà d’un tiers en sus de ses propres habitants ; et l’on estimait en Angleterre, au temps où a été écrit le Traité sur le commerce des blés, que l’importation dans ce pays n’allait pas au-delà de la 570e partie de sa consommation annuelle [72] .
Les causes de disette, et à plus forte raison de famine véritables, doivent donc être excessivement rares ; toutefois, comme ce malheur peut arriver, même quand on n’a rien fait qui dût l’attirer, il serait injuste de blâmer la sollicitude des gouvernements pour en préserver les peuples. Il n’est pas question ici d’une consommation dont on puisse se passer ou qu’on puisse remplacer efficacement par une autre ; il n’est pas question d’économie et de richesses : il s’agit de l’existence d’une partie d’un peuple ; et si elle est menacée, quels sont les moyens les moins insuffisants d’y pourvoir ? C’est ce qui me reste à examiner.
Lorsqu’un peuple ne compte que sur un seul produit pour en faire le fondement de sa subsistance, il ne faut qu’une circonstance fatale à un seul genre de production pour qu’il s’en voie privé. Quand plusieurs substances jouent un rôle important dans sa nourriture, comme il est bien plus difficile qu’elles manquent toutes à la fois, sa subsistance est évidemment plus assurée. Une nation où l’on mange communément beaucoup de viande, ou beaucoup de fruits, ou beaucoup de légumes, est donc moins exposée aux extrémités de la faim, qu’une nation qui ne se nourrit que de blé. Il est vrai que la rareté d’une denrée fait renchérir les autres ; mais un renchérissement n’est pas si fâcheux qu’un manquement absolu. C’est donc une mesure prudente que d’encourager la culture et la consommation d’une grande variété de denrées nourrissantes. Je ne me dissimule pas que l’habitude et l’opiniâtreté des gens du commun principale 709.ment ne rende fort difficile l’introduction de nouveaux aliments. J’ai vu dans certaines provinces de France une répugnance des plus marquées pour manger des pâtes façon d’Italie, qui sont pourtant une excellente nourriture, et qui offrent un fort bon moyen de conserver les farines ; et sans la disette qui a signalé quelques-unes des époques de notre Révolution, la culture et l’usage des pommes de terre pour la nourriture des hommes n’auraient point encore pénétré dans certains cantons où elles sont maintenant d’une grande ressource. On n’aurait pas la même répugnance à vaincre, lorsqu’il s’agirait d’étendre l’usage de plusieurs autres produits qui sont déjà consommés mais qui ne le sont pas en assez grande quantité pour offrir, dans l’occasion, un supplément efficace à la disette du pain ; tels sont les pois, les haricots, les fèves, les animaux de bassecour, et surtout les cochons.
Enfin, malgré ce qu’en disent les partisans de la liberté indéfinie, je crois qu’en raison des propriétés qui distinguent les grains et en général toutes denrées servant de nourriture fondamentale, on peut en défendre la sortie, lorsque leur prix excède un taux désigné d’avance, ou du moins en soumettre l’exportation à un droit un peu fort (car il vaut mieux que ceux qui sont déterminés à faire la contrebande paient leur prime d’assurance à l’État qu’à des assureurs) ; mais il faut que ce taux soit le plus haut possible ; si l’on promet une prime d’importation lorsque le prix atteint un certain taux, il faut que ce taux soit plus haut encore. Car quand un remède est lui-même un mal, il faut ne l’employer qu’au moment de l’indispensable nécessité.
[I-312]
CHAPITRE XXXVII.
Des apprentissages, des maîtrises et des règlements.↩
Le premier effet des règlements qui établissent de certaines conditions pour exercer une profession, est de réduire le nombre des personnes qui s’y livrent.
Ils réduisent ce nombre soit directement, en le fixant : telle est la loi qui fixe dans chaque ville de France le nombre des agents de change et des agents du commerce ; soit indirectement, comme le règlement qui ne permet pas aux fabricants de chapeaux, en Angleterre, de faire plus de deux apprentis. Les règlements eux-mêmes qui, sans fixer le nombre des apprentis, n’accordent la maîtrise qu’aux personnes qui ont exercé pendant plusieurs années une profession comme apprentis, et pendant plusieurs autres années comme compagnons, réduit le nombre de ceux qui l’exercent, en raison de la difficulté et des frais nécessaires pour atteindre à la qualité exigée. Enfin les règlements qui forcent à payer une finance pour exercer une profession en écartent de plus tous ceux qui ne sont pas en état de payer cette finance.
Ce premier effet entraîne deux inconvénients.
Le premier est d’enlever à chacun la liberté d’exercer son industrie et d’employer des capitaux de la manière qu’il juge la plus profitable pour lui, c’est-à-dire pour l’État.
Le second est d’établir, aux dépens du consommateur, une sorte de monopole, de privilège exclusif dont les producteurs se partagent le bénéfice. Ils peuvent d’autant plus aisément concerter des mesures favorables à leurs intérêts, qu’ils ont des assemblées légales, des syndics et d’autres officiers. Dans des réunions de ce genre, on appelle prospérité du commerce, avantage de l’État, la prospérité et l’avantage de la corporation ; et la chose dont on s’y occupe le moins, c’est d’examiner si les bénéfices qu’on se promet sont le résultat d’une production véritable, ou bien simplement un argent qui change de poche, un argent qui passe des mains des autres citoyens de l’État, entre les mains des citoyens privilégiés.
C’est pourquoi les gens exerçant une profession quelconque sont ordinairement portés à solliciter des règlements de la part de l’autorité publique, et l’autorité publique y trouvant toujours de son côté l’occasion de lever de l’argent, est fort disposée à les accorder. Les règlements, d’ailleurs, flattent l’amour-propre de ceux qui disposent du pouvoir : ils leur donnent l’air de la sagesse et de la prudence ; ils confirment leur autorité, qui paraît d’autant plus indispensable qu’elle est plus souvent exercée.
Aussi n’existe-t-il peut-être pas un seul pays en Europe où il soit libre à un homme de disposer de son industrie et de ses capitaux selon ses convenances ; dans la plupart on ne peut changer de place et de profession à son gré. Il ne suffit pas qu’on ait la volonté et le talent nécessaires pour être fabricant et marchand d’étoffes de laine ou de soie, de quincailleries ou de liqueurs ; il faut encore qu’on ait acquis la maîtrise ou qu’on fasse partie d’un corps de métiers.
Ce système a des avantages comme des inconvénients, mais avec cette différence que ses inconvénients sont positifs, inévitables, et que ses avantages sont incertains.
Je ne m’arrête pas à l’avantage de pouvoir entretenir une meilleure police parmi les marchands, par cela même qu’ils sont, pour ainsi dire, enrégimentés. C’est un moyen trop disproportionné avec le but. La discipline des armées est nécessaire pour vaincre ; mais établir la discipline pour avoir une discipline, serait folie, et accuserait la faiblesse d’un gouvernement.
L’avantage principal et celui sur lequel on appuie le plus volontiers, est de procurer au consommateur des produits d’une exécution plus parfaite, garantie qui est favorable au commerce national, et assure la continuation de la faveur des étrangers.
Mais cet avantage l’obtient-on par les maîtrises ? Sont-elles une garantie suffisante que le corps de métiers n’est composé, je ne dis pas seulement d’honnêtes gens, mais de gens très délicats, comme il faudrait qu’ils fussent pour ne jamais tromper ni leurs concitoyens, ni l’étranger ?
Les maîtrises, diton, facilitent l’exécution des règlements qui vérifient et attestent la bonne qualité des produits ; mais même avec les maîtrises, ces vérifications et ces attestations ne sont-elles pas illusoires ? Et dans le cas où elles sont absolument nécessaires, n’y a-t-il aucun moyen plus simple de l’obtenir ?
La longueur de l’apprentissage ne garantit pas mieux la perfection du travail. C’est l’aptitude de l’ouvrier et un salaire proportionné au mérite de son travail qui seuls garantissent efficacement cette perfection.
« Il n’est point de profession mécanique, dit Smith, dont les procédés ne puissent être enseignés en quelques semaines, et pour quelques-unes des plus communes, quelques jours sont suffisants. La dextérité de la main ne peut, à la vérité, être acquise que par une grande pratique ; mais cette pratique elle-même ne s’acquerrait-elle pas plus promptement si un jeune homme, au lieu de travailler comme apprenti, c’est-à-dire de force, nonchalamment et sans intérêt, était payé selon le mérite et la quantité de son ouvrage, sauf par lui à rembourser au maître les matériaux que son inexpérience ou sa maladresse gâterait ? » [73]
Les frais de la longue et coûteuse éducation d’un apprenti sont un capital qui renchérit les denrées que cet apprenti, devenu ouvrier, produit dans la suite, parce qu’il faut qu’indépendamment de tout le reste, le prix de ces marchandises en paie l’intérêt.
Si les apprentissages étaient un moyen d’obtenir des produits plus parfaits, les produits de l’Espagne vaudraient ceux de l’Angleterre. N’est-ce pas depuis l’abolition des maîtrises et des apprentissages forcés que la France a réussi à atteindre des perfectionnements dont elle était bien loin avant cette époque ? J’en atteste la belle exposition des produits de l’industrie française qui se fait annuellement au Louvre.
De tous les arts mécaniques, le plus difficile, peut-être, est celui du jardinier et du laboureur, et c’est le seul qu’on permette partout d’exercer sans apprentissage. En recueille-t-on des fruits moins beaux et des légumes moins abondants ? S’il y avait un moyen de former une corporation de cultivateurs, on nous aurait bientôt persuadés qu’il est impossible d’avoir des laitues bien pommées et des pêches savoureuses, sans de nombreux règlements composés de plusieurs centaines d’articles.
Enfin ces règlements, en les supposant utiles, sont illusoires du moment qu’on peut les éluder ; or il n’est pas de ville manufacturière où l’on ne soit dispensé de toutes les épreuves avec de l’argent ; et elles deviennent ainsi non seulement une garantie inutile, mais une occasion de passe-droits et d’injustices ; ce qui est odieux.
Ceux qui soutiennent le système réglementaire citent à l’appui de leur opinion la prospérité des manufactures d’Angleterre, où l’on sait qu’il y a beaucoup d’entraves à l’exercice de l’industrie manufacturière. Mais ils méconnaissent les véritables causes de cette prospérité.
« Les causes de la prospérité de l’industrie dans la GrandeBretagne, dit Smith [74] , sont cette liberté de commerce qui, malgré nos restrictions, est pourtant égale, et peut-être supérieure à celle dont on jouit dans quelque pays du monde que ce soit ; cette faculté d’exporter, sans droits, presque tous les produits de l’industrie domestique, quelle que soit leur destination ; et, ce qui est plus important encore, cette liberté illimitée de les transporter d’un bout à l’autre du royaume, sans être obligé de rendre aucun compte, sans être ex posé dans aucun bureau quelconque, au moindre examen, à la plus simple question, etc. »
Qu’on y joigne le respect inviolable de toutes les propriétés, soit de la part de tous les agents du gouvernement sans exception, soit de la part des particuliers, et l’on aura une explication suffisante de la prospérité de l’Angleterre.
Les personnes qui citent l’Angleterre pour justifier les chaînes dont elles voudraient charger l’industrie, ignorent encore qu’il y a en même temps en Angleterre beaucoup de lieux qui, sous différents prétextes, jouissent de plusieurs franchises et libertés, faveurs injustes sans doute, puisqu’elles ne sont pas communes à tous, mais qui n’ont pas moins grandement contribué à la prospérité des manufactures de cette nation. Manchester, Birmingham, Liverpool, qui n’étaient que des bourgades il y a deux siècles, se placent maintenant, relativement à la population et aux richesses, immédiatement après Londres et fort avant York, Cantorbery et même Bristol, villes anciennes, favorisées et capitales des principales provinces. Rien n’annonce que la prospérité des premières soit parvenue à son plus haut période ; chaque jour leur importance augmente ; elles font la richesse de leur nation en même temps que la leur propre. Sans doute plusieurs circonstances leur ont valu cette prospérité ; mais la principale et la plus généralement reconnue, est la liberté : il ne s’y trouve point de corps de métiers ; chacun peut y venir exercer son industrie et se livrer à toutes les spéculations qui lui conviennent [75] .
« La ville et la paroisse de Halifax, dit un auteur anglais qui passe pour bien connaître son pays, John Nickolls [76] , ont vu, depuis quarante ans, quadrupler le nombre de leurs habitants ; et plusieurs villes sujettes aux corporations ont éprouvé des diminutions sensibles. Les maisons situées dans l’enceinte de la cité à Londres se louent mal, tandis que Westminster, Southwark et les autres faubourgs prennent un accroissement continuel. Ils sont libres ; et la cité a quatre-vingt-douze compagnies exclusives de tous genres, dont on voit les membres orner tous les ans le triomphe du maire ».
Plus près de nous, n’avons-nous pas vu la prodigieuse activité des manufactures de quelques faubourgs de Paris et principalement du faubourg SaintAntoine, où l’industrie jouissait de quelques franchises ? Il y a tel produit qu’on ne savait faire que là. Comment arrivait-il donc qu’on y fût plus habile, sans apprentissage, sans compagnonnage forcé, que dans le reste de la ville où l’on était assujetti à ces règles qu’on cherche à faire envisager comme si essentielles ? C’est que l’intérêt privé est le plus habile des maîtres.
De même que des villes fleurissent au milieu de plusieurs autres qui déclinent, ou qui du moins font des progrès moins sensibles, une nation qui, au milieu de beaucoup d’autres nations réglementées, établirait chez elle la même liberté, en recueillerait probablement les mêmes fruits. Celles qui ont eu le moins d’entraves s’en sont le mieux trouvées. Ce qui est vrai d’une ville, d’une province, est vrai d’une nation relativement à toutes les autres. Sully, qui passait sa vie à étudier et à mettre en pratique les moyens de prospérité de la France, avait la même opinion. Il regarde dans ses Mémoires [77] la multiplicité des édits et des règlements inutiles comme un obstacle direct à la prospérité de l’État.
Colbert, élevé jeune dans le magasin des Mascrani, riches marchands de Lyon, s’y était imbu de bonne heure des principes des manufacturiers. Il fit grand bien au commerce et aux manufactures parce qu’il leur accorda une protection puissante et éclairée, mais il ne fut pas assez sobre d’ordonnances ; il fit peser sur l’agriculture les encouragements qu’il donna aux fabriques, et les profits brillants de certains monopoles furent payés par le peuple.
Qu’on ne s’y méprenne pas : c’est en grande partie ce système, plus ou moins suivi depuis Colbert jusqu’à nos jours, qui a procuré à la France de très grandes fortunes et une très grande misère ; des manufactures florissantes sur quelques points de son territoire, et des chaumières hideuses sur mille autres ; ce ne sont point ici des abstractions : ce sont des faits, dont l’étude des principes donne l’explication.
Si les principes d’une saine politique condamnent les actes de l’administration qui limitent la faculté que chacun doit avoir de disposer en liberté de ses talents et de ses capitaux, il est encore plus difficile de justifier de telles mesures en suivant les principes du droit naturel.
« Le patrimoine du pauvre, dit l’auteur de la Richesse des nations, est tout entier dans la force et l’adresse de ses doigts ; ne pas lui laisser la libre disposition de cette force et de cette adresse, toutes les fois qu’il ne l’emploie pas au préjudice des autres hommes, c’est attenter à la plus indisputable des propriétés ».
Mais comme il est aussi de droit naturel qu’on soumette à des règles une industrie qui, sans ces règles, pourrait devenir préjudiciable aux autres citoyens, c’est très justement qu’on assujettit les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, à des épreuves qui sont des garants de leur habileté. La vie de leurs concitoyens dépend de leurs connaissances : on peut exiger que leurs connaissances soient constatées ; mais suivant les principes énoncés plus haut, on ne doit, ni relativement à ces professions, ni relativement à aucune autre, fixer le nombre des praticiens, ni la manière dont ils doivent s’instruire. La société a intérêt de constater leur capacité, et rien de plus.
[I-325]
CHAPITRE XXXVIII.
Quels règlements sont utiles.↩
Josias Child disait aux Anglais en 1669 :
« Si les lois qui obligent nos fabricants à faire du drap fort, d’une certaine longueur, largeur et poids, étaient exactement suivies, et qu’on y tînt la main, elles nous seraient beaucoup plus nuisibles qu’utiles, parce que les fantaisies des hommes changent et que quelquefois on aime mieux un drap peu foulé, léger et à bon marché, comme aujourd’hui, qu’un drap plus pesant, plus fort et en effet mieux fabriqué. Si nous voulons étendre notre commerce sur tout le globe, il faut imiter les Hollandais qui font chez eux de mauvaises marchandises aussi bien que de bonnes, afin d’être en état de fournir tous les marchés et de satisfaire tous les goûts [78] . »
Par quel motif prescrirait-on à un producteur de fabriquer sa marchandise de telle façon plutôt que de telle autre ? est-ce pour qu’elle se débite mieux ? Eh ! qui est plus intéressé à cela que lui !
Mais les règlements sont bons et utiles chaque fois qu’ils préviennent une fraude, une pratique qui nuit évidemment à d’autres productions, ou à la sûreté du public.
Il ne faut pas qu’un fabricant puisse annoncer sur son étiquette une qualité supérieure à celle qu’il a fabriquée. Sa fidélité intéresse le consommateur indigène à qui le gouvernement doit sa protection. Elle intéresse le commerce que la nation fait au-dehors ; car l’étranger cesse bientôt de s’adresser à une nation qui le trompe.
Et remarquez que ce n’est point le cas d’appliquer l’intérêt personnel du fabricant comme la meilleure des garanties. À la veille de quitter sa profession, il peut vouloir en forcer les profits aux dépens de la bonne foi, et sacrifier l’avenir dont il n’a plus besoin, au présent dont il jouit encore. C’est ainsi que dès l’année 1783 les draperies françaises perdirent toute faveur dans le commerce du Levant et furent supplantées par les draperies allemandes et anglaises [79] .
Ce n’est pas tout. Le nom seul de l’étoffe, celui même de la ville où une étoffe est fabriquée, sont souvent une étiquette. On sait par une longue expérience que les étoffes qui viennent de tel endroit, ont telle largeur, que les fils de la chaîne sont en tel nombre. Fabriquer, dans la même ville, une étoffe de même nom, et s’écarter de l’usage reçu, c’est y mettre une fausse étiquette.
Cela suffit, je crois, pour indiquer jusqu’où peut s’étendre l’intervention utile du gouvernement. Il doit certifier la vérité de l’étiquette, et, du reste, ne se mêler en rien de la production. Je voudrais même qu’on ne perdît pas de vue que cette intervention, même utile, est un mal. Elle est un mal, d’abord parce qu’elle vexe et tourmente les particuliers, et ensuite parce qu’elle est coûteuse, soit pour le peuple quand l’intervention du gouvernement est gratuite, c’est-à-dire quand elle a lieu aux frais du Trésor public ; soit pour le consommateur, quand on prélève les frais en une taxe sur la marchandise. L’effet de cette taxe est de la faire renchérir ; or le renchérissement est pour le consommateur indigène une charge de plus, et pour le consommateur étranger un motif d’exclusion.
Si l’intervention du gouvernement est un mal, un bon gouvernement la rendra aussi rare qu’il sera possible. Il ne garantira point la qualité des marchandises sur lesquelles il serait moins facile de tromper l’acheteur que lui-même ; il ne garantira point celles dont la qualité n’est pas susceptible d’être vérifiée par ses agents, car un gouvernement a le malheur d’être toujours obligé de compter sur la négligence, l’incapacité et les coupables condescendances de ses agents. Mais il admettra par exemple le contrôle de l’or et de l’argent. Le titre de ces métaux ne saurait être constaté que par une opération chimique très compliquée, que la plupart des acheteurs ne sont pas capables d’exécuter, et qui, pussent-ils en venir à bout, leur coûterait plus qu’ils ne paient au gouvernement pour l’exécuter à leur place.
Chez les nations même les plus libres, l’autorité publique a pu, sans nuire à la production, s’ingérer dans les affaires des particuliers. Quoiqu’elle n’ait certainement pas le droit de punir la négligence, lorsque la négligence ne fait tort qu’à celui qui s’en rend coupable, elle peut la réprimer quand ses effets sont de nature à s’étendre sur des particuliers innocents. C’est très justement qu’on ordonne l’échenillage des arbres et la suppression de certaines plantes dont la semence est sujette à se propager.
Dans l’ancien canton de Berne on obligeait chaque propriétaire, dans la saison des hannetons, à fournir un nombre de boisseaux de ces insectes, proportionné à l’étendue de ses possessions. Les riches propriétaires achetaient ces boisseaux d’hannetons à de pauvres gens qui faisaient métier de les chasser, et y réussissaient si bien que le pays n’était plus exposé à leurs ravages.
C’est même principalement dans les pays libres qu’on trouve le plus de semblables règlements. La propriété y est si respectée qu’il semble qu’on la protège, non seulement contre les atteintes directes des malveillants, mais aussi contre la négligence des insouciants.
Il convient seulement que ces règlements, et en général tous ceux que réclame la sûreté publique, imposent le moins de gênes qu’il est possible. L’habileté de l’administration consiste à en alléger le poids. Les navires qui viennent du Levant subissent en arrivant dans nos ports une quarantaine sévère ; rien de mieux. Mais d’où vient que nous la faisons subir aux navires qui arrivent pour repartir ? Il suffirait d’y soumettre les marchandises qu’ils auraient apportées. Cette formalité superflue nuit à l’activité de notre commerce avec le Levant [80] .
Je n’ai point prétendu blâmer de si sages règlements en raison de ce qu’ils peuvent avoir d’incommode. Tout système absolu est un excès. Tout excès est mal. J’ai voulu seulement faire apprécier à leur juste valeur et les avantages et les inconvénients qui en résultent, afin qu’on n’adoptât pas légèrement des conseils dont on n’apercevrait que les avantages, et qu’on ne proscrivît pas sans appel des mesures dont on ne verrait que les défauts.
J’ajouterai encore un mot. C’est que si les règlements sont un mal, même quand ils produisent du bien, ils sont un mal déplorable lorsqu’ils ne doivent pas être suivis des avantages qu’on s’en propose ; ce qui arrive lorsqu’ils sont mal conçus ou mal exécutés.
« On a établi en France, dit Steuart, un conseil pour veiller à l’entretien et à la multiplication des bois. Quiconque plante un arbre se met sous la juridiction de la Table de marbre, et ne peut le couper ni en disposer sans la permission de ce bureau. C’est en grande partie pour cette raison qu’on voit si peu d’arbres autour des villages de France. [81] ».
Dans combien d’autres circonstances n’a-t-on pas pris beaucoup de peines et dépensé beaucoup d’argent pour augmenter le mal auquel on cherchait à remédier !
Combien de règlements assez exécutés pour produire tout le mal que des règlements peuvent faire, et assez violés pour conserver, en même temps, tous les inconvénients de la licence !
Il n’est pas de mon sujet de rechercher les causes du défaut d’exécution des actes de l’autorité publique. Je me bornerai à dire, en passant, qu’aucune mesure n’est bien exécutée, qu’autant qu’il se trouve quelqu’un qui soit directement intéressé à son exécution.
[I-333]
CHAPITRE XXXIX.
S’il convient que le gouvernement concoure à la production.↩
Le commerce est la profession des gens égaux, dit Montesquieu [82] . Si un gouvernement manque à ses engagements, le traduirez-vous devant un tribunal ? Si vous l’y traduisez, le tribunal osera-t-il le condamner ? S’il l’ose, par qui la sentence sera-t-elle exécutée ?
Il n’est pas d’homme assez simple pour ne pas faire toutes ces réflexions, et même d’autres encore, quand il traite avec le gouvernement. Il prend donc ses avantages et conclut ses marchés de telle manière qu’indépendamment du profit qu’il en attend, il s’en ménage un autre pour couvrir les risques qu’il court. Le gouvernement est donc nécessairement dupe dans tous ses marchés.
Sans doute il doit en prendre son parti quant aux marchés dont il ne peut se dispenser, ceux par le moyen desquels il se procure les objets de sa consommation ; mais rien ne l’oblige à multiplier les occasions d’éprouver ce dommage en devenant producteur.
La manufacture de tapisserie des Gobelins, qui est entretenue par le gouvernement de France, consomme des laines, des soies, des teintures ; elle consomme la rente de son local, l’entretien de ses ouvriers ; toutes choses qui devraient être remboursées par ses produits et qui sont loin de l’être. La manufacture des Gobelins, loin d’être une source de richesses, je ne dis pas seulement pour le gouvernement qui sait bien qu’il y perd, mais pour la nation toute entière, est pour elle une cause toujours subsistante de perte. La nation perd annuellement toute la valeur dont les consommations de cette manufacture excèdent ses produits.
On dit que ce sacrifice est nécessaire pour fournir au gouvernement les moyens de faire des présents et d’orner ses palais. Ce n’est point ici le lieu d’examiner jusqu’à quel point une nation est mieux gouvernée quand elle fait des présents et quand elle orne des palais ; je suppose que ces ornements et ces présents sont nécessaires ; dans ce cas, il ne convient pas à une nation d’ajouter aux sacrifices que réclament sa magnificence et sa libéralité, les pertes auxquelles elle s’expose quand son gouvernement devient cultivateur, manufacturier, ou commerçant. Il lui convient d’acheter tout bonnement ce qu’elle juge à propos de donner. Avec la même quantité d’argent sacrifiée, elle aura certainement un produit plus précieux, car les particuliers fabriquent à moins de frais que le gouvernement.
À la considération qui précède, on peut ajouter celle-ci : c’est qu’un État, quelqu’entreprise qu’il exploite, n’agit jamais que par procureurs, c’est-à-dire que par l’intermédiaire de gens qui ont un intérêt particulier, distinct du sien, et qui leur est beaucoup plus cher.
Que si le gouvernement a des capitaux dont il puisse disposer, il convient donc qu’il les prête plutôt que de les faire valoir. Le dépositaire de ces fonds, quel qu’il soit, en tirera un meilleur parti que le gouvernement n’aurait pu faire. Dans un pays mal pourvu de capitaux, c’est le plus efficace des encouragements qu’un gouvernement puisse accorder à l’industrie.
Les efforts de l’État pour créer des produits ont un autre inconvénient. Ils sont nuisibles à l’industrie des particuliers ; non des particuliers qui traitent avec lui, et qui, comme nous l’avons vu, s’arrangent pour ne rien perdre ; mais à l’industrie des particuliers qui n’ont avec lui aucune relation. L’État est un agriculteur, un cultivateur, un négociant riche, qui a trop d’argent à sa disposition et s’intéresse trop peu à ses propres affaires. Il peut consentir à vendre un produit au-dessous du prix coûtant. Il peut consommer, produire, accaparer en peu de temps une quantité de produits telle que la proportion qui s’établit naturellement entre les prix des choses soit violemment dérangée ; or, tout changement brusque dans le prix des choses est funeste. Le producteur assoit ses calculs sur la valeur présumable des produits au moment où ils seront achevés. Rien ne le décourage comme une variation qui se joue de tous les calculs. Les pertes qu’il fera seront aussi peu méritées que les profits extraordinaires que de telles variations peuvent lui procurer. Ces profits extraordinaires ne seront acquis qu’aux dépens du consommateur ; or de qui se compose la classe la plus nombreuse des consommateurs ? d’ouvriers, de gens vivant du travail de leurs mains. De là des variations dans le taux des salaires, c’est-à-dire dans le prix de beaucoup d’autres produits.
Ce n’est pas tout. Du moment que des causes accidentelles font varier les prix, ils ne se remettent pas promptement à leur taux naturel. Telle est l’aiguille d’une boussole qu’une secousse détourne de sa direction accoutumée : elle tend de nouveau vers le nord, mais ne s’y remet pas sans des oscillations prolongées. Il s’établit alors un genre de spéculation qui cherche ses gains, non dans un accroissement de valeur donné à la denrée, mais dans la différence de son prix d’hier à son prix d’aujourd’hui. Industrie qui n’est nullement productive et dont les profits se fondent sur des pertes ; ou plutôt, désordre dont les intrigants et les fripons profitent seuls et dont l’homme laborieux est la victime ; car il s’occupe plus de sa production que de s’instruire des finesses de l’agiot et des variations du cours.
Or ce désordre est fréquent là où le gouvernement veut entrer dans la lice où les producteurs joutent les uns contre les autres avec des ressources qui ne sont pas trop inégales.
Ce serait à tort cependant que, fondé sur les motifs qui précèdent, un gouvernement voudrait s’interdire toute espèce de production. Il en est telle qui ne convient qu’à ses vastes moyens, et de ce nombre sont beaucoup de produits à son usage ou à l’usage du public, les chemins, les canaux, les édifices, et tous les objets dans la production desquels il n’entre point en rivalité avec les particuliers et ne se fait pas leur pourvoyeur à prix d’argent. Que de créations à la fois utiles et magnifiques peuvent naître d’un gouvernement pénétré de l’amour des peuples et du sentiment de la vraie grandeur ! Que font dans l’oisiveté de la paix les soldats qui ont défendu l’État dans la guerre ? Jeunes, adroits, pleins de force et de constance, pourquoi tant de précieuses facultés se rouillent-elles dans d’obscures garnisons ? Nos ports sont-ils trop vastes et trop nombreux ? Nos communications sont-elles trop faciles ? L’eau circule-t-elle trop abondamment dans nos cités ? — Mais, diton, il y a de puissants préjugés à vaincre, de nombreuses difficultés à surmonter. — Sans doute ; eh ! qui l’ignore ? Mais aussi, des préjugés à vaincre, des difficultés à surmonter, c’est de la gloire à recueillir et des bénédictions à recevoir.
[I-340]
CHAPITRE XL.
En quoi l’autorité publique travaille efficacement à la richesse nationale.↩
On a vu combien l’autorité publique favorise peu la production par des prohibitions, des contraintes, des privilèges, des primes d’encouragement ; ou plutôt on a vu combien par tous ces moyens même un gouvernement nuit à la production qu’il se propose d’encourager.
On a vu que lorsqu’un gouvernement veut se faire producteur lui-même, il détruit ordinairement plus qu’il ne produit.
Quelques écrivains, frappés de toutes ces conséquences, n’ont pas craint d’affirmer que, relativement à la production, et par conséquent à l’enrichissement de l’État, l’autorité fait toujours assez de bien quand elle ne fait pas de mal. C’est aussi fermer les yeux à d’autres conséquences qui ne sont pas moins nécessaires.
Et d’abord la sûreté des personnes et des propriétés, garantie par la plupart des gouvernements, est plus favorable à la prospérité générale que toutes les entraves inventées jusqu’à ce jour ne lui sont contraires. Les entraves arrêtent l’essor de la production. Le défaut de sûreté la supprime totalement.
Voyez l’Afrique presqu’entière, l’Arabie, la Perse, cette Asie mineure, autrefois couverte de villes si florissantes dont, suivant l’expression de Montesquieu, il ne reste de vestiges que dans Strabon : on y est pillé par des brigands, par des pachas ; la richesse et la population ont fui ; et les hommes clairsemés qui y restent manquent de tout. Jetez au contraire les yeux sur l’Europe occidentale ; quoiqu’elle soit fort éloignée d’être aussi florissante qu’elle le devrait, la plupart des États y prospèrent, tout accablés qu’ils sont d’une foule de règlements et d’impôts, par cela seul qu’on y est, en général, à l’abri des outrages personnels et des spoliations arbitraires.
Sans doute il vaut mieux pour l’industrie que la liberté soit compagne de la sûreté. Poivre, qui avait beaucoup voyagé, dit qu’il n’a jamais vu de pays véritablement prospères, que ceux où elles se trouvaient réunies. Mais il n’en est pas moins avantageux de pouvoir se procurer l’une, dût-on sacrifier une portion de l’autre, et il reste de quoi bénir un gouvernement qui lie quelques-uns de vos membres, mais qui défend votre corps.
Il est bon cependant de remarquer que ce n’est pas seulement en vous mettant à l’abri des voleurs de grand chemin, qu’un bon gouvernement vous protège ; c’est aussi en vous garantissant des brigandages, bien plus redoutables, des gens puissants par leur crédit ou par leurs richesses ; c’est en préservant l’homme d’honneur des tracasseries des gens de lois ; c’est en forçant chacun à respecter ses engagements. Smith, passant en revue les véritables causes de la prospérité de la GrandeBretagne, met au premier rang
« cette prompte et impartiale administration de la justice qui rend les droits du dernier des citoyens respectables pour le plus puissant, et qui assurant à chacun le fruit de son travail, donne le plus réel de tous les encouragements à toute espèce d’industrie. [83] ».
Les Athéniens cherchaient par quels moyens ils pourraient ranimer leur commerce et attirer les étrangers dans leurs ports, Xénophon leur conseilla d’être rigoureusement justes envers tout le monde.
Mais combien d’autres moyens encore entre les mains de l’autorité publique de concourir indirectement à augmenter les richesses nationales ! Elle embellit les routes, creuse les canaux, répare les ports et rend ainsi les productions du commerce plus faciles et moins coûteuses. Elle favorise par une foule d’établissements les lumières, dont nous avons vu que le concours est indispensable pour la production. Elle envoie des voyageurs instruits aux extrémités du globe pour y conquérir de nouvelles richesses et consoler les nations de leurs succès militaires.
Et remarquez bien que les sacrifices qu’on fait pour reculer les bornes des connaissances humaines, ou simplement pour en conserver le dépôt, ne doivent pas être condamnés même lorsqu’ils n’ont rapport qu’à celles dont on n’aperçoit pas l’utilité immédiate. Toutes les connaissances se tiennent. Il est nécessaire qu’une science purement spéculative soit avancée, pour que telle autre qui a donné lieu aux plus heureuses applications le soit également. Il est impossible d’ailleurs de prévoir à quel point un phénomène qui ne paraît que curieux peut devenir utile. Lorsque le Hollandais Otto Guericke tira les premières étincelles électriques, pouvait-on soupçonner qu’elles mettraient Franklin sur la voie de diriger la foudre et d’en préserver nos édifices ? Entreprise qui semblait excéder de si loin les efforts du pouvoir de l’homme !
Ce n’est donc point un faste inutile que ces académies, ces écoles, ces nombreuses bibliothèques, ces vastes dépôts et toutes ces belles institutions dont j’aime à trouver le modèle dans mon pays. Combien le Muséum d’histoire naturelle de Paris n’a-t-il pas procuré de richesses à la France en donnant à nos colonies une seule plante : le café [84] !
Les voyages entrepris pour faire des découvertes sont des essais dispendieux, mais jusqu’à présent l’Europe a été dédommagée de ses sacrifices et doit l’être encore mieux. Combien d’arbres nouveaux, d’animaux, de légumes, ne devons-nous pas à des pays lointains, et dont nos ancêtres n’avaient pas la moindre idée ? Nous oublions tous les jours que la pomme de terre, ce légume précieux par son abondance autant que par sa qualité, qui croît à l’abri des intempéries de l’air, qui sert à la nourriture du pauvre comme du riche et prend toutes les formes pour plaire à tous les goûts, a été apportée de Virginie en Irlande, il n’y a pas plus de deux siècles. L’Amérique septentrionale nous a également fait connaître le poulet d’Inde vers la même époque. La brebis d’Espagne commence à passer du sein des fermes nationales sous le chaume du pauvre agriculteur et promet à nos manufactures des laines précieuses par leur abondance comme par leur beauté. Il en sera de même du buffle qui partage avec le cochon le dangereux honneur d’être profitable dans toutes ses parties. Déjà l’arbre à pain de la mer du Sud se propage dans les établissements français et l’on ne perd pas l’espérance de le naturaliser en Europe. Nos basses-cours, nos jardins, nos forêts, seront peuplés dans deux cents ans d’habitants qu’ils ne connurent jamais ; et nos descendants devront ces bienfaits aux efforts, aux lumières des gouvernements actuels.
Que si l’on prétendait qu’un nouveau produit en exclut un ancien, que le même territoire ne pouvant porter qu’un certain nombre de végétaux, des acquisitions nouvelles ne sont propres qu’à favoriser l’inconstance de l’homme, on ferait un pauvre raisonnement.
En premier lieu, quand un nouveau produit en exclurait nécessairement un autre, il faudrait toujours présumer qu’il est préférable à l’ancien dès lors qu’il est préféré. Les habitants des Gaules mangeaient autrefois du gland, dit-on ; le froment, qui donne une nourriture plus saine, plus délicate et plus abondante, n’en fut pas moins pour eux une acquisition précieuse.
En second lieu, c’est un avantage que de pouvoir cultiver deux produits au lieu d’un seul, et d’avoir la faculté de les varier suivant les goûts, les circonstances et les terrains. Qui sait si une lande, si un site abandonnés comme incapables de donner aucun produit, ne sont pas emplis de futures richesses ? Une saison qui n’est pas favorable aux produits que nous avons, le serait peut-être à ceux qui nous manquent ; chaque produit qu’on acquiert offre quelque propriété inconnue, par le moyen de laquelle on se procure une nouvelle jouissance ou l’on se préserve d’une ancienne incommodité.
La puissance d’un gouvernement éclairé, par l’influence qu’elle exerce sur les relations politiques des différents peuples, peut encore être singulièrement favorable à la prospérité qui résulte de l’extension du commerce. Mais à peine ose-t-on insister sur cette vérité dont les gouvernements d’Europe ne sont déjà que trop persuadés, et à laquelle ils donnent beaucoup trop d’importance. C’est cette persuasion qui nous a valu presque toutes les guerres qui ont affligé les quatre parties du monde depuis deux cents ans, et qui ont plus nui mille fois à la prospérité publique, qu’elles ne l’auraient servie, en supposant même que chaque puissance eût pleinement gagné le point qui lui a fait prendre les armes. peut-être les progrès qu’on fera dans la connaissance des véritables sources de la production nous garantiront-ils, du moins jusqu’à un certain point, du retour des mêmes fléaux. On s’apercevra que le commerce étranger n’est pour un grand État qu’une branche, presque toujours moins étendue qu’on ne la suppose, de son commerce total [85] ; et que la totalité de son commerce, c’est-à-dire toute son industrie commerçante, est peut-être la moins importante des trois industries qui lui procurent des richesses. On s’apercevra enfin que relativement à la partie de l’industrie commerçante qui traite avec l’étranger, tout gouvernement a dans ses mains un moyen de l’animer, plus puissant que tous ceux dont les gouvernements étrangers disposent : c’est de n’y point mettre d’obstacles lui-même.
J’ai oublié de parler d’un autre moyen par lequel un gouvernement peut contribuer à enrichir momentanément son pays. Ce moyen consiste à dépouiller les autres nations de toutes leurs richesses mobilières pour les rapporter dans son pays, et à leur imposer des tributs énormes pour les dépouiller des biens encore à naître : c’est ce que firent les Romains vers les derniers temps de la république et sous les premiers empereurs ; ce système est analogue à celui que suivent les gens qui abusent de leur pouvoir et de leur adresse pour s’enrichir. Ils ne produisent pas : ils ravissent les produits des autres.
Je fais mention de ce moyen d’accroître ses richesses, pour les embrasser tous ; mais sans prétendre que ce soit le plus honorable, ni même le plus sûr. Si les Romains avaient suivi avec la même persévérance un autre système, s’ils avaient cherché à répandre la civilisation chez les barbares, et s’ils avaient établi avec eux des relations d’où fussent résultés des besoins réciproques, il est probable que la puissance romaine subsisterait encore.
[I-350]
CHAPITRE XLI.
Si la prospérité d’une nation nuit à celle des autres.↩
Aussi longtemps qu’on s’est imaginé que la richesse consistait en une certaine marchandise (de l’or et de l’argent par exemple), plutôt qu’en toute autre, on a dû croire que l’enrichissement d’un État était contraire à l’enrichissement d’un autre. Il n’y a dans le monde qu’une certaine quantité de métaux précieux ; il est bien certain que plus une nation possède de cette denrée, moins il en reste pour les autres. Mais quand on vient à s’apercevoir que la richesse se compose de toutes les choses qui ont une valeur, on envisage la question sous un point de vue tout à fait différent.
Que l’Angleterre possède une multitude de choses précieuses, est-ce une raison qui nous empêche d’en posséder aussi ? Si elle possède du coton pour une valeur supérieure à ce que nous en avons, ne pouvonsnous pas posséder d’une autre denrée, de la soie, par exemple, pour une valeur supérieure à ce qu’elle en a ? L’Espagne qui, proportionnellement à sa population et à son commerce, a plus d’argent qu’aucun autre pays d’Europe, passe néanmoins pour un des plus indigents.
Si la richesse d’une nation se compose de la valeur totale des choses qu’elle possède, il est même naturel de croire qu’il vaut mieux avoir pour voisine une nation riche qu’une nation pauvre ; car la nation riche peut vous acheter ce que l’autre ne serait pas en état de payer ; c’est-à-dire peut vous donner une partie de ses richesses contre une partie des vôtres. Et qu’on ne s’imagine point que cet échange vous soit onéreux parce que les gains que vos voisins font dans leurs échanges avec vous se font à vos dépens. On a déjà vu [86] que de deux nations qui commercent ensemble, non seulement l’une ne perd point ce que l’autre gagne, mais que le plus souvent elles gagnent toutes les deux. Elles se partagent l’augmentation de valeur qu’acquièrent les marchandises qui, dans l’échange, passent de l’une à l’autre.
Il en est de cela comme des profits que les habitants des villes font sur les gens de la campagne, et que ceux-ci font sur les premiers ; ils ne sont une perte ni pour les uns ni pour les autres. Au contraire, leurs relations mutuelles les accommodent également ; il n’y a pas de campagnes plus riches que celles qui avoisinent les grandes villes. Ainsi non seulement l’on n’a point lieu d’être jaloux des profits qu’un peuple fait sur les marchandises qu’il vous vend ; mais puisque les gains sont réciproques, on a intérêt à ce que les nations avec qui l’on trafique deviennent industrieuses et riches. Alors les objets d’échange se multiplient : vos productions s’augmentent de tout ce que vous fabriquez dans le but de vendre, et vos jouissances de tout ce que vous achetez avec vos produits.
C’est à la suite de réflexions de ce genre que le gouvernement des ÉtatsUnis a entrepris en 1802 de civiliser les Creeks, ses sauvages voisins. Il a voulu leur donner de l’industrie et en faire des producteurs, pour qu’ils pussent donner quelque chose en échange aux Américains ; car on ne gagne rien à vendre à un peuple qui n’a pas de quoi payer.
Je n’aurais rien de plus à dire sur ce sujet, si l’on n’avait pas lieu de craindre qu’une nation industrieuse qui s’élève dans votre voisinage, en même temps qu’elle vous offre des relations profitables, n’acquière aussi des moyens de vous supplanter dans le commerce que vous entretenez avec des nations tierces. Cette matière devient beaucoup plus délicate. Si les relations et les échanges avec l’étranger sont en général un avantage, comme ils le sont incontestablement, et si l’adresse ou la prépondérance d’une nation rivale s’empare d’une partie de ce commerce, on ne peut nier qu’elle ne vous ravisse quelques-uns des avantages dont vous jouissiez.
Faut-il s’armer, faire la guerre, ressaisir par la force des faveurs qui vous échappent par la pente des choses ? Non, assurément ; je ne crois pas qu’il y ait un seul commerce étranger dont les bénéfices annuels paient l’intérêt des frais d’une guerre entreprise pour le conserver. Nous avons été témoins que les grandes nations d’Europe ne pouvaient pas faire la guerre sans une dépense extraordinaire de 200 millions de nos francs par année ; nous savons également que chaque guerre entreprise ne s’apaise pas communément avant cinq, six ou sept années de batailles ; en admettant une durée commune de cinq ans, on peut donc en évaluer par aperçu les frais pour chaque nation à mille millions, ou un milliard. La dernière guerre a coûté bien davantage à la France et à l’Angleterre [87] , mais je veux parler d’une guerre ordinaire et partir des suppositions les plus modérées. En supposant donc qu’une nation ait assez de crédit pour ne payer l’intérêt de cette dépense d’un milliard que sur le pied de 5%, elle reste chargée d’un intérêt annuel de 50 millions ; or il est bon qu’on sache que 50 millions annuels excèdent, je ne dis pas les profits, mais la masse totale des échanges que la France fait avec quelque nation que ce soit [88] .
Supposons néanmoins qu’il s’agisse pour la France de conserver le plus considérable de ses commerces étrangers ; supposons que la totalité des échanges dans ce commerce aille à la somme de 50 millions, et que, tous frais déduits, il y ait un bénéfice de 20%, ou un cinquième, sur ces échanges, ce qui est beaucoup, les bénéfices de ce commerce se monteront seulement à dix millions par année, et c’est pour conserver ces dix millions qu’on se serait imposé annuellement une charge de 50 millions.
Remarquez en outre que l’intérêt annuel de 50 millions est perpétuel, et qu’on n’en saurait dire autant des profits du commerce le mieux établi. Remarquez que je suppose le but de la guerre complètement atteint, ce qui n’arrive jamais, même avec les plus brillants succès. Remarquez enfin et surtout que les dépenses qu’occasionne une guerre sont le moindre de ses malheurs, et que je n’ai rien osé mettre en balance avec le sang répandu, les talents moissonnés, les gémissements et la démoralisation qui sont le résultat le plus assuré de toutes les guerres.
Au reste, il est rare qu’on obtienne ou qu’on perde en totalité les avantages qu’on espère obtenir, ou qu’on possède, en conséquence d’un commerce avec une nation étrangère.
Lui vend-on des productions exclusives de son territoire ? on ne craint pas la concurrence d’une autre nation. Nul risque que nos vins de Bordeaux croissent en Angleterre. Les nations du Nord les prendront donc toujours chez nous ; à moins cependant qu’elles ne s’accoutument graduellement à préférer les vins d’un autre sol, du Portugal par exemple.
Lui vend-on des produits manufacturés ? ceux-là peuvent sans doute être imités ailleurs ; cependant il y a un privilège de terroir pour les produits manufacturés comme pour les produits agricoles, quoiqu’il soit moins marqué. Un genre de fabrication se plaît dans une certaine situation, dans une certaine disposition de lieux, et réussit moins bien dans un autre. Il faut qu’une fabrique soit à portée des matières premières, à portée des débouchés ; qu’elle convienne aux goûts, aux préjugés, à l’aptitude des habitants. Quelquefois ce n’est pas être plus sage d’être jaloux des succès d’un canton, d’un peuple dans un certain genre de manufacture, que d’être jaloux des fruits de son climat. Les quincailleries viennent en Angleterre, comme les oranges au Portugal.
Et en accordant, comme il le faut pourtant bien, que telle fabrication puisse s’exécuter aussi parfaitement, aussi économiquement dans deux endroits différents, ce n’est jamais que lentement et par degrés qu’un commerce change de cours. Jamais un rival, particulier ou peuple, ne vous supplantera subitement. En lui supposant toute l’habileté et toutes les connaissances nécessaires, il éprouvera les désavantages qui accompagnent tous les commencements. Il aura toujours à lutter pendant un certain temps, soit contre l’ignorance des méthodes économiques et abrégées, soit contre des essais infructueux, des pertes qui l’obligeront à faire payer plus cher un ouvrage moins parfait.
Et après avoir atteint précisément le même degré de perfection, il aura encore à vaincre les habitudes du consommateur et le courant du commerce dirigé vers un autre côté.
Il est bon d’observer qu’il convient à une nation d’établir à un aussi bas prix qu’elle peut même les objets pour lesquels elle n’a point de concurrents ; que c’est le plus sûr moyen de les écarter ; et qu’il est souvent trop tard d’attendre qu’ils se soient montrés pour baisser son prix. En effet, en vous prévalant du privilège que vous tenez de la nature des choses, si vous portez votre bénéfice à 30%, par exemple, vous permettez à tout fabricant qui ne pourra produire la même marchandise sans des frais qui se montent à 25% de plus que les vôtres, d’entrer en concurrence avec vous. Il ne gagnera que 5% dans les commencements, mais pourra vendre à votre prix. C’est une politique des Anglais : ils ne vendent pas très cher, même ce qu’ils font seuls.
En cela, comme en beaucoup d’autres choses, on gagne à être modéré, à ne pas faire usage de toute sa puissance.
J’ai dit ce qui rendait difficiles les changements brusques ; or il n’y a guère que ceux-là qui soient vraiment fâcheux, vraiment à craindre. Si une nation étrangère vous supplante auprès d’une troisième nation dans un certain genre d’industrie, agricole, manufacturière ou commerçante, c’est donc un mauvais calcul que de lui faire la guerre ; il faut tâcher de faire mieux qu’elle, de faire à meilleur marché ; il faut tâcher que les relations qu’on a avec vous soient plus agréables et plus sûres. Le meilleur marché, la meilleure qualité, et les meilleures manières, sont toujours à la longue ce qui procure le plus grand débit.
Si l’on est vaincu dans cette lutte, il faut en savoir prendre son parti ; l’industrie, les capitaux prendront tout doucement leur cours vers d’autres branches qui leur promettront plus de succès.
Que si la nation qu’on a coutume d’approvisionner vous prive tout à coup, par humeur, par folie, de ses communications lucratives... je n’ai rien à dire sur cela : c’est un des inconvénients du commerce extérieur. Pour le coup on déclarera la guerre… fort bien : à ce malheur, on en ajoutera un autre.
[I-360]
CHAPITRE XLII.
Des produits immatériels, ou qui sont consommés au moment de leur production.↩
Un médecin vient visiter un malade, observe les symptômes de son mal, lui prescrit un remède, et sort sans laisser aucun produit que le malade ou sa famille puisse transmettre à d’autres personnes, ni même conserver pour la consommation d’un autre temps.
L’industrie du médecin a-t-elle été improductive ? Qui pourrait le penser ! le malade a été sauvé. Cette production était-elle incapable de devenir la matière d’un échange ? Nullement, puisque le conseil du médecin a été bien payé. Mais le besoin de cet avis a cessé dès le moment qu’il a été donné. Sa production était de le dire : sa consommation de l’entendre ; il a été consommé en même temps que produit.
C’est ce que je nomme un produit immatériel [89] .
L’industrie d’un musicien, d’un acteur, donne un produit du même genre. Elle vous procure un divertissement, un plaisir, qu’il vous est impossible de conserver, de retenir, pour le consommer plus tard ou pour l’échanger de nouveau contre d’autres jouissances. Celle-ci a bien son prix ; mais elle ne subsiste plus, si ce n’est dans le souvenir, au-delà du moment de sa production.
Le célèbre Adam Smith refuse aux résultats de ces industries le nom de produits. Il donne au travail auquel elles se livrent le nom d’improductif, et c’est une conséquence du sens qu’il attache au mot richesse ; au lieu de donner ce nom à toutes les choses qui ont une valeur échangeable, il ne le donne qu’aux choses qui ont une valeur échangeable susceptible de se conserver, et par conséquent il le refuse aux produits dont la consommation a lieu à l’instant même de leur création. Cependant l’industrie d’un médecin, et si l’on veut multiplier les exemples, d’un administrateur de la chose publique, d’un avocat, d’un juge, qui sont du même genre, satisfont à des besoins tellement nécessaires, que sans leurs travaux nulle société ne pour 814.rait subsister. Les fruits de ces travaux ne sont-ils pas réels ? Ils sont tellement réels qu’on se les procure au prix d’un autre produit matériel auquel Smith accorde le nom de richesse, et que par ces échanges répétés, les producteurs de produits immatériels acquièrent des fortunes.
Si l’on descend aux choses de pur agrément, on ne peut nier que la représentation d’une bonne comédie ne procure un plaisir aussi réel qu’une livre de bonbons ou une fusée d’artifice, qui dans la doctrine de Smith portent le nom de produits. Je ne trouve pas raisonnable de prétendre que le talent du peintre soit productif, et que celui du musicien ne le soit pas [90] .
Smith a combattu les économistes qui n’appelaient du nom de richesse que ce qu’il y avait dans chaque produit de matière brute ; il a fait faire un grand pas à l’économie politique en démontrant que la richesse était cette matière, plus la valeur qu’y ajoutait l’industrie ; mais puisqu’il a élevé au rang des richesses une chose abstraite, la valeur, pourquoi la compte-t-il pour rien, bien que réelle et échangeable, quand elle n’est fixée dans aucune matière ? Cela est d’autant plus surprenant qu’il va jusqu’à considérer le travail en faisant abstraction de la chose travaillée, qu’il examine les causes qui influent sur sa valeur, et qu’il propose cette valeur comme la mesure la plus sûre et la moins variable de toutes les autres.
De la nature des produits immatériels, il résulte qu’on ne saurait les accumuler et qu’ils ne servent point à augmenter le capital national. Une nation où il se trouverait une foule de musiciens, de prêtres, d’employés, pourrait être une nation fort divertie, bien endoctrinée, et admirablement bien administrée. Mais voilà tout. Son capital ne recevrait, de tout le travail de ces hommes industrieux, aucun accroissement direct.
En conséquence, lorsqu’on trouve le moyen de rendre plus nécessaire le travail d’une de ces professions, on ne fait rien pour la prospérité publique ; en augmentant ce genre de travail productif, on en augmente en même temps la consommation. Quand cette consommation est une jouissance on peut s’en consoler ; mais quand elle-même est un mal, il faut convenir qu’un semblable système est déplorable.
C’est ce qui arrive partout où l’on complique la législation. Le travail des gens de loi devenant plus considérable et plus difficile, occupe plus de monde et se paie plus cher. Qu’y gagne-t-on ? D’avoir ses droits mieux défendus ? Non certes : la complication des lois est bien plutôt favorable à la mauvaise foi en lui offrant de nouveaux subterfuges, tandis qu’elle n’ajoute presque jamais rien à la solidité du bon droit. On y gagne de plaider plus souvent et plus longtemps ; cela peut avoir des douceurs pour quelques personnes, mais la plus saine et la plus nombreuse partie du public regardera toujours les procès comme des malheurs, même quand on gagne sa cause.
Il est donc impossible d’admettre l’opinion de Garnier [91] , qui conclut de ce que le travail des médecins, des gens de loi et autres personnes semblables, est productif, qu’il est aussi avantageux à une nation de le multiplier que tout autre. Il en est de cela comme de la main-d’œuvre qu’on répandrait sur un produit, par-delà ce qui est nécessaire pour l’exécuter. Le travail productif de produits immatériels n’est productif que jusqu’au point où le produit est utile. Audelà de ce point, c’est un travail purement improductif.
Compliquer les lois pour les faire débrouiller par des légistes, c’est se donner une maladie pour avoir besoin du médecin.
Ajoutez que le temps et les soins que chaque individu consacre à la poursuite des produits immatériels quelconques, sont perdus pour la production très réelle à laquelle lui-même aurait pu se livrer. Un négociant enlève à ses affaires le temps qu’il donne à ses procès ou à ses plaisirs, sans parler des regrets, des lassitudes, des maladies qui peuvent suivre l’usage immodéré de quelques-uns de ces produits.
[I-366]
CHAPITRE XLIII.
Que les produits immatériels sont le fruit d’une industrie et d’un capital.↩
Les produits immatériels dont il a été question jusqu’ici sont le fruit de l’industrie humaine, puisque nous avons appelé industrie toute espèce de travail productif. On voit moins clairement comment ils sont en même temps le fruit d’un capital. Cependant la plupart de ces produits sont le résultat d’un talent ; tout talent suppose une étude préalable, et aucune étude n’a pu avoir lieu sans des avances.
Pour que le conseil du médecin ait été donné et reçu, il a fallu que le médecin ou ses parents aient fait, pendant plusieurs années, les frais de son instruction ; il a fallu qu’il fût entretenu tout le temps qu’ont duré ses études ; il a fallu payer des professeurs, acheter des livres, faire des voyages peut-être. Ce qui suppose l’emploi d’un capital précédemment accumulé.
Pour ne pas anticiper sur ce que je dois dire en traitant des salaires, je me bornerai à faire remarquer en passant que ce capital est placé à fonds perdu sur la tête du médecin, et que son salaire doit comprendre, outre la récompense de son travail actuel, non un intérêt simple, mais un intérêt viager du capital qui fut consacré à son instruction.
Il en est de même de la consultation de l’avocat, de la chanson du musicien, etc. : ces produits ne peuvent avoir lieu sans le concours d’une industrie et d’un capital.
On retrouve dans l’industrie qui donne des produits immatériels les mêmes opérations que nous avons trouvées nécessaires dans l’analyse qui a été faite au commencement de cet ouvrage des opérations de l’industrie en général [92] . Continuons le dernier exemple qui est tombé sous ma plume : pour qu’une chanson soit exécutée, il a fallu que l’art du compositeur et celui du musicien exécutant fussent des arts professés et connus, de même que les méthodes convenables pour les acquérir. L’application de cet art, de ces méthodes, a été faite par le compositeur et le musicien qui ont jugé, l’un en composant son air, l’autre en l’exécutant, qu’il en pouvait résulter un plaisir auquel les hommes attacheraient une valeur quelconque. Enfin l’exécution offre la dernière des opérations de l’industrie.
Il est cependant des productions immatérielles où les deux premières opérations jouent un si petit rôle, qu’on peut n’en tenir aucun compte. Tel est le service d’un domestique. La science du service est rien ou peu de chose ; et l’application des talents du serviteur étant faite par celui qui l’emploie, il ne reste guère au serviteur que l’exécution matérielle qui est la dernière des opérations de l’industrie.
Par une conséquence nécessaire, dans ce genre d’industrie, et dans quelques autres dont on trouve des exemples dans les dernières classes de la société, comme dans l’industrie des portefaix, des courtisanes, etc., l’apprentissage se réduisant à rien, les produits peuvent être regardés non seulement comme les fruits d’une industrie très grossière, mais encore comme des productions où les capitaux n’ont aucune part ; car je ne pense pas que les avances nécessaires pour élever la personne industrieuse depuis sa première enfance jusqu’au moment où elle se tire d’affaire elle-même, doivent être regardées comme un capital dont les profits qu’elle fait ensuite paient les intérêts. J’en dirai les raisons en parlant des salaires [93] .
Les plaisirs dont on jouit au prix d’un travail quelconque, sont des produits immatériels consommés, au moment de leur production, par la personne même qui les a créés. Tels sont les plaisirs que procurent les arts qu’on ne cultive que pour son agrément. Si j’apprends la musique, je consacre à cette étude un petit capital, une portion de mon temps et quelque travail ; c’est au prix de toutes ces choses que je goûte le plaisir de jouer un air nouveau et de faire ma partie dans un concert.
Le jeu, la danse, la chasse, sont des travaux du même genre. L’amusement qui en résulte est consommé à l’instant même par ceux même qui les ont exécutés. Quand un amateur fait pour son amusement un tableau, ou quand il exécute un ouvrage de menuiserie, ou de serrurerie, il crée à la fois un produit de valeur durable, et un produit immatériel qui est son amusement.
Une nation indolente et paresseuse fait peu d’usage des divertissements qui sont le fruit de l’exercice des facultés personnelles. Le travail est pour elle une si grande peine, qu’il y a peu de plaisirs capables de l’en dédommager. Les Turcs nous jugent fous de nous tant agiter pour avoir du plaisir ; ils ne voient pas que cette fatigue nous coûte beaucoup moins qu’à eux. Ils préfèrent les plaisirs qui leur sont préparés par la fatigue des autres ; dans ces pays-là, il y a bien autant de travail employé à procurer des plaisirs ; mais ce tra 833.vail est fait, en général, par des esclaves qui n’ont aucune part à son produit.
[I-371]
CHAPITRE XLIV.
Des capitaux productifs d’utilité ou d’agrément.↩
Nous avons vu, en traitant des capitaux, que les uns étaient productifs de produits matériels et que d’autres étaient absolument improductifs. Il en est d’autres qui sont productifs d’utilité ou d’agrément, et qu’on ne peut par conséquent mettre ni dans la classe des capitaux servant à la production d’objets matériels, ni dans celle des capitaux absolument inutiles. De ce nombre sont les maisons d’habitation, les meubles, les ornements, qui ne servent qu’à augmenter les agréments de la vie, et dont la consommation est si lente qu’elle ne coûte rien ou presque rien au revenu annuel, mais forme une portion du capital de chaque personne.
Quand un jeune ménage s’établit, l’argenterie dont il se pourvoit ne peut pas être considérée comme un capital absolument inutile, puisque la famille s’en sert habituellement ; elle ne peut pas être considérée non plus comme un capital productif de produits matériels ; ce n’est pas non plus un objet de consommation annuelle, puisqu’elle peut durer pendant la vie des époux et passer à leurs enfants : c’est un capital productif d’utilité et d’agrément.
Le produit de ces capitaux est tout à fait analogue aux produits immatériels qui nous ont occupés dans les deux chapitres précédents. En effet, de tels capitaux ne concourent à la production d’aucune marchandise, d’aucune valeur durable, susceptibles de se conserver, de s’accumuler pour s’échanger plus tard ; cependant leur usage a une valeur, une valeur tellement réelle qu’on le paie fort bien, témoin ce que coûte le loyer des meubles quand on a besoin d’y avoir recours.
Si c’est mal entendre ses intérêts que de laisser la plus petite partie de son capital sous une forme absolument improductive, ce n’est pas les méconnaître que de placer une partie de son capital, proportionnée à sa fortune, sous une forme productive d’utilité ou d’agrément. Entre les meubles grossiers du ménage villageois, et les ornements recherchés, les bijoux éblouissants du riche, il y a une foule de degrés dans la quantité de capitaux consacrés à cet usage par chaque personne. Dans un pays riche la famille la plus pauvre possède un capital de cette espèce, non pas considérable, mais suffisant pour satisfaire des désirs modestes et des besoins peu recherchés. Quelques meubles utiles et agréables qu’on rencontre dans toutes les habitations ordinaires, annoncent bien plus sûrement la richesse d’un pays que cet amas d’ameublements magnifiques et d’ornements fastueux qui remplissent les palais de quelques hommes à grande fortune, ou que ces diamants et ces parures qui peuvent éblouir lorsqu’on les voit accumulés dans une grande ville et quelquefois rassemblés presque tous à la fois dans l’enceinte d’un spectacle ou d’une fête, mais qui sont peu de chose comparés au mobilier de toute une grande nation.
Chez l’homme industrieux, le capital productif d’objets matériels et celui qui n’est productif que d’utilité et d’agrément se confondent souvent. Son entretien pendant la production est évidemment une partie des avances que la production rend nécessaires et qu’elle rembourse ; et l’utilité qu’il retire de ses meubles est une partie de son entretien. Il y a cet avantage à exercer une industrie quelconque, que l’on peut s’arranger pour mettre une grande partie de son capital utile et agréable au rang des capitaux productifs matériels ; aussi les gens industrieux n’y manquent guère. Ils joignent aux capitaux qu’ils ont placés en usines, en outils, ceux qu’ils ont placés en meubles pour leur usage ; et ils s’efforcent de prélever sur les produits de leur industrie l’intérêt des uns et des autres. Le régisseur d’un établissement industriel fait considérer sa maison d’habitation et souvent même son mobilier comme devant faire partie des frais de premier établissement.
Un capitaliste, dont le revenu est fondé sur l’intérêt de son argent, n’a pas cet avantage. La portion de son capital qu’il emploie pour son utilité ou pour son agrément, diminue la portion employée productivement de choses matérielles et par conséquent son revenu.
Les choses composant le capital productif d’utilité et d’agrément s’usent par la jouissance. Quand on les rétablit aux dépens du capital portant intérêt, on mange une partie de son capital ; on diminue sa fortune. Quand on ne les rétablit pas du tout, elles ne conservent plus la même valeur. C’est encore manger son capital.
Par la raison du contraire, quand on prend sur ses revenus annuels, quelle qu’en soit la source, pour augmenter son capital utile et agréable, on augmente ses capitaux, sa fortune, bien qu’on n’augmente pas ses revenus.
Cette observation paraît triviale, et cependant combien de gens croient ne manger que leurs revenus, lorsqu’ils consomment en même temps un capital considérable productif d’utilité et d’agrément. Qu’un homme, par exemple, habite sa propre maison ; cette maison doit avoir une durée de cent ans, je suppose, malgré les réparations les plus soigneuses, et elle a coûté cent mille francs à élever : il faut que cet homme ou ses héritiers prélèvent sur leurs revenus annuels, et indépendamment de toutes réparations, mille francs par année, pour rétablir le capital qui sera consommé au bout de cent années ; autrement ils auront mangé dans cet espace de temps un capital de cent mille francs indépendamment de leurs revenus.
J’ai pris des nombres ronds pour rendre mon raisonnement plus sensible. On sent qu’une maison de cent mille francs peut durer plus de cent ans, et de plus qu’il n’est pas nécessaire de mettre de côté chaque année mille francs, pour rétablir un capital de cent mille francs au bout de cent années ; car mille francs placés chaque année, avec leurs intérêts, et les intérêts des intérêts, produiraient fort au-delà de la somme exigée. Il s’agit ici d’exactitude dans le raisonnement et non dans les nombres.
Ce même raisonnement peut être appliqué à toute autre partie d’un capital productif d’utilité et d’agrément, à un meuble, à un bijou, à tout ce que la pensée peut ranger sous cette dénomination.
Les capitaux de cette sorte se forment comme tous les autres, sans exception, par l’accumulation d’une partie des produits annuels. Il n’est d’autre manière d’avoir des capitaux, si ce n’est de les accumuler soi-même ou de les tenir de quelqu’un qui les a accumulés. Ainsi je renvoie, à ce sujet, au chapitre 14, où j’ai traité de l’accumulation des capitaux.
Les capitaux ne passent sans perte d’une forme à une autre, qu’autant qu’on ne s’expose pas à en perdre la façon, car la façon fait partie du capital.
En 1688, Louis XIV ordonna que tous les meubles d’argent massif seraient portés à la monnaie ; lui-même donna l’exemple : il se priva de toutes ces tables d’argent, de ces candelabres, de ces canapés d’argent massif et de beaucoup d’autres meubles, chefs-d’œuvre de cizelure, exécutés sur les dessins de Lebrun. Tous les particuliers opulents firent de même. Le capital nécessaire à la circulation, c’est-à-dire le capital réellement productif de la nation, fut augmenté de toute la valeur intrinsèque de l’argent ; mais le capital d’utilité et d’agrément fut diminué de cette même valeur, plus de la valeur de la main-d’œuvre.
La perte est souvent bien plus grande quand il y a moins de valeur intrinsèque. De pareilles opérations répétées (et elles l’ont été quelquefois chez nous) ruinent une nation, ou du moins retardent la prospérité à laquelle elle s’élève par d’autres moyens.
Il ne convient pas à une nation qu’une trop grande partie de ses capitaux soit sous une forme productive seulement d’utilité et d’agrément, pour deux raisons majeures et purement économiques. Il y en a de non moins puissantes qui tiennent à la morale et à la politique, et dont je ne parlerai pas.
En premier lieu, ces capitaux s’usent, ou bien ils ne s’entretiennent qu’en prenant sur le revenu général, et dans tous les cas ils diminuent les produits et les richesses que les autres augmentent. En ceci se montre encore l’analogie qu’il y a entre la richesse nationale et la richesse privée. Un particulier qui consacre à la satisfaction de ses besoins personnels une trop grande portion de ses capitaux, une portion qu’il ne peut pas aisément entretenir avec ses revenus, se ruine infailliblement. Il en est de même d’une nation où les besoins factices sont excités, où le faste et le luxe obtiennent des honneurs, et s’introduisent par conséquent jusque dans les dernières classes de la société ; une grande portion des capitaux de cette nation prend une direction improductive de produits matériels. Je ne sais si elle a plus de plaisirs, mais, à coup sûr, elle finit par avoir moins de richesse.
En second lieu, les capitaux productifs d’utilité ou d’agrément ne sont tels que pour leurs propriétaires ou tout au plus pour les gens de leurs maisons. Un riche écrin peut procurer une grande satisfaction à une belle dame, mais personne qu’elle n’en retire, que je sache, un plaisir bien vif. Tandis que les capitaux productifs de produits matériels, non seulement procurent un intérêt et par conséquent des jouissances à leur propriétaire, mais encore ils mettent une foule d’hommes industrieux à portée d’exercer leur industrie et d’en tirer de leur côté un revenu et des jouissances.
[I-380]
CHAPITRE XLV.
Des terrains productifs d’agrément.↩
Un parc, un jardin d’agrément, sont des fonds de terre productifs de produits immatériels ; ils ne produisent aucun bien qu’on puisse conserver. La jouissance qu’on en retire se dissipe à mesure qu’elle est produite ; elle peut sans doute se renouveler chaque jour, mais chaque jour elle se consomme en même temps qu’elle est produite.
On voit qu’il ne faut pas confondre un terrain productif d’agrément avec des terres absolument improductives, des terres en friche. Nouvelle analogie qui se trouve entre les fonds de terre et les capitaux ; puisqu’on vient de voir que parmi ceux-ci, il s’en trouve qui sont de même productifs de produits immatériels.
Dans les jardins et les parcs d’agrément, il y a toujours quelque dépense faite en embellissements. Dans ce cas, il y a un capital réuni au fonds de terre pour donner un produit immatériel.
Il y a des parcs d’agrément qui produisent en même temps des bois et des pâturages. Ceux-là réunissent des produits de l’un et de l’autre genre. Les anciens jardins français ne donnaient aucun produit réel. Les jardins modernes sont un peu plus profitables ; ils le seraient davantage, si les produits du potager et ceux du verger s’y montraient un peu plus souvent. Sans doute ce serait être trop sévère que de reprocher à un propriétaire aisé les portions de son héritage qu’il consacre au pur agrément. Les doux moments qu’il y passe entouré de sa famille, le salutaire exercice qu’il y prend, la gaité qu’il y respire, sont des biens aussi, et ce ne sont pas les moins précieux. Qu’il dispose donc son terrain selon sa fantaisie ; qu’on y voie l’empreinte de son goût et même de son caprice ; mais si jusque dans ses caprices il y a un but d’utilité ; si sans recueillir moins de jouissances, il recueille aussi quelques fruits, alors son jardin possède un double mérite ; le philosophe et l’homme d’État s’y promèneront avec plus de plaisir.
J’ai vu un ou deux jardins dans lesquels il était impossible de désirer plus d’agrément, et où cependant il y avait peu d’endroits qui ne donnassent, suivant les sites et la nature du sol, des produits profitables. Le tilleul, le marronnier, le sycomore, les autres arbres d’ornement n’en étaient point exclus non plus que les fleurs et les gazons ; mais les arbres fruitiers embellis d’espérances au printemps, et chamarrés de fruits en été, contribuaient à la variété des teintes. Tout en cherchant l’exposition qui leur était favorable, ils se prêtaient aux sinuosités des clôtures et des allées. Les plates-bandes, les planches garnies de légumes, n’étaient pas constamment droites, égales, uniformes ; le terrain éprouvait de légères ondulations ; les limites en étaient incertaines ; on pouvait se promener dans la plupart des sentiers tracés pour la commodité de la culture ; et le tout présentait un mélange charmant de formes et de couleurs sans nombre. Jusqu’au puits couronné de vigne, où le jardinier venait remplir ses arrosoirs, était un ornement ; tout semblait avoir été imaginé pour convaincre que ce qui est joli peut être utile, et que le plaisir peut croître au même lieu que la richesse.
Un pays tout entier peut de même s’enrichir de ce qui fait son ornement. Si l’on plantait des arbres partout où ils peuvent venir sans nuire à d’autres produits [94] , non seulement le pays en serait fort embelli ; non seulement il serait rendu plus salubre [95] ; non seulement ces arbres multipliés provoqueraient des pluies fécondantes, mais le seul produit de leur bois, dans une contrée un peu étendue, s’élèverait à des valeurs considérables.
Les arbres ont cet avantage que leur production est due presqu’entièrement au travail de la nature, celui de l’homme se bornant à l’acte de la plantation. Mais planter ne suffit pas : il faut n’être pas tourmenté du désir d’abattre. Alors cette tige maigre et frêle dans l’origine, se nourrit peu à peu des sucs précieux de la terre et de l’atmosphère ; son tronc s’enfle et se durcit, sa taille s’élève, ses vastes rameaux se balancent dans l’air, sans que l’agriculteur s’en mêle. L’arbre ne demande à l’homme que d’en être oublié pendant quelques années ; et pour récompense (lors même qu’il ne donne pas de récoltes annuelles), parvenu à l’âge de la force, il livre à la charpente, à la menuiserie, au charronnage, à nos foyers, le trésor de son bois.
De tout temps la plantation et le respect des arbres ont été fortement recommandés par les meilleurs esprits. L’historien de Cyrus met au nombre des titres de gloire de ce prince d’avoir planté toute l’Asie mineure. Dans les ÉtatsUnis, quand un cultivateur se voit père d’une fille, il plante un petit bois qui grandit avec l’enfant, et fournit sa dot au moment où elle se marie. Notre grand Sully, qui avait tant de vues économiques, a planté dans presque toutes les provinces de France un très grand nombre d’arbres : j’en ai vu plusieurs auxquels la vénération publique attachait encore son nom, et je me suis rappelé ce mot d’Addison, qui, chaque fois qu’il voyait une plantation, s’écriait : un homme utile a passé par là.
[I-385]
CHAPITRE XLVI.
De la production dans ses rapports avec la population.↩
Si l’on veut connaître les rapports qui s’établissent entre la production et la population, il faut nécessairement distinguer les différents usages des produits et les diviser en trois grandes classes :
Les denrées nourrissantes ;
Les denrées vêtissantes, logeantes et meublantes ;
Les denrées ou produits immatériels.
Tous ces produits sont destinés à satisfaire des besoins indispensables en quelques circonstances, mais les denrées nourrissantes satisfont le plus impérieux, le plus constant de tous. Dans la plupart des climats de la terre, on peut à la rigueur vivre sans vêtements et sans abri ; dans la plupart des époques de la vie, on peut se passer des secours de la médecine et de la chirurgie ; mais sous aucun climat, à aucune époque de notre existence, nous ne pouvons la conserver sans nourriture.
Le besoin de la nourriture n’est pas seulement le plus indispensable de tous, il est encore le plus difficile à satisfaire. Voyez ce Canadien : en deux jours il se sera procuré les peaux nécessaires pour le vêtir, la cabane où il se logera pendant plus d’une année : mais sa nourriture l’obligera à des fatigues, à des travaux sans cesse renaissants.
Il en est à peu près de même quel que soit le degré de civilisation où un peuple est monté. Il a toujours assez de denrées vêtissantes, logeantes et meublantes, lorsqu’il a assez de denrées nourrissantes. Il y a des bornes à celles-ci, que ne reconnaissent point les autres ; et si l’on pouvait admettre que la France pût nourrir dix fois plus d’habitants qu’elle n’en a, on concevrait aisément qu’elle pourrait les habiller et les loger.
On en peut dire autant des produits immatériels : ils sont susceptibles de se multiplier, en tout pays, fort au-delà des besoins de la population que le pays peut nourrir.
La production des denrées logeantes et vêtissantes au moyen des échanges et du commerce, peut, à la vérité, remplacer la production des denrées nourrissantes. La Hollande se procure du blé avec ses toiles, et l’Amérique septentrionale obtient du sucre et du café en échange des maisons de bois qu’elle envoie toutes faites aux Antilles. Il n’y a pas jusqu’aux produits immatériels qui, bien qu’ils ne soient pas transportables, procurent à une nation des denrées nourrissantes. L’argent payé par un étranger pour voir un artiste éminent ou pour consulter un praticien célèbre peut retourner dans l’étranger pour y acheter des denrées plus substantielles. Ainsi, un produit destiné à satisfaire un besoin peut en satisfaire un autre, et, sauf quelques réserves que nous examinerons plus tard, la nature des produits s’accommode à la nature des besoins.
Ici s’ouvre une considération importante.
Tous les êtres animés sont tourmentés du désir de se reproduire. La nature leur a donné à tous la faculté, non seulement de réparer les pertes ordinaires qu’éprouve chaque espèce, mais d’engendrer incomparablement plus d’individus que l’ordre de la nature n’en détruit. Leur nombre n’est donc pas borné par la possibilité de se multiplier, mais par celle de satisfaire à leurs besoins.
Chez les animaux qui sont incapables de mettre aucune prévoyance dans la satisfaction de leurs appétits, les individus qui naissent, lorsqu’ils ne deviennent pas la proie de l’homme ou des autres animaux, périssent du moment qu’ils éprouvent un besoin indispensable qu’ils ne peuvent satisfaire. Chez l’homme, la nécessité de satisfaire à des besoins futurs fait entrer la prévoyance pour quelque chose dans l’accomplissement du vœu de la nature. L’obligation où il est de nourrir et de soigner ses rejetons pendant leur longue enfance a interdit chez presque tous les peuples policés la multiplicité des femmes. Beaucoup d’hommes ne se marient pas, et chaque célibataire, à peu près, condamne au célibat celle qui pouvait devenir son épouse. Dans le mariage, le temps de la grossesse et celui de l’allaitement empêchent qu’il ne naisse plus d’un enfant tous les deux ans ; et toutes ces gênes imposées par la prévoyance des lois ou par la nature, ne sont pas les seules. Suivant d’Expilly et Messance, qui se sont beaucoup occupés de population, la quantité moyenne d’enfants produite par chaque ménage est entre 3 et 4 ; mais qui doute qu’à considérer la durée moyenne des mariages, ils ne pussent produire un plus grand nombre d’enfants ? Les mariages ne sont-ils pas bien plus féconds dans les campagnes où l’on nourrit, où l’on habille les enfants à moins de frais, et où leurs facultés commencent de meilleure heure à devenir productives ? Les facultés des parents, leur position dans le monde, bornent donc, non pas toujours, mais souvent le nombre de leurs enfants.
Quelles que soient les bornes que la prévoyance des lois et celle des individus mettent à la multiplication des hommes, l’attrait qui unit les sexes est si puissant, que la production des enfants est toujours supérieure aux moyens que chaque pays offre de subvenir à leurs besoins. Il est affligeant mais il est vrai de dire que chez presque toutes les nations, surtout chez les nations nombreuses, une partie de la population périt tous les ans de besoin. Ce n’est pas que tous ceux qui périssent de besoin meurent positivement du défaut de nourriture, quoique ce malheur soit beaucoup plus fréquent qu’on ne pense ; je veux dire seulement qu’ils n’ont pas à leur disposition tout ce qui est nécessaire pour vivre, et que c’est parce qu’ils manquent de quelque chose qui leur serait nécessaire, qu’ils meurent.
Tantôt c’est un malade ou un homme affaibli, qu’un peu de repos remettrait, ou bien à qui il ne faudrait que la consultation d’un médecin et un remède fort simple, mais qui ne peut ni prendre du repos, ni consulter le médecin, ni faire le remède.
Tantôt c’est un petit enfant qui réclame les soins de sa mère ; mais sa mère est forcée au travail par l’indigence ; l’enfant périt ou par un accident, ou par malpropreté, ou par maladie. Sur un égal nombre d’enfants pris dans la classe aisée et dans la classe indigente, je crois qu’on s’éloignerait peu de la vérité en affirmant qu’au bout du même espace de temps, il en sera mort dans la seconde deux fois autant que dans la première.
Enfin, une nourriture trop peu abondante, ou malsaine, l’impossibilité de changer souvent de linge, de se vêtir plus chaudement, de se sécher, de se chauffer, causent la mort de bien des personnes, et toutes celles qui périssent faute des moyens nécessaires pour satisfaire à ces besoins, meurent de besoin.
Si la population est bornée uniquement par l’impossibilité de satisfaire aux besoins d’un nombre d’hommes plus considérable, et si les produits quels qu’ils soient, satisfont en général aux besoins quels qu’ils soient, il en résultera que la population se proportionnera toujours à la quantité des produits.
Sans doute un pays où les fortunes sont très inégalement partagées, où des mœurs dissolues font qu’un petit nombre d’individus consomment une quantité de produits qui pourrait suffire à l’entretien d’une multitude, un tel pays, dis-je, ne peut pas avec une pareille quantité de produits nourrir une population aussi forte que le pourrait une contrée plus sobre ; mais toutes choses d’ailleurs égales, la population d’un pays se proportionne à ses produits. C’est une vérité reconnue par la plupart des auteurs qui ont écrit sur l’économie politique, quelque variées que soient leurs opinions sur presque tout le reste [96] .
Il me semble qu’on n’a pas tiré de là une conséquence qui était pourtant bien naturelle, c’est que rien ne pouvait accroître la population que ce qui favorise la production, et que rien ne la pouvait diminuer, au moins d’une manière permanente, que ce qui attaque les sources de la production.
Les Romains firent des règlements sans fin pour réparer les pertes d’hommes que leurs guerres continuelles et lointaines occasionnaient. Les censeurs recommandaient les mariages ; des honneurs récompensaient la fécondité. Tout cela ne servait à rien. La difficulté n’est pas de faire des enfants, mais de les entretenir. Il fallait créer des produits au lieu de causer des dévastations. Tant de beaux règlements n’empêchèrent point, même avant l’invasion des barbares, la dépopulation de l’Italie et de la Grèce [97] .
Ce fut tout aussi vainement que Louis XIV, par son édit de 1666 en faveur du mariage, donna des pensions à ceux qui auraient dix enfants, et de plus fortes à ceux qui en auraient douze. Les primes que, sous mille formes diverses, il donnait au désœuvrement et à l’inutilité, faisaient bien plus de tort à la population que ces faibles encouragements ne pouvaient lui faire de bien.
On répète tous les jours que le Nouveau Monde a dépeuplé l’Espagne : ce sont ses mauvaises institutions qui l’ont dépeuplée, et le peu de productions que fournit le pays relativement à son étendue.
Ce qui encourage véritablement la population, c’est une industrie active. Elle pullule dans tous les cantons industrieux ; et quand un sol vierge conspire avec l’activité d’une nation entière qui n’admet point de désœuvrés, ses progrès sont étonnants, comme aux ÉtatsUnis où elle double tous les vingt ans.
Par la même raison les fléaux passagers qui détruisent beaucoup d’hommes sans attaquer les sources de la reproduction, sont plus affligeants pour l’humanité que funestes à la population. Ce qu’il faut le plus déplorer dans les grandes mortalités, c’est la perte de ces hommes supérieurs, et tels que les connaissances, les talents, les vertus d’un seul, peuvent influer sur le sort des nations plus que les bras de cent mille autres. Mais pour ce qui est de la population ordinaire, elle remonte en très peu de temps au point où la retient la masse des productions annuelles. Des calculs très curieux de Messance prouvent qu’après les ravages causés par la fameuse peste de Marseille en 1720, les mariages furent en Provence plus féconds qu’auparavant. L’abbé d’Expilly a trouvé les mêmes résultats. Les ravages de la guerre se réparent moins vite parce qu’elle entraîne une destruction de capitaux qui sont des moyens de production. La dépopulation la moins réparable et la plus funeste est celle qui provient d’une administration vicieuse ; celle-là ne peut se réparer que lorsqu’on change de système. Une forte inégalité dans les fortunes est défavorable à la population ; car la grande richesse ne veut pas faire des enfants et l’extrême pauvreté ne peut pas les élever.
On s’est beaucoup plaint du tort que les couvents font à la population, et l’on a eu raison ; mais on s’est mépris sur les causes. Ce n’est pas à cause du célibat des religieux : c’est à cause de leur oisiveté. Ils font travailler à leurs terres, dit-on ; voilà une belle avance ! Les terres resteraient-elles en friche si les moines venaient à disparaître de la surface de la terre ? Bien au contraire ; partout où les moines sont remplacés par des ateliers d’industrie comme nous en avons vu plusieurs exemples dans la Révolution française, le pays gagne tous les mêmes produits agricoles, et de plus ceux de son industrie manufacturière.
Une autre conséquence de ce qui précède, c’est que les habitants d’un pays ne sont pas plus mal pourvus des choses nécessaires à la vie, quand leur nombre s’augmente, ni mieux pourvus quand leur nombre diminue. Leur sort dépend de la quantité des produits dont ils disposent, et ces produits peuvent être abondants pour une nombreuse population, tout comme ils peuvent être rares pour une population clairsemée. La disette fréquentait l’Europe au Moyen-âge plus souvent que dans ce temps-ci où elle est évidemment plus populeuse. L’Angleterre, sous le règne d’Élisabeth, n’était pas si bien pourvue qu’elle l’est, quoiqu’elle eût moitié moins d’habitants ; et le peuple d’Espagne, réduit à huit millions d’âmes, ne vit pas avec autant d’aisance que du temps où il s’élevait à vingt-quatre millions [98] .
Si les habitants d’un pays s’élèvent naturellement au nombre que le pays peut entretenir, que deviennent-ils dans les années de disette ?
Steuart répond [99] :
Qu’il n’y a pas tant de différence qu’on l’imagine entre deux récoltes ; qu’une année mauvaise pour un canton est bonne pour un autre, que la mauvaise récolte d’une denrée est souvent balancée par la bonne récolte d’une autre. Il ajoute que le même peuple ne consomme pas autant dans les années de disette que dans les années d’abondance ; dans celles-ci tout le monde est mieux nourri ; on emploie une partie des produits à engraisser des animaux de bassecour ; les denrées étant moins chères il y a un peu plus de gaspillage. Quand la disette survient, la classe indigente est mal nourrie ; elle fait de petites portions à ses enfants ; loin de mettre en réserve, elle consomme ce qu’elle a amassé. Enfin il n’est malheureusement que trop avéré qu’une portion de cette classe souffre et meurt.
J’ai dit vers le commencement de ce chapitre qu’au moyen des échanges les produits s’accommodaient aux besoins, et que toute espèce de production, sauf quelques réserves, pouvait satisfaire à toute espèce de besoins. Il est convenable de faire apercevoir les restrictions que la nature des choses met à la généralité de cette proposition.
Les denrées nourrissantes n’excèdent jamais longtemps de suite les besoins de la population ; car lorsque les denrées nourrissantes se multiplient, soit par les progrès de l’agriculture, soit par le moyen du commerce, les hommes se multiplient avec elles. Il n’en est pas ainsi des denrées propres au logement et à l’habillement ; celles-ci peuvent se multiplier fort au-delà des besoins de la population. Pour qu’elles puissent se transformer par l’échange en denrées nourrissantes, il faut donc qu’elles se fassent jour dans l’étranger.
En d’autres termes, les richesses acquises par les manufactures et le commerce sont bien des richesses aussi réelles, aussi propres à procurer à leurs possesseurs tout ce qui est nécessaire à leur entretien ; mais une partie d’entre eux sont obligés de se pourvoir dans l’étranger de ces denrées indispensables que leur propre pays ne fournit pas en quantité suffisante ; car si la quantité de produits en général que fournit un pays, dépend de son industrie et de ses capitaux, la quantité de denrées nourrissantes qu’il peut produire dépend aussi de l’étendue de son territoire.
La pêche est peut-être la seule production nourrissante qui ne soit pas bornée par le territoire. Elle tire ses produits d’un fonds immense, à l’usage de tout le monde et pour ainsi dire inépuisable. Les ressources qu’elle offre sont bornées par la nécessité de con 893.sommer près des côtes la majeure partie de de son produit ; si toute espèce de poisson pouvait se transporter au loin sans se gâter, la pêche serait bien plus favorable encore à la population. Buckelz ayant enseigné aux Hollandais l’art d’encaquer les harengs, et par ce moyen de conserver et de transporter au loin cette abondante denrée, la nourriture a pu être augmentée partout où elle a pénétré et les profits partout où elle a pu être préparée. Plusieurs milliers d’hommes doivent leur existence à Buckelz. Faut-il être surpris des honneurs que les Hollandais rendent à sa mémoire ?
Les produits manufacturés, bien qu’ils procurent des denrées nourrissantes par l’échange, ne sont pas si indépendants des hommes et des évènements. Quand on dépend de nations étrangères et souvent éloignées, pour les besoins de première nécessité, on est soumis à tous les accidents de la nature et de la politique qui peuvent rompre ou suspendre les relations qu’on entretient avec elles. Dès lors on cherche à conserver ces relations, soit clandestinement, soit à force ouverte ; on écarte la concurrence par toutes sortes de voies, même les plus illégitimes ; on impose à une province, à un allié faible, l’obligation d’acheter, comme on imposerait un tribut ; on fait une guerre pour une branche de commerce et l’on fait le commerce même de la nation avec qui l’on est en guerre. C’est une position nécessairement violente et dangereuse.
Les produits de l’Angleterre en denrées nourrissantes ont incontestablement beaucoup augmenté vers la fin du XVIIIe siècle, mais ses produits en denrées propres au vêtement et à l’ameublement ont probablement augmenté dans une proportion plus rapide encore ; il en est résulté cette masse énorme de production qui permet à ce peuple de se multiplier au-delà du nombre que le sol peut nourrir [100] , et de supporter, sans en être écrasé, des charges telles qu’aucune autre nation n’en a jamais connu de semblables, ni même qui en aient approché. Mais il ne pourrait plus supporter ces charges, il ne pourrait plus même nourrir toute sa population, si un seul de ses débouchés venait à se fermer. Pour se nourrir et payer ses contributions, il faut qu’il vende tout ce qu’il vend actuellement de marchandises ; et pour les vendre il faut qu’il puisse toujours compter sur des achats égaux, tout au moins, de la part de l’étranger. Tel serait un riche fabricant qui, à la faveur d’un commerce florissant, aurait accru sa maison d’un nombre considérable de gens, les uns laborieux, les autres oisifs, mais qui ne pourrait continuer à les entretenir qu’autant qu’il continuerait à fournir des marchandises à toute la contrée et même à ses rivaux. Un tel manufacturier ne manque point de blé tant qu’il ne manque point d’argent ; mais il manque de l’un et de l’autre du moment qu’il vient à manquer de pratiques. Il vaut mieux sans doute avoir un débit moins forcé et plus sûr.
Le peuple anglais ne peut pas sans inconvénients réduire sa production, puisque la subsistance de sa nombreuse population en dépend ; mais il pourrait en changer le cours par degrés, en cessant les encouragements qui dirigent sans cesse de nouveaux capitaux vers les manufactures et le commerce extérieur, et en augmentant ceux qui les portent vers l’industrie agricole. Il est probable qu’alors plusieurs cantons qui n’ont point encore la culture dont ils sont susceptibles, surtout en Écosse et en Irlande, donneraient des produits agricoles qui paieraient, du moins en grande partie, les produits de ses manufactures et de son commerce. La GrandeBretagne se créerait par ce moyen des consommateurs, au lieu d’en aller chercher jusque chez ses ennemis. Mais ceci tiendrait à un système de modération et de sagesse, plus favorable au bonheur de cette nation que propre à exciter la jalousie des autres, et duquel il résulterait une prospérité moins brillante et plus durable ; il n’est donc pas permis de croire qu’il soit jamais adopté de propos délibéré.
[I-404]
CHAPITRE XLVII.
De la production dans ses rapports avec la distribution des habitants.↩
Les limites et l’administration des États, qui sont tout aux yeux de la politique, ne sont pour l’économie politique que des accidents qui influent de diverses manières et à différents degrés sur la production, la distribution et la consommation des richesses. Les avantages ou les désavantages qui en résultent pour chaque pays, ou portion de pays, ou réunion de pays, ne sont qu’une partie des avantages ou des désavantages sous l’empire desquels ces mêmes contrées existent, tels que l’intelligence ou la stupidité des habitants, la stérilité ou la fécondité du sol, le voisinage ou l’éloignement des rivières et de la mer.
C’est pour cette raison qu’une colonie, et même une province éloignée, doivent, en économie politique, être considérées comme des pays étrangers qui supportent de certaines entraves ou reçoivent de certaines faveurs d’un autre pays qui est leur métropole ; et, sous d’autres rapports, une agrégation de différents États, soumis à certaines circonstances pareilles, comme l’Italie dans l’Europe, l’Europe dans le monde, peut être considérée comme un pays unique. C’est ainsi que Smith a recherché les avantages que l’Europe, considérée comme une grande république, a retirés de la découverte de l’Amérique.
La politique et la géographie physique influant sur les productions, influent sur le nombre des habitants qu’on trouve en chaque lieu, et par conséquent sur leur distribution entre les différentes parties de la terre ; mais ce n’est qu’accidentellement : la nature des productions auxquelles ils se consacrent y influe fondamentalement et suivant des lois constantes.
Ceux qui exercent l’industrie agricole habitent des fermes, des hameaux et tout au plus des villages. Ceux qui exercent l’industrie manufacturière et commerçante se rassemblent le plus souvent dans les bourgs et les villes. Cette distribution est conforme à la nature de leurs occupations : pour cultiver la terre, il faut être répandu sur toute la surface du sol ; pour cultiver les arts industriels et le commerce, il convient de se réunir aux lieux où l’on peut les exercer avec plus d’avantage, c’est-à-dire aux lieux où la division du travail exige un grand concours d’ouvriers et d’entrepreneurs. Le teinturier s’établira auprès du marchand d’étoffes, le droguiste auprès du teinturier, le commissionnaire ou l’armateur qui font venir les drogues se rapprocheront du droguiste ; et il en sera de même des autres producteurs.
D’un autre côté, ceux qui, sans travailler, vivent de leurs capitaux ou de leurs terres, sont attirés dans les villes où ils trouvent réuni tout ce qui flatte leurs goûts ; plus de choix dans la société ; plus de variété dans les plaisirs. Les agréments de la vie des villes y arrêtent les étrangers et y fixent toutes les personnes qui, vivant de leur travail, sont libres néanmoins de l’exercer partout à leur choix. C’est ainsi qu’elles deviennent le siège des administrations, des tribunaux, des établissements publics, et s’accroissent encore de toutes les personnes qui tiennent à ces établissements et de toutes celles que leurs affaires en rapprochent accidentellement.
Ce n’est pas qu’il n’y ait toujours un certain nombre de gens qui exercent l’industrie manufacturière dans les campagnes, sans parler de ceux qui y sont retenus par leurs goûts : une convenance locale, un ruisseau, une forêt, une mine, fixent beaucoup d’usines et un grand nombre de travailleurs manufacturiers hors de l’enceinte des villes. Il y a même quelques travaux manufacturiers qui ne peuvent être exercés que près des consommateurs, comme ceux du tailleur, du cordonnier, du maréchal ; mais ces travaux sont fort peu de chose comparés aux travaux manufacturiers de tout genre qui s’exécutent dans les villes.
Les écrivains économiques estiment qu’un pays peut nourrir les hommes qui se consacrent à sa culture, et encore autant par-delà. Quelques exemples portent à croire que des travaux mieux entendus, un meilleur choix de cultures et moins de terrains perdus permettraient, même sur un sol médiocrement fertile, d’en nourrir beaucoup davantage. Mais en prenant leur évaluation pour bonne, une moitié des habitants d’un pays peut, sans inconvénient, occuper les bourgs et les villes ; et quand les villes fournissent quelques produits à la consommation des contrées étrangères, étant dès lors en état de recevoir des subsistances en échange, elles peuvent contenir une population proportionnellement bien plus forte. C’est ce qu’on voit dans plusieurs petits États dont le territoire seul, comme celui d’Hambourg, ne suffirait pas à nourrir un des faubourgs de leur capitale.
La culture des prairies exigeant moins de façons que celle des champs, dans les pays d’herbages un plus grand nombre d’habitants peuvent se consacrer aux arts industriels ; ils seront donc plus cultivés dans ces pays-là que dans ceux où l’on cultive principalement du blé. C’est ce qui se voit dans la ci-devant Normandie, dans la Flandres, en Hollande.
Depuis l’invasion des barbares dans l’Empire romain jusqu’au XVIIe siècle, c’est-à-dire jusqu’à des temps où nous touchons encore, les villes ont eu un faible éclat dans tous les grands États de l’Europe. La moitié de la population qu’on estime être nourrie par les cultivateurs, ne se composait pas alors principalement de manufacturiers et de négociants, mais de nobles entourés d’une suite nombreuse, de gens d’église et d’autres oisifs, qui habitaient les châteaux avec leurs dépendances, les abbayes, les couvents, et fort peu dans des villes. Les produits des manufactures et du commerce se bornaient à très peu de chose ; les manufacturiers étaient des artisans de chaumière, les négociants des porte-balles ; quelques outils fort simples, des meubles et des ustensiles imparfaits suffisaient aux besoins de la culture et de la vie ordinaire. Trois ou quatre foires par année fournissaient des produits un peu plus recherchés qui nous paraîtraient bien misérables, et si l’on tirait de loin en loin des villes commerçantes d’Italie ou de chez les grecs de Constantinople quelques meubles, quelques étoffes, quelques bijoux de prix, c’était une magnificence grande et rare, réservée seulement aux plus riches seigneurs et aux princes.
Dans cet ordre de choses, les villes devaient faire une pauvre figure. Aussi tout ce qu’on voit de magnifique dans les nôtres est-il très moderne ; parmi toutes les villes de France il serait impossible de trouver un beau quartier, une seule belle rue qui eût deux cents ans d’ancienneté. Tout ce qui date d’une époque antérieure n’y présente, sauf quelques églises gothiques, que des bicoques entassées dans des rues tortueuses, étranglées, qui ne suffisent nullement à la circulation des chars, des voitures, et de la foule qui attestent leur population et leur opulence actuelles.
L’agriculture d’un pays ne produit tout ce qu’elle doit produire que lorsque des villes multipliées sont répandues sur toute l’étendue de son territoire. Elles sont nécessaires au déploiement de la plupart des manufactures, et les manufactures sont nécessaires pour procurer des objets d’échange à l’agriculteur. Un canton où l’agriculture n’a point de débouchés ne nourrit que la moitié des habitants qu’il pourrait nourrir ; et encore ces habitants ne jouissent-ils que d’une existence grossière, dépourvue de tout agrément, de toute recherche ; ils ne sont qu’à moitié civilisés. Qu’une colonie industrieuse vienne s’établir dans ce canton, et y forme peu à peu une ville dont les habitants égaleront bientôt en nombre les cultivateurs qui l’exploitent, cette ville pourra subsister des produits agricoles du canton, et les cultivateurs s’enrichiront des produits industriels de la ville.
La ville même est un excellent moyen de répandre au loin les valeurs agricoles de sa province. Les produits bruts de l’agriculture sont d’un transport difficile, les frais excédant promptement le prix de la marchandise transportée. Les produits des manufactures sont d’un transport beaucoup moins dispendieux ; leur travail fixe une valeur souvent très considérable dans une matière de peu de volume et d’un poids léger. Par le moyen des manufactures, les produits bruts d’une province se transforment donc en produits manufacturés qui voyagent au loin et envoient en retour des valeurs qui enrichissent la province.
Il ne manque à plusieurs de nos provinces de France, maintenant très misérables, que des villes pour être bien cultivées.
Ces provinces resteraient éternellement misérables et dépeuplées si l’on suivait le système des Économistes, qui veulent qu’on fasse faire au-dehors les objets de fabrique, et qu’on paie les marchandises manufacturées avec les produits bruts de l’agriculture.
Mais si les villes ne se fondent que par manufactures de toutes les sortes, petites et grandes, les manufactures ne se fondent qu’avec des capitaux productifs ; et des capitaux productifs ne se forment que de ce qu’on épargne sur les consommations. Il ne suffit pas de tracer le plan d’une ville et de lui donner un nom ; il faut, pour qu’elle existe véritablement, la fournir par degrés de talents industriels, d’ustensiles, de matières premières, de tout ce qui est nécessaire pour entretenir les industrieux jusqu’à la parfaite confection et à la vente de leurs produits ; autrement on risque de faire comme une grande princesse qui a fondé plusieurs villes qui ne se trouvent que sur ses cartes de géographie. C’est ce que l’empereur Joseph II, invité par elle à poser en cérémonie la seconde pierre de la ville d’Ecatherinoslaw dans la Tauride, faisait sentir en disant : J’ai fini une grande affaire en un jour avec l’impératrice de Russie : elle a posé la première pierre d’une ville, et moi la dernière.
LIVRE SECOND.
DES MONNAIES.
[I-413]
RÉFLEXION PRÉLIMINAIRE.↩
Dans le livre qui précède, j’ai expliqué aussi nettement qu’il m’a été possible les principaux phénomènes de la production. Le savant, le chef d’entreprise, l’ouvrier, l’homme qui exerce un talent quelconque, le capitaliste, le propriétaire foncier, le gouvernement enfin, ont pu voir quel est le contingent qu’ils apportent à cette masse où la société puise la satisfaction de ses besoins et de ses jouissances.
Nous nous sommes élevés j’espère à cette considération importante que la richesse consiste, non dans le produit en lui-même, puisqu’il n’est pas une richesse s’il n’a pas une valeur, mais dans sa VALEUR.
Il s’agirait maintenant de montrer comment et dans quelles proportions s’opère entre les membres de la société la distribution de la chose produite, c’est-à-dire de la VALEUR des produits ; mais il convient auparavant qu’on connaisse bien la nature et l’usage du principal agent de cette distribution, la MONNAIE, portion importante des richesses sociales, à laquelle certaines personnes réservent exclusivement le nom de richesses, tandis que selon d’autres elle n’en est que le signe ; deux erreurs qu’on a souvent réunies, quoique contradictoires, et qui ont précipité les hommes dans des opérations bien fausses et souvent bien funestes.
[I-415]
CHAPITRE PREMIER.
De la nature et de l’usage des monnaies.↩
Dans une société tant soit peu civilisée, chaque personne ne produit pas tout ce qui est nécessaire à ses besoins. Il est rare même qu’une seule personne crée entièrement un seul produit. Mais quand elle le créerait en entier, ses besoins ne se bornent pas à une seule chose : ils sont extrêmement variés. Elle est donc obligée de se procurer tous les autres objets de sa consommation, en échangeant ce qu’elle produit en un seul genre au-delà de ses besoins, contre les autres produits qui lui sont nécessaires.
Et l’on peut remarquer ici en passant que chaque personne ne conservant pour son usage que la plus petite partie de ce qu’elle produit, le jardinier la plus petite partie des légumes qu’il fait croître, le boulanger la plus petite partie du pain qu’il cuit, le cordonnier la plus petite partie des chaussures qu’il fabrique, et ainsi des autres, on peut remarquer, dis-je, que la plus grande partie, la presque totalité des produits de la société n’est consommée qu’à la suite d’un échange.
Ici une difficulté se présente.
Le coutelier va chez le boulanger, et, pour avoir du pain, il lui offre des couteaux ; mais le boulanger est pourvu de couteaux : c’est un habit qu’il lui faut. Pour en avoir un il donnerait volontiers du pain au tailleur ; mais le tailleur ne manque point de cette denrée ; il voudrait avoir de la viande, et ainsi de suite à l’infini.
Dans le cas supposé, le coutelier ne pouvant faire agréer au boulanger une marchandise dont celui-ci n’a pas besoin, cherchera du moins à lui offrir une marchandise que le boulanger puisse à son tour échanger facilement contre toutes les denrées qui pourront lui devenir nécessaires. S’il existe dans la société une marchandise qui soit recherchée non seulement à cause des services qu’on en peut tirer, mais à cause de la facilité qu’on trouve à l’échanger contre tous les produits nécessaires à la consommation, c’est celle-là dont se munira notre coutelier lorsqu’il voudra se procurer du pain.
Cette marchandise est la monnaie.
Tout producteur sachant que, suivant la coutume de son pays, elle sera volontiers reçue en échange contre toute autre marchandise d’égale valeur, est toujours prêt à la recevoir lui-même en échange des produits dont il peut disposer. Elle lui convient par cela seul qu’il est assuré qu’elle conviendra à d’autres ; et elle convient à tous par la même raison qu’elle lui convient à lui-même.
Dans une société très avancée, où les besoins de chacun sont variés et nombreux, et où les opérations productives sont réparties entre beaucoup de mains, la nécessité des échanges est encore plus grande et ils deviennent plus compliqués. Si un homme, par exemple, au lieu de faire un couteau tout entier, ne fait autre chose que des manches de couteaux, comme cela arrive dans les villes où la fabrique de coutellerie est établie en grand, cet homme ne produit pas une seule chose qui puisse lui être utile, car que ferait-il d’un manche de couteau sans lame ? Il ne saurait consommer la plus petite partie de ce qu’il produit ; il faut nécessairement qu’il en échange la totalité contre les choses qui lui sont nécessaires, contre du pain, de la viande, de la toile, etc. ; mais ni le boulanger, ni le boucher, ni le tisserand n’ont besoin dans aucun cas d’un produit qui ne saurait convenir qu’au seul manufacturier en coutellerie, lequel ne saurait donner, en échange, de la viande ou du pain, puisqu’il n’en produit point ; il faut donc qu’il donne une marchandise que, suivant la coutume du pays, on puisse espérer d’échanger facilement contre la plupart des autres denrées.
C’est ainsi que la monnaie est d’autant plus nécessaire que le pays est plus civilisé et que la division du travail y est poussée plus loin. Cependant l’histoire offre des exemples de nations assez considérables où l’usage d’une marchandise-monnaie a été inconnu. Tels étaient les Mexicains [101] . Encore à l’époque où des aventuriers espagnols les subjuguèrent, commençaient-ils à employer, comme monnaie, des grains de cacao dans les menus détails du commerce.
J’ai dit que c’était la coutume et non pas l’autorité du gouvernement qui faisait qu’une certaine marchandise était monnaie plutôt qu’une autre ; car la monnaie a beau être frappée en écus, le gouvernement (du moins dans les temps où la propriété est respectée) ne force personne à donner sa marchandise contre des écus. Si, en faisant un marché, on consent à recevoir des écus en échange d’une autre denrée, ce n’est point par égard pour l’empreinte. On donne et l’on reçoit de la monnaie aussi librement que toute autre denrée, et l’on troque, toutes les fois qu’on le juge préférable, une denrée contre une autre, ou contre un lingot d’or ou d’argent non frappé en monnaie. C’est donc uniquement parce qu’on sait par expérience que les écus conviendront aux propriétaires des marchandises dont on pourra avoir besoin, que soi-même on reçoit des écus préférablement à toute autre marchandise. Cette libre préférence est la seule autorité qui donne aux écus l’usage de monnaie ; et si l’on croyait qu’avec une marchandise autre que des écus, avec du blé par exemple, on pût acheter plus aisément les choses dont on supposera qu’on peut avoir besoin, on refuserait sa marchandise contre des écus, on demanderait du blé en échange, et c’est alors le blé qui deviendrait monnaie.
C’est donc la coutume et non la loi d’un pays qui fait qu’une certaine marchandise, fût-ce même des écus, est monnaie plutôt qu’une autre marchandise.
L’échange d’un produit quelconque contre la marchandise monnaie se répétant plus souvent que tout autre, on lui a donné un nom particulier. Recevoir de la monnaie en échange, c’est vendre ; en donner, c’est acheter.
Tel est le fondement de l’usage de la monnaie. Il ne faut pas croire que ces considérations soient une spéculation purement curieuse. Tous les raisonnements, toutes les lois, tous les règlements relatifs à cette matière doivent reposer sur ces fondements. L’édifice qu’on élèverait sur une autre base ne serait ni beau, ni solide, et remplirait mal l’objet de sa destination.
Afin d’entourer de clarté les qualités essentielles de la monnaie et les principaux accidents qui y ont rapport, je ferai, suivant ma méthode, de ces matières le sujet d’autant de chapitres particuliers, et je tâcherai que malgré cette division, l’esprit du lecteur qui m’accordera quelqu’attention suive aisément le fil qui les lie, et puisse les grouper ensuite de manière à comprendre le jeu total de ce mécanisme, et la nature des dérangements qu’y apportent quelquefois les sottises des hommes ou le hasard des événements.
[I-422]
CHAPITRE II.
Du choix de la marchandise qui sert de monnaie.↩
Bien que le choix de la marchandise qui sert de monnaie soit arbitraire, il est loin d’être indifférent. Il faut qu’elle réunisse plusieurs qualités propres à cet usage et sans lesquelles on ne peut espérer que la coutume de la recevoir comme monnaie s’étende bien loin et dure bien longtemps.
Homère dit que l’armure de Diomède avait coûté neuf bœufs. Si un guerrier avait voulu acheter une armure qui n’eût valu que la moitié de celle-là, comment aurait-il fait pour payer quatre bœufs et demi ? Il faut que la marchandise servant de monnaie puisse se proportionner, sans s’altérer, aux divers produits qu’on peut vouloir acquérir en échange.
En Abyssinie le sel sert de monnaie [102] . Si le même usage existait en France, il faudrait, en allant au marché, porter avec soi une montagne de sel pour payer ses provisions. Il faut que la marchandise servant de monnaie ne soit pas tellement commune qu’on ne puisse l’échanger qu’en transportant des masses énormes.
On dit qu’à TerreNeuve on se sert de morues sèches en guise de monnaie, et Smith parle d’un village d’Écosse où l’on emploie pour cet usage des clous [103] . Outre beaucoup d’inconvénients auxquels ces matières sont sujettes, on peut en augmenter rapidement la masse presqu’à volonté, ce qui amènerait en peu de temps une grande variation dans leur valeur. Or on n’est pas disposé à recevoir couramment une marchandise qui peut, d’un moment à l’autre, perdre la moitié ou les trois quarts de son prix. Il faut que la marchandise servant de monnaie soit d’une extraction assez difficile pour que ceux qui la reçoivent ne craignent pas de la voir s’avilir en très peu de temps.
Aux Maldives, et dans quelques parties de l’Inde et de l’Afrique, on se sert pour monnaie d’un coquillage nommé cauri. Cette monnaie ne pourrait longtemps avoir cours chez des nations qui trafiqueraient avec une grande partie du globe ; elles trouveraient trop incommode une marchandise-monnaie qui, hors des limites d’un certain territoire, n’aurait plus de cours. On est d’autant plus disposé à recevoir une marchandise par échange, qu’il y a plus de lieux où cette même marchandise sera admise à son tour de la même façon.
On ne doit donc pas être surpris que presque toutes les nations commerçantes du monde aient fixé leur choix sur les métaux pour leur servir de monnaie ; et il suffit que les plus industrieuses, les plus commerçantes d’entre elles l’aient fait, pour qu’il ait convenu aux autres de le faire.
Aux époques où les métaux maintenant les plus communs étaient rares, on se contentait de ceux-là. La monnaie des Lacédémoniens était de fer. Celle des premiers Romains était de cuivre. À mesure qu’on a tiré de la terre une plus grande quantité de fer ou de cuivre, ces monnaies ont eu les inconvénients attachés aux produits de trop peu de valeur [104] , et depuis longtemps les métaux précieux, c’est-à-dire l’or et l’argent, sont la monnaie la plus généralement adoptée.
Ils sont singulièrement propres à cet usage. Ils se divisent en autant de petites portions qu’il est besoin et se réunissent de nouveau sans perdre de leur poids ni de leur valeur. On peut par conséquent proportionner leur quantité à la valeur de la chose qu’on achète.
En second lieu, les métaux précieux sont d’une qualité uniforme par toute la terre.
Un gramme d’or pur, qu’il sorte des mines d’Amérique ou d’Europe, ou bien des rivières d’Afrique, est exactement pareil à un autre gramme d’or pur. Le temps, l’air, l’humidité n’altèrent point cette qualité ; et le poids de chaque partie de métal est par conséquent une mesure exacte de sa quantité et de sa valeur comparée à toute autre partie ; deux grammes d’or ont une valeur justement double d’un gramme du même métal.
La dureté de l’or et de l’argent, surtout au moyen des alliages qu’ils admettent, les fait résister à un frottement assez considérable ; ce qui les rend propres à une circulation rapide ; quoique sous ce rapport ils soient inférieurs à plusieurs pierres précieuses.
Ils ne sont ni assez rares, ni par conséquent assez chers, pour que la quantité d’or ou d’argent équivalente à la plupart des marchandises échappe aux sens par sa petitesse ; et ils ne sont pas encore assez communs pour qu’il faille en transporter une immense quantité pour transporter une grosse valeur. Ils seront peut-être dans plusieurs siècles sujets à cet inconvénient, surtout si l’on découvre des mines nouvelles et abondantes. Alors il se pourra qu’on fasse de la monnaie avec du platine ou d’autres métaux que nous ne connaissons pas encore.
Enfin, l’or et l’argent sont susceptibles de recevoir des marques et des empreintes qui certifient le poids des pièces et le degré de leur pureté.
Quoique les métaux précieux servant de monnaie soient ordinairement alliés à une certaine quantité d’un métal plus commun comme le cuivre, on compte pour rien la valeur du métal commun qui fait l’alliage. Ce n’est pas que ce métal commun n’ait aucune valeur en lui-même ; mais si l’on voulait le séparer, cette opération coûterait plus que le métal commun qu’on en retirerait ne vaudrait. C’est pour cela qu’on ne considère dans une pièce de métal précieux portant alliage, que la quantité de métal précieux pur qu’elle contient.
Dans notre monnaie d’argent actuelle, il y a un dixième de cuivre sur neuf dixièmes d’argent fin ; la valeur du cuivre est à celle de l’argent environ comme 1 est à 100. La valeur du cuivre contenu dans notre monnaie d’argent est donc à peu près la millième partie de la valeur totale de nos pièces d’argent. En supposant qu’on voulût en séparer le cuivre il ne paierait pas les frais de départ ; sans parler du prix de la façon de la monnaie qu’on perdrait. On le compte donc pour rien dans l’évaluation de la monnaie. On ne voit dans une pièce de 5 francs que 22,5 grammes d’argent fin qui s’y trouvent, quoique son poids total soit de 25 grammes, le cuivre compris.
[I-428]
CHAPITRE III.
De la valeur que la qualité d’être monnaie ajoute à une marchandise.↩
Il résulte des précédents chapitres que la monnaie est reçue dans les échanges, non par l’autorité du gouvernement, mais parce que c’est une marchandise ayant une valeur ; et qu’elle est préférée à égalité de valeur, parce qu’au moyen de la convention qui la fait admettre en échange de toute autre denrée indifféremment, elle est à l’usage de tous ceux qui ont besoin de quelque chose, c’est-à-dire de tout le monde. Avec de la marchandise-monnaie on est assuré de pouvoir se procurer une denrée quelconque au moyen d’un seul échange ; avec toute autre marchandise, on ne l’est pas : si celle que vous offrez ne convient pas à l’homme qui possède celle dont vous avez besoin, vous êtes forcé d’échanger la vôtre d’abord contre de la monnaie et d’échanger ensuite votre monnaie contre la denrée qui vous est nécessaire.
Maintenant j’ajouterai que l’adoption d’une marchandise pour faire office de monnaie, augmente considérablement sa valeur intrinsèque, sa valeur comme marchandise. C’est un nouvel usage trouvé à cette denrée, et qui la fait rechercher davantage. C’est un emploi qui en absorbe une grande partie, la moitié, peut-être les trois quarts, et qui par conséquent la rend plus rare et plus chère.
Si avec la quantité d’or et d’argent qui existe actuellement, ces métaux ne servaient qu’à la fabrication de quelques ustensiles et de quelques ornements, ils abonderaient, et seraient à bien meilleur marché qu’ils ne sont ; c’est-à-dire qu’en les échangeant contre toute espèce de denrées il faudrait, dans ce troc, en donner davantage à proportion. Mais comme une grande partie de ces métaux sert de monnaie et que cette partie ne sert pas à autre chose, il en reste moins à employer en meubles et en bijoux ; or cette rareté ajoute à leur valeur. De même s’ils ne servaient jamais de meubles et de bijoux, il en resterait davantage pour l’usage de monnaie et la monnaie baisserait de prix, c’est-à-dire qu’il en faudrait donner plus pour acheter la même quantité de marchandise. L’usage des métaux précieux dans l’orfèvrerie les rend plus rares et plus chers comme monnaie, de même que leur usage comme monnaie les rend plus rares et plus chers dans l’orfèvrerie.
Le résultat de ce fait est que ces matières étant devenues d’un prix plus grand que ne le comporte leur usage comme marchandise, à cause de leur qualité de monnaie, il convient moins de les em 948.ployer comme marchandise. Une telle marchandise vaut plus qu’elle ne profite. Aussi l’usage des meubles d’or massif un peu considérables est-il absolument tombé, surtout dans les pays où un commerce actif, un grand mouvement de richesses, a rendu l’or très précieux comme monnaie. Chez les gens les plus riches on se contente de meubles dorés, c’est-à-dire sur lesquels on a étendu une très mince couche d’or ; et l’on ne fait plus en or massif que des bijoux fort petits et auxquels l’art du joaillier a encore trouvé le moyen de placer moins de valeur en métal qu’en main-d’œuvre.
L’augmentation de la valeur des métaux en général, qui a quelques inconvénients en ce qu’elle élève le prix de certains ustensiles très commodes comme des plats, des cuillers d’argent, au-dessus de la portée de bien des ménages, n’a aucun inconvénient lorsqu’elle élève leur prix comme monnaie ; il y a au contraire plus de commodité à transporter soit dans les échanges, soit dans les déplacements, une moins grande masse d’argent que si l’argent était plus commun.
Quelquefois une marchandise n’a d’autre utilité que d’être admise par la coutume à faire office de monnaie. Je ne sache pas que les coquillages nommés cauris aient aucun autre usage. Cette seule utilité suffit pour leur donner une valeur ; valeur qui s’établit dans les lieux où l’on vend et achète avec des cauris, suivant les règles qui déterminent les valeurs des choses, qui déterminent chez nous-mêmes la valeur de notre monnaie. (Voyez le Liv. III.)
Cette valeur établie pour les cauris dans un lieu du monde, leur donne même une certaine valeur dans tous les autres lieux qui communiquent avec le premier. Sans l’usage qu’on peut faire de ce coquillage à Ceylan où il passe comme monnaie, il ne vaudrait rien à Batavia où il ne sert point couramment à cet usage.
L’emploi d’une marchandise comme monnaie dans un lieu du monde, augmente de la même façon sa valeur dans les lieux où elle fait également office de monnaie. Si l’argent cessait d’être adopté comme monnaie en Asie, il n’y a pas de doute que ce métal ne diminuât de valeur en Europe, et qu’il ne fallût y donner plus d’argent en échange de toute autre denrée ; car un des usages de l’argent d’Europe consiste à pouvoir être employé en Asie.
Cette faculté de servir de monnaie ne fixe point la valeur des métaux précieux ; elle reste variable soit d’un lieu à un autre, soit d’un temps à un autre, comme celle de toute autre marchandise. Avec une demi-once d’argent à la Chine, on obtient des denrées utiles ou agréables équivalentes à ce qu’on en aurait pour une once d’argent en France. Et en France, avec une once d’argent, on obtient en général plus de choses qu’on n’en obtient à Londres avec la même quantité de ce métal. L’argent vaut plus en Chine qu’en France, et plus en France qu’en Angleterre.
On voit que la monnaie, que quelques-uns appellent numéraire, est une marchandise dont la valeur s’établit suivant les règles communes à toutes les autres marchandises. Considéré en masse, le numéraire qui se trouve répandu dans une société fait aussi bien partie des richesses de cette société que l’indigo, le sucre, le café qui sont en sa possession. Il varie de valeur comme les autres marchandises et se consomme comme elles, quoique plus lentement que la plupart d’entre elles. On ne saurait donc approuver la manière dont le représente un auteur estimé, lorsqu’il dit que « tant que l’argent reste sous la forme de monnaie, il n’est pas proprement une richesse, dans le sens strict de ce mot, puisqu’il ne peut directement et immédiatement satisfaire un besoin ou une jouissance ». Une foule de valeurs ne sont pas susceptibles de satisfaire un besoin ou une jouissance sous leur forme actuelle. Un négociant possède un magasin entier rempli d’indigo qui ne peut servir en nature, ni à nourrir, ni à vêtir, et qui n’en est pas moins une richesse, richesse qu’il transformera dès qu’il le voudra en une autre valeur immédiatement propre à l’usage. L’argent en écus est donc une richesse aussi bien que l’indigo en barils.
Le même auteur avoue à la vérité dans un autre endroit que
« dans les coffres d’un particulier le numéraire est une vraie richesse, une partie intégrante des biens qu’il possède et qu’il peut consacrer à ses jouissances ; mais que sous le rapport de l’économie publique, ce numéraire n’est autre chose qu’un instrument d’échange, totalement distinct des richesses qu’il sert à faire circuler. [105] ».
Je crois en avoir dit assez pour prouver l’analogie complète qu’il y a entre le numéraire et toutes les autres richesses. Ce qui est richesse pour un particulier l’est pour une nation qui n’est que la réunion des particuliers, l’est aux yeux de l’économie publique qui ne doit pas raisonner sur des valeurs imaginaires, mais sur ce que chaque particulier, ou tous les particuliers réunis, regardent, non dans leurs discours, mais dans leurs actions, comme des valeurs.
C’est une preuve de plus qu’il n’y a pas deux ordres de vérités dans cette science non plus que dans les autres ; ce qui est vrai pour un individu l’est pour un gouvernement, l’est pour une société. La vérité est une : les applications seules diffèrent.
[I-436]
CHAPITRE IV.
De l’utilité de l’empreinte des monnaies, et des frais de fabrication.↩
Jusqu’à présent, il n’a été nullement question de la valeur qu’ajoutent aux monnaies l’empreinte et la fabrication. L’or et l’argent ont presque partout une valeur comme marchandises utiles et agréables ; et dans leur utilité, j’ai compris celle de servir de monnaie : voilà tout.
Dans les pays où l’or et l’argent servent de monnaie, cette qualité les expose à subir des échanges fréquents. Il est peu de personnes qui, dans le cours de chaque journée, ne fassent plusieurs ventes ou plusieurs achats. Qu’il serait incommode d’aller, toujours la balance à la main, vérifier la quantité d’or qu’on donne ou qu’on reçoit ! Que d’erreurs et de disputes naîtraient de la maladresse des gens, ou de l’imperfection des instruments !
Ce serait peu. L’or et l’argent peuvent subir, par leur mélange avec d’autres métaux, une altération qui n’est pas reconnaissable à la seule inspection. Il faut, pour s’assurer de leur pureté, une opération chimique, délicate et compliquée. Combien les échanges ne sont-ils donc pas plus commodes quand une empreinte, facile à reconnaître, atteste à la fois le poids du morceau de métal, et sa qualité !
C’est l’art du monnayeur qui réduit les métaux à un titre connu, et qui les divise par pièces dont le poids est également connu.
Ordinairement, dans chaque État, le gouvernement se réserve l’exercice exclusif de ce genre de manufacture, soit qu’à la faveur du monopole il veuille se ménager un profit plus considérable que si cette industrie était ouverte à tout le monde, soit plutôt qu’il veuille offrir à ses administrés une garantie plus digne de leur confiance que celle que leur donnerait une manufacture appartenant à des particuliers. En effet la garantie des gouvernements, toute frauduleuse qu’elle a été trop souvent, convient encore mieux aux peuples qu’une garantie particulière, tant à cause de l’uniformité des pièces, que parce que la fraude serait peut-être plus difficile encore à reconnaître exercée par des particuliers.
Le monnayage ajoute incontestablement une valeur au métal monnayé ; c’est-à-dire qu’un morceau d’argent frappé en une pièce de 5 francs vaut un peu plus que la même quantité du même métal en lingot. La raison en est simple. La façon donnée à ce métal évite à celui qui le reçoit en échange les frais (parmi lesquels sont compris la perte de son temps et sa peine) que lui occasionneraient l’essayage et le pesage. C’est ainsi qu’un habit tout fait vaut plus que l’étoffe dont il est composé. Ainsi, en supposant que l’industrie de battre monnaie fût libre et que l’autorité publique se bornât à fixer le titre, le poids et l’empreinte que chaque pièce devrait avoir, il conviendrait encore à toute personne qui n’aurait que des lingots, de payer à un manufacturier la façon du métal qu’elle serait dans le cas d’employer comme monnaie, car autrement elle aurait de la peine à en faire l’échange, et dans cet échange elle serait peut-être obligée de supporter une perte plus grande que la façon des pièces de monnaie.
Ne confondons point la valeur ainsi ajoutée aux métaux précieux par le monnayage, avec celle qu’ils ont acquise comme marchandise servant de monnaie. Cette dernière valeur est commune à la masse totale de l’or ou de l’argent ; un gobelet d’argent vaut plus que si l’argent ne servait pas à faire des monnaies ; tandis que la valeur ajoutée par la fabrication des pièces est particulière à la pièce, comme la façon est particulière au gobelet, et elle est en sus de la valeur que les divers usages de la marchandise lui ont donnée.
En Angleterre, le gouvernement supporte en entier les frais de fabrication. Il vous rend en guinées le même poids qu’on lui porte en lingots au titre des guinées. Il fait cadeau au peuple, comme consommateur de monnaie, des frais de fabrique qu’il prélève, par la voie des impôts, sur le peuple comme contribuable. Cependant l’or façonné en guinées a évidemment un avantage ; ce n’est pas l’avantage d’être tout pesé, car on prend la peine de le peser de nouveau chaque fois qu’on le reçoit ; mais il a celui d’être essayé. Il arrive quelquefois, en conséquence, qu’on porte des lingots à la Monnaie, non pour en tirer des pièces de monnaie, mais simplement pour faire constater le titre du métal, et se servir de cette attestation soit dans l’intérieur, soit au-dehors. De manière que lorsqu’on a de l’or à envoyer dans l’étranger, on doit préférer d’y envoyer des guinées comme étant des lingots soumis à l’essai, plutôt que des lingots qui ne portent aucun certificat d’essayage.
D’un autre côté, l’étranger, quand il a de l’or à faire passer en Angleterre, n’a aucun intérêt à y envoyer des guinées plutôt que des lingots ; elles n’y ont pas une valeur supérieure au lingot (à titre et poids égaux), puisque l’hôtel des monnaies vous donne gratuitement des guinées contre des lingots. L’étranger a intérêt au contraire de se réserver les guinées qui sont un métal portant son certificat d’essayage, et d’envoyer en Angleterre des lingots auxquels on donnera, sans frais, le même certificat. On voit que cette méthode présente des motifs pour faire sortir du pays le métal monnayé, et n’en présente pas pour l’y faire rentrer [106] .
Ces inconvénients sont en partie prévenus par une circonstance purement accidentelle qui n’est point entrée dans les calculs du législateur. L’hôtel des monnaies de Londres, le seul qu’il y ait en Angleterre, est tellement surchargé d’ouvrage, qu’il ne peut rendre la monnaie fabriquée que plusieurs semaines et quelquefois plusieurs mois après qu’on lui a porté l’or en lingots [107] . Il en résulte que le propriétaire de l’or, quand il lui confie son métal pour y être frappé, perd l’intérêt de sa somme pendant tout le temps que l’hôtel des monnaies la lui garde. Cela équivaut à un léger droit de fabrication qui élève la valeur de l’or en monnaie un peu au-dessus de celle de l’or en lingots. On sent que cette valeur serait exactement la même si, à bureau ouvert, on recevait à volonté des guinées pour de l’or, poids pour poids.
Tel est l’effet de la législation anglaise à cet égard.
Dans tous les autres États de l’Europe, le gouvernement, si je ne me trompe, se ménage un bénéfice plus que suffisant pour couvrir les frais de fabrication [108] . Le privilège exclusif de battre monnaie qu’ils se sont réservé avec raison, et les peines sévères auxquelles sont exposés les monnayeurs clandestins, leur permettent de porter ce bénéfice un peu plus haut que les bénéfices ordinaires des fabrications libres ; c’est-à-dire de l’élever aussi haut que le comporte la facilité qu’ils procurent en divisant l’or et l’argent en pièces de monnaie. Ils ne peuvent pas le porter au-delà. Ils ne peuvent pas, et ceci est digne de remarque, faire recevoir la monnaie pour une valeur plus grande que la valeur du métal, plus la valeur qu’y ajoutent l’affinage et la façon. En effet, si l’on suppose que, dans le commerce, un lingot d’argent vaille cent francs, et que frappé en écus l’utilité de cette nouvelle forme porte sa valeur à cent cinq francs ; c’est-à-dire en supposant qu’on obtienne un vingtième de plus de quelque marchandise que ce soit, lorsque l’argent avec lequel on achète cette marchandise est frappé en écus ; dans cette supposition, dis-je, le gouvernement pourra faire un bénéfice de cinq francs sur cent francs, dont la moitié, plus ou moins, sera absorbée par les frais du monnayage ; mais il ne pourra pas porter son bénéfice plus loin. S’il lui arrivait de dire qu’il entend s’attribuer un bénéfice non de cinq, mais de douze francs, sur cent, et s’il appelait cent douze francs un lingot de la valeur de cent francs frappé en monnaie, il n’obtiendrait pour cent douze francs que la même quantité de denrées, les mêmes services qu’il aurait obtenus s’il eût appelé le même lingot cent cinq francs. Dans les marchés que le gouvernement conclut avec les particuliers, et dans ceux que les particuliers concluent entre eux, une pièce de monnaie n’est reçue, quelque dénomination qu’on lui donne, que pour sa valeur intrinsèque, accrue de la valeur que l’utilité de son empreinte y ajoute [109] .
À la vérité le gouvernement peut acquitter des engagements précédemment contractés, avec une valeur nominale au lieu d’une valeur réelle ; il peut donner à ses créanciers pour cent douze francs ce qui n’en vaut que cent cinq ; mais c’est alors une altération des monnaies qui ressemble à toutes les autres ; c’est une banqueroute érigée en loi, et une banqueroute très défavorable au gouvernement lui-même, car un gouvernement est créancier en même temps que débiteur ; il est créancier des contribuables. La banqueroute qu’il fait en diminuant la valeur intrinsèque des monnaies, lui est utile seulement dans une partie de ses paiements (ceux qu’il fait en vertu d’un contrat antérieur) tandis qu’elle lui est nuisible dans la presque totalité de ses recettes.
C’est donc à tort qu’on a dit qu’un impôt sur les monnaies était payé par tous ceux qui font usage des monnaies. Il n’y a de payé par eux que la valeur provenant de la commodité de l’empreinte ; la partie de l’impôt qui excède cette valeur n’est payée que par le créancier de l’État dont le contrat est antérieur à l’établissement de l’impôt ; car les nouveaux créanciers traitent en conséquence, et s’ils ne se font peut-être pas payer un intérêt plus fort, c’est que la monnaie qu’ils prêtent ne vaut pas plus que celle avec quoi on les paie.
Quand la fabrication de la monnaie n’est pas gratuite, et surtout quand elle est payée sur le pied d’une fabrication exclusive, il est absolument indifférent à l’État qu’on fonde ou qu’on exporte les monnaies ; car on ne peut les fondre ou les exporter qu’après avoir bien payé leur façon, la seule valeur qui se perde dans la fonte ou l’exportation [110] . Bien au contraire ; l’exportation d’une telle monnaie n’est pas moins avantageuse que toute autre exportation de marchandise manufacturée. C’est une branche de l’orfèvrerie ; et il n’est pas douteux qu’une monnaie qui serait assez bien frappée pour ne pouvoir être aisément contrefaite, une monnaie essayée et pesée avec précision, et sur la fabrication de laquelle on se contenterait d’un bénéfice modéré, pourrait devenir d’un usage courant en plusieurs lieux du monde, et que l’État qui la fabriquerait en tirerait un profit nullement méprisable.
Le gouvernement, quoique fabricant de monnaie, et n’étant point tenu de la fabriquer gratuitement, ne doit pas néanmoins retenir les frais de fabrication sur les sommes qu’il paie en exécution de ses engagements. S’il s’est engagé à payer, je suppose, pour des fournitures qui lui ont été faites, une somme d’un million, il ne peut, avec justice, dire au fournisseur :
« Je me suis engagé à vous payer un million, mais je vous paie en monnaie qui sort de dessous le balancier, et je vous retiens vingt mille francs, plus ou moins, pour frais de fabrication. »
En effet, le sens de tous les engagements pris par le gouvernement ou par les particuliers est celui-ci : Je m’engage à payer telle somme en monnaie fabriquée, et non pas telle somme en lingots ; l’échange qui sert de base à ce marché a été fait en conséquence de ce que l’un des contractants donnait pour sa part une denrée un peu plus chère que l’argent, c’est-à-dire de l’argent frappé en écus.
Le gouvernement doit donc de l’argent monnayé ; il a dû acheter en conséquence, c’est-à-dire obtenir plus de marchandise que s’il s’était engagé à payer en argent-lingots ; dans ce cas il bénéficie des frais de fabrication, au moment où il conclut le marché, au moment où il obtient une plus grande quantité de marchandise que s’il eût fait ses paiements en lingots.
C’est quand on lui porte du métal à fabriquer en monnaie qu’il doit faire payer ou retenir en argent les frais de fabrication.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit, que la fabrication des monnaies en pièces frappées augmente leur valeur en proportion de l’augmentation de commodité qui en résulte pour ceux qui en font usage, et non au-delà, quels que soient les frais et les droits qu’on peut vouloir y joindre ; que le gouvernement, en se réservant la faculté de fabriquer exclusivement les pièces de monnaie, peut faire son profit de toute la valeur ainsi ajoutée au métal ; qu’il lui est impossible de pousser son bénéfice plus loin dans les paiements qu’il fait en vertu de marchés librement contractés avec lui ; et que quant aux paiements qu’il fait en vertu de marchés antérieurs, il ne le peut sans faire une banqueroute.
Il est au surplus évident que pour ce qui est des ventes et des achats qui se font entre particuliers, il est encore moins au pouvoir du souverain de donner, au moyen de l’empreinte, à la marchandise servant de monnaie, une valeur supérieure à sa valeur intrinsèque, augmentée de la valeur qu’y ajoute la façon. Le souverain aura beau ordonner qu’une once d’argent vaille cent francs quand elle a reçu son empreinte, elle n’achètera toujours que ce que peut acheter une once d’argent ainsi façonnée.
[I-449]
CHAPITRE V.
De l’altération des monnaies.↩
Si la théorie des monnaies a offert des difficultés contre lesquelles ont échoué même de très bons esprits, c’est, je crois, parce qu’on a confondu ce qui est de la nature des monnaies, avec ce que les dispositions des hommes y ont ajouté chez presque toutes les nations. C’est un labyrinthe obscur dont la législation a épaissi les ténèbres et multiplié les détours. Les princes, après avoir épuisé les inventions du génie fiscal pour imposer aux peuples toutes les charges que ceux-ci pouvaient supporter, ont cherché de nouvelles ressources dans des lois ou des règlements monétaires, publics ou secrets ; quelquefois même des administrateurs animés du seul amour du bien public se sont imaginé de la meilleure foi du monde qu’ils enrichiraient leur pays par de pareilles opérations. Le philosophe qui s’efforce de débrouiller ce chaos ne ressemble pas mal à un chimiste qui cherche le résultat d’une expérience, à travers les souillures que l’intérêt ou la sottise ont répandues dans son creuset.
On peut observer avant tout que la puissance publique a presque toujours eu la prétention de désigner la marchandise qui devait servir de monnaie. Cette prétention par elle-même a eu peu d’inconvénients, les intérêts du souverain étant ici parfaitement d’accord avec ceux du peuple. Un gouvernement qui offrirait une monnaie peu acceptable ne ferait que des achats désavantageux.
Ainsi Numa, qui frappa le premier des monnaies pour les Romains, les fit en cuivre ; et cette matière était celle qui convenait le mieux à cette époque, puisqu’avant Numa les Romains se servaient de cuivre en lingot [111] . De la même manière les gouvernements modernes ont choisi l’or et l’argent, qui seraient sans doute choisis par les particuliers, quand même les gouvernements ne s’en mêleraient pas.
Les princes s’étant persuadés que leur volonté était nécessaire et suffisante pour donner cours de monnaie à une certaine marchandise, ils sont parvenus à le persuader à des peuples ignorants, dans le temps même que ces peuples, guidés par l’intérêt personnel, agissaient suivant des principes tout opposés ; car quiconque n’était pas satisfait de la monnaie du prince, ou ne vendait pas, ou bien disposait autrement de sa marchandise.
Cette erreur en a entraîné une beaucoup plus grave et qui a tout brouillé.
L’autorité publique s’est persuadée qu’elle pouvait à son gré augmenter ou diminuer la valeur des monnaies, et que dans l’échange d’une marchandise contre une pièce de monnaie, la valeur de la marchandise se balançait avec la valeur imaginaire que le prince donnait à sa monnaie, et non avec la valeur intrinsèque contenue dans cette monnaie.
Ainsi quand Philippe Ier roi de France mêla un tiers d’alliage dans la livre d’argent de Charlemagne, qui pesait 12 onces d’argent, et qu’il appela du même nom de livre un poids de 8 onces d’argent seulement, il crut néanmoins que sa livre valait autant que celle de ses prédécesseurs. Elle ne valait cependant que les deux tiers de la livre de Charlemagne. Pour une livre de monnaie on ne trouva plus à acheter que les deux tiers de la quantité de marchandise que l’on avait auparavant pour une livre. Les créanciers du roi et ceux des particuliers ne retirèrent plus de leurs créances que les deux tiers de ce qu’ils devaient en retirer ; les baux ne rendirent plus aux propriétaires de biens-fonds que les deux tiers de leur précédent revenu, jusqu’à ce que de nouveaux contrats remissent les choses sur un pied plus équitable.
On commit et l’on autorisa comme on voit bien des injustices ; mais on ne fit pas valoir une livre de 8 onces d’argent pur autant qu’une livre de 12 onces.
Dans l’année 1113, ce qu’on appelait livre ne contenait plus que six onces d’argent fin ; au commencement du règne de Louis VII elle ne contenait plus que 4 onces. Saint Louis appela du nom de livre une quantité d’argent pesant 2 onces 6 gros 6 grains [112] . Enfin à l’époque de la Révolution française, ce qu’on appelait du même nom n’était plus que la sixième partie d’une once ; tellement que la livre tournois n’avait plus que la 72e partie de la quantité d’argent fin qu’elle contenait du temps de Charlemagne.
Je ne m’occupe point en ce moment de la diminution qui a eu lieu dans la valeur de l’argent fin, qui, à égalité de poids, ne vaut guère que le quart de ce qu’il valait alors. Cette considération sort du sujet de ce chapitre ; j’en parle ailleurs.
On voit que le nom de livre tournois a successivement été appliqué à des quantités fort diverses d’argent fin. Tantôt ce changement s’est opéré en diminuant la grandeur et le poids des pièces d’argent de même dénomination, tantôt en altérant leur titre, c’est-à-dire en y mettant plus d’alliage et moins d’argent fin ; tantôt en augmentant la dénomination d’une même pièce, et nommant par exemple 3 livres, une pièce qui n’était auparavant que de 2 livres. Comme il n’est ici question que de l’argent fin, puisque c’est la seule marchandise ayant quelque valeur dans la monnaie d’argent, de toutes ces manières l’altération a eu le même effet, puisqu’elle a diminué la quantité d’argent qu’on a appelée du nom de livre tournois. C’est ce que nos écrivains, d’après les ordonnances, appellent fort ridiculement augmentation des monnaies, parce qu’une telle opération augmente la valeur nominale des espèces, et qu’il serait plus raisonnable d’appeler diminution des monnaies, puisqu’elle diminue la quantité du métal qui seul fait la monnaie.
Bien que cette quantité ait été en diminuant depuis Charlemagne jusqu’à nos jours, plusieurs rois l’ont cependant augmentée à diverses époques, notamment depuis Saint Louis. Les raisons qu’ils avaient de la diminuer sont bien évidentes : il est plus commode de payer ce qu’on doit avec une moindre quantité d’argent. Mais les rois ne sont pas seulement débiteurs, ils sont dans beaucoup de cas créanciers ; ils sont relativement aux contribuables dans le cas du propriétaire relativement au fermier. Or quand tout le monde était autorisé à s’acquitter avec une moindre quantité d’argent, le contribuable payait ses contributions, de même que le fermier son fermage, avec une moindre quantité de ce métal.
Tandis que le roi recevait moins d’argent, il en dépensait autant qu’auparavant, car les marchandises haussaient nominalement de prix en proportion de la diminution de la quantité d’argent contenue dans la livre. Quand on appelait 4 livres la quantité d’argent nommée auparavant 3 livres, le gouvernement payait 4 livres ce qu’il aurait eu pour 3 auparavant. Il se voyait forcé d’augmenter les impôts ou d’en établir de nouveaux, c’est-à-dire que pour lever la même quantité d’argent fin on demandait aux contribuables un plus grand nombre de livres. Mais ce moyen, toujours odieux, même lorsqu’il ne fait réellement pas payer davantage, était quelquefois impraticable. Alors on revenait à ce qu’on appelait la forte monnaie. La livre contenant un plus grand poids d’argent, les peuples en payant le même nombre de livres, donnaient en effet plus d’argent [113] .
Le vertueux Alexandre-Sévère, animé par des motifs opposés, les réduisit de beaucoup.
Aussi voyon-nous que les augmentations de métal fin contenu dans les monnaies datent à peu près de la même époque que l’établissement des impôts permanents. Auparavant les rois n’avaient pas d’intérêt à accroître la valeur intrinsèque des pièces qu’ils frappaient.
On se tromperait si l’on supposait que, dans l’exécution, ces nombreuses variations dans la quantité de métal fin contenue dans les monnaies fussent aussi simples, aussi claires que je les présente ici pour la commodité du lecteur. Quelquefois l’altération n’était pas avouée, et on la cachait le plus longtemps qu’on pouvait ; de là le jargon barbare adopté dans ce genre de manufacture [114] . D’autres fois on altérait une espèce de monnaie et l’on ne changeait rien aux autres ; à la même époque, la livre représentée par de certaines pièces de monnaie contenait plus d’argent fin que la livre représentée par d’autres pièces. Enfin, presque toujours, pour rendre la matière plus obscure, on obligeait les particuliers à compter tantôt par livres et par sous, tantôt par écus, et à payer en pièces qui n’étaient ni des livres, ni des sols, ni des écus, mais seulement des fractions ou des multiples de ces monnaies de compte. Il est impossible de voir, dans tous les princes qui ont eu recours à ces misérables ressources, autre chose que des faussaires armés de la puissance publique.
On comprend le tort qui devait en résulter pour la bonne foi, pour l’industrie, pour toutes les sources de la prospérité ; il a été tel qu’à plusieurs époques de notre histoire, les opérations monétaires ont mis complètement en fuite toute espèce de commerce. Philippe le Bel fit déserter nos foires par tous les marchands étrangers en les forçant à recevoir en paiement sa monnaie décriée et en leur défendant de contracter en une monnaie qui leur inspirait plus de confiance [115] . Philippe de Valois fit de même à l’égard des monnaies d’or. Pareil effet s’ensuivit. Un historien de son temps [116] dit que presque tous les marchands étrangers cessèrent de venir trafiquer dans le royaume ; que les Français même, ruinés par ces fréquents changements dans les monnaies et l’incertitude de leurs valeurs, se retirèrent en d’autres pays ; et que les autres sujets du roi, nobles et bourgeois, ne se trouvèrent pas moins appauvris que les marchands ; ce qui faisait, ajoute l’historien, que le roi n’était pas du tout aimé.
J’ai puisé mes exemples dans nos monnaies françaises ; les mêmes altérations ont eu lieu chez presque tous les peuples anciens et modernes.
Les gouvernements populaires n’ont pas agi mieux que les autres. Les Romains, dans les plus belles époques de leur liberté, firent banqueroute en changeant la valeur intrinsèque de leurs monnaies. Dans la première guerre punique, l’as, qui devait être de douze onces de cuivre, n’en pesa plus que deux ; et dans la seconde il ne fut plus que d’une [117] .
La Pennsylvanie, qui bien que ce fût avant la guerre d’Amérique, agissait en cela comme État indépendant, ordonna en 1722 qu’une livre sterling passerait pour 1 livre 5 sols sterling [118] . Et les ÉtatsUnis, la France même, après s’être déclarés républiques, ont depuis fait pis encore.
« Si l’on voulait, dit Steuart, entrer dans le détail de tous les artifices inventés pour brouiller les idées des nations relativement aux monnaies, dans le but de déguiser ou de faire paraître utiles, justes ou raisonnables, les altérations qu’en ont faites presque tous les princes, on en composerait un gros livre. [119] ».
Steuart aurait pu ajouter que ce gros livre n’éclaircirait rien, et n’empêcherait pas qu’un artifice nouveau ne pût être pratiqué dès le lendemain. Ce qu’il faut éclaircir, c’est la fange au sein de laquelle germent ces abus ; car si l’on parvient à la transformer en une eau limpide, chaque abus, dès sa naissance, pourra être découvert et déconcerté.
Et qu’on ne s’imagine pas que les gouvernements perdent un avantage précieux en perdant le pouvoir de tromper. La tromperie ne leur sert que pendant un temps bien court, et finit par leur causer plus de tort qu’elle ne leur a fait de profit. Nul sentiment dans l’homme ne tient son intelligence éveillée autant que l’intérêt personnel ; il donne de l’esprit aux plus simples. De tous les actes de l’administration, ceux, en conséquence, dont on est le moins la dupe, sont ceux qui touchent à l’intérêt personnel. S’ils tendent à procurer, par la finesse, des ressources à l’autorité, les particuliers ne s’y laissent pas prendre ; s’ils font un tort dont les particuliers ne puissent se garantir, comme lorsqu’ils renferment un manquement de foi, quelqu’artistement déguisé qu’on le suppose, on s’en aperçoit bientôt ; dans l’opinion qu’on se forme d’un tel gouvernement, l’idée de l’astuce se joint à celle de l’infidélité, et il perd la confiance avec laquelle on fait de bien plus grandes choses qu’avec un peu d’argent acquis par la fraude. Souvent même ce sont les seuls agents du gouvernement qui ont fait leur profit particulier de l’injustice qu’on a commise envers les peuples. Le gouvernement perd la confiance et ce sont eux qui font le profit ; ils recueillent le fruit de la honte qu’ils ont fait rejaillir sur l’autorité publique.
Ce qui convient le mieux aux gouvernements c’est de se procurer, non des ressources factices, honteuses, funestes, mais des ressources réellement fécondes et inépuisables. C’est donc les bien servir que de les écarter des unes et de leur indiquer les autres.
L’effet immédiat de l’altération des monnaies est une réduction proportionnée des dettes et des obligations payables en monnaie, des rentes perpétuelles ou remboursables, payables par l’État ou par les particuliers, des loyers et fermages, de toutes les valeurs enfin qui sont exprimées en monnaie et qu’on est appelé à recevoir. C’est une autorisation donnée à tout débiteur dont la dette est exprimée en une certaine quantité de monnaie, de faire banqueroute du montant de la diminution de métal fin employé sous une même dénomination.
Ainsi, un gouvernement qui a recours à cette opération ne se contente pas de faire un gain illicite, il excite tous les débiteurs de sa domination à faire le même gain.
Cependant nos rois, en diminuant ou en augmentant la quantité de métal fin contenu sous une même dénomination, n’ont pas toujours voulu que les particuliers, dans les relations qu’ils avaient entre eux, se prévalussent de cette circonstance pour leur profit particulier. Le gouvernement a bien toujours entendu payer moins ou recevoir plus d’argent fin qu’il ne devait en payer ou en recevoir ; mais il a quelquefois obligé les particuliers au moment d’un changement à payer et à recevoir en monnaie ancienne, ou en monnaie nouvelle au cours qui s’établissait entre les deux monnaies [120] .
Les Romains en avaient donné l’exemple lorsque dans la seconde guerre punique ils réduisirent à une once de cuivre l’as qui en pesait deux. La république paya en as, c’est-à-dire la moitié de ce qu’elle devait. Quant aux particuliers, leurs obligations étaient stipulées en deniers : le denier jusque-là n’avait valu que 10 as ; l’ordonnance porta qu’il en vaudrait 16. Il fallut payer 16 as, ou 16 onces de cuivre, pour un denier : auparavant on en aurait payé 20, c’est-à-dire, pour chaque denier, 10 as à 2 onces chaque.
La république fit banqueroute de moitié et autorisa les particuliers à ne la faire que d’un cinquième.
On a quelquefois regardé une banqueroute faite par l’altération des monnaies comme une banqueroute simple et franche, portant réduction de la dette. On a cru qu’il était moins dur pour un créancier de l’État de recevoir une monnaie altérée, qu’il peut donner pour la même valeur qu’il l’a reçue, que de voir sa créance réduite d’un quart, de moitié, etc. Distinguons.
Des deux manières le créancier supporte la perte quant aux achats qu’il fait postérieurement à la banqueroute. Que ses rentes aient diminué de moitié, ou qu’il paie tout le double plus cher, cela revient exactement au même pour lui.
Quant aux créanciers qu’il a, il les paie à la vérité sur le même pied qu’il est payé lui-même par le Trésor public. Mais sur quel fondement croit-on que les créanciers de l’État soient toujours débiteurs relativement aux autres citoyens ? Leurs relations privées sont les mêmes que celles de tous les autres citoyens ; et tout porte à croire qu’en somme totale, il est dû autant aux créanciers de l’État par les autres particuliers, qu’il est dû à ceux-ci par les créanciers de l’État. Ainsi l’injustice qu’on les autorise à exercer est compensée par celle à laquelle on les expose, et la banqueroute provenant de l’altération des monnaies ne leur est pas moins fâcheuse que toute autre.
Mais elle a de plus de très graves inconvénients, des inconvénients funestes à la prospérité et au bienêtre des nations.
Elle occasionne un bouleversement dans les prix des denrées, qui a lieu de mille manières suivant chaque circonstance particulière ; ce qui dérange les spéculations les plus utiles et les mieux combinées. Elle détruit toute confiance pour prêter et emprunter. On ne prête pas volontiers là où l’on est exposé à recevoir moins qu’on n’a prêté, et l’on emprunte à regret là où l’on est exposé à rendre plus qu’on n’a reçu. Les capitaux en conséquence ne peuvent pas chercher les emplois productifs. Les maximum et les taxes de denrées qui marchent souvent à la suite des dégradations des monnaies, portent à leur tour un coup funeste à la production.
La morale d’un peuple ne souffre pas moins des variations monétaires. Elles confondent toujours pendant un certain temps ses idées relativement aux valeurs, et dans tous les marchés donnent l’avantage au fripon adroit sur l’honnête homme simple. Enfin elles autorisent, par l’exemple et par le fait, le vol et la spoliation, mettent aux prises l’intérêt personnel avec la probité, et l’autorité des lois avec les mouvements de la conscience.
[I-466]
CHAPITRE VI.
Que la monnaie n’est ni un signe, ni une mesure.↩
La monnaie serait seulement un signe si elle n’avait point de valeur par elle-même ; bien loin de là, sa valeur intrinsèque, quand on fait une vente ou un achat, est tout ce qu’on considère en elle. En vendant une marchandise contre une pièce de cinq francs, on ne la troque pas contre la figure ou le nom de cette pièce ; mais contre la quantité d’argent qu’on sait y être contenue.
Cela est si vrai, que si le gouvernement frappait des écus en étain, ils ne vaudraient pas autant que des écus d’argent. Leur dénomination fût-elle la même, le nombre qu’on en demanderait pour une même denrée serait fort différent. S’ils n’étaient qu’un signe les uns vaudraient les autres.
Si la force, l’adresse ou bien des circonstances politiques extraordinaires ont quelquefois soutenu la valeur courante des monnaies lorsque leur valeur intrinsèque a décliné, ce n’a jamais été que pendant un temps fort court. L’intérêt personnel parvient bien vite à découvrir si la marchandise qu’il reçoit vaut moins que celle qu’il donne ; et il trouve toujours le moyen de se soustraire aux désavantages d’un échange inégal.
Ce qui est un signe c’est un billet de banque payable à la première réquisition ; il est le signe de l’argent qu’on peut recevoir au moment qu’on veut, sur la présentation de cet effet. S’il n’est pas payable à la première réquisition, il n’est le signe de rien. Mais quant à la monnaie d’argent qu’on reçoit à la caisse, elle n’est pas le signe : elle est la chose signifiée.
La monnaie d’argent est si peu un signe que les pièces de monnaie perdent de leur valeur en s’usant par le frottement, ou par la friponnerie des rogneurs d’espèces ; toutes les marchandises augmentent nominativement de prix en proportion de l’altération éprouvée par elles ; et si le gouvernement fait une refonte équitable et rétablit dans chaque pièce la quantité de métal fin qui s’y trouvait dans l’origine, les marchandises reprennent le prix qu’elles avaient alors, sauf les variations qui ont pu avoir lieu dans la valeur de ces marchandises par des circonstances qui leur sont particulières.
C’est ce qui arriva sous le règne de Charles II en Angleterre, où ce genre de dégradation fut poussé fort loin. Les prix de toutes les denrées s’élevèrent ; et cette augmentation nominale n’était pas due à une diminution dans la valeur du métal, puisque la valeur de l’argent relativement aux denrées ne baissa pas dans le reste de l’Europe [121] . Après la refonte générale qu’il y eut ensuite sous le règne de Guillaume, les prix se rétablirent.
Quand on vend sa marchandise on ne l’échange donc pas contre un signe, mais contre une autre marchandise appelée monnaie, à laquelle on suppose une valeur égale à celle qu’on vend.
Quand on achète, on ne donne pas seulement un signe : on donne une marchandise ayant une valeur réelle égale à celle qu’on reçoit.
Cette première erreur a été le fondement d’une autre erreur souvent reproduite depuis Hume jusqu’à ces derniers temps. De ce que la monnaie était le signe de toutes les valeurs, on a conclu hardiment que la valeur de la monnaie était en chaque pays égale à la valeur de toutes les denrées, et par extension on a dit que « la masse totale de la richesse du monde commerçant avait une valeur égale à celle de la somme totale du papier de crédit et de l’argent qui circule. [122] ». Opinion qui reçoit une apparence de vraisemblance de ce que le prix de toutes les marchandises augmente quand la quantité d’argent augmente, et diminue lorsque la quantité d’argent diminue.
Mais qui ne voit que cette variation a lieu de même pour toutes les autres marchandises. Quand la récolte du vin a été double dans une certaine année, son prix tombe à moitié de ce qu’il était l’année précédente ; par une raison semblable on peut supposer que si la masse des espèces qui circulent venait à doubler, le prix de toutes choses doublerait, c’est-à-dire que pour avoir la même chose il faudrait donner le double d’argent. Mais cet effet n’indique pas plus que la valeur totale de l’argent est toujours égale à la valeur totale des autres richesses, qu’il n’indique que la valeur totale du vin est égale à toutes les autres valeurs. La variation survenue dans la valeur de l’argent et du vin, dans les deux suppositions, est une conséquence du rapport de ces denrées avec elles-mêmes, et non de leurs rapports avec la quantité des autres denrées.
Nous avons déjà vu que la valeur totale de la monnaie d’un pays, même en y ajoutant la valeur de tous les métaux précieux qu’il renferme, est peu de chose comparée avec la masse entière de ses valeurs ; si cela est vrai de chaque pays en particulier, cela l’est de la totalité des pays, ou du monde commerçant [123] .
La monnaie n’est pas plus une mesure qu’elle n’est un signe.
De quoi a-t-on prétendu qu’elle était une mesure ? De la valeur des choses ; c’est-à-dire qu’elle indiquait le rapport qui se trouve entre la valeur de deux choses, de même que des toises, des aunes, des mètres indiquent le rapport qui se trouve entre leur longueur. Or c’est ce qu’elle n’indique pas.
Commençons par mettre entièrement de côté les dénominations des monnaies qui se sont successivement appliquées à des pièces fort diverses, de poids, de matière, et de forme. Si les noms des monnaies n’ont pas même donné la mesure des pièces auxquelles ils se sont appliqués, comment auraient-ils donné la mesure des valeurs qui ont été achetées avec ces pièces ? On nous dit qu’une vache coûtait 36 sols du temps de Philippe-le-Bel [124] , mais quelle idée ces 36 sols peuvent-ils nous donner de la valeur d’une vache, quand ils ne nous donnent aucune idée, même de la monnaie qu’ils expriment ?
Il reste à savoir si le métal précieux contenu dans la monnaie, en supposant que le nom de la monnaie l’indique exactement, peut être la mesure de la valeur de deux choses diverses.
En premier lieu ce n’est pas la quantité d’argent qui peut être la mesure d’une valeur, c’est sa valeur. Il y a de l’analogie, de la ressemblance entre la valeur d’une chose et celle d’une autre ; mais il n’y en a aucune entre le poids ou la longueur d’une chose et la valeur d’une autre. Quand on dit ce livre vaut dix francs, ou cinquante grammes d’argent, on entend qu’il vaut autant que cinquante grammes, et non que sa valeur est égale à un poids de quelque matière que ce soit. C’est donc la valeur de la monnaie et non son poids qu’il faut considérer ici. Mais le métal contenu dans la monnaie n’est qu’une marchandise, plus ou moins abondante suivant les temps et les lieux, plus ou moins recherchée suivant les usages auxquels on l’emploie, suivant le nombre et la richesse de ses consommateurs ; circonstances qui font varier sa valeur.
L’autorité la plus arbitraire ne pourrait pas plus fixer cette valeur qu’elle ne peut fixer l’opinion des hommes. Elle ordonnera que Charles, possesseur d’un sac de blé, le donne à Martial pour un louis d’or ; mais elle peut ordonner de même que Charles le donne pour rien. Par cette ordonnance elle aura peut-être volé Charles au profit de Martial, mais elle n’aura pas plus établi qu’un louis d’or soit la mesure de la valeur d’un sac de blé, qu’elle n’aurait établi qu’un sac de blé n’a point de valeur parce qu’elle aurait forcé à le donner pour rien.
On a vu que la valeur de l’argent était en Chine presque double de ce qu’elle est en Europe comparée à la main-d’œuvre, à la nourriture, à toutes les autres denrées ; mais ce n’est pas seulement à de grandes distances qu’elle varie : elle diffère, quoique moins sensiblement, de la ville à la campagne, d’un village à un autre.
Relativement au temps, il est facile de se convaincre que la valeur d’une même quantité d’argent a été évaluée très différemment suivant les différentes époques. Si la valeur de l’argent avait varié relativement à la valeur d’une autre denrée, on pourrait croire que c’est la valeur de cette autre denrée qui a varié, et que celle de l’argent est restée fixe. Mais on trouve que la valeur de l’argent a varié relativement à un très grand nombre de denrées dont les valeurs sont restées à peu près les mêmes comparées entre elles.
Afin de ne pas compliquer les exemples, choisissons parmi ces denrées une de celles qui, bien qu’essuyant d’une année à l’autre des variations de valeur assez fréquentes relativement aux autres denrées, est néanmoins une de celles qui garde avec la plupart d’entre elles les rapports les plus constants à des époques éloignées : je veux dire le blé. C’est ainsi que, sauf les années de mauvaises récoltes et les circonstances extraordinaires, un septier de blé a toujours valu par exemple un peu plus qu’un beau mouton.
Il suffira de comparer la valeur moyenne du blé comme l’une des moins variables, à la valeur de l’argent pur, pour nous convaincre des grandes variations de valeur que ce métal a subies.
Dupré de Saint-Maur, qui a donné un livre plein de savantes recherches sur la valeur des choses, croit que depuis Philippe Auguste, qui est mort en 1223, jusque vers l’année 1520, le septier de blé (mesure de Paris) valait communément autant que la neuvième partie d’un marc d’argent fin [125] . Ce qui fait 512 grains pesant d’argent fin.
Vers l’année 1536 le marc d’argent valant 13 livres tournois, ou plutôt portant la dénomination de 13 livres tournois, le prix commun du septier de blé était d’environ 3 livres tournois. C’était 1/13e du marc d’argent, ou une valeur égale à celle de 1063 grains pesant d’argent fin.
En 1602, sous Henri IV, le marc d’argent fin étant à 22 liv., le prix commun du septier de blé était à 9 liv. 16 s. 9 den. ou valait autant que 2 060 grains d’argent fin [126] .
Depuis ce temps le septier de blé, année moyenne, a toujours valu à peu près la même quantité d’argent fin.
En 1789 le marc d’argent étant à 54 liv. 19 s. et le prix commun du blé, suivant l’estimation de Lavoisier, étant de 24 livres, le septier valait 2 012 grains d’argent fin.
J’ai négligé les fractions de grains, car il ne peut être question en tout ceci que d’approximation : le prix du septier de blé, qui est évalué ici, pour les environs de Paris, n’étant lui-même qu’une approximation assez vague.
Il résulte de ces rapprochements que le septier de blé, dont la valeur comparée aux autres denrées a peu varié depuis 1520 jusqu’à nos jours, a été échangé, savoir :
En 1520 contre 512 grains d’arg. pur ;
En 1536 contre 1 063 ;
En 1602 contre 2 060 ;
En 1789 contre 2 012 ;
ce qui indique que la valeur de l’argent pur a subi une variation considérable depuis la première de ces époques, puisqu’il faut maintenant dans les échanges en donner à peu près 4 fois ce qu’on en donnait il y a trois siècles, pour la même quantité de marchandise.
Nous verrons ailleurs pourquoi la découverte des mines d’Amérique, qui a répandu dans le monde environ dix fois plus d’argent qu’il n’y en avait auparavant, n’a pourtant fait baisser sa valeur que dans la proportion de 4 à 1.
Il ne faut pas s’imaginer que la valeur de l’argent ne puisse varier qu’en vertu de circonstances grandes et singulières comme la découverte des mines d’Amérique. Cette marchandise subit toutes les variations qui affectent les autres marchandises. Smith pense et fonde sur de bonnes données, que lorsque le Pérou, le Mexique et le Brésil ont inondé notre hémisphère de leurs brillants poisons (pour me servir d’une expression de Voltaire), il pense, dis-je, que la valeur des métaux précieux augmentait rapidement ; que leur abondance a fait tomber cette valeur jusque vers le commencement du XVIIe siècle ; et que depuis cette dernière époque la valeur commune de l’argent a recommencé à hausser et continuera probablement à hausser encore, si d’autres circonstances extraordinaires ne viennent de nouveau jeter le désordre dans cette valeur. Il est clair qu’indépen 1051.damment de ces grandes variations qui s’évaluent en prenant une année commune sur plusieurs, il y a dans la valeur de cette marchandise, comme dans celle de toute espèce de marchandise, des variations qui ont lieu d’un marché à l’autre et du jour au lendemain.
Si la valeur du métal précieux contenue dans la monnaie varie à ce point, même quand sa quantité demeure invariable, elle ne peut donc pas mieux servir de mesure des valeurs que la dénomination dont il plaît au prince de décorer une certaine portion de métal. Si une toise s’allongeait ou s’accourcissait à toutes les heures et en changeant de place, pourrait-on raisonnablement l’appeler une mesure ? Le métal précieux, qu’il soit monnayé ou non, n’est donc qu’une marchandise dont la valeur est arbitraire et se règle à chaque marché qu’on fait, par un accord entre le vendeur et l’acheteur ; il ne peut par conséquent remplir l’office d’une mesure dont le premier caractère est d’être invariable. Ainsi lorsque Montesquieu a dit, en parlant des monnaies : « Rien ne doit être si exempt de variations que ce qui est la mesure commune de tout [127] », il a renfermé trois erreurs en deux lignes. D’abord on ne peut prétendre que la monnaie soit la mesure de tout, mais bien de toutes les valeurs ; en second lieu elle n’est pas même la mesure des valeurs ; et enfin il est impossible de rendre sa valeur invariable. Si Montesquieu voulait engager les gouvernements à ne pas altérer les monnaies, il devait se contenter de les persuader par de bonnes raisons, et non par des traits brillants qui accréditent de fausses idées.
Cette variabilité perpétuelle dans les valeurs, d’où il suit que la valeur d’aucune marchandise ne saurait être une mesure de la valeur des autres, n’empêche pas, lorsqu’on n’a besoin que d’une évaluation vague et approximative, qu’on ne se serve de la valeur d’une denrée pour donner une idée de la valeur d’une autre. Rien n’empêche qu’on n’évalue une maison, une terre, une rente, un traitement, en blé, ou en argent, et qu’on ne dise : Ceci vaut tant de myriagrammes de froment ou tant d’onces d’argent.
Sous ce point de vue l’argent est une marchandise servant à évaluer tout aussi bonne et meilleure qu’une autre, parce que ses variations, quoiqu’elles aient été considérables, n’ont jamais été excessivement brusques. Mais il y a là-dessus deux observations à faire ; c’est d’abord que ce n’est point la dénomination de la monnaie qui sert d’évaluation : c’est la marchandise faisant office de monnaie ; le nom ne sert qu’à faire connaître la quantité de métal qu’on veut désigner. Et en second lieu c’est que cette propriété de donner l’idée approximative d’une valeur, ou d’évaluer une denrée, n’est point particulière à la monnaie ; que la monnaie partage cette propriété avec toutes les autres marchandises, et que si l’on préfère de dire : Cette maison vaut 50 mille francs en écus, plutôt que de dire : cette maison vaut 25 mille myriagrammes de froment, c’est d’une part parce que l’habitude fait qu’on se forme plus vite une idée de la valeur de 50 mille francs d’écus, que d’une valeur égale à 25 mille myriagrammes de froment ; et d’un autre côté que la valeur de 50 mille francs d’écus, quoique variable, est réellement un peu moins variable dans des temps courts, ou à de petites distances de lieux, que celle de 25 mille myriagrammes de froment.
Pour apprécier les différentes valeurs des choses, je les compare, dans le cours de cet ouvrage, au prix auquel elles peuvent se vendre ; c’est que je n’ai nul besoin dans mes exemples d’une exactitude rigoureuse. Le géomètre lui-même ne trace des lignes que pour rendre sensibles ses démonstrations ; et il n’a besoin d’exactitude rigoureuse que dans ses raisonnements et dans ses conséquences. Toute autre marchandise pourrait de même me servir pour évaluer par approximation les valeurs, et si je me sers de la monnaie, c’est qu’on est plus accoutumé à comparer la valeur des autres marchandises à la valeur de celle-là qu’à toute autre.
Adam Smith croit que la valeur du travail, si l’on pouvait connaître ce qu’elle a été en différents temps et en différents lieux, serait une mesure excellente des diverses valeurs des choses. On verra, quand je traiterai des valeurs, par quelles raisons je ne pense pas que cette mesure soit plus exacte que la valeur du blé et de quelques autres marchandises.
On dit que les Noirs de la côte d’Afrique ont un signe purement idéal pour fixer la valeur de leurs denrées lorsqu’ils veulent en faire l’échange. Ils disent : Telle marchandise vaut 3 macutes ; telle autre vaut 5 macutes ; telle autre en vaut 10 [128] . Et cependant des macutes ne peuvent ni se voir, ni se toucher ; c’est un terme entièrement abstrait et qui ne désigne aucun objet sensible. est-ce une monnaie ? est-ce un signe ? est-ce une mesure ? Ce n’est ni une monnaie, ni un signe, ni une mesure ; car on n’échange pas sa marchandise contre 2, 3, 4 macutes, mais contre une autre marchandise valant le même nombre de macutes. C’est, dans un pays qui n’a point de monnaie, une évaluation assez grossière de deux marchandises, dont aucune ne fait les fonctions de monnaie, et qui se mesurent l’une l’autre, autant que deux marchandises qui n’ont quelquefois aucune analogie entre elles, comme des esclaves et des fusils, peuvent se mesurer.
Si je me suis arrêté à combattre des expressions inexactes, c’est qu’elles m’ont semblé trop répandues ; qu’elles suffisent quelquefois pour établir des idées fausses ; que des idées fausses deviennent souvent la base d’un faux système, et que d’un faux système enfin, naissent les mauvaises opérations.
[I-483]
CHAPITRE VII.
D’une attention qu’il faut avoir en évaluant les sommes dont il est fait mention dans l’histoire.↩
Les historiens les plus éclairés, lorsqu’ils évaluent en monnaie de notre temps les sommes dont il est fait mention dans l’histoire, se contentent de réduire en monnaie courante la quantité d’or ou d’argent indiquée par la somme ancienne.
Cela ne suffit pas. Nous savons bien par ce moyen ce que cette quantité d’or ou d’argent ancien vaudrait de notre temps, mais nous n’avons aucune idée de sa valeur au temps ancien. Il faut donc encore avoir égard à la variation survenue dans la valeur du métal lui-même.
Des exemples feront mieux sentir la chose.
Voltaire, dans son Essai sur l’histoire universelle [129] , dit que Charles V déclara que les fils de France auraient un apanage de 12 mille livres de rente ; que ces 12 mille livres n’en valent aujourd’hui qu’environ 100 mille ; et dans cette supposition, il remarque avec assez de raison que ce n’est pas une fort grande ressource pour les fils d’un roi.
Or voici le calcul sur lequel Voltaire a fondé son évaluation : il compte que le marc d’argent fin valait environ 6 livres du temps de Charles V ; 12 mille livres, sur ce pied, font 2 000 marcs d’argent, lesquels, au taux du moment où Voltaire écrivait, donnent en effet une somme de 100 mille livres environ. Mais deux mille marcs d’argent fin au temps de Charles V valent bien plus que deux mille marcs du temps de Louis XV.
Nous avons vu dans le précédent chapitre que depuis PhilippeAuguste, c’est-à-dire depuis l’année 1200 environ jusque vers l’année 1520 (ce qui comprend le règne de Charles V), le septier de blé, mesure de Paris, valait communément autant que la neuvième partie du marc d’argent.
Au moment où Voltaire écrivait, le marc d’argent pur valant environ 54 livres, et le prix commun du blé pouvant être de 24 livres le septier, le blé valait, à peu de chose près, autant que les quatre neuvièmes d’un marc d’argent. Il fallait donc, du temps de Voltaire, donner quatre fois plus d’argent pour la même quantité de blé et probablement pour la plupart des autres denrées. La même quantité d’argent valait donc quatre fois moins du temps de Voltaire, ou ce qui revient au même, quatre fois plus du temps de Charles V. Dès lors les 2 000 marcs d’argent qui formaient l’apanage des fils de France valaient autant que 8 000 de nos marcs, c’est-à-dire plus de 400 mille francs de nos jours.
Dès lors la réflexion de Voltaire sur la modicité de cet apanage devient moins applicable.
Raynal, qui a pourtant écrit sur des matières commerciales, commet la même erreur lorsqu’il évalue le revenu public sous le règne de Louis XII à 36 de nos millions, se fondant sur ce qu’il allait à 7 650 000 liv. à 17 livres le marc d’argent. On trouve à la vérité que cette somme contenait 695 454 marcs d’argent ; mais il ne fallait pas se borner à réduire ces marcs d’argent en livres au taux du jour. Ils valaient autant que quatre fois la même quantité d’argent aujourd’hui. Il fallait donc, avant de les réduire en livres actuelles, les multiplier par quatre, ou, ce qui revient au même, faire la multiplication après avoir fait la réduction ; d’après ce calcul, on aura une somme de 144 millions de nos livres pour le revenu public sous Louis XII.
Combien ne faut-il pas, à plus forte raison, se défier des évaluations faites par des historiens moins éclairés que Voltaire et Raynal ! Dans l’histoire ancienne de Rollin, dans l’histoire ecclésiastique de Fleury, on estime les talents, les mines, les sesterces, suivant l’évaluation qui en a été faite par quelques savants sous le ministère de Colbert. Or ces évaluations donnent, d’une manière déjà fort problématique, la quantité de métaux précieux contenue dans les sommes anciennes : première source d’erreurs ; la valeur de ces métaux précieux a varié considérablement depuis les temps anciens jusqu’à Colbert : seconde source d’erreurs ; la réduction qui en a été faite sous ce ministère était calculée sur le pied de 26 livres 10 sols par chaque marc d’argent, taux suivant lequel l’argent fin était alors reçu à la Monnaie ; or ce taux-là avait déjà subi une grande variation au temps où Rollin écrivait : troisième source d’erreurs ; enfin le même taux s’est fort élevé depuis Rollin, de manière qu’une livre nous présente maintenant l’idée de moins d’argent qu’elle n’en rappelait de son temps : quatrième source d’erreurs. De façon que quiconque lit à présent Rollin, et s’en rapporte aux évaluations qu’on y trouve, se forme les idées les plus fausses des revenus des anciens États, de leur commerce, de la paie de leurs soldats et de toute leur économie.
Je ne prétends pas qu’aucun historien puisse avoir des données assez sûres pour offrir à ses lecteurs une évaluation toujours juste de toutes ces choses ; mais je crois que pour s’écarter beaucoup moins de la vérité qu’on ne l’a fait jusqu’à présent dans la réduction des sommes des anciens, et même de celles du Moyen-âge, en sommes de notre monnaie actuelle, il faut, ainsi que cela se pratique, chercher d’abord à connaître, d’après les antiquaires, la quantité de métal d’argent ou d’or qu’elles exprimaient. Il faut ensuite, jusqu’au temps de Charles-Quint, c’est-à-dire jusque vers l’année 1520, multiplier cette quantité par 4, si c’est une quantité d’argent, et par 3, si c’est une quantité d’or, parce que la découverte des mines d’Amérique a fait baisser la valeur de l’argent dans la proportion de quatre à un environ, et celle de l’or dans la proportion de trois à un environ [130] . Il faut enfin réduire cette quantité d’or ou d’argent en monnaie courante au cours de l’époque où l’on se trouve.
Depuis l’année 1520, la valeur de l’argent a toujours décliné jusqu’à la fin du règne d’Henri IV, c’est-à-dire jusque vers les premières années du XVIIe siècle. Cette diminution de valeur peut être appréciée par l’augmentation du prix d’une même denrée, ainsi que je l’ai montré au chapitre précédent. Pour avoir une idée juste de la valeur du marc d’argent pendant cette époque, il faut l’augmenter d’autant moins que le prix des denrées, du blé si l’on veut, va en s’élevant, non pas nominativement, mais en métal.
Depuis le commencement du XVIIe siècle, comme il ne paraît pas que la valeur de l’argent ait sensiblement décliné (puisque pour le même poids d’argent fin on a pu acheter la même quantité de la plupart des denrées), après avoir réduit les sommes de cette époque en marcs d’argent, il ne faut leur faire subir aucune augmentation, et se contenter de les évaluer en monnaie courante actuelle, suivant le cours du jour pour le marc d’argent fin.
Ainsi, par exemple, on voit dans les Mémoires de Sully que ce ministre avait amassé dans les caves de la Bastille 36 millions de livres tournois pour servir aux grands desseins d’Henri IV contre la maison d’Autriche. Pour connaître la valeur actuelle de cette somme, il faut d’abord savoir ce qu’elle contenait d’argent fin. Vingt-deux livres tournois étaient alors l’expression en livres du marc d’argent ; 36 millions de livres faisaient donc 1 636 363 marcs 5 onces d’argent. Ce métal n’a pas sensiblement varié dans sa valeur depuis l’époque dont il est question : on achetait avec cette quantité de métal la même quantité de blé qu’on aurait aujourd’hui. Or, aujourd’hui, 1 636 363 marcs 5 onces, ou ce qui revient au même 399 588 018. 5. grammes d’argent fin frappés en monnaie, font 88 millions 797 mille 315 francs.
On n’accomplirait pas de nos jours de bien grands desseins avec cette somme ; mais il faut considérer que la guerre se fait bien différemment et qu’elle est beaucoup plus dispendieuse, non seulement de nom, mais de fait.
[I-491]
CHAPITRE VIII.
Qu’il n’y a point de rapport fixe entre la valeur d’un métal et la valeur d’un autre métal.↩
La même erreur qui a fait croire qu’on pouvait fixer la valeur d’un métal, a conduit à vouloir fixer la valeur relative des différents métaux qui ont en même temps servi de monnaie. On a dit : Une certaine quantité d’argent vaudra 24 livres et une certaine quantité d’or vaudra aussi 24 livres. De là une proportion fixe établie entre la valeur nominale de l’or et celle de l’argent.
Comme cette prétention est aussi vaine que l’autre, qu’est-il arrivé ? La valeur des deux métaux, toujours variable comparativement à toutes les denrées, a été de même variable dans les échanges faits de ces deux métaux entre eux. Avant la refonte des espèces d’or ordonnée par arrêt du 30 octobre 1785, les louis d’or se vendaient contre de l’argent 24 livres et quelques sols. On se gardait bien en conséquence de payer en monnaies d’or les obligations stipulées en livres : on aurait réellement payé 24 livres et 8 ou 10 sols pour chaque fois 24 livres contenue dans la somme stipulée.
Depuis la refonte de 1785 où l’on diminua d’un seizième la quantité d’or contenue dans le louis, il a valu à peu près autant que la quantité d’argent nommée 24 livres ; aussi a-t-on payé depuis cette époque plus indifféremment en or ou en argent. Les paiements en argent sont néanmoins restés plus communs, soit à cause des habitudes de la nation, soit parce que la monnaie d’or étant plus exposée aux entreprises des faussaires et des rogneurs que l’autre, celui qui reçoit dispute plus volontiers sur son poids et sa qualité.
En Angleterre une fixation différente a produit des effets contraires. En 1728 le cours naturel des échanges avait porté le prix en argent de la guinée à 21 shillings. C’était la proportion de 15,2 à 1 ; pour 1 once d’or, on donnait 15,2 onces d’argent. On fixa par une loi cette proportion ; c’est-à-dire qu’on prétendit fixer une proportion variable de sa nature. L’argent éprouva successivement plus de demandes que l’or : le goût de la vaisselle et des ustensiles d’argent se répandit ; le commerce de l’Inde prit un plus grand essor et emporta de l’argent de préférence à l’or, parce qu’en Orient il vaut plus relativement à l’or qu’en Europe ; finalement la valeur relative de ces deux métaux est devenue en Angleterre comme 14,5 environ est à 1. On achète dans le commerce une once d’or avec 14,5 onces d’argent. On sent dès lors que si l’on payait en argent les obligations stipulées en livres sterling, il faudrait donner en argent 15,2 là où l’on peut ne donner réellement qu’une valeur égale à 14,5 en payant en or. Aussi fait-on en Angleterre les paiements en or.
Par la même raison quand l’Hôtel des monnaies bat de la monnaie d’argent, cette monnaie est aussitôt achetée avec des guinées et fondue. En effet, quand l’Hôtel des monnaies donne une livre sterling en monnaie d’argent, cette quantité d’argent pèse 3 onces 17 pennies 10 grains, poids de Troy [131] . Or 3 onces 17 pennies 10 grains d’argent en lingots au titre légal, valent dans le commerce environ 1 livre sterling et 8 pence [132] . Il convient donc de retirer avec de l’or toute la monnaie d’argent neuve qu’on trouve, et de la fondre. On gagne à cette manœuvre à peu près 8 pence par livre sterling [133].
Aussi quand l’administration a l’imprudence de frapper de la monnaie d’argent, elle est sur-le-champ enlevée. On ne voit, dans la circulation en Angleterre, de monnaie d’argent que des shillings et des demi-shillings frappés dès avant le règne de George Ier, et tellement usés par le frottement, qu’en les fondant on ne trouverait plus le même profit que s’ils étaient entiers. Le frottement a rétabli entre l’or et l’argent à peu près la proportion fixée par le commerce.
Quelle conséquence doit-on tirer de tout cela ? C’est qu’il n’est pas possible dans la pratique d’assigner une valeur fixe à des marchandises dont la valeur est dans la réalité variable ; et qu’on doit laisser une once d’or, une once d’argent, chercher leurs différentes valeurs dans les échanges où les hommes jugent à propos de les employer.
Ce qui vient d’être dit de l’or et de l’argent peut être dit de l’argent et du cuivre, et en général de la valeur relative de tous les autres métaux. Il n’est pas plus sage de dire que la quantité de cuivre contenue dans 20 sols vaut autant que l’argent contenu dans une livre tournois, qu’il ne l’est de dire que la quantité d’argent contenue dans 24 livres tournois vaut autant que l’or contenu dans un louis.
Cependant la proportion fixée par la loi entre le cuivre et les métaux précieux n’a pas eu de très grands inconvénients, en ce que la loi n’a pas autorisé à payer indifféremment en cuivre ou en métaux précieux les sommes stipulées en livres tournois et en francs ; de manière que la seule monnaie reconnue pour les sommes qui surpassent la valeur des pièces d’argent, c’est l’argent ou l’or.
[I-496]
CHAPITRE IX.
Ce que devraient être les monnaies.↩
Ce que j’ai dit jusqu’à présent des monnaies peut, j’espère, faire pressentir ce qu’il faudrait qu’elles fussent.
L’extrême convenance des métaux précieux pour servir de monnaie les a fait préférer presque partout pour cet usage. Nulle autre matière n’y est plus propre ; ainsi nul changement à cet égard n’est désirable.
On en peut dire autant de la division des métaux précieux en portions égales et maniables. Il convient donc de les frapper comme on a fait jusqu’à présent chez la plupart des peuples civilisés, en pièces d’un poids et d’un titre pareils.
Il est au mieux qu’elles portent une empreinte qui soit la garantie de ce poids et de ce titre, et que la faculté de donner cette garantie et par conséquent de fabriquer les pièces de monnaies soit exclusivement réservée au gouvernement, car une multitude de manufacturiers qui les fabriqueraient concurremment n’offriraient point une garantie égale.
C’est ici que devrait s’arrêter l’action de l’autorité publique sur les monnaies.
La valeur d’un morceau d’argent est arbitraire et se règle de gré à gré dans les transactions qui se font entre les particuliers ou entre le gouvernement et les particuliers : pourquoi établirait-on d’avance cette valeur qui ne peut être qu’imaginaire, et dont on ne tiendra nul compte en se servant de la monnaie ? Pourquoi donnerait-on un nom à cette valeur imaginaire et fixe qu’il est impossible d’attacher à la monnaie ? Qu’est-ce qu’une piastre, un ducat, un florin, une livre sterling, une livre tournois ? Peut-on voir autre chose en tout cela que des morceaux d’or ou d’argent ayant un certain poids et un certain titre ? Si l’on ne peut y voir autre chose, pourquoi donnerait-on à ces lingots un autre nom que le leur, que celui qui désigne leur nature et leur poids ?
Une once d’argent, diton, vaut 6 livres tournois. Cette phrase n’a aucun autre sens que celui-ci : Une once d’argent vaut une once d’argent. Car quelle idée ai-je de la valeur de 6 livres tournois, autre que celle que me donne une once d’argent ? Le blé, le chocolat, la cire, prennent-ils un nom différent lorsqu’ils sont divisés suivant leur poids ? Une livre pesante de pain, de chocolat, de bougie, s’appelle-t-elle autrement qu’une livre de pain, de chocolat, de bougie ? Pourquoi donc n’appellerait-on pas une pièce d’argent du poids d’une once, par son véritable nom : pourquoi ne l’appellerait-on pas simplement une once d’argent ?
Cette légère rectification, qui semble consister dans un mot, dans un rien, est immense dans ses conséquences. Dès qu’on l’admet, il n’est plus possible de contracter en valeur nominale ; il faut, dans chaque marché, balancer une marchandise réelle contre une autre marchandise réelle, une certaine quantité d’argent contre une certaine quantité de grains, de viande ou d’étoffe. Si l’on prend un engagement à terme, il n’est plus possible d’en déguiser la violation ; si l’on s’engage à me payer tant d’onces d’argent fin, et si mon débiteur est solvable, je suis assuré de la quantité d’argent fin que je recevrai quand le terme sera venu.
Dès lors s’écroule tout le système monétaire ; système tellement compliqué, qu’il n’est jamais compris entièrement même de la plupart de ceux qui en font leur occupation habituelle ; système d’où découlent perpétuellement la mauvaise foi, l’injustice et la spoliation. Dès lors il devient impossible de faire une fausse opération sur les monnaies sans battre de la fausse monnaie ; de composer avec ses engagements sans faire une banqueroute. La fabrication des monnaies se trouve être la chose la plus simple : une branche de l’orfèvrerie.
Les poids dont on s’est servi jusqu’à l’introduction du système métrique en France, c’est-à-dire les onces, gros, grains, avaient l’avantage de présenter des quantités pondérantes, fixes depuis plusieurs siècles, et applicables à toutes les marchandises ; de manière qu’on ne pouvait changer l’once pour les métaux précieux, sans la changer pour le sucre, le miel, et toutes les denrées qui se mesurent au poids ; mais combien, sous ce rapport, les poids du nouveau système métrique n’ont-ils pas plus d’avantages encore ? Ils sont fondés sur une quantité donnée par la nature et qui ne peut varier tant que notre globe subsistera. Le gramme est le poids d’un centimètre cubique d’eau ; le centimètre est la centième partie du mètre, et le mètre est la dix-millionième partie de l’arc que forme la circonférence de la terre du pôle à l’équateur. On peut changer le nom de gramme, mais il n’est pas au pouvoir des hommes de changer la quantité pesante de ce qu’on entend actuellement par gramme ; et quiconque s’engagerait à payer, à une époque future, une quantité d’argent égale à cent grammes d’argent, ne pourrait, quelqu’opération arbitraire qui intervînt, payer moins d’argent sans violer sa promesse d’une manière évidente.
La facilité que le gouvernement peut donner pour l’exécution des échanges et des contrats où la marchandise-monnaie est employée, consiste à diviser le métal en différentes pièces, d’un ou de plusieurs grammes, d’un ou de plusieurs centigrammes, de manière que, sans balance, on puisse compter quinze, vingt, trente grammes d’or ou d’argent, selon les paiements qu’on veut faire.
Des expériences faites par l’Académie des Sciences prouvent que l’or et l’argent pur résistent moins au frottement que lorsqu’ils contiennent un peu d’alliage ; les monnayeurs disent, de plus, que pour les épurer complètement, il faudrait des manipulations très dispendieuses, qui renchériraient beaucoup la fabrication des monnaies. Qu’on mêle donc à l’or et à l’argent une certaine quantité d’alliage ; mais que cette quantité soit annoncée par l’empreinte qui ne doit être autre chose qu’une étiquette certifiant le poids et la qualité du métal.
On voit qu’il n’est ici aucunement question de francs, de décimes, de centimes. C’est qu’en effet de tels noms ne devraient point exister, attendu qu’ils ne sont le nom de rien. Nos lois veulent qu’on frappe des pièces d’un franc qui pèseront 5 grammes d’argent : elles devraient ordonner simplement qu’on frappât des pièces de 5 grammes.
Alors au lieu de faire un billet ou une lettre de change de 400 francs, par exemple, on les ferait de 2 000 grammes d’argent au titre de 9/10e de fin ; ou si l’on aimait mieux de 130 grammes d’or au titre de 9/10e de fin ; et rien ne serait plus facile à acquitter, car les pièces de monnaie, soit en or, soit en argent, seraient toutes des multiples ou des fractions de grammes au titre de 9/10e de métal fin mêlé avec 1/10e d’alliage.
Il faudrait, à la vérité, qu’une loi statuât que toute convention stipulant un certain nombre de grammes d’argent ou d’or, ne pourrait être soldée qu’en pièces frappées (à moins de stipulation contraire), afin que le débiteur ne pût s’acquitter avec des lingots qui auraient un peu moins de valeur que des pièces frappées. On sent que cette précaution n’est qu’un détail d’exécution, et que suivant les principes, une obligation devrait porter, outre l’énonciation de la matière et du titre, qu’elle est payable soit en lingots, soit en pièces empreintes du poinçon national. Cette loi ou cette ordonnance n’aurait d’autre but que d’éviter sur chaque acte l’énonciation de plusieurs clauses, qui dès lors seraient sous-entendues.
Le gouvernement ne frapperait les lingots des particuliers qu’autant qu’on lui paierait les frais et même les bénéfices de la fabrication, suivant les principes contenus au chap. IV de ce livre. Quant aux lingots que le gouvernement achèterait et frapperait pour son compte, la monnaie qui en proviendrait rembourserait les frais et paierait le bénéfice par la quantité supérieure de valeur qu’elle achèterait dans les échanges, ainsi que j’ai tâché de le prouver dans le même chapitre.
Rien n’empêcherait qu’à l’empreinte énonciative du poids et du titre, ne fussent joints tous les signes qu’on jugerait propres à prévenir la contrefaçon.
Je n’ai point parlé de proportion entre l’or et l’argent, et je n’avais nul besoin d’en parler. Ne me mêlant point d’énoncer leur valeur dans une dénomination particulière, les variations réciproques de cette valeur ne m’occupent pas plus que les variations de leur valeur relativement à toutes les autres marchandises. Il faut la laisser s’établir d’elle-même puisqu’on chercherait en vain à la fixer. Quant aux obligations, elles seraient payées suivant qu’elles auraient été contractées ; un engagement de donner cent grammes d’argent serait acquitté au moyen de cent grammes d’argent, à moins que d’un consentement mutuel, à l’époque du paiement, les parties contractantes ne préférassent de le solder avec un autre métal ou avec une autre marchandise, suivant une évaluation dont elles tomberaient d’accord [134] .
Il serait difficile de calculer le bien qui résulterait pour tous les genres d’industrie d’un arrangement si simple ; mais on peut s’en faire une idée par le mal qui est résulté d’un système contraire. Non seulement les fortunes ont souvent été bouleversées et les entreprises les plus utiles et les mieux conçues traversées ou détruites, mais des lésions de tous les instants ont lieu constamment presque partout contre les intérêts du public et des particuliers.
Une monnaie qui ne serait que de l’argent ou de l’or étiqueté, qui n’aurait point une valeur nominale autre que sa valeur réelle et qui par conséquent échapperait au caprice de toutes les lois, serait tellement avantageuse pour tout le monde et dans tous les genres de commerce, que je ne doute nullement qu’elle ne devînt courante même parmi les étrangers. La nation qui la frapperait deviendrait alors manufacturière de monnaie pour la consommation extérieure, et pourrait faire un fort bon bénéfice sur cette branche d’industrie. Nous voyons dans le Traité historique des monnaies de France de Le Blanc (Prolégomènes, pag. 4) qu’une certaine monnaie que fit battre Saint Louis et dont les pièces s’appelaient agnels d’or à cause de la figure d’un agneau qui y était empreinte, fut recherchée même des étrangers et qu’ils aimaient fort à contracter en cette monnaie, seulement parce qu’elle contint toujours la même quantité d’or depuis Saint Louis jusqu’à Charles VI.
En supposant que la nation qui ferait cette bonne affaire fût la France, je ne pense pas qu’aucun de ceux qui me font l’honneur de lire cet ouvrage regrettât de voir ainsi sortir notre numéraire, suivant l’expression de certaines gens qui n’entendent rien et ne veulent rien entendre à toutes ces matières. L’argent ou l’or monnayé ne s’en iraient certainement pas sans être bien payés, et avec eux la façon qu’on y aurait mise. Les fabriques et le commerce de bijouteries ne sont-ils pas considérés comme très lucratifs, bien qu’ils envoient de l’or et de l’argent ? La beauté des dessins et des formes ajoute à la vérité un grand prix aux métaux qu’ils expédient au-dehors : mais l’exactitude des essais et des pesées, et surtout la permanence des mêmes poids et des mêmes titres dans les monnaies, est un mérite encore plus rare et qui ne serait certainement pas moins apprécié.
Si l’on disait que pareil système a été suivi par Charlemagne qui a appelé livre une livre d’argent ; que cependant il n’a pas empêché la dégradation des monnaies et qu’on n’appelât dans la suite une livre ce qui ne pesait réellement que 96 grains, je répondrais :
1°. Qu’il n’y a jamais eu du temps de Charlemagne, ni depuis, des pièces d’argent d’une livre ; que la livre a toujours été une monnaie de compte, une mesure idéale. Les pièces d’argent étaient alors des sols d’argent ; et le sol n’est pas une fraction de la livre de poids.
2°. Aucune monnaie ne portait sur son empreinte le poids du métal dont elle était faite. Il nous reste dans les cabinets de médailles plusieurs pièces de monnaies du temps de Charlemagne. On n’y voit que le nom du prince et quelquefois celui des villes où la pièce avait été frappée, écrits en lettres grossièrement formées, ce qui est peu surprenant dans un royaume dont le monarque, tout protecteur des lettres qu’il était, ne savait pas écrire [135] .
3°. Les monnaies portaient encore moins le titre, ou le degré de fin du métal ; et ce fut la première cause de la dégradation ; car sous Philippe Ier, les sols d’argent formant une livre de compte pesaient bien encore une livre de poids, mais cette livre de poids était composée de 8 onces d’argent allié avec 4 onces de cuivre, au lieu de contenir, comme sous la seconde race, 12 onces d’argent fin, poids de la livre d’alors.
[I-509]
CHAPITRE X.
De la monnaie de cuivre et de billon.↩
Les pièces de cuivre et celles de billon [136] ne sont pas proprement de la monnaie, puisqu’on n’est pas admis à payer avec ces pièces les obligations qu’on a contractées, mais seulement les appoints qui, à cause de leur petitesse, ne peuvent se solder avec de l’or ou de l’argent. L’or et l’argent sont les seuls métaux-monnaie chez presque tous les peuples commerçants. Les pièces de cuivre sont des espèces de billets de confiance, de signe, représentant une portion d’argent trop petite pour être frappée en monnaie.
Comme billets de confiance, le gouvernement qui les met en émission devrait toujours les échanger, à bureau ouvert, contre de l’argent, du moment qu’on lui en rapporte un nombre suffisant pour égaler une pièce d’argent. C’est le seul moyen de s’assurer qu’il n’en reste pas entre les mains du public au-delà des besoins de la circulation.
S’il en restait plus, les pièces de cuivre ne pouvant avoir les mêmes avantages pour leur possesseur que l’or ou l’argent qu’elles représentent, mais qu’elles ne valent pas, il chercherait à s’en défaire soit en les vendant à perte, soit en payant de préférence avec cette monnaie les menues denrées qui renchériraient en conséquence, soit enfin en plaçant les pièces de cuivre dans les paiements qu’il a à faire, en plus grande proportion que ne l’exigerait la nécessité des appoints.
Le gouvernement, qui est intéressé à ce qu’on ne les vende pas à perte, attendu qu’il disposerait moins avantageusement de celles qu’il met en émission, autorise ordinairement le dernier parti.
Au moment où j’écris, par exemple, on est autorisé chez nous à payer en monnaie de cuivre, 1/40e des sommes qu’on doit ; ce qui produit un effet pareil à une altération dans le titre des monnaies. Toute personne qui conclut un marché sait qu’elle est exposée à être payée dans la proportion de 1/40e en cuivre et de 39/40e en argent ; elle fait son marché en conséquence et demande un prix plus élevé que si cet alliage n’avait pas lieu.
Je ne prétends pas que chaque contractant fasse réellement et par chiffres un tel calcul ; je veux dire seulement que la quantité de cuivre qui entre dans les paiements influe sur la valeur courante de la monnaie d’argent, et que chaque personne qui contracte sait fort bien la valeur courante de l’argent monnayé. Il en est de cela comme du poids et du titre des monnaies d’argent : chaque vendeur, armé d’une balance et d’un creuset, ne s’arrête pas à les vérifier ; mais les gens qui font le commerce des matières d’or et d’argent, ou d’autres métiers analogues, sont perpétuellement occupés à comparer la valeur intrinsèque des monnaies avec leur valeur courante ; quand ces deux valeurs ne sont pas exactement les mêmes, la différence est pour eux une source de bénéfice ; et les opérations mêmes qu’ils font pour obtenir ce bénéfice tendent toujours à établir la valeur courante des monnaies au niveau de leur valeur réelle.
La quantité de cuivre qu’on est forcé de recevoir influe de même sur le change avec l’étranger. Une lettre de change, payable en francs à Paris, se vend certainement moins cher à Amsterdam, en raison de ce qu’une partie de sa valeur sera payée en cuivre ; de même qu’elle vaudrait moins si le franc contenait une moindre quantité d’argent fin et plus d’alliage.
Il faut pourtant remarquer que cette circonstance ne fait pas baisser la valeur de la monnaie en général autant que l’alliage : l’alliage n’a aucune valeur intrinsèque (on en a vu la raison page 219) ; tandis que la monnaie de cuivre qui entre pour un quarantième dans nos paiements, a une légère valeur intrinsèque, inférieure cependant au quarantième de la somme en argent, autrement on n’aurait pas été forcé de faire une ordonnance pour contraindre à la recevoir.
Si le gouvernement remboursait à bureau ouvert, en argent, les pièces de cuivre qu’on viendrait lui rapporter, il pourrait, presque sans inconvénient, leur donner extrêmement peu de valeur intrinsèque ; les besoins de la circulation en absorberaient toujours une fort grande quantité, et elles conserveraient leur valeur aussi complètement que si elles valaient la fraction de monnaie qu’elles représentent ; de même qu’un billet de banque qui n’a point de valeur intrinsèque, circule néanmoins, et même plusieurs années de suite, comme s’il valait intrinsèquement ce que porte sa valeur nominale. Cette opération lui vaudrait plus que la faculté de la faculté de compléter une partie de ses paiements en cuivre, et la valeur des monnaies n’en serait point altérée.
Il n’y aurait à craindre que les contrefacteurs qui seraient d’autant plus excités à leur infâme métier, qu’il y aurait plus de différence entre la valeur intrinsèque et la valeur courante. L’avantdernier roi de Sardaigne ayant voulu retirer une monnaie de billon que son père avait fabriquée dans des temps malheureux, en retira trois fois plus que le gouvernement n’en avait jamais fait. Le roi de Prusse éprouva une semblable perte et par une semblable cause, lorsqu’il fit retirer sous le nom emprunté du juif Éphraïm, le bas billon qu’il avait forcé les Saxons de recevoir, dans la détresse où l’avait réduit la guerre de sept ans [137] . C’est principalement dans les pays étrangers que s’opèrent ces contrefaçons. Les Anglais ont cherché à prévenir cet inconvénient en faisant fabriquer en 1799 des demi-deniers sterling (halfpence) avec un poinçon très beau et un soin tout particulier, perfection que les contrefacteurs ne peuvent pas facilement atteindre.
[I-515]
CHAPITRE XI.
De la meilleure forme des pièces de monnaies.↩
L’usure des pièces de monnaie, ou ce qu’on nomme en terme de l’art le frai, est proportionné à l’étendue de leur surface. Entre deux morceaux de métal de même poids, celui qui s’usera le moins, sera celui qui offrira le moins de surface au frottement.
La forme sphérique, la forme d’une boule, serait par conséquent celle qui s’userait le moins. Mais elle a été rejetée parce qu’elle est trop incommode.
Après cette forme-là, celle qui offre le moins de surface, est celle d’un cylindre qui serait aussi long que large ; cette forme serait également fort incommode ; on s’est donc en général arrêté à la forme d’un cylindre fort aplati. Mais il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’il convient de l’aplatir aussi peu que possible, c’est-à-dire de faire les pièces de monnaie plutôt épaisses qu’étendues.
Quant à l’empreinte, voici quelles doivent être ses principales qualités.
La première de toutes est de constater le poids de la pièce et son titre. Il faut donc qu’elle soit très visible et très intelligible, afin que les plus ignorants puissent comprendre ce qu’elle signifie. Il faut de plus que l’empreinte s’oppose autant qu’il est possible à l’altération de la pièce ; c’est-à-dire qu’il convient que la circulation naturelle ou la friponnerie ne puissent pas altérer le poids de la pièce sans altérer son empreinte. Les demi-sous d’Angleterre portent, depuis peu d’années, un cordon pratiqué dans l’épaisseur de la tranche, qui n’occupe pas la totalité de l’épaisseur et ne déborde pas. Il n’est susceptible ni de s’user ni d’être rogné. Cette méthode sera infailliblement appliquée aux monnaies d’or et d’argent qui sont celles dont on est le plus intéressé à prévenir l’altération.
L’empreinte, quand elle est saillante, doit l’être peu, pour que les pièces se tiennent facilement empilées, et surtout pour être moins exposées à l’action du frottement. Par la même raison, les traits d’une empreinte saillante ne doivent pas être déliés : le frottement les emporterait trop aisément. On a essayé, dans ce but, de faire des empreintes en creux ; on a éprouvé qu’elles affaiblissaient les pièces qui se courbaient alors et se cassaient plus aisément. Mais peut-être a-t-on eu tort de renoncer à cette méthode, dont on aurait évité les inconvénients en faisant des pièces plus épaisses.
Les motifs pour donner en général aux pièces de monnaie le moins de surface possible, doivent engager à faire les pièces aussi grosses qu’on le peut sans incommodité ; car plus elles sont divisées, plus elles présentent de surface. Il ne faut fabriquer de petites pièces de métal précieux, que ce qui est absolument nécessaire pour les petits échanges et les appoints.
[I-518]
CHAPITRE XII.
Par qui doit être supportée la perte qui résulte du frai des monnaies.↩
C’est une question de savoir par qui doit être supporté le frai des pièces de monnaie. Dans l’exacte justice, cette usure devrait être, comme en toute autre espèce de marchandise, supportée par celui qui s’est servi de la monnaie. Un homme qui revend un habit après l’avoir porté, le revend moins cher qu’il ne l’a acheté. Un homme qui vend un écu contre de la marchandise, devrait le vendre moins cher qu’il ne l’a acheté, c’est-à-dire recevoir en échange moins de marchandise qu’il n’en a donné.
Mais la portion de l’écu usée en passant par les mains d’un seul honnête homme, est si peu de chose, qu’il est presqu’impossible de l’évaluer. Ce n’est qu’après avoir circulé pendant plusieurs années, que son poids a sensiblement diminué, sans qu’on puisse dire précisément entre les mains de qui cette diminution a eu lieu. Je sais fort bien que chacun de ceux entre les mains de qui l’écu a passé, a supporté, sans s’en apercevoir, la dégradation occasionnée dans sa valeur échangeable par l’usure ; je sais que chaque jour l’écu a dû acheter un peu moins de marchandise ; je sais que cette diminution, insensible d’un jour à l’autre, le devient au bout d’un certain nombre d’années, et qu’une monnaie usée achète moins de marchandises qu’une monnaie neuve. Je crois en conséquence que si une espèce entière de pièces de monnaie se dégradait successivement, au point d’exiger une refonte, les possesseurs de ces pièces, au moment de la refonte, ne pourraient raisonnablement exiger que leur monnaie dégradée fût échangée contre une monnaie neuve, pièce pour pièce et troc pour troc. Leurs pièces ne devraient être prises même par le gouvernement que pour ce qu’elles valent réellement ; elles contiennent moins d’argent que dans leur origine ; mais aussi les ont-ils eues à meilleur compte, puisque, pour les avoir, ils n’ont donné qu’une quantité de marchandises inférieure à ce qu’ils auraient donné dans l’origine.
Telle est en effet la rigueur du principe. Mais deux considérations doivent empêcher de s’y tenir.
1°. Les pièces de monnaie ne sont pas une marchandise individuelle, si je peux ainsi m’exprimer. Leur valeur dans les échanges s’établit, non pas précisément sur le poids et la qualité des pièces actuellement offertes ; mais sur le poids et la qualité qu’on sait, par expérience, exister dans la monnaie du pays prise au hasard et par grandes masses. Un écu un peu plus ancien, un peu plus usé, passe sur le même pied qu’un plus entier ; l’un compense l’autre. Chaque année, les hôtels des monnaies frappent de nouvelles pièces qui contiennent tout le métal pur qu’elles doivent avoir ; et dans cet état de choses, la valeur de la monnaie n’éprouve pas, même au bout d’un grand nombre d’années, du moins pour cause d’usure, une diminution dans sa valeur.
C’est ce qui s’observe bien facilement au moment où j’écris, dans nos pièces de 12 et de 24 sols, qui, par la facilité qu’elles ont de passer concurremment avec les écus de six livres, conservent une valeur égale aux écus, quoique, dans la même somme nominale, il y ait environ un quart moins d’argent dans les pièces usées de 12 et 24 sols que dans les écus.
Dans cet état de choses, si l’on retirait de la circulation cette dernière monnaie, et qu’on ne la reçût que pour 9 et 18 sols, qui est tout au plus ce qu’elle vaut intrinsèquement, on les reprendrait aux possesseurs actuels sur un pied inférieur à celui auquel ils les ont eues dans les échanges ; car elles ont bien passé jusqu’au dernier moment pour 12 et 24 sols.
2°. L’empreinte, la façon de la pièce, sert précisément au même degré, jusqu’au dernier moment, quoique sur la fin elle soit à peine visible, ou même ne le soit plus du tout, comme sur les shillings d’Angleterre. Nous avons vu que la pièce de monnaie a une certaine valeur en raison de cette empreinte. Cette valeur a été reconnue jusqu’à l’échange qui l’a fait passer dans les mains du dernier possesseur ; celui-ci l’a reçue, par cette raison, à un taux un peu supérieur à celui d’un petit lingot du même poids. La valeur de la façon serait donc perdue pour lui seul, quoiqu’il soit peut-être la millionième personne entre les mains de qui la pièce ait passé.
Ces considérations me portent à croire que ce devrait être à la société toute entière, c’est-à-dire au Trésor public, à supporter dans ces cas-là la perte de l’usure et la perte de la façon ; c’est la société toute entière qui a usé la monnaie, et l’on ne peut faire supporter cette perte à chaque particulier, proportionnellement à l’avantage qu’il a retiré de la monnaie.
Ainsi l’on peut faire payer à tout homme qui porterait des lingots à l’hôtel des monnaies, pour y être façonnés, les frais de fabrication, et même, si l’on veut, les bénéfices du monopole ; il n’y a point là d’inconvénient : le monnayage élève la valeur de son lingot de tout le prix qu’il paie à la Monnaie ; et si cette façon ne l’élevait pas à ce point, il n’aurait garde de l’y porter. Mais en même temps je pense que l’hôtel des monnaies devrait changer une pièce vieille contre une pièce neuve, toutes les fois qu’il en serait requis. Ce qui n’empêcherait pas au surplus qu’on ne prît toutes les précautions possibles contre les rogneurs d’espèces. La Monnaie ne recevrait pas des pièces auxquelles il manquerait certaines portions de l’empreinte que l’usure naturelle ne doit pas enlever. La perte porterait alors sur le particulier assez négligent pour recevoir des pièces privées de signes faciles à reconnaître. La promptitude avec laquelle on aurait soin de reporter à l’hôtel des monnaies une pièce altérée, fournirait au ministère public des moyens de remonter plus aisément à la source des altérations frauduleuses.
Sous une administration diligente, la perte supportée par le Trésor public pour cette cause-là se réduirait à peu de chose, et le système général des monnaies, de même que le change avec l’étranger, en seraient sensiblement améliorés.
FIN DU TOME PREMIER.
NOTES
Endnotes for Volume 1↩
[1] Oikos, maison ; nomos, loi. Mais Xénophon dit positivement au commencement de ses Économiques, que la signification du mot maison, dans ce cas, embrasse tous les biens qu’on possède, et qu’il faut entendre par biens tout ce qui peut contribuer à notre bienêtre. Ainsi, même d’après l’étymologie, le mot d’économie politique ne doit s’appliquer qu’aux biens, aux richesses de la société.
[2] Du latin status, état, situation.
[3] Voyez les Mémoires de Sully, Liv. XVI.
[4] Du commerce et du gouvernement, considérés l’un relativement à l’autre.
[5] La traduction de Smith par Garnier est la seule qui soit digne de l’original. Il est fâcheux que le traducteur, dans sa préface, dans ses notes, comme dans les Éléments qu’il avait publiés quelques années auparavant, ait reproduit les principales erreurs des Économistes ; ce qui n’empêche point que ses travaux ne soient extrêmement recommandables, et que je ne les aie moi-même consultés avec beaucoup de fruit.
[6] On appelle matière brute ou matière première, une matière qui n’a pas encore reçu toutes les préparations qui doivent la rendre propre à l’usage de l’homme.
[7] Voyez les Œuvres de Poivre, pages 77 et 78.
[8] Observations on the produce of the income tax.
[9] Pitt, qu’on soupçonne d’avoir exagéré la quantité du numéraire, l’évalue 44 millions pour l’or, et Price 3 millions pour l’argent, ce qui fait bien 47 millions.
[10] Le mot utilité, du latin uti, user, d’où l’on a fait utilitas, utilité, est pris ici dans son sens primitif, dans son sens le plus étendu. C’est la qualité de pouvoir servir. Dans ce sens il suffit qu’une chose puisse concourir à satisfaire des besoins, et même des caprices, pour qu’elle ait ce qu’on appelle ici une utilité.
[11] Histoire philosoph. des établ. des Européens dans les Indes.
[12] Le commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre. Ire partie, chap. 6.
[13] On croit que les moulins à eau ne furent en usage que du temps d’Auguste. Les moulins à vent sont bien plus récents, et ne datent guère que du temps des croisades.
[14] Il n’est pas question ici de la mouture que les riches citoyens de Rome faisaient faire par leurs esclaves, mais de celle qui se faisait par entreprise.
[15] J’estime que 3 compositeurs peuvent composer une feuille ordinaire d’impression dans un jour ; 2 pressiers peuvent l’imprimer aussi dans un jour, au nombre de mille exemplaires. Voilà donc 5 journées d’ouvriers pour faire mille copies de cette feuille. J’estime qu’une copie manuscrite de cette même feuille, où l’on mettrait le même soin qu’on donnait aux livres manuscrits, occuperait un copiste pendant un jour. Il faudrait donc mille copistes pour faire la besogne qui a été exécutée par 5 imprimeurs, c’est-à-dire 200 pour faire la besogne d’un seul.
[16] Tom. IV, pag. 198.
[17] C’est à Eberfeld en Allemagne que sont faits la plupart des lacets, et de la manière que je dis.
[18] Il n’est pas très rare de voir, dans les manufactures riches, de simples ouvriers posséder une bibliothèque de dix à douze volumes ; et si l’on trouvait des moyens d’écarter de la bibliothèque des ouvriers et des laboureurs les sottises et les inutilités, si elles pouvaient se composer d’un ou deux bons ouvrages sur l’art qu’exerce l’ouvrier, ou les arts qui y tiennent de plus près, sur celui de conserver sa santé, et sur l’éducation des enfants, qui peut douter de l’immense influence que ces dix ou douze volumes exerceraient sur les facultés morales d’une nation ?
[19] Voyez ce Liv. I, ch. 3.
[20] Rich. des nat. Liv. II, ch. 3.
[21] Idem.
[22] Voltaire donne 200 millions de fortune à Mazarin.
[23] Cette augmentation dans les dépenses ne tient pas à une dégradation dans la valeur de l’argent, sa valeur, non pas nominale mais réelle, n’a presque pas changé depuis cent ans ; c’est-à-dire que pour le même poids d’argent, on a à peu près le même poids de blé. Si l’on dépense plus d’argent, on ne dépense donc pas une valeur plus grande de nom seulement ; mais une valeur plus grande de fait.
[24] Réflex. sur la form. et la distrib. des rich. §. 81.
[25] Il n’est question ici que du profit du capital, et non du profit de l’industrie de l’entrepreneur.
[26] Dupont, Physiocratie, pag. 114.
[27] Ordre naturel des sociétés politiques, tom. II, pag. 255.
[28] Le Monthly magazine (année 1801) estime que la valeur des objets de cuivre actuellement fabriqués en Angleterre, soit pour la consommation intérieure, soit pour la consommation extérieure, s’élève à 84 millions environ de nos francs, et qu’elle fait vivre une population de 60 mille personnes. Le même journal assure que, vers les années 1720 et 1730, presque tous les ustensiles de cuivre employés en Angleterre y venaient de Hollande et de Hambourg.
[29] Voyez Macartney, tom. V, pag. 74.
[30] Le comte de Veri est, à ma connaissance, le premier qui ait dit en quoi consistait le principe et le fondement du commerce. Jusqu’à lui et depuis, on a sans cesse répété que le commerce était un échange de l’excédent de denrée dont chaque peuple pouvait disposer. On a pris le moyen pour le principe. Le comte de Veri a dit, en 1772 : « Le commerce n’est réellement autre chose que le transport des marchandises d’un lieu à un autre ». (Réflex. sur l’écon. polit. ch. 4). En effet, ce n’est point l’échange qui produit, qui augmente la richesse, c’est l’accroissement de valeur donné à un produit par le transport d’un lieu à un autre.
[31] On voit que Steuart s’est totalement mépris sur la nature des richesses, lorsqu’il a dit (Liv. II, ch. 26) qu’une fois que le commerce extérieur cesse, la masse des richesses intérieures ne peut être augmentée. Il semblerait que la richesse ne peut venir que du dehors. Mais au dehors d’où vient-elle ? encore du dehors. Il faudrait donc, en la cherchant de dehors en dehors, sortir de notre globe ; ce qui est absurde. C’est sur ce principe évidemment faux qu’il bâtit son système sur le commerce.
[32] Physiocratie, page 116.
[33] Ibid., page 140.
[34] Rich. des nat. Liv. IV, ch. 2.
[35] Esp. des lois, Liv. XX, ch. 4 et suivants.
[36] Ibid., Liv. XX, ch. 6.
[37] Quelquefois le gouvernement paie une prime pour soutenir un commerce qui donne de la perte ; mais c’est une autre question. Voyez ci-après le Ch. 31 (Des primes d’encouragement).
[38] À en croire les tableaux de la balance du commerce d’Angleterre, il est entré dans ce pays, depuis le commencement du XVIIIe siècle, pour 347 millions sterling d’or et d’argent de plus qu’il n’en est sorti ; ce qui, joint à tout l’or et l’argent qui existaient déjà en Angleterre lorsque le siècle a commencé, donnerait au moins un total de 400 millions, pour la valeur des métaux précieux qui devraient s’y trouver à présent. Or on a déjà vu que Smith n’évalue qu’à 18 millions le numéraire existant en Angleterre ; mais comme Smith convient qu’on n’a aucune base satisfaisante pour cette évaluation, et comme il est à propos d’y comprendre le numéraire des trois royaumes, admettons celle de M. Pitt, qui était intéressé à représenter favorablement la situation de la Grande-Bretagne ; il évalue le numéraire en or qui s’y trouve maintenant, à la somme de 44 millions sterling. Le numéraire en argent n’a jamais excédé, suivant le docteur Price, 3 millions sterling ; et il a dû diminuer depuis cet écrivain, car il ne s’en est point introduit de nouveau dans la circulation, par des raisons que l’on verra au livre suivant : le cours forcé des billets de banque a dû réduire la masse de l’un et de l’autre. Il n’y a donc, au plus, que pour 47 millions de numéraire métallique dans la Grande-Bretagne. Et si l’on veut y joindre la valeur des métaux précieux employés en bijoux, en vaisselle, valeur que Beekles estime 50 millions sterling, on n’aura jamais que pour 97 millions de valeurs métalliques, au lieu de 400 millions indiqués par la balance du commerce. Les tableaux de la balance du commerce de France donnent des résultats analogues et non moins trompeurs.
[39] L’examen des moyens qu’ils ont employés sera l’objet de quelques autres chapitres.
[40] Tom. II, pag. 311.
[41] La reine Christine de Suède disait, à l’occasion de la révocation de l’Édit de Nantes, que Louis XIV s’était coupé le bras gauche avec le bras droit.
[42] Une association en commandite est une association où chaque intéressé n’est solidaire que jusqu’à concurrence de sa mise de fonds.
[43] Liv. IV, ch. 7, 3e part.
[44] Un commerce interlope est un commerce non permis.
[45] Ce fut sous le règne de Henri IV, en 1604, que fut établie en France la première compagnie pour le commerce des Indes orientales. Elle fut formée par un Flamand nommé Gérard-Leroi, et n’eut pas de succès.
[46] Taylor, Lettres sur l’Inde.
[47] Raynal, Hist. ph. et polit. des étab. des Européens dans les deux Indes, Liv. IV, §. 19.
[48] Siècle de Louis XV.
[49] Les nations européennes sont les seules, ce me semble, qui aient fondé des colonies. Il est, je crois, sans exemple, que l’Asie, l’Afrique ou l’Amérique, aient, en aucun temps, envoyé des colonies en Europe, si l’on en excepte les Carthaginois qui firent des établissements en Espagne. Mais les Carthaginois étaient une colonie de Phéniciens, qui étaient eux-mêmes une colonie d’Européens. Quant à l’opinion que la Grèce est une colonie d’Égyptiens, elle est trop incertaine.
[50] Voyez le ch. 16.
[51] Voyez plus loin ce qui a rapport à la population.
[52] J’en excepte toujours les fondateurs de plusieurs États dans l’Amérique septentrionale et quelques autres, parmi lesquels les fondateurs de la colonie de la Baie de Botanique peuvent être comptés.
[53] Voyez les aveux contenus dans un discours prononcé dans une assemblée des colons des Antilles anglaises, le 7 mars 1798, par Clément Caines, l’un des plus anciens colons de la Jamaïque.
[54] Steuart, Traité d’économie politique, Liv. II, ch. 6.
Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, §. 28.
Smith, Richesses des nations, Liv. I, ch. 8 ; et Liv. III, ch. 2.
[55] On leur confie cependant des travaux plus relevés, tels que la direction des autres esclaves, le soin des provisions, la tenue de quelques registres ; et il faut bien que dans ces occupations même ils montrent plus de diligence que des employés libres, puisque des chefs d’entreprise très éclairés et très vigilants les préfèrent à ces derniers.
[56] Œuvres de Poivre, pages 156 et 157.
[57] Je dis, même dans leurs intérêts actuels, parce qu’une nation peut d’autant mieux être chargée d’impôts par le gouvernement, qu’elle est moins chargée de dépenses pour ses consommations, et qu’une petite augmentation dans la contribution de tous les citoyens fait entrer au Trésor public plus d’argent que l’augmentation de contribution qu’on peut demander à quelques colons enrichis.
[58] Voyez dans les chapitres précédents en quoi consistent les profits du commerce extérieur : c’est le moins avantageux des commerces.
[59] Voyez les Œuvres de Poivre, page 209 ; et encore il ne comprend pas làdedans l’entretien des forces maritimes et militaires de la France, dont une partie au moins devait être mise sur le compte de cette colonie.
[60] Œuvres de Franklin, tome II, page 50.
[61] Lorsqu’Henri IV favorisa l’établissement des manufactures de Lyon et de Tours, d’autres professions adressaient à ce prince, contre les étoffes de soie, les mêmes réclamations que Tours et Lyon ont faites depuis contre les toiles peintes. Voyez les Mémoires de Sully.
[62] Richesse des nations, Liv. IV, ch. 5.
[63] Dans le langage du navigateur, un tonneau est un poids qui équivaut à 2 milliers pesant.
[64] Rich. des nat. Liv. IV, ch. 2.
[65] Je suis bien éloigné d’approuver également tous les encouragements donnés sous le même ministère, et surtout les dépenses faites en faveur de plusieurs établissements purement de faste, et qui, comme la manufacture des Gobelins, ont constamment plus dépensé qu’ils n’ont produit.
[66] Voyez les lois du 7 janvier et 25 mai 1791, du 20 septembre 1792, et l’arrêté du gouvernement du 5 vendémiaire an IX.
[67] Rich. des nat. Liv. IV, ch. 2.
[68] Mém. de Sully, Liv. II.
[69] Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, n° 4.
[70] Richess. des nat. Liv. IV, ch. 5. Digression, etc.
[71] Tom. I, pag. 113.
[72] Cet ouvrage est cité deux fois par Smith comme très exact ; mais les choses doivent avoir beaucoup changé depuis qu’il est écrit, et l’importation des blés en Angleterre doit être bien plus considérable. Néanmoins eût-elle quintuplé, elle n’excéderait pas encore la 114e partie de la consommation de l’Angleterre, et ceci montre toujours que la consommation des blés étrangers dans chaque pays est fort inférieure à ce qu’on la suppose communément.
[73] Rich. des nat. Liv. I, ch. 10.
[74] Ibid. Liv. IV, ch. 7.
[75] Tableau de la Grande-Bretagne, par Baert, Tom. I, pag. 107.
[76] Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne.
[77] Liv. XIX.
[78] Traité sur le commerce, etc., pag. 504.
[79] On a faussement attribué cet effet à la liberté introduite par la Révolution ; on voit, dans le Tableau du commerce de la Grèce, par Beaujour, qu’il date de plus loin, malgré les règlements.
[80] Félix Beaujour, Tableau du commerce de la Grèce.
[81] Steuart, De l’économie politique, T. I, p. 146.
[82] Espr. des lois, Liv. V, ch. 8.
[83] Rich. des nat. Liv. IV, ch. 7.
[84] Ce ne fut qu’en 1720 que Declieux, officier d’infanterie, parvint à enrichir nos îles de la plante du café. On sait qu’il transporta un pied de cet arbuste des serres du Jardin des Plantes à la Martinique, et qu’il ne le conserva que par des soins vraiment paternels, tellement que, pendant la traversée, l’eau étant devenue rare, il partagea sa portion avec son jeune plant.
[85] Le commerce total d’un État comprend toutes les affaires faites sur les produits créés et consommés dans l’intérieur, depuis les herbes du marché jusqu’aux marchandises les plus recherchées.
[86] Voyez le ch. 23, qui montre en quoi le commerce extérieur est productif.
[87] Pendant la dernière guerre le principal de la dette d’Angleterre a été augmenté de 146 millions 500 mille livres sterling, ce qui fait plus de 3 milliards et demi ; et cette dépense n’embrasse point les produits des contributions mises en pays étrangers, des entretiens forcés de troupes, des pillages, etc., qui ont fourni à une partie des frais de la guerre. Ce que cette même guerre a coûté du côté de la France, il est impossible de l’évaluer même par approximation.
[88] Dans les tableaux de la balance du commerce publiés par Arnould, le total des échanges avec l’Italie et l’Allemagne excède cette somme ; mais sous ces dénominations d’Allemagne et d’Italie, l’auteur comprend plusieurs puissances ; et la masse des échanges avec chacune en particulier ne s’élève pas à 50 millions.
[89] J’avais d’abord eu l’intention de nommer ces produits indurables, et c’était sans doute le mot propre. Intransmissible l’est moins ; car ces produits se transmettent du producteur au consommateur. Transitoire signifie passager, mais n’exclut pas l’idée de toute espèce de durée. Immatériel a quelque chose de mystique, et qui, de plus, dans l’usage que j’en fais, s’applique bizarrement à quelques jouissances très sensuelles ; cependant j’ai mieux aimé employer ce dernier nom que d’en fabriquer un qui aurait pu paraître trop étrange.
[90] Garnier a déjà relevé cette erreur dans les notes instructives qu’il a jointes à l’excellente traduction qu’il a donnée de Smith.
[91] Traduction de Smith, note 20.
[92] Liv. 1, ch. 2.
[93] Les salaires du simple manouvrier se bornent à ce qui lui est nécessaire pour vivre, à ce qui est nécessaire pour que son travail se continue. Il ne reste rien pour l’intérêt d’aucun capital. Mais dans l’entretien du simple manouvrier se trouve compris celui de ses enfants jusqu’à l’âge où ils gagnent leur vie.
[94] Dans beaucoup de pays on croit trop aisément que les arbres nuisent aux autres produits. Il faut bien qu’ils augmentent plus qu’ils ne diminuent les revenus des terres, puisque les pays les mieux plantés, comme la cidevant Normandie, l’Angleterre, sont en même temps les plus productifs.
[95] Les feuilles des arbres absorbent le gaz acide carbonique qui compose en partie l’air que nous respirons, et qui n’est pas lui-même respirable. C’est ce gaz qui, lorsqu’il est trop abondant, jette l’homme dans l’asphyxie et le tue. Les plantes rendent au contraire de l’oxygène, qui est cette partie de l’air la plus propre à la respiration et à la santé.
[96] Voyez Steuart, De l’économie politique, Liv. I, ch. 4. Montesquieu, Esprit des lois, Liv. XVIII, ch. 10 et Liv. XXIII, ch. 10. Buffon, édition de Bernard, tom. IV, page 266. Forbonnais, Principes et observations, pages 39, 45. Hume, Essais. Partie II, essai 11. Poivre, le volume de ses œuvres, pages 145, 146. Condillac, Le Commerce et le Gouvernement, Partie I, ch. 24 et 25. Le comte de Veri, Réflexions sur l’économie politique, ch. 21. Mirabeau, Ami des hommes, Tom. I, page 40. Raynal, Histoire de l’établissement, etc. Liv. XI, §. 23. Chastellux, De la Félicité publique, Tom. II, pag. 205. Necker, Administration des Finances de France, ch. 9, et ses Notes sur l’Éloge de Colbert. Condorcet, Notes sur Voltaire, édit. de Kell, Tome 45, page 60. Smith, Rich. des nations, Liv. I, ch. 8 et 11. Garnier, Abrégé Élémentaire, Part. I, ch. 3, et dans la préface de sa traduction de Smith. Canard, Principes d’économie polit. page 135.
[97] Voyez Tite-Live, Liv. VI. Plutarque, Œuvres morales : Des Oracles qui ont cessé. Strabon, Liv. VII.
[98] Si la population dépend de la quantité des productions, c’est une estimation très imparfaite pour en juger que le nombre des naissances. Là où l’industrie et les produits augmentent, les naissances plus multipliées à proportion des habitants déjà existants, donnent une évaluation trop forte. Dans les pays qui déclinent, au contraire, la population excède le nombre indiqué par les naissances.
[99] Liv. I, ch. 17.
[100] Le lord Liverpool, d’ailleurs fort partisan du système anglais, disait au parlement en 1800 :
« Il est bien connu que, depuis plusieurs années, il ne croît plus dans ce pays assez de blé pour la nourriture de ses habitants, malgré les améliorations continuelles qui se sont faites et la grande quantité de biens communaux mis en culture chaque année.... Depuis 40 ans, j’ai observé que tous les cinq ans la quantité de blé importé était constamment plus considérable que les cinq années précédentes ».
L’Angleterre avait acheté au-dehors, l’année précédente, sept cent mille quarters de blé, qui lui avaient coûté 5 millions 60 mille livres sterling (environ 121 millions de francs).
[101] Raynal, Hist. ph. et polit. Liv. VI.
[102] Montesq. Esp. des lois.
[103] Rich. des nat. Liv. I, ch. 4.
[104] Les lois de Lacédémone offrent une preuve de ce que j’ai dit, que l’autorité de la loi ne peut suffire pour établir le cours de la monnaie. Lycurgue voulut que la monnaie fût de fer, précisément pour qu’on ne pût en amasser ni en transporter aisément une grande quantité ; mais comme cela même contrariait un des principaux usages de la monnaie, sa loi fut violée. Lycurgue fut pourtant le mieux obéi des législateurs.
[105] Garnier, Abrégé des principes d’économie publique, Ire partie, ch. 4, et dans l’avertissement.
[106] Je n’ai pas besoin d’avertir que, lorsque le numéraire sort d’un pays, le pays ne perd pas la valeur du numéraire ; car personne n’est disposé à faire cadeau de son argent à l’étranger ; on n’envoie une valeur que pour en recevoir une autre équivalente. Mais le pays perd la façon du numéraire. Quand les guinées sortent d’Angleterre, l’Angleterre ne reçoit en échange que la valeur du métal, et rien pour la façon.
[107] Smith, Richesse des nations, Liv. I, ch. 5.
[108] Excepté le gouvernement français qui, pendant dix années, sous le ministère de Colbert (de 1679 à 1689), et depuis le 9 frimaire jusqu’au 26 germinal an IV, n’a point retenu de frais de fabrication.
[109] La valeur que la commodité de l’empreinte ajoute à la monnaie peut se connaître par le moyen du prix que le commerce met au métal en lingot. Quand on payait, avant la Révolution, l’argent en lingots, de même titre que les écus, 48 livres le marc, on ne donnait réellement que 7 onces 5 gros 48 grains d’argent façonné, pour 8 onces ou un marc d’argent non façonné ; car 48 livres font 8 écus de 6 livres, qui pesaient chacun 555 grains, ou 7 gros 51 grains. On payait donc librement, pour la façon d’un marc d’argent, 2 gros 24 grains, c’est-à-dire à peu près 3,5%.
[110] La valeur provenant de la façon ne se perd pas entièrement dans l’exportation ; c’est un poinçon qui sert quelquefois hors du pays où on l’a imprimé.
[111] Abot de Bazinguen, Traité des monnaies, Tom. II, page 61.
[112] On voit dans les Prolégomènes de Leblanc, page 25, que le sol d’argent de SaintLouis pesait 1 gros 7,5 grains, ce qui, multiplié par 20, fait bien pour la livre 2 onces 6 gros 6 grains.
[113] C’est ce qu’avait déjà fait à Rome l’empereur Héliogabale, noté dans l’histoire pour ses épouvantables profusions. Les citoyens romains devant payer, non un certain poids en or, mais un certain nombre de pièces d’or (aurei), l’empereur, pour recevoir davantage, en fit fabriquer qui pesaient jusqu’à 2 livres (24 onces).
[114] Philippe de Valois, dans le mandement qu’il adressa aux officiers des monnaies en 1350, leur ordonne le secret sur l’affaiblissement des monnaies, et le leur fait jurer sur l’Évangile, afin que les marchands y soient trompés. « Faites savoir aux marchands, dit-il, le cours du marc d’or de la bonne manière ; en sorte qu’ils ne s’aperçoivent qu’il y a mutation de pied ». On voit, sous le roi Jean, plusieurs exemples semblables. Le Blanc, Traité historique des monnaies, page 251.
[115] Le Blanc, Traité historique des monnaies, p. 27.
[116] Mathieu Villani.
[117] Montesquieu, Esp. des lois, Liv. XXII, ch. 11.
[118] Smith, Rich. des nat. Liv. II, ch. 2.
[119] Steuart, Tom. I, pag. 553.
[120] Voyez l’ordonnance de Philippe-le--Bel de 1302 ; celles de Philippe de Valois de 1329 et de 1343 ; celle du roi Jean de 1354 ; celle de Charles VI de 1421.
[121] Smith, Richesse des nations, Liv. I, chap. 11, Partie 3e.
[122] Canard, Discours qui a remporté le prix, etc.
[123] On ne peut tirer avantage de ce qu’on joint à la valeur de la monnaie celle des papiers de crédit. L’agent de la circulation, qu’il soit sous forme d’espèces ou sous forme de papier de crédit, n’excède jamais les besoins de la circulation ; et la valeur que la circulation emploie comme agent de circulation est toujours peu de chose comparée avec l’ensemble des valeurs d’un pays. Voyez ci-après le chapitre des Billets de banque.
[124] Voyez Dupré de St. Maur, Variations dans les prix, etc., page 8.
[125] Rapport entre l’argent et les denrées, page 35.
[126] Ces évaluations sont puisées dans l’Essai sur les monnaies, et dans les Variations dans les prix, de Dupré de Saint-Maur.
[127] Esp. des lois, Liv. XXII, ch. 3.
[128] Voyez l’Esprit des lois, Liv. XXII, ch. 8.
[129] Tom. XVII, pag. 394, des Œuvres complètes.
[130] En Europe, jusqu’à l’époque dont il est ici question, 1 once d’or valait autant que 10 à 12 onces d’argent. Maintenant, chez la plupart des nations européennes, 1 once d’or vaut autant que 14 à 15 onces d’argent. En prenant pour terme moyen de la proportion de l’or à l’argent dans les temps anciens 11,25 à 1, et dans les temps modernes 15 à 1, l’once d’or a, relativement à l’argent, augmenté de valeur dans la proportion que j’établis ici de 3 à 4. Multiplier l’un par 3, donne donc la même valeur que de multiplier l’autre par 4.
[131] Les Anglais se servent pour les métaux du poids de Troy, dont la livre se divise en 12 onces, l’once en 20 pennies, et le penny en 24 grains.
[132] La livre sterling se divise en 20 sols ou shillings, et le shilling en 12 deniers ou pence.
[133] Je fonde ces calculs sur ce que dit Smith (Liv. I, ch. 5), qu’une once d’argent monnayé donne 5 shillings 2 pences, et que l’once d’argent en lingot se rend 5 shillings et 3 à 5 pences l’once ; prix commun 5 shillings et 4 pences.
[134] Il faudrait à la vérité double tarif pour les cas où un tarif est nécessaire, comme dans les douanes, les postes, etc., afin de procurer aux payeurs la faculté de s’acquitter, soit en argent, soit en or, suivant leur commodité ; à moins qu’une loi, qu’on renouvellerait quand on voudrait, ne fixât la quantité d’un métal qu’on serait autorisé à payer en remplacement d’un autre. Une loi de deux lignes suffirait pour cela, et porterait, par exemple : Toute espèce de taxe pourra être acquittée en or, moyennant un gramme d’or pour quinze grammes d’argent, plus ou moins. Il faudrait seulement que cette fixation fût un peu au-dessous du taux du commerce, pour qu’on pût exiger des comptables la réduction en métal tarifé, et des comptes rendus en une seule monnaie.
[135] Éginard dit positivement que Charlemagne ne savait pas écrire, qu’il tenta vainement de l’apprendre dans un âge avancé, et que ce fut pour cette cause qu’il se servit, pour sa signature, du monogramme, figure composée des principales lettres de son nom, et qui lui parut plus facile à former. Les successeurs de Charlemagne, et même beaucoup d’évêques de ce temps là, étaient obligés de se servir du monogramme pour la même raison.
[136] On appelle billon un alliage dans lequel il entre un quart ou moitié d’argent fin, et où le reste est du cuivre.
[137] Mongez, Considérations sur les monnaies, pag. 31.