VOLTAIRE
Questions sur l'Encyclopédie,
par des Amateurs (1774)
Tome 2 “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”
 |
 |
This is an e-Book from |
Source
Voltaire, Collection complette des oeuvres de Mr. de * * * . (Geneve, 1774). Questions sur l’Encyclopédie, par des amateurs, Tomes 21-24.
- Tome premier, “A - Bibliothèque”, pp. 538.
- Tome second, “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”, pp. 520.
- Tome troisième, “Eloquence - Intolérance,” pp. 534.
- Tome quatrième, “Juif - Zoroaster,” pp. 528.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- given the poor quality of the original HTML coding I had to work with, I have not followed mmy usual practice of inserting the page numbers of the original edition (there are over 2,000). Instead I have limited the page numbers to the beginning of the individual articles.
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
Table des Articles contenus dans ce volume
- SOUVERAIN BIEN. [p. 1]
- BIENS D'ÉGLISE. [p. 4]
- TOUT EST BIEN. [p. 11]
- BLASPHÈME. [p. 21]
- BLED OU BLÉ. [p. 26]
- BLÉ. [p. 37]
- BOEUF APIS. [p. 38]
- BOIRE À LA SANTÉ. [p. 39]
- BORNES DE L'ESPRIT HUMAIN. [p. 42]
- BOUC. [p. 45]
- BOUFFON, BURLESQUE. [p. 48]
- BOULEVARD, ou BOULEVART. [p. 57]
- BOURGES. [p. 58]
- BOURREAU. [p. 59]
- BRACHMANES, BRAMES. [p. 60]
- BULGARES, ou BOULGARES. [p. 66]
- BULLE. [p. 69]
- CALEBASSE. [p. 77]
- CARACTÈRE. [p. 79]
- CARÊME. [p. 81]
- CARTÉSIANISME. [p. 84]
- DE CATON, DU SUICIDE, [p. 89]
- CAUSES FINALES. [p. 100]
- CELTES. [p. 109]
- CEREMONIES, TITRES, PRÉÉMINENCE ,&c. [p. 111]
- CERTAIN, CERTITUDE. [p. 119]
- CÉSAR. [p. 124]
- CHAINE DES ÊTRES CRÉES. [p. 126]
- CHAINE, OU GÉNÉRATION DES ÉVÉNEMENS. [p. 128]
- CHANGEMENS ARRIVÉS DANS LE GLOBE. [p. 131]
- CHANT, MUSIQUE, MELOPÉE, GESTICULATION, SALTATION. [p. 134]
- CHARITÉ, [p. 137]
- CHARLATAN. [p. 141]
- CHARLES IX. [p. 145]
- CHEMINS. [p. 147]
- CHIEN. [p. 151]
- DE LA CHINE. [p. 153]
- CHRISTIANISME. [p. 160]
- CHRONOLOGIE. [p. 167]
- CICÉRON. [p. 170]
- CIEL MATÉRIEL. [p. 174]
- LE CIEL DES ANCIENS. [p. 179]
- CLERC. [p. 182]
- CLIMAT. [p. 186]
- CLOU. [p. 191]
- COHÉRENCE, COHÉSION, ADHÉSION. [p. 193]
- COLIMAÇONS. [p. 194]
- CONCILE. [p. 198]
- CONFESSION. [p. 204]
- CONFIANCE EN SOI-MÊME. [p. 213]
- CONFISCATION. [p. 218]
- CONSCIENCE. [p. 221]
- CONSEILLER OU JUGE. [p. 227]
- Dialogue BARTOLOMÉ. - GERONIMO
- CONSÉQUENCE. [p. 228]
- CONSPIRATIONS CONTRE LESPEUPLES, OU PROSCRIPTIONS. [p. 230]
- CONSPIRATIONS OU PROSCRIPTIONS JUIVES.
- CELLE DE MITHRIDATE.
- CELLE DE SYLLA, DE MARIUS ET DES TRIUMVIRS.
- CELLE DES JUIFS SOUS TRAJAN.
- CELLE DE THÉODOSE, &C.
- CELLE DE L'IMPERATRICE THÉODORA.
- CELLE DES CROISÉS CONTRE LES JUIFS.
- CELLE DES CROISADES CONTRE LES ALBIGEOIS.
- LES VÊPRES SICILIENNES.
- LES TEMPLIERS.
- MASSACRE DANS LE NOUVEAU MONDE.
- CONSPIRATION CONTRE MÉRINDOL.
- CONSPIRATION DE LA ST. BARTHELEMI.
- CONSPIRATION D'IRLANDE.
- CONSPIRATION DANS LES VALLÉES DU PIEMONT.
- CONTRADICTION. [p. 245]
- EXEMPLES TIRÉS DE L'HISTOIRE DE LA SAINTE ECRITURE, DE PLUSIEURS ÉCRIVAINS, DU FAMEUX CURÉ MÊLIER, D'UN PRÉDICANT NOMMÉ ANTOINE, &c.
- DES CONTRADICTIONS DANS QUELQUES RITES.
- DES CONTRADICTIONS DANS LES AFFAIRES ET DANS LES HOMMES.
- DES CONTRADICTIONS DANS LES HOMMES ET DANS LES AFFAIRES.
- DES CONTRADICTIONS APPARENTES DANS LES LIVRES.
- CONTRADICTIONS DANS LES JUGEMENS SUR LES OUVRAGES.
- CONTRASTE. [p. 257]
- CONVULSIONS. [p. 258]
- DES COQUILLES. [p. 259]
- ET DES SYSTEMES BATIS SUR DES COQUILLES.
- AMAS DE COQUILLES.
- OBSERVATION IMPORTANTE SUR LA FORMATION DES PIERRES ET DES COQUILLES.
- DE LA GROTTE DES FÉES.
- DU FALLUN DE TOURAINE ET DE SES COQUILLES.
- IDÉES DE PALISSI SUR LES COQUILLES PRÉTENDUES.
- DU SYSTEME DE MAILLET, QUI DE L'INSPECTION DES COQUILLES CONCLUT QUE LES POISSONS SONT LES PREMIERS PÈRES DES HOMMES.
- CORPS. [p. 272]
- COUTUME. [p. 275]
- DES CRIMES OU DÉLITS. [p. 276]
- CRIMINALISTE. [p. 281]
- CRIMINEL. [p. ibid.]
- CRITIQUE. [p. 288]
- CROIRE. [p. 294]
- CROMWELL. [p. 296]
- C U. [p. 297]
- CUISSAGE OU CULAGE, [p. 299]
- LE CURÉ DE CAMPAGNE. [p. 301]
- SECTION PREMIÈRE.
- SECTION SECONDE.
- DIALOGUE. ARISTON - TÉOTIME.
- CURIOSITÉ. [p. 308]
- CYRUS. [p. 311]
- DAVID. [p. 315]
- DÉFLORATION. [p. 318]
- DÉJECTION. [p. 319]
- DÉLUGE UNIVERSEL. [p. 321]
- DÉMOCRATIE. [p. 324]
- DÉMONIAQUES, [p. 329]
- DE ST. DENIS L'AREOPAGITE, [p. 333]
- DÉNOMBREMENT. [p. 336]
- DESTIN. [p. 340]
- DÉVOT. [p. 343]
- DICTIONNAIRE. [p. 345]
- DIEU. DIEUX. [p. 351]
- SECTION PREMIÈRE.
- LETTRE DE MAXIME DE MADAURE.
- RÉPONSE D'AUGUSTIN.
- D'UNE CALOMNIE DE WARBURTON CONTRE CICERON, AU SUJET D'UN DIEU SUPRÊME.
- LES ROMAINS ONT-ILS PRIS TOUS LEURS DIEUX DES GRECS?
- SECTION SECONDE.
- Examen de Spinosa.
- PROFESSION DE FOI DE SPINOZA.
- DU FONDEMENT DE LA PHILOSOPHIE DE SPINOSA.
- SECTION TROISIÉME.
- Du Systême de la nature.
- Voyez l'article Anguilles . HISTOIRE DES ANGUILLES SUR LESQUELLES EST FONDÉ LE SYSTÊME.
- SECTION QUATRIÉME.
- De la nécessité de croire un Etre suprême.
- AMOUR DE DIEU. [p. 373]
- DE DIODORE DE SICILE, ET D'HÉRODOTE. [p. 373]
- DIRECTEUR. [p. 381]
- DISPUTE. [p. 383]
- DE LA DISTANCE. [p. 391]
- DIVORCE. [p. 397]
- DOGMES. [p. 399]
- DONATIONS. [p. 402]
- DONATION DE CONSTANTIN.
- DONATION DE PEPIN.
- DONATION DE CHARLEMAGNE.
- DONATION DE BENEVENT PAR L'EMPEREUR HENRI III.
- DONATION DE LA COMTESSE MATHILDE.
- DONATION DE LA SUZERAINETÉ DE NAPLES AUX PAPES.
- DONATION DE L'ANGLETERRE ET DE L'IRLANDE AUX PAPES, PAR LE ROI JEAN.
- EXAMEN DE LA VASSALITÉ DE NAPLES ET DE L'ANGLETERRE.
- DES DONATIONS FAITES PAR LES PAPES.
- DONATIONS ENTRE PARTICULIERS.
- LES SEPT DORMANTS. [p. 411]
- DROIT. [p. 412]
- DROIT CANONIQUE. [p. 418]
- IDÉE GÉNÉRALE DU DROIT CANONIQUE, PAR MR. BERTRAND CI-DEVANT PREMIER PASTEUR DE L'ÉGLISE DE BERNE.
- SECTION PREMIÈRE.
- Du ministère ecclésiastique.
- SECTION SECONDE.
- Des possessions des ecclésiastiques.
- SECTION TROISIÉME.
- Des assemblées ecclésiastiques ou religieuses.
- SECTION QUATRIÉME.
- Des peines ecclésiastiques.
- SECTION CINQUIÉME.
- De l'inspection sur le dogme.
- SECTION SIXIÉME.
- Inspection des magistrats fur l'administration des sacremens.
- SECTION SEPTIÉME.
- Jurisdiction des ecclésiastiques.
- EXTRAIT DU TARIF DES DROITS QU'ON PAYE EN FRANCE ...
- DISPENSES DE MARIAGE.
- DU DROIT DE LA GUERRE. [p. 437]
- DRUIDES. [p.446]
- ÉCONOMIE. [p. 448]
- ECONOMIE DE PAROLES. [p. 460]
- ECROUELLES. [p. 465]
- EDUCATION. [p. 467]
- EGALITÉ. [p. 470]
- EGLISE. [p. 474]
- PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE CHRETIENNE.
- DU POUVOIR DE CHASSER LES DIABLES DONNÉ A L'ÉGLISE.
- DES MARTYRS DE L'ÉGLISE.
- DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉGLISE SOUS CONSTANTIN.
- DE LA SIGNIFICATION DU MOT EGLISE. PORTRAIT DE L'ÉGLISE PRIMITIVE. DÉGÉNÉRATION. EXAMEN DES SOCIÉTÉS QUI ONT VOULU RÉTABLIR L'ÉGLISE PRIMITIVE ET PARTICULIÈREMENT DES PRIMITIFS APPELLÉS QUAKERS.
- DU NOM D'EGLISE DANS LES SOCIETÉS CHRÉTIENNES.
- DE LA PRIMITIVE EGLISE, ET DE CEUX QUI ONT CRU LA RÉTABLIR.
- DES PRIMITIFS APPELLÉS QUAKERS.
- QUERELLES ENTRE L'ÉGLISE GRECQUE ET LA LATINE, DANS L'ASIE ET DANS L'EUROPE.
- DE LA PRÉSENTE ÉGLISE GRECQUE.
- EGLOGUE. [p. 504]
- ELIE & ENOCH. [p. 516]
Questions sur l'Encyclopédie, par des Amateurs.
Tome 2 “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”
SOUVERAIN BIEN. [p. 1] ↩
SECTION PREMIÈRE.
Le bien-être est rare. Le souverain bien en ce monde ne pourrait-il pas être regardé comme souverainement chimérique? Les philosophes grecs discutèrent longuement à leur ordinaire cette question. Ne vous imaginez-vous pas, mon cher lecteur, voir des mendiants qui raisonnent sur la pierre philosophale?
Le souverain bien! quel mot! autant aurait-il valu demander ce que c'est que le souverain bleu, ou le souverain ragoût, le souverain marcher, le souverain lire, etc.
Chacun met son bien où il peut, et en a autant qu'il peut à sa façon, et a bien petite mesure.
Quid dem, quid non dem, renuis tu quod jubet alter .
Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem
Pugnis etc.
Castor veut des chevaux, Pollux veut des lutteurs:
Comment concilier tant de goûts, tant d'humeurs!
Le plus grand bien est celui qui vous délecte avec tant de force, qu'il vous met dans l'impuissance totale de sentir autre chose, comme le plus grand mal est celui qui va jusqu'à nous priver de tout sentiment. Voilà les deux extrêmes de la nature humaine, et ces deux moments sont courts.
Il n'y a ni extrêmes délices, ni extrêmes tourments qui puissent durer toute la vie: le souverain bien et le souverain mal sont des chimères.
Nous avons la belle fable de Crantor; il fait comparaître aux jeux olympiques la Richesse, la Volupté, la Santé, la Vertu; chacune demande la pomme: la Richesse dit, C'est moi qui suis le souverain bien, car avec moi on achète tous les biens: la Volupté dit, La pomme m'appartient, car on ne demande la richesse que pour m'avoir: la Santé assure que sans elle il n'y a point de volupté, et que la richesse est inutile: enfin la Vertu représente qu'elle est au-dessus des trois autres, parce qu'avec de l'or, des plaisirs et de la santé, on peut se rendre très misérable si on se conduit mal. La vertu eut la pomme.
La fable est très ingénieuse; elle le serait encore plus si Crantor avait dit que le souverain bien est l'assemblage des quatre rivales réunies, vertu, santé, richesse, volupté: mais cette fable ne résout ni ne peut résoudre la question absurde du souverain bien. La vertu n'est pas un bien: c'est un devoir; elle est d'un genre différent, d'un ordre supérieur. Elle n'a rien à voir aux sensations douloureuses ou agréables. Un homme vertueux avec la pierre et la goutte, sans appui, sans amis, privé du nécessaire, persécuté, enchaîné par un tyran voluptueux qui se porte bien, est très malheureux; et le persécuteur insolent qui caresse une nouvelle maîtresse sur son lit de pourpre est très heureux. Dites que le sage persécuté est préférable à son indigne persécuteur; dites que vous aimez l'un, et que vous détestez l'autre; mais avouez que le sage dans les fers enrage. Si le sage n'en convient pas, il vous trompe, c'est un charlatan. [49]
BIENS D'ÉGLISE. [p. 4] ↩
L'Evangile défend à ceux qui veulent atteindre à la perfection, Matth. ch. VI, v. 19 d'amasser des trésors et de conserver leurs biens temporels. Nolite ibid v. 25. thesaurisare vobis thesauros in terra. -- Si vis perfectus esse, vade, ibid v. 29. vende quae habes, et da pauperibus. -- Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut sorores, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit .
Les apôtres et leurs premiers successeurs ne recevaient aucun immeuble, ils n'en acceptaient que le prix; et après avoir prélevé ce qui était nécessaire pour leur subsistance, ils distribuaient le reste aux pauvres. Saphire et Ananie ne donnèrent pas leurs biens à St Pierre, mais ils le vendirent et lui en apportèrent le prix. Vende quae habes et da pauperibus .
L'Eglise possédait déjà des biens-fonds considérables sur la fin du troisième siècle, puisque Dioclétien et Maximien en prononcèrent la confiscation en 302.
Dès que Constantin fut sur le trône des Césars, il permit de doter les églises comme l'étaient les temples de l'ancienne religion; et dès lors l'Eglise acquit de riches terres. St Jérôme s'en plaignit dans une de ses lettres à Eustochie: ‘Quand vous les voyez, dit-il, aborder d'un air doux et sanctifié les riches veuves qu'ils rencontrent, vous croiriez que leur main ne s'étend que pour leur donner des bénédictions, mais c'est au contraire pour recevoir le prix de leur hypocrisie.'
Les saints prêtres recevaient sans demander. Valentinien I er crut devoir défendre aux ecclésiastiques de rien recevoir des veuves et des femmes par testament, ni autrement. Cette loi, que l'on trouve au Code Théodosien , fut révoquée par Martien et par Justinien.
Justinien, pour favoriser les ecclésiastiques, défendit aux juges par sa novelle XVIII, chap. II, d'annuler les testaments faits en faveur de l'Eglise, quand même ils ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par les lois.
Anastase avait statué en 491, que les biens d'Eglise se prescriraient Cod. tit. de fund. patrimon . Cod. loi XXIV de sacro sanctis ecclesiis . par quarante ans. Justinien inséra cette loi dans son code; mais ce prince qui changea continuellement la jurisprudence, étendit cette prescription à cent ans. Alors quelques ecclésiastiques, indignes de leur profession, supposèrent de faux titres; ils tirèrent de la poussière de vieux testaments, nuls selon les anciennes lois, mais valables suivant les nouvelles. Les citoyens étaient dépouillés de leur patrimoine par la fraude. Les possessions qui jusque-là avaient été regardées comme sacrées, furent envahies par l'Eglise. Enfin, l'abus fut si criant, que Justinien lui-même fut obligé de rétablir les dispositions de la loi d'Anastase par sa novelle CXXXI, chap. VI.
Les tribunaux français ont longtemps adopté le chap. XI de la novelle XVIII, quand les legs faits à l'Eglise n'avaient pour objet que des sommes d'argent, ou des effets mobiliers; mais depuis l'ordonnance de 1735 les legs pieux n'ont plus ce privilège en France.
Pour les immeubles, presque tous les rois de France depuis Philippe le Hardi, ont défendu aux églises d'en acquérir sans leur permission. Mais la plus efficace de toutes les lois, c'est l'édit de 1749, rédigé par le chancelier d'Aguesseau. Depuis cet édit, l'Eglise ne peut recevoir aucun immeuble, soit par donation, par testament, ou par échange, sans lettres patentes du roi enregistrées au parlement.
SECTION SECONDE.
Les biens d'Eglise pendant les cinq premiers siècles de notre ère, furent régis par des diacres qui en faisaient la distribution aux clercs et aux pauvres. Cette communauté n'eut plus lieu dès la fin du cinquième siècle; on partagea les biens de l'Eglise en quatre parts; on en donna une aux évêques, une autre aux clercs, une autre à la fabrique, et la quatrième fut assignée aux pauvres.
Bientôt après ce partage, les évêques se chargèrent seuls des quatre portions; et c'est pourquoi le clergé inférieur est en général très pauvre.
Le parlement de Toulouse rendit un arrêt le 18 avril 1651, qui ordonnait que dans trois jours les évêques du ressort pourvoiraient à la nourriture des pauvres, passé lequel temps saisie serait faite du sixième de tous les fruits que les évêques prennent dans les paroisses dudit ressort, etc.
En France l'Eglise n'aliène pas valablement ses biens sans de grandes formalités, et si elle ne trouve pas de l'avantage dans l'aliénation, on juge que l'on peut prescrire sans titre, par une possession de quarante ans, les biens d'Eglise; mais s'il paraît un titre, et qu'il soit défectueux, c'est-à-dire, que toutes les formalités n'y aient pas été observées, l'acquéreur, ni ses héritiers ne peuvent jamais prescrire. Et de là cette maxime, melius est non habere titulum, quam habere vitiosum . On fonde cette jurisprudence sur ce que l'on présume que l'acquéreur dont le titre n'est pas en forme est de mauvaise foi, et que suivant les canons, un possesseur de mauvaise foi ne peut jamais prescrire. Mais celui qui n'a point de titres ne devrait-il pas plutôt être présumé usurpateur? Peut-on prétendre que le défaut d'une formalité que l'on a ignorée soit une présomption de mauvaise foi? Doit-on dépouiller le possesseur sur cette présomption? Doit-on juger que le fils qui a trouvé un domaine dans l'hoirie de son père, le possède avec mauvaise foi, parce que celui de ses ancêtres qui acquit ce domaine n'a pas rempli une formalité?
Les biens de l'Eglise nécessaires au maintien d'un ordre respectable, ne sont point d'une autre nature que ceux de la noblesse et du tiers état; les uns et les autres devraient être assujettis aux mêmes règles. On se rapproche aujourd'hui autant qu'on le peut de cette jurisprudence équitable.
Il semble que les prêtres et les moines qui aspirent à la perfection Matth. ch. V, v. 40. évangélique, ne devraient jamais avoir des procès; et ei qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium .
St Basile entend sans doute parler de ce passage, lorsqu'il dit, Homel. de legend. graec. De gubern. Dei lib. III . pag. 47. édit. de Paris 1645. qu'il y a dans l'Evangile une loi expresse, qui défend aux chrétiens d'avoir jamais aucun procès. Salvien a entendu de même ce passage. Jubet Christus ne litigemus nec solum jubet, sed in tantum hoc jubet ut ipsa nos de quibus lis est, relinquere jubeat, dummodo litibus exuamur .
Le quatrième concile de Carthage a aussi réitéré ces défenses. Episcopus nec provocatus de rebus transitoriis litiget .
Mais d'un autre côté il n'est pas juste qu'un évêque abandonne ses droits; il est homme, il doit jouir du bien que les hommes lui ont donné; il ne faut pas qu'on le vole parce qu'il est prêtre.
( Ces deux sections sont de M. Christin célèbre avocat au parlement de Besançon, qui s'est fait une réputation immortelle dans son pays, en plaidant pour abolir la servitude . )
DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, DES ABBAYES EN COMMANDE, ET DES MOINES QUI ONT DES ESCLAVES.
Section troisième
Il en est de la pluralité des gros bénéfices, archevêchés, évêchés, abbayes, de trente, quarante, cinquante, soixante mille florins d'Empire, comme de la pluralité des femmes; c'est un droit qui n'appartient qu'aux hommes puissants.
Un prince de l'Empire, cadet de sa maison, serait bien peu chrétien s'il n'avait qu'un seul évêché; il lui en faut quatre ou cinq pour constater sa catholicité. Mais un pauvre curé qui n'a pas de quoi vivre, ne peut guère parvenir à deux bénéfices; du moins rien n'est plus rare.
Le pape qui disait qu'il était dans la règle; qu'il n'avait qu'un seul bénéfice, et qu'il s'en contentait avait très grande raison.
On a prétendu qu'un nommé Ebrouin évêque de Poitiers, fut le premier qui eut à la fois une abbaye et un évêché. L'empereur Charles le Chauve lui fit ces deux présents. L'abbaye était celle de St Germain-des-Près-les-Paris. C'étit un gros morceau, mais pas si gros qu'aujourd'hui.
Avant cet Ebrouin nous voyons force gens d'Eglise posséder plusieurs abbayes.
Alcuin diacre, favori de Charlemagne, possédait à la fois celles de St Martin-de-Tours, de Ferrières, de Comeri et quelques autres. On ne saurait trop en avoir; car si on est un saint, on édifie plus d'âmes; et si on a le malheur d'être un honnête homme du monde, on vit plus agréablement.
Il se pourrait bien que dès ce temps-là ces abbés fussent commandataires; car ils ne pouvaient réciter l'office dans sept ou huit endroits à la fois. Charles Martel et Pépin son fils, qui avaient pris pour eux tant d'abbayes, n'étaient pas des abbés réguliers.
Quelle est la différence entre un abbé commandataire et un abbé qu'on appelle régulier ? La même qu'entre un homme qui a cinquante mille écus de rente pour se réjouir, et un homme qui a cinquante mille écus pour gouverner.
Ce n'est pas qu'il ne soit loisible aux abbés réguliers de se réjouir aussi. Voici comme s'exprimait sur leur douce joie Jean Trithême dans une de ses harangues, en présence d'une convocation d'abbés bénédictins.
Neglecto superum cultu spretoque tonantis
Imperio, Baccho indulgent venerique nefandae, etc.
En voici une traduction, ou plutôt une imitation faite par une bonne âme, quelque temps après Jean Trithême.
Ils se moquent du ciel et de la Providence,
Ils aiment mieux Bacchus et la mère d'amour;
Ce sont leurs deux grands saints pour la nuit et le jour.
Des pauvres à prix d'or ils vendent la substance.
Ils s'abreuvent dans l'or, l'or est sur leurs lambris;
L'or est sur leurs catins qu'on paye au plus haut prix.
Et passant mollement de leur lit à la table,
Ils ne craignent ni lois, ni rois, ni dieu, ni diable.
Jean Trithême, comme on voit, était de très méchante humeur. On eût pu lui répondre ce que disait César avant les ides de mars, Ce n'est pas ces voluptueux que je crains, ce sont ces raisonneurs maigres et pâles . Les moines qui chantent le pervigilium veneris pour matines, ne sont pas dangereux. Les moines argumentants, prêchants, cabalants, ont fait beaucoup plus de mal que tous ceux dont parle Jean Trithême.
Les moines ont été aussi maltraités par l'évêque célèbre du Bellai qu'ils l'avaient été par l'abbé Trithême. Il leur appplique, dans son Apocalypse de Méliton, ces paroles d'Osée: Vaches grasses qui frustrez les pauvres, qui dites sans cesse, Apportez et nous boirons, le Seigneur a juré par son saint nom que voici les jours qui viendront sur vous; vous aurez agacement de dents et disette de pain en toutes vos maisons .
La prédiction ne s'est pas accomplie; mais l'esprit de police qui s'est répandu dans toute l'Europe en mettant des bornes à la cupidité des moines, leur a inspiré plus de décence.
Il faut convenir malgré tout ce qu'on a écrit contre leurs abus, qu'il y a toujours eu parmi eux des hommes éminents en science et en vertu; que s'ils ont fait de grands maux ils ont rendu de grands services, et qu'en général on doit les plaindre encore plus que les condamner.
DES BIENS DE L'ÉGLISE.
Section quatrième.
Tous les abus grossiers qui durèrent dans la distribution des bénéfices depuis le dixième siècle jusqu'au seizième, ne subsistent plus aujourd'hui; s'ils sont inséparables de la nature humaine, ils sont beaucoup moins révoltants par la décence qui les couvre. Un Maillard ne dirait plus aujourd'hui en chaire, O domina quae facitis placitum domini episcopi etc. O madame qui faites le plaisir de monsieur l'évêque; si vous demandez comment cet enfant de dix ans a eu un bénéfice, on vous répondra que madame sa mère était fort privée de monsieur l'évêque .
On n'entend plus en chaire un cordelier Menot criant, Deux crosses, deux mîtres, et adhuc non sunt contenti. Entre vous, mesdames, qui faites à monsieur l'évêque le plaisir que savez, oh oh! il fera du bien à mon fils, ce sera un des mieux pourvus en l'Eglise, isti protonotarii qui habent illas dispensas ad tria, immò in quindecim beneficia, et sunt simoniaci et sacrilegi: et non cessant arripere beneficia, incompatibilia: idem est eis. Si vacet episcopatus, pro eo habendo dabitur unus grossus fasciculus aliorum beneficiorum. Primò accumulabuntur archidiaconatus, abbatiae, duo prioratus, quatuor aut quinque praebendae, et dabuntur haec omnia pro recompensatione .
Si ces protonotaires qui ont des dispenses pour trois, ou même quinze bénéfices, sont simoniaques et sacrilèges, et si on ne cesse d'accrocher des bénéfices incompatibles, c'est même chose pour eux. Il vaque un bénéfice; pour l'avoir on vous donnera une poignée d'autres bénéfices, un archidiaconat, des abbayes, deux prieurés, quatre ou cinq prébendes, et tout cela pour faire la compensation.
Le même prédicateur dans un autre endroit s'exprime ainsi: ‘Dans quatre plaideurs qu'on rencontre au palais, il y a toujours un moine; et si on leur demande ce qu'ils font là, un cléricus répondra, Notre chapitre est bandé contre le doyen, contre l'évêque et contre les autres officiers, et je vais après les queues de ces messieurs pour cette affaire. Et toi, maître moine, que fais-tu ici? Je plaide une abbaye de huit cents livres de rente pour mon maître. Et toi, moine blanc? Je plaide un petit prieuré pour moi. Et vous, mendiants, qui n'avez terre, ni sillon, que battez-vous ici le pavé? Le roi nous a octroyé du sel, du bois et autres choses: mais ses officiers les nous dénient. Ou bien, un tel curé par son avarice et envie nous veut empêcher la sépulture et la dernière volonté d'un qui est mort ces jours passés, tellement qu'il nous est force d'en venir à la cour.'
Il est vrai que ce dernier abus, dont retentissent tous les tribunaux de l'Eglise catholique romaine, n'est point déraciné.
Il en est un plus funeste encore, c'est celui d'avoir permis aux bénédictins, aux bernardins, aux chartreux même, d'avoir des mainmortables, des esclaves. On distingue sous leur domination dans plusieurs provinces de France et en Allemagne,
Esclavage de la personne,
Esclavage des biens,
Esclavage de la personne et des biens.
L'esclavage de la personne consiste dans l'incapacité de disposer de ses biens en faveur de ses enfants, s'ils n'ont pas toujours vécu avec leur père dans la même maison et à la même table. Alors tout appartient aux moines. Le bien d'un habitant du mont Jura mis entre les mains d'un notaire de Paris, devient dans Paris même la proie de ceux qui originairement avaient embrassé la pauvreté évangélique au mont Jura. Le fils demande l'aumône à la porte de la maison que son père a bâtie; et les moines, bien loin de lui donner cette aumône, s'arrogent jusqu'au droit de ne point payer les créanciers du père, et de regarder comme nulles les dettes hypothéquées sur la maison dont ils s'emparent. La veuve se jette en vain à leurs pieds pour obtenir une partie de sa dot. Cette dot, ces créances, ce bien paternel, tout appartient de droit divin aux moines. Les créanciers, la veuve, les enfants, tout meurt dans la mendicité.
L'esclavage réel est celui qui est affecté à une habitation. Quiconque vient occuper une maison dans l'empire de ces moines, et y demeure un an et un jour, devient leur serf pour jamais. Il est arrivé quelquefois qu'un négociant français, père de famille, attiré par ses affaires dans ce pays barbare, y ayant pris une maison à loyer pendant une année, et étant mort ensuite dans sa patrie, dans une autre province de France, sa veuve, ses enfants ont été tout étonnés de voir des huissiers venir s'emparer de leurs meubles, avec des paréatis, les vendre au nom de St Claude, et chasser une famille entière de la maison de son père.
L'esclavage mixte est celui qui étant composé des deux, est ce que la rapacité a jamais inventé de plus exécrable, et ce que les brigands n'oseraient pas même imaginer.
Il y a donc des peuples chrétiens gémissant dans un triple esclavage sous des moines qui ont fait voeu d'humilité et de pauvreté! chacun demande comment les gouvernements souffrent ces fatales contradictions? C'est que les moines sont riches; et leurs esclaves sont pauvres. C'est que les moines, pour conserver leur droit d' attila , font des présents aux commis, aux maîtresses de ceux qui pourraient interposer leur autorité pour réprimer une telle oppression. Le fort écrase toujours le faible. Mais pourquoi faut-il que les moines soient les plus forts?
Quel horrible état que celui d'un moine dont le couvent est riche! la comparaison continuelle qu'il fait de sa servitude et de sa misère avec l'empire et l'opulence de l'abbé, du prieur, du procureur, du secrétaire, du maître des bois etc, lui déchire l'âme. . . à l'église et au réfectoire. Il maudit le jour où il prononça ses voeux imprudents et absurdes: il se désespère; il voudrait que tous les hommes fussent aussi malheureux que lui. S'il a quelque talent pour contrefaire les écritures, il l'emploie en faisant de fausses chartes pour plaire au sous-prieur; il accable les paysans qui ont le malheur inexprimable d'être vassaux d'un couvent: étant devenu bon faussaire, il parvient aux charges: et comme il est fort ignorant, il meurt dans le doute et dans la rage.
TOUT EST BIEN. [p. 11] ↩
Je vous prie, messieurs, de m'expliquer le tout est bien , car je ne l'entends pas.
Cela signifie-t-il, tout est arrangé , tout est ordonné , suivant la théorie des forces mouvantes? je comprends et je l'avoue.
Entendez-vous que chacun se porte bien, qu'il a de quoi vivre, et que personne ne souffre? vous savez combien cela est faux.
Votre idée est-elle que les calamités lamentables qui affligent la terre sont bien par rapport à Dieu et le réjouissent? Je ne crois point cette horreur, ni vous non plus.
De grâce, expliquez-moi le tout est bien . Platon le raisonneur daigna laisser à Dieu la liberté de faire cinq mondes, par la raison, dit-il, qu'il n'y a que cinq corps solides réguliers en géométrie, le tétraèdre, le cube, l'hexaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre. Mais pourquoi resserrer ainsi la puissance divine? pourquoi ne lui pas permettre la sphère, qui est encore plus régulière, et même le cône, la pyramide à plusieurs faces, le cylindre? etc.
Dieu choisit, selon lui, nécessairement le meilleur des mondes possibles; ce système a été embrassé par plusieurs philosophes chrétiens, quoiqu'il semble répugner au dogme du péché originel. Car notre globe, après cette transgression, n'est plus le meilleur des globes; il l'était auparavant: il pourrait donc l'être encore; et bien des gens croient qu'il est le pire des globes, au lieu d'être le meilleur.
Leibnitz, dans sa Théodicée , prit le parti de Platon. Plus d'un lecteur s'est plaint de n'entendre pas plus l'un que l'autre; pour nous, après les avoir lus tous deux plus d'une fois, nous avouons notre ignorance, selon notre coutume: et puisque l'Evangile ne nous a rien révélé sur cette question, nous demeurons sans remords dans nos ténèbres.
Leibnitz qui parle de tout, a parlé du péché originel aussi; et comme tout homme à système fait entrer dans son plan tout ce qui peut le contredire, il imagina que la désobéissance envers Dieu, et les malheurs épouvantables qui l'ont suivie, étaient des parties intégrantes du meilleur des mondes, des ingrédients nécessaires de toute la félicité possible. Calla calla señor don Carlos: todo che se haze e por su ben .
Quoi! être chassé d'un lieu de délices, où l'on aurait vécu à jamais, si on n'avait pas mangé une pomme? Quoi! faire dans la misère, des enfants misérables et criminels qui souffriront tout, qui feront tout souffrir aux autres? Quoi! éprouver toutes les maladies, sentir tous les chagrins, mourir dans la douleur, et pour rafraîchissement être brûlé dans l'éternité des siècles; ce partage est-il bien ce qu'il y avait de meilleur? Cela n'est pas trop bon pour nous; et en quoi cela peut-il être bon pour Dieu?
Leibnitz sentait qu'il n'y avait rien à répondre; aussi fit-il de gros livres dans lesquels il ne s'entendait pas.
Nier qu'il y ait du mal, cela peut être dit en riant par un Lucullus qui se porte bien et qui fait un bon dîner avec ses amis et sa maîtresse dans le salon d'Apollon; mais, qu'il mette la tête à la fenêtre, il verra des malheureux; qu'il ait la fièvre, il le sera lui-même.
Je n'aime point à citer; c'est d'ordinaire une besogne épineuse; on néglige ce qui précède et ce qui suit l'endroit qu'on cite, et on s'expose à mille querelles. Il faut pourtant que je cite Lactance, Père de l'Eglise, qui dans son chap. XIII de la Colère de Dieu , fait parler ainsi Epicure: ‘Ou Dieu veut ôter le mal de ce monde, et ne le peut: ou il le peut, et ne le veut pas; ou il ne le peut, ni ne le veut; ou enfin il le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut pas, c'est impuissance, ce qui est contraire à la nature de Dieu; s'il le peut et ne le veut pas, c'est méchanceté, et cela est non moins contraire à sa nature; s'il ne le veut ni ne le peut, c'est à la fois méchanceté et impuissance; s'il le veut et le peut (ce qui seul de ces parties convient à Dieu), d'où vient donc le mal sur la terre?'
L'argument est pressant, aussi Lactance y répond fort mal, en disant que Dieu veut le mal, mais qu'il nous a donné la sagesse avec laquelle on acquiert le bien. Il faut avouer que cette réponse est bien faible en comparaison de l'objection; car elle suppose que Dieu ne pouvait donner la sagesse qu'en produisant le mal; et puis, nous avons une plaisante sagesse!
L'origine du mal a toujours été un abîme dont personne n'a pu voir le fond. C'est ce qui réduisit tant d'anciens philosophes et des législateurs à recourir à deux principes, l'un bon, l'autre mauvais. Typhon était le mauvais principe chez les Egyptiens, Arimane chez les Perses. Les manichéens adoptèrent, comme on sait, cette théologie; mais comme ces gens-là n'avaient jamais parlé ni au bon, ni au mauvais principe, il ne faut pas les en croire sur leur parole.
Parmi les absurdités dont ce monde regorge, et qu'on peut mettre au nombre de nos maux, ce n'est pas une absurdité légère, que d'avoir supposé deux êtres tout-puissants, se battant à qui des deux mettrait plus du sien dans ce monde, et faisant un traité comme les deux médecins de Molière: Passez-moi l'émétique, et je vous passerai la saignée.
Basilide, après les platoniciens, prétendit, dès le premier siècle de l'Eglise, que Dieu avait donné notre monde à faire à ses derniers anges; et que ceux-ci n'étant pas habiles, firent les choses telles que nous les voyons. Cette fable théologique tombe en poussière par l'objection terrible, qu'il n'est pas dans la nature d'un Dieu tout-puissant et tout sage, de faire bâtir un monde par des architectes qui n'y entendent rien.
Simon qui a senti l'objection, la prévient en disant, que l'ange qui présidait à l'atelier est damné pour avoir si mal fait son ouvrage; mais la brûlure de cet ange ne nous guérit pas.
L'aventure de Pandore chez les Grecs, ne répond pas mieux à l'objection. La boîte où se trouvent tous les maux, et au fond de laquelle reste l'espérance, est à la vérité une allégorie charmante; mais cette Pandore ne fut faite par Vulcain que pour se venger de Prométhée, qui avait fait un homme avec de la boue.
Les Indiens n'ont pas mieux rencontré; Dieu ayant créé l'homme, il lui donna une drogue qui lui assurait une santé permanente; l'homme chargea son âne de la drogue, l'âne eut soif, le serpent lui enseigna une fontaine, et pendant que l'âne buvait, le serpent prit la drogue pour lui.
Les Syriens imaginèrent que l'homme et la femme ayant été créés dans le quatrième ciel, ils s'avisèrent de manger d'une galette, au lieu de l'ambroisie qui était leur mets naturel. L'ambroisie s'exhalait par les pores, mais après avoir mangé de la galette, il fallait aller à la selle. L'homme et la femme prièrent un ange de leur enseigner où était la garde-robe. Voyez-vous, leur dit l'ange, cette petite planète, grande comme rien, qui est à quelque soixante millions de lieues d'ici, c'est là le privé de l'univers, allez-y au plus vite: ils y allèrent, on les y laissa; et c'est depuis ce temps que notre monde fut ce qu'il est.
On demandera toujours aux Syriens, pourquoi Dieu permit que l'homme mangeât la galette, et qu'il nous en arrivât une foule de maux si épouvantables?
Je passe vite de ce quatrième ciel à milord Bolingbroke, pour ne pas m'ennuyer. Cet homme, qui avait sans doute un grand génie, donna au célèbre Pope son plan du tout est bien , qu'on retrouve en effet mot pour mot dans les oeuvres posthumes de milord Bolingbroke, et que milord Shaftsbury avait auparavant inséré dans ses Caractéristiques . Lisez dans Shaftsbury le chapitre des moralistes , vous y verrez ces paroles:
‘On a beaucoup à répondre à ces plaintes des défauts de la nature. Comment est-elle sortie si impuissante et si défectueuse des mains d'un être parfait? mais je nie qu'elle soit défectueuse. . . sa beauté résulte des contrariétés, et la concorde universelle naît d'un combat perpétuel. . . Il faut que chaque être soit immolé à d'autres; les végétaux aux animaux, les animaux à la terre. . . et les lois du pouvoir central et de la gravitation, qui donnent aux corps célestes leur poids et leur mouvement, ne seront point dérangées pour l'amour d'un chétif animal, qui tout protégé qu'il est par ces mêmes lois, sera bientôt par elles réduit en poussière.'
Bolingbroke, Shaftsbury, et Pope leur metteur en oeuvre, ne résolvent pas mieux la question que les autres: leur tout est bien , ne veut dire autre chose, sinon que le tout est dirigé par des lois immuables; qui ne le sait pas? vous ne nous apprenez rien quand vous remarquez après tous les petits enfants, que les mouches sont nées pour être mangées par des araignées, les araignées par les hirondelles, les hirondelles par les pies-grièches, les pies-grièches par les aigles, les aigles pour être tués par les hommes, les hommes pour se tuer les uns les autres, et pour être mangés par les vers, et ensuite par les diables, au moins mille sur un.
Voilà un ordre net et constant parmi les animaux de toute espèce; il y a de l'ordre partout. Quand une pierre se forme dans ma vessie, c'est une mécanique admirable, des sucs pierreux passent petit à petit dans mon sang, ils se filtrent dans les reins, passent par les urètres, se déposent dans ma vessie, s'y assemblent par une excellente attraction newtonienne; le caillou se forme, se grossit, je souffre des maux mille fois pires que la mort, par le plus bel arrangement du monde; un chirurgien ayant perfectionné l'art inventé par Tubal-Caïn, vient m'enfoncer un fer aigu et tranchant dans le périnée, saisit ma pierre avec ses pincettes, elle se brise sous ses efforts par un mécanisme nécessaire; et par le même mécanisme je meurs dans des tourments affreux; tout cela est bien , tout cela est la suite évidente des principes physiques inaltérables, j'en tombe d'accord, et je le savais comme vous.
Si nous étions insensibles, il n'y aurait rien à dire à cette physique. Mais ce n'est pas cela dont il s'agit; nous vous demandons s'il n'y a point de maux sensibles, et d'où ils viennent? Il n'y a point de maux , dit Pope dans sa quatrième épître sur le tout est bien; s'il y a des maux particuliers, ils composent le bien général .
Voilà un singulier bien général, composé de la pierre, de la goutte, de tous les crimes, de toutes les souffrances, de la mort, et de la damnation.
La chute de l'homme est l'emplâtre que nous mettons à toutes ces maladies particulières du corps et de l'âme, que vous appelez santé générale ; mais Shaftsbury et Bolingbroke ont osé attaquer le péché originel; Pope n'en parle point; il est clair que leur système sape la religion chrétienne par ses fondements, et n'explique rien du tout.
Cependant, ce système a été approuvé depuis peu par plusieurs théologiens, qui admettent volontiers les contraires; à la bonne heure, il ne faut envier à personne la consolation de raisonner comme il peut sur le déluge de maux qui nous inonde. Il est juste d'accorder aux malades désespérés, de manger de ce qu'ils veulent. On a été jusqu'à prétendre que ce système est consolant. Dieu , dit Pope, voit d'un même oeil périr le héros et le moineau, un atome, ou mille planètes précipitées dans la ruine, une boule de savon, ou un monde se former .
Voilà, je vous l'avoue, une plaisante consolation; ne trouvez-vous pas un grand lénitif dans l'ordonnance de milord Shaftsbury, qui dit que Dieu n'ira pas déranger ses lois éternelles pour un animal aussi chétif que l'homme? Il faut avouer du moins que ce chétif animal a droit de crier humblement, et de chercher à comprendre en criant, pourquoi ces lois éternelles ne sont pas faites pour le bien-être de chaque individu?
Ce système du tout est bien , ne représente l'auteur de toute la nature, que comme un roi puissant et malfaisant, qui ne s'embarrasse pas qu'il en coûte la vie à quatre ou cinq cent mille hommes, et que les autres traînent leurs jours dans la disette et dans les larmes, pourvu qu'il vienne à bout de ses desseins.
Loin donc que l'opinion du meilleur des mondes possibles console, elle est désespérante pour les philosophes qui l'embrassent. La question du bien et du mal, demeure un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de bonne foi; c'est un jeu d'esprit pour ceux qui disputent; ils sont des forçats qui jouent avec leurs chaînes. Pour le peuple non pensant, il ressemble assez à des poissons qu'on a transportés d'une rivière dans un réservoir; ils ne se doutent pas qu'ils sont là pour être mangés le carême; aussi ne savons-nous rien du tout par nous-mêmes des causes de notre destinée.
Mettons à la fin de presque tous les chapitres de métaphysique les deux lettres des juges romains quand ils n'entendaient pas une cause, N. L. non liquet , cela n'est pas clair. Imposons surtout silence aux scélérats, qui étant accablés comme nous du poids des calamités humaines, y ajoutent la fureur de la calomnie. Confondons leurs exécrables impostures, en recourant à la foi et à la Providence. Copions la fin de l'épître en vers sur le désastre de Lisbonne:[50]
Mon malheur, dites-vous, est le bien d'un autre être.
De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître:
Quand la mort met le comble aux maux que j'ai soufferts,
Le beau soulagement d'être mangé des vers!
Tristes calculateurs des misères humaines,
Ne me consolez point; vous aigrissez mes peines:
Et je ne vois en vous que l'effort impuissant
D'un fier infortuné qui feint d'être content.
Je ne suis du grand Tout qu'une faible partie:
Oui; mais les animaux condamnés à la vie,
Tous les êtres sentants nés sous la même loi,
Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.
Le vautour acharné sur sa timide proie,
De ses membres sanglants se repaît avec joie:
Tout semble bien pour lui, mais bientôt à son tour
Une aigle au bec tranchant dévore le vautour.
L'homme d'un plomb mortel atteint cette aigle altière;
Et l'homme aux champs de Mars couché sur la poussière,
Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants,
Sert d'aliment affreux aux oiseaux dévorants.
Ainsi du monde entier tous les membres gémissent;
Nés tous pour les torments, l'un par l'autre ils périssent:
Et vous composerez, dans ce chaos fatal,
Des malheurs de chaque être un bonheur général?
Quel bonheur! ô mortel, superbe et misérable!
Vous criez, Tout est bien , d'une voix lamentable.
L'univers vous dément, et votre propre coeur
Cent fois de votre esprit a réfuté l'erreur.
Eléments, animaux, humains, tout est en guerre.
Il le faut avouer, le mal est sur la terre:
Son principe secret ne nous est point connu.
De l'auteur de tout bien le mal est-il venu?
Est-ce le noir Typhon,[51] le barbare Arimane, [52]
Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne?
Mon esprit n'admet point ces monstres odieux,
Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.
Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même,
Qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime,
Et qui versa sur eux les maux à pleines mains?
Quel oeil peut pénétrer dans ses profonds desseins?
De l'Etre tout-parfait le mal ne pouvait naître:
Il ne vient point d'autrui,[53] puisque Dieu seul est maître.
Il existe pourtant. O tristes vérités!
O mélange étonnant de contrariétés!
Un Dieu vint consoler notre race affligée;
Il visita la terre, et ne l'a point changée; [54]
Un sophiste arrogant nous dit qu'il ne l'a pu;
Il le pouvait, dit l'autre, et ne l'a pas voulu;
Il le voudra sans doute. Et tandis qu'on raisonne,
Des foudres souterrains engloutissent Lisbonne,
Et de trente cités dispersent les débris,
Des bords sanglants du Tage à la mer de Cadis.
Ou l'homme est né coupable, et Dieu punit sa race,
Ou ce maître absolu de l'être et de l'espace,
Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent,
De ses premiers décrets suit l'éternel torrent:
Ou la matière informe à son maître rebelle,
Porte en soi des défauts nécessaires comme elle;
Ou bien Dieu nous éprouve; et ce séjour mortel[55]
N'est qu'un passage étroit vers un monde éternel.
Nous essuyons ici des douleurs passagères.
Le trépas est un bien qui finit nos misères.
Mais quand nous sortirons de ce passage affreux,
Qui de nous prétendra mériter d'être heureux?
Quelque parti qu'on prenne, on doit frémir sans doute.
Il n'est rien qu'on connaisse, et rien qu'on ne redoute.
La nature est muette, on l'interroge en vain.
On a besoin d'un Dieu, qui parle au genre humain.
Il n'appartient qu'à lui d'expliquer son ouvrage,
De consoler le faible, et d'éclairer le sage.
L'homme au doute, à l'erreur, abandonné sans lui,
Cherche en vain des roseaux qui lui servent d'appui.
Leibnitz ne m'apprend point, par quels noeuds invisibles
Dans le mieux ordonné des univers possibles,
Un désordre éternel, un chaos de malheurs,
Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs;
Ni pourquoi l'innocent, ainsi que le coupable,
Subit également ce mal inévitable;
Je ne conçois pas plus comment tout serait bien :
Je suis comme un docteur, hélas! je ne sais rien.
Platon dit qu'autrefois l'homme avait eu des ailes,
Un corps impénétrable aux atteintes mortelles;
La douleur, le trépas, n'approchaient point de lui.
De cet état brillant qu'il diffère aujourd'hui!
Il rampe, il souffre, il meurt, tout ce qui naît expire;
De la destruction la nature est l'empire.
Un faible composé de nerfs et d'ossements
Ne peut être insensible au choc des éléments;
Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre,
Puisqu'il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre.
Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats
Fut soumis aux douleurs ministres du trépas.
C'est-là ce que m'apprend la voix de la nature.
J'abandonne Platon, je rejette Epicure.
Bayle en sait plus qu'eux tous: je vais le consulter:
La balance à la main, Bayle enseigne à douter. [56]
Assex sage, assez grand, pour être sans système,
Il les a tous détruits, et se combat lui-même:
Semblable à cet aveugle en butte aux Philistins,
Qui tomba sous les murs abattus par ses mains.
Que peut donc de l'esprit la plus vaste étendue?
Rien: le livre du sort se ferme à notre vue.
L'homme étranger à soi, de l'homme est ignoré.
Que suis-je? où suis-je? où vais-je? et d'où suis-je tiré? [57]
Atomes tourmentés sur cet amas de boue,
Que la mort engloutit, et dont le sort se joue,
Mais atomes pensants, atomes dont les yeux
Guidés par la pensée ont mesuré les cieux;
Au sein de l'infini nous élançons notre être,
Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.
Ce monde, ce théâtre, et d'orgueil et d'erreur,
Est plein d'infortunés qui parlent de bonheur.
Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être;
Nul ne voudrait mourir; nul ne voudrait renaître. [58]
Quelquefois dans nos jours consacrés aux douleurs,
Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs.
Mais le plaisir s'envole, et passe comme une ombre,
Nos chagrins, nos regrets, nos pertes sont sans nombre.
Le passé n'est pour nous qu'un triste souvenir;
Le présent est affreux, s'il n'est point d'avenir,
Si la nuit du tombeau détruit l'être qui pense.
Un jour tout sera bien , voilà notre espérance;
Tout est bien aujourd'hui , voilà l'illusion.
Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison.
Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance,
Je ne m'élève point contre la Providence.
Sur un ton moins lugubre on me vit autrefois,
Chanter des doux plaisirs les séduisantes lois.
D'autres temps, d'autres moeurs: instruit par la vieillesse,
Des humains égarés partageant la faiblesse,
Dans une épaisse nuit cherchant à m'éclairer,
Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer.
Un calife autrefois à son heure dernière,
Au Dieu qu'il adorait dit pour toute prière:
Je t'apporte, ô seul roi, seul Etre illimité ,
Tout ce que tu n'as point dans ton immensité ,
Les défauts, les regrets, les maux et l'ignorance .
Mais il pouvait encore ajouter l' espérance .
Des raisonneurs ont prétendu qu'il n'est pas dans la nature de l'Etre des êtres que les choses soient autrement qu'elles sont. C'est un rude système, je n'en sais pas assez pour oser seulement l'examiner.
BLASPHÈME. [p. 21] ↩
C'est un mot grec qui signifie, atteinte à la réputation. Blasphemia se trouve dans Démosthène. De là vient, dit Ménage, le mot de blâmer. Blasphème ne fut employé dans l'Eglise grecque que pour signifier injure faite à Dieu . Les Romains n'employèrent jamais cette expression, ne croyant pas apparemment qu'on pût jamais offenser l'honneur de Dieu comme on offense celui des hommes.
Il n'y a presque point de synonyme. Blasphème n'emporte pas tout à fait l'idée de sacrilège . On dira d'un homme qui aura pris le nom de Dieu en vain, qui dans l'emportement de la colère aura ce qu'on appelle juré le nom de Dieu , c'est un blasphémateur; mais on ne dira pas, c'est un sacrilège. L'homme sacrilège est celui qui se parjure sur l'Evangile; qui étend sa rapacité sur les choses consacrées, qui détruit les autels, qui trempe sa main dans le sang des prêtres.
Les grands sacrilèges ont toujours été punis de mort chez toutes les nations, et surtout les sacrilèges avec effusion de sang.
L'auteur des Instituts au droit criminel , compte parmi les crimes de lèse-majesté divine au second chef, l'inobservation des fêtes et des dimanches. Il devait ajouter l'inobservation accompagnée d'un mépris marqué; car la simple négligence est un péché, mais non pas un sacrilège, comme il le dit. Il est absurde de mettre dans le même rang, comme fait cet auteur, la simonie, l'enlèvement d'une religieuse, et l'oubli d'aller à vêpres un jour de fête. C'est un grand exemple des erreurs où tombent les jurisconsultes, qui n'ayant pas été appelés à faire des lois, se mêlent d'interpréter celles de l'Etat.
Les blasphèmes prononcés dans l'ivresse, dans la colère, dans l'excès de la débauche, dans la chaleur d'une conversation indiscrète, ont été soumis par les législateurs à des peines beaucoup plus légères. Par exemple, l'avocat que nous avons déjà cité, dit que les lois de France condamnent les simples blasphémateurs à une amende pour la première fois, double pour la seconde, triple pour la troisième, quadruple pour la quatrième. Le coupable est mis au carcan pour la cinquième récidive, au carcan encore pour la sixième, et la lèvre supérieure est coupée avec un fer chaud; et pour la septième fois on lui coupe la langue. Il fallait ajouter que c'est l'ordonnance de 1666.
Les peines sont presque toujours arbitraires; c'est un grand défaut dans la jurisprudence. Mais aussi ce défaut ouvre une porte à la clémence, à la compassion; et cette compassion est d'une justice étroite; car il serait horrible de punir un emportement de jeunesse, comme on punit des empoisonneurs et des parricides. Une sentence de mort pour un délit qui ne mérite qu'une correction, n'est qu'un assassinat commis avec le glaive de justice.
N'est-il pas à propos de remarquer ici que ce qui fut blasphème dans un pays, fut souvent piété dans un autre?
Un marchand de Tyr abordé au port de Canope, aura pu être scandalisé de voir porter en cérémonie un oignon, un chat, un bouc; il aura pu parler indécemment d'Isheth, d'Oshireth, et d'Horeth; il aura peut-être détourné la tête, et ne se sera point mis à genoux en voyant passer en procession les parties génitales du genre humain plus grandes que nature. Il en aura dit son sentiment à souper, il aura même chanté une chanson dans laquelle les matelots tyriens se moquaient des absurdités égyptiaques. Une servante de cabaret l'aura entendu; sa conscience ne lui permet pas de cacher ce crime énorme. Elle court dénoncer le coupable au premier shoen qui porte l'image de la vérité sur la poitrine; et on sait comment l'image de la vérité est faite. Le tribunal des shoen ou shotim condamne le blasphémateur tyrien à une mort affreuse et confisque son vaisseau. Ce marchand était regardé à Tyr comme un des plus pieux personnages de la Phénicie.
Numa voit que sa petite horde de Romains est un ramas de flibustiers latins qui volent à droite et à gauche tout ce qu'ils trouvent, boeufs, moutons, volailles, filles. Il leur dit qu'il a parlé à la nymphe Egérie dans une caverne, et que la nymphe lui a donné des lois de la part de Jupiter. Les sénateurs le traitent d'abord de blasphémateur, et le menacent de le jeter de la roche Tarpéienne la tête en bas. Numa se fait un parti puissant. Il gagne des sénateurs qui vont avec lui dans la grotte d'Egérie. Elle leur parle; elle les convertit. Ils convertissent le sénat et le peuple. Bientôt ce n'est plus Numa qui est un blasphémateur. Ce nom n'est plus donné qu'à ceux qui doutent de l'existence de la nymphe.
Il est triste parmi nous que ce qui est blasphème à Rome, à Notre-Dame de Lorette, dans l'enceinte des chanoines de San Gennaro, soit piété dans Londres, dans Amsterdam, dans Stockholm, dans Berlin, dans Copenhague, dans Berne, dans Bâle, dans Hambourg. Il est encore plus triste que dans le même pays, dans la même ville, dans la même rue, on se traite réciproquement de blasphémateur.
Que dis-je, des dix mille Juifs qui sont à Rome, il n'y en a pas un seul qui ne regarde le pape comme le chef de ceux qui blasphèment; et réciproquement les cent mille chrétiens qui habitent Rome à la place des deux millions de joviens [59] qui la remplissaient du temps de Trajan, croient fermement que les Juifs s'assemblent les samedis dans leurs synagogues pour blasphémer.
Un cordelier accorde sans difficulté le titre de blasphémateur au dominicain, qui dit que la Sainte Vierge est née dans le péché originel, quoique les dominicains aient une bulle du pape qui leur permet d'enseigner dans leurs couvents la conception maculée; et qu'outre cette bulle ils aient pour eux la déclaration expresse de St Thomas d'Aquin.
La première origine de la scission, faite dans les trois quarts de la Suisse et dans une partie de la Basse-Allemagne, fut une querelle dans l'église cathédrale de Francfort entre un cordelier dont j'ignore le nom et un dominicain nommé Vigand.
Tous deux étaient ivres, selon l'usage de ce temps-là. L'ivrogne cordelier qui prêchait, remercia Dieu dans son sermon de ce qu'il n'était pas jacobin, jurant qu'il fallait exterminer les jacobins blasphémateurs qui croyaient la Sainte Vierge née en péché mortel et délivrée du péché par les seuls mérites de son fils: l'ivrogne jacobin lui dit tout haut, Vous en avez menti, blasphémateur vous-même. Le cordelier descend de chaire un grand crucifix de fer à la main, en donne cent coups à son adversaire et le laisse presque mort sur la place.
Ce fut pour venger cet outrage que les dominicains firent beaucoup de miracles en Allemagne, et en Suisse. Ils prétendaient prouver leur foi par ces miracles. Enfin ils trouvèrent le moyen de faire imprimer dans Berne les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ à un de leurs frères laïcs nommé Jetzer; ce fut la Sainte Vierge elle-même qui lui fit cette opération; mais elle emprunta la main du sous-prieur qui avait pris un habit de femme, et entouré sa tête d'une auréole. Le malheureux petit frère laïc exposé tout en sang sur l'autel des dominicains de Berne à la vénération du peuple, cria enfin au meurtre, au sacrilège: les moines, pour l'apaiser, le communièrent au plus vite avec une hostie saupoudrée de sublimé corrosif; l'excès de l'acrimonie lui fit rejeter l'hostie. [60]
Les moines alors l'accusèrent devant l'évêque de Lausanne d'un sacrilège horrible. Les Bernois indignés accusèrent eux-mêmes les moines, quatre d'entre eux furent brûlés à Berne le 31 mai 1509 à la porte de Marsilly.
C'est ainsi que finit cette abominable histoire qui détermina enfin les Bernois à choisir une religion (mauvaise à la vérité à nos yeux catholiques,) mais dans laquelle ils seraient délivrés des cordeliers et des jacobins.
La foule de semblables sacrilèges est incroyable. C'est à quoi l'esprit de parti conduit.
Les jésuites ont soutenu pendant cent ans que les jansénistes étaient des blasphémateurs, et l'ont prouvé par mille lettres de cachet. Les jansénistes ont répondu par plus de quatre mille volumes, que c'était les jésuites qui blasphémaient. L'écrivain des gazettes ecclésiastiques prétend que toutes les honnêtes gens blasphèment contre lui; et il blasphème du haut de son grenier contre tous les honnêtes gens du royaume. Le libraire du gazetier blasphème contre lui et se plaint de mourir de faim. Il vaudrait mieux être poli et honnête.
Une chose aussi remarquable que consolante, c'est que jamais en aucun pays de la terre chez les idolâtres les plus fous, aucun homme n'a été regardé comme un blasphémateur pour avoir reconnu un Dieu suprême, éternel et tout-puissant. Ce n'est pas sans doute pour avoir reconnu cette vérité qu'on fit boire la ciguë à Socrate, puisque le dogme d'un Dieu suprême était annoncé dans tous les mystères de la Grèce. Ce fut une faction qui perdit Socrate. On l'accusa au hasard de ne pas reconnaître les dieux secondaires; ce fut sur cet article qu'on le traita de blasphémateur.
On accusa de blasphème les premiers chrétiens par la même raison; mais les partisans de l'ancienne religion de l'empire, les joviens, qui reprochaient le blasphème aux premiers chrétiens, furent enfin condamnés eux-mêmes comme blasphémateurs sous Théodose II. Driden a dit:
This side to day and the other to morrow burn's
And they are all god's al mithy in their turn's .
Tel est chaque parti, dans sa rage obstiné,
Aujourd'hui condamnant et demain condamné.
BLED OU BLÉ. [p. 26] ↩
SECTION PREMIÈRE
Origine du mot, & de la chose
Il faut être pyrrhonien outré pour douter que pain vienne de panis . Mais pour faire du pain il faut du blé. Les Gaulois avaient du blé du temps de César; où avaient-ils pris ce mot de blé ? On prétend que c'est de bladum , mot employé dans la latinité barbare du moyen âge, par le chancelier Desvignes, de Vineis , à qui l'empereur Frédéric II fit, dit-on, crever les yeux.
Mais les mots latins de ces siècles barbares n'étaient que d'anciens mots celtes ou tudesques latinisés. Bladum venait donc de notre blead ; et non pas notre blead de bladum . Les Italiens disaient biada ; et les pays, où l'ancienne langue romance s'est conservée, disent encore blia .
Cette science n'est pas infiniment utile: mais on serait curieux de savoir où les Gaulois et les Teutons avaient trouvé du blé pour le semer? On vous répond que les Tyriens en avaient apporté en Espagne, les Espagnols en Gaule, et les Gaulois en Germanie. Et où les Tyriens avaient-ils pris ce blé? Chez les Grecs probablement, dont ils l'avaient reçu en échange de leur alphabet.
Qui avait fait ce présent aux Grecs? C'était autrefois Cérès sans doute; et quand on a remonté à Cérès, on ne peut guère aller plus haut. Il faut que Cérès soit descendue exprès du ciel pour nous donner du froment, du seigle, de l'orge, etc.
Mais comme le crédit de Cérès qui donna le blé aux Grecs, et celui d'Ishet ou Isis qui en gratifia l'Egypte, est fort déchu aujourd'hui, nous restons dans l'incertitude sur l'origine du blé.
Sanchoniaton assure que Dagon ou Dagan, l'un des petits-fils de Thaut, avait en Phénicie l'intendance du blé. Or son Thaut est à peu près du temps de notre Jared. Il résulte de là que le blé est fort ancien, et qu'il est de la même antiquité que l'herbe. Peut-être que ce Dagon fut le premier qui fit du pain, mais cela n'est pas démontré.
Chose étrange! nous savons positivement que nous avons l'obligation du vin à Noé, et nous ne savons pas à qui nous devons le pain. Et, chose encore plus étrange, nous sommes si ingrats envers Noé, que nous avons plus de deux mille chansons en l'honneur de Bacchus, et qu'à peine en chantons-nous une seule en l'honneur de Noé, notre bienfaiteur.
Un juif m'a assuré que le blé venait de lui-même en Mésopotamie, comme les pommes, les poires sauvages, les châtaignes, les nèfles dans l'Occident. Je le veux croire jusqu'à ce que je sois sûr du contraire; car enfin il faut bien que le blé croisse quelque part. Il est devenu la nourriture ordinaire et indispensable dans les plus beaux climats et dans tout le Nord.
De grands philosophes dont nous estimons les talents, et dont nous ne suivons point les systèmes, ont prétendu, dans l' Histoire naturelle du chien (pag.195) que les hommes ont fait le blé; que nos pères à force de semer de l'ivraie et du gramen, les ont changés en froment. Comme ces philosophes ne sont pas de notre avis sur les coquilles, ils nous permettront de n'être pas du leur sur le blé. Nous ne pensons pas qu'avec du jasmin on ait jamais fait venir des tulipes. Nous trouvons que le germe du blé est tout différent de celui de l'ivraie, et nous ne croyons à aucune transmutation. Quand on nous en montrera nous nous rétracterons.
Nous avons vu à l'article Arbre-à-pain , qu'on on ne mange point de pain dans les trois quarts de la terre. On prétend que les Ethiopiens se moquaient des Egyptiens qui vivaient de pain. Mais enfin, puisque c'est notre nourriture principale, le blé est devenu un des plus grands objets du commerce et de la politique. On a tant écrit sur cette matière, que si un laboureur semait autant de Blé pesant que nous avons de volumes sur cette denrée, il pourrait espérer la plus ample récolte, et devenir plus riche que ceux qui dans leurs salons vernis et dorés ignorent l'excès de sa peine et de sa misère.
SECTION SECONDE.
Richesse du blé.
Dès qu'on commence à balbutier en économie politique, on fait comme font dans notre rue tous les voisins et les voisines qui demandent: Combien a-t-il de rentes, comment vit-il, combien sa fille aura-t-elle en mariage, etc.? On demande en Europe: L'Allemagne a-t-elle plus de blés que la France? L'Angleterre recueille-t-elle (et non pas récolte-t-elle) de plus belles moissons que l'Espagne? Le blé de Pologne produit-il autant de farine que celui de Sicile? La grande question est de savoir si un pays purement agricole est plus riche qu'un pays purement commerçant?
La supériorité du pays de blé est démontrée par le livre aussi petit que plein de M. Melon, le premier homme qui ait raisonné en France, par la voie de l'imprimerie, immédiatement après la déraison universelle du système de Lass. Melon a pu tomber dans quelques erreurs relevées par d'autres écrivains instruits, dont les erreurs ont été relevées à leur tour. En attendant qu'on relève les miennes, voici le fait.
L'Egypte devint la meilleure terre à froment de l'univers, lorsqu'après plusieurs siècles qu'il est difficile de compter au juste, les habitants eurent trouvé le secret de faire servir à la fécondité du sol un fleuve destructeur, qui avait toujours inondé le pays, et qui n'était utile qu'aux rats d'Egypte, aux insectes, aux reptiles et aux crocodiles. Son eau même mêlée d'une bourbe noire ne pouvait désaltérer ni laver les habitants. Il fallut des travaux immenses, et un temps prodigieux pour dompter le fleuve, le partager en canaux, fonder des villes dans un terrain autrefois mouvant, et changer les cavernes des rochers en vastes bâtiments.
Tout cela est plus étonnant que des pyramides; tout cela fait, voilà un peuple sûr de sa nourriture avec le meilleur blé du monde, sans même avoir presque besoin de labourer. La voilà qui élève et qui engraisse de la volaille supérieure à celle de Caux. Il est vêtu du plus beau lin dans le climat le plus tempéré. Il n'a donc aucun besoin réel des autres peuples.
Les Arabes ses voisins au contraire ne recueillent pas un setier de blé depuis le désert qui entoure le lac de Sodome et qui va jusqu'à Jérusalem, jusqu'au voisinage de l'Euphrate, à l'Yemen, et à la terre de Gad; ce qui compose un pays quatre fois plus étendu que l'Egypte. Ils disent: Nous avons des voisins qui ont tout le nécessaire; allons dans l'Inde leur chercher du superflu; portons-leur du sucre, des aromates, des épiceries, des curiosités; soyons les pourvoyeurs de leurs fantaisies, et ils nous donneront de la farine. Ils en disent autant des Babyloniens; ils s'établissent courtiers de ces deux nations opulentes, qui regorgent de blé; et en étant toujours leurs serviteurs, ils restent toujours pauvres. Memphis et Babilone jouissent; les Arabes les servent; la terre à blé demeure toujours la seule riche; le superflu de son froment attire les métaux, les parfums, les ouvrages d'industrie. Le possesseur du blé impose donc toujours la loi à celui qui a besoin de pain. Et Midas aurait donné tout son or à un laboureur de Picardie.
La Hollande paraît de nos jours une exception, et n'en est point une. Les vicissitudes de ce monde ont tellement tout bouleversé, que les habitants d'un marais persécutés par l'océan qui les menaçait de les noyer, et par l'Inquisition qui apportait des fagots pour les brûler, allèrent au bout du monde s'emparer des îles qui produisent des épiceries devenues aussi nécessaires aux riches que le pain l'est aux pauvres. Les Arabes vendaient de la myrrhe, du baume, et des perles à Memphis et à Babilone: les Hollandais vendent de tout à l'Europe et à l'Asie, et mettent le prix à tout.
Ils n'ont point de blé, dites-vous; ils en ont plus que l'Angleterre et la France. Qui est réellement possesseur du blé? C'est le marchand qui l'achète du laboureur. Ce n'était pas le simple agriculteur de Caldée ou d'Egypte qui profitait beaucoup de son froment. C'était le marchand chaldéen ou l'Egyptien adroit qui en faisait des amas, et les vendait aux Arabes; il en retirait des aromates, des perles, des rubis, qu'il vendait chèrement aux riches. Tel est le Hollandais; il achète partout et revend partout; il n'y a point pour lui de mauvaise récolte; il est toujours prêt à secourir pour de l'argent ceux qui manquent de farine.
Que trois ou quatre négociants entendus, libres, sobres, à l'abri de toute vexation, exempts de toute crainte, s'établissent dans un port; que leurs vaisseaux soient bons, que leur équipage sache vivre de gros fromage et de petite bière, qu'ils fassent acheter à bas prix du froment à Dantzick et à Tunis, qu'ils sachent le conserver, qu'ils sachent attendre; et ils feront précisément ce que font les Hollandais.
SECTION TROISIÉME.
Histoire du blé en France.
Dans les anciens gouvernements ou anciennes anarchies barbares, il y eut je ne sais quel seigneur ou roi de Soissons qui mit tant d'impôts sur les laboureurs, les batteurs en grange, les meuniers, que tout le monde s'enfuit, et le laissa sans pain régner tout seul à son aise. [61]
Comment fit-on pour avoir du blé, lorsque les Normands, qui n'en avaient pas chez eux, vinrent ravager la France et l'Angleterre, lorsque les guerres féodales achevèrent de tout detruire; lorsque ces brigandages féodaux se mêlèrent aux irruptions des Anglais, quand Edouard III détruisit les moissons de Philippe de Valois, et Henri V celles de Charles VI; quand les armées de Charles-Quint et celles de Henri VIII mangeaient la Picardie; enfin tandis que les bons catholiques et les bons réformés coupaient le blé en herbe, et égorgeaient pères, mères et enfants, pour savoir si on devait se servir de pain fermenté ou de pain azyme les dimanches?
Comment on faisait? Le peuple ne mangeait pas la moitié de son besoin; on se nourrissait très mal; on périssait de misère; la population était très médiocre; des cités étaient désertes.
Cependant vous voyez encore de prétendus historiens qui vous répètent que la France possédait vingt-neuf millions d'habitants du temps de la St-Barthélemi.
C'est apparemment sur ce calcul que l'abbé de Caveirac a fait l'apologie de la St-Barthélemi il a prétendu que le massacre de soixante et dix mille hommes, plus ou moins, était une bagatelle dans un royaume alors florissant, peuplé de vingt-neuf millions d'hommes, qui nageaient dans l'abondance.
Cependant la vérité est que la France avait peu d'hommes et peu de blé; et qu'elle était excessivement misérable, ainsi que l'Allemagne.
Dans le court espace du règne enfin tranquille de Henri IV, pendant l'administration économe du duc de Sulli, les Français en 1597 eurent une abondante récolte; ce qu'ils n'avaient pas vu depuis qu'ils étaient nés. Aussitôt ils vendirent tout leur blé aux étrangers, qui n'avaient pas fait de si heureuses moissons, ne doutant pas que l'année 1598 ne fût encore meilleure que la précédente. Elle fut très mauvaise; le peuple alors fut dans le cas de Mlle Bernard qui avait vendu ses chemises et ses draps pour acheter un collier; elle fut obligée de vendre son collier à perte pour avoir des draps et des chemises. Le peuple pâtit davantage. On racheta chèrement le même blé qu'on avait vendu à un prix médiocre.
Pour prévenir une telle imprudence et un tel malheur, le ministère défendit l'exportation; et cette loi ne fut point révoquée. Mais sous Henri IV, sous Louis XIII et sous Louis XIV, non seulement la loi fut souvent éludée, mais quand le gouvernement était informé que les greniers étaient bien fournis, il expédiait des permissions particulières sur le compte qu'on lui rendait de l'état des provinces. Ces permissions firent souvent murmurer le peuple; les marchands de blé furent en horreur comme des monopoleurs, qui voulaient affamer une province. Quand il arrivait une disette, elle était toujours suivie de quelque sédition. On accusait le ministère plutôt que la sécheresse ou la pluie.
Cependant année commune, la France avait de quoi se nourrir, et quelquefois de quoi vendre. On se plaignit toujours; (et il faut se plaindre pour qu'on vous suce un peu moins) mais la France depuis 1661 jusqu'au commencement du dix-huitième siècle fut au plus haut point de grandeur. Ce n'était pas la vente de son blé qui la rendait si puissante; c'était son excellent vin de Bourgogne, de Champagne et de Bordeaux, le débit de ses eaux-de-vie dans tout le Nord, de son huile, de ses fruits, de son sel, de ses toiles, de ses draps, des magnifiques étoffes de Lyon et même de Tours, de ses rubans, de ses modes de toute espèce, enfin des progrès de l'industrie. Le pays est si bon, le peuple si laborieux, que la révocation de l'édit de Nantes ne put faire périr l'Etat. Il n'y a peut-être pas une preuve plus convaincante de sa force.
Le blé resta toujours à vil prix: la main-d'oeuvre par conséquent ne fut pas chère; le commerce prospéra; et on cria toujours contre la dureté du temps.
La nation ne mourut pas de la disette horrible de 1709; elle fut très malade; mais elle réchappa. Nous ne parlons ici que du blé qui manqua absolument; il fallut que les Français en achetassent de leurs ennemis mêmes; les Hollandais en fournirent seuls autant que les Turcs.
Quelques désastres que la France ait éprouvés; quelques succès qu'elle ait eus; que les vignes aient gelé, ou qu'elles aient produit autant de grappes que dans la Jérusalem céleste, le prix du blé a toujours été assez uniforme; et, année commune, un setier de blé a toujours payé quatre paires de souliers depuis Charlemagne.
Vers l'an 1750 la nation rassasiée de vers, de tragédies, de comédies, d'opéras, de romans, d'histoires romanesques, de réflexions morales plus romanesques encore, et de disputes théologiques sur la grâce et les convulsions, se mit enfin à raisonner sur les blés.
On oublia même les vignes pour ne parler que de froment et de seigle. On écrivit des choses utiles sur l'agriculture: tout le monde les lut, excepté les laboureurs. On supposa, au sortir de l'Opéra Comique, que la France avait prodigieusement de blé à vendre. Enfin le cri de la nation obtint du gouvernement, en 1764, la liberté de l'exportation.
Aussitôt on exporta. Il arriva précisément ce qu'on avait éprouvé du temps de Henri IV; on vendit un peu trop; une année stérile survint; il fallut pour la seconde fois que Mlle Bernard revendît son collier pour ravoir ses draps et ses chemises. Alors quelques plaignants passèrent d'une extrémité à l'autre. Ils éclatèrent contre l'exportation qu'ils avaient demandée: ce qui fait voir combien il est difficile de contenter tout le monde et son père.
Des gens de beaucoup d'esprit, et d'une bonne volonté sans intérêt, avaient écrit avec autant de sagacité que de courage en faveur de la liberté illimitée du commerce des grains. Des gens qui avaient autant d'esprit et des vues aussi pures, écrivirent dans l'idée de limiter cette liberté; et M. l'abbé Gagliani Napolitain, réjouit la nation française sur l'exportation des blés; il trouva le secret de faire, même en français, des dialogues aussi amusants que nos meilleurs romans, et aussi instructifs que nos meilleurs livres sérieux. Si cet ouvrage ne fit pas diminuer le prix du pain, il donna beaucoup de plaisir à la nation, ce qui vaut beaucoup mieux pour elle. Les partisans de l'exportation illimitée lui répondirent vertement. Le résultat fut que les lecteurs ne surent plus où ils en étaient: la plupart se mirent à lire des romans en attendant trois ou quatre années abondantes de suite qui les mettraient en état de juger. Les dames ne surent pas distinguer davantage le froment du seigle. Les habitués de paroisse continuèrent de croire que le grain doit mourir et pourrir en terre pour germer.
SECTIONN QUATRIÉME.
Des blés d'Angleterre.
Les Anglais, jusqu'au dix-septième siècle, furent des peuples chasseurs et pasteurs, plutôt qu'agriculteurs. La moitié de la nation courait le renard en selle rase avec un bridon: l'autre moitié nourrissait des moutons et préparait les laines. Les sièges des pairs ne sont encore que de gros sacs de laine, pour les faire souvenir qu'ils doivent protéger la principale denrée du royaume. Ils commencèrent à s'apercevoir au temps de la restauration qu'ils avaient aussi d'excellentes terres à froment. Ils n'avaient guère jusqu'alors labouré que pour leurs besoins. Les trois quarts de l'Irlande se nourrissaient de pommes de terre appelées alors potâtôs , et par les Français topinambous , et ensuite pommes de terre . La moitié de l'Ecosse ne connaissait point le blé. Il courait une espèce de proverbe en vers anglais assez plaisants, dont voici le sens.
Si l'époux d'Eve la féconde
Au pays d'Ecosse était né,
A demeurer chez lui Dieu l'aurait condamné,
Et non pas à courir le monde.
L'Angleterre fut le seul des trois royaumes qui défricha quelques champs, mais en petite quantité. Il est vrai que ces insulaires mangent le plus de viande, le plus de légumes et le moins de pain qu'ils peuvent. Le manoeuvre auvergnat et limousin dévore quatre livres de pain qu'il trempe dans l'eau, tandis que le manoeuvre anglais en mange à peine une avec du fromage; et boit d'une bière aussi nourrissante que dégoûtante, qui l'engraisse.
On peut encore, sans raillerie, ajouter à ces raisons l'énorme quantité de farine dont les Français ont chargé longtemps leur tête. Ils portaient des perruques volumineuses hautes d'un demi-pied sur le front, et qui descendaient jusqu'aux hanches. Seize onces d'amidon saupoudraient seize onces de cheveux étrangers, qui cachaient dans leur épaisseur le buste d'un petit homme; de sorte que dans une farce, où un maître à chanter du bel air, nommé M. Des Soupirs, secouait sa perruque sur le théâtre, on était inondé pendant un quart d'heure d'un nuage de poudre. Cette mode s'introduisit en Angleterre, mais les Anglais épargnèrent l'amidon.
Pour venir à l'essentiel, il faut savoir qu'en 1689, la première année du règne de Guillaume et de Marie, un acte du parlement accorda une gratification à quiconque exporterait du blé, et même de mauvaises eaux-de-vie de grain sur les vaisseaux de la nation.
Voici comme cet acte, favorable à la navigation et à la culture, fut conçu.
Quand une mesure nommée quarter , égale à vingt-quatre boisseaux de Paris, n'excédait pas en Angleterre la valeur de deux livres sterling huit shelings au marché, le gouvernement payait à l'exportateur de ce quarter cinq shelings = 6 l de France. à l'exportateur du seigle quand il ne valait qu'une livre sterling et douze shelings, on donnait de récompense trois shelings et six sous = 3 l 12 s. de France.
Le reste dans une proportion assez exacte.
Quand le prix des grains haussait, la gratification n'avait plus lieu; quand ils étaient plus chers, l'exportation n'était plus permise. Ce règlement a éprouvé quelques variations; mais enfin le résultat a été un profit immense. On a vu par un extrait de l'exportation des grains présenté à la Chambre des Communes en 1751, que l'Angleterre en avait vendu aux autres nations en cinq années pour 7, 405, 786 liv. sterling, qui font cent soixante et dix millions trois cent trente-trois mille soixante et dix-huit livres de France. Et sur cette somme que l'Angleterre tira de l'Europe en cinq années, la France en paya environ dix millions et demi.
L'Angleterre devait sa fortune à sa culture qu'elle avait trop longtemps négligée; mais aussi elle la devait à son terrain. Plus sa terre a valu, plus elle s'est encore améliorée. On a eu plus de chevaux, de boeufs et d'engrais. Enfin on prétend qu'une récolte abondante peut nourrir l'Angleterre cinq ans, et qu'une même récolte peut à peine nourrir la France deux années.
Mais aussi la France a presque le double d'habitants; et en ce cas l'Angleterre n'est que d'un cinquième plus riche en blés, pour nourrir la moitié moins d'hommes: ce qui est bien compensé par les autres denrées, et par les manufactures de la France.
SECTION CINQUIÉME.
Mémoire court sur les autres pays.
L'Allemagne est comme la France; elle a des provinces fertiles en blé, et d'autres stériles; les pays voisins du Rhin et du Danube, la Bohême, sont les mieux partagés. Il n'y a guère de grand commerce de grains que dans l'intérieur.
La Turquie ne manque jamais de blé, et en vend peu. L'Espagne en manque quelquefois, et n'en vend jamais. Les côtes d'Afrique en ont, et en vendent. La Pologne en est toujours bien fournie et n'en est pas plus riche.
Les provinces méridionales de la Russie en regorgent; on le transporte à celles du Nord avec beaucoup de peine; on en peut faire un grand commerce par Riga.
La Suède ne recueille du froment qu'en Scanie; le reste ne produit que du seigle; les provinces septentrionales rien.
Le Dannemarck peu.
L'Ecosse encore moins.
La Flandre autrichienne est bien partagée.
En Italie tous les environs de Rome, depuis Viterbe jusqu'à Terracine, sont stériles. Le Bolonois, dont les papes se sont emparés, parce qu'il était à leur bienséance, est presque la seule province qui leur donne du pain abondamment.
Les Vénitiens en ont à peine de leur crû pour le besoin, et sont souvent obligés d'acheter des firmans à Constantinople, c'est-à-dire, des permissions de manger. C'est leur ennemi et leur vainqueur qui est leur pourvoyeur.
Le Milanais est la terre promise en supposant que la terre promise avait du froment.
La Sicile se souvient toujours de Cérès; mais on prétend qu'on n'y cultive pas aussi bien la terre que du temps d'Hiéron qui donnait tant de blé aux Romains. Le royaume de Naples est bien moins fertile que la Sicile, et la disette s'y fait sentir quelquefois, malgré San Gennaro.
Le Piémont est un des meilleurs pays.
La Savoie a toujours été pauvre et le sera.
La Suisse n'est guère plus riche; elle a peu de froment; il y a des cantons qui en manquent absolument.
Un marchand de blé peut se régler sur ce petit mémoire; et il sera ruiné, à moins qu'il ne s'informe au juste de la récolte de l'année, et du besoin du moment.
Resumé.
Suivez le précepte d'Horace: ayez toujours une année de blé par devers vous; provisae frugis in annum .
BLÉ. [p. 37] ↩
GRAMMAIRE MORALE.
Section seconde.
On dit proverbialement, manger son blé en herbe; être pris comme dans un blé; crier famine sur un tas de blé . Mais de tous les proverbes que cette production de la nature et de nos soins a fournis, il n'en est point qui mérite plus l'attention des législateurs que celui-ci.
Ne nous remets pas au gland quand nous avons du blé.
Cela signifie une infinité de bonnes choses, comme par exemple:
Ne nous gouverne pas dans le dix-huitième siècle comme on gouvernait du tems d'Albouin, de Gondebald, de Clodevik nommé en latin Clodovaeus.
Ne parle plus des lois de Dagobert, quand nous avons les oeuvres du chancelier d'Aguesseau, les discours de MM. les gens du roi, Montclar, Servan, Castillon, la Chalotais, Du Paty, etc.
Ne nous cite plus les miracles de St Amable, dont les gants et le chapeau furent portés en l'air pendant tout le voyage qu'il fit à pied du fond de l'Auvergne à Rome.
Laisse pourrir tous les livres remplis de pareilles inepties, songe dans quel siècle nous vivons.
Si jamais on assassine à coups de pistolet un maréchal d'Ancre; ne fais point brûler sa femme en qualité de sorcière sous prétexte que son médecin italien lui a ordonné de prendre du bouillon fait avec un coq blanc, tué au clair de la lune, pour la guérir de ses vapeurs.
Distingue toujours les honnêtes gens qui pensent, de la populace qui n'est pas faite pour penser.
Si l'usage t'oblige à faire une cérémonie ridicule en faveur de cette canaille, et si en chemin tu rencontres quelques gens d'esprit, avertis-les par un signe de tête; par un coup d'oeil que tu penses comme eux; mais qu'il ne faut pas rire.
Affaiblis peu à peu toutes les superstitions anciennes, et n'en introduis aucune nouvelle.
Les lois doivent être pour tout le monde; mais laisse chacun suivre ou rejeter à son gré ce qui ne peut être fondé que sur un usage indifférent.
Si la servante de Bayle meurt entre tes bras, ne lui parle point comme à Bayle; ni à Bayle comme à sa servante.
Si les imbéciles veulent encore du gland, laisse-les en manger; mais trouve bon qu'on leur présente du pain.
En un mot, ce proverbe est excellent en mille occasions.
BOEUF APIS. [p. 38] ↩
Il a été agité si le boeuf Apis était révéré à Memphis comme dieu, comme symbole, ou comme boeuf. Il est à croire que les fanatiques voyaient en lui un dieu, les sages un simple symbole, et que le sot peuple adorait le boeuf. Cambyse fit-il bien quand il eut conquis l'Egypte, de tuer ce boeuf de sa main? Pourquoi non? Il faisait voir aux imbéciles qu'on pouvait mettre leur dieu à la broche, sans que la nature s'armât pour venger ce sacrilège. Hérodote ajoute qu'il fit bien fouetter les prêtres; il avait tort, si ces prêtres avaient été de bonnes gens qui se fussent contentés de gagner leur pain dans le culte d'Apis, sans molester les citoyens. Mais s'ils avaient été persécuteurs, s'ils avaient forcé les consciences, s'ils avaient établi une espèce d'inquisition et violé le droit naturel, Cambyse avait un autre tort, c'était celui de ne les pas faire pendre.
On a fort vanté les Egyptiens: il faut pourtant qu'il y ait toujours eu dans leur caractère, et dans leur gouvernement un vice radical, qui en a toujours fait de vils esclaves.
Je consens que dans les temps presque inconnus, ils aient conquis la terre; mais dans les temps de l'histoire ils ont été subjugués par tous ceux qui s'en sont voulu donner la peine, par les Assyriens, par les Grecs, par les Romains, par les Arabes, par les Mammelus, par les Turcs, enfin par tout le monde, excepté par nos croisés, attendu que ceux-ci étaient plus malavisés que les Egyptiens n'étaient lâches. Ce fut la milice des Mammelus qui battit les Français. Il n'y a peut-être que deux choses passables dans cette nation; la première, que ceux qui adoraient un boeuf ne voulurent jamais contraindre ceux qui adoraient un singe, à changer de religion, quoique les boeufs-lâtres et les singes-lâtres se haïssent vivement; la seconde, qu'ils ont fait toujours éclore des poulets dans des fours.
On vante leurs pyramides; mais ce sont des monuments d'un peuple esclave. Il faut bien qu'on y ait fait travailler toute la nation, sans quoi on n'aurait pu venir à bout d'élever ces vilaines masses. A quoi servaient-elles? A conserver dans une petite chambre la momie de quelque prince ou de quelque gouverneur, ou de quelque intendant que son âme devait ranimer au bout de mille ans, on a dit même au bout de trois mille. Mais s'ils espéraient cette résurrection des corps, pourquoi leur ôter la cervelle avant de les embaumer? Les Egyptiens devaient-ils ressusciter sans cervelle? L'observatoire que fit bâtir Louis XIV, me paraît un plus beau monument que les pyramides, parce qu'il est plus utile.
BOIRE À LA SANTÉ. [p. 39] ↩
D'où vient cette coutume? est-ce depuis le temps qu'on boit? Il paraît naturel qu'on boive du vin pour sa propre santé, mais non pas pour la santé d'un autre.
Le propino des Grecs, adopté par les Romains, ne signifiait pas, je bois afin que vous vous portiez bien; mais je bois avant vous pour que vous buviez; je vous invite à boire.
Dans la joie d'un festin on buvait pour célébrer sa maîtresse, et non pas pour qu'elle eût une bonne santé. Voyez dans Martial,
Naevia sex cyathis, septem Justina bibatur.
Six coups pour Nevia, sept au moins pour Justine.
Les Anglais qui se sont piqués de renouveler plusieurs coutumes de l'antiquité, boivent à l'honneur des dames; c'est ce qu'ils appellent toster ; et c'est parmi eux un grand sujet de dispute si une femme est tostable ou non, si elle est digne qu'on la toste.
On buvait à Rome pour les victoires d'Auguste, pour le retour de sa santé. Dion Cassius rapporte qu'après la bataille d'Actium le sénat décréta que dans les repas on lui ferait des libations au second service. C'est un étrange décret. Il est plus vraisemblable que la flatterie avait introduit volontairement cette bassesse. Quoi qu'il en soit, vous lisez dans Horace,
Hinc ad vina redit laetus, et alteris
Te mensis adhibet Deum .
Te multa prece, te prosequitur mero
Defuso pateris: et laribus tuum
Miscet numen, uti Graecia Castoris ,
Et magni memor Herculis .
Longas ô utinam, dux bone, ferias
Praestes hesperiae: dicimus integro
Sicci mane die, dicimus uvidi ,
Quum sol oceano subest .
Sois le dieu des festins, le dieu de l'allégresse,
Que nos tables soient tes autels.
Préside à nos jeux solennels
Comme Hercule aux jeux de la Grèce.
Seul tu fais les beaux jours; que tes jours soient sans fin.
C'est ce que nous disons en revoyant l'aurore;
Ce qu'en nos douces nuits nous redisons encore
Entre les bras du dieu du vin. [62]
On ne peut, ce me semble, faire entendre plus expressément ce que nous entendons par ces mots, Nous avons bu à la santé de votre majesté.
C'est de là probablement que vint, parmi nos nations barbares, l'usage de boire à la santé de ses convives; usage absurde, puisque vous videriez quatre bouteilles sans leur faire le moindre bien. Et que veut dire boire à la santé du roi , s'il ne signifie pas ce que nous venons de voir?
Le Dictionnaire de Trévoux nous avertit qu'on ne boit pas à la santé de ses supérieurs en leur présence . Passe pour la France et pour l'Allemagne; mais en Angleterre c'est un usage reçu. Il y a moins loin d'un homme à un homme à Londres qu'à Vienne.
On sait de quelle importance il est en Angleterre de boire à la santé d'un prince qui prétend au trône; c'est se déclarer son partisan. Il en a coûté cher à plus d'un Eccossais et d'un Irlandais pour avoir bu à la santé des Stuarts.
Tous les whigs buvaient après la mort du roi Guillaume, non pas à sa santé, mais à sa mémoire. Un tory nommé Brown, évêque de Cork en Irlande, grand ennemi de Guillaume, dit qu'il mettrait un bouchon à toutes les bouteilles qu'on vidait à la gloire de ce monarque, parce que Cork en anglais signifie bouchon . Il ne s'en tint pas à ce fade jeu de mots; il écrivit en 1702 une brochure (ce sont les mandements du pays) pour faire voir aux Irlandais que c'est une impiété atroce de boire à la santé des rois, et surtout à leur mémoire ; que c'est une profanation de ces paroles de Jésus-Christ, Buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi .
Ce qui étonnera, c'est que cet évêque n'était pas le premier qui eût conçu une telle démence. Avant lui, le presbytérien Pryn avait fait un gros livre contre l'usage impie de boire à la santé des chrétiens.
Enfin, il y eut un Jean Geré, curé de la paroisse de Ste Foi, qui publia la divine potion, pour conserver la santé spirituelle par la cure de la maladie invétérée de boire à la santé, avec des arguments clairs et solides contre cette coutume criminelle, le tout pour la satisfaction du public; à la requête d'un digne membre du parlement, l'an de notre salut 1648 .
Notre révérend père Garasse, notre révérend père Patouillet, et notre révérend père Nonotte n'ont rien de supérieur à ces profondeurs anglaises. Nous avons longtemps lutté, nos voisins et nous, à qui l'emporterait.
BORNES DE L'ESPRIT HUMAIN. [p. 42] ↩
On demandait un jour à Newton pourquoi il marchait quand il en avait envie? et comment son bras et sa main se remuaient à sa volonté? Il répondit bravement qu'il n'en savait rien. Mais, du moins, lui dit-on, vous qui connaissez si bien la gravitation des planètes, vous me direz par quelle raison elles tournent dans un sens plutôt que dans un autre; et il avoua encore qu'il n'en savait rien.
Ceux qui enseignèrent que l'Océan était salé de peur qu'il ne se corrompît, et que les marées étaient faites pour conduire nos vaisseaux dans nos ports, furent un peu honteux quand on leur répliqua que la Méditerranée a des ports et point de reflux. Musshembroek lui-même est tombé dans cette inadvertance.
Quelqu'un a-t-il jamais pu dire précisément, comment une bûche se change dans son foyer en charbon ardent, et par quelle mécanique la chaux s'enflamme avec de l'eau fraîche?
Le premier principe du mouvement du coeur dans les animaux est-il bien connu? sait-on bien nettement comment la génération s'opère? a-t-on deviné ce qui nous donne les sensations, les idées, la mémoire? Nous ne connaissons pas plus l'essence de la matière que les enfants qui en touchent la superficie.
Qui nous apprendra par quelle mécanique ce grain de blé que nous jetons en terre se relève pour produire un tuyau chargé d'un épi, et comment le même sol produit une pomme au haut de cet arbre et une châtaigne à l'arbre voisin? Plusieurs docteurs ont dit: Que ne sais-je pas? Montagne disait: Que sais-je!
Décideur impitoyable, pédagogue à phrases, raisonneur fourré, tu cherches les bornes de ton esprit. Elles sont au bout de ton nez.
Parle: m'apprendras-tu par quels subtils ressorts
L'éternel artisan fait végéter les corps?
Pourquoi l'aspic affreux, le tigre, la panthère,
N'ont jamais adouci leur cruel caractère;
Et que reconnaissant la main qui le nourrit,
Le chien meurt en léchant le maître qu'il chérit?
D'où vient qu'avec cent pieds, qui semblent inutiles,
Cet insecte tremblant traîne ses pas débiles?
Pourquoi ce ver changeant se bâtit un tombeau,
S'enterre, et ressuscite avec un corps nouveau;
Et le front couronné, tout brillant d'étincelles,
S'élance dans les airs en déployant ses ailes?
Le sage Dufay parmi ses plants divers,
Végétaux rassemblés des bouts de l'univers,
Me dira-t-il pourquoi la tendre sensitive
Se flétrit sous nos mains, honteuse et fugitive?
Pour découvrir un peu ce qui se passe en moi,
Je m'en vais consulter le médecin du roi.
Sans doute il en sait plus que ses doctes confrères.
Je veux savoir de lui par quels secrets mystères
Ce pain, cet aliment dans mon corps digéré
Se transforme en un lait doucement préparé?
Comment toujours filtré dans ses routes certaines,
En longs ruisseaux de pourpre il court enfler mes veines,
A mon corps languissant rend un pouvoir nouveau,
Fait palpiter mon coeur, et penser mon cerveau?
Il lève au ciel les yeux, il s'incline, il s'écrie:
Demandez-le à ce Dieu, qui nous donna la vie.
Courriers de la physique, argonautes nouveaux,
Qui franchissez les monts, qui traversez les eaux,
Ramenez des climats soumis aux trois couronnes,
Vos perches, vos secteurs, et surtout deux Lapones.
Vous avez recherché, dans ces lieux pleins d'ennui,
Ce que Newton connut sans sortir de chez lui:
Vous avez arpenté quelque faible partie
Des flancs toujours glacés de la terre aplatie.
Dévoilez ces ressorts, qui font la pesanteur.
Vous connaissez les lois qu'établit son auteur.
Parlez, enseignez-moi, comment ses mains fécondes
Font tourner tant de cieux, graviter tant de mondes?
Pourquoi, vers le soleil notre globe entraîné,
Se meut autour de soi sur son axe incliné?
Parcourant en douze ans les célèstes demeures,
D'où vient que Jupiter a son jour de dix heures?
Vous ne le savez point. Votre savant compas
Mesure l'univers, et ne le connaît pas.
Je vous vois dessiner, par un art infaillible,
Les dehors d'un palais à l'homme inaccessible;
Les angles, les côtés sont marqués par vos traits;
Le dedans à vos yeux est fermé pour jamais.
Pourquoi donc m'affliger, si ma débile vue
Ne peut percer la nuit sur mes yeux répandue?
Je n'imiterai point ce malheureux savant,
Qui des feux de l'Etna scrutateur imprudent,
Marchant sur des monceaux de bitume et de cendre,
Fut consumé du feu qu'il cherchait à comprendre.
Nos bornes sont donc partout, et avec cela nous sommes orgueilleux comme des paons que nous prononçons pans .
BOUC. [p. 45] ↩
BESTIALITÉ, SORCELLERIE.
Les honneurs de toute espèce, que l'antiquité a rendus aux boucs, seraient bien étonnants, si quelque chose pouvait étonner ceux qui sont un peu familiarisés avec le monde ancien et moderne. Les Egyptiens et les Juifs désignèrent souvent les rois et les chefs du peuple par le mot de bouc . Vous trouvez dans Zacharie: Ch. X, v. 3. La fureur du Seigneur s'est irritée contre les pasteurs du peuple, contre les boucs; elle les visitera: il a visité son troupeau la maison de Juda, et il en a fait son cheval de bataille .
Ch. I, v. 8. Sortez de Babilone , dit Jérémie aux chefs du peuple; soyez les boucs à la tête du troupeau .
Isaïe s'est servi aux chapitres X et XIV du terme de bouc , qu'on a traduit par celui de prince .
Les Egyptiens firent bien plus que d'appeler leurs rois boucs , ils consacrèrent un bouc dans Mendès, et l'on dit même qu'ils l'adorèrent. Il se peut très bien que le peuple ait pris en effet un emblème pour une divinité, c'est ce qui ne lui arrive que trop souvent.
Il n'est pas vraisemblable que les shoen ou shotim d'Egypte, c'est-à-dire les prêtres, aient à la fois immolé et adoré des boucs. On sait qu'ils avaient leur bouc Hazazel qu'ils précipitaient orné et couronné de fleurs pour l'expiation du peuple, et que les Juifs prirent d'eux cette cérémonie et jusqu'au nom même d'Hazazel, ainsi qu'ils adoptèrent plusieurs autres rites de l'Egypte.
Mais les boucs reçurent encore un honneur plus singulier; il est constant qu'en Egypte plusieurs femmes donnèrent avec les boucs le même exemple que donna Pasiphaë avec son taureau. Hérodote raconte que lorsqu'il était en Egypte, une femme eut publiquement ce commerce abominable dans le nome de Mendès; il dit qu'il en fut très étonné, mais il ne dit point que la femme fut punie.
Ce qui est encore plus étrange, c'est que Plutarque et Pindare qui vivaient dans des siècles si éloignés l'un de l'autre, s'accordent tous deux à dire, qu'on présentait des femmes au bouc consacré. [63] Cela fait frémir la nature. Pindare dit, ou bien on lui fait dire:
Charmantes filles de Mendès,
Quels amants cueillent sur vos lèvres
Les doux baisers que je prendrais?
Quoi! ce sont les maris des chèvres!
Liv. II. Paralip. ch. XI, v. 15. Les Juifs n'imitèrent que trop ces abominations. Jeroboam institua des prêtres pour le service de ses veaux et de ses boucs. Le texte hébreu porte expressément boucs . Mais ce qui outragea le plus la nature humaine, ce fut le brutal égarement de quelques Juives qui furent passionnées pour des boucs, et des Juifs qui s'accouplèrent avec des chèvres. Il fallut une loi expresse pour réprimer cette horrible turpitude. Cette loi fut donnée dans le Levit. ch. XVII, v. 7. Lévitique, et y est exprimée à plusieurs reprises. D'abord c'est une défense éternelle de sacrifier aux velus avec lesquels on a Ch. XVIII, v. 23. forniqué. Ensuite une autre défense aux femmes de se prostituer aux bêtes, Ch. XX, v. 15 et 16. et aux hommes de se souiller du même crime. Enfin, il est ordonné que quiconque se sera rendu coupable de cette turpitude, sera mis à mort avec l'animal dont il aura abusé. L'animal est réputé aussi criminel que l'homme et la femme; il est dit que leur sang retombera sur eux tous.
C'est principalement des boucs et des chèvres dont il s'agit dans ces lois, devenues malheureusement nécessaires au peuple hébreu. C'est aux boucs et aux chèvres, aux asirim, qu'il est dit que les Juifs se sont prostitués; asiri , un bouc et une chèvre; asirim des boucs ou des chèvres. Cette fatale dépravation était commune dans plusieurs pays chauds. Les Juifs alors erraient dans un désert où l'on ne peut guère nourrir que des chèvres et des boucs. On ne sait que trop combien cet excès a été commun chez les bergers de la Calabre et dans plusieurs autres contrées de l'Italie. Virgile même en parle dans sa troisième églogue: Le novimus et qui te transversa tuentibus hircis , n'est que trop connu.
On ne s'en tint pas à ces abominations. Le culte du bouc fut établi dans l'Egypte et dans les fables d'une partie de la Palestine. On crut opérer des enchantements par le moyen des boucs, des égypans et de quelques autres monstres auxquels on donnait toujours une tête de bouc.
La magie, la sorcellerie passa bientôt de l'Orient dans l'Occident, et s'étendit dans toute la terre. On appelait sabbatum chez les Romains l'espèce de sorcellerie qui venait des Juifs, en confondant ainsi leur jour sacré avec leurs secrets infâmes. C'est de là qu'enfin être sorcier et aller au sabbat, fut la même chose chez les nations modernes.
De misérables femmes de village trompées par des fripons, et encore plus par la faiblesse de leur imagination, crurent qu'après avoir prononcé le mot abraxa , et s'être frottées d'un onguent mêlé de graisse, de bouse de vache et de poil de chèvre, elles allaient au sabbat sur un manche à balai pendant leur sommeil, qu'elles y adoraient un bouc, et qu'il avait leur jouissance.
Cette opinion était universelle. Tous les docteurs prétendaient que c'était le diable qui se métamorphosait en bouc. C'est ce qu'on peut voir dans les Disquisitions de Del Rio, et dans cent autres auteurs. Le théologien Grillandus, l'un des grands promoteurs de Del Rio pag. 190. l'Inquisition, cité par Del Rio, dit que les sorcières appellent le bouc Martinet. Il assure qu'une femme qui s'était donnée à Martinet, montait sur son dos et était transportée en un instant dans les airs à un endroit nommé La noix de Bénévent .
Il y eut des livres où les mystères des sorciers étaient écrits. J'en ai vu un, à la tête duquel on avait dessiné assez mal un bouc, et une femme à genoux derrière lui. On appelait ces livres grimoires en France, et ailleurs l' alphabet du diable . Celui que j'ai vu ne contenait que quatre feuillets en caractères presque indéchiffrables, tels à peu près que ceux de l'Almanach du berger.
La raison et une meilleure éducation auraient suffi pour extirper en Europe une telle extravagance; mais au lieu de raison on employa les supplices. Si les prétendus sorciers eurent leur grimoire, les juges eurent leur code des sorciers. Le jésuite Del Rio docteur de Louvain, fit imprimer ses Disquisitions magiques en l'an 1599: il assure que tous les hérétiques sont magiciens; et il recommande souvent qu'on leur donne la question. Il ne doute pas que le diable ne se transforme en bouc et n'accorde ses Pag. 180. faveurs à toutes les femmes qu'on lui présente. Il cite plusieurs jurisconsultes qu'on nomme démonographes , qui prétendent que Pag. 181. Luther naquit d'un bouc et d'une femme. Il assure qu'en l'année 1595 une femme accoucha dans Bruxelles d'un enfant que le diable lui avait fait, déguisé en bouc, et qu'elle fut punie; mais il ne dit pas de quel supplice.
Celui qui a le plus approfondi la jurisprudence de la sorcellerie, est un nommé Boguet, grand-juge en dernier ressort d'une abbaye de St Claude en Franche-Comté. Il rend raison de tous les supplices auxquels il a condamné des sorcières et des sorciers: le nombre en est très considérable. Presque toutes ces sorcières sont supposées avoir couché avec le bouc.
On a déjà dit que plus de cent mille prétendus sorciers ont été exécutés à mort en Europe. La seule philosophie a guéri enfin les hommes de cette abominable chimère, et a enseigné aux juges qu'il ne faut pas brûler les imbéciles.
BOUFFON, BURLESQUE. [p. 48] ↩
BAS COMIQUE.
Il était bien subtil ce scoliaste qui a dit le premier que l'origine de bouffon est due à un petit sacrificateur d'Athènes nommé Bupho, qui lassé de son métier s'enfuit et qu'on ne revit plus. L'Aréopage ne pouvant le punir fit le procès à la hache de ce prêtre. Cette farce, dit-on, qu'on jouait tous les ans dans le temple de Jupiter, s'appela bouffonnerie . Cette historiette ne paraît pas d'un grand poids. Bouffon n'était pas un nom propre, boufonos signifie immolateur de boeufs . Jamais plaisanterie chez les Grecs ne fut appelée boufonia . Cette cérémonie, toute frivole qu'elle paraît, peut avoir une origine sage, humaine, digne des vrais Athéniens.
Une fois l'année le sacrificateur subalterne, ou plutôt le boucher sacré, prêt d'immoler un boeuf s'enfuyait comme saisi d'horreur, pour faire souvenir les hommes que dans des temps plus sages et plus heureux on ne présentait aux dieux que des fleurs et des fruits, et que la barbarie d'immoler des animaux innocents et utiles, ne s'introduisit que lorsqu'il y eut des prêtres qui voulurent s'engraisser de ce sang, et vivre aux dépens des peuples. Cette idée n'a rien de bouffon.
Ce mot de bouffon est reçu depuis longtemps chez les Italiens et chez les Espagnols; il signifiait mimus, scurra, joculator ; mime, farceur, jongleur. Ménage après Saumaise le dérive de bocca infiata , boursouflé; et en effet on veut dans un bouffon un visage rond et la joue rebondie. Les Italiens disent bufo magro , maigre bouffon, pour exprimer un mauvais plaisant qui ne vous fait pas rire.
Bouffon, bouffonnerie , appartiennent au bas comique, à la Foire, à Gilles, à tout ce qui peut amuser la populace. C'est par là que les tragédies ont commencé à la honte de l'esprit humain. Thespis fut un bouffon avant que Sophocle fût un grand homme.
Au seizième et dix-septième siècle les tragédies espagnoles et anglaises furent toutes avilies par des bouffonneries dégoûtantes. (Voyez l'article Dramatique . )
Les cours furent encore plus déshonorées par les bouffons que le théâtre. La rouille de la barbarie était si forte, que les hommes ne savaient pas goûter des plaisirs honnêtes.
Boileau a dit de Molière:
C'est par là que Molière illustrant ses écrits,
Peut-être de son art eût emporté le prix,
Si moins ami du peuple en ses doctes peintures,
Il n'eût fait quelquefois grimacer ses figures;
Quitté pour le bouffon l'agréable et le fin,
Et sans honte à Térence allié Tabarin.
Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe,
Je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope.
Mais il faut considérer que Raphaël a daigné peindre des grotesques. Molière ne serait point descendu si bas s'il n'eût eu pour spectateurs que des Louis XIV, des Condés, des Turenne, des ducs de la Rochefoucault, des Montausier, des Beauvilliers, des dames de Montespan et de Thiange; mais il travaillait aussi pour le peuple de Paris qui n'était pas encore décrassé; le bourgeois aimait la grosse farce, et la payait. Les Jodelets de Scaron étaient à la mode. On est obligé de se mettre au niveau de son siècle avant d'être supérieur à son siècle; et après tout, on aime quelquefois à rire. Qu'est-ce que la Batrachomyomachie attribuée à Homère, sinon une bouffonnerie, un poème burlesque?
Ces ouvrages ne donnent point de réputation, et ils peuvent avilir celle dont on jouit.
Le bouffon n'est pas toujours dans le style burlesque. Le Médecin malgré lui , les Fourberies de Scapin ne sont point dans le style des Jodelets de Scaron. Molière ne va pas rechercher des termes d'argot comme Scaron. Ses personnages les plus bas n'affectent point des plaisanteries de gilles. La bouffonnerie est dans la chose et non dans l'expression. Le style burlesque est celui de Don Japhet d'Arménie .
Du bon père Noé j'ai l'honneur de descendre,
Noé qui sur les eaux fit flotter sa maison
Quand tout le genre humain but plus que de raison.
Vous voyez qu'il n'est rien de plus net que ma race,
Et qu'un cristal auprès paraîtrait plein de crasse.
Pour dire qu'il veut se promener, il dit qu' il va exercer sa vertu caminante . Pour faire entendre qu'on ne pourra lui parler, il dit,
Vous aurez avec moi disette de loquelle.
C'est presque partout le jargon des gueux; le langage des halles; et même il est inventeur dans ce langage.
Tu m'as tout compissé, pisseuse abominable.
Enfin, la grossièreté de sa bassesse est poussée jusqu'à chanter sur le théâtre,
Amour nabot
Qui du jabot
De Dom Japhet
A fait
Une ardente fournaise:
Et dans mon pis
A mis
Une essence de braise.
Et ce sont ces plates infamies qu'on a jouées pendant plus d'un siècle alternativement avec le Misanthrope ; ainsi qu'on voit passer dans une rue indifféremment un magistrat et un chiffonnier.
Le Virgile travesti est à peu près dans ce goût; mais rien n'est plus abominable que sa Mazarinade .
Notre Jules n'est pas César,
C'est un caprice du hasard,
Qui naquit garçon et fut garce,
Qui n'était né que pour la farce.
Tous ses desseins prennent un rat
Dans la moindre affaire d'Etat.
Singe du prélat de Sorbonne,
Ma foi tu nous la bailles bonne.
Tu n'es à ce cardinal duc
Comparable qu'en aqueduc.
Illustre en ta partie honteuse,
Ta seule braguette est fameuse.
...............................
Va rendre compte au Vatican
De tes meubles mis à l'encan;
D'être cause que tout se perde,
De tes caleçons pleins de merde.
Ces saletés font vomir, et le reste est si exécrable qu'on n'ose le copier. Cet homme était digne du temps de la Fronde. Rien n'est peut-être plus extraordinaire que l'espèce de considération qu'il eut pendant sa vie, si ce n'est ce qui arriva dans sa maison après sa mort.
On commença par donner d'abord le nom de poème burlesque au Lutrin de Boileau; mais le sujet seul était burlesque; le style fut agréable et fin, quelquefois même héroïque.
Les Italiens avaient une autre sorte de burlesque qui était bien supérieur au nôtre, c'est celui de l'Arétin, de l'archevêque La Caza, du Berni, du Mauro, du Dolce. La décence y est souvent sacrifiée à la plaisanterie; mais les mots déshonnêtes en sont communément bannis. Le Capitolo del forno de l'archevêque La Caza roule à la vérité sur un sujet qui fait enfermer à Bissêtre les abbés Desfontaines, et qui mène en Grève les Déchaufours. Cependant il n'y a pas un mot qui offense les oreilles chastes; il faut deviner.
Trois ou quatre Anglais ont excellé dans ce genre: Buttler dans son Hudibras , qui est la guerre civile excitée par les puritains, tournée en ridicule; le docteur Garth dans la Querelle des apothicaires et des médecins ; Prior dans son Histoire de l'âme , où il se moque fort plaisamment de son sujet; Philippe dans sa pièce du Brillant Sheling .
Hudibras est autant au-dessus de Scaron qu'un homme de bonne compagnie est au-dessus d'un chansonnier des cabarets de la Courtille. Le héros d' Hudibras était un personnage très réel qui avait été capitaine dans les armées de Fairfax et de Cromwell; il s'appelait le chevalier Samuel Luke. Voici le commencement de son poème assez fidèlement traduit.
Quand les profanes et les saints
Dans l'Angleterre étaient aux prises,
Qu'on se battait pour des églises,
Aussi fort que pour des catins;
Lorsque anglicans et puritains
Faisaient une si rude guerre,
Et qu'au sortir du cabaret
Les orateurs de Nazareth
Allaient battre la caisse en chaire;
Que partout sans savoir pourquoi,
Au nom du ciel, au nom du roi,
Les gens d'armes couvraient la terre;
Alors monsieur le chevalier,
Longtemps oisif ainsi qu'Achille,
Tout rempli d'une sainte bile,
Suivi de son grand écuyer,
S'échappa de son poulailler,
Avec son sabre et l'Evangile,
Et s'avisa de guerroyer.
Sire Hudibras, cet homme rare,
Etait, dit-on, rempli d'honneur,
Avait de l'esprit et du coeur,
Mais il en était fort avare.
D'ailleurs par un talent nouveau,
Il était tout propre au barreau,
Ainsi qu'à la guerre cruelle;
Grand sur les bancs, grand sur la selle,
Dans les camps et dans un bureau;
Semblable à ces rats amphibies,
Qui paraissant avoir deux vies,
Sont rats de campagne et rats d'eau.
Mais malgré sa grande éloquence,
Et son mérite et sa prudence,
Il passa chez quelques savants
Pour être un de ces instruments,
Dont les fripons avec adresse
Savent user sans dire mot,
Et qu'ils tournent avec souplesse;
Cet instrument s'appelle un sot .
Ce n'est pas qu'en théologie,
En logique, en astrologie,
Il ne fût un docteur subtil;
En quatre il séparait un fil,
Disputant sans jamais se rendre,
Changeant de thèse tout à coup,
Toujours prêt à parler beaucoup
Quand il fallait ne point s'étendre.
D'Hudibras la religion
Etait tout comme sa raison,
Vide de sens et fort profonde.
Le puritanisme divin,
La meilleure secte du monde,
Et qui certes n'a rien d'humain;
La vraie Eglise militante,
Qui prêche un pistolet en main,
Pour mieux convertir son prochain,
A grands coups de sabre argumente,
Qui promet les célestes biens
Par le gibet et par la corde,
Et damne sans miséricorde
Les péchés des autres chrétiens,
Pour se mieux pardonner les siens;
Secte qui toujours détruisante
Se détruit elle-même enfin:
Tel Samson de sa main puissante
Brisa le temple philistin,
Mais il périt par sa vengeance,
Et lui-même il s'ensevelit,
Ecrasé sous la chute immense
De ce temple qu'il démolit.
Au nez du chevalier antique
Deux grandes moustaches pendaient,
A qui les parques attachaient
Le destin de la république.
Il les garde soigneusement,
Et si jamais on les arrache,
C'est la chute du parlement;
L'Etat entier en ce moment
Doit tomber avec sa moustache.
Ainsi Taliacotius,
Grand Esculape d'Etrurie,
Répara tous les nez perdus
Par une nouvelle industrie:
Il vous prenait adroitement
Un morceau du cul d'un pauvre homme,
L'appliquait au nez proprement;
Enfin il arrivait qu'en somme,
Tout juste à la mort du prêteur
Tombait le nez de l'emprunteur;
Et souvent dans la même bière,
Par justice et par bon accord,
On remettait au gré du mort
Le nez auprès de son derrière.
Notre grand héros d'Albion,
Grimpé dessus sa haridelle,
Pour venger la religion,
Avait à l'arçon de sa selle
Deux pistolets et du jambon.
Mais il n'avait qu'un éperon.
C'était de tout temps sa manière,
Sachant que si sa talonnière
Pique une moitié du cheval,
L'autre moitié de l'animal
Ne resterait point en arrière.
Voilà donc Hudibras parti;
Que Dieu bénisse son voyage,
Ses arguments et son parti,
Sa barbe rousse et son courage.
Le poème de Garth sur les médecins et les apothicaires, est moins dans le style burlesque que dans celui du Lutrin de Boileau; on y trouve beaucoup plus d'imagination, de variété, de naïveté etc. que dans le Lutrin; et ce qui est étonnant, c'est qu'une profonde érudition y est embellie par la finesse et par les grâces: il commence à peu près ainsi:
Muse, raconte-moi les débats salutaires,
Des médecins de Londres et des apothicaires.
Contre le genre humain si longtemps réunis,
Quel dieu pour nous sauver les rendit ennemis?
Comment laissèrent-ils respirer leurs malades
Pour frapper à grands coups sur leurs chers camarades?
Comment changèrent-ils leur coiffure en armet,
La seringue en canon, la pilule en boulet?
Ils connurent la gloire; acharnés l'un sur l'autre,
Ils prodiguaient leur vie et nous laissaient la nôtre.
Prior que nous avons vu plénipotentiaire en France avant la paix d'Utrecht, se fit médiateur entre les philosophes qui disputent sur l'âme. Son poème est dans le style d' Hudibras qu'on appelle Dogrel rimes , c'est le stilo Berniesco des Italiens.
La grande question est d'abord de savoir si l'âme est toute en tout, ou si elle est logée derrière le nez et les deux yeux sans sortir de sa niche. Suivant ce dernier système, Prior la compare au pape qui reste toujours à Rome, d'où il envoie ses nonces et ses espions pour savoir ce qui se passe dans la chrétienté.
Prior, après s'être moqué de plusieurs systèmes, propose le sien. Il remarque que l'animal à deux pieds nouveau-né remue les pieds tant qu'il peut quand on a la bêtise de l'emmailloter; et il juge de là que l'âme entre chez lui par les pieds; que vers les quinze ans elle a monté au milieu du corps; qu'elle va ensuite au coeur, puis à la tête, et qu'elle sort à pieds joints quand l'animal finit sa vie.
A la fin de ce poème singulier, rempli de vers ingénieux et d'idées aussi fines que plaisantes, on voit ce vers charmant de Fontenelle:
Il est des hochets pour tout âge.
Prior prie la fortune de lui donner des hochets pour sa vieillesse.
Give us play things for our old age.
Et il est bien certain que Fontenelle n'a pas pris ce vers de Prior, ni Prior de Fontenelle. L'ouvrage de Prior est antérieur de vingt ans, et Fontenelle n'entendait pas l'anglais.
Le poème est terminé par cette conclusion.
Je n'aurai point la fantaisie
D'imiter ce pauvre Caton
Qui meurt dans notre tragédie
Pour une page de Platon.
Car, entre nous, Platon m'ennuie.
La tristesse est une folie;
Etre gai c'est avoir raison.
Çà qu'on m'ôte mon Cicéron,
D'Aristote la rhapsodie,
De René la philosophie;
Et qu'on m'apporte mon flacon.
Distinguons bien dans tous ces poèmes le plaisant, le léger, le naturel, le familier, du grotesque, du bouffon, du bas, et surtout du forcé. Ces nuances sont démêlés par les connaisseurs, qui seuls à la longue font le destin des ouvrages.
La Fontaine a bien voulu quelquefois descendre au style burlesque.
Autrefois carpillon fretin,
Il eut beau faire, il eut beau dire,
On le mit dans la poêle à frire.
Il appelle les louveteaux, messieurs les louvats . Phèdre ne se sert jamais de ce style dans ses fables; mais aussi il n'a pas la grâce et la naïve mollesse de La Fontaine, quoiqu'il ait plus de précision et de pureté.
BOULEVARD, ou BOULEVART. [p. 57] ↩
Boulevard, fortification, rempart. Belgrade est le boulevard de l'empire ottoman du côté de la Hongrie. Qui croirait que ce mot ne signifie dans son origine qu'un jeu de boule? Le peuple de Paris jouait à la boule sur le gazon du rempart; ce gazon s'appelait le verd , de même que le marché aux herbes. On boulait sur le verd . De là vient que les Anglais, dont la langue est une copie de la nôtre presque dans tous ses mots qui ne sont pas saxons, ont appelé leur jeu de boule boulin-green , le verd du jeu de boule. Nous avons repris d'eux ce que nous leur avions prêté. Nous avons appelé d'après eux boulingrins , sans savoir la force du mot, les parterres de gazon que nous avons introduits das nos jardins.
J'ai entendu autrefois de bonnes bounrgeoises qui s'allaient promener sur le Bouleverd , et non pas sur le Boulevard . On se moquait d'elles et on avait tort. Mais en tout genre l'usage l'emporte; et tous ceux qui ont raison contre l'usage sont sifflés ou condamnés.
BOURGES. [p. 58] ↩
Nos questions ne roulent guère sur la géographie; mais qu'on nous permette de marquer en deux mots notre étonnement sur la ville de Bourges. Le Dictionnaire de Trévoux prétend que c'est une des plus anciennes de l'Europe, qu'elle était le siège de l'empire des Gaules, et donnait des rois aux Celtes .
Je ne veux combattre l'ancienneté d'aucune ville, ni d'aucune famille. Mais, y a-t-il jamais eu un empire des Gaules? Les Celtes avaient-ils des rois? Cette fureur d'antiquité est une maladie dont on ne guérira pas sitôt. Les Gaules, la Germanie, le Nord n'ont rien d'antique que le sol, les arbres et les animaux. Si vous voulez des antiquités, allez vers l'Asie; et encore c'est fort peu de chose. Les hommes sont anciens et les monuments nouveaux; c'est ce que nous avons en vue dans plus d'un article.
Si c'était un bien réel d'être né dans une enceinte de pierre ou de bois plus ancienne qu'une autre, il serait très raisonnable de faire remonter la fondation de sa ville au temps de la guerre des géants. Mais puisqu'il n'y a pas le moindre avantage dans cette vanité, il faut s'en détacher. C'est tout ce que j'avais à dire sur Bourges .
BOURREAU. [p. 59] ↩
Il semble que ce mot n'aurait point dû souiller un dictionnaire des arts et des sciences; cependant il tient à la jurisprudence et à l'histoire. Nos grands poètes n'ont pas dédaigné de se servir fort souvent de ce mot dans les tragédies; Clitemnestre dans Iphigénie dit à Agamemnon:
Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin
Que d'en faire à sa mère un horrible festin.
On emploie gaiement ce mot en comédie: Mercure dit dans l' Amphitrion :
Comment! bourreau, tu fais des cris?
Le joueur dit:
Que je chante, bourreau.
Et les Romains se permettaient de dire:
Quorsum vadis, carnifex?
Le Dictionnaire encyclopédique, au mot Exécuteur , détaille tous les privilèges du bourreau de Paris; mais un auteur nouveau a été Roman intitulé Emile , tom. IV, pag. 177 et 178. plus loin. Dans un roman d'éducation, qui n'est ni celui de Xénophon, ni celui de Télémaque , il prétend que le monarque doit donner sans balancer la fille du bourreau en mariage à l'héritier présomptif de la couronne, si cette fille est bien élevée, et si elle a beaucoup de convenance avec le jeune prince . C'est dommage qu'il n'ait pas stipulé la dot qu'on devait donner à la fille; et les honneurs qu'on devait rendre au père le jour des noces.
Par convenance on ne pouvait guère pousser plus loin la morale approfondie, les règles nouvelles de l'honnêteté publique, les beaux paradoxes, les maximes divines dont cet auteur a régalé notre siècle. Il aurait été sans doute par convenance un des garçons. . . de la noce. Il aurait fait l'épithalame de la princesse, et n'aurait pas manqué de célébrer les hautes oeuvres de son père. C'est pour lors que la nouvelle mariée aurait donné des baisers âcres; car le même écrivain introduit dans un autre roman, intitulé Héloïse , un jeune Suisse qui a gagné dans Paris une de ces maladies qu'on ne nomme pas; et qui dit à sa Suissesse, Garde tes baisers, ils sont trop âcres .
On ne croira pas un jour que de tels ouvrages aient eu une espèce de vogue. Elle ne ferait pas honneur à notre siècle si elle avait duré. Les pères de famille ont conclu bientôt qu'il n'était pas honnête de marier leurs fils aînés à des filles de bourreau, quelque convenance qu'on pût apercevoir entre le poursuivant et la poursuivie.
Est modus in rebus sunt certi denique fines
Quos ultra citrague neguit consistere rectum .
BRACHMANES, BRAMES. [p. 60] ↩
Ami lecteur, observez d'abord que le père Thomassin, l'un des plus savants hommes de notre Europe, dérive les brachmanes d'un mot juif barac par un C, supposé que les Juifs eussent un C. Ce barac signifiait, dit-il, s'enfuir , et les bracmanes s'enfuyaient des villes; supposé qu'alors il y eût des villes.
Ou, si vous l'aimez mieux, bracmanes vient de barak par un K, qui veut dire bénir ou bien prier . Mais pourquoi les Biscayens n'auraient-ils pas nommé les brames du mot bran qui exprimait quelque chose que je ne veux pas dire? ils y avaient autant de droit que les Hébreux. Voilà une étrange érudition. En la rejetant entièrement on saurait moins, et on saurait mieux.
N'est-il pas vraisemblable que les bracmanes sont les premiers législateurs de la terre, les premiers philosophes, les premiers théologiens?
Le peu de monuments qui nous restent de l'ancienne histoire, ne forment-ils pas une grande présomption en leur faveur, puisque les premiers philosophes grecs allèrent apprendre chez eux les mathématiques, et que les curiosités les plus antiques recueillies par les empereurs de la Chine sont toutes indiennes, ainsi que les relations l'attestent dans la collection de Du Halde.
Nous parlerons ailleurs du Shasta ; c'est le premier livre de théologie des bracmanes, écrit environ quinze cents ans avant leur Veidam , et antérieur à tous les autres livres.
Leurs annales ne font mention d'aucune guerre entreprise par eux en aucun temps. Les mots d' armes , de tuer , de mutiler ne se trouvent ni dans les fragments du Shasta , que nous avons, ni dans l' Ezourveidam , ni dans le Cormoveidam . Je puis du moins assurer que je ne les ai point vus dans ces deux derniers recueils: et ce qu'il y a de plus singulier, c'est que le Shasta qui parle d'une conspiration dans le ciel, ne fait mention d'aucune guerre dans la grande presqu'île enfermée entre l'Indus et le Gange.
Les Hébreux qui furent connus si tard, ne nomment jamais les bracmanes; ils ne connurent l'Inde qu'après les conquêtes d'Alexandre; et leurs établissements dans l'Egypte, de laquelle ils avaient dit tant de mal. On ne trouve le nom de l'Inde que dans le livre d'Esther, et dans celui de Job qui n'était pas hébreu. (Voyez Job .) On voit un singulier contraste entre les livres sacrés des Hébreux et ceux des Indiens. Les livres indiens n'annoncent que la paix et la douceur; ils défendent de tuer les animaux: les livres hébreux ne parlent que de tuer, de massacrer hommes et bêtes; on y égorge tout au nom du Seigneur; c'est tout un autre ordre de choses.
C'est incontestablement des bracmanes que nous tenons l'idée de la chute des êtres célestes révoltés contre le souverain de la nature; et c'est là probablement que les Grecs ont puisé la fable des titans. C'est aussi là que les Juifs prirent enfin l'idée de la révolte de Lucifer dans le premier siècle de notre ère.
Comment ces Indiens purent-ils supposer une révolte dans le ciel sans en avoir vu sur la terre? Un tel saut de la nature humaine à la nature divine ne se conçoit guère. On va d'ordinaire du connu à l'inconnu.
On n'imagine une guerre de géants qu'après avoir vu quelques hommes plus robustes que les autres tyranniser leurs semblables. Il fallait ou que les premiers bracmanes eussent éprouvé des discordes violentes, ou qu'ils en eussent vu du moins chez leurs voisins pour en imaginer dans le ciel.
C'est toujours un très étonnant phénomène qu'une société d'hommes qui n'a jamais fait la guerre, et qui a inventé une espèce de guerre faite dans les espaces imaginaires, ou dans un globe éloigné du nôtre, ou dans ce qu'on appelle le firmament , l' empyrée (Voyez Ciel matériel .) Mais il faut bien soigneusement remarquer que dans cette révolte des êtres célestes contre leur souverain, il n'y eut point de coups donnés, point de sang céleste répandu; point de montagnes jetés à la tête, point d'anges coupés en deux ainsi que dans le poème sublime et grotesque de Milton.
Ce n'est, selon le Shasta , qu'une désobéissance formelle aux ordres du Très-Haut, une cabale que Dieu punit en reléguant les anges rebelles dans un vaste lieu de ténèbres nommé Ondéra pendant le temps d'un mononthour entier. Un mononthour est de quatre cent vingt-six millions de nos années. Mais Dieu daigna pardonner aux coupables au bout de cinq mille ans, et leur ondéra ne fut qu'un purgatoire.
Il en fit des Mhurd , des hommes, et les plaça dans notre globe à condition qu'ils ne mangeraient point d'animaux, et qu'ils ne s'accoupleraient point avec les mâles de leur nouvelle espèce, sous peine de retourner à l'ondéra.
Ce sont là les principaux articles de la foi des bracmanes, qui a duré sans interruption de temps immémorial jusqu'à nos jours: il nous paraît étrange que ce fût parmi eux un péché aussi grave de manger un poulet que d'exercer la sodomie.
Ce n'est là qu'une petite partie de l'ancienne cosmogonie des bracmanes. Leurs rites, leurs pagodes prouvent que tout était allégorique chez eux; ils représentent encore la vertu sous l'emblème d'une femme qui a dix bras et qui combat dix péchés mortels figurés par des monstres. Nos missionnaires n'ont pas manqué de prendre cette image de la vertu pour celle du diable, et d'assurer que le diable est adoré dans l'Inde. Nous n'avons jamais été chez ces peuples que pour nous y enrichir, et pour les calomnier.
DE LA MÉTEMPSYCOSE DES BRACMANES.
La doctrine de la métempsycose, vient d'une ancienne loi de se nourrir de lait de vaches ainsi que de légumes, de fruits et de riz. Il parut horrible aux bracmanes de tuer et de manger sa nourrice: on eut bientôt le même respect pour les chèvres, les brebis et pour tous les autres animaux; ils les crurent animés par ces anges rebelles qui achevaient de se purifier de leurs fautes dans les corps des bêtes, ainsi que dans ceux des hommes. La nature du climat seconda cette loi, ou plutôt en fut l'origine: une atmosphère brûlante exige une nourriture rafraîchissante, et inspire de l'horreur pour notre coutume d'engloutir des cadavres dans nos entrailles.
L'opinion que les bêtes ont une âme fut générale dans tout l'Orient, et nous en trouvons des vestiges dans les anciens livres Genèse ch. IX, v. 4. sacrés. Dieu, dans la Genèse, défend aux hommes de manger leur chair avec leur sang et leur âme . C'est ce que porte le texte hébreu: Je vengerai , dit-il, le sang de vos âmes de la griffe des bêtes et de la Levit. ch. XVII, v. 14. main des hommes . Il dit dans le Lévitique, l' âme de la chair est dans le sang . Il fait plus; il fait un pacte solennel avec les hommes et Genèse ch. IV, v. 10. avec tous les animaux, ce qui suppose dans les animaux une intelligence.
Dans des temps très postérieurs, l'Ecclésiaste dit formellement: Eccles. ch. XVIII, v. 19. Dieu fait voir que l'homme est semblable aux bêtes: car les hommes meurent comme les bêtes, leur condition est égale, comme l'homme meurt, la bête meurt aussi. Les uns et les autres respirent de même: l'homme n'a rien de plus que la bête .
Jonas, quand il va prêcher à Ninive, fait jeûner les hommes et les bêtes.
Tous les auteurs anciens attribuent de la connaissance aux bêtes, les livres sacrés comme les profanes; et plusieurs les font parler. Il n'est donc pas étonnant que les bracmanes, et les pythagoriciens après eux, aient cru que les âmes passaient successivement dans les corps des bêtes et des hommes. En conséquence ils se persuadèrent, ou du moins ils dirent que les âmes des anges délinquants, pour achever leur purgatoire, appartenaient tantôt à des bêtes, tantôt à des hommes: c'est une partie du roman du jésuite Bougeant qui imagina que les diables sont des esprits envoyés dans le corps des animaux. Ainsi de nos jours, au bord de l'Occident, un jésuite renouvelle sans le savoir un article de la foi des plus anciens prêtres orientaux.
DES HOMMES ET DES FEMMES QUI SE BRULENT CHEZ LES BRACMANES.
Les brames, ou bramins d'aujourd'hui, qui sont les mêmes que les anciens bracmanes, ont conservé comme on sait, cette horrible coutume. D'où vient que chez un peuple qui ne répandit jamais le sang des hommes, ni celui des animaux, le plus bel acte de dévotion fut-il et est-il encore de se brûler publiquement? La superstition qui allie tous les contraires, est l'unique source de cet affreux sacrifice; coutume beaucoup plus ancienne que les lois d'aucun peuple connu.
Les brames prétendent que Brama leur grand prophète fils de Dieu, descendit parmi eux, et eut plusieurs femmes; qu'étant mort, celle de ses femmes qui l'aimait le plus se brûla sur son bûcher pour le rejoindre dans le ciel. Cette femme se brûla-t-elle en effet, comme on prétend que Porcia femme de Brutus avala des charbons ardents pour rejoindre son mari? ou est-ce une fable inventée par les prêtres? Y eut-il un Brama qui se donna en effet pour un prophète et pour un fils de Dieu? Il est à croire qu'il y eut un Brama, comme dans la suite on vit des Zoroastres, des Bacchus. La fable s'empara de leur histoire; ce qu'elle a toujours continué de faire partout.
Dès que la femme du fils de Dieu se brûle, il faut bien que les dames de moindre condition se brûlent aussi. Mais comment retrouveront-elles leurs maris qui sont devenus chevaux, élephants, ou éperviers? Comment démêler précisément la bête que le défunt anime, comment le reconnaître et être encore sa femme? Cette difficulté n'embarrasse point des théologiens indous; ils trouvent aisément des distinguo, des solutions, in sensu composito, in sensu diviso . La métempsycose n'est que pour les personnes du commun, ils ont pour les autres âmes une doctrine plus sublime. Ces âmes étant celles des anges jadis rebelles vont se purifiant, celles des femmes qui s'immolent sont béatifiées et retrouvent leurs maris tout purifiés: enfin les prêtres ont raison et les femmes se brûlent.
Il y a plus de quatre mille ans que ce terrible fanatisme est établi chez un peuple doux, qui croirait faire un crime de tuer une cigale. Les prêtres ne peuvent forcer une veuve à se brûler; car la loi invariable est que ce dévouement soit absolument volontaire. L'honneur est d'abord déféré à la plus ancienne mariée des femmes du mort: c'est à elle de descendre au bûcher; si elle ne s'en soucie pas, la seconde se présente; ainsi du reste. On prétend qu'il y en eut une fois dix-sept qui se brûlèrent à la fois sur le bûcher d'un raya; mais ces sacrifices sont devenus assez rares: la foi s'affaiblit depuis que les mahométans gouvernent une grande partie du pays, et que les Européens négocient dans l'autre.
Cependant il n'y a guère de gouverneur de Madrass et de Pondichéri qui n'ait vu quelque Indienne périr volontairement dans les flammes. M. Holwell rapporte qu'une jeune veuve de dix-neuf ans, d'une beauté singulière, mère de trois enfants, se brûla en présence de madame Roussel femme de l'amiral, qui était à la rade de Madrass: elle résista aux prières, aux larmes de tous les assistants. Madame Roussel la conjura au nom de ses enfants de ne les pas laisser orphelins: l'Indienne lui répondit, Dieu qui les a fait naître aura soin d'eux ; ensuite elle arrangea tous les préparatifs elle-même, mit de sa main le feu au bûcher, et consomma son sacrifice avec la sérénité d'une de nos religieuses qui allume des cierges.
M. Shernoc négociant anglais, voyant un jour une de ces étonnantes victimes, jeune et aimable qui descendait dans le bûcher, l'en arracha de force lorsqu'elle allait y mettre le feu; et, secondé par quelques Anglais, l'enleva et l'épousa. Le peuple regarda cette action comme le plus horrible sacrilège.
Pourquoi les maris ne se sont-ils jamais brûlés pour aller retrouver leurs femmes? pourquoi un sexe naturellement faible et timide a-t-il eu toujours cette force frénétique? est-ce parce que la tradition ne dit point qu'un homme ait jamais épousé une fille de Brama, au lieu qu'elle assure qu'une Indienne fut mariée avec le fils de ce Dieu? est-ce parce que les femmes sont plus superstitieuses que les hommes? est-ce parce que leur imagination est plus faible, plus tendre, plus faite pour être dominée?
Les anciens bracmanes se brûlaient quelquefois pour prévenir l'ennui et les maux de la vieillesse, et surtout pour se faire admirer. Calan ou Calanus ne se serait peut-être pas mis sur un bûcher sans le plaisir d'être regardé par Alexandre. Le chrétien rénégat Pellegrinus se brûla en public par la même raison qu'un fou parmi nous s'habille quelquefois en arménien pour attirer les regards de la populace.
N'entre-t-il pas aussi un malheureux mélange de vanité dans cet épouvantable sacrifice des femmes indiennes? Peut-être, si on portait une loi de ne se brûler qu'en présence d'une seule femme de chambre, cette abominable coutume serait pour jamais détruite.
Ajoutons un mot; une centaine d'Indiennes tout au plus, a donné ce terrible spectacle. Et nos inquisitions, nos fous atroces qui se sont dit juges, ont fait mourir dans les flammes plus de cent mille de nos frères, hommes, femmes, enfants, pour des choses que personne n'entendait. Plaignons et condamnons les brames: mais rentrons en nous-mêmes misérables que nous sommes.
Vraiment nous avons oublié une chose fort essentielle dans ce petit article des bracmanes; c'est que leurs livres sacrés sont remplis de contradictions. Mais le peuple ne les connaît pas. Et les docteurs ont des solutions prêtes, des sens figurés et figurants, des allégories, des types, des déclarations expresses de Birma, de Brama et de Vitsnou, qui fermeraient la bouche à tout raisonneur.
BULGARES, ou BOULGARES. [p. 66] ↩
Puisqu'on a parlé des Bulgares dans le Dictionnaire encyclopédique, quelques lecteurs seront peut-être bien aises de savoir qui étaient ces étranges gens qui parurent si méchants, qu'on les traita d'hérétiques , et dont ensuite on donna le nom en France aux non-conformistes qui n'ont pas pour les dames toute l'attention qu'ils leur doivent; de sorte qu'aujourd'hui on appelle ces messieurs Boulgares , en retranchant L et A .
Les anciens Boulgares ne s'attendaient pas qu'un jour dans les halles de Paris, le peuple, dans la conversation familière, s'appellerait mutuellement Boulgare , en y ajoutant des épithètes qui enrichissent la langue.
Ces peuples étaient originairement des Huns qui s'étaient établis auprès du Volga; et de Volgares on fit aisément Boulgares .
Sur la fin du septième siècle, ils firent des irruptions vers le Danube, ainsi que tous les peuples qui habitent la Sarmatie; et ils inondèrent l'empire romain comme les autres. Ils passèrent par la Moldavie, la Valachie, où les Russes leurs anciens compatriotes ont porté leurs armes victorieuses en 1769 sous l'empire de CatherineII .
Ayant franchi le Danube, ils s'établirent dans une partie de la Dacie et de la Moesie, et donnèrent leur nom à ces pays qu'on appelle encore Bulgarie. Leur domination s'étendait jusqu'au mont Hémus, et au Pont-Euxin.
L'empereur Nicéphore successeur d'Irène, du temps de Charlemagne, fut assez imprudent pour marcher contre eux après avoir été vaincu par les Sarrasins; il le fut aussi par les Bulgares. Leur roi nommé Crom, lui coupa la tête, et fit de son crâne une coupe dont il se servait dans ses repas, selon la coutume de ces peuples, et de presque tous les hyperboréens.
On conte qu'au neuvième siècle, un Bogoris qui faisait la guerre à la princesse Théodora, mère et tutrice de l'empereur Michel, fut si charmé de la noble réponse de cette impératrice à sa déclaration de guerre, qu'il se fit chrétien.
Les Boulgares qui n'étaient pas si complaisants, se révoltèrent contre lui; mais Bogoris leur ayant montré une croix, ils se firent tous baptiser sur le champ. C'est ainsi que s'en expliquent les auteurs grecs du Bas-Empire; et c'est ainsi que le disent après eux nos compilateurs.
Et voilà justement comme on écrit l'histoire .
Théodora était, disent-ils, une princesse très religieuse, et qui même passa ses dernières années dans un couvent. Elle eut tant d'amour pour la religion catholique grecque, qu'elle fit mourir par divers supplices cent mille hommes qu'on accusait d'être Histoire rom. prétendue traduite de Laurent Echard , tom. II, pag. 242. manichéens. ‘C'était, dit le modeste continuateur d'Echard, la plus impie, la plus détestable, la plus dangereuse, la plus abominable de toutes les hérésies. Les censures ecclésiastiques étaient des armes trop faibles contre des hommes qui ne reconnaissaient point l'Eglise'.
On prétend que les Bulgares voyant qu'on tuait tous les manichéens, eurent dès ce moment du penchant pour leur religion, et la crurent la meilleure puisqu'elle était persécutée; mais cela est bien fin pour des Bulgares.
Le grand schisme éclata dans ce temps-là plus que jamais entre l'Eglise grecque sous le patriarche Photius, et l'Eglise latine sous le pape Nicolas I er . Les Bulgares prirent le parti de l'Eglise grecque. Ce fut probablement dès lors qu'on les traita en Occident d' hérétiques ; et qu'on y ajouta la belle épithète dont on les charge encore aujourd'hui.
L'empereur Basile leur envoya en 871 un prédicateur nommé Pierre de Sicile pour les préserver de l'hérésie du manichéisme, et on ajoute que dès qu'ils l'eurent écouté ils se firent manichéens. Il se peut très bien que ces Bulgares qui buvaient dans le crâne de leurs ennemis, ne fussent pas d'excellents théologiens, non plus que Pierre de Sicile.
Il est singulier que ces barbares qui ne savaient ni lire ni écrire, aient été regardés comme des hérétiques très déliés, contre lesquels il était très dangereux de disputer. Ils avaient certainement autre chose à faire qu'à parler de controverse, puisqu'ils firent une guerre sanglante aux empereurs de Constantinople pendant quatre siècles de suite, et qu'ils assiégèrent même la capitale de l'empire.
Au commencement du treizième siècle, l'empereur Alexis voulant se faire reconnaître par les Bulgares, leur roi Joannic lui répondit qu'il ne serait jamais son vassal. Le pape Innocent III ne manqua pas de saisir cette occasion pour s'attacher le royaume de Bulgarie. Il envoya au roi Joannic un légat pour le sacrer roi, et prétendit lui avoir conféré le royaume qui ne devait plus relever que du Saint-Siège.
C'était le temps le plus violent des croisades; le Bulgare indigné fit alliance avec les Turcs, déclara la guerre au pape et à ses croisés, prit le prétendu empereur Baudouin prisonnier, lui fit couper les bras, les jambes et la tête; et se fit une coupe de son crâne à la manière de Crom. C'en était bien assez pour que les Boulgares fussent en horreur à toute l'Europe, on n'avait pas besoin de les appeler manichéens , nom qu'on donnait alors à tous les hérétiques. Car manichéen, patarin et vaudois, c'était la même chose. On prodiguait ces noms à quiconque ne voulait pas se soumettre à l'Eglise romaine.
Le mot de boulgare tel qu'on le prononçait, fut une injure vague et indéterminée, appliquée à quiconque avait des moeurs barbares ou corrompues. C'est pourquoi, sous St Louis, frère Robert, grand inquisiteur, qui était un scélérat, fut accusé juridiquement d'être un boulgare par les communes de Picardie.
Ce terme changea ensuite de signification vers les frontières de France; il devint un terme d'amitié. Rien n'était plus commun en Flandre, il y a quarante ans, que de dire d'un jeune homme bien fait, c'est un joli boulgare : un bon homme était un bon boulgare .
Lorsque Louis XIV alla faire la conquête de la Flandre, les Flamands disaient en le voyant, Notre gouverneur est un bien plat boulgare en comparaison de celui-ci .
En voilà assez pour l'étymologie de ce beau nom.
BULLE. [p. 69] ↩
Ce mot désigne la boule ou le sceau d'or, d'argent, de cire ou de plomb, attaché à un instrument, ou charte quelconque. Le plomb pendant aux rescrits expédiés en cour romaine porte d'un côté les têtes de St Pierre à droite, et de St Paul à gauche. On lit au revers le nom du pape régnant, et l'an de son pontificat. La bulle est écrite sur parchemin. Dans la salutation le pape ne prend que le titre de serviteur des serviteurs de Dieu , suivant cette sainte parole Matth. ch. XX, v. 7. de Jésus à ses disciples: Celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre serviteur .
Des hérétiques prétendent que par cette formule humble en apparence, les papes expriment une espèce de système féodal, par lequel la chrétienté est soumise à un chef qui est Dieu, dont les grands vassaux, St Pierre et St Paul, sont représentés par le pontife leur serviteur; et les arrière-vassaux sont tous les princes séculiers, soit empereurs, rois, ou ducs.
Ils se fondent, sans doute, sur la fameuse bulle in Coena Domini , qu'un cardinal diacre lit publiquement à Rome chaque année, le jour de la cène, ou le jeudi saint, en présence du pape accompagné des autres cardinaux et des évêques. Après cette lecture, sa sainteté jette un flambeau allumé dans la place publique, pour marque d'anathème.
Cette bulle se trouve pag. 714, tom. I du Bullaire imprimé à Lyon en 1673, et pag. 118 de l'édition de 1727. La plus ancienne est de 1536. Paul III, sans marquer l'origine de cette cérémonie, y dit que c'est une ancienne coutume des souverains pontifes de publier cette excommunication le jeudi saint, pour conserver la pureté de la religion chrétienne, et pour entretenir l'union des fidèles. Elle contient vingt-quatre paragraphes, dans lesquels ce pape excommunie:
1 o . Les hérétiques, leurs fauteurs, et ceux qui lisent leurs livres.
2 o . Les pirates, et surtout ceux qui osent aller en course sur les mers du souverain pontife.
3 o . Ceux qui imposent dans leurs terres de nouveaux péages.
10 o . Ceux qui, en quelque manière que ce puisse être, empêchent l'exécution des lettres apostoliques, soit qu'elles accordent des grâces, ou qu'elles prononcent des peines.
11 o . Les juges laïques qui jugent les ecclésiastiques, et les tirent à leur tribunal, soit que ce tribunal s'appelle audience, chancellerie, conseil , ou parlement .
12 o . Tous ceux qui ont fait ou publié, feront, ou publieront des édits, règlements, pragmatiques, par lesquels la liberté ecclésiastique, les droits du pape et ceux du Saint-Siège seront blessés, ou restreints en la moindre chose, tacitement ou expressément.
14 o . Les chanceliers, conseillers ordinaires ou extraordinaires de quelque roi ou prince que ce puisse être, les présidents des chancelleries, conseils ou parlements, comme aussi les procureurs généraux, qui évoquent à eux les causes ecclésiastiques, ou qui empêchent l'exécution des lettres apostoliques; même quand ce serait sous prétexte d'empêcher quelque violence.
Par le même paragraphe le pape se réserve à lui seul d'absoudre lesdits chanceliers, conseillers, procureurs généraux et autres excommuniés, lesquels ne pourront être absous qu'après qu'ils auront publiquement révoqué leurs arrêts, et les auront arrachés des registres.
20 o . Enfin le pape excommunie ceux qui auront la présomption de donner l'absolution aux excommuniés ci-dessus; et, afin qu'on n'en puisse prétendre cause d'ignorance, il ordonne
21 o . Que cette bulle sera publiée et affichée à la porte de la basilique du prince des apôtres, et à celle de St Jean de Latran.
22 o . Que tous patriarches, primats, archevêques et évêques, en vertu de la sainte obédience, aient à publier solennellement cette bulle, au moins une fois l'an.
24 o . Il déclare que, si quelqu'un ose aller contre la disposition de cette bulle, il doit savoir qu'il va encourir l'indignation de Dieu tout-puissant, et celle des bienheureux apôtres St Pierre et St Paul.
Les autres bulles postérieures appelées aussi in Coena Domini , ne sont qu'ampliatives. L'article 21, par exemple, de celle de PieV , de l'année 1567, ajoute au paragraphe 3 de celle dont nous venons de parler, que tous les princes qui mettent dans leurs Etats de nouvelles impositions, de quelque nature qu'elles soient, ou qui augmentent les anciennes, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'approbation du Saint-Siège, sont excommuniés ipso facto .
La troisième bulle in Coena Domini de 1610, contient trente paragraphes, dans lesquels Paul V renouvelle les dispositions des deux précédentes.
La quatrième et dernière bulle in Coena Domini , qu'on trouve dans le Bullaire , est du 1 er avril 1627. Urbain VIII y annonce qu'à l'exemple de ses prédécesseurs, pour maintenir inviolablement l'intégrité de la foi, la justice et la tranquillité publique, il se sert du glaive spirituel de la discipline ecclésiastique pour excommunier en ce jour qui est l'anniversaire de la cène du Seigneur:
1 o . Les hérétiques.
2 o . Ceux qui appellent du pape au futur concile; et le reste comme dans les trois premières.
On dit que celle qui se lit à présent est de plus fraîche date, et qu'on y a fait quelques additions.
L' Histoire de Naples par Giannone, fait voir quels désordres les ecclésiastiques ont causé dans ce royaume, et quelles vexations ils y ont exercées sur tous les sujets du roi, jusqu'à leur refuser l'absolution et les sacrements, pour tâcher d'y faire recevoir cette bulle, laquelle vient enfin d'y être proscrite solennellement, ainsi que dans la Lombardie autrichienne, dans les Etats de l'impératrice-reine, dans ceux du duc de Parme et ailleurs.[64]
L'an 1580, le clergé de France avait pris le temps des vacances du parlement de Paris pour faire publier la même bulle in Coena Domini . Mais le procureur général s'y opposa, et la chambre des vacations, présidée par le célèbre et malheureux Brisson, rendit le 4 octobre un arrêt qui enjoignait à tous les gouverneurs de s'informer quels étaient les archevêques, évêques, ou les grands vicaires qui avaient reçu ou cette bulle ou une copie sous le titre: Litterae processûs , et quel était celui qui la leur avait envoyée pour la publier; d'en empêcher la publication si elle n'était pas encore faite; d'en retirer les exemplaires, et de les envoyer à la chambre; et en cas qu'elle fût publiée, d'ajourner les archevêques, les évêques ou leurs grands vicaires à comparaître devant la chambre, et à répondre au réquisitoire du procureur général; et cependant de saisir leur temporel, et de le mettre sous la main du roi; de faire défense d'empêcher l'exécution de cet arrêt sous peine d'être puni comme ennemi de l'Etat et criminel de lèse-majesté, avec ordre d'imprimer cet arrêt et d'ajouter foi aux copies collationnées par des notaires comme à l'original même.
Le parlement ne faisait en cela qu'imiter faiblement l'exemple de Philippe le Bel. La bulle Ausculta Fili du 5 décembre 1301 lui fut adressée par Boniface VIII, qui, après avoir exhorté ce roi à l'écouter avec docilité, lui disait: ‘Dieu nous a établi sur les rois et les royaumes pour arracher, détruire, perdre, dissiper, édifier et planter en son nom et par sa doctrine. Ne vous laissez donc pas persuader que vous n'ayez point de supérieur, et que vous ne soyez pas soumis au chef de la hiérarchie ecclésiastique. Qui pense ainsi est insensé; et qui le soutient opiniâtrement est un infidèle séparé du troupeau du bon pasteur.' Ensuite ce pape entrait dans le plus grand détail sur le gouvernement de France, jusqu'à faire des reproches au roi sur le changement de la monnaie.
Philippe le Bel fit brûler à Paris cette bulle, et publier à son de trompe cette exécution par toute la ville le dimanche 11 février 1302. Le pape, dans un concile qu'il tint à Rome la même année, fit beaucoup de bruit, et éclata en menaces contre Philippe le Bel, mais sans venir à l'exécution. Seulement on regarde comme l'ouvrage de ce concile la fameuse décrétale Unam sanctam dont voici la substance.
‘Nous croyons et confessons une Eglise sainte, catholique et apostolique, hors laquelle il n'y a point de salut; nous reconnaissons aussi qu'elle est unique, que c'est un seul corps qui n'a qu'un chef et non pas deux comme un monstre. Ce seul chef est Jésus-Christ et St Pierre son vicaire et le successeur de St Pierre. Soit donc les Grecs, soit d'autres qui disent qu'ils ne sont pas soumis à ce successeur, il faut qu'ils avouent qu'ils ne sont pas des ouailles de Jésus-Christ; puisqu'il a dit lui-même, (Jean c.X, v.16) qu' il n'y a qu'un troupeau et un pasteur .
‘Nous apprenons que dans cette Eglise et sous sa puissance sont deux glaives, le spirituel et le temporel: mais l'un doit être employé par l'Eglise et par la main du pontife, l'autre pour l'Eglise et par la main des rois et des guerriers, suivant l'ordre ou la permission du pontife. Or il faut qu'un glaive soit soumis à l'autre, c'est-à-dire, la puissance temporelle à la spirituelle; autrement elles ne seraient point ordonnées, et elles doivent l'être selon l'apôtre, (Rom. c.XIII, v.1). Suivant le témoignage de la vérité, la puissance spirituelle doit instituer et juger la temporelle, et ainsi se vérifie à l'égard de l'Eglise la prophétie de Jérémie: (c.I, v.10) Je t'ai établi sur les nations et les royaumes, et le reste .'
Philippe le Bel de son côté assembla les états généraux; et les communes, dans la requête qu'ils présentèrent à ce monarque, disaient en propres termes: C'est grande abomination d'ouïr que ce Boniface entende malement comme Boulgare (en retranchant l et a ) cette parole d'esperitualité; (en St Matthieu c.XVI, v.19). Ce que tu lieras en terre sera lié au ciel . Comme si cela signifiait que s'il mettait un homme en prison temporelle, Dieu pour ce le mettrait en prison au ciel.
BULLES DE LA CROISADE ET DE LA COMPOSITION.
Si on disait à un Africain ou à un Asiatique sensé que dans la partie de notre Europe où des hommes ont défendu à d'autres hommes de manger de la chair le samedi, le pape donne la permission d'en manger par une bulle, moyennant deux réales de plate, et qu'une autre bulle permet de garder l'argent qu'on a volé, que diraient cet Asiatique et cet Africain? Ils conviendraient du moins que chaque pays a ses usages; et que dans ce monde, de quelque nom qu'on appelle les choses, et quelque déguisement qu'on y apporte, tout se fait pour de l'argent comptant.
Il y a deux bulles sous le nom de la Cruzada , la croisade, l'une du temps d'Isabelle et de Ferdinand, l'autre de Philippe V. La première vend la permission de manger les samedis, ce qu'on appelle la grossura , les issues , les foies , les rognons , les animelles , les gésiers , les ris de veau , le mou , les fressures , les fraises , les têtes , les cous , les hauts d'ailes , les pieds .
La seconde bulle accordée par le pape Urbain VIII, donne la permission de manger gras pendant tout le carême, et absout de tout crime, excepté celui d'hérésie.
Non seulement on vend ces bulles, mais il est ordonné de les acheter, et elles coûtent plus cher, comme de raison, au Pérou et au Mexique qu'en Espagne. On les y vend une piastre. Il est juste que les pays qui produisent l'or et l'argent paient plus que les autres.
Le prétexte de ces bulles est de faire la guerre aux Maures. Les esprits difficiles ne voient pas quel est le rapport entre des fressures et une guerre contre les Africains; et ils ajoutent que Jésus-Christ n'a jamais ordonné qu'on fît la guerre aux mahométans sous peine d'excommunication.
La bulle qui permet de garder le bien d'autrui est appelée la bulle de la composition . Elle est affermée et a rendu longtemps des sommes honnêtes dans toute l'Espagne, dans le Milanais, en Sicile et à Naples. Les adjudicataires chargent les moines les plus éloquents de prêcher cette bulle. Les pécheurs qui ont volé le roi, ou l'Etat, ou les particuliers, vont trouver ces prédicateurs, se confessent à eux, leur exposent combien il serait triste de restituer le tout. Ils offrent cinq, six et quelquefois sept pour cent aux moines pour garder le reste en sûreté de conscience; et la composition faite, ils reçoivent l'absolution.
Le frère prêcheur auteur du Voyage d'Espagne et d'Italie , imprimé à Paris avec privilège, chez Jean-Batiste de l'Epine, Tom. V, pag. 210. s'exprime ainsi sur cette bulle, N'est-il pas bien gracieux d'en être quitte à un prix si raisonnable, sauf à en voler davantage quand on aura besoin d'une plus grosse somme ?
BULLE UNIGÉNITUS.
La bulle in Coena Domini , indigna tous les souverains catholiques qui l'ont enfin proscrite dans leurs Etats; mais la bulle Unigénitus n'a troublé que la France. On attaquait dans la première les droits des princes et des magistrats de l'Europe; ils les soutinrent. On ne proscrivait dans l'autre que quelques maximes de morale et de piété. Personne ne s'en soucia hors les parties intéressées dans cette affaire passagère; mais bientôt ces parties intéressées remplirent la France entière. Ce fut d'abord une querelle des jésuites tout-puissants et des restes de Port-royal écrasé.
Le prêtre de l'Oratoire Quesnel, réfugié en Hollande, avait dédié un commentaire sur le Nouveau Testament, au cardinal de Noailles, alors évêque de Châlons-sur-Marne. Cet évêque l'approuva, et l'ouvrage eut le suffrage de tous ceux qui lisent ces sortes de livres.
Un nommé le Tellier, jésuite, confesseur de Louis XIV, ennemi du cardinal de Noailles, voulut le mortifier en faisant condamner à Rome ce livre qui lui était dédié, et dont il faisait un très grand cas.
Ce jésuite fils d'un procureur de Vire en basse Normandie, avait dans l'esprit toutes les ressources de la profession de son père. Ce n'était pas assez de commettre le cardinal de Noailles avec le pape, il voulut le faire disgracier par le roi son maître. Pour réussir dans ce dessein, il fit composer par ses émissaires des mandements contre lui, qu'il fit signer par quatre évêques. Il minuta encore des lettres au roi qu'il leur fit signer.
Ces manoeuvres, qui auraient été punies dans tous les tribunaux, réussirent à la cour; le roi s'aigrit contre le cardinal, Mme de Maintenon l'abandonna.
Ce fut une suite d'intrigues dont tout le monde voulut se mêler d'un bout du royaume à l'autre; et plus la France était malheureuse alors dans une guerre funeste, plus les esprits s'échauffaient pour une querelle de théologie.
Pendant ces mouvements, le Tellier fit demander à Rome par Louis XIV lui-même, la condamnation du livre de Quesnel, dont ce monarque n'avait jamais lu une page. Le Tellier et deux autres jésuites nommés Doucin et l'Allemand, extrairent cent trois propositions que le pape Clément XI devait condamner; la cour de Rome en retrancha deux pour avoir du moins l'honneur de paraître juger par elle-même.
Le cardinal Fabroni chargé de cette affaire, et livré aux jésuites, fit dresser la bulle par un cordelier nommé frère Palerne, Elie capucin, le barnabite Terrovi, le servite Castelli, et même un jésuite nommé Alfaro.
Le pape Clément XI les laissa faire; il voulait seulement plaire au roi de France qu'il avait longtemps indisposé en reconnaissant l'archiduc Charles depuis empereur, pour roi d'Espagne. Il ne lui en coûtait pour satisfaire le roi qu'un morceau de parchemin scellé en plomb, sur une affaire qu'il méprisait lui-même.
Clément XI ne se fit pas prier, il envoya la bulle, et fut tout étonné d'apprendre qu'elle était reçue presque dans toute la France avec des sifflets et des huées. Comment donc , disait-il au cardinal Carpegne, on me demande instamment cette bulle, je la donne de bon coeur, tout le monde s'en moque!
Tout le monde fut surpris en effet de voir un pape qui, au nom de Jésus-Christ, condamnait comme hérétique, sentant l'hérésie, malsonnante, et offensant les oreilles pieuses, cette proposition, Il est bon de lire des livres de piété le dimanche, surtout la sainte Ecriture . Et cette autre, La crainte d'une excommunication injuste ne doit pas nous empêcher de faire notre devoir .
Les partisans des jésuites étaient alarmés eux-mêmes de cette censure, mais ils n'osaient parler. Les hommes sages et désintéressés criaient au scandale, et le reste de la nation au ridicule.
Le Tellier n'en triompha pas moins jusqu'à la mort de Louis XIV; il était en horreur, mais il gouvernait. Il n'est rien que ce malheureux ne tentât pour faire déposer le cardinal de Noailles; mais ce boute-feu fut exilé après la mort de son pénitent. Le duc d'Orléans, dans sa régence, apaisa ces querelles en s'en moquant. Elles jetèrent depuis quelques étincelles, mais enfin elles sont oubliées et probablement pour jamais. C'est bien assez qu'elles aient duré plus d'un demi-siècle. Heureux encore les hommes s'ils n'étaient divisés que pour des sottises qui ne font point verser le sang humain!
CALEBASSE. [p. 77] ↩
Ce fruit, gros comme nos citrouilles, croît en Amérique aux branches d'un arbre aussi haut que les plus grands chênes.
Ainsi Matthieu Garo [1] qui croit avoir eu tort en Europe de trouver mauvais que les citrouilles rampent à terre, et ne soient pas pendues au haut des arbres, aurait eu raison au Mexique. Il aurait eu encore raison dans l'Inde où les cocos sont fort élevés. Cela prouve qu'il ne faut jamais se hâter de conclure. Dieu fait bien ce qu'il fait ; sans doute; mais il n'a pas mis les citrouilles à terre dans nos climats, de peur qu'en tombant de haut elles n'écrasent le nez de Matthieu Garo.
La calebasse ne servira ici qu'à faire voir qu'il faut se défier de l'idée que tout a été fait pour l'homme. Il y a des gens qui prétendent que le gazon n'est vert que pour réjouir la vue. Les apparences pourtant seraient que l'herbe est plutôt faite pour les animaux qui la broutent, que pour l'homme à qui le gramen et le trèfle sont assez inutiles. Si la nature a produit les arbres en faveur de quelque espèce, il est difficile de dire à qui elle a donné la préférence: les feuilles, et même l'écorce, nourrissent une multitude prodigieuse d'insectes: les oiseaux mangent leurs fruits, habitent entre leurs branches, y composent l'industrieux artifice de leurs nids, et les troupeaux se reposent sous leurs ombres.
L'auteur du Spectacle de la nature prétend que la mer n'a un flux et un reflux que pour faciliter le départ et l'entrée de nos vaisseaux. Il paraît que Matthieu Garo raisonnait encore mieux: la Méditerranée sur laquelle on a tant de vaisseaux, et qui n'a de marée qu'en trois on quatre endroits, détruit l'opinion de ce philosophe.
Jouissons de ce que nous avons, et ne croyons pas être la fin et le centre de tout. Voici sur cette maxime quatre petits vers d'un géomètre; il les calcula un jour en ma présence: ils ne sont pas pompeux.
Homme chétif, la vanité te point.
Tu te fais centre: encore si c'était ligne!
Mais dans l'espace à grand-peine es-tu point .
Vas, sois zéro : ta sottise en est digne.
CARACTÈRE. [p. 79] ↩
Peut-on changer de caractère? Oui, si on change de corps. Il se peut qu'un homme né brouillon, inflexible et violent, étant tombé dans sa vieillesse en apoplexie, devienne un sot enfant pleureur, timide et paisible. Son corps n'est plus le même. Mais tant que ses nerfs, son sang, et sa moelle allongée seront dans le même état, son naturel ne changera pas plus que l'instinct d'un loup et d'une fouine.
L'auteur anglais du Dispensari , petit poème très supérieur aux capitoli italiens, et peut-être même au Lutrin de Boileau, a très bien dit, ce me semble,
Un mélange secret de feu, de terre et d'eau
Fit le coeur de César, et celui de Nassau.
D'un ressort inconnu, le pouvoir invincible
Rendit Slone impudent et sa femme sensible.
Le caractère est formé de nos idées et de nos sentiments: or il est très prouvé qu'on ne se donne ni sentiments ni idées; donc notre caractère ne peut dépendre de nous.
S'il en dépendait, il n'y a personne qui ne fût parfait.
Nous ne pouvons nous donner des goûts, des talents; pourquoi nous donnerions-nous des qualités?
Quand on ne réfléchit pas, on se croit le maître de tout; quand on y réfléchit, on voit qu'on n'est maître de rien.
Voulez-vous changer absolument le caractère d'un homme; purgez-le tous les jours avec des délayants jusqu'à ce que vous l'ayez tué. Charles XII, dans sa fièvre de suppuration sur le chemin de Bender, n'était plus le même homme. On disposait de lui comme d'un enfant.
Si j'ai un nez de travers, et deux yeux de chat, je peux les cacher avec un masque. Puis-je davantage sur le caractère que m'a donné la nature?
Un homme né violent, emporté, se présente devant François I er roi de France, pour se plaindre d'un passe-droit; le visage du prince, le maintien respectueux des courtisans, le lieu même où il est, font une impression puissante sur cet homme; il baisse machinalement les yeux, sa voix rude s'adoucit, il présente humblement sa requête, on le croirait né aussi doux que le sont (dans ce moment au moins) les courtisans, au milieu desquels il est même déconcerté; mais si François I er se connaît en physionomies, il découvre aisément dans ses yeux baissés, mais allumés d'un feu sombre, dans les muscles tendus de son visage, dans ses lèvres serrées l'une contre l'autre, que cet homme n'est pas si doux qu'il est forcé de paraître. Cet homme le suit à Pavie, est pris avec lui, mené avec lui en prison à Madrid; la majesté de François I er ne fait plus sur lui la même impression; il se familiarise avec l'objet de son respect. Un jour en tirant les bottes du roi, et les tirant mal, le roi aigri par son malheur se fâche, mon homme envoie promener le roi, et jette ses bottes par la fenêtre.
Sixte-Quint était né pétulant, opiniâtre, altier, impétueux, vindicatif, arrogant; ce caractère semble adouci dans les épreuves de son noviciat. Commence-t-il à jouir de quelque crédit dans son ordre? il s'emporte contre un gardien et l'assomme à coups de poings: est-il inquisiteur à Venise? il exerce sa charge avec insolence: le voilà cardinal, il est possédé da la rabbia papale : cette rage l'emporte sur son naturel; il ensevelit dans l'obscurité sa personne et son caractère; il contrefait l'humble et le moribond; on l'élit pape; ce moment rend au ressort, que la politique avait plié, toute son élasticité longtemps retenue; il est le plus fier et le plus despotique des souverains.
Naturam expellas furca tamen ipsa redibit.
Chassez le naturel, il revient au galop.
La religion, la morale, mettent un frein à la force du naturel, elles ne peuvent le détruire. L'ivrogne dans un cloître, réduit à un demi-setier de cidre à chaque repas, ne s'enivrera plus, mais il aimera toujours le vin.
L'âge affaiblit le caractère; c'est un arbre qui ne produit plus que quelques fruits dégénérés, mais ils sont toujours de même nature; il se couvre de noeuds et de mousse, il devient vermoulu; mais il est toujours chêne ou poirier. Si on pouvait changer son caractère, on s'en donnerait un, on serait le maître de la nature. Peut-on se donner quelque chose? ne recevons-nous pas tout? Essayez d'animer l'indolent d'une activité suivie, de glacer par l'apathie l'âme bouillante de l'impétueux, d'inspirer du goût pour la musique et pour la poésie à celui qui manque de goût et d'oreille; vous n'y parviendrez pas plus que si vous entrepreniez de donner la vue à un aveugle-né. Nous perfectionnons, nous adoucissons, nous cachons ce que la nature a mis dans nous, mais nous n'y mettons rien.
On dit à un cultivateur, Vous avez trop de poissons dans ce vivier, ils ne prospéreront pas; voilà trop de bestiaux dans vos prés, l'herbe manque, ils maigriront. Il arrive après cette exhortation que les brochets mangent la moitié des carpes de mon homme, et les loups la moitié de ses moutons, le reste engraisse. S'applaudira-t-il de son économie? Ce campagnard, c'est toi-même; une de tes passions a dévoré les autres, et tu crois avoir triomphé de toi. Ne ressemblons-nous pas presque tous à ce vieux général de quatre-vingt-dix ans, qui ayant rencontré de jeunes officiers qui faisaient un peu de désordre avec des filles, leur dit tout en colère, Messieurs, est-ce là l'exemple que je vous donne?
CARÊME. [p. 81] ↩
Nos questions sur le carême ne regarderont que la police. Il paraît utile qu'il y ait un temps dans l'année où l'on égorge moins de boeufs, de veaux, d'agneaux, de volaille. On n'a point encore de jeunes poulets ni de pigeons en février et en mars, temps auquel le carême arrive. Il est bon de faire cesser le carnage quelques semaines dans les pays où les pâturages ne sont pas aussi gras que ceux de l'Angleterre et de la Hollande.
Les magistrats de la police ont très sagement ordonné que la viande fût un peu plus chère à Paris pendant ce temps, et que le profit en fût donné aux hôpitaux. C'est un tribut presque insensible que paient alors le luxe et la gourmandise à l'indigence: car ce sont les riches qui n'ont pas la force de faire carême; les pauvres jeûnent toute l'année.
Il est très peu de cultivateurs qui mangent de la viande une fois par mois. S'il fallait qu'ils en mangeassent tous les jours, il n'y en aurait pas assez pour le plus florissant royaume. Vingt millions de livres de viande par jour feraient sept milliards trois cent millions de livres par année. Ce calcul est effrayant.
Le petit nombre de riches, financiers, prélats, principaux magistrats, grands seigneurs, grandes dames qui daignent faire servir du maigre [2] à leurs tables, jeûnent pendant six semaines avec des soles, des saumons, des vives, des turbots, des esturgeons.
Un de nos plus fameux financiers avait des courriers qui lui apportaient chaque jour pour cent écus de marée à Paris. Cette dépense faisait vivre les courriers, les maquignons qui avaient vendu les chevaux, les pêcheurs qui fournissaient le poisson, les fabricateurs de filets (qu'on nomme en quelques endroits les filetiers ), les constructeurs de bateaux etc., les épiciers chez lesquels on prenait toutes les drogues raffinées qui donnent au poisson un goût supérieur à celui de la viande. Lucullus n'aurait pas fait carême plus voluptueusement.
Il faut encore remarquer que la marée en entrant dans Paris, paie à l'Etat un impôt considérable.
Le secrétaire des commandements du riche, ses valets de chambre, les demoiselles de madame, le chef d'office etc. mangent la desserte du Crésus, et jeûnent aussi délicieusement que lui.
Il n'en est pas de même des pauvres. Non seulement s'ils mangent pour quatre sous d'un mouton coriace, ils commettent un grand péché; mais ils chercheront en vain ce misérable aliment. Que mangeront-ils donc? ils n'ont que leurs châtaignes, leur pain de seigle; les fromages qu'ils ont pressurés du lait de leurs vaches, de leurs chèvres ou de leurs brebis; et quelque peu d'oeufs de leurs poules.
Il y a des Eglises où l'on a pris l'habitude de leur défendre les oeufs et le laitage. Que leur resterait-il à manger? rien. Ils consentent à jeûner; mais ils ne consentent pas à mourir. Il est absolument nécessaire qu'ils vivent, quand ce ne serait que pour labourer les terres des gros bénéficiers et des moines.
On demande donc s'il n'appartient pas uniquement aux magistrats de la police du royaume, chargés de veiller à la santé des habitants, de leur donner la permission de manger les fromages que leurs mains ont pétris, et les oeufs que leurs poules ont pondus?
Il paraît que le lait, les oeufs, le fromage, tout ce qui peut nourrir le cultivateur, sont du ressort de la police, et non pas une cérémonie religieuse.
Nous ne voyons pas que Jésus-Christ ait défendu les omelettes St Luc ch. X, v. 8. à ses apôtres; au contraire, il leur a dit: Mangez ce qu'on vous donnera .
La sainte Eglise a ordonné le carême; mais en qualité d'Eglise elle ne commande qu'au coeur; elle ne peut infliger que des peines spirituelles; elle ne peut faire brûler aujourd'hui, comme autrefois, un pauvre homme qui n'ayant que du lard rance, aura mis un peu de ce lard sur une tranche de pain noir le lendemain du mardi gras.
Quelquefois dans les provinces, des curés s'emportant au-delà de leurs devoirs, et oubliant les droits de la magistrature, s'ingèrent d'aller chez les aubergistes, chez les traiteurs, voir s'ils n'ont pas quelques onces de viande dans leurs marmites, quelques vieilles poules à leur croc, ou quelques oeufs dans une armoire lorsque les oeufs sont défendus en carême. Alors ils intimident le pauvre peuple; ils vont jusqu'à la violence envers des malheureux qui ne savent pas que c'est à la seule magistrature qu'il appartient de faire la police. C'est une inquisition odieuse et punissable.
Il n'y a que les magistrats qui puissent être informés au juste des denrées plus ou moins abondantes, qui peuvent nourrir le pauvre peuple des provinces. Le clergé a des occupations plus sublimes. Ne serait-ce donc pas aux magistrats qu'il appartiendrait de régler ce que le peuple peut manger en carême? Qui aura l'inspection sur le comestible d'un pays, sinon la police du pays?
CARTÉSIANISME. [p. 84] ↩
On a pu voir à l'article Aristote que ce philosophe et ses sectateurs se sont servis de mots qu'on n'entend point, pour signifier des choses qu'on ne conçoit pas. Entéléchie, formes substantielles, espèces intentionnelles .
Ces mots après tout ne signifiaient que l'existence des choses dont nous ignorons la nature et la fabrique. Ce qui fait qu'un rosier produit une rose et non pas un abricot, ce qui détermine un chien à courir après un lièvre, ce qui constitue les propriétés de chaque être a été appelé forme substantielle ; ce qui fait que nous pensons a été nommé entéléchie ; ce qui nous donne la vue d'un objet a été nommé espèce intentionnelle ; nous n'en savons pas plus aujourd'hui sur le fond des choses. Les mots de force , d' âme , de gravitation même ne nous font nullement connaître le principe et la nature de la force, ni de l'âme, ni de la gravitation. Nous en connaissons les propriétés, et probablement nous nous en tiendrons là tant que nous ne serons que des hommes.
L'essentiel est de nous servir avec avantage des instruments que la nature nous a donnés sans pénétrer jamais dans la structure intime du principe de ces instruments. Archimède se servait admirablement du ressort, et ne savait pas ce que c'est que le ressort.
La véritable physique consiste donc à bien déterminer tous les effets. Nous connaîtrons les causes premières quand nous serons des dieux. Il nous est donné de calculer, de peser, de mesurer, d'observer; voilà la philosophie naturelle; presque tout le reste est chimère.
Le malheur de Descartes fut de n'avoir pas, dans son voyage d'Italie, consulté Galilée qui calculait, pesait, mesurait, observait, qui avait inventé le compas de proportion, trouvé la pesanteur de l'atmosphère, découvert les satellites de Jupiter et la rotation du soleil sur son axe.
Ce qui est surtout bien étrange, c'est qu'il n'ait jamais cité Galilée, et qu'au contraire il ait cité le jésuite Skeiner plagiaire et Principes de Descartes, 3 e part. pag. 159. ennemi de Galilée, qui déféra ce grand homme à l'Inquisition, et qui par là couvrit l'Italie d'opprobre, lorsque Galilée la couvrait de gloire.
Les erreurs de Descartes sont:
1 o . D'avoir imaginé trois éléments qui n'étaient nullement évidents, après avoir dit qu'il ne fallait rien croire sans évidence.
2 o . D'avoir dit qu'il y a toujours également de mouvement dans la nature, ce qui est démontré faux.
3 o . Que la lumière ne vient point du soleil et qu'elle est transmise à nos yeux en un instant, démontré faux par les expériences de Roëmer, de Molineux et de Bradley, et même par la simple expérience du prisme.
4 o . D'avoir admis le plein, dans lequel il est démontré que tout mouvement serait impossible, et qu'un pied cube d'air pèserait autant qu'un pied cube d'or.
5 o . D'avoir supposé un tournoiement imaginaire dans de prétendus globules de lumière pour expliquer l'arc-en-ciel.
6 o . D'avoir imaginé un prétendu tourbillon de matière subtile qui emporte la terre et la lune parallèlement à l'équateur, et qui fait tomber les corps graves dans une ligne tendante au centre de la terre, tandis qu'il est démontré que dans l'hypothèse de ce tourbillon imaginaire tous les corps tomberaient suivant une ligne perpendiculaire à l'axe de la terre.
7 o . D'avoir supposé que des comètes qui se meuvent d'orient en occident et du nord au sud, sont poussées par des tourbillons qui se meuvent d'occident en orient.
8 o . D'avoir supposé que dans le mouvement de rotation les corps les plus denses allaient au centre, et les plus subtils à la circonférence, ce qui est contre toutes les lois de la nature.
9 o . D'avoir voulu étayer ce roman par des suppositions encore plus chimériques que le roman même, d'avoir supposé contre toutes les lois de la nature que ces tourbillons ne se confondraient pas ensemble, et d'en avoir donné pour preuve cette figure qui n'est pas assurément une figure géométrique.

10 o . D'avoir donné cette figure même pour la cause des marées et pour celle des propriétés de l'aimant.
11 o . D'avoir supposé que la mer a un cours inconnu, qui la porte d'orient en occident.
12 o . D'avoir imaginé que la matière de son premier élément mêlée avec celle du second, forme le mercure qui, par le moyen de ces deux éléments, est coulant comme l'eau et compact comme la terre.
13 o . Que la terre est un soleil encroûté.
14 o . Qu'il y a de grandes cavités sous toutes les montagnes qui reçoivent l'eau de la mer et qui forment les fontaines.
15 o . Que les mines de sel viennent de la mer.
16 o . Que les parties de son troisième élément composent des vapeurs qui forment des métaux et des diamants.
17 o . Que le feu est produit par un combat du premier et du second élément.
18 o . Que les pores de l'aimant sont remplis de la matière cannelée, enfilée par la matière subtile qui vient du pôle boréal.
19 o . Que la chaux vive ne s'enflamme lorsqu'on y jette de l'eau, que parce que le premier élément chasse le second élément des pores de la chaux.
20 o . Que les viandes digérées dans l'estomac passent par une infinité de trous dans une grande veine qui les porte au foie, ce qui est entièrement contraire à l'anatomie.
21 o . Que le chyle, dès qu'il est formé, acquiert dans le foie la forme du sang, ce qui n'est pas moins faux.
22 o . Que le sang se dilate dans le coeur par un feu sans lumière.
23 o . Que le pouls dépend de onze petites peaux qui ferment et ouvrent les entrées des quatre vaisseaux dans les deux concavités du coeur.
24 o . Que quand le foie est pressé par ses nerfs, les plus subtiles parties du sang montent incontinent vers le coeur.
25 o . Que l'âme réside dans la glande pinéale du cerveau. Mais comme il n'y a que deux petits filaments nerveux qui aboutissent à cette glande, et qu'on a disséqué des sujets dans qui elle manquait absolument, on la plaça depuis dans les corps cannelés, dans les nates , les testes , l' infundibulum , dans tout le cervelet. Ensuite Lancisi, et après lui la Peyronie, lui donnèrent pour habitation le corps calleux. L'auteur ingénieux et savant qui a donné dans l'Encyclopédie l'excellent paragraphe Ame marqué d'une étoile, dit avec raison qu'on ne sait plus où la mettre.
26 o . Que le coeur se forme des parties de la semence qui se dilate, c'est assurément plus que les hommes n'en peuvent savoir; il faudrait avoir vu la semence se dilater et le coeur se former.
27 o . Enfin, sans aller plus loin, il suffira de remarquer que son système sur les bêtes n'étant fondé ni sur aucune raison physique, ni sur aucune raison morale, ni sur rien de vraisemblable, a été justement rejeté de tous ceux qui raisonnent et de tous ceux qui n'ont que du sentiment.
Il faut avouer qu'il n'y eut pas une seule nouveauté dans la physique de Descartes qui ne fût une erreur. Ce n'est pas qu'il n'eût beaucoup de génie; au contraire, c'est parce qu'il ne consulta que ce génie, sans consulter l'expérience et les mathématiques; il était un des plus grands géomètres de l'Europe, et il abandonna sa géométrie pour ne croire que son imagination. Il ne substitua donc qu'un chaos au chaos d'Aristote. Par là il retarda de plus de cinquante ans les progrès de l'esprit humain. Ses erreurs étaient d'autant plus condamnables qu'il avait pour se conduire dans le labyrinthe de la physique, un fil qu'Aristote ne pouvait avoir, celui des expériences; les découvertes de Galilée, de Toricelli, de Guéric etc., et surtout sa propre géométrie.
On a remarqué que plusieurs universités condamnèrent dans sa philosophie les seules choses qui fussent vraies, et qu'elles adoptèrent enfin toutes celles qui étaient fausses. Il ne reste aujourd'hui de tous ces faux systèmes et de toutes les ridicules disputes qui en ont été la suite, qu'un souvenir confus qui s'éteint de jour en jour. L'ignorance préconise encore quelquefois Descartes, et même cette espèce d'amour-propre qu'on appelle national s'est efforcé de soutenir sa philosophie. Des gens qui n'avaient jamais lu ni Descartes ni Newton, ont prétendu que Newton lui avait l'obligation de toutes ses découvertes. Mais il est très certain qu'il n'y a pas dans tous les édifices imaginaires de Descartes une seule pierre sur laquelle Newton ait bâti. Il ne l'a jamais ni suivi ni expliqué, ni même réfuté; à peine le connaissait-il. Il voulut un jour en lire un volume, il mit en marge à sept ou huit pages error , et ne le relut plus. Ce volume a été longtemps entre les mains du neveu de Newton.
Le cartésianisme a été une mode en France; mais les expériences de Newton sur la lumière et ses principes mathématiques, ne peuvent pas plus être une mode que les démonstrations d'Euclide.
Il faut être vrai; il faut être juste; le philosophe n'est ni Français ni Anglais, ni Florentin, il est de tout pays. Il ne ressemble pas à la duchesse de Marlborough qui, dans une fièvre tierce, ne voulait pas prendre de quinquina, parce qu'on l'appelait en Angleterre la poudre des jésuites .
Le philosophe, en rendant hommage au génie de Descartes, foule aux pieds les ruines de ses systèmes.
Le philosophe surtout dévoue à l'exécration publique et au mépris éternel les persécuteurs de Descartes qui osèrent l'accuser d'athéisme, lui qui avait épuisé toute la sagacité de son esprit à chercher de nouvelles preuves de l'existence de Dieu. Lisez le morceau de M. Thomas dans l'éloge de Descartes, où il peint d'une manière si énergique l'infâme théologien Voëtius qui calomnia Descartes, comme depuis le fanatique Jurieu calomnia Bayle, etc. etc. etc., comme Patouillet et Nonotte ont calomnié un philosophe, comme le vinaigrier Chaumel et Fréron ont calomnié l'Encyclopédie, comme on calomnie tous les jours. Et plût à Dieu qu'on ne pût que calomnier.
DE CATON, DU SUICIDE, [p. 89] ↩
ET DU LIVRE DE L'ABBÉ DE ST.CYRAN QUI LÉGITIME LE SUICIDE.
L'ingénieux La Motte s'est exprimé ainsi sur Caton dans une de ses odes plus philosophiques que poétiques:
Caton d'une âme plus égale,
Sous l'heureux vainqueur de Pharsale,
Eût souffert que Rome pliât;
Mais incapable de se rendre,
Il n'eut pas la force d'attendre
Un pardon qui l'humiliât.
C'est, je crois, parce que l'âme de Caton fut toujours égale, et qu'elle conserva jusqu'au dernier moment le même amour pour les lois et pour la patrie, qu'il aima mieux périr avec elles que de ramper sous un tyran; il finit comme il avait vécu.
Incapable de se rendre ! Et à qui? à l'ennemi de Rome, à celui qui avait volé de force le trésor public pour faire la guerre à ses concitoyens, et les asservir avec leur argent même?
Un pardon ! il semble que La Motte Houdart parle d'un sujet révolté qui pouvait obtenir sa grâce de Sa Majesté avec des lettres en chancellerie.
Malgré sa grandeur usurpée,
Le fameux vainqueur de Pompée
Ne put triompher de Caton.
C'est à ce juge inébranlable
Que César, cet heureux coupable,
Aurait dû demander pardon.
Il paraît qu'il y a quelque ridicule à dire que Caton se tua par faiblesse . Il faut une âme forte pour surmonter ainsi l'instinct le plus puissant de la nature. Cette force est quelquefois celle d'un frénétique; mais un frénétique n'est pas faible.
Le suicide est défendu chez nous par le droit canon. Mais les décrétales qui font la jurisprudence d'une partie de l'Europe, furent inconnues à Caton, à Brutus, à Cassius, à la sublime Arria, à l'empereur Othon, à Marc-Antoine et à cent héros de la véritable Rome, qui préférèrent une mort volontaire à une vie qu'ils croyaient ignominieuse.
Nous nous tuons aussi nous autres; mais c'est quand nous avons perdu notre argent, ou dans l'excès très rare d'une folle passion, pour un objet qui n'en vaut pas la peine. J'ai connu des femmes qui se sont tuées pour les plus sots hommes du monde. On se tue aussi quelquefois parce qu'on est malade; et c'est en cela qu'il y a de la faiblesse.
Le dégoût de son existence, l'ennui de soi-même, est encore une maladie qui cause des suicides. Le remède serait un peu d'exercice, de la musique, la chasse, la comédie, une femme aimable. Tel homme qui dans un accès de mélancolie se tue aujourd'hui, aimerait à vivre s'il attendait huit jours.
J'ai presque vu de mes yeux un suicide qui mérite l'attention de tous les physiciens. Un homme d'une profession sérieuse, d'un âge mûr, d'une conduite régulière, n'ayant point de passions, étant au-dessus de l'indigence, s'est tué le 17 octobre 1769, et a laissé au conseil de la ville où il était né, l'apologie par écrit de sa mort volontaire, laquelle on n'a pas jugé à propos de publier, de peur d'encourager les hommes à quitter une vie dont on dit tant de mal. Jusque-là il n'y a rien de bien extraordinaire; on voit partout de tels exemples. Voici l'étonnant.
Son frère et son père s'étaient tués, chacun au même âge que lui. Quelle disposition secrète d'organes, quelle sympathie, quel concours de lois physiques fait périr le père et les deux enfants de leur propre main et du même genre de mort, précisément quand ils ont atteint la même année? Est-ce une maladie qui se développe à la longue dans une famille, comme on voit souvent les pères et les enfants mourir de la petite vérole, de la pulmonie ou d'un autre mal? Trois, quatre générations sont devenues sourdes, aveugles ou goutteuses, ou scorbutiques dans un temps préfix.
Le physique, ce père du moral, transmet le même caractère de père en fils pendant des siècles. Les Appius furent toujours fiers et inflexibles; les Catons toujours sévères. Toute la lignée des Guises fut audacieuse, téméraire, factieuse, pétrie du plus insolent orgueil et de la politesse la plus séduisante. Depuis François de Guise jusqu'à celui qui seul et sans être attendu alla se mettre à la tête du peuple de Naples, tous furent d'une figure, d'un courage et d'un tour d'esprit au-dessus du commun des hommes. J'ai vu les portraits en pied de François de Guise, du Balafré et de son fils; leur taille est de six pieds; mêmes traits, même courage, même audace sur le front, dans les yeux et dans l'attitude.
Cette continuité, cette série d'êtres semblables est bien plus remarquable encore dans les animaux; et si l'on avait la même attention à perpétuer les belles races d'hommes que plusieurs nations ont encore à ne pas mêler celles de leurs chevaux et de leurs chiens de chasse, les généalogies seraient écrites sur les visages, et se manifesteraient dans les moeurs.
Il y a eu des races de bossus, de six-digitaires, comme nous en voyons de rousseaux, de lippus, de longs nez et de nez plats.
Mais que la nature dispose tellement les organes de toute une race, qu'à un certain âge tous ceux de cette famille auront la passion de se tuer, c'est un problème que toute la sagacité des anatomistes les plus attentifs ne peut résoudre. L'effet est certainement tout physique; mais c'est de la physique occulte. Eh quel est le secret principe qui ne soit pas occulte?
On ne nous dit point, et il n'est pas vraisemblable que du temps de Jules-César et des empereurs, les habitants de la Grande-Bretagne se tuassent aussi délibérément qu'ils le font aujourd'hui quand ils ont des vapeurs qu'ils appellent le spleen , et que nous prononçons le spline .
Au contraire, les Romains qui n'avaient point le spline, ne faisaient aucune difficulté de se donner la mort. C'est qu'ils raisonnaient; ils étaient philosophes, et les sauvages de l'île Britain ne l'étaient pas. Aujourd'hui les citoyens anglais sont philosophes, et les citoyens romains ne sont rien. Aussi les Anglais quittent la vie fièrement quand il leur en prend fantaisie. Mais il faut à un citoyen romain une indulgentia in articulo mortis ; ils ne savent ni vivre ni mourir.
Le chevalier Temple dit, qu'il faut partir quand il n'y a plus d'espérance de rester agréablement. C'est ainsi que mourut Atticus.
Les jeunes filles qui se noient et qui se pendent par amour, ont donc tort; elles devraient écouter l'espérance du changement qui est aussi commun en amour qu'en affaires.
Un moyen presque sûr de ne pas céder à l'envie de vous tuer, c'est d'avoir toujours quelque chose à faire. Crech, le commentateur de Lucrèce, mit sur son manuscrit. NB. Qu'il faudra que je me pende quand j'aurai fini mon commentaire . Il se tint parole pour avoir le plaisir de finir comme son auteur. S'il avait entrepris un commentaire sur Ovide, il aurait vécu plus longtemps.
Pourquoi avons-nous moins de suicides dans les campagnes que dans les villes? C'est que dans les champs il n'y a que le corps qui souffre; à la ville c'est l'esprit. Le laboureur n'a pas le temps d'être mélancolique. Ce sont les oisifs qui se tuent; ce sont ces gens si heureux aux yeux du peuple.
Je résumerai ici quelques suicides arrivés de mon temps, et dont quelques-uns ont déjà été publiés dans d'autres volumes. Les morts peuvent être utiles aux vivants.
PRÉCIS DE QUELQUES SUICIDES SINGULIERS.
Philippe Mordant, cousin germain de ce fameux comte de Peterboroug, si connu dans toutes les cours de l'Europe, et qui se vantait d'être l'homme de l'univers qui a vu le plus de postillons et le plus de rois; Philippe Mordant, dis-je, était un jeune homme de vingt-sept ans, beau, bien fait, riche, né d'un sang illustre, pouvant prétendre à tout; et ce qui vaut encore mieux, passionnément aimé de sa maîtresse. Il prit à ce Mordant un dégoût de la vie; il paya ses dettes, écrivit à ses amis pour leur dire adieu, et même fit des vers dont voici les derniers traits en français:
L'opium peut aider le sage;
Mais, selon mon opinion,
Il lui faut au lieu d'opion
Un pistolet et du courage.
Il se conduisit selon ses principes, et se dépêcha d'un coup de pistolet, sans en avoir donné d'autre raison, sinon que son âme était lasse de son corps, et que quand on est mécontent de sa maison, il faut en sortir. Il semblait qu'il eût voulu mourir, parce qu'il était dégoûté de son bonheur.
Richard Smith en 1726 donna un étrange spectacle au monde pour une cause fort différente. Richard Smith était dégoûté d'être réellement malheureux: il avait été riche, et il était pauvre; il avait eu de la santé, et il était infirme. Il avait une femme à laquelle il ne pouvait faire partager que sa misère: un enfant au berceau était le seul bien qui lui restât. Richard Smith et Bridget Smith, d'un commun consentement, après s'être tendrement embrassés, et avoir donné le dernier baiser à leur enfant, ont commencé par tuer cette pauvre créature, et ensuite se sont pendus aux colonnes de leur lit. Je ne connais nulle part aucune horreur de sang-froid qui soit de cette force; mais la lettre que ces infortunés ont écrite à M. Brindley leur cousin, avant leur mort, est aussi singulière que leur mort même. ‘Nous croyons, disent-ils, que Dieu nous pardonnera, etc. Nous avons quitté la vie, parce que nous étions malheureux sans ressource; et nous avons rendu à notre fils unique le service de le tuer, de peur qu'il ne devînt aussi malheureux que nous, etc.' Il est à remarquer, que ces gens, après avoir tué leur fils par tendresse paternelle, ont écrit à un ami pour lui recommander leur chat et leur chien. Ils ont cru, apparemment, qu'il était plus aisé de faire le bonheur d'un chat et d'un chien dans le monde, que celui d'un enfant, et ils ne voulaient pas être à charge à leur ami.
Milord Scarbourou en 1737 a quitté la vie depuis peu avec le même sang-froid qu'il avait quitté sa place de grand-écuyer. On lui reprochait dans la chambre des pairs, qu'il prenait le parti du roi, parce qu'il avait une belle charge à la cour. ‘Messieurs, dit-il, pour vous prouver que mon opinion ne dépend pas de ma place, je m'en démets dans l'instant.' Il se trouva depuis embarrassé entre une maîtresse qu'il aimait, mais à qui il n'avait rien promis, et une femme qu'il estimait, mais à qui il avait fait une promesse de mariage. Il se tua pour se tirer d'embarras.
Toutes ces histoires tragiques, dont les gazettes anglaises fourmillent, ont fait penser à l'Europe qu'on se tue plus volontiers en Angleterre qu'ailleurs. Je ne sais pourtant, si à Paris il n'y a pas autant de fous ou de héros qu'à Londres; peut-être que si nos gazettes tenaient un registre exact de ceux qui ont eu la démence de vouloir se tuer, et le triste courage de le faire, nous pourrions sur ce point avoir le malheur de tenir tête aux Anglais. Mais nos gazettes sont plus discrètes: les aventures des particuliers ne sont jamais exposées à la médisance publique dans ces journaux avoués par le gouvernement.
Tout ce que j'ose dire avec assurance, c'est qu'il ne sera jamais à craindre, que cette folie de se tuer devienne une maladie épidémique: la nature y a trop bien pourvu; l'espérance, la crainte, sont les ressorts puissants dont elle se sert pour arrêter très souvent la main du malheureux prêt à se frapper.
On entendit un jour le cardinal Dubois se dire à lui-même, Tue-toi donc, tu n'oserais.
On dit qu'il y a eu des pays où un conseil était établi pour permettre aux citoyens de se tuer, quand ils en avaient des raisons valables. Je réponds, ou que cela n'est pas, ou que ces magistrats n'avaient pas une grande occupation.
Ce qui pourrait nous étonner, et ce qui mérite, je crois, un sérieux examen, c'est que les anciens héros romains se tuaient presque tous, quand ils avaient perdu une bataille dans les guerres civiles: et je ne vois point que ni du temps de la Ligue, ni de celui de la Fronde, ni dans les troubles d'Italie, ni dans ceux d'Angleterre, aucun chef ait pris le parti de mourir de sa propre main. Il est vrai que ces chefs étaient chrétiens, et qu'il y a bien de la différence entre les principes d'un guerrier chrétien et ceux d'un héros païen; cependant pourquoi ces hommes, que le christianisme retenait quand ils voulaient se procurer la mort, n'ont-ils été retenus par rien, quand ils ont voulu empoisoner, assassiner, ou faire mourir leurs ennemis vaincus sur des échafauds, etc.? La religion chrétienne ne défend-elle pas ces homicides-là, encore plus que l'homicide de soi-même, dont le Nouveau Testament n'a jamais parlé?
Les apôtres du suicide nous disent, qu'il est très permis de quitter sa maison quand on en est las. D'accord; mais la plupart des hommes aiment mieux coucher dans une vilaine maison que de dormir à la belle étoile.
Je reçus un jour d'un Anglais une lettre circulaire, par laquelle il proposait un prix à celui qui prouverait le mieux qu'il faut se tuer dans l'occasion. Je ne lui répondis point: je n'avais rien à lui prouver: il n'avait qu'à examiner, s'il aimait mieux la mort que la vie.
Un autre Anglais nommé M. Bacon Moris vint me trouver à Paris en 1724; il était malade, et me promit qu'il se tuerait s'il n'était pas guéri au 20 juillet. En conséquence il me donna son épitaphe conçue en ces mots: Qui mare et terrâ pacem quaesivit, hîc invenit . Il me chargea aussi de vingt-cinq louis d'or pour lui dresser un petit monument au bout du faubourg St Martin. Je lui rendis son argent le 20 juillet, et je gardai son épitaphe.
De mon temps, le dernier prince de la maison de Courtenai, très vieux, et le dernier prince de la branche de Lorraine-Harcourt, très jeune, se sont donné la mort sans qu'on en ait presque parlé. Ces aventures font un fracas terrible le premier jour, et quand les biens du mort sont partagés on n'en parle plus.
Voici le plus fort de tous les suicides. Il vient de s'exécuter à Lyon au mois de juin 1770.
Un jeune homme très connu, beau, bien fait, aimable, plein de talents, est amoureux d'une jeune fille, que les parents ne veulent point lui donner. Jusqu'ici ce n'est que la première scène d'une comédie, mais l'étonnante tragédie va suivre.
L'amant se rompt une veine par un effort. Les chirurgiens lui disent qu'il n'y a point de remède; sa maîtresse lui donne un rendez-vous avec deux pistolets et deux poignards, afin que si les pistolets manquent leur coup les deux poignards servent à leur percer le coeur en même temps. Ils s'embrassent pour la dernière fois; les détentes des pistolets étaient attachées à des rubans couleur de rose; l'amant tient le ruban du pistolet de sa maîtresse, elle tient le ruban du pistolet de son amant. Tous deux tirent à un signal donné, tous deux tombent au même instant.
La ville entière de Lyon en est témoin. Arrie et Petus, vous en aviez donné l'exemple; mais vous étiez condamnés par un tyran; et l'amour seul a immolé ces deux victimes. On leur a fait cette épitaphe:
A votre sang mêlons nos pleurs:
Attendrissons-nous d'âge en âge
Sur vos amours et vos malheurs.
Mais admirons votre courage.
DES LOIX CONTRE LE SUICIDE.
Y a-t-il une loi civile ou religieuse qui ait prononcé défense de se tuer sous peine d'être pendu après sa mort, ou sous peine d'être damné?
Il est vrai que Virgile a dit:
Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi lethum
Insontes peperere manu, lucemque perosi
Projecere animas; quam vellent aethere in alto
Nunc et pauperiem et duros perferre labores !
Fata obstant, tristique Palus innabilis unda
Adligat, et novies Styx interfusa coërcet .
Virg. Aeneid. Lib. VI. v. 434. et seqq.
Là sont ces insensés, qui d'un bras téméraire,
Ont cherché dans la mort un secours volontaire;
Qui n'ont pu supporter, faibles et furieux,
Le fardeau de la vie imposé par les dieux.
Hélas! ils voudraient tous se rendre à la lumière,
Recommencer cent fois leur pénible carrière:
Ils regrettent la vie, ils pleurent; et le sort,
Le sort, pour les punir, les retient dans la mort;
L'abîme du Cocyte et l'Acheron terrible,
Met entre eux et la vie un obstacle invincible.
Telle était la religion de quelques païens; et malgré l'ennui qu'on allait chercher dans l'autre monde, c'était un honneur de quitter celui-ci et de se tuer; tant les moeurs des hommes sont contradictoires. Parmi nous le duel n'est-il pas encore malheureusement honorable, quoique défendu par la raison, par la religion et par toutes les lois? Si Caton et César, Antoine et Auguste ne se sont pas battus en duel, ce n'est pas qu'ils ne fussent aussi braves que nos Français. Si le duc de Montmorency, le maréchal de Marillac, de Thou, Cinq-Mars et tant d'autres, ont mieux aimé être traînés au dernier supplice dans une charrette, comme des voleurs de grand chemin, que de se tuer comme Caton et Brutus; ce n'est pas qu'ils n'eussent autant de courage que ces Romains, et qu'ils n'eussent autant de ce qu'on appelle honneur . La véritable raison c'est, que la mode n'était pas alors à Paris de se tuer en pareil cas, et cette mode était établie à Rome.
Les femmes de la côte de Malabar se jettent toutes vives sur le bûcher de leurs maris: ont-elles plus de courage que Cornélie? Non; mais la coutume est dans ce pays-là, que les femmes se brûlent.
Coutume, opinion, reines de notre sort,
Vous réglez des mortels et la vie et la mort.
Au Japon, la coutume est que quand un homme d'honneur a été outragé par un homme d'honneur, il s'ouvre le ventre en présence de son ennemi, et lui dit, Fais-en autant si tu as du coeur. L'agresseur est deshonoré à jamais s'il ne se plonge pas incontinent un grand couteau dans le ventre.
La seule religion dans laquelle le suicide soit défendu par une loi claire et positive, est le mahométisme. Il est dit, dans le sura IV, Ne vous tuez pas vous-même, car Dieu est miséricordieux envers vous; et quiconque se tue par malice et méchamment, sera certainement rôti au feu d'enfer .
Nous traduisons mot à mot. Le texte semble n'avoir pas le sens commun, ce qui n'est pas rare dans les textes. Que veut dire, ne vous tuez point vous-même, car Dieu est miséricordieux ? Peut-être faut-il entendre, ne succombez pas à vos malheurs que Dieu peut adoucir; ne soyez pas assez fou pour vous donner la mort aujourd'hui, pouvant être heureux demain.
Et quiconque se tue par malice et méchamment ? Cela est plus difficile à expliquer. Il n'est peut-être jamais arrivé dans l'antiquité qu'à la Phèdre d'Euripide, de se pendre exprès pour faire accroire à Thésée qu'Hippolite l'avait violée. De nos jours, un homme s'est tiré un coup de pistolet dans la tête, ayant tout arrangé pour faire jeter le soupçon sur un autre.
Dans la comédie de George Dandin , la coquine de femme qu'il a épousée, le menace de se tuer pour le faire pendre. Ces cas sont rares. Si Mahomet les a prévus, on peut dire qu'il voyait de loin.
Le fameux Duverger de Hauranne abbé de St Cyran, regardé comme le fondateur de Port-royal, écrivit vers l'an 1608 un traité sur le suicide, [3] qui est devenu un des livres les plus rares de l'Europe.
‘Le Décalogue, dit-il, ordonne de ne point tuer. L'homicide de soi-même ne semble pas moins compris dans ce précepte que le meurtre du prochain. Or s'il est des cas où il est permis de tuer son prochain, il est aussi des cas où il est permis de se tuer soi-même.
‘On ne doit attenter sur sa vie qu'après avoir consulté la raison. L'autorité publique qui tient la place de Dieu peut disposer de notre vie. La raison de l'homme peut aussi tenir lieu de la raison de Dieu, c'est un rayon de la lumière éternelle.'
St Cyran étend beaucoup cet argument, qu'on peut prendre pour un pur sophisme. Mais quand il vient à l'explication et aux détails, il est plus difficile de lui répondre. ‘On peut, dit-il, se tuer pour le bien de son prince, pour celui de sa patrie, pour celui de ses parents.'
Nous ne voyons pas en effet qu'on puisse condamner les Codrus et les Curtius. Il n'y a point de souverain qui osât punir la famille d'un homme qui se serait dévoué pour lui; que dis-je? il n'en est point qui osât ne la pas récompenser. St Thomas avant St Cyran avait dit la même chose. Mais on n'a besoin ni de Thomas, ni de Bonaventure, ni de Verger de Hauranne, pour savoir qu'un homme qui meurt pour sa patrie est digne de nos éloges.
L'abbé de St Cyran conclut qu'il est permis de faire pour soi-même ce qu'il est beau de faire pour un autre. On sait assez tout ce qui est allégué dans Plutarque, dans Sénèque, dans Montagne et dans cent autres philosophes en faveur du suicide. C'est un lieu commun épuisé. Je ne prétends point ici faire l'apologie d'une action que les lois condamnent; mais ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau n'ont jamais défendu à l'homme de sortir de la vie quand il ne peut plus la supporter. Aucune loi romaine n'a condamné le meurtre de soi-même. Au contraire, voici la loi de l'empereur Marc-Antonin qui ne fut jamais révoquée.
[4] ‘Si votre père ou votre frère, n'étant prévenu d'aucun crime, se tue ou pour se soustraire aux douleurs ou par ennui de la vie ou par désespoir ou par démence, que son testament soit valable, ou que ses héritiers succèdent par intestat.'
Malgré cette loi humaine de nos maîtres, nous traînons encore sur la claie, nous traversons d'un pieu le cadavre d'un homme qui est mort volontairement, nous rendons sa mémoire infâme autant qu'on le peut. Nous déshonorons sa famille autant qu'il est en nous. Nous punissons le fils d'avoir perdu son père, et la veuve d'être privée de son mari. On confisque même le bien du mort; ce qui est en effet ravir le patrimoine des vivants auxquels il appartient. Cette coutume, comme plusieurs autres, est dérivée de notre droit canon, qui prive de la sépulture ceux qui meurent d'une mort volontaire. On conclut de là qu'on ne peut hériter d'un homme qui est censé n'avoir point d'héritage au ciel. Le droit canon, au titre de poenitentiâ , assure que Judas commit un plus grand péché en s'étranglant qu'en vendant notre Seigneur Jésus-Christ.
CAUSES FINALES. [p. 100] ↩
Virgile dit:
Mens agitat molem et magno se corpore miscet .
L'esprit régit le monde; il s'y mêle, il l'anime.
Virgile a bien dit; et Benoît Spinosa[5] qui n'a pas la clarté de Virgile et qui ne le vaut pas, est forcé de reconnaître une intelligence qui préside à tout. S'il me l'avait niée, je lui aurais dit, Benoît, tu es fou; tu as une intelligence et tu la nies, et à qui la nies-tu?
Il vient en 1770 un homme très supérieur à Spinosa à quelques égards, aussi éloquent que le juif hollandais est sec; moins méthodique; mais cent fois plus clair; peut-être aussi géomètre sans affecter la marche ridicule de la géométrie dans un sujet métaphysique et moral: c'est l'auteur du Système de la nature : il a pris le nom de Mirabeau secrétaire de l'Académie française. Hélas! notre bon Mirabeau n'était pas capable d'écrire une page du livre de notre redoutable adversaire. Vous tous, qui voulez vous servir de votre raison et vous instruire, lisez cet éloquent et dangereux passage du Système de la nature , chapitre V, pag. 153 et suivantes.
‘On prétend que les animaux nous fournissent une preuve convaincante d'une cause puissante de leur existence; on nous dit que l'accord admirable de leurs parties, que l'on voit se prêter des secours mutuels afin de remplir leurs fonctions et de maintenir leur ensemble, nous annoncent un ouvrier qui réunit la puissance à la sagesse. Nous ne pouvons douter de la puissance de la nature; elle produit tous les animaux à l'aide des combinaisons de la matière qui est dans une action continuelle; l'accord des parties de ces mêmes animaux est une suite des lois nécessaires de leur nature et de leur combinaison; dès que cet accord cesse, l'animal se détruit nécessairement. Que deviennent alors la sagesse, l'intelligence [6] ou la bonté de la cause prétendue à qui l'on faisait honneur d'un accord si vanté? ces animaux si merveilleux que l'on dit être les ouvrages d'un Dieu immuable, ne s'altèrent-ils point sans cesse et ne finissent-ils pas toujours par se détruire? Où est la sagesse, la bonté, la prévoyance, l'immutabilité [7] d'un ouvrier qui ne paraît occupé qu'à déranger et briser les ressorts des machines qu'on nous annonce comme les chefs-d'oeuvre de sa puissance et de son habileté? si ce Dieu ne peut faire autrement, [8] il n'est ni libre, ni tout-puissant. S'il change de volonté, il n'est point immuable. S'il permet que des machines qu'il a rendues sensibles éprouvent de la douleur, il manque de bonté. [9] S'il n'a pu rendre ses ouvrages plus solides, c'est qu'il a manqué d'habileté. En voyant que les animaux, ainsi que tous les autres ouvrages de la Divinité, se détruisent, nous ne pouvons nous empêcher d'en conclure ou que tout ce que la nature fait est nécessaire et n'est qu'une suite de ses lois, ou que l'ouvrier qui la fait agir est dépourvu de plan, de puissance, de constance, d'habileté, de bonté.
‘L'homme, qui se regarde lui-même comme le chef-d'oeuvre de la Divinité, nous fournirait plus que toute autre production la preuve de l'incapacité ou de la malice [10] de son auteur prétendu. Dans cet être sensible, intelligent, pensant, qui se croit l'objet constant de la prédilection divine, et qui fait son dieu d'après son propre modèle, nous ne voyons qu'une machine plus mobile, plus frêle, plus sujette à se déranger par sa grande complication que celle des êtres les plus grossiers. Les bêtes dépourvues de nos connaissances, les plantes qui végètent, les pierres privées de sentiment, sont à bien des égards des êtres plus favorisés que l'homme; ils sont au moins exempts des peines d'esprit, des tourments de la pensée, des chagrins dévorants, dont celui-ci est si souvent la proie. Qui est-ce qui ne voudrait point être un animal ou une pierre toutes les fois qu'il se rappelle la perte irréparable d'un objet aimé? [11] Ne vaudrait-il pas mieux être une masse inanimée qu'un superstitieux inquiet qui ne fait que trembler ici-bas sous le joug de son Dieu, et qui prévoit encore des tourments infinis dans une vie future? Les êtres privés de sentiment, de vie, de mémoire et de pensée ne sont point affligés par l'idée du passé, du présent et de l'avenir; ils ne se croient pas en danger de devenir éternellement malheureux pour avoir mal raisonné, comme tant d'êtres favorisés, qui prétendent que c'est pour eux que l'architecte du monde a construit l'univers.
‘Que l'on ne nous dise point que nous ne pouvons avoir l'idée d'un ouvrage, sans avoir celle d'un ouvrier distingué de son ouvrage. La nature n'est point un ouvrage: elle a toujours existé par elle-même, [12] c'est dans son sein que tout se fait; elle est un atelier immense pourvu de matériaux, et qui fait les instruments dont elle se sert pour agir: tous ses ouvrages sont des effets de son énergie et des agents ou causes qu'elle fait, qu'elle renferme, qu'elle met en action. Des éléments éternels, incréés, indestructibles, toujours en mouvement, en se combinant diversement, font éclore tous les êtres, et les phénomènes que nous voyons, tous les effets bons ou mauvais que nous sentons, l'ordre ou le désordre, que nous ne distinguons jamais que par les différentes façons dont nous sommes affectés, en un mot toutes les merveilles sur lesquelles nous méditons et raisonnons. Ces éléments n'ont besoin pour cela que de leurs propriétés, soit particulières, soit réunies, et du mouvement qui leur est essentiel, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un ouvrier inconnu pour les arranger, les façonner, les combiner, les conserver et les dissoudre.
‘Mais en supposant pour un instant qu'il soit impossible de concevoir l'univers sans un ouvrier qui l'ait formé et qui veille à son ouvrage, où placerons-nous cet ouvrier? [13] sera-t-il dedans ou hors de l'univers? est-il matière ou mouvement? ou bien n'est-il que l'espace, le néant ou le vide? Dans tous ces cas, ou il ne serait rien, ou il serait contenu dans la nature et soumis à ses lois. S'il est dans la nature, je n'y pense voir que de la matière en mouvement, et je dois en conclure que l'agent qui la meut est corporel et matériel, et que par conséquent il est sujet à se dissoudre. Si cet agent est hors de la nature je n'ai plus aucune idée [14] du lieu qu'il occupe, ni d'un être immatériel, ni de la façon dont un esprit sans étendue peut agir sur la matière dont il est séparé. Ces espaces ignorés, que l'imagination a placés au-delà du monde visible, n'existent point pour un être qui voit à peine à ses pieds: [15] la puissance idéale qui les habite, ne peut se peindre à mon esprit que lorsque mon imagination combinera au hasard les couleurs fantastiques qu'elle est toujours forcée de prendre dans le monde où je suis; dans ce cas je ne ferai que reproduire en idée ce que mes sens auront réellement aperçu: et ce Dieu, que je m'efforce de distinguer de la nature et de placer hors de son enceinte, y rentrera toujours nécessairement et malgré moi.
‘L'on insistera, et l'on dira que si l'on portait une statue ou une montre à un sauvage qui n'en aurait jamais vu, il ne pourrait s'empêcher de reconnaître que ces choses sont des ouvrages de quelque agent intelligent, plus habile et plus industrieux que lui-même: l'on conclura de là que nous sommes pareillement forcés de reconnaître que la machine de l'univers, que l'homme, que les phénomènes de la nature sont des ouvrages d'un agent dont l'intelligence et le pouvoir surpassent de beaucoup les nôtres.
‘Je réponds en premier lieu, que nous ne pouvons douter que la nature ne soit très puissante et très industrieuse; [16] nous admirons son industrie toutes les fois que nous sommes surpris des effets étendus, variés et compliqués que nous trouvons dans ceux de ses ouvrages que nous prenons la peine de méditer: cependant elle n'est ni plus ni moins industrieuse dans l'un de ses ouvrages que dans les autres. Nous ne comprenons pas plus comment elle a pu produire une pierre ou un métal qu'une tête organisée comme celle de Newton: nous appelons industrieux un homme qui peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. La nature peut tout; et dès qu'une chose existe, c'est une preuve qu'elle a pu la faire. Ainsi ce n'est jamais que relativement à nous-mêmes que nous jugeons la nature industrieuse; nous la comparons alors à nous-mêmes; et comme nous jouissons d'une qualité que nous nommons intelligence , à l'aide de laquelle nous produisons des ouvrages où nous montrons notre industrie, nous en concluons que les ouvrages de la nature qui nous étonnent le plus, ne lui appartiennent point, mais sont dûs à un ouvrier intelligent comme nous, dont nous proportionnons l'intelligence à l'étonnement que ses oeuvres produisent en nous; c'est-à-dire, à notre faiblesse et à notre propre ignorance.' [17]
Voyez la réponse à ces arguments aux articles Athéisme et Dieu , et à l'article suivant, Cause finale , écrit longtemps avant le Système de la nature .
CAUSE FINALE.
SECTION PREMIÈRE.
Si une horloge n'est pas faite pour montrer l'heure, j'avouerai alors que les causes finales sont des chimères; et je trouverai fort bon qu'on m'appelle cause finalier , c'est-à-dire, un imbécile.
Toutes les pièces de la machine de ce monde semblent pourtant faites l'une pour l'autre. Quelques philosophes affectent de se moquer des causes finales rejetées par Epicure et par Lucrèce. C'est plutôt, ce me semble, d'Epicure et de Lucrèce qu'il faudrait se moquer. Ils vous disent que l'oeil n'est point fait pour voir; mais qu'on s'en est servi pour cet usage, quand on s'est aperçu que les yeux y pouvaient servir. Selon eux, la bouche n'est point faite pour parler, pour manger, l'estomac pour digérer, le coeur pour recevoir le sang des veines et l'envoyer dans les artères, les pieds pour marcher, les oreilles pour entendre. Ces gens-là cependant avouaient que les tailleurs leur faisaient des habits pour les vêtir, et les maçons des maisons pour les loger; et ils osaient nier à la nature, au grand Etre, à l'intelligence universelle ce qu'ils accordaient tous à leurs moindres ouvriers.
Il ne faut pas sans doute abuser des causes finales; nous avons remarqué qu'en vain M. le Prieur, dans le Spectacle de la nature , prétend que les marées sont données à l'Océan pour que les vaisseaux entrent plus aisément dans les ports, et pour empêcher que l'eau de la mer ne se corrompe. En vain dirait-il que les jambes sont faites pour être bottées, et les nez pour porter des lunettes.
Pour qu'on puisse s'assurer de la fin véritable pour laquelle une cause agit, il faut que cet effet soit de tous les temps et de tous les lieux. Il n'y a pas eu des vaisseaux en tout temps et sur toutes les mers; ainsi l'on ne peut pas dire que l'Océan ait été fait pour les vaisseaux. On sent combien il serait ridicule de prétendre que la nature eût travaillé de tout temps pour s'ajuster aux inventions de nos arts arbitraires, qui tous ont paru si tard; mais il est bien évident que si les nez n'ont pas été faits pour les bésicles, ils l'ont été pour l'odorat, et qu'il y a des nez depuis qu'il y a des hommes. De même les mains n'ayant pas été données en faveur des gantiers, elles sont visiblement destinées à tous les usages que le métacarpe et les phalanges de nos doigts, et les mouvements du muscle circulaire du poignet nous procurent.
Cicéron qui doutait de tout, ne doutait pas pourtant des causes finales.
Il paraît bien difficile surtout, que les organes de la génération ne soient pas destinés à perpétuer les espèces. Ce mécanisme est bien admirable, mais la sensation que la nature a jointe à ce mécanisme est plus admirable encore. Epicure devait avouer que le plaisir est divin; et que ce plaisir est une cause finale, par laquelle sont produits sans cesse ces êtres sensibles qui n'ont pu se donner la sensation.
Cet Epicure était un grand homme pour son temps; il vit ce que Descartes a nié, ce que Gassendi a affirmé, ce que Newton a démontré, qu'il n'y a point de mouvement sans vide. Il conçut la nécessité des atomes pour servir de parties constituantes aux espèces invariables. Ce sont là des idées très philosophiques. Rien n'était surtout plus respectable que la morale des vrais épicuriens; elle consistait dans l'éloignement des affaires publiques incompatibles avec la sagesse, et dans l'amitié, sans laquelle la vie est un fardeau. Mais pour le reste de la physique d'Epicure, elle ne paraît pas plus admissible que la matière cannelée de Descartes. C'est, ce me semble, se boucher les yeux et l'entendement que de prétendre qu'il n'y a aucun dessein dans la nature; et, s'il y a du dessein, il y a une cause intelligente, il existe un Dieu.
On nous objecte les irrégularités du globe, les volcans, les plaines de sables mouvants, quelques petites montagnes abîmées et d'autres formées par des tremblements de terre etc. Mais de ce que les moyeux des roues de votre carrosse auront pris feu, s'ensuit-il que votre carrosse n'ait pas été fait expressément pour vous porter d'un lieu à un autre?
Les chaînes des montagnes qui couronnent les deux hémisphères, et plus de six cents fleuves qui coulent jusqu'aux mers du pied de ces rochers, toutes les rivières qui descendent de ces mêmes réservoirs et qui grossissent les fleuves après avoir fertilisé les campagnes; des milliers de fontaines qui partent de la même source, et qui abreuvent le genre animal et le végétal, tout cela ne paraît pas plus l'effet d'un cas fortuit et d'une déclinaison d'atomes, que la rétine qui reçoit les rayons de la lumière, le cristallin qui les réfracte, l'enclume, le marteau, l'étrier, le tambour de l'oreille qui reçoit les sons, les routes du sang dans nos veines, la systole et la diastole du coeur, ce balancier de la machine qui fait la vie.
SECTION SECONDE.
Mais, dit-on, si Dieu a fait visiblement une chose à dessein, il a donc fait toutes choses à dessein. Il est ridicule d'admettre la Providence dans un cas, et de la nier dans les autres. Tout ce qui est fait a été prévu, a été arrangé. Nul arrangement sans objet, nul effet sans cause; donc tout est également le résultat, le produit d'une cause finale; donc il est aussi vrai de dire que les nez ont été faits pour porter des lunettes, et les doigts pour être ornés de bagues, qu'il est vrai de dire que les oreilles ont été formées pour entendre les sons, et les yeux pour recevoir la lumière.
Il ne résulte de cette objection, rien autre, ce me semble, sinon que tout est l'effet prochain ou éloigné d'une cause finale générale; que tout est la suite des lois éternelles.
Les pierres en tout lieu et en tout temps, ne composent pas des bâtiments; tous les nez ne portent pas des lunettes; tous les doigts n'ont pas une bague; toutes les jambes ne sont pas couvertes de bas de soie. Un ver à soie n'est donc pas fait pour couvrir mes jambes, précisément comme votre bouche est faite pour manger, et votre derrière pour aller à la garde-robe. Il y a donc des effets immédiats produits par les causes finales; et des effets en très grand nombre qui sont des produits éloignés de ces causes.
Tout ce qui appartient à la nature est uniforme, immuable, est l'ouvrage immédiat du maître; c'est lui qui a créé les lois par lesquelles la lune entre pour les trois quarts dans la cause du flux et du reflux de l'Océan, et le soleil pour son quart: c'est lui qui a donné un mouvement de rotation au soleil, par lequel cet astre envoie en sept minutes et demie des rayons de lumière dans les yeux des hommes, des crocodiles et des chats.
Mais, si après bien des siècles nous nous sommes avisés d'inventer des ciseaux et des broches, de tondre avec les uns la laine des moutons, et de les faire cuire avec les autres pour les manger, que peut-on en inférer autre chose, sinon, que Dieu nous a faits de façon qu'un jour nous deviendrions nécessairement industrieux et carnassiers?
Les moutons n'ont pas sans doute été faits absolument pour être cuits et mangés, puisque plusieurs nations s'abstiennent de cette horreur. Les hommes ne sont pas créés essentiellement pour se massacrer, puisque les brames et les respectables primitifs qu'on homme quakers ne tuent personne; mais la pâte dont nous sommes pétris produit souvent des massacres, comme elle produit des calomnies, des vanités, des persécutions et des impertinences. Ce n'est pas que la formation de l'homme soit précisément la cause finale de nos fureurs et de nos sottises; car une cause finale est universelle et invariable en tout temps et en tout lieu. Mais les horreurs et les absurdités de l'espèce humaine n'en sont pas moins dans l'ordre éternel des choses. Quand nous battons notre blé, le fléau est la cause finale de la séparation du grain. Mais si ce fléau, en battant mon grain écrase mille insectes, ce n'est pas par ma volonté déterminée, ce n'est pas non plus par hasard; c'est que ces insectes se sont trouvés cette fois sous mon fléau, et qu'ils devaient s'y trouver.
C'est une suite de la nature des choses, qu'un homme soit ambitieux, que cet homme enrégimente quelquefois d'autres hommes, qu'il soit vainqueur, ou qu'il soit battu; mais jamais on ne pourra dire, L'homme a été créé de Dieu pour être tué à la guerre.
Les instruments que nous a donnés la nature ne peuvent être toujours des causes finales en mouvement. Les yeux donnés pour voir ne sont pas toujours ouverts; chaque sens a ses temps de repos. Il y a même des sens dont on ne fait jamais d'usage. Par exemple, une malheureuse imbécile enfermée dans un cloître à quartorze ans, ferme pour jamais chez elle la porte dont devait sortir une génération nouvelle; mais la cause finale n'en subsiste pas moins; elle agira dès qu'elle sera libre.
CELTES. [p. 109] ↩
Parmi ceux qui ont eu assez de loisir, de secours et de courage pour rechercher l'origine des peuples, il s'en est trouvé qui ont cru trouver celle de nos Celtes, ou qui du moins ont voulu faire accroire qu'ils l'avaient rencontrée; cette illusion était le seul prix de leurs travaux immenses: il ne faut pas la leur envier.
Du moins quand vous voulez connaître quelque chose des Huns (quoiqu'ils ne méritent guère d'être connus, puisqu'ils n'ont rendu aucun service au genre humain) vous trouvez quelques faibles notices de ces barbares chez les Chinois, ce peuple le plus ancien des nations connues après les Indiens. Vous apprenez d'eux que les Huns allèrent dans certains temps, comme des loups affamés ravager des pays regardés encore aujourd'hui comme des lieux d'exil et d'horreur. C'est une bien triste et bien misérable science. Il vaut mieux sans doute cultiver un art utile à Paris, à Lyon et à Bordeaux que d'étudier sérieusement l'histoire des Huns et des ours; mais enfin on est aidé dans ces recherches par quelques archives de la Chine.
Pour les Celtes, point d'archives; on ne connaît pas plus leurs antiquités que celles des Samoyèdes et des terres australes.
Nous n'avons rien appris de nos ancêtres que par le peu de mots que Jules-César leur conquérant a daigné en dire. Il commence ses commentaires par distinguer toutes les Gaules en Belges, Aquitainiens et Celtes.
De là quelques fiers savants ont conclu que les Celtes étaient les Scythes; et dans ces Scythes-Celtes ils ont compris toute l'Europe. Mais pourquoi pas toute la terre? pourquoi s'arrêter en si beau chemin?
On n'a pas manqué de nous dire que Japhet fils de Noé, vint au plus vite au sortir de l'arche peupler de Celtes toutes ces vastes contrées, qu'il gouverna merveilleusement bien. Mais des auteurs plus modestes rapportent l'origine de nos Celtes à la tour de Babel, à la confusion des langues, à Gomer dont jamais personne n'entendit parler jusqu'au temps très récent, où quelques Occidentaux lurent le nom de Gomer dans une mauvaise traduction des Septante.
Et voilà justement comme on écrit l'histoire .
Bochart dans sa chronologie sacrée (quelle chronologie!) prend un tour fort différent; il fait de ces hordes innombrables des Celtes une colonie égyptienne, conduite habilement et facilement des bords fertiles du Nil par Hercule dans les forêts et dans les marais de la Germanie, où sans doute ces colons portèrent tous les arts, la langue égyptienne et les mystères d'Isis, sans qu'on ait pu jamais en retrouver la moindre trace.
Ceux-là m'ont paru avoir encore mieux rencontré, qui ont dit que les Celtes des montagnes du Dauphiné étaient appelés Cottiens, de leur roi Cottius; les Bérichons de leur roi Betrich, les Welches ou Gaulois de leur roi Wallus, les Belges de Balgen, qui veut dire hargneux.
Une origine encore plus belle, c'est celle des Celtes-Pannoniens, du mot latin pannus , drap; attendu, nous dit-on, qu'ils se vêtissaient de vieux morceaux de drap mal cousus, assez ressemblants à l'habit d'Arlequin. Mais la meilleure origine est sans contredit la tour de Babel.
O braves et généreux compilateurs qui avez tant écrit sur des hordes de sauvages, qui ne savaient ni lire ni écrire, j'admire votre laborieuse opiniâtreté! Et vous, pauvres Celtes-Welches, permettez-moi de vous dire aussi bien qu'aux Huns, que des gens qui n'ont pas eu la moindre teinture des arts utiles ou agréables, ne méritent pas plus nos recherches que les porcs et les ânes qui ont habité leur pays.
On dit que vous étiez anthropophages; mais qui ne l'a pas été?
On me parle de vos druides qui étaient de très savants prêtres. Allons donc à l'article Druide .
CEREMONIES, TITRES, PRÉÉMINENCE ,&c. [p. 111] ↩
Toutes ces choses qui seraient inutiles, et même fort impertinentes dans l'état de pure nature, sont fort utiles dans l'état de notre nature corrompue et ridicule.
Les Chinois sont de tous les peuples celui qui a poussé le plus loin l'usage des cérémonies: il est certain qu'elles servent à calmer l'esprit autant qu'à l'ennuyer. Les porte-faix, les charretiers chinois sont obligés au moindre embarras qu'ils causent dans les rues, de se mettre à genoux l'un devant l'autre, et de se demander mutuellement pardon selon la formule prescrite. Cela prévient les injures, les coups, les meurtres; ils ont le temps de s'apaiser, après quoi ils s'aident mutuellement.
Plus un peuple est libre, moins il a de cérémonies; moins de titres fastueux; moins de démonstrations d'anéantissement devant son supérieur. On disait à Scipion, Scipion ; et à César, César : et dans la suite des temps on dit aux empereurs, Votre majesté, votre divinité.
Les titres de St Pierre et de St Paul étaient Pierre et Paul . Leurs successeurs se donnèrent reciproquement le titre de votre sainteté que l'on ne voit jamais dans les Actes des apôtres , ni dans les écrits des disciples.
Nous lisons dans l' Histoire d'Allemagne que le dauphin de France qui fut depuis le roi Charles V, alla vers l'empereur Charles IV à Metz, et qu'il passa après le cardinal de Périgord.
Il fut ensuite un temps où les chanceliers eurent la préséance sur les cardinaux, après quoi les cardinaux l'emportèrent sur les chanceliers.
Les pairs précédèrent en France les princes du sang, et ils marchèrent tous en ordre de pairie jusqu'au sacre de Henri III.
La dignité de la pairie était avant ce temps si éminente, qu'à la cérémonie du sacre d'Elizabeth épouse de Charles IX, en 1571, décrite par Simon Bouquet échevin de Paris, il est dit que les dames et damoiselles de la reine ayant baillé à la dame d'honneur le pain, le vin et le cierge avec l'argent pour l'offerte pour être présentés à la reine par la dite dame d'honneur; cette dite dame d'honneur, pour ce qu'elle était duchesse, commanda aux dames d'aller porter elles-mêmes l'offerte aux princesses , etc. Cette dame d'honneur était la connétable de Montmorency.
Le fauteuil à bras, la chaise à dos, le tabouret, la main droite, et la main gauche, ont été pendant plusieurs siècles d'importants objets de politique, et d'illustres sujets de querelles. Je crois que l'ancienne étiquette concernant les fauteuils vient de ce que chez nos barbares de grands-pères, il n'y avait qu'un fauteuil tout au plus dans une maison, et ce fauteuil même ne servait que quand on était malade. Il y a encore des provinces d'Allemagne et d'Angleterre, où un fauteuil s'appelle une chaise de doléance .
Longtemps après Attila et Dagobert, quand le luxe s'introduisit dans les cours, et que les grands de la terre eurent deux ou trois fauteuils dans leurs donjons, ce fut une belle distinction de s'asseoir sur un de ces trônes; et tel seigneur châtelain prenait acte, comment ayant été à demi-lieue de ses domaines faire sa cour à un comte, il avait été reçu dans un fauteuil à bras.
On voit par les mémoires de Mademoiselle, que cette auguste princesse passa un quart de sa vie dans les angoisses mortelles des disputes pour des chaises à dos. Devait-on s'asseoir dans une certaine chambre sur une chaise ou sur un tabouret, ou même ne point s'asseoir? Voilà ce qui intriguait toute une cour. Aujourd'hui les moeurs sont plus unies; les canapés et les chaises longues sont employées par les dames, sans causer d'embarras dans la société.
Lorsque le cardinal de Richelieu traita du mariage de Henriette de France et de Charles I e r avec les ambassadeurs d'Angleterre, l'affaire fut sur le point d'être rompue, pour deux ou trois pas de plus que les ambassadeurs exigeaient auprès d'une porte; et le cardinal se mit au lit pour trancher toute difficulté. L'histoire a soigneusement conservé cette précieuse circonstance. Je crois que si on avait proposé à Scipion de se mettre nu entre deux draps pour recevoir la visite d'Annibal, il aurait trouvé cette cérémonie fort plaisante.
La marche des carrosses, et ce qu'on appelle le haut du pavé , ont été encore des témoignages de grandeur, des sources de prétentions, de disputes et de combats pendant un siècle entier. On a regardé comme une signalée victoire de faire passer un carrosse devant un autre carrosse. Il semblait à voir les ambassadeurs se promener dans les rues, qu'ils disputassent le prix dans des cirques; et quand un ministre d'Espagne avait pu faire reculer un cocher portugais, il envoyait un courrier à Madrid informer le roi son maître de ce grand avantage.
Nos histoires nous réjouissent par vingt combats à coups de poing pour la préséance, le parlement contre les clercs de l'évêque à la pompe funèbre de Henri IV, la chambre des comptes contre le parlement dans la cathédrale quand Louis XIII donna la France à la Vierge, le duc d'Epernon dans l'église de St Germain contre le garde des sceaux Du Vair. Les présidents des enquêtes gourmèrent dans Notre-Dame le doyen des conseillers de grand'chambre Savare, pour le faire sortir de sa place d'honneur; (tant l'honneur est l'âme des gouvernements monarchiques) et on fut obligé de faire empoigner par quatre archers le président Barillon qui frappait comme un sourd sur ce pauvre doyen. Nous ne voyons point de telles contestations dans l'aréopage ni dans le sénat romain.
A mesure que les pays sont barbares, ou que les cours sont faibles, le cérémonial est plus en vogue. La vraie puissance et la vraie politesse dédaignent la vanité.
Il est à croire qu'à la fin on se défera de cette coutume qu'ont encore quelquefois les ambassadeurs, de se ruiner pour aller en procession par les rues avec quelques carrosses de louage rétablis et redorés, précédés de quelques laquais à pied. Cela s'appelle faire son entrée ; et il est assez plaisant de faire son entrée dans une ville sept ou huit mois après qu'on y est arrivé.
Cette importante affaire du punctilio , qui constitue la grandeur des Romains modernes; cette science du nombre des pas qu'on doit faire pour reconduire un Monsignor , d'ouvrir un rideau à moitié ou tout à fait, de se promener dans une chambre à droite ou à gauche; ce grand art que les Fabius et les Catons n'auraient jamais deviné, commence à baisser: et les caudataires des cardinaux se plaignent que tout annonce la décadence.
Un colonel français était dans Bruxelles un an après la prise de cette ville par le maréchal de Saxe; et ne sachant que faire, il voulut aller à l'assemblée de la ville. Elle se tient chez une princesse, lui dit-on. Soit, répondit l'autre, que m'importe? Mais il n'y a que des princes qui aillent là; êtes-vous prince? Va, va, dit le colonel, ce sont de bons princes; j'en avais l'année passée une douzaine dans mon antichambre, quand nous eûmes pris la ville, et ils étaient tous fort polis.
En relisant Horace j'ai remarqué ce vers dans une épître à Mécène: Te dulcis amice revisam . J'irai vous voir, mon bon ami. Ce Mécène était la seconde personne de l'empire romain, c'est-à-dire, un homme plus considérable et plus puissant que ne l'est aujourd'hui le plus grand monarque de l'Europe.
En relisant Corneille, j'ai remarqué que dans une lettre au grand Scudéri gouverneur de Notre-Dame de la Garde, il s'exprime ainsi au sujet du cardinal de Richelieu, Monsieur le cardinal votre maître et le mien . C'est peut-être la première fois qu'on a parlé ainsi d'un ministre, depuis qu'il y a dans le monde des ministres, des rois, et des flatteurs. Le même Pierre Corneille, auteur de Cinna , dédie humblement ce Cinna au sieur de Montauron trésorier de l'épargne, qu'il compare sans façon à Auguste. Je suis fâché qu'il n'ait pas appelé Montauron monseigneur.
On conte qu'un vieil officier qui savait peu le protocole de la vanité, ayant écrit au marquis de Louvois, Monsieur , et n'ayant point eu de réponse, lui écrivit Monseigneur , et n'en obtint pas davantage, parce que le ministre avait encore le Monsieur sur le coeur. Enfin il lui écrivit, à mon Dieu, mon Dieu Louvois ; et au commencement de la lettre il mit, Mon Dieu, mon Créateur . Tout cela ne prouve-t-il pas que les Romains du bon temps étaient grands et modestes, et que nous sommes petits et vains?
Comment vous portez-vous, mon cher ami? disait un duc et pair à un gentilhomme; A votre service, mon cher ami, répondit l'autre; et dès ce moment il eut son cher ami pour ennemi implacable. Un grand de Portugal parlait à un grand d'Espagne, et lui disait à tout moment, Votre excellence . Le Castillan lui répondait, Votre courtoisie, Vuestra merced ; c'est le titre que l'on donne aux gens qui n'en ont pas. Le Portugais piqué appela l'Espagnol à son tour, Votre courtoisie ; l'autre lui donna alors de l' excellence . A la fin le Portugais lassé lui dit, Pourquoi me donnez-vous toujours de la courtoisie, quand je vous donne de l'excellence? et pourquoi m'appelez-vous, Votre excellence, quand je vous dis Votre courtoisie? C'est que tous les titres me sont égaux, répondit humblement le Castillan, pourvu qu'il n'y ait rien d'égal entre vous et moi.
La vanité des titres ne s'introduisit dans nos climats septentrionaux de l'Europe que quand les Romains eurent fait connaissance avec la sublimité asiatique. La plupart des rois de l'Asie étaient, et sont encore cousins germains du soleil et de la lune: leurs sujets n'osent jamais prétendre à cette alliance; et tel gouverneur de province qui s'intitule, Muscade de consolation et Rose de plaisir , serait empalé, s'il se disait parent le moins du monde de la lune et du soleil.
Constantin fut, je pense, le premier empereur romain, qui chargea l'humilité chrétienne d'une page de noms fastueux. Il est vrai qu'avant lui on donnait du dieu aux empereurs. Mais ce mot dieu ne signifiait rien d'approchant de ce que nous entendons. Divus Augustus, Divus Trajanus , voulaient dire, St Auguste, St Trajan . On croyait qu'il était de la dignité de l'empire romain, que l'âme de son chef allât au ciel après sa mort; et souvent même on accordait le titre de Saint , de Divus , à l'empereur, en avancement d'hoirie. C'est à peu près par cette raison, que les premiers patriarches de l'Eglise chrétienne s'appelaient tous, votre sainteté . On les nommait ainsi pour les faire souvenir de ce qu'ils devaient être.
On se donne quelquefois à soi-même des titres fort humbles, pourvu qu'on en reçoive de fort honorables. Tel abbé qui s'intitule frère , se fait appeler monseigneur par ses moines. Le pape se nomme serviteur des serviteurs de Dieu . Un bon prêtre du Holstein écrivit un jour au pape Pie IV: A Pie IV serviteur des serviteurs de Dieu . Il alla ensuite à Rome solliciter son affaire; et l'Inquisition le fit mettre en prison pour lui apprendre à écrire.
Il n'y avait autrefois que l'empereur qui eût le titre de majesté . Les autres rois s'appelaient votre altesse, votre sérénité, votre grâce . Louis XI fut le premier en France qu'on appela communément majesté , titre non moins convenable en effet à la dignité d'un grand royaume héréditaire qu'à une principauté élective. Mais on se servait du terme d' altesse avec les rois de France longtemps après lui; et on voit encore des lettres à Henri III, dans lesquelles on lui donne ce titre. Les états d'Orléans ne voulurent point que la reine Catherine de Médicis fût appelée majesté . Mais peu à peu cette dernière dénomination prévalut. Le nom est indifférent; il n'y a que le pouvoir qui ne le soit pas.
La chancellerie allemande, toujours invariable dans ses nobles usages, a prétendu jusqu'à nos jours ne devoir traiter tous les rois que de sérénité . Dans le fameux traité de Vestphalie, où la France et la Suède donnèrent des lois au saint empire romain, jamais les plénipotentiaires de l'empereur ne présentèrent de mémoires latins où sa sacrée majesté impériale ne traitât avec les sérénissimes rois de France et de Suède ; mais de leur côté les Français et les Suédois ne manquaient pas d'assurer que leurs sacrés majestés de France et de Suède avaient beaucoup de griefs contre le sérénissime empereur . Enfin dans le traité tout fut égal de part et d'autre. Les grands souverains ont depuis ce temps passé dans l'opinion des peuples pour être tous égaux; et celui qui a battu ses voisins a eu la prééminence dans l'opinion publique.
Philippe II fut la première majesté en Espagne; car la sérénité de Charles V ne devint majesté qu'à cause de l'empire. Les enfants de Philippe II furent les premières altesses , et ensuite ils furent altesses royales . Le duc d'Orléans frère de LouisXIII , ne prit qu'en 1631 le titre d' altesse royale : alors le prince de Condé prit celui d' altesse sérénissime , que n'osèrent s'arroger les ducs de Vendôme. Le duc de Savoie fut alors altesse royale , et devint ensuite majesté . Le grand-duc de Florence en fit autant, à la majesté près; et enfin le tzar, qui n'était connu en Europe que sous le nom de grand-duc, s'est déclaré empereur , et a été reconnu pour tel.
Il n'y avait anciennement que deux marquis d'Allemagne, deux en France, deux en Italie. Le marquis de Brandebourg est devenu roi , et grand roi ; mais aujourd'hui nos marquis italiens et français sont d'une espèce un peu différente.
Qu'un bourgeois italien ait l'honneur de donner à dîner au légat de sa province, et que le légat en buvant lui dise, Monsieur le marquis, à votre santé , le voilà marquis lui et ses enfants à tout jamais. Qu'un provincial en France, qui possédera pour tout bien dans son village la quatrième partie d'une petite châtellenie ruinée, arrive à Paris, qu'il y fasse un peu de fortune, ou qu'il ait l'air de l'avoir faite, il s'intitule dans ses actes, Haut et puissant seigneur, marquis et comte ; et son fils sera chez son notaire, Très haut et très puissant seigneur ; et comme cette petite ambition ne nuit en rien au gouvernement ni à la société civile, on n'y prend pas garde. Quelques seigneurs français se vantent d'avoir des barons allemands dans leurs écuries: quelques seigneurs allemands disent qu'ils ont des marquis français dans leurs cuisines: il n'y a pas longtemps, qu'un étranger étant à Naples fit son cocher duc . La coutume en cela est plus forte que l'autorité royale. Soyez peu connu à Paris, vous y serez comte ou marquis , tant qu'il vous plaira; soyez homme de robe ou de finance, et que le roi vous donne un marquisat bien réel, vous ne serez jamais pour cela monsieur le marquis . Le célèbre Samuel Bernard était plus comte que cinq cents comtes que nous voyons qui ne possèdent pas quatre arpents de terre; le roi avait érigé pour lui sa terre de Coubert en bonne comté. S'il se fût fait annoncer dans une visite, le comte Bernard , on aurait éclaté de rire. Il en va tout autrement en Angleterre. Si le roi donne à un négociant un titre de comte ou de baron , il reçoit sans difficulté de toute la nation le nom qui lui est propre. Les gens de la plus haute naissance, le roi lui-même, l'appellent milord , monseigneur. Il en est de même en Italie: il y a le protocole des monsignori . Le pape lui-même leur donne ce titre. Son médecin est monsignor , et personne n'y trouve à redire.
En France le monseigneur est une terrible affaire. Un évêque n'était avant le cardinal de Richelieu que mon révérendissime père en Dieu .
Avant l'année 1635, non seulement les évêques ne se monseigneurisaient pas, mais ils ne donnaient point du monseigneur aux cardinaux. Ces deux habitudes s'introduisirent par un évêque de Chartres, qui alla en camail et en rochet appeler monseigneur le cardinal de Richelieu; sur quoi Louis XIII dit, (si l'on en croit les mémoires de l'archevêque de Toulouse Montchal) Ce Chartrain irait baiser le derrière du cardinal, et pousserait son nez dedans jusqu'à ce que l'autre lui dît, C'est assez .
Ce n'est que depuis ce temps que les évêques se donnèrent réciproquement du monseigneur .
Cette entreprise n'essuya aucune contradiction dans le public. Mais comme c'était un titre nouveau que les rois n'avaient pas donné aux évêques, on continua dans les édits, déclarations, ordonnances, et dans tout ce qui émane de la cour, à ne les appeler que sieurs : et messieurs du conseil n'écrivent jamais à un évêque que monsieur .
Les ducs et pairs ont eu plus de peine à se mettre en possession du monseigneur . La grande noblesse, et ce qu'on appelle la grande robe , leur refusent tout net cette distinction. Le comble des succès de l'orgeuil humain, est de recevoir des titres d'honneur de ceux qui croient être vos égaux; mais il est bien difficile d'arriver à ce point: on trouve partout l'orgueil qui combat l'orgueil.
Quand les ducs exigèrent que les pauvres gentilshommes leur écrivissent monseigneur , les présidents à mortier en demandèrent autant aux avocats et aux procureurs. On a connu un président, qui ne voulut pas se faire saigner, parce que son chirurgien lui avait dit, ‘Monsieur, de quel bras voulez-vous que je vous saigne?' Il y eut un vieux conseiller de la grand'chambre qui en usa plus franchement. Un plaideur lui dit, Monseigneur, monsieur votre secrétaire . . . Le conseiller l'arrêta tout court; Vous avez dit trois sottises en trois paroles: je ne suis point monseigneur , mon secrétaire n'est point monsieur , c'est mon clerc .
Pour terminer ce grand procès de la vanité, il faudra un jour que tout le monde soit monseigneur dans la nation; comme toutes les femmes, qui étaient autrefois mademoiselle , sont actuellement madame . Lorsqu'en Espagne un mendiant rencontre un autre gueux, il lui dit, ‘Seigneur, votre courtoisie a-t-elle pris son chocolat?' Cette manière polie de s'exprimer élève l'âme, et conserve la dignité de l'espèce.
Nous avons dit ailleurs une grande partie de ces choses. Il est bon de les inculquer pour corriger au moins quelques coqs d'Inde qui passent leur vie à faire la roue.
CERTAIN, CERTITUDE. [p. 119] ↩
Je suis certain, j'ai des amis, ma fortune est sûre; mes parents ne m'abandonneront jamais; on me rendra justice; mon ouvrage est bon, il sera bien reçu; on me doit, on me payera; mon amant sera fidèle, il l'a juré; le ministre m'avancera, il l'a promis en passant: toutes paroles qu'un homme qui a un peu vécu raye de son dictionnaire.
Quand les juges condamnèrent Danglade, le Brun, Calas, Sirven, Martin, Montbailli et tant d'autres, reconnus depuis pour innocents, ils étaient certains, ou ils devaient l'être, que tous ces infortunés étaient coupables; cependant ils se trompèrent.
Il y a deux manières de se tromper, de mal juger, de s'aveugler; celle d'errer en homme d'esprit, et celle de décider comme un sot.
Les juges se trompèrent en gens d'esprit dans l'affaire de Danglade, ils s'aveuglèrent sur des apparences qui pouvaient éblouir; ils n'examinèrent point assez les apparences contraires, ils se servirent de leur esprit pour se croire certains que Danglade avait commis un vol, qu'il n'avait certainement pas commis: et sur cette pauvre certitude incertaine de l'esprit humain, un gentilhomme fut appliqué à la question ordinaire et extraordinaire. De là replongé sans secours dans un cachot et condamné aux galères où il mourut; sa femme renfermée dans un autre cachot avec sa fille âgée de sept ans, laquelle depuis épousa un conseiller au même parlement qui avait condamné le père aux galères et la mère au banissement.
Il est clair que les juges n'auraient pas prononcé cet arrêt s'ils n'avaient été certains . Cependant, dès le temps même de cet arrêt, plusieurs personnes savaient que le vol avait été commis par un prêtre nommé Gagnat associé avec un voleur de grand chemin: et l'innocence de Danglade ne fut reconnue qu'après sa mort.
Ils étaient de même certains , lorsque par une sentence en première instance, ils condamnèrent à la roue l'innocent le Brun, qui par appel fut brisé dans les tortures, et en mourut.
L'exemple des Calas et des Sirven est assez connu; celui de Martin l'est moins. C'était un bon agriculteur d'auprès de Bar en Lorraine. Un scélérat lui dérobe son habit, et va, sous cet habit, assassiner sur le grand chemin un voyageur qu'il savait chargé d'or, et dont il avait épié la marche. Martin est accusé; son habit dépose contre lui; les juges regardent cet indice comme une certitude. Ni la conduite passée du prisonnier, ni une nombreuse famille qu'il élevait dans la vertu, ni le peu de monnaie trouvé chez lui, probabilité extrême qu'il n'avait point volé le mort; rien ne peut le sauver. Le juge subalterne se fait un mérite de sa rigueur. Il condamne l'innocent à être roué; et, par une fatalité malheureuse, la sentence est confirmée à la Tournelle. Le vieillard Martin est rompu vif en attestant Dieu de son innocence jusqu'au dernier soupir. Sa famille se disperse; son petit bien est confisqué. A peine ses membres rompus sont-ils exposés sur le grand chemin, que l'assassin qui avait commis le meurtre et le vol est mis en prison pour un autre crime; il avoue sur la roue à laquelle il est condamné à son tour, que c'est lui seul qui est coupable du crime pour lequel Martin a souffert la torture et la mort.
Montbailli qui dormait avec sa femme est accusé d'avoir de concert avec elle tué sa mère morte évidemment d'apoplexie: le conseil d'Arras condamne Montbailli à expirer sur la roue et sa femme à être brûlée. Leur innocence est reconnue, mais après que Montbailli a été roué.
Ecartons ici la foule de ces aventures funestes qui font gémir sur la condition humaine. Mais gémissons du moins sur la certitude prétendue que les juges croient avoir quand ils rendent de pareilles sentences.
Il n'y a nulle certitude, dès qu'il est physiquement et moralement possible que la chose soit autrement. Quoi! il faut une démonstration pour oser assurer que la surface d'une sphère est égale à quatre fois l'aire de son grand cercle, et il n'en faudra pas pour arracher la vie à un citoyen par un supplice affreux?
Si tel est le malheur de l'humanité qu'on soit obligé de se contenter d'extrêmes probabilités, il faut du moins consulter l'âge, le rang, la conduite de l'accusé, l'intérêt qu'il peut avoir eu à commettre le crime, l'intérêt de ses ennemis à le perdre: il faut que chaque juge se dise: La postérité, l'Europe entière ne condamnera-t-elle pas ma sentence! dormirai-je tranquille les mains teintes du sang innocent?
Passons de cet horrible tableau à d'autres exemples d'une certitude qui conduit droit à l'erreur.
Pourquoi te charges-tu de chaînes, fanatique et malheureux santon? Pourquoi as-tu mis à ta vilaine verge un gros anneau de fer? C'est que je suis certain d'être placé un jour dans le premier des paradis à côté du grand prophète. Hélas! mon ami, viens avec moi dans ton voisinage au mont Athos, et tu verras trois mille gueux qui sont certains que tu iras dans le gouffre qui est sous le pont aigu, et qu'ils iront tous dans le premier paradis.
Arrête, misérable veuve malabare; ne crois point ce fou qui te persuade que tu seras réunie à ton mari dans les délices d'un autre monde si tu te brûles sur son bûcher. Non, je me brûlerai; je suis certaine de vivre dans les délices avec mon époux; mon brame me l'a dit.
Prenons des certitudes moins affreuses, et qui aient un peu plus de vraisemblance.
Quel âge a votre ami Christophe? Vingt-huit ans; j'ai vu son contrat de mariage, son extrait baptistaire, je le connais dès son enfance; il a vingt-huit ans, j'en ai la certitude, j'en suis certain.
A peine ai-je entendu la réponse de cet homme si sûr de ce qu'il dit, et de vingt autres qui confirment la même chose, que j'apprends qu'on a antidaté par des raisons secrètes, et par un manège singulier, l'extrait baptistaire de Christophe. Ceux à qui j'avais parlé n'en savent encore rien; cependant, ils ont toujours la certitude de ce qui n'est pas.
Si vous aviez demandé à la terre entière avant le temps de Copernic, Le soleil est-il levé? s'est-il couché aujourd'hui? tous les hommes vous auraient répondu, Nous en avons une certitude entière; ils étaient certains, et ils étaient dans l'erreur.
Les sortilèges, les divinations, les obsessions, ont été longtemps la chose du monde la plus certaine aux yeux de tous les peuples. Quelle foule innombrable de gens qui ont vu toutes ces belles choses, qui en ont été certains! aujourd'hui cette certitude est un peu tombée.
Un jeune homme qui commence à étudier la géométrie vient me trouver; il n'en est encore qu'à la définition des triangles: N'êtes-vous pas certain, lui dis-je, que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits? Il me répond que non seulement il n'en est point certain, mais qu'il n'a pas même d'idée nette de cette proposition; je la lui démontre, il en devient alors très certain, et il le sera pour toute sa vie.
Voilà une certitude bien différente des autres; elles n'étaient que des probabilités; et ces probabilités examinées sont devenues des erreurs; mais la certitude mathématique est immuable et éternelle.
J'existe, je pense, je sens de la douleur, tout cela est-il aussi certain qu'une vérité géométrique? Oui; tout douteur que je suis, je l'avoue. Pourquoi? C'est que ces vérités sont prouvées par le même principe qu'une chose ne peut être, et n'être pas en même temps. Je ne peux en même temps exister et n'exister pas, sentir, et ne sentir pas. Un triangle ne peut en même temps avoir cent quatre-vingts degrés, qui sont la somme de deux angles droits, et ne les avoir pas.
La certitude physique de mon existence, de mon sentiment, et la certitude mathématique sont donc de même valeur, quoiqu'elles soient d'un genre différent.
Il n'en est pas de même de la certitude fondée sur les apparences, ou sur les rapports unanimes, que nous font les hommes.
Mais quoi, me dites-vous, n'êtes-vous pas certain que Pékin existe? n'avez-vous pas chez vous des étoffes de Pékin? des gens de différents pays, de différentes opinions, et qui ont écrit violemment les uns contre les autres en prêchant tous la vérité à Pékin, ne vous ont-ils pas assuré de l'existence de cette ville? Je réponds qu'il m'est extrêmement probable qu'il y avait alors une ville de Pékin; mais je ne voudrais pas parier ma vie que cette ville existe; et je parierai quand on voudra ma vie, que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits.
On a imprimé dans le Dictionnaire encyclopédique une chose fort plaisante; on y soutient qu'un homme devrait être aussi sûr, aussi certain que le maréchal de Saxe est ressuscité, si tout Paris le lui disait, qu'il est sûr que le maréchal de Saxe a gagné la bataille de Fontenoy, quand tout Paris le lui dit. Voyez, je vous prie, combien ce raisonnement est admirable; je crois tout Paris quand il me dit une chose moralement possible; donc je dois croire tout Paris quand il me dit une chose moralement et physiquement impossible.
Apparemment que l'auteur de cet article voulait rire, et que l'autre auteur qui s'extasie à la fin de cet article, et écrit contre lui-même, voulait rire aussi. [18]
Pour nous, qui n'avons entrepris ce petit Dictionnaire que pour faire des questions, nous sommes bien loin d'avoir de la certitude .
CÉSAR. [p. 124] ↩
On n'envisage point ici dans César le mari de tant de femmes et la femme de tant d'hommes, le vainqueur de Pompée et des Scipions, l'écrivain satirique qui tourne Caton en ridicule, le voleur du trésor public qui se servit de l'argent des Romains pour asservir les Romains, le triomphateur clément qui pardonnait aux vaincus, le savant qui réforma le calendrier, le tyran et le père de sa patrie, assassiné par ses amis et par son bâtard. Ce n'est qu'en qualité de descendant des pauvres barbares, subjugués par lui, que je considère cet homme unique.
Vous ne passez pas par une seule ville de France ou d'Espagne ou des bords du Rhin, ou du rivage d'Angleterre vers Calais, que vous ne trouviez de bonnes gens qui se vantent d'avoir eu César chez eux. Des bourgeois de Douvres sont persuadés que César a bâti leur château, et des bourgeois de Paris croient que le grand Châtelet est un de ses beaux ouvrages. Plus d'un seigneur de paroisse en France montre une vieille tour qui lui sert de colombier, et dit que c'est César qui a pourvu au logement de ses pigeons. Chaque province dispute à sa voisine l'honneur d'être la première en date à qui César donna les étrivières; c'est par ce chemin, non c'est par cet autre qu'il passa pour venir nous égorger, et pour caresser nos femmes et nos filles, pour nous imposer des lois par interprètes, et pour nous prendre le très peu d'argent que nous avions.
Les Indiens sont plus sages; nous avons vu qu'ils savent confusément qu'un grand brigand nommé Alexandre passa chez eux après d'autres brigands: et ils n'en parlent presque jamais.
Un antiquaire italien, en passant il y a quelques années par Vannes en Bretagne, fut tout émerveillé d'entendre les savants de Vannes s'enorgueillir du séjour de César dans leur ville. Vous avez sans doute, leur dit-il, quelques monuments de ce grand homme? Oui, répondit le plus notable; nous vous montrerons l'endroit où ce héros fit pendre tout le sénat de notre province au nombre de six cents.
Des ignorants qui trouvèrent dans le chenal de Kerantrait une centaine de poutres en 1755, avancèrent dans les journaux que c'étaient des restes d'un pont de César; mais je leur ai prouvé dans ma dissertation de 1756, que c'étaient les potences où ce héros avait fait attacher notre parlement. Où sont les villes en Gaule qui puissent en dire autant? Nous avons le témoignage du grand César lui-même; il dit dans ses Commentaires, De bello gallico. lib. III. que nous sommes inconstants, et que nous préférons la liberté à la servitude . Il nous accuse d'avoir été assez insolents pour prendre des otages des Romains à qui nous en avions donné, et de n'avoir pas voulu les rendre à moins qu'on ne nous remît les nôtres. Il nous apprit à vivre.
Il fit fort bien, répliqua le virtuose, son droit était incontestable. On le lui disputait pourtant. Car lorsqu'il eut vaincu les Suisses émigrants, au nombre de trois cent soixante et huit mille, et qu'il n'en resta plus que cent dix mille, vous savez qu'il eut une conférence en Alsace avec Arioviste roi germain ou allemand, et que cet Arioviste lui dit: Je viens piller les Gaules, et je ne souffrirai pas qu'un autre que moi les pille. Après quoi ces bons Germains qui étaient venus pour dévaster le pays, mirent entre les mains de leurs sorcières deux chevaliers romains ambassadeurs de César; et ces sorcières allaient les brûler et les sacrifier à leurs dieux, lorsque César vint les délivrer par une victoire. Avouons que le droit était égal des deux côtés; et Tacite a bien raison de donner tant d'éloges aux moeurs des anciens Allemands.
Cette conversation fit naître une dispute assez vive entre les savants de Vannes et l'antiquaire. Plusieurs Bretons ne concevaient pas quelle était la vertu des Romains d'avoir trompé toutes les nations des Gaules l'une après l'autre, de s'être servi d'elles tour à tour pour leur propre ruine, d'en avoir massacré un quart et d'avoir réduit les trois autres quarts en servitude.
Ah! rien n'est plus beau, répliqua l'antiquaire; j'ai dans ma poche une médaille à fleur de coin qui représente le triomphe de César au Capitole. C'est une des mieux conservées; il montra sa médaille. Un Breton un peu brusque la prit et la jeta dans la rivière. Que ne puis-je, dit-il, y noyer tous ceux qui se servent de leur puissance et de leur adresse pour opprimer les autres hommes? Rome autrefois nous trompa, nous désunit, nous massacra, nous enchaîna. Et Rome aujourd'hui dispose encore de plusieurs de nos bénéfices. Est-il possible que nous ayons été si longtemps et en tant de façons pays d'obédience?
Je n'ajouterai qu'un mot à la conversation de l'antiquaire italien et du Breton; c'est que Perrot d'Ablancourt, le traducteur des Commentaires de César , dans son épître dédicatoire au grand Condé, lui dit ces propres mots: ‘ Ne vous semble-t-il pas, monseigneur, que vous lisiez la vie d'un philosophe chrétien ? Quel philosophe chrétien que César! je m'étonne qu'on n'en ait pas fait un saint. Les faiseurs d'épîtres dédicatoires disent de belles choses, et fort à propos.
CHAINE DES ÊTRES CRÉES. [p. 126] ↩
Cette gradation d'êtres qui s'élèvent depuis le plus léger atome jusqu'à l'Etre suprême; cette échelle de l'infini frappe d'admiration. Mais quand on la regarde attentivement, ce grand fantôme s'évanouit, comme autrefois toutes les apparitions s'enfuyaient le matin au chant du coq.
L'imagination se complaît d'abord à voir le passage imperceptible de la matière brute à la matière organisée, des plantes aux zoophytes, de ces zoophytes aux animaux, de ceux-ci à l'homme, de l'homme aux génies, de ces génies revêtus d'un petit corps aérien à des substances immatérielles; et enfin mille ordres différents de ces substances, qui de beautés en perfections s'élèvent jusqu'à Dieu même. Cette hiérarchie plaît beaucoup aux bonnes gens, qui croient voir le pape et ses cardinaux suivis des archevêques, des évêques; après quoi viennent les curés, les vicaires, les simples prêtres, les diacres, les sous-diacres, puis paraissent les moines, et la marche est fermée par les capucins.
Mais il y a peut-être un peu plus de distance entre Dieu et ses plus parfaites créatures, qu'entre le Saint-Père et le doyen du sacré collège: ce doyen peut devenir pape, mais le plus parfait des génies créés par l'Etre suprême, peut-il devenir Dieu? n'y a-t-il pas l'infini entre Dieu et lui?
Cette chaîne, cette gradation prétendue n'existe pas plus dans les végétaux et dans les animaux; la preuve en est qu'il y a des espèces de plantes et d'animaux qui sont détruites. Nous n'avons plus de murex. Il était défendu aux Juifs de manger du griffon et de l'ixion; ces deux espèces ont probablement disparu de ce monde, quoi qu'en dise Bochart: où donc est la chaîne?
Quand même nous n'aurions pas perdu quelques espèces, il est visible qu'on en peut détruire. Les lions, les rhinocéros commencent à devenir fort rares. Si le reste du monde avait imité les Anglais, il n'y aurait plus de loups sur la terre.
Il est probable qu'il y a eu des races d'hommes qu'on ne retrouve plus; mais je veux qu'elles aient toutes subsisté, ainsi que les blancs, les nègres, les Cafres à qui la nature a donné un tablier de leur peau, pendant du ventre à la moitié des cuisses, et les Samoyèdes dont les femmes ont un mamelon d'un bel ébène, etc.
N'y a-t-il pas visiblement un vide entre le singe et l'homme? n'est-il pas aisé d'imaginer un animal à deux pieds sans plumes, qui serait intelligent sans avoir ni l'usage de la parole, ni notre figure, que nous pourrions apprivoiser, qui répondrait à nos signes et qui nous servirait? et entre cette nouvelle espèce et celle de l'homme, n'en pourrait-on pas imaginer d'autres?
Par delà l'homme, vous logez dans le ciel, divin Platon, une file de substances célestes; nous croyons nous autres à quelques-unes de ces substances, parce que la foi nous l'enseigne. Mais vous, quelle raison avez-vous d'y croire? vous n'avez pas parlé apparemment au génie de Socrate; et le bonhomme Heres qui ressuscita exprès pour vous apprendre les secrets de l'autre monde, ne vous a rien appris de ces substances.
La prétendue chaîne n'est pas moins interrompue dans l'univers sensible.
Quelle gradation, je vous prie, entre vos planètes! la Lune est quarante fois plus petite que notre globe. Quand vous avez voyagé de la Lune dans le vide, vous trouvez Vénus; elle est environ aussi grosse que la Terre. De là vous allez chez Mercure, il tourne dans une ellipse qui est fort différente du cercle que parcourt Vénus; il est vingt-sept fois plus petit que nous, le Soleil un million de fois plus gros, Mars cinq fois plus petit; celui-là fait son tour en deux ans, Jupiter son voisin en douze, Saturne en trente; et encore Saturne, le plus éloigné de tous, n'est pas si gros que Jupiter. Où est la gradation prétendue?
Et puis, comment voulez-vous que dans de grands espaces vides il y ait une chaîne qui lie tout? s'il y en a une, c'est certainement celle que Newton a découverte; c'est elle qui fait graviter tous les globes du monde planétaire les uns vers les autres dans ce vide immense.
O Platon tant admiré! j'ai peur que vous ne nous ayez conté que des fables, et que vous n'ayez jamais parlé qu'en sophismes. O Platon! vous avez fait bien plus de mal que vous ne croyez. Comment cela? me demandera-t-on; je ne le dirai pas.
CHAINE, OU GÉNÉRATION DES ÉVÉNEMENS. [p. 128] ↩
Le présent accouche, dit-on, de l'avenir. Les événements sont enchaînés les uns aux autres, par une fatalité invincible; c'est le destin qui, dans Homère, est supérieur à Jupiter même. Ce maître des dieux et des hommes, déclare net, qu'il ne peut empêcher Sarpédon son fils de mourir dans le temps marqué. Sarpédon était né dans le moment qu'il fallait qu'il naquît, et ne pouvait pas naître dans un autre; il ne pouvait mourir ailleurs que devant Troye; il ne pouvait être enterré ailleurs qu'en Lycie; son corps devait dans le temps marqué produire des légumes qui devaient se changer dans la substance de quelques Lyciens; ses héritiers devaient établir un nouvel ordre dans ses Etats; ce nouvel ordre devait influer sur les royaumes voisins; il en résultait un nouvel arrangement de guerre et de paix avec les voisins des voisins de la Lycie: ainsi de proche en proche la destinée de toute la terre a dépendu de la mort de Sarpédon, laquelle dépendait de l'enlèvement d'Hélène: et cet enlèvement était nécessairement lié au mariage d'Hécube, qui en remontant à d'autres événements était lié à l'origine des choses.
Si un seul de ces faits avait été arrangé différemment, il en aurait résulté un autre univers: or il n'était pas possible que l'univers actuel n'existât pas: donc il n'était pas possible à Jupiter de sauver la vie à son fils, tout Jupiter qu'il était.
Ce système de la nécessité et de la fatalité, a été inventé de nos jours par Leibnitz, à ce qu'on dit, sous le nom de raison suffisante ; il est pourtant fort ancien; ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que souvent la plus petite cause produit les plus grands effets.
Milord Bolingbroke avoue que les petites querelles de Mme Marlborough, et de Mme Masham, lui firent naître l'occasion de faire le traité particulier de la reine Anne avec Louis XIV: ce traité amena la paix d'Utrecht; cette paix d'Utrecht affermit Philippe V sur le trône d'Espagne. Philippe V prit Naples et la Sicile sur la maison d'Autriche; le prince espagnol qui est aujourd'hui roi de Naples, doit évidemment son royaume à milady Masham: et il ne l'aurait pas eu, il ne serait peut-être même pas né, si la duchesse de Marlborough avait été plus complaisante envers la reine d'Angleterre. Son existence à Naples dépendait d'une sottise de plus ou de moins à la cour de Londres.
Examinez les situations de tous les peuples de l'univers, elles sont ainsi établies sur une petite suite de faits qui paraissent ne tenir à rien, et qui tiennent à tout. Tout est rouage, poulie, corde, ressort dans cette immense machine.
Il en est de même dans l'ordre physique. Un vent qui souffle du fond de l'Afrique et des mers australes, amène une partie de l'atmosphère africaine, qui retombe en pluie dans les vallées des Alpes; ces pluies fécondent nos terres; notre vent du nord à son tour envoie nos vapeurs chez les nègres; nous faisons du bien à la Guinée, et la Guinée nous en fait. La chaîne s'étend d'un bout de l'univers à l'autre.
Mais il me semble qu'on abuse étrangement de la vérité de ce principe. On en conclut qu'il n'y a si petit atome dont le mouvement n'ait influé dans l'arrangement actuel du monde entier; qu'il n'y a si petit accident, soit parmi les hommes, soit parmi les animaux, qui ne soit un chaînon essentiel de la grande chaîne du destin.
Entendons-nous: tout effet a évidemment sa cause, à remonter de cause en cause dans l'abîme de l'éternité; mais toute cause n'a pas son effet, à descendre jusqu'à la fin des siècles. Tous les événements sont produits les uns par les autres, je l'avoue; si le passé est accouché du présent, le présent accouche du futur; tout a des pères, mais tout n'a pas toujours des enfants. Il en est ici précisément comme d'un arbre généalogique; chaque maison remonte, comme on sait, à Adam; mais dans la famille il y a bien des gens qui sont morts sans laisser de postérité.
Il y a un arbre généalogique des événements de ce monde. Il est incontestable que les habitants des Gaules et de l'Espagne descendent de Gomer; et les Russes de Magog son frère cadet: on trouve cette généalogie dans tant de gros livres! sur ce pied-là, on ne peut nier que le grand Turc qui descend aussi de Magog, ne lui ait l'obligation d'avoir été bien battu en 1769 par l'impératrice de Russie Catherine II. Cette aventure tient évidemment à d'autres grandes aventures; mais que Magog ait craché à droite ou à gauche, auprès du mont Caucase, et qu'il ait fait deux ronds dans un puits ou trois, qu'il ait dormi sur le côté gauche ou sur le côté droit; je ne vois pas que cela ait influé beaucoup sur les affaires présentes.
Il faut songer que tout n'est pas plein dans la nature comme Newton l'a démontré, et que tout mouvement ne se communique pas de proche en proche, jusqu'à faire le tour du monde comme il l'a démontré encore. Jetez dans l'eau un corps de pareille densité, vous calculez aisément qu'au bout de quelque temps le mouvement de ce corps, et celui qu'il a communiqué à l'eau, sont anéantis; le mouvement se perd et se répare; donc le mouvement que put produire Magog en crachant dans un puits, ne peut avoir influé sur ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie et en Valachie. Donc, les événements présents ne sont pas les enfants de tous les événements passés; ils ont leurs lignes directes; mais mille petites lignes collatérales ne leur servent à rien. Encore une fois, tout être a son père, mais tout être n'a pas des enfants. Voyez Destin .
CHANGEMENS ARRIVÉS DANS LE GLOBE. [p. 131] ↩
Quand on a vu de ses yeux une montagne s'avancer dans une plaine, c'est-à-dire un immense rocher de cette montagne se détacher et couvrir des champs, un château tout entier enfoncé dans la terre, un fleuve englouti qui sort ensuite de son abîme, des marques indubitables qu'un vaste amas d'eaux inondait autrefois un pays habité aujourd'hui, et cent vestiges d'autres révolutions, on est alors plus disposé à croire les grands changements qui ont altéré la face du monde, que ne l'est une dame de Paris qui sait seulement que la place où est bâtie sa maison était autrefrois un champ labourable. Mais une dame de Naples, qui a vu sous terre les ruines d'Herculaneum, est encore moins asservie au préjugé qui nous fait croire que tout a toujours été comme il est aujourd'hui.
Y a-t-il eu un grand embrasement du temps d'un Phaëton? Rien n'est plus vraisemblable; mais ce ne fut ni l'ambition de Phaëton, ni la colère de Jupiter foudroyant, qui causèrent cette catastrophe; de même qu'en 1755 ce ne furent point les feux allumés si souvent dans Lisbonne par l'Inquisition qui ont attiré la vengeance divine; qui ont allumé les feux souterrains et qui ont détruit la moitié de la ville. Car Mequinès, Tétuan et des hordes considérables d'Arabes furent encore plus maltraitées que Lisbonne; et il n'y avait point d'Inquisition dans ces contrées.
L'île de St Domingue, toute bouleversée depuis peu, n'avait pas déplu au Grand Etre plus que l'île de Corse. Tout est soumis aux lois physiques éternelles.
Le soufre, le bitume, le nitre, le fer renfermés dans la terre, ont par leurs mélanges et par leurs explosions renversé mille cités, ouvert et fermé mille gouffres, et nous sommes menacés tous les jours de ces accidents attachés à la manière dont ce monde est fabriqué, comme nous sommes menacés dans plusieurs contrées des loups et des tigres affamés pendant l'hiver.
Si le feu que Démocrite croyait le principe de tout, a bouleversé une partie de la terre, le premier principe de Thalès, l'eau a causé d'aussi grands changements.
La moitié de l'Amérique est encore inondée par les anciens débordements du Maragnon, de Rio de la Plata, du fleuve St Laurent, du Mississipi et de toutes les rivières perpétuellement augmentées par les neiges éternelles des montagnes les plus hautes de la terre, qui traversent ce continent d'un bout à l'autre. Ces déluges accumulés ont produit presque partout de vastes marais. Les terres voisines sont devenues inhabitables; et la terre, que les mains des hommes auraient dû fertiliser, a produit des poisons.
La même chose était arrivée à la Chine et à l'Egypte; il fallut une multitude de siècles pour creuser des canaux et pour dessécher les terres. Joignez à ces longs désastres les irruptions de la mer, les terrains qu'elle a envahis, et qu'elle a désertés, les îles qu'elle a détachées du continent, vous trouverez qu'elle a dévasté plus de quatre-vingt mille lieues carrées d'orient en occident depuis le Japon jusqu'au mont Atlas.
L'engloutissement de l'île Atlantide par l'Océan, peut être regardé avec autant de raison comme un point d'histoire, que comme une fable. Le peu de profondeur de la mer Atlantide jusqu'aux Canaries, pourrait être une preuve de ce grand événement; et les îles Canaries pourraient bien être des restes de l'Atlantide.
Platon prétend dans son Timée , que les prêtres d'Egypte, chez lesquels il a voyagé, conservaient d'anciens registres qui faisaient foi de la destruction de cette île abîmée dans la mer. Cette catastrophe, dit Platon, arriva neuf mille ans avant lui. Personne ne croira cette chronologie sur la foi seule de Platon; mais aussi personne ne peut apporter contre elle aucune preuve physique, ni même aucun témoignage historique tiré des écrivains profanes.
Pline, dans son livre III, dit, que de tout temps les peuples des côtes espagnoles méridionales ont cru que la mer s'était fait un passage entre Calpé et Abila: Indignae columnas Herculis vocant, creduntque perfossas exclusa anteà admisisse maria et rerum naturae mutasse faciem .
Un voyageur attentif peut se convaincre par ses yeux que les Ciclades, les Sporades faisaient autrefois une partie du continent de la Grèce, et surtout que la Sicile était jointe à l'Apulie. Les deux volcans de l'Etna et du Vésuve qui ont les mêmes fondements sous la mer, le petit gouffre de Caribde, seul endroit profond de cette mer; la parfaite ressemblance des deux terrains, sont des témoignages non récusables: les déluges de Deucalion et d'Ogigès sont assez connus; et les fables inventées d'après cette vérité sont encore l'entretien de tout l'Occident.
Les anciens ont fait mention de plusieurs autres déluges en Asie. Celui dont parle Bérose arriva, selon lui, en Caldée environ quatre mille trois ou quatre cents ans avant notre ère vulgaire; et l'Asie fut inondée de fables au sujet de ce déluge, autant qu'elle le fut des débordements du Tigre et de l'Euphrate, et de tous les fleuves qui tombent dans le Pont-Euxin. Voyez Déluge .
Il est vrai que ces débordements ne peuvent couvrir les campagnes que de quelques pieds d'eau; mais la stérilité qu'ils apportent, la destruction des maisons et des ponts, la mort des bestiaux, sont des pertes qui demandent près d'un siècle pour être réparées. On sait ce qu'il en a coûté à la Hollande; elle a perdu plus de la moitié d'elle-même depuis 1050. Il faut encore qu'elle combatte tous les jours contre la mer qui la menace; et elle n'a jamais employé tant de soldats pour résister à ses ennemis, qu'elle emploie de travailleurs à se défendre continuellement des assauts d'une mer toujours prête à l'engloutir.
Le chemin par terre d'Egypte en Phénicie, en côtoyant le lac Sirbon, était autrefois très praticable; il ne l'est plus depuis très longtemps. Ce n'est plus qu'un sable mouvant abreuvé d'une eau croupissante. En un mot, une grande partie de la terre ne serait qu'un vaste marais empoisonné et habité par des monstres, sans le travail assidu de la race humaine.
On ne parlera point ici du déluge universel de Noé. Il suffit de lire la sainte Ecriture avec soumission. Le déluge de Noé est un miracle incompréhensible, opéré surnaturellement par la justice et la bonté d'une Providence ineffable, qui voulait détruire tout le genre humain coupable, et former un nouveau genre humain innocent. Si la race humaine nouvelle fut plus méchante que la première, et si elle devint plus criminelle de siècle en siècle, et de réforme en réforme, c'est encore un effet de cette Providence, dont il est impossible de sonder les profondeurs, et dont nous adorons, comme nous le devons, les inconcevables mystères transmis aux peuples d'Occident depuis quelques siècles, par la traduction latine des Septante. Nous n'entrons jamais dans ces sanctuaires redoutables; nous n'examinons dans nos questions que la simple nature.
CHANT, MUSIQUE, MELOPÉE, GESTICULATION, SALTATION. [p. 134] ↩
QUESTIONS SUR CES OBJETS.
Un Turc pourra-t-il concevoir que nous ayons une espèce de chant pour le premier de nos mystères, quand nous le célébrons en musique; une autre espèce que nous appelons des motets dans le même temple, une troisième espèce à l'Opéra, une quatrième à l'Opéra-Comique?
De même pouvons-nous imaginer comment les anciens soufflaient dans leurs flûtes, récitaient sur leurs théâtres la tête couverte d'un énorme masque, et comment leur déclamation était notée?
On promulguait les lois dans Athènes à peu près comme on chante dans Paris un air du Pont-neuf. Le crieur public chantait un édit en se faisant accompagner d'une lyre.
C'est ainsi qu'on crie dans Paris, la rose et le bouton sur un ton, vieux passements d'argent à vendre sur un autre; mais dans les rues de Paris on se passe de lyre.
Après la victoire de Chéronée, Philippe père d'Alexandre, se mit à chanter le décret par lequel Démosthène lui avait fait déclarer la guerre, et battit du pied la mesure. Nous sommes fort loin de chanter dans nos carrefours nos édits sur les finances et sur les deux sous pour livre.
Il est très vraisemblable que la mélopée , regardée par Aristote dans sa Poétique comme une partie essentielle de la tragédie, était un chant uni et simple comme celui de ce qu'on nomme la préface à la messe , qui est, à mon avis, le chant grégorien, et non l'ambrosien, mais qui est une vraie mélopée.
Quand les Italiens firent revivre la tragédie au seizième siècle, le récit était une mélopée, mais qu'on ne pouvait noter; car qui peut noter des inflexions de voix qui sont des huitièmes, des seizièmes de ton? on les apprenait par coeur. Cet usage fut reçu en France quand les Français commencèrent à former un théâtre plus d'un siècle après les Italiens. La Sophonisbe de Mairet se chantait comme celle du Trissin, mais plus grossièrement; car on avait alors le gosier un peu rude à Paris, ainsi que l'esprit. Tous les rôles des acteurs, mais surtout des actrices, étaient notés de mémoire par tradition. Mlle Bauval actrice du temps de Corneille, de Racine et de Molière, me récita il y a quelque soixante ans et plus, le commencement du rôle d'Emilie dans Cinna , tel qu'il avait été débité dans les premières représentations par la Beaupré.
Cette mélopée ressemblait à la déclamation d'aujourd'hui, beaucoup moins que notre récit moderne ne ressemble à la manière dont on lit la gazette.
Je ne puis mieux comparer cette espèce de chant, cette mélopée, qu'à l'admirable récitatif de Lulli, critiqué par les adorateurs des doubles croches, qui n'ont aucune connaissance du génie de notre langue, et qui veulent ignorer combien cette mélodie fournit de secours à un acteur ingénieux et sensible.
La mélopée théâtrale périt avec la comédienne Duclos, qui n'ayant pour tout mérite qu'une belle voix, sans esprit et sans âme, rendit enfin ridicule ce qui avait été admiré dans la des OEillets et dans la Champmêlé.
Aujourd'hui on joue la tragédie sèchement; si on ne la réchauffait pas par le pathétique du spectacle et de l'action, elle serait très insipide. Notre siècle recommandable par d'autres endroits, est le siècle de la sécheresse.
Est-il vrai que chez les Romains un acteur récitait, et un autre faisait les gestes?
Ce n'est pas par méprise que l'abbé Dubos imagina cette plaisante façon de déclamer. Tite-Live qui ne néglige jamais de nous instruire des moeurs et des usages des Romains, et qui en cela est plus utile que l'ingénieux et satirique Tacite; Tite-Live, Lib. VII. dis-je, nous apprend qu'Andronicus s'étant enroué en chantant dans les intermèdes, obtint qu'un autre chantât pour lui tandis qu'il exécuterait la danse, et que de là vint la coutume de partager les intermèdes entre les danseurs et les chanteurs. Dicitur cantum egisse magis vigente motu cum nihil vocis usus impediebat . Il exprima le chant par la danse. Cantum egisse magis vigente motu avec des mouvements plus vigoureux.
Mais on ne partagea point le récit de la pièce entre un acteur qui n'eût fait que gesticuler, et un autre qui n'eût que déclamé. La chose aurait été aussi ridicule qu'impraticable.
L'art des pantomimes qui jouent sans parler, est tout différent, et nous en avons vu des exemples très frappants; mais cet art ne peut plaire que lorsqu'on représente une action marquée, un événement théâtral qui se dessine aisément dans l'imagination du spectateur. On peut représenter Orosmane tuant Zaïre, et se tuant lui-même; Sémiramis se traînant blessée sur les marches du tombeau de Ninus, et tendant les bras à son fils. On n'a pas besoin de vers pour exprimer ces situations par des gestes, aux sons d'une symphonie lugubre et terrible. Mais comment deux pantomimes peindront-ils la dissertation de Maxime et de Cinna sur les gouvernements monarchiques et populaires?
A propos de l'exécution théâtrale chez les Romains, l'abbé Dubos dit, que les danseurs dans les intermèdes étaient toujours en robe. La danse exige un habit plus leste. On conserve précieusement dans le pays de Vaud, une grande salle de bains bâtie par les Romains, dont le pavé est en mosaïque. Cette mosaïque qui n'est point dégradée, représente des danseurs vêtus précisément comme les danseurs de l'Opéra. On ne fait pas ces observations pour relever des erreurs dans Dubos; il n'y a nul mérite dans le hasard d'avoir vu ce monument antique qu'il n'avait point vu; et on peut d'ailleurs être un esprit très solide et très juste, en se trompant sur un passage de Tite-Live.
CHARITÉ, [p. 137] ↩
MAISONS DE CHARITÉ, DE BIENFAISANCE, HOPITAUX, HOTELS-DIEU ,&c.
Cicéron parle en plusieurs endroits de la charité universelle; charitas humani generis ; mais on ne voit point que la police et la bienfaisance des Romains aient établi de ces maisons de charité où les pauvres et les malades fussent soulagés aux dépens du public. Il y avait une maison pour les étrangers au port d'Ostia, qu'on appelait Xenodokium . St Jérôme rend aux Romains cette justice. Les hôpitaux pour les pauvres semblent avoir été inconnus dans l'ancienne Rome. Elle avait un usage plus noble, celui de fournir des blés au peuple. Trois cent vingt-sept greniers immenses étaient établis à Rome. Avec cette libéralité continuelle, on n'avait pas besoin d'hôpital; il n'y avait point de nécessiteux.
On ne pouvait fonder des maisons de charité pour les enfants trouvés; personne n'exposait ses enfants; les maîtres prenaient soin de ceux de leurs esclaves. Ce n'était point une honte à une fille du peuple d'accoucher. Les plus pauvres familles, nourries par la république, et ensuite par les empereurs, voyaient la subsistance de leurs enfants assurée.
Le mot de maison de charité suppose, chez nos nations modernes, une indigence que la forme de nos gouvernements n'a pu prévenir.
Le mot d' hôpital qui rappelle celui d' hospitalité , fait souvenir d'une vertu célèbre chez les Grecs qui n'existe plus; mais aussi il exprime une vertu bien supérieure. La différence est grande entre loger, nourrir, guérir tous les malheureux qui se présentent, et recevoir chez vous deux ou trois voyageurs chez qui vous aviez aussi le droit d'être reçu. L'hospitalité, après tout n'était qu'un échange. Les hôpitaux sont des monuments de bienfaisance.
Il est vrai que les Grecs connaissaient les hôpitaux sous le nom de Xénodokia pour les étrangers, Nozocomeia pour les malades, et de Ptokia pour les pauvres. On lit dans Diogène de Laërce concernant Bion ce passage, Il souffrit beaucoup par l'indigence de ceux qui étaient chargés du soin des malades .
L'hospitalité entre particuliers s'appelait Idioxenia , et entre les étrangers Proxenia . De là on appelait Proxenos celui qui recevait et entretenait chez lui les étrangers au nom de toute la ville; mais cette institution paraît avoir été fort rare.
Il n'est guère aujourd'hui de ville en Europe sans hôpitaux. Les Turcs en ont, et même pour les bêtes, ce qui semble outrer la charité. Il vaudrait mieux oublier les bêtes et songer davantage aux hommes.
Cette prodigieuse multitude de maisons de charité prouve évidemment une vérité à laquelle on ne fait pas assez d'attention; c'est que l'homme n'est pas si méchant qu'on le dit, et que malgré toutes ses fausses opinions, malgré les horreurs de la guerre qui le changent en bête féroce, on peut croire que cet animal est bon, et qu'il n'est méchant que quand il est effarouché, ainsi que les autres animaux: le mal est qu'on l'agace trop souvent.
Rome moderne a presque autant de maisons de charité que Rome antique avait d'arcs de triomphe et d'autres monuments de conquête. La plus considérable de ces maisons est une banque qui prête sur gages à deux pour cent, et qui vend les effets, si l'emprunteur ne les retire pas dans le temps marqué. On appelle cette maison l' archihospedale , l'archihôpital. Il est dit, qu'il y a presque toujours deux mille malades, ce que ferait la cinquantième partie des habitants de Rome pour cette seule maison, sans compter les enfants qu'on y élève, et les pélerins qu'on y héberge. De quels calculs ne faut-il pas rabattre!
N'a-t-on pas imprimé dans Rome que l'hôpital de la Trinité avait couché et nourri pendant trois jours quatre cent quarante mille cinq cents pélerins, et vingt-cinq mille cinq cents pélerines au jubilé de l'an 1600? Misson lui-même, n'a-t-il pas dit que l'hôpital de l'Annonciade à Naples possède deux de nos millions de rente?
Peut-être enfin qu'une maison de charité fondée pour recevoir des pélerins qui sont d'ordinaire des vagabonds, est plutôt un encouragement à la fainéantise qu'un acte d'humanité. Mais ce qui est véritablement humain, c'est qu'il y a dans Rome cinquante maisons de charité de toutes les espèces. Ces maisons de charité, de bienfaisance, sont aussi utiles et aussi respectables que les richesses de quelques monastères et de quelques chapelles sont inutiles et ridicules.
Il est beau de donner du pain, des vêtements, des remèdes, des secours en tout genre à ses frères; mais quel besoin un saint a-t-il d'or et de diamants? quel bien revient-il aux hommes que Notre-Dame de Lorette ait un plus beau trésor que le sultan des Turcs? Lorette est une maison de vanité et non de charité.
Londres, en comptant les écoles de charité, a autant de maisons de bienfaisance que Rome.
Le plus beau monument de bienfaisance qu'on ait jamais élevé, est l'Hôtel des invalides fondé par Louis XIV.
De tous les hôpitaux, celui où l'on reçoit journellement le plus de pauvres malades, est l'Hôtel-Dieu de Paris. Il y en a eu souvent entre quatre à cinq mille à la fois. Dans ces cas, la multitude nuit à la charité même. C'est en même temps le réceptacle de toutes les horribles misères humaines, et le temple de la vraie vertu qui consiste à les secourir.
Il faudrait avoir souvent dans l'esprit le contraste d'une fête de Versailles, d'un opéra de Paris, où tous les plaisirs et toutes les magnificences sont réunis avec tant d'art, et d'un Hôtel-Dieu où toutes les douleurs, tous les dégoûts et la mort sont entassés avec tant d'horreur. C'est ainsi que sont composées les grandes villes.
Par une police admirable, les voluptés mêmes et le luxe servent la misère et la douleur. Les spectacles de Paris ont payé année commune un tribut de plus de cent mille écus à l'hôpital.
Dans ces établissements de charité, les inconvénients ont souvent surpassé les avantages. Une preuve des abus attachés à ces maisons, c'est que les malheureux qu'on y transporte craignent d'y être.
L'Hôtel-Dieu, par exemple, était très bien placé autrefois dans le milieu de la ville auprès de l'évêché. Il l'est très mal quand la ville est trop grande, quand quatre ou cinq malades sont entassés dans chaque lit, quand un malheureux donne le scorbut à son voisin dont il reçoit la vérole, et qu'une atmosphère empestée répand les maladies incurables et la mort, non seulement dans cet hospice destiné pour rendre les hommes à la vie, mais dans une grande partie de la ville à la ronde.
L'inutilité, le danger même de la médecine en ce cas, sont démontrés. S'il est si difficile qu'un médecin connaisse et guérisse une maladie d'un citoyen bien soigné dans sa maison, que sera-ce de cette multitude de maux compliqués, accumulés les uns sur les autres dans un lieu pestiféré?
En tout genre souvent plus le nombre est grand, plus mal on est.
M. de Chamousset, l'un des meilleurs citoyens et des plus attentifs au bien public, a calculé par des relevés fidèles, qu'il meurt un quart des malades à l'Hôtel-Dieu, un huitième à l'hôpital de la Charité, un neuvième dans les hôpitaux de Londres, un trentième dans ceux de Versailles.
Dans le grand et célèbre hôpital de Lyon, qui a été longtemps un des mieux administrés de l'Europe, il ne mourait qu'un quinzième des malades, année commune.
On a proposé souvent de partager l'Hôtel-Dieu de Paris en plusieurs hospices mieux situés, plus aérés, plus salutaires; l'argent a manqué pour cette entreprise.
Curtae nescio quid semper abest rei .
On en trouve toujours quand il s'agit d'aller faire tuer des hommes sur la frontière; il n'y en a plus quand il faut les sauver. Cependant l'Hôtel-Dieu de Paris possède plus d'un million de revenu qui augmente chaque année; et les Parisiens l'ont doté à l'envi.
On ne peut s'empêcher de remarquer ici que Germain Brice, dans sa Description de Paris , en parlant de quelques legs faits par le premier président de Bellièvre à la salle de l'Hôtel-Dieu, nommée St Charles, dit, ‘qu'il faut lire cette belle inscription gravée en lettres d'or dans une grande table de marbre de la composition d'Olivier Patru de l'Académie française, un des plus beaux esprits de son temps, dont on a des plaidoyers fort estimés'.
Qui que tu sois qui entres dans ce saint lieu, tu n'y verras presque partout que des fruits de la charité du grand Pomponne; les brocards d'or et d'argent, et les beaux meubles qui paraient autrefois sa chambre, par une heureuse métamorphose, servent maintenant aux nécessités des malades. Cet homme divin qui fut l'ornement et les délices de son siècle, dans le combat même de la mort, a pensé au soulagement des affligés. Le sang de Bellièvre s'est montré dans toutes les actions de sa vie. La gloire de ses ambassades n'est que trop connue, etc .
L'utile Chamousset fit mieux que Germain Brice et Olivier Patru l'un des plus beaux esprits du temps; voici le plan dont il proposa de se charger à ses frais, avec une compagnie solvable.
Les administrateurs de l'Hôtel-Dieu portaient en compte la valeur de cinquante livres pour chaque malade, ou mort, ou guéri. M. de Chamousset et sa compagnie offraient de gérer pour cinquante livres seulement par guérison. Les morts allaient par-dessus le marché, et étaient à sa charge.
La proposition était si belle, qu'elle ne fut point acceptée. On craignit qu'il ne pût la remplir. Tout abus qu'on veut réformer est le patrimoine de ceux qui ont plus de crédit que les réformateurs.
Une chose non moins singulière, est que l'Hôtel-Dieu a seul le privilège de vendre la chair en carême à son profit; et il y perd. M. de Chamousset offrit de faire un marché où l'Hôtel-Dieu gagnerait; on le refusa, et on chassa le boucher qu'on soupçonna de lui avoir donné l'avis.
Ainsi chez les humains, par un abus fatal,
Le bien le plus parfait est la source du mal.
CHARLATAN. [p. 141] ↩
L'article Charlatan du Dictionnaire encyclopédique, est rempli de vérités utiles, agréablement énoncées. M. le chevalier de Jaucour y a développé le charlatanisme de la médecine.
On prendra ici la liberté d'y ajouter quelques réflexions. Le séjour des médecins est dans les grandes villes; il n'y en a presque point dans les campagnes. C'est dans les grandes villes que sont les riches malades; la débauche, les excès de table, les passions causent leurs maladies. Dumoulin, non pas le jurisconsulte, mais le médecin, qui était aussi bon praticien que l'autre, a dit en mourant, qu'il laissait deux grands médecins après lui, la diète et l'eau de la rivière.
En 1728, du temps de Lass le plus fameux des charlatans de la première espèce; un autre, nommé Villars, confia à quelques amis que son oncle qui avait vécu près de cent ans, et qui n'était mort que par accident, lui avait laissé le secret d'une eau qui pouvait aisément prolonger la vie jusqu'à cent cinquante années, pourvu qu'on fût sobre. Lorsqu'il voyait passer un enterrement, il levait les épaules de pitié; si le défunt, disait-il, avait bu de mon eau, il ne serait pas où il est. Ses amis, auxquels il en donna généreusement, et qui observèrent un peu le régime prescrit, s'en trouvèrent bien. Alors il vendit la bouteille six francs; le débit en fut prodigieux. C'était de l'eau de Seine avec un peu de nitre. Ceux qui en prirent et qui s'astreignirent à un peu de régime, surtout qui étaient nés avec un bon tempérament, recouvrèrent en peu de jours une santé parfaite. Il disait aux autres, C'est votre faute si vous n'êtes pas entièrement guéris. Vous avez été intempérants et incontinents: corrigez-vous de ces deux vices, et vous vivrez cent cinquante ans pour le moins. Quelques-uns se corrigèrent; la fortune de ce bon charlatan s'augmenta comme sa réputation. L'abbé de Pons l'enthousiaste, le mettait fort au-dessus du maréchal de Villars: il fait tuer des hommes, lui dit-il, et vous les faites vivre.
On sut enfin que l'eau de Villars n'était que de l'eau de rivière; on n'en voulut plus: et on alla à d'autres charlatans.
Il est certain qu'il avait fait du bien, et qu'on ne pouvait lui reprocher que d'avoir vendu l'eau de la Seine un peu trop cher. Il portait les hommes à la tempérance, et par là il était supérieur à l'apothicaire Arnoud qui a farci l'Europe de ses sachets contre l'apoplexie, sans recommander aucune vertu.
J'ai connu un médecin de Londres nommé Broun, qui pratiquait aux Barbades. Il avait une sucrerie et des nègres; on lui vola une somme considérable; il assemble ses nègres: Mes amis, leur dit-il, le grand serpent m'a apparu dans la nuit, il m'a dit que le voleur aurait dans ce moment une plume de perroquet sur le bout du nez. Le coupable, sur le champ porte la main à son nez. C'est toi qui m'as volé, dit le maître; le grand serpent vient de m'en instruire; et il reprit son argent. On ne peut guère condamner une telle charlatanerie; mais il fallait avoir à faire à des nègres.
Scipion le premier Africain, ce grand Scipion fort différent d'ailleurs du médecin Broun, faisait croire volontiers à ses soldats qu'il était inspiré par les dieux. Cette grande charlatanerie était en usage dès longtemps. Peut-on blâmer Scipion de s'en être servi? il fut peut-être l'homme qui fit le plus d'honneur à la république romaine; mais pourquoi les dieux lui inspirèrent-ils de ne point rendre ses comptes?
Numa fit mieux; il fallait policer des brigands et un sénat qui était la portion de ces brigands la plus difficile à gouverner. S'il avait proposé ses lois aux tribus assemblées, les assassins de son prédécesseur lui auraient fait mille difficultés. Il s'adresse à la déesse Egérie qui lui donne des pandectes de la part de Jupiter; il est obéi sans contradiction, et il règne heureux. Ses instructions sont bonnes, son charlatanisme fait du bien; mais si quelque ennemi secret avait découvert la fourberie, si on avait dit, Exterminons un fourbe qui prostitue le nom des dieux pour tromper les hommes, il courait risque d'être envoyé au ciel avec Romulus.
Il est probable que Numa prit très bien ses mesures, et qu'il trompa les Romains pour leur profit avec une habileté convenable au temps, aux lieux, à l'esprit des premiers Romains.
Mahomet fut vingt fois sur le point d'échouer; mais enfin il réussit avec les Arabes de Médine, et on le crut intime ami de l'ange Gabriel. Si quelqu'un venait aujourd'hui annoncer dans Constantinople qu'il est le favori de l'ange Raphaël très supérieur à Gabriel en dignité, et que c'est à lui seul qu'il faut croire, il serait empalé en place publique. C'est aux charlatans à bien prendre leur temps.
N'y avait-il pas un peu de charlatanisme dans Socrate avec son démon familier, et la déclaration précise d'Apollon qui le proclama le plus sage de tous les hommes? Comment Rollin, dans son histoire, peut-il raisonner d'après cet oracle? comment ne fait-il pas connaître à la jeunesse que c'était une pure charlatanerie? Socrate prit mal son temps. Peut-être cent ans plus tôt il aurait gouverné Athènes.
Tout chef de secte en philosophie a été un peu charlatan; mais les plus grands de tous ont été ceux qui ont aspiré à la domination. Cromwell fut le plus terrible de tous nos charlatans. Il parut précisément dans le seul temps où il pouvait réussir: sous Elizabeth il aurait été pendu: sous Charles II il n'eût été que ridicule. Il vint heureusement dans le temps où l'on était dégoûté des rois; et son fils, dans le temps où l'on était las d'un protecteur.
DE LA CHARLATANERIE DES SCIENCES ET DE LA LITTÉRATURE.
Les sciences ne pouvaient guère être sans charlatanerie. On veut faire recevoir ses opinions; le docteur subtil veut éclipser le docteur angélique; le docteur profond veut régner seul. Chacun bâtit son système de physique, de métaphysique, de théologie scolastique; c'est à qui fera valoir sa marchandise. Vous avez des courtiers qui la vantent, des sots qui vous croient, des protecteurs qui vous appuient.
Y a-t-il une charlatanerie plus grande que de mettre les mots à la place des choses, et de vouloir que les autres croient ce que vous ne croyez pas vous-mêmes?
L'un établit des tourbillons de matière subtile rameuse, globuleuse, striée, cannelée; l'autre des éléments de matière qui ne sont point matière, et une harmonie préétablie qui fait que l'horloge du corps sonne l'heure quand l'horloge de l'âme la montre par son aiguille. Ces chimères trouvent des partisans pendant quelques années. Quand ces drogues sont passées de mode, de nouveaux énergumènes montent sur le théâtre ambulant; ils bannissent les germes du monde, ils disent que la mer a produit les montagnes, et que les hommes ont été autrefois poissons.
Combien a-t-on mis de charlatanerie dans l'histoire, soit en étonnant le lecteur par des prodiges, soit en chatouillant la malignité humaine par des satires, soit en flattant des familles de tyrans par d'infâmes éloges?
La malheureuse espèce qui écrit pour vivre, est charlatane d'une autre manière. Un pauvre homme qui n'a point de métier, qui a eu le malheur d'aller au collège et qui croit savoir écrire, va faire sa cour à un marchand libraire, et lui demande à travailler. Le marchand libraire sait que la plupart des gens domiciliés veulent avoir de petites bibliothèques, qu'il leur faut des abrégés et des titres nouveaux; il ordonne à l'écrivain un abrégé de l' Histoire de Rapin-Thoiras, un abrégé de l' Histoire de l'Eglise , un Recueil de bons mots tiré de Ménagiana , un Dictionnaire des grands hommes , où l'on place un pédant inconnu à côté de Cicéron, et un sonnettiero d'Italie auprès de Virgile.
Un autre marchand libraire commande des romans, ou des traductions de romans. Si vous n'avez pas d'imagination, dit-il à son ouvrier, vous prendrez quelques aventures dans Cyrus , dans Gusman d'Alfarache , dans les Mémoires secrets d'un homme de qualité ou d'une femme de qualité; et du total vous ferez un volume de quatre cents pages à vingt sous la feuille.
Un autre marchand libraire donne les gazettes et les almanachs de dix années à un homme de génie. Vous me ferez un extrait de tout cela, et vous me le rapporterez dans trois mois sous le nom d' Histoire fidèle du temps , par M. le chevalier de trois étoiles lieutenant de vaisseau, employé dans les affaires étrangères.
De ces sortes de livres il y en a environ cinquante mille en Europe, et tout cela passe comme le secret de blanchir la peau, de noircir les cheveux et la panacée universelle.
CHARLES IX. [p. 145] ↩
Charles IX roi de France, était, dit-on, un bon poète. Il est sûr que ses vers étaient admirables de son vivant. Brantôme ne dit pas à la vérité que ce roi fût le meilleur poète de l'Europe, mais il assure qu' il faisait surtout fort gentiment des quatrains impromptu sans songer, (comme il en a vu plusieurs) et quand il faisait mauvais temps ou pluie, ou d'un extrême chaud, il envoyait quérir messieurs les poètes en son cabinet, et là passait son temps avec eux .
S'il avait toujours passé son temps ainsi, et surtout s'il avait fait de bons vers, nous n'aurions pas eu la St Barthélemi; il n'aurait pas tiré de sa fenêtre avec une carabine sur ses propres sujets comme sur des perdreaux. Ne croyez-vous pas qu'il est impossible qu'un bon poète soit un barbare? pour moi j'en suis persuadé.
On lui attribue ces vers, faits en son nom pour Ronsard.
Ta lyre qui ravit par de si doux accords,
Te soumet les esprits dont je n'ai que les corps;
Le maître elle t'en rend, et te sait introduire
Où le plus fier tyran ne peut avoir d'empire.
Ces vers sont bons, mais sont-ils de lui? ne sont-ils pas de son précepteur? en voici de son imagination royale qui sont un peu différents.
Il faut suivre ton roi qui t'aime par sus tous,
Pour les vers qui de toi coulent braves et doux;
Et crois, si tu ne viens me trouver à Pontoise,
Qu'entre nous adviendra une très grande noise.
L'auteur de la St Barthélemi pourrait bien avoir fait ceux-là. Les vers de César sur Térence sont écrits avec un peu plus d'esprit et de goût. Ils respirent l'urbanité romaine. Ceux de François I e r et de Charles IX se ressentent de la grossièreté welche. Plût à Dieu que Charles IX eût fait plus de vers même mauvais! Une application constante aux arts aimables adoucit les moeurs.
Emollit mores nec sinit esse feros .
Au reste, la langue française ne commença à se dérouiller un peu, que longtemps après Charles IX. Voyez les lettres qu'on nous a conservées de François I e r . Tout est perdu fors l'honneur , est d'un digne chevalier; mais en voici une qui n'est ni de Cicéron, ni de César.
Tout a steure ynsi que je me volois mettre o lit est arrivé Laval qui m'a aporté la serteneté du lèvement du siège .
Nous avons quelques lettres de la main de Louis XIII, qui ne sont pas mieux écrites. On n'exige pas qu'un roi écrive des lettres comme Pline, ni qu'il fasse des vers comme Virgile; mais personne n'est dispensé de bien parler sa langue. Tout prince qui écrit comme une femme de chambre, a été fort mal élevé.
CHEMINS. [p. 147] ↩
Il n'y a pas longtemps que les nouvelles nations de l'Europe ont commencé à rendre les chemins praticables, et à leur donner quelque beauté. C'est un des grands soins des empereurs mongols et de ceux de la Chine. Mais ces princes n'ont pas approché des Romains. La voie Appienne, l'Aurélienne, la Flaminienne, l'Emilienne, la Trajane subsistent encore. Les seuls Romains pouvaient faire de tels chemins, et seuls pouvaient les réparer.
Bergier, qui d'ailleurs a fait un livre utile, insiste beaucoup sur ce que Salomon employa trente mille Juifs pour couper du bois sur le Liban, quatre-vingt mille pour maçonner son temple, soixante et dix mille pour les charrois; et trois mille six cents pour présider aux travaux. Soit: mais il ne s'agissait pas là de grands chemins.
Pline dit, qu'on employa trois cent mille hommes pendant vingt ans pour bâtir une pyramide en Egypte: je le veux croire; mais voilà trois cent mille hommes bien mal employés. Ceux qui travaillèrent aux canaux de l'Egypte, à la grande muraille, aux canaux et aux chemins de la Chine; ceux qui construisirent les voies de l'empire romain, furent plus avantageusement occupés que les trois cent mille misérables qui bâtirent des tombeaux en pointe pour faire reposer le cadavre d'un superstitieux Egyptien.
On connaît assez les prodigieux ouvrages des Romains; les lacs creusés ou détournés, les collines aplanies; la montagne percée par Vespasien dans la voie Flaminienne l'espace de mille pieds de longueur, et dont l'inscription subsiste encore. Le Pausilipe n'en approche pas.
Il s'en faut beaucoup que les fondations de la plupart de nos maisons soient aussi solides que l'étaient les grands chemins dans le voisinage de Rome; et ces voies publiques s'étendirent dans tout l'empire, mais non pas avec la même solidité. Ni l'argent, ni les hommes n'auraient pu y suffire.
Presque toutes les chaussées d'Italie étaient relevées sur quatre pieds de fondation. Lorsqu'on trouvait un marais sur le chemin, on le comblait. Si on rencontrait un endroit montagneux, on le joignait au chemin par une pente douce. On soutenait en plusieurs lieux ces chemins par des murailles.
Sur les quatre pieds de maçonnerie étaient posées de larges pierres de taille, des marbres épais de près d'un pied, et souvent larges de dix; ils étaient piqués au ciseau, afin que les chevaux ne glissassent pas. On ne savait ce qu'on devait admirer davantage ou l'utilité ou la magnificence.
Presque toutes ces étonnantes constructions se firent aux dépens du trésor public. César répara et prolongea la voie Appienne de son propre argent; mais son argent n'était que celui de la république.
Quels hommes employait-on à ces travaux? les esclaves, les peuples domptés, les provinciaux qui n'étaient point citoyens romains. On travaillait par corvées, comme on fait en France et ailleurs, mais on leur donnait une petite rétribution.
Auguste fut le premier qui joignit les légions au peuple pour travailler aux grands chemins dans les Gaules, en Espagne, en Asie. Il perça les Alpes à la vallée qui porta son nom, et que les Piémontais et les Français appellent par corruption la vallée d'Aoste . Il fallut d'abord soumettre tous les sauvages qui habitaient ces cantons. On voit encore entre le grand et le petit St Bernard l'arc de triomphe que le sénat lui érigea après cette expédition. Il perça encore les Alpes par un autre côté qui conduit à Lyon, et de là dans toute la Gaule. Les vaincus n'ont jamais fait pour eux-mêmes ce que firent les vainqueurs.
La chute de l'empire romain fut celle de tous les ouvrages publics, comme de toute police, de tout art, de toute industrie. Les grands chemins disparurent dans les Gaules, excepté quelques chaussées que la malheureuse reine Brunehaut fit réparer pour un peu de temps. A peine pouvait-on aller à cheval sur les anciennes voies qui n'étaient plus que des abîmes de bourbe entremêlée de pierres. Il fallait passer par les champs labourables; les charrettes faisaient à peine en un mois le chemin qu'elles font aujourd'hui dans une semaine. Le peu de commerce qui subsista fut borné à quelques draps, quelques toiles, un peu de mauvaise quincaillerie qu'on portait à dos de mulet dans des prisons à créneaux et à machicoulis, qu'on appelait châteaux , situés dans des marais, ou sur la cîme des montagnes couvertes de neige.
Pour peu qu'on voyageât pendant les mauvaises saisons si longues et si rebutantes dans les climats septentrionaux, il fallait ou enfoncer dans la fange, ou gravir sur des rocs. Telles furent l'Allemagne et la France entière jusqu'au milieu du dix-septième siècle. Tout le monde était en bottes: on allait dans les rues sur des échasses dans plusieurs villes d'Allemagne.
Enfin sous Louis XIV, on commença les grands chemins que les autres nations ont imités. On en a fixé la largeur à soixante pieds en 1720. Ils sont bordés d'arbres en plusieurs endroits jusqu'à trente lieues de la capitale; cet aspect forme un coup d'oeil admirable. Les voies militaires romaines n'étaient larges que de seize pieds; mais elles étaient infiniment plus solides. On n'était pas obligé de les réparer tous les ans comme les nôtres. Elles étaient embellies de monuments, de colonnes milliaires, et même de tombeaux superbes. Car ni en Grèce ni en Italie il n'était permis de faire servir les villes de sépultures; encore moins les temples: c'eût été un sacrilège. Il n'en était pas comme dans nos églises, où une vanité de barbares fait ensevelir à prix d'argent des bourgeois riches qui infectent le lieu même où l'on vient adorer Dieu, et où l'encens ne semble brûler que pour déguiser les odeurs des cadavres, tandis que les pauvres pourrissent dans le cimetière attenant, et que les uns et les autres répandent les maladies contagieuses parmi les vivants.
Les empereurs furent presque les seuls dont les cendres reposèrent dans des monuments érigés à Rome.
Les grands chemins de soixante pieds de large occupent trop de terrain. C'est environ quarante pieds de trop. La France a près de deux cents lieues ou environ de l'embouchure du Rhône au fond de la Bretagne, autant de Perpignan à Dunkerke, en comptant la lieue à deux mille cinq cents toises. Cela fait cent vingt millions de pieds carrés pour deux seuls grands chemins, perdus pour l'agriculture. Cette perte est très considérable dans un pays où les récoltes ne sont pas toujours abondantes.
On essaya de paver le grand chemin d'Orléans qui n'était pas de cette largeur; mais on s'aperçut depuis que rien n'était plus mal imaginé pour une route couverte continuellement de gros charrois. De ces pavés posés tout simplement sur la terre, les uns se baissent, les autres s'élèvent; le chemin devient raboteux, et bientôt impraticable; il a fallu y renoncer.
Les chemins recouverts de gravier et de sable exigent un nouveau travail toutes les années. Ce travail nuit à la culture des terres, et ruine l'agriculteur.
M. Turgot, fils du prévôt des marchands, dont le nom est en bénédiction à Paris, et l'un des plus éclairés magistrats du royaume et des plus zélés pour le bien public; et le bienfaisant M. de Fontète ont remédié autant qu'ils ont pu à ce fatal inconvénient dans les provinces du Limousin et de la Normandie.
On a prétendu qu'on devait, à l'exemple d'Auguste et de Trajan, employer les troupes à la confection des chemins; mais alors il faudrait augmenter la paie du soldat; et un royaume qui n'était qu'une province de l'empire romain, et qui est souvent obéré, peut rarement entreprendre ce que l'empire romain faisait sans peine.
C'est une coutume assez sage dans les Pays-Bas d'exiger de toutes les voitures un péage modique pour l'entretien des voies publiques. Ce fardeau n'est point pesant. Le paysan est à l'abri des vexations. Les chemins y sont une promenade continue très agréable.
Les canaux sont beaucoup plus utiles. Les Chinois surpassent tous les peuples par ces monuments qui exigent un entretien continuel. Louis XIV, Colbert, et Riquet se sont immortalisés par le canal qui joint les deux mers; on ne les a pas encore imités. Il n'est pas difficile de traverser une grande partie de la France par des canaux. Rien n'est plus aisé en Allemagne que de joindre le Rhin au Danube, mais on a mieux aimé s'égorger et se ruiner pour la possession de quelques villages que de contribuer au bonheur du monde.
CHIEN. [p. 151] ↩
Il semble que la nature ait donné le chien à l'homme pour sa défense et pour son plaisir. C'est de tous les animaux le plus fidèle: c'est le meilleur ami que puisse avoir l'homme.
Il paraît qu'il y en a plusieurs espèces absolument différentes. Comment imaginer qu'un lévrier vienne originairement d'un barbet? il n'en a ni le poil, ni les jambes, ni le corsage, ni la tête, ni les oreilles, ni la voix, ni l'odorat, ni l'instinct. Un homme qui n'aurait vu en fait de chiens que des barbets ou des épagneuls, et qui verrait un lévrier pour la première fois, le prendrait plutôt pour un petit cheval nain que pour un animal de la race épagneule. Il est bien vraisemblable que chaque race fut toujours ce qu'elle est, sauf le mélange de quelques-unes en petit nombre.
Il est étonnant que le chien ait été déclaré immonde dans la loi juive, comme l'ixion, le griffon, le lièvre, le porc, l'anguille; il faut qu'il y ait quelque raison physique ou morale que nous n'ayons pu encore découvrir.
Ce qu'on raconte de la sagacité, de l'obéissance, de l'amitié, du courage des chiens est prodigieux, et est vrai. Le philosophe Voyage d'Ulloa au Pérou , liv. VI. militaire Ulloa, nous assure que dans le Pérou les chiens espagnols reconnaissent les hommes de race indienne, les poursuivent et les déchirent; que les chiens péruviens en font autant des espagnols. Ce fait semble prouver que l'une et l'autre espèce de chiens retient encore la haine qui lui fut inspirée du temps de la découverte; et que chaque race combat toujours pour ses maîtres avec le même attachement et la même valeur.
Pourquoi donc le mot de chien est-il devenu une injure? On dit par tendresse, mon moineau, ma colombe, ma poule ; on dit même mon chat ; quoique cet animal soit traître. Et quand on est fâché, on appelle les gens chiens ! Les Turcs mêmes, sans être en colère, disent par une horreur mêlée au mépris, les chiens de chrétiens . La populace anglaise, en voyant passer un homme qui par son maintien, son habit et sa perruque, a l'air d'être né vers les bords de la Seine ou de la Loire, l'appelle communément French dog , chien de Français. Cette figure de rhétorique n'est pas polie et paraît injuste.
Le délicat Homère introduit d'abord le divin Achille disant au divin Agamemnon, qu' il est impudent comme un chien . Cela pourrait justifier la populace anglaise.
Les plus zélés partisans du chien doivent confesser que cet animal a de l'audace dans les yeux, que plusieurs sont hargneux, qu'ils mordent quelquefois des inconnus en les prenant pour des ennemis de leurs maîtres; comme des sentinelles tirent sur les passants qui approchent trop de la contrescarpe. Ce sont là probablement les raisons qui ont rendu l'épithète de chien une injure; mais nous n'osons décider.
Pourquoi le chien a-t-il été adoré ou révéré (comme on voudra) chez les Egyptiens? C'est, dit-on, que le chien avertit l'homme. Plutarque, ch. d'Isis et d'Osiris. Plutarque nous apprend qu'après que Cambyse eut tué leur boeuf Apis et l'eut fait mettre à la broche, aucun animal n'osa manger les restes des convives, tant était profond le respect pour Apis; mais le chien ne fut pas si scrupuleux, il avala du dieu. Les Egyptiens furent scandalisés comme on le peut croire, et Anubis perdit beaucoup de son crédit.
Le chien conserva pourtant l'honneur d'être toujours dans le ciel sous le nom du grand et du petit chien . Nous eûmes constamment les jours caniculaires.
Mais de tous les chiens, Cerbère fut celui qui eut le plus de réputation; il avait trois gueules. Nous avons remarqué que tout allait par trois. Isis, Osiris et Orus les trois premières divinités égyptiaques; les trois frères dieux du monde grec, Jupiter, Neptune et Pluton; les trois parques; les trois furies; les trois juges d'enfer; les trois gueules du chien de là-bas.
Nous nous apercevons ici avec douleur que nous avons omis l'article des chats ; mais nous nous consolons en renvoyant à leur histoire. Nous remarquerons seulement qu'il n'y a point de chats dans les cieux, comme il y a des chèvres, des écrevisses, des taureaux, des béliers, des aigles, des lions, des poissons, des lièvres et des chiens. Mais en récompense, le chat fut consacré ou révéré, ou adoré du culte de dulie dans quelques villes, et peut-être de latrie par quelques femmes.
DE LA CHINE. [p. 153] ↩
Nous avons assez remarqué ailleurs combien il est téméraire et maladroit de disputer à une nation telle que la chinoise ses titres authentiques. Nous n'avons aucune maison en Europe dont l'antiquité soit aussi bien prouvée que celle de l'empire de la Chine. Figurons-nous un savant maronite du mont Athos qui contesterait la noblesse des Morozini, des Tiepolo et des autres anciennes maisons de Venise, des princes d'Allemagne, des Montmorency, des Châtillons, des Talerandes de France, sous prétexte qu'il n'en est parlé ni dans St Thomas, ni dans St Bonaventure. Ce maronite passerait-il pour un homme de bon sens ou de bonne foi?
Je ne sais quels lettrés de nos climats se sont effrayés de l'antiquité de la nation chinoise. Mais ce n'est point ici une affaire de scholastique. Laissez tous les lettrés chinois, tous les mandarins, tous les empereurs reconnaître Fo-hi pour un des premiers qui donnèrent des lois à la Chine environ deux mille cinq ou six cents ans avant notre ère vulgaire. Convenez qu'il faut qu'il y ait des peuples avant qu'il y ait des rois. Convenez qu'il faut un temps prodigieux avant qu'un peuple nombreux, ayant inventé les arts nécessaires, se soit réuni pour se choisir un maître. Si vous n'en convenez pas, il ne nous importe. Nous croirons toujours sans vous que deux et deux font quatre.
Dans une province d'Occident nommée autrefois la Celtique , on a poussé le goût de la singularité et du paradoxe jusqu'à dire que les Chinois n'étaient qu'une colonie d'Egypte, ou bien, si l'on veut, de Phénicie. On a cru prouver, comme on prouve tant d'autres choses, qu'un roi d'Egypte appelé Ménès par les Grecs, était le roi de la Chine Yu, et qu'Atoès était Ki, en changeant seulement quelques lettres; et voici de plus comme on a raisonné.
Les Egyptiens allumaient des flambeaux quelquefois pendant la nuit, les Chinois allument des lanternes; donc les Chinois sont évidemment une colonie d'Egypte. Le jésuite Parennin qui avait déjà vécu vingt-cinq ans à la Chine, et qui possédait également la langue et les sciences des Chinois, a réfuté toutes ces imaginations avec autant de politesse que de mépris. Tous les missionnaires, tous les Chinois à qui l'on conta qu'au bout de l'Occident on faisait la réforme de l'empire de la Chine, ne firent qu'en rire. Le père Parennin répondit un plus plus sérieusement. Vos Egyptiens, disait-il, passèrent apparemment par l'Inde pour aller peupler la Chine. L'Inde alors était-elle peuplée ou non? si elle l'était, aurait-elle laissé passer une armée étrangère? si elle ne l'était pas, les Egyptiens ne seraient-ils pas restés dans l'Inde? auraient-ils pénétré par des déserts et des montagnes impraticables jusqu'à la Chine, pour y aller fonder des colonies, tandis qu'ils pouvaient si aisément en établir sur les rivages fertiles de l'Inde et du Gange.
Les compilateurs d'une histoire universelle imprimée en Angleterre, ont voulu aussi dépouiller les Chinois de leur antiquité, parce que les jésuites étaient les premiers qui avaient bien fait connaître la Chine. C'est là sans doute une bonne raison pour dire à toute une nation: vous en avez menti .
Il y a, ce me semble, une réflexion bien importante à faire sur les témoignages que Confutzé, nommé parmi nous Confucius, rend à l'antiquité de sa nation; c'est que Confutzé n'avait nul intérêt de mentir; il ne faisait point le prophète, il ne se disait point inspiré, il n'enseignait point une religion nouvelle, il ne recourait point aux prestiges; il ne flatte point l'empereur sous lequel il vivait, il n'en parle seulement pas. C'est enfin le seul des instituteurs du monde qui ne se soit point fait suivre par des femmes.
J'ai connu un philosophe qui n'avait que le portrait de Confucius dans son arrière-cabinet; il mit au bas ces quatre vers:
De la seule raison salutaire interprète,
Sans éblouir le monde éclairant les esprits,
Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète;
Cependant on le crut, et même en son pays.
J'ai lu ses livres avec attention, j'en ai fait des extraits; je n'y ai trouvé que la morale la plus pure, sans aucune teinture de charlatanisme. Il vivait six cents ans avant notre ère vulgaire. Ses ouvrages furent commentés par les plus savants hommes de la nation. S'il avait menti, s'il avait fait une fausse chronologie, s'il avait parlé d'empereurs qui n'eussent point existé, ne se serait-il trouvé personne dans une nation savante qui eût réformé la chronologie de Confutzé? Un seul Chinois a voulu le contredire, et il a été universellement bafoué.
Ce n'est pas ici la peine d'opposer le monument de la grande muraille de la Chine aux monuments des autres nations qui n'en ont jamais approché, ni de redire que les pyramides d'Egypte ne sont que des masses inutiles et puériles en comparaison de ce grand ouvrage, ni de parler de trente-deux éclipses calculées dans l'ancienne chronique de la Chine, dont vingt-huit ont été vérifiées par les mathématiciens d'Europe, ni de faire voir combien le respect des Chinois pour leurs ancêtres assure l'existence de ces mêmes ancêtres, ni de répéter au long combien ce même respect a nui chez eux au progrès de la physique, de la géométrie et de l'astronomie.
On sait assez qu'ils sont encore aujourd'hui ce que nous étions tous il y a environ trois cents ans, des raisonneurs très ignorants. Le plus savant Chinois ressemble à un de nos savants du quinzième siècle qui possédait son Aristote. Mais on peut être un fort mauvais physicien et un excellent moraliste. Aussi c'est dans la morale et dans l'économie politique, dans l'agriculture, dans les arts nécessaires que les Chinois se sont perfectionnés. Nous leur avons enseigné tout le reste; mais dans cette partie nous devions être leurs disciples.
DE L'EXPULSION DES MISSIONNAIRES DE LA CHINE.
Humainement parlant, et indépendamment des services que les jésuites pouvaient rendre à la religion chrétienne, n'étaient-ils pas bien malheureux d'être venus de si loin porter la discorde et le trouble dans le plus vaste royaume et le mieux policé de la terre? Et n'était-ce pas abuser horriblement de l'indulgence et de la bonté des peuples orientaux, surtout après les torrents de sang versés à leur occasion au Japon? scène affreuse dont cet empire n'a cru pouvoir prévenir les suites qu'en fermant ses ports à tous les étrangers.
Ils avaient obtenu de l'empereur de la Chine Cam-hi la permission d'enseigner le catholicisme; ils s'en servirent pour faire croire à la petite portion du peuple dirigé par eux, qu'on ne pouvait servir d'autre maître que celui qui tenait la place de Dieu sur la terre, et qui résidait en Italie sur le bord d'une petite rivière nommée le Tibre; que toute autre opinion religieuse, tout autre culte était abominable aux yeux de Dieu, et qu'il punirait éternellement quiconque ne croirait pas aux jésuites; que l'empereur Cam-hi leur bienfaiteur, qui ne pouvait pas prononcer Christ parce que les Chinois n'ont point la lettre R, serait damné à tout jamais; que l'empereur Yontchin son fils le serait sans miséricorde; que tous les ancêtres des Chinois et des Tartares l'étaient, que leurs descendants le seraient ainsi que tout le reste de la terre; et que les révérends pères jésuites avaient une compassion vraiment paternelle de la damnation de tant d'âmes.
Ils vinrent à bout de persuader trois princes du sang tartare. Cependant l'empereur Cam-hi mourut à la fin de 1722. Il laissa l'empire à son quatrième fils Yontchin, qui a été si célèbre dans le monde entier par la justice et par la sagesse de son gouvernement, par l'amour de ses sujets et par l'expulsion des jésuites.
Ils commencèrent par baptiser les trois princes et plusieurs personnes de leur maison: ces néophytes eurent le malheur de désobéir à l'empereur en quelques points qui ne regardaient que le service militaire. Pendant ce temps-là même l'indignation de tout l'empire éclata contre les missionnaires; tous les gouverneurs des provinces, tous les colaos présentèrent contre eux des mémoires. Les accusations furent portées si loin qu'on mit aux fers les trois princes disciples des jésuites.
Il est évident que ce n'était pas pour avoir été baptisés qu'on les traita si durement, puisque les jésuites eux-mêmes avouent dans leurs lettres, que pour eux ils n'essuyèrent aucune violence, et que même ils furent admis à une audience de l'empereur qui les honora de quelques présents. Il est donc prouvé que l'empereur Yontchin n'était nullement persécuteur. Et si les princes furent renfermés dans une prison vers la Tartarie, tandis qu'on traitait si bien leurs convertisseurs, c'est une preuve indubitable qu'ils étaient prisonniers d'État et non pas martyrs.
L'empereur céda bientôt aux cris de la Chine entière; on demandait le renvoi des jésuites, comme depuis en France et dans d'autres pays on a demandé leur abolition. Tous les tribunaux de la Chine voulaient qu'on les fît partir sur-le-champ pour Macao qui est regardé comme une place séparée de l'empire, et dont on a laissé toujours la possession aux Portugais avec garnison chinoise.
Yontchin eut la bonté de consulter les tribunaux et les gouverneurs, pour savoir s'il y aurait quelque danger à faire conduire tous les jésuites dans la province de Kanton. En attendant la réponse il fit venir trois jésuites en sa présence, et leur dit ces propres paroles que le père Parennin rapporte avec beaucoup de bonne foi: ‘Vos Européens dans la province de Fo-Kien voulaient anéantir nos lois [19] et troublaient nos peuples; les tribunaux me les ont déférés; j'ai dû pourvoir à ces désordres, il y va de l'intérêt de l'empire. . . Que diriez-vous si j'envoyais dans votre pays une troupe de bonzes et de lamas prêcher leur loi? comment les recevriez-vous?. . . Si vous avez su tromper mon père, n'espérez pas me tromper de même. . . Vous voulez que les Chinois se fassent chrétiens, votre loi le demande, je le sais bien; mais alors que deviendrons-nous? les sujets de vos rois! Les chrétiens ne croient que vous; dans un temps de trouble ils n'écouteraient d'autre voix que la vôtre. Je sais bien qu'actuellement il n'y a rien à craindre; mais quand les vaisseaux viendront par mille et dix mille, alors il pourrait y avoir du désordre.
‘La Chine au nord touche le royaume des Russes qui n'est pas méprisable; elle a au sud les Européens et leurs royaumes qui sont encore plus considérables; et à l'ouest les princes de Tartarie qui nous font la guerre depuis huit ans. . . Laurent Lange compagnon du prince Ismaelof ambassadeur du tsar, demandait qu'on accordât aux Russes la permission d'avoir dans toutes les provinces une factorerie; on ne le leur permit qu'à Pékin et sur les limites de Kalkas. Je vous permets de demeurer de même ici et à Kanton, tant que vous ne donnerez aucun sujet de plainte; et si vous en donnez, je ne vous laisserai ni ici ni à Kanton.'
On abattit leurs maisons et leurs églises dans toutes les autres provinces. Enfin les plaintes contre eux redoublèrent. Ce qu'on leur reprochait le plus, c'était d'affaiblir dans les enfants le respect pour leurs pères en ne rendant point les honneurs dus aux ancêtres, d'assembler indécemment les jeunes gens et les filles dans les lieux écartés qu'ils appelaient églises , de faire agenouiller les filles entre leurs jambes et de leur parler bas en cette posture. Rien ne paraissait plus monstrueux à la délicatesse chinoise. L'empereur Yontchin daigna même en avertir les jésuites, après quoi il renvoya la plupart des missionnaires à Macao, mais avec des politesses et des attentions dont les seuls Chinois peut-être sont capables.
Il retint à Pékin quelques jésuites mathématiciens, et entre autres ce même Parennin dont nous avons déjà parlé, et qui possédant parfaitement le chinois et le tartare, avait souvent servi d'interprète. Plusieurs jésuites se cachèrent dans des provinces éloignées, d'autres dans Kanton même; et on ferma les yeux.
Enfin, l'empereur Yontchin étant mort, son fils et son successeur Kun-long acheva de contenter la nation en faisant partir pour Macao tous les missionnaires déguisés qu'on put trouver dans l'empire. Un édit solennel leur en interdit à jamais l'entrée. S'il en vient quelques-uns, on les prie civilement d'aller exercer leurs talents ailleurs. Point de traitement dur, point de persécution. On m'a assuré qu'en 1760 un jésuite de Rome étant allé à Kanton, et ayant été déféré par un facteur des Hollandais, le colao gouverneur de Kanton le renvoya avec un présent d'une pièce de soie, des provisions et de l'argent.
DU PRÉTENDU ATHEISME DE LA CHINE.
On a examiné plusieurs fois cette accusation d'athéisme, intentée par nos théologaux d'Occident contre le gouvernement chinois [20] à l'autre bout du monde, c'est assurément le dernier excès de nos folies et de nos contradictions pédantesques. Tantôt on prétendait dans une de nos facultés que les tribunaux ou parlements de la Chine étaient idolâtres, tantôt qu'ils ne reconnaissaient point de divinité; et ces raisonneurs poussaient quelquefois leur fureur de raisonner jusqu'à soutenir que les Chinois étaient à la fois athées et idolâtres.
Au mois d'octobre 1700, la Sorbonne déclara hérétiques toutes les propositions qui soutenaient que l'empereur et les colaos croyaient en Dieu. On faisait de gros livres dans lesquels on démontrait, selon la façon théologique de démontrer, que les Chinois n'adoraient que le ciel matériel.
Nil praeter nubes et coeli numen adorant .
Mais s'ils adoraient ce ciel matériel, c'était donc là leur dieu. Ils ressemblaient aux Perses qu'on dit avoir adoré le soleil; ils ressemblaient aux anciens Arabes qui adoraient les étoiles: ils n'étaient donc ni fabricateurs d'idoles, ni athées. Mais un docteur n'y regarde pas de si près, quand il s'agit dans son tripot de déclarer une proposition hérétique et malsonnante.
Ces pauvres gens qui faisaient tant de fracas en 1700 sur le ciel matériel des Chinois, ne savaient pas qu'en 1689 les Chinois ayant fait la paix avec les Russes à Niptchou qui est la limite des deux empires, ils érigèrent la même année, le 8 septembre, un monument de marbre, sur lequel on grava en langue chinoise et en latin ces paroles mémorables.
Si quelqu'un a jamais la pensée de rallumer le feu de la guerre, nous prions le Seigneur souverain de toutes choses, qui connaît les coeurs, de punir ces perfides, etc . [21]
Il suffisait de savoir un peu de l'histoire moderne pour mettre fin à ces disputes ridicules; mais les gens qui croient que le devoir de l'homme consiste à commenter St Thomas et Scot, ne s'abaissent pas à s'informer de ce qui se passe entre les plus grands empires de la terre.
CHRISTIANISME. [p. 160] ↩
ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME, DANS SON ÉTAT CIVIL ET POLITIQUE.
Dieu nous garde d'oser mêler ici le divin au profane, nous ne sondons point les voies de la Providence. Hommes, nous ne parlons qu'à des hommes.
Lorsque Antoine et ensuite Auguste eurent donné la Judée à l'arabe Hérode leur créature et leur tributaire, ce prince, étranger chez les Juifs, devint le plus puissant de tous leurs rois. Il eut des ports sur la Méditerranée, Ptolomaïde, Ascalon. Il bâtit des villes, il éleva un temple au dieu Apollon dans Rhodes; un temple à Auguste dans Césarée. Il bâtit de fond en comble celui de Jérusalem, et il en fit une très forte citadelle. La Palestine, sous son règne, jouit d'une profonde paix. Enfin, il fut regardé comme un messie, tout barbare qu'il était dans sa famille, et tout tyran de son peuple dont il dévorait la substance pour subvenir à ses grandes entreprises. Il n'adorait que César, et il fut presque adoré des hérodiens.
La secte des Juifs était répandue depuis longtemps dans l'Europe et dans l'Asie; mais ses dogmes étaient entièrement ignorés. Personne ne connaissait les livres juifs, quoique plusieurs fussent, dit-on, déjà traduits en grec dans Alexandrie. On ne savait des Juifs que ce que les Turcs et les Persans savent aujourd'hui des Arméniens, qu'ils sont des courtiers de commerce, des agents de change. Du reste un Turc ne s'informe jamais si un Arménien est eutichéen, ou jacobite, ou chrétien de St Jean, ou arien.
Le théisme de la Chine et les respectables livres de Confutzé, qui vécut environ six cents ans avant Hérode, étaient encore plus ignorés des nations occidentales que les rites juifs.
Les Arabes qui fournissaient les denrées précieuses de l'Inde aux Romains, n'avaient pas plus d'idée de la théologie des brachmanes que nos matelots qui vont à Pondichéri ou à Madrass. Les femmes indiennes étaient en possession de se brûler sur le corps de leurs maris de temps immémorial; et ces sacrifices étonnants qui sont encore en usage, étaient aussi ignorés des Juifs que les coutumes de l'Amérique. Leurs livres qui parlent de Gog et de Magog, ne parlent jamais de l'Inde.
L'ancienne religion de Zoroastre était célèbre et n'en était pas plus connue dans l'empire romain. On savait seulement en général que les mages admettaient une résurrection, un paradis, un enfer; et il fallait bien que cette doctrine eût percé chez les Juifs voisins de la Caldée, puisque la Palestine était partagée du temps d'Hérode entre les pharisiens qui commençaient à croire le dogme de la résurrection, et les saducéens qui ne regardaient cette doctrine qu'avec mépris.
Alexandrie, la ville la plus commerçante du monde entier, était peuplée d'Egyptiens qui adoraient Sérapis, et qui consacraient des chats; de Grecs qui philosophaient, de Romains qui dominaient, de Juifs qui s'enrichissaient. Tous ces peuples s'acharnaient à gagner de l'argent, à se plonger dans les plaisirs ou dans le fanatisme; à faire ou à défaire des sectes de religion, surtout dans l'oisiveté qu'ils goûtèrent dès qu'Auguste eut fermé le temple de Janus.
Les Juifs étaient divisés en trois factions principales; celle des Samaritains se disait la plus ancienne, parce que Samarie (alors Sebaste) avait subsisté pendant que Jérusalem fut détruite avec son temple sous les rois de Babilone; mais ces Samaritains étaient un mélange de Persans et de Palestins.
La seconde faction et la plus puissante, était celle des Jérosolimites. Ces Juifs proprement dits, détestaient ces Samaritains, et en étaient détestés. Leurs intérêts étaient tout opposés. Ils voulaient qu'on ne sacrifiât que dans le temple de Jérusalem. Une telle contrainte eût attiré beaucoup d'argent dans cette ville. C'était par cette raison-là même que les Samaritains ne voulaient sacrifier que chez eux. Un petit peuple, dans une petite ville, peut n'avoir qu'un temple; mais dès que ce peuple s'est étendu dans soixante et dix lieues de pays en long, et dans vingt-trois en large, comme fit le peuple juif; dès que son territoire est presque aussi grand et aussi peuplé que le Languedoc ou la Normandie, il est absurde de n'avoir qu'une église. Où en seraient les habitants de Montpellier s'ils ne pouvaient entendre la messe qu'à Toulouse?
La troisième faction était des Juifs hellénistes, composée principalement de ceux qui commerçaient, et qui exerçaient des métiers en Egypte et en Grèce. Ceux-là avaient le même intérêt que les Samaritains. Onias fils d'un grand-prêtre juif, et qui voulait être grand-prêtre aussi, obtint du roi d'Egypte Ptolomée Philometor, et surtout de Cléopâtre sa femme, la permission de bâtir un temple juif auprès de Bubaste. Il assura la reine Cléopâtre qu'Isaïe avait prédit qu'un jour le Seigneur aurait un temple dans cet endroit-là. Cléopâtre, à qui il fit un beau présent, lui manda que puisque Isaïe l'avait dit, il fallait l'en croire. Ce temple fut nommé l'Onion. Et si Onias ne fut pas grand sacrificateur, il fut capitaine d'une troupe de milices. Ce temple fut construit cent soixante ans avant notre ère vulgaire. Les Juifs de Jérusalem eurent toujours cet Onion en horreur, aussi bien que la traduction dites des Septante. Ils instituèrent même une fête d'expiation pour ces deux prétendus sacrilèges.
Les rabbins de l'Onion mêlés avec les Grecs, devinrent plus savants (à leur mode) que les rabbins de Jérusalem et de Samarie; et ces trois factions commencèrent à disputer entre elles sur des questions de controverse qui rendent nécessairement l'esprit subtil, faux et insociable.
Les Juifs égyptiens, pour égaler l'austérité des esséniens et des judaïtes de la Palestine, établirent quelque temps avant le christianisme la secte des thérapeutes, qui se vouèrent comme eux à une espèce de vie monastique et à des mortifications.
Ces différentes sociétés étaient des imitations des anciens mystères égyptiens, persans, thraciens, grecs, qui avaient inondé la terre depuis l'Euphrate et le Nil jusqu'au Tibre.
Dans les commencements les initiés admis à ces confréries étaient en petit nombre, et regardés comme des hommes privilégiés séparés de la multitude; mais du temps d'Auguste leur nombre fut très considérable; de sorte qu'on ne parlait que de religion du fond de la Syrie au mont Atlas, et à l'Océan germanique.
Parmi tant de sectes et de cultes s'était établie l'école de Platon, non seulement dans la Grèce, mais à Rome, et surtout dans l'Egypte. Platon avait passé pour avoir puisé sa doctrine chez les Egyptiens, et ceux-ci croyaient revendiquer leur propre bien en faisant valoir les idées archétypes platoniques, son verbe, et l'espèce de trinité qu'on débrouille dans quelques ouvrages de Platon.
Il paraît que cet esprit philosophique répandu alors sur tout l'Occident connu, laissa du moins échapper quelques étincelles d'esprit raisonneur vers la Palestine.
Il est certain que du temps d'Hérode on disputait sur les attributs de la Divinité, sur l'immortalité de l'esprit humain, sur la résurrection des corps. Les Juifs racontent que la reine Cléopâtre leur demanda si on ressusciterait nu ou habillé.
Les Juifs raisonnaient donc à leur manière. L'exagérateur Joseph était très savant pour un militaire. Il y avait d'autres savants dans l'état civil, puisqu'un homme de guerre l'était. Philon son contemporain aurait eu de la réputation parmi les Grecs. Gamaliel le maître de St Paul, était un grand controversiste. Les auteurs de la Mishna furent des polymathes.
La populace s'entretenait de religion chez les Juifs, comme nous voyons aujourd'hui en Suisse, à Genève, en Allemagne, en Angleterre, et surtout dans les Cévennes, les moindres habitants agiter la controverse. Il y a plus; des gens de la lie du peuple ont fondé des sectes; Fox en Angleterre, Muncer en Allemagne, les premiers réformés en France. Enfin, en faisant abstraction du grand courage de Mahomet, il n'était qu'un marchand de chameaux.
Ajoutons à tous ces préliminaires, que du temps d'Hérode on s'imagina que le monde était près de sa fin, comme nous l'avons déjà remarqué. (Voyez Fin du monde .)
Ce fut dans ces temps préparés par la divine Providence, qu'il plut au Père éternel d'envoyer son Fils sur la terre; mystère adorable et incompréhensible auquel nous ne touchons pas.
Nous disons seulement que dans ces circonstances, si Jésus prêcha une morale pure, s'il annonça un prochain royaume des cieux pour la récompense des justes, s'il eut des disciples attachés à sa personne et à ses vertus, si ces vertus mêmes lui attirèrent les persécutions des prêtres; si la calomnie le fit mourir d'une mort infâme; sa doctrine constamment annoncée par ses disciples dut faire un très grand effet dans le monde. Je ne parle encore une fois qu'humainement: je laisse à part la foule des miracles et des prophéties. Je soutiens que le christianisme dut plus réussir par sa mort que s'il n'avait pas été persécuté. On s'étonne que ses disciples aient fait de nouveaux disciples; je m'étonnerais bien davantage s'ils n'avaient pas attiré beaucoup de monde dans leur parti. Soixante et dix personnes convaincues de l'innocence de leur chef, de la pureté de ses moeurs et de la barbarie de ses juges, doivent soulever bien des coeurs sensibles.
Le seul Saul Paul, devenu l'ennemi de Gamaliel son maître, (quelle qu'en ait été la raison) devait humainement parlant, attirer mille hommages à Jésus, quand même Jésus n'aurait été qu'un homme de bien opprimé. St Paul était savant, éloquent, véhément, infatigable, instruit dans la langue grecque, secondé de zélateurs bien plus intéressés que lui à défendre la réputation de leur maître. St Luc était un Grec d'Alexandrie, [22] homme de lettres puisqu'il était médecin.
Le premier chapitre de St Jean est d'une sublimité platonicienne qui dut plaire aux platoniciens d'Alexandrie. Et en effet, il se forma bientôt dans cette ville une école fondée par Luc, ou par Marc (soit l'évangéliste, soit un autre) perpétuée par Athénagore, Panthène, Origène, Clément, tous savants, tous éloquents. Cette école une fois établie, il était impossible que le christianisme ne fît pas des progrès rapides.
La Grèce, la Syrie, l'Egypte, étaient les théâtres de ces célèbres anciens mystères qui enchantaient les peuples. Les chrétiens eurent leurs mystères comme eux. On dut s'empresser à s'y faire initier, ne fût-ce d'abord que par curiosité; et bientôt cette curiosité devint persuasion. L'idée de la fin du monde prochaine devait surtout engager les nouveaux disciples à mépriser les biens passagers de la terre qui allaient périr avec eux. L'exemple des thérapeutes invitait à une vie solitaire et mortifiée: tout concourait donc puissamment à l'établissement de la religion chrétienne.
Les divers troupeaux de cette grande société naissante ne pouvaient, à la vérité, s'accorder entre eux. Cinquante-quatre sociétés eurent cinquante-quatre évangiles différents, tous secrets comme leurs mystères, tous inconnus aux gentils, qui ne virent nos quatre Evangiles canoniques qu'au bout de deux cent cinquante années. Ces différents troupeaux, quoique divisés, reconnaissaient le même pasteur. Ebionites opposés à St Paul, nazaréens, disciples d'Himeneos, d'Alexandros, d'Hermogènes, carpocratiens, basilidiens, valentiniens, marcionites, sabelliens, gnostiques, montanistes, cent sectes élevées les unes contre les autres; toutes en se faisant des reproches mutuels, étaient cependant toutes unies en Jésus, invoquaient Jésus, voyaient en Jésus l'objet de leurs pensées et le prix de leurs travaux.
L'empire romain, dans lequel se formèrent toutes ces sociétés, n'y fit pas d'abord attention. On ne les connut à Rome que sous le nom général de Juifs, auxquels le gouvernement ne prenait pas garde. Les Juifs avaient acquis par leur argent le droit de commercer. On en chassa de Rome quatre mille sous Tibère. Le peuple les accusa de l'incendie de Rome sous Néron, eux et les nouveaux juifs demi-chrétiens.
On les chassa encore sous Claude; mais leur argent les fit toujours revenir. Ils furent méprisés et tranquilles. Les chrétiens de Rome furent moins nombreux que ceux de Grèce, d'Alexandrie et de Syrie. Les Romains n'eurent ni Pères de l'Eglise, ni hérésiarques dans les premiers siècles. Plus ils étaient éloignés du berceau du christianisme, moins on vit chez eux de docteurs et d'écrivains. L'Eglise était grecque, et tellement grecque qu'il n'y eut pas un seul mystère, un seul rite, un seul dogme qui ne fût exprimé en cette langue.
Tous les chrétiens, soit grecs, soit syriens, soit romains, soit egyptiens, étaient partout regardés comme des demi-juifs. C'était encore une raison de plus pour ne pas communiquer leurs livres aux gentils, pour rester unis entre eux et impénétrables. Leur secret était plus inviolablement gardé que celui des mystères d'Isis et de Cérès. Ils faisaient une république à part, un état dans l'Etat. Point de temples, point d'autels, nul sacrifice, aucune cérémonie publique. Ils élisaient leurs supérieurs secrets à la pluralité des voix. Ces supérieurs, sous le nom d'anciens, de prêtres, d'évêques, de diacres ménageaient la bourse commune, avaient soin des malades, pacifiaient leurs querelles. C'était une honte, un crime parmi eux de plaider devant les tribunaux, de s'enrôler dans la milice; et pendant cent ans il n'y eut pas un chrétien dans les armées de l'empire.
Ainsi retirés au milieu du monde, et inconnus même en se montrant, ils échappaient à la tyrannie des proconsuls et des préteurs, et vivaient libres dans le public esclavage.
On ignore l'auteur du fameux livre intitulé, Ton apostolon Didakai , les Constitutions apostoliques; de même qu'on ignore les auteurs des cinquante évangiles non reçus, et des Actes de St Pierre, et du Testament des douze patriarches, et de tant d'autres écrits des premiers chrétiens. Mais il est vraisemblable que ces constitutions sont du second siècle. Quoiqu'elles soient faussement attribuées aux apôtres, elles sont très précieuses. On y voit quels étaient les devoirs d'un évêque élu par les chrétiens; quel respect ils devaient avoir pour lui, quels tributs ils devaient lui payer.
L'évêque ne pouvait avoir qu'une épouse qui eût bien soin de Liv. IV, ch. I. sa maison. Mias andra gegenimenon gunaikos monogamou kalos tou idiou oikou proestota .
On exhortait les chrétiens riches à adopter les enfants des pauvres. On faisait des collectes pour les veuves et les orphelins; mais on ne recevait point l'argent des pécheurs; et nommément il Ch. VI. n'était pas permis à un cabaretier de donner son offrande. Il est dit qu'on les regardait comme des fripons. C'est pourquoi très peu de cabaretiers étaient chrétiens. Cela même empêchait les chrétiens de fréquenter les tavernes, et les éloignait de toute société avec les gentils.
Les femmes pouvant parvenir à la dignité de diaconesses, en étaient plus attachées à la confraternité chrétienne. On les consacrait; l'évêque les oignait d'huile au front comme on avait huilé autrefois les rois juifs. Que de raisons pour lier ensemble les chrétiens par des noeuds indissolubles!
Les persécutions, qui ne furent jamais que passagères, ne pouvaient servir qu'à redoubler le zèle et à enflammer la ferveur; de sorte que sous Dioclétien un tiers de l'empire se trouva chrétien.
Voilà une petite partie des causes humaines qui contribuèrent au progrès du christianisme. Joignez-y les causes divines qui sont à elles comme l'infini est à l'unité, et vous ne pourrez être surpris que d'une seule chose, c'est que cette religion si vraie ne se soit pas étendue tout d'un coup dans les deux hémisphères, sans en excepter l'île la plus sauvage.
Dieu lui-même étant descendu du ciel, étant mort pour racheter tous les hommes, pour extirper à jamais le péché sur la surface de la terre, a cependant laissé la plus grande partie du genre humain en proie à l'erreur, au crime et au diable. Cela paraît une fatale contradiction à nos faibles esprits; mais ce n'est pas à nous d'interroger la Providence; nous ne devons que nous anéantir devant elle.
CHRONOLOGIE. [p. 167] ↩
On dispute depuis longtemps sur l'ancienne chronologie, mais y en a-t-il une?
Il faudrait que chaque peuplade considérable eût possédé et conservé des registres authentiques bien attestés. Mais combien peu de peuplades savaient écrire? et dans le petit nombre d'hommes qui cultivèrent cet art si rare, s'en est-il trouvé qui prissent la peine de marquer deux dates avec exactitude?
Nous avons à la vérité dans des temps très récents les observations célestes des Chinois et des Chaldéens. Elles ne remontent qu'environ deux mille ans plus ou moins avant notre ère vulgaire. Mais quand les premières annales se bornent à nous instruire qu'il y eut une éclipse sous un tel prince, c'est nous apprendre que ce prince existait, et non pas ce qu'il a fait.
De plus, les Chinois comptent l'année de la mort d'un empereur tout entière, fût-il mort le premier jour de l'an; et son successeur date l'année suivante du nom de son prédécesseur. On ne peut montrer plus de respect pour ses ancêtres; mais on ne peut supputer les temps d'une manière plus fautive en comparaison de nos nations modernes.
Ajoutez que les Chinois ne commencent leur cycle sexagénaire, dans lequel ils ont mis de l'ordre, qu'à l'empereur Iao, deux mille trois cent cinquante-sept ans avant notre ère vulgaire. Tout le temps qui précède cette époque est d'une obscurité profonde.
Les hommes se sont toujours contentés de l'à peu près en tout genre. Par exemple, avant les horloges on ne savait qu'à peu près les heures du jour et de la nuit. Si on bâtissait, les pierres n'étaient qu'à peu près taillées, les bois à peu près équarris, les membres des statues à peu près dégrossis, on ne connaissait qu'à peu près ses plus proches voisins; et malgré la perfection où nous avons tout porté, c'est ainsi qu'on en use encore dans la plus grande partie de la terre.
Ne nous étonnons donc pas s'il n'y a nulle part de vraie chronologie ancienne. Ce que nous avons des Chinois est beaucoup, si vous le comparez aux autres nations.
Nous n'avons rien des Indiens ni des Perses, presque rien des anciens Egyptiens. Tous nos systèmes inventés sur l'histoire de ces peuples, se contredisent autant que nos systèmes métaphysiques.
Les olympiades des Grecs ne commencent que sept cent vingt-huit ans avant notre manière de compter. On voit seulement vers ce temps-là quelques flambeaux dans la nuit, comme l'ère de Nabonassar, la guerre de Lacédémone et de Messène; encore dispute-t-on sur ces époques.
Tite-Live n'a garde de dire en quelle année Romulus commença son prétendu règne. Les Romains, qui savaient combien cette époque est incertaine, se seraient moqués de lui s'il eût voulu la fixer.
Il est prouvé que les deux cent quarante ans qu'on attribue aux sept premiers rois de Rome, sont le calcul le plus faux.
Les quatre premiers siècles de Rome sont absolument dénués de chronologie.
Si quatre siècles de l'empire le plus mémorable de la terre, ne forment qu'un amas indigeste d'événements mêlés de fables, sans presque aucune date, que sera-ce des petites nations resserrées dans un coin de terre, qui n'ont jamais fait aucune figure dans le monde, malgré tous leurs efforts pour remplacer en charlataneries et en prodiges, ce qui leur manquait en puissance et en culture des arts?
DE LA VANITÉ DES SYSTEMES, SURTOUT EN CHRONOLOGIE.
M. l'abbé de Condillac rendit un très grand service à l'esprit humain, quand il fit voir le faux de tous les systèmes. Si on peut espérer de rencontrer un jour un chemin vers la vérité, ce n'est qu'après avoir bien reconnu tous ceux qui mènent à l'erreur. C'est du moins une consolation d'être tranquille, et de ne plus chercher, quand on voit que tant de savants ont cherché en vain.
La chronologie est un amas de vessies remplies de vent. Tous ceux qui ont cru y marcher sur un terrain solide, sont tombés. Nous avons aujourd'hui quatre-vingts systèmes, dont il n'y en a pas un de vrai.
Les Babyloniens disaient, Nous comptons quatre cent soixante et treize mille années d'observations célestes. Vient un Parisien qui leur dit, Votre compte est juste; vos années étaient d'un jour solaire; elles reviennent à douze cent quatre-vingt-dix-sept des nôtres, depuis Atlas roi d'Afrique grand astronome, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre à Babilone.
Mais jamais, quoi qu'en dise notre Parisien, aucun peuple n'a pris un jour pour un an; et le peuple de Babilone encore moins que personne. Il fallait seulement que ce nouveau venu de Paris dît aux Chaldéens, Vous êtes des exagérateurs, et vos ancêtres des ignorants; les nations sont sujettes à trop de révolutions pour conserver des quatre mille sept cent trente-six siècles de calculs astronomiques. Et quant au roi des Maures Atlas, personne ne sait en quel temps il a vécu. Pythagore avait autant de raison de prétendre avoir été coq, que vous de vous vanter de tant d'observations.
Le grand ridicule de toutes ces chronologies fantastiques, est d'arranger toutes les époques de la vie d'un homme, sans savoir si cet homme a existé.
Langlet répète après quelques autres, dans sa Compilation chronologique sur l'histoire universelle , que précisément dans le temps d'Abraham, six ans après la mort de Sara, très peu connue des Grecs, Jupiter âgé de soixante et deux ans commença à régner en Thessalie, que son règne fut de soixante ans, qu'il épousa sa soeur Junon, qu'il fut obligé de céder les côtes maritimes à son frère Neptune, que les titans lui firent la guerre. Mais y a-t-il eu un Jupiter? C'était par là qu'il fallait commencer.
CICÉRON. [p. 170] ↩
C'est dans le temps de la décadence des beaux-arts en France, c'est dans le siècle des paradoxes, et dans l'avilissement de la littérature et de la philosophie persécutées, qu'on veut flétrir Cicéron; et quel est l'homme qui essaie de déshonorer sa mémoire? c'est un de ses disciples, c'est un homme qui prête, comme lui, son ministère à la défense des accusés; c'est un avocat qui a étudié l'éloquence chez ce grand maître; c'est un citoyen qui paraît animé comme Cicéron même de l'amour du bien public.
Dans un livre intitulé Canaux navigables , livre rempli de vues patriotiques et grandes plus que praticables, on est bien étonné de lire cette philippique contre Cicéron qui n'a jamais fait creuser de canaux.
‘Le trait le plus glorieux de l'histoire de Cicéron, c'est la ruine de la conjuration de Catilina; mais à le bien prendre, elle ne fit du bruit à Rome qu'autant qu'il affecta d'y mettre de l'importance. Le danger existait dans ses discours bien plus que dans la chose. C'était une entreprise d'hommes ivres qu'il était facile de déconcerter. Ni le chef, ni les complices n'avaient pris la moindre mesure pour assurer le succès de leur crime. Il n'y eut d'étonnant dans cette étrange affaire que l'appareil dont le consul chargea toutes ses démarches, et la facilité avec laquelle on lui laissa sacrifier à son amour-propre tant de rejetons des plus illustres familles.
‘D'ailleurs, la vie de Cicéron est pleine de traits honteux; son éloquence était vénale autant que son âme était pusillanime. Si ce n'était pas l'intérêt qui dirigeait sa langue, c'était la frayeur ou l'espérance; le désir de se faire des appuis le portait à la tribune pour y défendre sans pudeur des hommes plus déshonorés, plus dangereux cent fois que Catilina. Parmi ses clients, on ne voit presque que des scélérats: et par un trait singulier de la justice divine, il reçut enfin la mort des mains d'un de ces misérables que son art avait dérobés aux rigueurs de la justice humaine.'
A le bien prendre , la conjuration de Catilina fit à Rome plus que du bruit ; elle la plongea dans le plus grand trouble, et dans le plus grand danger. Elle ne fut terminée que par une bataille si sanglante qu'il n'est aucun exemple d'un pareil carnage, et peu d'un courage aussi intrépide. Tous les soldats de Catilina après avoir tué la moitié de l'armée de Petreius furent tués jusqu'au dernier; Catilina périt percé de coups sur un monceau de morts, et tous furent trouvés le visage tourné contre l'ennemi. Ce n'était pas là une entreprise si facile à déconcerter; César la favorisait, et elle apprit à César à conspirer un jour plus heureusement contre sa patrie.
Cicéron défendait sans pudeur des hommes plus déshonorés, plus dangereux cent fois que Catilina .
Est-ce quand il défendait dans la tribune la Sicile contre Verrès, et la république romaine contre Antoine? est-ce quand il réveilla la clémence de César en faveur de Ligarius et du roi Déjotare? ou lorsqu'il obtenait le droit de cité pour le poète Archias; ou lorsque dans sa belle oraison pour la loi Manilia il emportait tous les suffrages des Romains en faveur du grand Pompée?
Il plaida pour Milon meurtrier de Clodius; mais Clodius avait mérité sa fin tragique par ses fureurs. Clodius avait trempé dans la conjuration de Catilina, Clodius était son plus mortel ennemi, il avait soulevé Rome contre lui, et l'avait puni d'avoir sauvé Rome; Milon était son ami.
Quoi! c'est de nos jours qu'on ose dire que Dieu punit Cicéron d'avoir plaidé pour un tribun militaire nommé Popilius Léna, et que la vengeance céleste le fit assassiner par ce Popilius Léna même! Personne ne sait si Popilius Léna était coupable ou non du crime dont Cicéron le justifia quand il le défendit; mais tous les hommes savent que ce monstre fut coupable de la plus horrible ingratitude, de la plus infâme avarice, et de la plus détestable barbarie, en assassinant son bienfaiteur pour gagner l'argent de trois monstres comme lui. Il était réservé à notre siècle de vouloir faire regarder l'assassinat de Cicéron comme un acte de la justice divine. Les triumvirs ne l'auraient pas osé. Tous les siècles jusqu'ici ont détesté et pleuré sa mort.
On reproche à Cicéron de s'être vanté trop souvent d'avoir sauvé Rome, et d'avoir trop aimé la gloire. Mais ses ennemis voulaient flétrir cette gloire. Une faction tyrannique le condamnait à l'exil, et abattait sa maison, parce qu'il avait préservé toutes les maisons de Rome de l'incendie que Catilina leur préparait. Il vous est permis (c'est même un devoir) de vanter vos services quand on les méconnaît, et surtout quand on vous en fait un crime.
On admire encore Scipion de n'avoir répondu à ses accusateurs que par ces mots: C'est à pareil jour que j'ai vaincu Annibal, allons rendre grâces aux dieux . Il fut suivi par tout le peuple au Capitole, et nos coeurs l'y suivent encore en lisant ce trait d'histoire; quoique après tout il eût mieux valu rendre ses comptes que se tirer d'affaire par un bon mot.
Cicéron fut admiré de même par le peuple romain le jour qu'à l'expiration de son consulat, étant obligé de faire les serments ordinaires, et se préparant à haranguer le peuple selon la coutume, il en fut empêché par le tribun Metellus qui voulait l'outrager. Cicéron avait commencé par ces mots, Je jure ; le tribun l'interrompit, et déclara qu'il ne lui permettrait pas de haranguer. Il s'éleva un grand murmure. Cicéron s'arrêta un moment, et renforçant sa voix noble et sonore, il dit pour toute harangue, Je jure que j'ai sauvé la patrie . L'assemblée enchantée s'écria, Nous jurons qu'il a dit la vérité . Ce moment fut le plus beau de sa vie. Voilà comme il faut aimer la gloire.
Je ne sais où j'ai lu autrefois ces vers ignorés.
Romains, j'aime la gloire et ne veux point m'en taire;
Des travaux des humains c'est le digne salaire:
Ce n'est qu'en vous servant qu'il la faut acheter.
Qui n'ose la vouloir n'ose la mériter.
Peut-on mépriser Cicéron si on considère sa conduite dans son gouvernement de la Cilicie, qui était alors une des plus importantes provinces de l'empire romain, en ce qu'elle confinait à la Syrie, et à l'empire des Parthes. Laodicée, l'une des plus belles villes d'Orient, en était la capitale: cette province était aussi florissante qu'elle est dégradée aujourd'hui sous le gouvernement des Turcs, qui n'ont jamais eu de Cicéron.
Il commence par protéger le roi de Cappadoce Ariobarzane, et il refuse les présents que ce roi veut lui faire. Les Parthes viennent attaquer en pleine paix Antioche; Cicéron y vole, il atteint les Parthes après des marches forcées par le mont Taurus, il les fait fuir, il les poursuit dans leur retraite, Orzace leur général est tué avec une partie de son armée.
De là il court à Pendenissum capitale d'un pays allié des Parthes, il la prend; cette province est soumise. Il tourne aussitôt contre les peuples appelés Tiburaniens, il les défait; ses troupes lui défèrent le titre d' empereur qu'il garda toute sa vie. Il aurait obtenu à Rome les honneurs du triomphe sans Caton qui s'y opposa, et qui obligea le sénat à ne décerner que des réjouissances publiques et des remerciements aux dieux, lorsque c'était à Cicéron qu'on devait en faire.
Si on se représente l'équité, le désintéressement de Cicéron dans son gouvernement, son activité, son affabilité, deux vertus si rarement compatibles, les bienfaits dont il combla les peuples dont il était le souverain absolu, il faudra être bien difficile pour ne pas accorder son estime à un tel homme.
Si vous faites réflexion que c'est là ce même Romain qui le premier introduisit la philosophie dans Rome, que ses Tusculanes et son livre de la Nature des dieux sont les deux plus beaux ouvrages qu'ait jamais écrit la sagesse qui n'est qu'humaine, et que son traité des Offices est le plus utile que nous ayons en morale, il sera encore plus malaisé de mépriser Cicéron. Plaignons ceux qui ne le lisent pas, plaignons encore plus ceux qui ne lui rendent pas justice.
Opposons au détracteur français les vers de l'Espagnol Martial dans son épigramme contre Antoine:
Quid prosunt sacrae pretiosa silentia linguae ?
Incipient omnes pro Cicerone loqui .
Ta prodigue fureur acheta son silence,
Mais l'univers entier parle à jamais pour lui.
Voyez surtout ce que dit Juvenal, Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit .
CIEL MATÉRIEL. [p. 174] ↩
Les lois de l'optique fondées sur la nature des choses, ont ordonné que de notre petit globe nous verrons toujours le ciel matériel, comme si nous en étions le centre, quoique nous soyons bien loin d'être centre.
Que nous le verrons toujours comme une voûte surbaissée, quoiqu'il n'y ait d'autre voûte que celle de notre atmosphère, laquelle n'est point surbaissée.
Que nous verrons toujours les astres roulant sur cette voûte, et comme dans un même cercle, quoiqu'il n'y ait que cinq planètes principales et dix lunes, et un anneau, qui marchent ainsi que nous dans l'espace.
Que notre soleil et notre lune nous paraîtront toujours d'un tiers plus grands à l'horizon qu'au zénith, quoiqu'ils soient plus près de l'observateur au zénith qu'à l'horizon; et que les étoiles nous paraîtront toujours plus rapprochées à l'horizon qu'au zénith. Voici l'effet que font nécessairement les astres sur nos yeux.
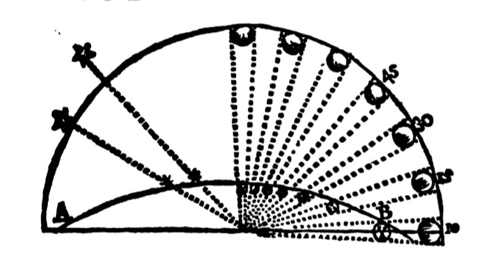
Cette figure représente à peu près en quelle proportion le soleil et la lune doivent être aperçus dans la courbe A B, et comment les astres doivent paraître plus rapprochés les uns des autres dans la même courbe .
1 o . Telles sont les lois de l'optique, telle est la nature de vos yeux, que premièrement le ciel matériel, les nuages, la lune, le soleil qui est si loin de vous, les planètes qui dans leur apogée un sont encore plus loin, tous les astres placés à des distances encore plus immenses, comètes, météores, tout doit vous paraître dans cette voûte surbaissée composée de votre atmosphère.
2 o . Pour moins compliquer cette vérité, observons seulement ici le soleil qui semble parcourir le cercle A B.
Il doit vous paraître au zénith plus petit qu'à quinze degrés au-dessous, à trente degrés encore plus gros, et enfin à l'horizon encore davantage; tellement que ses dimensions dans le ciel inférieur décroissent en raison de ses hauteurs dans la progression suivante;
| A l'horizon | 100. |
| A quinze degrés | 68. |
| A trente degrés | 50. |
| A quarante-cinq degrés | 40. |
Ses grandeurs apparentes dans la voûte surbaissée, sont comme ses hauteurs apparentes; et il en est de même de la lune et d'une comète. (Voyez Robert Shmith .)
3 o . Ce n'est point l'habitude, ce n'est point l'interposition des terres, ce n'est point la réfraction de l'atmosphère qui causent cet effet. Mallebranche et Regis ont disputé l'un contre l'autre; mais Robert Shmith a calculé.
4 o . Observez les deux étoiles qui étant à une prodigieuse distance l'une de l'autre, et à des profondeurs très différentes dans l'immensité de l'espace, sont considérées ici comme placées dans le cercle que le soleil semble parcourir. Vous les voyez distantes l'une de l'autre dans le grand cercle; se rapprochant dans le petit par les mêmes lois.
C'est ainsi que vous voyez le ciel matériel. C'est par ces règles invariables de l'optique que vous voyez les planètes tantôt rétrogrades, tantôt stationnaires; elles ne sont rien de tout cela. Si vous étiez dans le soleil, vous verriez toutes les planètes et les comètes rouler régulièrement autour de lui dans les ellipses que Dieu leur assigne. Mais vous êtes sur la planète de la Terre, dans un coin où vous ne pouvez jouir de tout le spectacle.
N'accusons donc point les erreurs de nos sens avec Mallebranche; des lois constantes de la nature, émanées de la volonté immuable du Tout-puissant, et proportionnées à la constitution de nos organes, ne peuvent être des erreurs.
Nous ne pouvons voir que les apparences des choses, et non les choses mêmes. Nous ne sommes pas plus trompés quand le soleil, ouvrage de Dieu, cet astre un million de fois aussi gros que notre terre, nous paraît plat et large de deux pieds, que lorsque dans un miroir convexe, ouvrage de nos mains, nous voyons dans un miroir convexe, ouvrage de nos mains, nous voyons un homme sous la dimension de quelques pouces.
Si le mages Chaldéens furent les premiers qui se servirent de l'intelligence que Dieu leur donna pour mesurer et mettre à leur place les globes célestes, d'autres peuples plus grossiers ne les imitèrent pas.
Ces peuples enfants et sauvages imaginèrent la terre plate, soutenue dans l'air je ne sais comment par son propre poids; le soleil, la lune et les étoiles marchant continuellement sur un ceintre solide qu'on appela plaque firmament ; ce ceintre portant des eaux et ayant des portes d'espace en espace, les eaux sortant par ces portes pour humecter la terre.
Mais comment le soleil, la lune et tous les astres reparaissaient-ils après s'être couchés? on n'en savait rien. Le ciel touchait à la terre plate; il n'y avait pas moyen que le soleil, la lune et les étoiles tournassent sous la terre et allassent se lever à l'orient après s'être couchés à l'occident. Il est vrai que ces ignorants avaient raison par hasard, en ne concevant pas que le soleil et les étoiles fixes tournassent autour de la terre. Mais ils étaient bien loin de soupçonner le soleil immobile, et la terre avec son satellite tournant autour de lui dans l'espace avec les autres planètes. Il y avait plus loin de leurs fables au vrai système du monde que des ténèbres à la lumière.
Ils croyaient que le soleil et les étoiles revenaient par des chemins inconnus, après s'être délassés de leur course dans la mer Méditerranée, on ne sait pas précisément dans quel endroit. Il n'y avait pas d'autre astronomie du temps même d'Homère qui est si nouveau. Car les Chaldéens tenaient leur science secrète pour se faire plus respecter des peuples. Homère dit plus d'une fois, que le soleil se plonge dans l'Océan; (et encore cet océan c'est le Nil) c'est là qu'il répare par la fraîcheur des eaux, pendant la nuit, l'épuisement du jour; après quoi il va se rendre au lieu de son lever par des routes inconnues aux mortels. On a comparé cette idée à celle du baron de Feneste, qui dit, que si on ne voit pas le soleil quand il revient, c'est qu'il revient de nuit .
Comme alors la plupart des peuples de Syrie et les Grecs, connaissaient un peu l'Asie et une petite partie de l'Europe, et qu'ils n'avaient aucune notion de tout ce qui est au nord du Pont-Euxin et au midi du Nil, ils établirent d'abord que la terre était plus longue que large d'un grand tiers; par conséquent le ciel qui touchait à la terre et qui l'embrassait, était aussi plus long que large. De là nous vinrent les degrés de longitude et de latitude, dont nous avons toujours conservé les noms, quoique nous ayons réformé la chose.
Le livre de Job, composé par un ancien Arabe, qui avait quelque connaissance de l'astronomie puisqu'il parle des constellations, s'exprime pourtant ainsi. ‘Où étiez-vous quand je jetais les fondements de la terre? qui en a pris les dimensions? sur quoi ses bases portent-elles? qui a posé sa pierre angulaire?'
Le moindre écolier lui répondrait aujourd'hui, La terre n'a ni pierre angulaire, ni base, ni fondement; et à l'égard de ses dimensions nous les connaissons très bien, puisque depuis Magellan jusqu'à M. de Bougainville, plus d'un navigateur en a fait le tour.
Le même écolier fermerait la bouche au déclamateur Lactance et à tous ceux qui ont dit avant et après lui que la terre est fondée sur l'eau, et que le ciel ne peut être au-dessous de la terre; et que par conséquent il est ridicule et impie de soupçonner qu'il y ait des antipodes.
C'est une chose curieuse de voir avec quel dédain, avec quelle pitié Lactance regarde tous les philosophes qui depuis quatre cents ans commençaient à connaître le cours apparent du soleil et des planètes, la rondeur de la terre, la liquidité, la non-résistance des cieux, à travers desquels les planètes couraient dans leurs orbites Lactance liv. III, ch. XXIV. etc. Il recherche par quels degrés les philosophes sont parvenus à cet excès de folie de faire de la terre une boule, et d'entourer cette boule du ciel .
Ces raisonnements sont dignes de tous ceux qu'il fait sur les sibylles.
Notre écolier dirait à tous ces docteurs, Apprenez qu'il n'y a point de cieux solides placés les uns sur les autres, comme on vous l'a dit; qu'il n'y a point de cercles réels dans lesquels les astres courent sur une prétendue plaque.
Que le soleil est le centre de notre monde planétaire.
Que la terre et les planètes roulent autour de lui, dans l'espace, non pas en traçant des cercles, mais des ellipses.
Apprenez qu'il n'y a ni dessus ni dessous; mais que les planètes, les comètes tendent toutes vers le soleil, leur centre, et que le soleil tend vers elles, par une gravitation éternelle.
Lactance et les autres babillards seraient bien étonnés en voyant le système du monde tel qu'il est.
Cette petite planche représente, quoi qu'imparfaitement, comment notre soleil, notre monde planétaire, nos comètes sont perdus dans l'immensité de l'espace peuplé de tant d'autres univers, et à quel point cette expression commune le ciel et la terre est impropre, quoique nécessaire à notre faiblesse .

LE CIEL DES ANCIENS. [p. 179] ↩
Si un ver à soie donnait le nom de ciel au petit duvet qui entoure sa coque, il raisonnerait aussi bien que firent tous les anciens, en donnant le nom de ciel à l'atmosphère, qui est, comme dit très bien M. de Fontenelle dans ses Mondes , le duvet de notre coque.
Les vapeurs qui sortent de nos mers et de notre terre, et qui forment les nuages, les météores et les tonnerres, furent pris d'abord pour la demeure des dieux. Les dieux descendent toujours dans des nuages d'or chez Homère; c'est de là que les peintres les peignent encore aujourd'hui assis sur une nuée. Comment est-on assis sur l'eau? Il était bien juste que le maître des dieux fût plus à son aise que les autres: on lui donna un aigle pour le porter, parce que l'aigle vole plus haut que les autres oiseaux.
Les anciens Grecs voyant que les maîtres des villes demeuraient dans des citadelles, au haut de quelque montagne, jugèrent que les dieux pouvaient avoir une citadelle aussi, et la placèrent en Thessalie sur le mont Olympe, dont le sommet est quelquefois caché dans les nues; de sorte que leur palais était de plain-pied à leur ciel.
Les étoiles et les planètes qui semblent attachées à la voûte bleue de notre atmosphère, devinrent ensuite les demeures des dieux; sept d'entre eux eurent chacun leur planète, les autres logèrent où ils purent; le conseil général des dieux se tenait dans une grande salle, à laquelle on allait par la voie lactée; car il fallait bien que les dieux eussent une salle en l'air, puisque les hommes avaient des hôtels de ville sur la terre.
Quand les Titans, espèce d'animaux entre les dieux et les hommes, déclarèrent une guerre assez juste à ces dieux-là, pour réclamer une partie de leur héritage du côté paternel, étant fils du ciel et de la terre, ils ne mirent que deux ou trois montagnes les unes sur les autres, comptant que c'en était bien assez pour se rendre maître du ciel, et du château de l'Olympe.
Neve foret terris securior arduus aether ;
Affectasse ferunt regnum coeleste gigantes ,
Altaque congestos struxisse ad sidera montes .
On attaqua le ciel aussi bien que la terre;
Les géants, chez les dieux osant porter la guerre,
Entassèrent des monts jusqu'aux astres des nuits.
Il y a pourtant des six cent millions de lieues de ces astres-là, et beaucoup plus loin encore de plusieurs étoiles au mont Olympe.
Virgile ne fait point de difficulté de dire
Sub pedibusque videt nubes et sydera Daphnis.
Daphnis voit sous ses pieds les astres et les nuits.
Mais où donc était Daphnis?
A l'opéra et dans des ouvrages plus sérieux on fait descendre des dieux au milieu des vents, des nuages et du tonnerre, c'est-à-dire qu'on promène Dieu dans les vapeurs de notre petit globe. Ces idées sont si proportionées à notre faiblesse, qu'elles nous paraissent grandes.
Cette physique d'enfants et de vieilles, était prodigieusement ancienne; cependant on croit que les Chaldéens avaient des idées presque aussi saines que nous de ce qu'on appelle le ciel ; ils plaçaient le soleil au centre de notre monde planétaire, à peu près à la distance de notre globe que nous avons reconnue; ils faisaient tourner la terre, et quelques planètes autour de cet astre; c'est ce que nous apprend Aristarque de Samos: c'est à peu près le système du monde que Copernic a perfectionné depuis; mais les philosophes gardaient le secret pour eux, afin d'être plus respectés des rois et du peuple, ou plutôt pour n'être pas persécutés.
Le langage de l'erreur est si familier aux hommes, que nous appelons encore nos vapeurs, et l'espace de la terre à la lune, du nom de ciel ; nous disons, monter au ciel, comme nous disons que le soleil tourne, quoiqu'on sache bien qu'il ne tourne pas. Nous sommes probablement le ciel pour les habitants de la lune, et chaque planète place son ciel dans la planète voisine.
Si on avait demandé à Homère dans quel ciel était allée l'âme de Sarpédon, et où était celle d'Hercule, Homère eût été bien embarrassé; il eût répondu par des vers harmonieux.
Quelle sûreté avait-on que l'âme aérienne d'Hercule se fût trouvée plus à son aise dans Vénus, dans Saturne, que sur notre globe? Aurait-elle été dans le soleil? la place ne paraît pas tenable dans cette fournaise. Enfin, qu'entendaient les anciens par le ciel? ils n'en savaient rien, ils criaient toujours le ciel et la terre ; c'est comme si on criait l'infini et un atome. Il n'y a point, à proprement parler, de ciel, il y a une quantité prodigieuse de globes qui roulent dans l'espace vide; et notre globe roule comme les autres.
Les anciens croyaient qu'aller dans les cieux c'était monter; mais on ne monte point d'un globe à un autre; les globes célestes sont tantôt au-dessus de notre horizon, tantôt au-dessous. Ainsi, supposons que Vénus étant venue à Paphos, retournât dans sa planète quand cette planète était couchée, la déesse Vénus ne montait point alors par rapport à notre horizon; elle descendait, et on devait dire en ce cas descendre au ciel . Mais les anciens n'y entendaient pas tant de finesse; ils avaient des notions vagues, incertaines, contradictoires sur tout ce qui tenait à la physique. On a fait des volumes immenses pour savoir ce qu'ils pensaient sur bien des questions de cette sorte. Quatre mots auraient suffi; ils ne pensaient pas .
CLERC. [p. 182] ↩
Il y aurait peut-être encore quelque chose à dire sur ce mot, même après le Dictionnaire de Du Cange, et celui de l'Encyclopédie. Nous pouvons, par exemple, observer qu'on était si savant vers le dixième et onzième siècle, qu'il s'introduisit une coutume ayant force de loi en France, en Allemagne, en Angleterre, de faire grâce de la corde à tout criminel condamné qui savait lire; tant un homme de cette érudition était nécessaire à l'Etat.
Guillaume le Bâtard, conquérant de l'Angleterre, y porta cette coutume. Cela s'appelait bénéfice de clergie, beneficium clericorum aut clergicorum .
Nous avons remarqué en plus d'un endroit que de vieux usages perdus ailleurs se retrouvent en Angleterre, comme on retrouva dans l'île de Samothrace les anciens mystères d'Orphée. Aujourd'hui même encore ce bénéfice de clergie subsiste chez les Anglais dans toute sa force pour un meurtre commis sans dessein, et pour un premier vol qui ne passe pas cinq cents livres sterling. Le criminel qui sait lire, demande le bénéfice de clergie; on ne peut le lui refuser. Le juge qui était réputé par l'ancienne loi ne savoir pas lire lui-même, s'en rapporte encore au chapelain de la prison, qui présente un livre au condamné. Ensuite il demande au chapelain, Legit? Lit-il ? Le chapelain répond, Legit ut clericus, Il lit comme un clerc . Et alors on se contente de faire marquer d'un fer chaud le criminel à la paume de la main. On a eu soin de l'enduire de graisse; le fer fume et produit un sifflement sans faire aucun mal au patient réputé clerc.
DU CÉLIBAT DES CLERCS.
On demande si dans les premiers siècles de l'Eglise le mariage fut permis aux clercs, et dans quel temps il fut défendu?
Il est avéré que les clercs, loin d'être engagés au célibat dans la religion juive, étaient tous au contraire excités au mariage, non seulement par l'exemple de leurs patriarches, mais par la honte attachée à vivre sans postérité.
Toutefois, dans les temps qui précédèrent les derniers malheurs des Juifs, il s'éleva des sectes de rigoristes, esséniens, judaïtes, thérapeutes, hérodiens; et dans quelques-unes comme celles des esséniens et des thérapeutes, les plus dévots ne se mariaient pas. Cette continence était une imitation de la chasteté des vestales établies par Numa Pompilius, de la fille de Pythagore qui institua un couvent, des prêtresses de Diane, de la pythie de Delphe, et plus anciennement de Cassandre et de Chrysis prêtresses d'Apollon, et même des prêtresses de Bacchus.
Les prêtres de Cybèle non seulement faisaient voeu de chasteté, mais de peur de violer leurs voeux ils se rendaient eunuques.
Plutarque, dans sa huitième question des propos de table, dit qu'il y a des collèges de prêtres en Egypte qui renoncent au mariage.
Les premiers chrétiens, quoique faisant profession d'une vie aussi pure que celle des esséniens et des thérapeutes, ne firent point une vertu du célibat. Nous avons vu que presque tous les Epître à Tite ch. I. apôtres et les disciples étaient mariés. St Paul écrit à Tite, Choisissez pour prêtre celui qui n'aura qu'une femme ayant des enfants fidèles, et non accusés de luxure .
I à Timot. ch. III, v. 2. Il dit la même chose à Timothée; que le surveillant soit mari d'une seule femme .
Il semble faire si grand cas du mariage, que dans la même lettre Ch. II, v. 15. à Timothée, il dit, la femme ayant prévariqué se sauvera en faisant des enfants .
Ce qui arriva dans le fameux concile de Nicée au sujet des prêtres mariés, mérite une grande attention. Quelques évêques, Sozom. liv. I. Socrate liv. I. au rapport de Sozomène et de Socrate, proposèrent une loi qui défendît aux évêques et aux prêtres de toucher dorénavant à leurs femmes; mais St Paphnuce le martyr, évêque de Thèbes en Egypte, s'y opposa fortement, disant, que coucher avec sa femme c'est chasteté ; et son avis fut suivi par le concile.
Suidas, Gelase Cisicène, Cassiodore et Nicéphore Caliste, rapportent précisément la même chose.
Le concile seulement défendit aux ecclésiastiques d'avoir chez eux des agapètes, des associées, autres que leurs propres femmes, excepté leurs mères, leurs soeurs, leurs tantes et des vieilles hors de tout soupçon.
Depuis ce temps, le célibat fut recommandé sans être ordonné. St Jérôme voué à la solitude, fut celui de tous les Pères qui fit les plus grands éloges du célibat des prêtres; cependant, il prend hautement le parti de Cartérius évêque d'Espagne qui s'était Lettre LXVII à Oceanus. remarié deux fois. Si je voulais nommer , dit-il, tous les évêques qui ont passé à de secondes noces, j'en trouverais plus qu'il n'y eut d'évêques au concile de Rimini ; Tantus numerus congregabitur ut Riminensis synodus superetur .
Les exemples des clercs mariés, et vivant avec leurs femmes, sont innombrables. Sydonius évêque de Clermont en Auvergne au cinquième siècle, épousa Papianilla fille de l'empereur Avitus; et la maison de Polignac a prétendu en descendre. Simplicius évêque de Bourges eut deux enfants de sa femme Palladia.
St Grégoire de Nazianze était fils d'un autre Grégoire évêque de Nazianze, et de Nonna, dont cet évêque eut trois enfants, savoir Cesarius, Gorgonia et le Saint.
On trouve dans le décret romain, au canon Osius, une liste très longue d'évêques enfants des prêtres. Le pape Osius lui-même était fils du sous-diacre Etienne, et le pape Boniface I e r fils du prêtre Joconde. Le pape Felix III fut fils du prêtre Felix, et devint lui-même un des aïeux de Grégoire le Grand. Jean II eut pour père le prêtre Projectus, Agapet le prêtre Gordien. Le pape Sylvestre était fils du pape Hormisdas. Théodore I e r naquit du mariage de Théodore patriarche de Jérusalem, ce qui devait réconcilier les deux Eglises.
Enfin, après plus d'un concile tenu inutilement sur le célibat qui devait toujours accompagner le sacerdoce, le pape Grégoire VII excommunia tous les prêtres mariés, soit pour rendre l'Eglise respectable par une discipline plus rigoureuse, soit pour attacher plus étroitement à la cour de Rome les évêques et les prêtres des autres pays qui n'auraient d'autre famille que l'Eglise.
Cette loi ne s'établit pas sans de grandes contradictions.
C'est une chose très remarquable que le concile de Bâle ayant déposé, du moins en paroles, le pape Eugène IV, et élu Amédée de Savoie, plusieurs évêques ayant objecté que ce prince avait été marié, Enéas Silvius, depuis pape sous le nom de Pie II, soutint l'élection d'Amédée par ces propres paroles: Non solum qui uxorem habuit, sed uxorem habens potest assumi. -- Non seulement celui qui a été marié, mais celui qui l'est peut être pape .
Ce Pie II était conséquent. Lisez ses lettres à sa maîtresse dans le recueil de ses oeuvres . Il était persuadé qu'il y a de la démence à Voyez Onanisme . vouloir frauder la nature, qu'il faut la guider, et non chercher à l'anéantir.
Quoi qu'il en soit, depuis le concile de Trente il n'y a plus de dispute sur le célibat des clercs dans l'Eglise catholique romaine; il n'y a plus que des désirs.
Toutes les communions protestantes se sont séparées de Rome sur cet article.
Dans l'Eglise grecque qui s'étend aujourd'hui des frontières de la Chine au cap Matapan, les prêtres se marient une fois. Partout les usages varient, la discipline change selon les temps et selon les lieux. Nous ne faisons ici que raconter, et nous ne controversons jamais.
DES CLERCS DU SECRET, DEVENUS DEPUIS SECRÉTAIRES D'ÉTAT ET MINISTRES.
Les clercs du secret, clercs du roi, qui sont devenus depuis secrétaires d'Etat en France et en Angleterre, étaient originairement notaires du roi; ensuite on les nomma secrétaires des commandements . C'est le savant et laborieux Pasquier qui nous l'apprend. Il était bien instruit, puisqu'il avait sous ses yeux les registres de la chambre des comptes qui de nos jours ont été consumés par un incendie.
A la malheureuse paix du Catau-Cambresis en 1558, un clerc de Philippe II ayant pris le titre de secrétaire d'Etat , l'Aubépine qui était clerc secrétaire des commandements du roi de France, et son notaire, prit aussi le titre de secrétaire d'Etat afin que les dignités fussent égales, si les avantages de la paix ne l'étaient pas.
En Angleterre avant Henri VIII, il n'y avait qu'un secrétaire du roi, qui présentait debout les mémoires et requêtes au conseil. Henri VIII en créa deux, et leur donna les mêmes titres et les mêmes prérogatives qu'en Espagne. Les grands seigneurs alors n'acceptaient pas ces places; mais avec le temps elles sont devenues si considérables, que les pairs du royaume et les généraux des armées en ont été revêtus. Ainsi tout change. Il ne reste rien en France du gouvernement de Hugues surnommé Capet , ni en Angleterre de l'administration de Guillaume surnommé le Bâtard .
CLIMAT. [p. 186] ↩
Hic segetes, illic veniunt felicius uvae :
Arborei foetus alibi, atque injussa virescunt
Gramina; nonne vides, croceos ut Tmolus odores ,
India mittit ebur, molles sua thura Sabaei ?
Ut chalybes nudi ferrum, virosaque Pontus
Castorea, Eliadum palmas Epirus equarum ?
Il faut ici se servir de la traduction de M. l'abbé de l'Isle, dont l'élégance en tant d'endroits est égale au mérite de la difficulté surmontée.
Ici sont des vergers qu'enrichit la culture,
Là règne un vert gazon qu'entretient la nature;
Le Tmole est parfumé d'un safran précieux;
Dans les champs de Saba l'encens croît pour les dieux;
L'Euxin voit le castor se jouer dans ses ondes,
Le Pont s'enorgueillit de ses mines profondes;
L'Inde produit l'ivoire; et dans ses champs guerriers
L'Epire pour l'Elide exerce ses coursiers.
Il est certain que le sol et l'atmosphère signalent leur empire sur toutes les productions de la nature, à commencer par l'homme, et à finir par les champignons.
Dans le grand siècle de Louis XIV, l'ingénieux Fontenelle a dit: ‘On pourrait croire que la zone torride et les deux glaciales, ne sont pas fort propres pour les sciences. Jusqu'à présent elles n'ont point passé l'Egypte et la Mauritanie d'un côté, et de l'autre la Suède. Peut-être n'a-ce pas été par hasard qu'elles se sont tenues entre le mont Atlas et la mer Baltique. On ne sait si ce ne sont point là les bornes que la nature leur a posées; et si l'on peut espérer de voir jamais de grands auteurs lapons ou nègres.'
Chardin, l'un de ces voyageurs qui raisonnent, et qui approfondissent, va encore plus loin que Fontenelle en parlant de la Perse. Chardin ch. VII. ‘La température des climats chauds (dit-il) énerve l'esprit comme le corps, et dissipe ce feu nécessaire à l'imagination pour l'invention. On n'est pas capable dans ces climats-là de longues veilles, et de cette forte application qui enfantent les ouvrages des arts libéraux et des arts mécaniques, etc.'
Chardin ne songeait pas que Sadi et Lokman étaient Persans. Il ne faisait pas attention qu'Archimède était de Sicile, où la chaleur est plus grande que dans les trois quarts de la Perse. Il oubliait que Pythagore apprit autrefois la géométrie chez les brachmanes.
L'abbé Dubos soutint, et développa autant qu'il le put ce sentiment de Chardin.
Cent cinquante ans avant eux Bodin en avait fait la base de son système, dans sa République et dans sa Méthode de l'histoire ; il dit que l'influence du climat est le principe du gouvernement des peuples et de leur religion.
Diodore de Sicile fut de ce sentiment longtemps avant Bodin.
L'auteur de l' Esprit des lois , sans citer personne, poussa cette idée encore plus loin que Dubos, Chardin et Bodin. Une certaine partie de la nation l'en crut l'inventeur, et lui en fit un crime. C'est ainsi que cette partie de la nation est faite. Il y a partout des gens qui ont plus d'enthousiasme que d'esprit.
On pourrait demander à ceux qui soutiennent que l'atmosphère fait tout, pourquoi l'empereur Julien dit dans son Misopogon que ce qui lui plaisait dans les Parisiens c'était la gravité de leurs caractères, et la sévérité de leurs moeurs; et pourquoi ces Parisiens, sans que le climat ait changé, sont aujourd'hui des enfants badins à qui le gouvernement donne le fouet en riant, et qui eux-mêmes rient le moment d'après, et chansonnent leurs précepteurs?
Pourquoi les Egyptiens qu'on nous peint encore plus graves que les Parisiens, sont aujourd'hui le peuple le plus mou, le plus frivole et le plus lâche, après avoir, dit-on, conquis autrefois toute la terre pour leur plaisir, sous un roi nommé Sésostris?
Pourquoi dans Athènes n'y a-t-il plus d'Anacréons ni d'Aristotes, ni de Zeuxis?
D'où vient que Rome a pour ses Cicérons, ses Catons et ses Tite-Lives, des citoyens qui n'osent parler, et une populace de gueux abrutis, dont le suprême bonheur est d'avoir quelquefois de l'huile à bon marché, et de voir défiler des processions?
Cicéron plaisante beaucoup sur les Anglais dans ses lettres. Il prie Quintus son frère, lieutenant de César, de lui mander s'il a trouvé de grands philosophes parmi eux dans l'expédition d'Angleterre. Il ne se doutait pas qu'un jour ce pays pût produire des mathématiciens qu'il n'aurait jamais pu entendre. Cependant le climat n'a point changé; et le ciel de Londre est tout aussi nébuleux qu'il l'était alors.
Tout change dans les corps et dans les esprits avec le temps. Peut-être un jour les Américains viendront enseigner les arts aux peuples de l'Europe.
Le climat a quelque puissance, le gouvernement cent fois plus; la religion jointe au gouvernement encore davantage.
INFLUENCE DU CLIMAT.
Le climat influe sur la religion en fait de cérémonies et d'usages. Un législateur n'aura pas eu de peine à faire baigner des Indiens dans le Gange à certains temps de la lune; c'est un grand plaisir pour eux. On l'aurait lapidé s'il eût proposé le même bain aux peuples qui habitent les bords de la Duina vers Arcangel. Défendez le porc à un Arabe qui aurait la lèpre s'il mangeait de cette chair très mauvaise et très dégoûtante dans son pays, il vous obéira avec joie. Faites la même défense à un Vestphalien, il sera tenté de vous battre.
L'abstinence du vin est un bon précepte de religion dans l'Arabie, où les eaux d'orange, de citron, de limon sont nécessaires à la santé. Mahomet n'aurait pas peut-être défendu le vin en Suisse, surtout avant d'aller au combat.
Il y a des usages de pure fantaisie. Pourquoi les prêtres d'Egypte imaginèrent-ils la circoncision? ce n'est pas pour la santé. Cambyse qui les traita comme ils le méritaient, eux et leur boeuf Apis, les courtisans de Cambyse, les soldats de Cambyse, n'avaient point fait couper leurs prépuces et se portaient fort bien. La raison du climat ne fait rien aux parties génitales d'un prêtre. On offrait son prépuce à Isis probablement, comme on présenta partout les prémices des fruits de la terre. C'était offrir les prémices du fruit de la vie.
Les religions ont toujours roulé sur deux pivots; observance et croyance; l'observance tient en grande partie au climat; la croyance n'en dépend point. On fera tout aussi bien recevoir un dogme sous l'équateur et sous le cercle polaire. Il sera ensuite également rejeté à Batavia et aux Orcades, tandis qu'il sera soutenu unguibus et rostro à Salamanque. Cela ne dépend point du sol et de l'atmosphère, mais uniquement de l'opinion, cette reine inconstante du monde.
Certaines libations de vin seront de précepte dans un pays de vignoble, et il ne tombera point dans l'esprit d'un législateur d'instituer en Norvège des mystères sacrés qui ne pourraient s'opérer sans vin.
Il sera expressément ordonné de brûler de l'encens dans le parvis d'un temple où l'on égorge des bêtes à l'honneur de la Divinité et pour le souper des prêtres. Cette boucherie appelée temple , serait un lieu d'infection abominable, si on ne le purifiait pas continuellement: et sans le secours des aromates, la religion des anciens aurait apporté la peste. On ornait même l'intérieur des temples de festons de fleurs pour rendre l'air plus doux.
On ne sacrifiera point de vache dans le pays brûlant de la presqu'île des Indes; parce que cet animal qui nous fournit un lait nécessaire est très rare dans une campagne aride, que sa chair y est sèche, coriace, très peu nourrissante, et que les brachmanes feraient très mauvaise chère. Au contraire, la vache deviendra sacrée, attendu sa rareté et son utilité.
On n'entrera que pieds nus dans le temple de Jupiter-Ammon, où la chaleur est excessive: il faudra être bien chaussé pour faire ses dévotions à Copenhague.
Il n'en est pas ainsi du dogme. On a cru au polythéisme dans tous les climats; et il est aussi aisé à un Tartare de Crimée qu'à un habitant de la Mecque de reconnaître un Dieu unique, incommunicable, non-engendré et non-engendreur. C'est par le dogme encore plus que par les rites qu'une religion s'étend d'un climat à un autre. Le dogme de l'unité d'un Dieu passa bientôt de Médine au mont Caucase; alors le climat cède à l'opinion.
Les Arabes dirent aux Turcs: ‘Nous nous faisions circoncire en Arabie sans savoir trop pourquoi; c'était une ancienne mode des prêtres d'Egypte d'offrir à Oshiret ou Osiris une petite partie de ce qu'ils avaient de plus précieux: Nous avions adopté cette coutume trois mille ans avant d'être mahométans. Vous serez circoncis comme nous; vous serez obligés comme nous de coucher avec une de vos femmes tous les vendredis, et de donner par an deux et demi pour cent de votre revenu aux pauvres. Nous ne buvons que de l'eau et du sorbet; toute liqueur enivrante nous est défendue; elles sont pernicieuses en Arabie. Vous embrasserez ce régime, quoique vous aimiez le vin passionnément; et que même il vous soit souvent nécessaire sur les bords du Phaze et de l'Araxe. Enfin, si vous voulez aller au ciel et y être bien placés, vous prendrez le chemin de la Mecque.'
Les habitants du nord du Caucase se soumettent à ces lois, et embrassent dans toute son étendue une religion qui n'était pas faite pour eux.
En Egypte le culte emblématique des animaux succéda aux dogmes de Thaut. Les dieux des Romains partagèrent ensuite l'Egypte avec les chiens, les chats et les crocodiles. A la religion romaine succéda le christianisme: il fut entièrement chassé par le mahométisme, qui cédera peut-être la place à une religion nouvelle.
Dans toutes ces vicissitudes le climat n'est entré pour rien: le gouvernement a tout fait. Nous ne considérons ici que les causes secondes, sans lever des yeux profanes vers la Providence qui les dirige. La religion chrétienne, née dans la Syrie, ayant reçu ses principaux accroissements dans Alexandrie, habite aujourd'hui les pays où Teutate, Irminsul, Frida, Odin étaient adorés.
Il y a des peuples dont ni le climat, ni le gouvernement n'ont fait la religion. Quelle cause a détaché le nord de l'Allemagne, le Dannemarck, les trois quarts de la Suisse, la Hollande, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande de la communion romaine? . . . la pauvreté. On vendait trop cher les indulgences et la délivrance du purgatoire à des âmes dont les corps avaient alors très peu d'argent. Les prélats, les moines engloutissaient tout le revenu d'une province. On prit une religion à meilleur marché. Enfin, après vingt guerres civiles, on a cru que la religion du pape était fort bonne pour les grands seigneurs, et la réformée pour les citoyens. Le temps fera voir qui doit l'emporter vers la mer Egée et le Pont-Euxin de la religion grecque ou de la religion turque.
CLOU. [p. 191] ↩
Nous ne nous arrêterons pas à remarquer la barbarie agreste qui fit clou de clavus , et cloud de clodoaldus , et clou de girofle, quoique le girofle ressemble fort mal à un clou; et clou , maladie de l'oeil; et clou , tumeur de la peau, etc. Ces expressions viennent de la négligence et de la stérilité de l'imagination; c'est la honte d'un langage.
Nous demandons seulement ici aux réviseurs de livres la permission de transcrire ce que le missionnaire Labat dominicain, provéditeur du Saint Office, a écrit sur les clous de la croix, à laquelle il est plus que probable que jamais aucun clou ne fut attaché.
Voyages du jacobin Labat. tom. VIII, pag. 34 et 35. ‘Le religieux italien qui nous conduisait, eut assez de crédit pour nous faire voir entre autre un des clous dont notre Seigneur fut attaché à la croix. Il me parut bien différent de celui que les bénédictins font voir à St Denis. Peut-être que celui de St Denis avait servi pour les pieds, et qu'il devait être plus grand que celui des mains. Il fallait pourtant que ceux des mains fussent assez grands, et assez forts pour soutenir tout le poids du corps. Mais il faut que les Juifs aient employé plus de quatre clous, ou que quelques-uns de ceux qu'on expose à la vénération des fidèles ne soient pas bien authentiques. Car l'histoire rapporte que Ste Hélène en jeta un dans la mer pour apaiser une tempête furieuse qui agitait son vaisseau. Constantin se servit d'un autre pour faire le mord de la bride de son cheval. On en montre un tout entier à St Denis en France, un autre aussi tout entier à Ste Croix de Jérusalem à Rome. Un auteur romain de notre siècle, très célèbre, assure que la couronne de fer dont on couronne les empereurs en Italie, est faite d'un de ces clous. On voit à Rome et à Carpentras deux mords de bride aussi faits de ces clous, et on en fait voir encore en d'autres endroits. Il est vrai qu'on a la discrétion de dire de quelques-uns, tantôt que c'est la pointe, et tantôt que c'est la tête.'
Le missionnaire parle sur le même ton de toutes les reliques. Il dit au même endroit que lorsqu'on apporta de Jérusalem à Rome le corps du premier diacre St Etienne, et qu'on le mit dans le tombeau du diacre St Laurent, en 557, St Laurent se retira de lui-même pour donner la droite à son hôte; action qui lui acquit le surnom de civil Espagnol . [23]
Ne faisons sur ces passages qu'une réflexion, c'est que si quelque philosophe s'était expliqué dans l'Encyclopédie comme le missionnaire dominicain Labat, une foule de Patouillets et de Nonottes, de Chiniacs, de Chaumeix et d'autres polissons auraient crié au déiste, à l'athée, au géomètre.
Selon ce que l'on peut être
Les choses changent de nom.
Amphitrion .
COHÉRENCE, COHÉSION, ADHÉSION. [p. 193] ↩
Force par laquelle les parties des corps tiennent ensemble. C'est le phénomène le plus commun et le plus inconnu. Newton se moque des atomes crochus par lesquels on a voulu expliquer la cohérence ; car il resterait à savoir pourquoi ils sont crochus, et pourquoi ils cohèrent.
Il ne traite pas mieux ceux qui ont expliqué la cohésion par le repos; C'est , dit-il, une qualité occulte . Il a recours à une attraction; mais cette attraction qui peut exister, et qui n'est point du tout démontrée, n'est-elle pas une qualité occulte? La grande attraction des globes célestes est démontrée et calculée. Celle des corps adhérents est incalculable. Or, comment admettre une force immensurable qui serait de la même nature que celle qu'on mesure?
Néanmoins, il est démontré que la force d'attraction agit sur toutes les planètes et sur tous les corps graves, proportionnellement à leur solidité; donc elle agit sur toutes les parties de la matière; donc il est très vraisemblable qu'en résidant dans chaque partie par rapport au tout, elle réside aussi dans chaque partie par rapport à la continuité; donc la cohérence peut être l'effet de l'attraction.
Cette opinion paraît admissible jusqu'à ce qu'on trouve mieux; et le mieux n'est pas facile à rencontrer.
COLIMAÇONS. [p. 194] ↩
Petit ouvrage écrit en 1768.
SECTION PREMIÈRE.
Il y a quelque temps qu'on ne parlait que des jésuites, et à présent on ne s'entretient que des escargots. Chaque chose a son temps; mais il est certain que les colimaçons dureront plus que tous nos ordres religieux: car il est clair que si on avait coupé la tête à tous les capucins et à tous les carmes, ils ne pourraient plus recevoir de novices; au lieu qu'une limace à qui l'on a coupé le cou reprend une nouvelle tête au bout d'un mois.
Plusieurs naturalistes ont fait cette expérience, et ce qui n'arrive que trop souvent, ils ne sont pas du même avis. Les uns disent que ce sont les limaces simples que j'appelle incoques qui reprennent une tête; les autres disent que ce sont les escargots, les limaçons à coquilles. Experientia fallax , l'expérience même est trompeuse. [24] Il est très vraisemblable que le succès de cette tentative dépend de l'endroit dans lequel l'on fait l'amputation et de l'âge du patient.
Je me suis donné souvent le plaisir innocent de couper des têtes de colimaçons escargots à coquilles, et de limaces nues incoques. Je vais vous exposer fidèlement ce qui m'est arrivé. Je serais fâché d'en imposer au monde.
Le vingt-sept de mai 1768 par les neuf heures du matin, le temps étant serein, je coupai la tête entière avec ses quatre antennes à vingt limaces nues incoques de couleur mordoré brun, et à douze escargots à coquilles. Je coupai aussi la tête à huit autres escargots, mais entre les antennes. Au bout de quinze jours deux de mes limaces ont montré une tête naissante, elles mangeaient déjà, et leurs quatre antennes commençaient à poindre. Les autres se portent bien, elles mangent sous le capuchon qui les couvre sans allonger encore le cou. Il ne m'est mort que la moitié de mes escargots, tous les autres sont en vie. Ils marchent, ils grimpent à un mur, ils allongent le cou; mais il n'y a nulle apparence de tête, excepté à un seul. On lui avait coupé le cou entièrement, sa tête est revenue; mais il ne mange pas encore. Unus est ne desperes; sed unus est ne confidas . [25]
Ceux à qui l'on n'a fait l'opération qu'entre les quatre antennes, ont déjà repris leur museau. Dès qu'ils seront en état de manger et de faire l'amour, j'en rendrai compte. Voilà deux prodiges bien avérés: des animaux qui vivent sans tête; des animaux qui reproduisent une tête.
J'ose espérer que mes escargots, mes colimaçons reprendront des têtes entières comme les limaces; mais enfin je n'en ai encore vu qu'un à qui cela soit arrivé; et je crains même de m'être trompé.
Si la tête revient difficilement aux escargots, ils ont en récompense des privilèges bien plus considérables. Les colimaçons ont le bonheur d'être à la fois mâles et femelles, comme ce beau garçon fils de Vénus et de Mercure, dont la nymphe Salmacis fut amoureuse.
Les colimaçons sont assurément l'espèce la plus favorisée de la nature. Ils ont de doubles organes de plaisir. Chacun d'eux est pourvu d'une espèce de carquois blanc, dont il tire une flèche amoureuse longue de trois à quatre lignes. Ils donnent et reçoivent tour à tour; leurs voluptés sont non seulement le double des nôtres, mais elles sont beaucoup plus durables. On sait, jeunes gens, dans quel court espace de temps s'évanouit votre jouissance. Un moment la voit naître et mourir. Cela passe comme un éclair, et ne revient pas si souvent qu'on le dit dans les chansons. Les colimaçons se pâment trois, quatre heures entières. C'est peu par rapport à l'éternité; mais c'est beaucoup par rapport à nous. Vous voyez évidemment que Louis Racine a tort d'appeler le colimaçon solitaire odieux , il n'y a rien de plus sociable. J'ose interpeller ici l'amant le plus tendre et le plus vigoureux; s'il était quatre heures entières dans la même attitude avec l'objet de ses chastes amours, je pense qu'il serait bien ennuyé et qu'il désirerait d'être quelque temps à lui-même; mais les colimaçons ne s'ennuient point. C'est un charme de les voir s'approcher et s'unir ensemble par cette longue fraise qui leur sert à la fois de jambes et de manteau. J'ai vingt fois été témoin de leurs tendres caresses.
Si les limaces incoques n'ont ni deux sexes ni ces longs ravissements, la nature en récompense les fait renaître. Lequel vaux mieux?
Les escargots nous surpassent autant dans la faculté de la vue que dans celle de l'amour. Ils ont une double paire d'yeux comme un double instrument de tendresse. Quatre yeux pour un colimaçon! Oh nature! nature! Il y a un grain noir au bout de leurs quatre antennes supérieures. Ce point noir descend dans le creux de ces quatre trompes quand on y touche, à travers une espèce d'humeur vitrée, et remonte ensuite avec célérité; leurs yeux sont mobiles, ils sont enfermés dans une gaine; ces yeux sont à la fois des cornes, des trompes, avec lesquelles l'escargot et la limace cherchent leur nourriture. Coupez les yeux et les trompes à l'escargot et à la limace incoque, ces yeux se reproduisent dans la limace incoque. Peut-être qu'ils ressusciteront aussi dans l'escargot.
Je crois l'une et l'autre espèce sourde: car quelque bruit que l'on fasse autour d'eux, rien ne les alarme. Si elles ont des oreilles je me rétracterai; cela ne coûte rien à un galant homme.
Qu'ils soient sourds ou non, il est certain que les têtes des limaces ressuscitent; et que les colimaçons vivent sans tête. O altitudo divitiarum !
SECTION SECONDE.
Cet animal à qui je viens de couper la tête est-il encore animé? Oui sans doute, puisque l'escargot décapité remue et montre son cou, puisqu'il vit, puisque la tête revient en moins d'un mois à des limaces incoques.
Cet animal a-t-il des sensations avant que sa tête soit revenue? Je dois le soupçonner, puisqu'il remue le cou, qu'il l'étend, et que dès qu'on y touche, il le resserre.
Peut-on avoir des sensations sans avoir au moins quelque idée confuse? Je ne le crois pas: car toute sensation est plaisir ou douleur, et on a la perception de cette douleur et de ce plaisir. Autrement ce serait ne pas sentir.
Qui donne cette sensation, cette idée commencée? Celui qui a fait le limaçon, le soleil et les astres. Il est impossible qu'un animal se donne des sensations à lui-même. Le sceau de la Divinité est dans les aperceptions d'un ciron, comme dans le cerveau de Virgile.
On cherche à expliquer comme on sent, comment on pense. Je m'en tiens au poète Aratus que St Paul a cité.
In Deo vivimus, movemur et sumus .
Qui me dira comment une âme, un principe de sensation et d'idées, réside entre quatre cornes, et comment l'âme restera dans l'animal quand les quatre cornes et la tête sont coupées? On ne peut guère dire d'une limace: Igneus est illis vigor et caelestis origo ; il serait difficile de prouver que l'âme d'un colimaçon, qui n'est qu'une glaire en vie soit un feu céleste. Enfin ce prodige d'une tête renaissante inconnu depuis le commencement des choses jusqu'à nous, est plus inexplicable que la direction de l'aimant. Cet étonnant objet de notre curiosité confondue tient à la nature des choses, aux premiers principes, qui ne sont pas plus à notre portée que la nature des habitants de Sirius et de Canope. Pour peu qu'on creuse on trouve un abîme infini. Il faut admirer et se taire.
CONCILE. [p. 198] ↩
Assemblée, conseil d'Etat, parlement, états généraux, c'était autrefois la même chose parmi nous. On n'écrivait ni en celte, ni en germain, ni en espagnol dans nos premiers siècles. Le peu qu'on écrivait était conçu en langue latine par quelques clercs; ils exprimaient toute assemblée de leudes, de heerren, ou de ricos-ombres, ou de quelques prélats par le mot de concilium . De là vient qu'on trouve dans le sixième, septième et huitième siècle, tant de conciles qui n'étaient précisément que des conseils d'Etat.
Nous ne parlerons ici que des grands conciles appelés généraux soit par l'Eglise grecque, soit par l'Eglise latine: on les nomma synodes à Rome comme en Orient dans les premiers siècles; car les Latins empruntèrent des Grecs les noms et les choses.
En 325 grand concile dans la ville de Nicée, convoqué par Constantin. La formule de la décision est: Nous croyons Jésus consubstantiel au Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré et non fait. Nous croyons aussi au Saint Esprit . (Voyez Arianisme . )
Il est dit dans le supplément appelé appendix , que les Pères du concile voulant distinguer les livres canoniques des apocryphes, les mirent tous sur l'autel, et que les apocryphes tombèrent par terre d'eux-mêmes.
Liv. VIII, ch. XXIII. Nicéphore assure que deux évêques, Chrisante et Misonius, morts pendant les premières sessions, ressuscitèrent pour signer la condamnation d'Arius, et remoururent incontinent après.
Baronius soutient le fait, mais Fleuri n'en parle pas.
Tom. IV. N o 82. En 359 l'empereur Constance assemble le grand concile de Rimini et de Séleucie, au nombre de six cents évêques, et d'un nombre prodigieux de prêtres. Ces deux conciles correspondant ensemble, défont tout ce que le concile de Nicée a fait, et proscrivent la consubstantiabilité. Aussi fut-il regardé depuis comme faux concile.
En 381, par les ordres de l'empereur Théodose, grand concile à Constantinople, de cent cinquante évêques, qui anathématisent le concile de Rimini. St Grégoire de Nazianze y préside; [26] l'évêque de Rome y envoie des députés. On ajoute au symbole de Nicée, Jésus-Christ s'est incarné par le Saint Esprit et de la vierge Marie -- il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate -- il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, suivant les Ecritures. -- Il est assis à la droite du Père -- nous croyons aussi au Saint Esprit, Seigneur vivifiant qui procède du Père .
En 431 grand concile d'Ephèse convoqué par l'empereur Théodose. Nestorius évêque de Constantinople ayant persécuté violemment tous ceux qui n'étaient pas de son opinion sur des points de théologie, essuya des persécutions à son tour pour avoir soutenu que la sainte vierge Marie mère de Jésus-Christ n'était point mère de Dieu, parce que, disait-il, Jésus-Christ étant le verbe fils de Dieu, Marie ne pouvait pas être à la fois la mère de Dieu le père et de Dieu le fils. St Cyrille s'éleva hautement contre lui. Nestorius demanda un concile oecuménique; il l'obtint. Nestorius fut condamné, mais Cyrille fut déposé par un comité du concile. L'empereur cassa tout ce qui s'était fait dans ce concile; ensuite permit qu'on se rassemblât. Les députés de Rome arrivèrent fort tard. Les troubles augmentant, l'empereur fit arrêter Nestorius et Cyrille. Enfin, il ordonna à tous les évêques de s'en retourner chacun dans son église, et il n'y eut point de conclusion. Tel fut le fameux concile d'Ephèse.
En 449 grand concile encore à Ephèse, surnommé depuis le brigandage . Les évêques furent au nombre de cent trente. Dioscore évêque d'Alexandrie y présida. Il y eut deux députés de l'Eglise de Rome, et plusieurs abbés de moines. Il s'agissait de savoir si Jésus-Christ avait deux natures. Les évêques et tous les moines d'Egypte s'écrièrent qu' il fallait déchirer en deux tous ceux qui diviseraient en deux Jésus-Christ . Les deux natures furent anathématisées. On se battit en plein concile, ainsi qu'on s'était battu au petit concile de Cirthe en 355, et au petit concile de Carthage.
En 451 grand concile de Calcédoine convoqué par Pulchérie, qui épousa Martien, à condition qu'il ne serait que son premier sujet. St Léon évêque de Rome qui avait un très grand crédit, profitant des troubles que la querelle des deux natures excitait dans l'empire, présida au concile par ses légats; c'est le premier exemple que nous en ayons. Mais les Pères du concile craignant que l'Eglise d'Occident ne prétendît par cet exemple la supériorité sur celle d'Orient, décidèrent par le vingt-huitième canon que le siège de Constantinople et celui de Rome auraient également les mêmes avantages et les mêmes privilèges. Ce fut l'origine de la longue inimitié qui régna et règne encore entre les deux Eglises.
Ce concile de Calcédoine établit les deux natures et une seule personne.
En 553 grand concile à Constantinople, convoqué par Justinien qui se mêlait de théologie. Il s'agissait de trois petits écrits différents qu'on ne connaît plus aujourd'hui. On les appela les trois chapitres . On disputait aussi sur quelques passages d'Origène.
L'évêque de Rome Vigile, voulut y aller en personne, mais Justinien le fit mettre en prison. Le patriarche de Constantinople présida. Il n'y eut personne de l'Eglise latine, parce qu'alors le grec n'était plus entendu dans l'Occident devenu tout à fait barbare.
En 680 encore un concile général à Constantinople, convoqué par l'empereur Constantin le Barbu. C'est le premier concile appelé par les Latins in trullo , parce qu'il fut tenu dans un salon du palais impérial. L'empereur y présida lui-même. A sa droite étaient les patriarches de Constantinople et d'Antioche; à sa gauche les députés de Rome et de Jérusalem. On y décida que Jésus-Christ avait deux volontés. On y condamna le pape Honorius I er comme monothélite, c'est-à-dire, qui voulait que Jésus-Christ n'eût eu qu'une volonté.
En 787 second concile de Nicée, convoqué par Irène sous le nom de l'empereur Constantin son fils, auquel elle fit crever les yeux. Son mari Léon avait aboli le culte des images, comme contraire à la simplicité des premiers siècles; et favorisant l'idolâtrie, Irène le rétablit; elle parla elle-même dans le concile. C'est le seul qui ait été tenu par une femme. Deux légats du pape Adrien IV y assistèrent et ne parlèrent point, parce qu'ils n'entendaient pas le grec: ce fut le patriarche Tarèze qui fit tout.
Sept ans après, les Francs ayant entendu dire qu'un concile à Constantinople avait ordonné l'adoration des images, assemblèrent par l'ordre de Charles fils de Pépin, nommé depuis Charlemagne, un concile assez nombreux à Francfort. On y traita le second concile de Nicée de synode impertinent et arrogant, tenu en Grèce pour adorer des peintures .
En 842 grand concile à Constantinople, convoqué par l'impératrice Théodora. Culte des images solennellement établi. Les Grecs ont encore une fête en l'honneur de ce grand concile, qu'on appelle l' orthodoxie . Théodora n'y présida pas.
En 861 grand concile à Constantinople, composé de trois cent dix-huit évêques, convoqué par l'empereur Michel. On y dépose St Ignace patriarche de Constantinople, et on élut Photius.
En 866 autre grand concile à Constantinople, où le pape Nicolas I er est déposé par contumace et excommunié.
En 869 autre grand concile à Constantinople, où Photius est excommunié et déposé à son tour, et St Ignace rétabli.
En 879 autre grand concile à Constantinople, où Photius déjà rétabli est reconnu pour vrai patriarche par les légats du pape Jean VIII. On y traite de conciliabule le grand concile oecuménique où Photius avait été déposé.
Le pape Jean VIII déclare Judas, tous ceux qui disent que le Saint Esprit procède du Père et du Fils.
En 1123 et 24 grand concile à Rome, tenu dans l'église de St Jean de Latran par le pape Calixte II. C'est le premier concile général que les papes convoquèrent. Les empereurs d'Occident n'avaient presque plus d'autorité, et les empereurs d'Orient pressés par les mahométans et par les croisés, ne tenaient plus que de chétifs petits conciles.
Au reste, on ne sait pas trop ce que c'est que Latran. Quelques petits conciles avaient été déjà convoqués dans Latran. Les uns disent que c'était une maison bâtie par un nommé Latranus du temps de Néron, les autres que c'est l'église de St Jean même bâtie par l'évêque Sylvestre.
Les évêques dans ce concile se plaignirent fortement des moines; Ils possèdent , disent-ils, les églises, les terres, les châteaux, les dîmes, les offrandes des vivants et des morts, il ne leur reste plus qu'à nous ôter la crosse et l'anneau . Les moines restèrent en possession.
En 1139 autre grand concile de Latran par le pape Innocent II; il y avait, dit-on, mille évêques. C'est beaucoup. On y déclara les dîmes ecclésiastiques de droit divin , et on excommunia les laïques qui en possédaient.
En 1179 autre grand concile de Latran par le pape Alexandre III; il y eut trois cent deux évêques latins et un abbé grec. Les décrets furent tous de discipline. La pluralité des bénéfices y fut défendue.
En 1215 dernier concile général de Latran par Innocent III, quatre cent douze évêques, huit cents abbés. Dès ce temps, qui était celui des croisades, les papes avaient établi un patriarche latin à Jérusalem et un à Constantinople. Ces patriarches vinrent au concile. Ce grand concile dit, que Dieu ayant donné aux hommes la doctrine salutaire par Moïse, fit naître enfin son fils d'une vierge pour montrer le chemin plus clairement; que personne ne peut être sauvé hors de l'Eglise catholique .
Le mot de transsubstantiation ne fut connu qu'après ce concile. Il y fut défendu d'établir de nouveaux ordres religieux. Mais depuis ce temps on en a formé quatre-vingts.
Ce fut dans ce concile qu'on dépouilla Raimond comte de Toulouse de toutes ses terres.
En 1245 grand concile à Lyon ville impériale. Innocent IV y mène l'empereur de Constantinople Jean Paléologue qu'il fait asseoir à côté de lui. Il y dépose l'empereur Fréderic II comme félon ; il donne un chapeau rouge aux cardinaux, signe de guerre contre Frédéric. Ce fut la source de trente ans de guerres civiles.
En 1274 autre grand concile à Lyon. Cinq cents évêques, soixante et dix gros abbés et mille petits. L'empereur grec Michel Paléologue, pour avoir la protection du pape, envoie son patriarche grec Théophane, et un évêque de Nicée pour se réunir en son nom à l'Eglise latine. Mais ces évêques sont désavoués par l'Eglise grecque.
En 1311 le pape Clément V indique un concile général dans la petite ville de Vienne en Dauphiné. Il y abolit l'ordre des templiers. On ordonne de brûler les bégares, béguins et béguines, espèce d'hérétiques auxquels on imputait tout ce qu'on avait imputé autrefois aux premiers chrétiens.
En 1414 grand concile de Constance, convoqué enfin par un empereur qui rentre dans ses droits; c'est Sigismond. On y dépose le pape Jean XXIII convaincu de plusieurs crimes. On y brûle Jean Hus et Jérôme de Prague convaincus d'opiniâtreté.
En 1431 grand concile de Bâle, où l'on dépose en vain le pape Eugène IV qui fut plus habile que le concile.
En 1438 grand concile à Ferrare, transféré à Florence, où le pape excommunié excommunie le concile, et le déclare criminel de lèse-majesté. On y fit une réunion feinte avec l'Eglise grecque, écrasée par les synodes turcs qui se tenaient le sabre à la main.
Il ne tint pas au pape Jules II que son concile de Latran en 1512, ne passât pour un concile général oecuménique. Ce pape y excommunia solennellement le roi de France Louis XII, mit la France en interdit, cita tout le parlement de Provence à comparaître devant lui; il excommunia tous les philosophes, parce que la plupart avaient pris le parti de Louis XII. Cependant, ce concile n'a point le titre de brigandage comme celui d'Ephèse.
En 1537 concile de Trente, convoqué d'abord par le pape Paul III à Mantoue, et ensuite à Trente en 1543, terminé en décembre 1563 sous Pie IV. Les princes catholiques le reçurent quant au dogme, et deux ou trois quant à la discipline.
On croit qu'il n'y aura désormais pas plus de conciles généraux qu'il n'y aura d'états généraux en France et en Espagne.
Il y a dans le Vatican un beau tableau qui contient la liste des conciles généraux. On n'y a inscrit que ceux qui sont approuvés par la cour de Rome: chacun met ce qu'il veut dans ses archives.
CONFESSION. [p. 204] ↩
Le repentir de ses fautes peut seul tenir lieu d'innocence. Pour paraître s'en repentir, il faut commencer par les avouer. La confession est donc presque aussi ancienne que la société civile.
On se confessait dans tous les mystères d'Egypte, de Grèce, de Samothrace. Il est dit dans la vie de Marc-Aurèle, que lorsqu'il daigna s'associer aux mystères d'Eleusine, il se confessa à l'hiérophante, quoi qu'il fût l'homme du monde qui eût le moins besoin de confession.
Cette cérémonie pouvait être très salutaire. Elle pouvait aussi être très dangereuse: c'est le sort de toutes les institutions humaines. On sait la réponse de ce Spartiate à qui un hiérophante voulait persuader de se confesser: A qui dois-je avouer mes fautes? est-ce à Dieu ou à toi? c'est à Dieu, dit le prêtre. -- Retire-toi donc, homme. (Plutarque, Dits notables des Lacédémoniens.)
Il est difficile de dire en quel temps cette pratique s'établit chez les Juifs, qui prirent beaucoup de rites de leurs voisins. La Mishna Mishnah tom. II, pag. 394. qui est le recueil des lois juives, dit que souvent on se confessait en mettant la main sur un veau appartenant au prêtre, ce qui s'appelait la confession des veaux .
Mishnah tom. IV, pag. 134. Il est dit dans la même Mishna que tout accusé qui avait été condamné à la mort, s'allait confesser devant témoins dans un lieu écarté, quelques moments avant son supplice. S'il se sentait coupable, il devait dire, Que ma mort expie tous mes péchés . S'il se sentait innocent, il prononçait, Que ma mort expie mes péchés, hors celui dont on m'accuse .
Le jour de la fête que l'on appelait chez les Juifs l' expiation solennelle , Synagogue judaïque , ch. XXXV. les Juifs dévots se confessaient les uns les autres en spécifiant leurs péchés. Le confesseur récitait trois fois treize mots du psaume LXXVII, ce qui fait trente-neuf; et pendant ce temps il donnait trente-neuf coups de fouet au confessé, lequel les lui rendait à son tour; après quoi ils s'en retournaient quitte à quitte. On dit que cette cérémonie subsiste encore.
On venait en foule se confesser à St Jean pour la réputation de sa sainteté, comme on venait se faire baptiser par lui du baptême de justice, selon l'ancien usage; mais il n'est point dit que St Jean donnât trente-neuf coups de fouet à ses pénitents.
La confession alors n'était point un sacrement. Il y en a plusieurs raisons. La première est que le mot de sacrement était alors inconnu: cette raison dispense de déduire les autres. Les chrétiens prirent la confession dans les rites juifs et non pas dans les mystères d'Isis et de Cérès. Les Juifs se confessaient à leurs camarades et les chrétiens aussi. Il parut dans la suite plus convenable que ce droit appartînt aux prêtres. Nul rite, nulle cérémonie ne s'établit qu'avec le temps. Il n'était guère possible qu'il ne restât quelque trace de l'ancien usage des laïques de se confesser les uns aux autres.
Voyez le paragraphe ci-dessous, Si les laïques etc., page 210.
Du temps de Constantin, on confessa d'abord publiquement ses fautes publiques.
Au cinquième siècle après le schisme de Novatus et de Novatien, on établit les pénitenciers pour absoudre ceux qui étaient tombés dans l'idolâtrie. Cette confession aux prêtres pénitenciers fut abolie Socrate liv. V. Sozomène liv. VII. sous l'empereur Théodose. Une femme s'étant accusée tout haut au pénitencier de Constantinople d'avoir couché avec le diacre, cette indiscrétion [27] causa tant de scandale et de trouble dans toute la ville, que Nectarius permit à tous les fidèles de s'approcher de la sainte table sans confession, et de n'écouter que leur conscience pour communier. C'est pourquoi St Jean Chrysostome qui succéda à Nectarius, dit au peuple dans sa cinquième homélie: ‘Confessez-vous continuellement à Dieu; je ne vous produis point sur un théâtre avec vos compagnons de service pour leur découvrir vos fautes. Montrez à Dieu vos blessures, et demandez-lui les remèdes; avouez vos péchés à celui qui ne les reproche point devant les hommes. Vous les céleriez en vain à celui qui connaît toutes choses, etc.'
On prétend que la confession auriculaire ne commença en Occident que vers le septième siècle, et qu'elle fut instituée par les abbés, qui exigèrent que leurs moines vinssent deux fois par an leur avouer toutes leurs fautes. Ce furent ces abbés qui inventèrent cette formule, Je t'absous autant que je peux et que tu en as besoin . Il semble qu'il eût été plus respectueux pour l'Etre suprême, et plus juste, de dire, Puisse-t-il pardonner à tes fautes et aux miennes !
Le bien que la confession a fait, est d'avoir obtenu quelquefois des restitutions de petits voleurs. Le mal est d'avoir quelquefois dans les troubles des Etats, forcé les pénitents à être rebelles et sanguinaires en conscience. Les prêtres guelfes refusaient l'absolution aux gibelins; et les prêtres gibelins se gardaient bien d'absoudre les guelfes.
Le conseiller d'Etat Lénet rapporte dans ses mémoires, que tout ce qu'il put obtenir en Bourgogne pour faire soulever les peuples en faveur du prince de Condé détenu à Vincennes par le Mazarin, fut de lâcher des prêtres dans les confessionnaux . C'est en parler comme de chiens enragés qui pouvaient souffler la rage de la guerre civile dans le secret du confessionnal.
Au siège de Barcelone, les moines refusèrent l'absolution à tous ceux qui restaient fidèles à Philippe V.
Dans la dernière révolution de Gènes, on avertissait toutes les consciences, qu'il n'y avait point de salut pour quiconque ne prendrait pas les armes contre les Autrichiens.
Ce remède salutaire se tourna de tout temps en poison. Les assassins des Sforces, des Médicis, des princes d'Orange, des rois de France, se préparèrent aux parricides par le sacrement de la confession.
Louix XI, la Brinvilliers se confessaient dès qu'ils avaient commis un grand crime; et se confessaient souvent, comme les gourmands prennent médecine pour avoir plus d'appétit.
DE LA RÉVÉLATION PAR LA CONFESSION.
Jaurigny et Baltazar Gérard , assassins du prince d'Orange Guillaume I er , le dominicain Jacques Clément, Jean Châtel, le feuillant Ravaillac et tous les autres parricides de ce temps-là se confessèrent avant de commettre leurs crimes. Le fanatisme dans ces siècles déplorables était parvenu à un tel excès, que la confession n'était qu'un engagement de plus à consommer leur scélératesse: elle devenait sacrée, par cette raison que la confession est un sacrement.
Strada dit lui-même, que Jaurigny non ante facinus aggredi sustinuit quam expiatam noxis animam apud dominicanum sacerdotem coelesti pane firmaverit. Jaurigny n'osa entreprendre cette action sans avoir fortifié par le pain céleste son âme purgée par la confession aux pieds d'un dominicain .
On voit dans l'interrogatoire de Ravaillac que ce malheureux sortant des feuillants et voulant entrer chez les jésuites, s'était adressé au jésuite d'Aubigni; qu'après lui avoir parlé de plusieurs apparitions qu'il avait eues, il montra à ce jésuite un couteau, sur la lame duquel un coeur et une croix étaient gravés, et qu'il dit ces propres mots au jésuite: Ce coeur indique que le coeur du roi doit être porté à faire la guerre aux huguenots .
Peut-être si ce d'Aubigini avait eu assez de zèle et de prudence pour faire instruire le roi de ces paroles, peut-être s'il avait dépeint l'homme qui les avait prononcées, le meilleur des rois n'aurait pas été assassiné.
Le vingtième auguste, ou août, l'année 1610, trois mois après la mort de Henri IV, dont les blessures saignaient dans le coeur de tous les Français, l'avocat général Servin, dont la mémoire est encore illustre, requit qu'on fît signer aux jésuites les quatre articles suivants:
1 o . Que le concile est au-dessus du pape.
2 o . Que le pape ne peut priver le roi d'aucun de ses droits par l'excommunication.
3 o . Que les ecclésiastiques sont entièrement soumis au roi comme les autres.
4 o . Qu'un prêtre qui sait par la confession une conspiration contre le roi et l'Etat, doit la révéler aux magistrats.
Le 22 le parlement rendit un arrêt, par lequel il défendait aux jésuites d'enseigner la jeunesse avant d'avoir signé ces quatre articles. Mais la cour de Rome était alors si puissante, et celle de France si faible, que cet arrêt fut inutile.
Un fait qui mérite d'être observé, c'est que cette même cour de Rome, qui ne voulait pas qu'on révélât la confession, quand il s'agirait de la vie des souverains, obligeait les confesseurs à dénoncer aux inquisiteurs ceux que leurs pénitentes accusaient en confession de les avoir séduites et d'avoir abusé d'elles. Paul IV, Pie IV, Clément VIII, Grégoire XV ordonnèrent ces révélations. [28] C'était un piège bien embarrassant pour les confesseurs et pour les pénitentes. C'était faire d'un sacrement un greffe de délations et même de sacrilèges. Car par les anciens canons, et surtout par le concile de Latran tenu sous Innocent III, tout prêtre qui révèle une confession de quelque nature que ce puisse être, doit être interdit et condamné à une prison perpétuelle.
Mais il y a bien pis; voilà quatre papes au seizième et dix-septième siècles qui ordonnent la révélation d'un péché d'impureté, et qui ne permettent pas celle d'un parricide. Une femme avoue ou suppose dans le sacrement devant un carme qu'un cordelier l'a séduite; le carme doit dénoncer le cordelier. Un assassin fanatique croyant servir Dieu en tuant son prince, vient consulter un confesseur sur ce cas de conscience; le confesseur devient sacrilège s'il sauve la vie à son souverain.
Cette contradiction absurde et horrible est une suite malheureuse de l'opposition continuelle qui règne depuis tant de siècles entre les lois ecclésiastiques et les lois civiles. Le citoyen se trouve pressé dans cent occasions entre le sacrilège et le crime de haute trahison; et les règles du bien et du mal sont ensevelies dans un chaos dont on ne les a pas encore tirées.
La réponse du jésuite Coton à Henri IV durera plus que l'ordre des jésuites. Révéleriez-vous la confession d'un homme résolu de m'assassiner? Non; mais je me mettrais entre vous et lui .
On n'a pas toujours suivi la maxime du père Coton. Il y a dans quelques pays des mystères d'Etat inconnus au public, dans lesquels les révélations des confessions entrent pour beaucoup. On sait par le moyen des confesseurs attitrés les secrets des prisonniers. Quelques confesseurs, pour accorder leur intérêt avec le sacrilège, usent d'un singulier artifice. Ils rendent compte, non pas précisément de ce que le prisonnier leur a dit, mais de ce qu'il ne leur a pas dit. S'ils sont chargés, par exemple, de savoir si un accusé a pour complice un Français ou un Italien, ils disent à l'homme qui les emploie, Le prisonnier m'a juré qu'aucun Italien n'a été informé de ses desseins. De là on juge que c'est le Français soupconné qui est coupable.
L'auteur de cet article a été presque témoin lui-même d'une révélation encore plus forte et plus singulière.
On connaît la trahison que fit Daubenton jésuite, à Philippe V roi d'Espagne, dont il était confesseur. Il crut par une politique très mal entendue, devoir rendre compte des secrets de son pénitent au duc d'Orléans régent du royaume, et eut l'imprudence de lui écrire ce qu'il n'aurait dû confier à personne de vive voix. Le duc d'Orléans envoya sa lettre au roi d'Espagne; le jésuite fut chassé, et mourut quelque temps après. C'est un fait avéré. [29]
On ne laisse pas d'être fort en peine pour décider formellement dans quels cas il faut révéler la confession; car si on décide que c'est pour crime de lèse-majesté humaine, il est aisé d'étendre bien loin ce crime de lèse-majesté, et de le porter jusqu'à la contrebande du sel et des mousselines, attendu que ce délit offense précisément les majestés. A plus forte raison faudra-t-il révéler les crimes de lèse-majesté divine; et cela peut aller jusqu'aux moindres fautes, comme d'avoir manqué vêpres et le salut.
Il serait donc très important de bien convenir des confessions qu'on doit révéler, et de celles qu'on doit taire; mais une telle décision serait encore très dangereuse. Que de choses il ne faut pas approfondir!
Pontas qui décide en trois volumes in-folio de tous les cas possibles de la conscience des Français, et qui est ignoré dans le reste de la terre, dit qu'en aucune occasion on ne doit révéler la confession. Les parlements ont décidé le contraire. A qui croire de Pontas ou des gardiens des lois du royaume, qui veillent sur la vie des rois et sur le salut de l'Etat? [30]
SI LES LAÏQUES ET LES FEMMES ONT ÉTÉ CONFESSEURS ET CONFESSEUSES ?
De même que dans l'ancienne loi les laïques se confessaient les uns aux autres; les laïques dans la nouvelle loi eurent longtemps ce droit par l'usage. Il suffit pour le prouver de citer le célèbre Joinville qui dit expressément, que le connétable de Chypre se confessa à lui, et qu'il lui donna l'absolution selon le droit qu'il en avait .
3 e part. pag. 255. édition de Lyon 1738. St Thomas s'exprime ainsi dans sa Somme: Confessio ex defectu sacerdotis laïco facta sacramentalis est quodam modò. La confession faite à un laïque au défaut d'un prêtre est sacramentale en quelque façon .
Livre LXXVI. tom. XVI, pag. 246. Fleuri, dans son Histoire ecclésiastique , dit, qu'en Espagne, au treizième siècle, les abbesses donnaient l'absolution à leurs religieuses, entendaient leurs confessions, et prêchaient publiquement.
Innocent III n'attaque point cet usage dans sa lettre du 10 décembre 1210.
Tom. II, pag. 453. Ce droit était si ancien qu'on le trouve établi dans les règles de St Basile. Il permet aux abbesses de confesser leurs religieuses conjointement avec un prêtre.
Le père Martène, dans ses Rites de l'Eglise , convient que les Tom. II, pag. 39. abbesses confessèrent longtemps leurs nonnes; mais il ajoute qu'elles étaient si curieuses, qu'on fut obligé de leur ôter ce droit.
L'ex-jésuite nommé Nonotte doit se confesser, et faire pénitence, non pas d'avoir été un des plus grands ignorants qui aient jamais barbouillé du papier, car ce n'est pas un péché; non pas d'avoir appelé du nom d' erreurs des vérités qu'il ne connaissait pas; mais d'avoir calomnié avec la plus stupide insolence l'auteur de cet article, et d'avoir appelé son frère Raca , en niant tous ces faits et beaucoup d'autres dont il ne savait pas un mot. Il s'est rendu coupable de la géhenne du feu ; il faut espérer qu'il demandera pardon à Dieu de ses énormes sottises: nous ne demandons point la mort du pécheur, mais sa conversion.
On a longtemps agité pourquoi trois hommes assez fameux dans cette petite partie du monde où la confession est en usage, sont morts sans ce sacrement. Ce sont le pape Léon X, Pélisson et le cardinal Dubois.
Ce cardinal se fit ouvrir le périnée par le bistouri de la Peironie, mais il pouvait se confesser et communier avant l'opération.
Pélisson protestant jusqu'à l'âge de quarante ans, s'était converti pour être maître des requêtes et pour avoir des bénéfices.
A l'égard du pape Léon X, il était si occupé des affaires temporelles, quand il fut surpris par la mort, qu'il n'eut pas le temps de songer aux spirituelles.
DES BILLETS DE CONFESSION.
Dans les pays protestants on se confesse à Dieu, et dans les pays catholiques aux hommes. Les protestants disent qu'on ne peut tromper Dieu; au lieu qu'on ne dit aux hommes que ce qu'on veut. Comme nous ne traitons jamais la controverse, nous n'entrons point dans cette ancienne dispute. Notre société littéraire est composée de catholiques et de protestants réunis par l'amour des lettres. Il ne faut pas que les querelles ecclésiastiques y sèment la zizanie.
Contentons-nous de la belle réponse de ce Grec qu'un prêtre voulait confesser aux mystères de Cérès: Est-ce à Dieu ou à toi que je dois parler? -- C'est à Dieu. -- Retire-toi donc, ô homme.
En Italie, et dans les pays d'obédience, il faut que tout le monde sans distinction se confesse et communie. Si vous avez par devers vous des péchés énormes, vous avez aussi les grands pénitenciers pour vous absoudre. Si votre confession ne vaut rien, tant pis pour vous. On vous donne à bon compte un reçu imprimé, moyennant quoi vous communiez, et on jette tous les reçus dans un ciboire; c'est la règle.
On ne connaissait point à Paris ces billets au porteur, lorsque vers l'an 1750 un archevêque de Paris imagina d'introduire une espèce de banque spirituelle pour extirper le jansénisme et pour faire triompher la bulle Unigenitus . Il voulut qu'on refusât l'extrême-onction et le viatique à tout malade qui ne remettait pas un billet de confession, signé d'un prêtre constitutionnaire.
C'était refuser les sacrements aux neuf dixièmes de Paris. On lui disait en vain, Songez à ce que vous faites; ou ces sacrements sont nécessaires pour n'être point damné, ou l'on peut être sauvé sans eux avec la foi, l'espérance, la charité, les bonnes oeuvres et les mérites de notre Sauveur. Si l'on peut être sauvé sans ce viatique, vos billets sont inutiles. Si les sacrements sont absolument nécessaires, vous damnez tous ceux que vous en privez; vous faites brûler pendant toute l'éternité six à sept cent mille âmes, supposé que vous viviez assez longtemps pour les enterrer; cela est violent; calmez-vous; et laissez mourir chacun comme il peut.
Il ne répondit point à ce dilemme; mais il persista. C'est une chose horrible d'employer pour tourmenter les hommes la religion qui doit les consoler. Le parlement qui a la grande police, et qui vit la société troublée, opposa, selon la coutume, des arrêts aux mandements. La discipline ecclésiastique ne voulut point céder à l'autorité légale. Il fallut que la magistrature employât la force, et qu'on envoyât des archers pour faire confesser, communier, et enterrer les Parisiens à leur gré.
Dans cet excès de ridicule dont il n'y avait point encore d'exemple, les esprits s'aigrirent; on cabala à la cour, comme s'il s'était agi d'une place de fermier-général, ou de faire disgracier un ministre. Le royaume fut troublé d'un bout à l'autre. Il entre toujours dans une cause des incidents qui ne sont pas du fond: il s'en mêla tant que tous les membres du parlement furent exilés, et que l'archevêque le fut à son tour.
Ces billets de confession auraient fait naître une guerre civile dans les temps précédents; mais dans le nôtre ils ne produisirent heureusement que des tracasseries civiles. L'esprit philosophique qui n'est autre chose que la raison, est devenu chez tous les honnêtes gens le seul antidote dans ces maladies épidémiques.
CONFIANCE EN SOI-MÊME. [p. 213] ↩
Nous tromper dans nos entreprises,
C'est à quoi nous sommes sujets;
Le matin je fais des projets,
Et le long du jour des sottises.
Ces petits vers conviennent assez à un grand nombre de raisonneurs; et c'est une chose assez plaisante de voir un grave directeur d'âmes finir par un procès criminel, conjointement avec un banqueroutier. A ce propos nous réimprimons ici ce petit conte qui est ailleurs, car il est bon qu'il soit partout.
Memnon conçut un jour le projet insensé d'être parfaitement sage. Il n'y a guère d'hommes à qui cette folie n'ait quelquefois passé par la tête. Memnon se dit à lui-même, Pour être très sage, et par conséquent très heureux, il n'y a qu'à être sans passions; et rien n'est plus aisé, comme on sait. Premièrement je n'aimerai jamais de femme; car en voyant une beauté parfaite, je me dirai à moi-même, Ces joues-là se rideront un jour, ces beaux yeux seront bordés de rouge, cette gorge ronde deviendra plate et pendante, cette belle tête deviendra chauve. Or je n'ai qu'à la voir à présent des mêmes yeux dont je la verrai alors; et assurément cette tête ne fera pas tourner la mienne.
En second lieu je serai toujours sobre: j'aurai beau être tenté par la bonne chère, par des vins délicieux, par la séduction de la société; je n'aurai qu'à me représenter les suites des excès, une tête pesante, un estomac embarrassé, la perte de la raison, de la santé, et du temps: je ne mangerai alors que pour le besoin; ma santé sera toujours égale, mes idées toujours pures et lumineuses. Tout cela est si facile, qu'il n'y a aucun mérite à y parvenir.
Ensuite, disait Memnon, il faut penser un peu à ma fortune; mes désirs sont modérés, mon bien est solidement placé sur le receveur général des finances de Ninive; j'ai de quoi vivre dans l'indépendance; c'est là le plus grand des biens. Je ne serai jamais dans la cruelle nécessité de faire ma cour: je n'envierai personne, et personne ne m'enviera. Voilà qui est encore très aisé. J'ai des amis, continuait-il, je les conserverai, puisqu'ils n'auront rien à me disputer. Je n'aurai jamais d'humeur avec eux, ni eux avec moi. Cela est sans difficulté.
Ayant fait ainsi son petit plan de sagesse dans sa chambre, Memnon mit la tête à la fenêtre. Il vit deux femmes qui se promenaient sous des platanes auprès de sa maison. L'une était vieille et paraissait ne songer à rien. L'autre était jeune, jolie, et semblait fort occupée. Elle soupirait, elle pleurait, et n'en avait que plus de grâces. Notre sage fut touché, non pas de la beauté de la dame, (il était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse) mais de l'affliction où il la voyait. Il descendit, il aborda la jeune Ninivienne, dans le dessein de la consoler avec sagesse. Cette belle personne lui conta de l'air le plus naïf et le plus touchant tout le mal que lui faisait un oncle qu'elle n'avait point; avec quels artifices il lui avait enlevé un bien qu'elle n'avait jamais possédé, et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance de venir jusque chez moi, et d'examiner mes affaires, je suis sûre que vous me tireriez du cruel embarras où je suis. Memnon n'hésita pas à la suivre, pour examiner sagement ses affaires, et pour lui donner un bon conseil.
La dame affligée le mena dans une chambre parfumée, et le fit asseoir avec elle poliment sur un large sofa, où ils se tenaient tous deux les jambes croisées vis-à-vis l'un de l'autre. La dame parla en baissant les yeux, dont il échappait quelquefois des larmes, et qui en se relevant rencontraient toujours les regards du sage Memnon. Ses discours étaient pleins d'un attendrissement qui redoublait toutes les fois qu'ils se regardaient. Memnon prenait ses affaires extrêmement à coeur, et se sentait de moment en moment la plus grande envie d'obliger une personne si honnête et si malheureuse. Ils cessèrent insensiblement, dans la chaleur de la conversation, d'être vis-à-vis l'un de l'autre. Leurs jambes ne furent plus croisées. Memnon la conseilla de si près, et lui donna des avis si tendres, qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre parler d'affaires, et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient.
Comme ils en étaient là, arrive l'oncle, ainsi qu'on peut bien le penser: Il était armé de la tête aux pieds; et la première chose qu'il dit, fut qu'il allait tuer, comme de raison, le sage Memnon et sa niéce; la dernière qui lui échappa fut qu'il pouvait pardonner pour beaucoup d'argent. Memnon fut obligé de donner tout ce qu'il avait. On était heureux dans ce temps-là d'en être quitte à si bon marché; l'Amérique n'était pas encore découverte; et les dames affligées n'étaient pas à beaucoup près si dangereuses qu'elles le sont aujourd'hui.
Memnon honteux et désespéré rentra chez lui: il y trouva un billet qui l'invitait à dîner avec quelques-uns de ses intimes amis. Si je reste seul chez moi, dit-il, j'aurai l'esprit trop occupé de ma triste aventure, je ne mangerai point, je tomberai malade. Il vaut mieux aller faire avec mes amis intimes un repas frugal. J'oublierai dans la douceur de leur société la sottise que j'ai faite ce matin. Il va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin. On le fait boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin pris modérément est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pense le sage Memnon; et il s'enivre. On lui propose de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joue; on lui gagne tout ce qu'il a dans sa bourse, et quatre fois autant sur sa parole. Une dispute s'élève sur le jeu, on s'échauffe: l'un de ses amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui crève un oeil. On rapporte chez lui le sage Memnon, ivre, sans argent, et ayant un oeil de moins.
Il cuve un peu son vin; et dès qu'il a la tête plus libre, il envoie son valet chercher de l'argent chez le receveur général des finances de Ninive, pour payer ses intimes amis: on lui dit que son débiteur a fait le matin une banqueroute frauduleuse qui met en alarme cent familles. Memnon outré va à la cour avec un emplâtre sur l'oeil et un placet à la main, pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il rencontra dans un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un air aisé des cerceaux de vingt-quatre pieds de circonférence. L'une d'elles qui le connaissait un peu, dit en le regardant de côté: Ah l'horreur! Une autre qui le connaissait davantage lui dit, Bonsoir, monsieur Memnon; mais vraiment, Monsieur Memnon, je suis fort aise de vous voir; à propos, monsieur Memnon, pourquoi avez-vous perdu un oeil? Et elle passa sans attendre sa réponse. Memnon se cacha dans un coin, et attendit le moment où il pût se jeter aux pieds du monarque. Ce moment arriva. Il baisa trois fois la terre, et présenta son placet. Sa gracieuse majesté le reçut très favorablement, et donna le mémoire à un de ses satrapes pour lui en rendre compte. Le satrape tire Memnon à part, et lui dit d'un air de hauteur en ricanant amèrement, Je vous trouve un plaisant borgne, de vous adresser au roi plutôt qu'à moi; et encore plus plaisant d'oser me demander justice contre un honnête banqueroutier, que j'honore de ma protection, et qui est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire-là, mon ami, si vous voulez conserver l'oeil qui vous reste.
Memnon ayant ainsi renoncé le matin aux femmes, aux excès de table, au jeu, à toute querelle, et surtout à la cour, avait été avant la nuit trompé et volé par une belle dame, s'était enivré, avait joué, avait eu une querelle, s'était fait crever un oeil, et avait été à la cour où l'on s'était moqué de lui.
Pétrifié d'étonnement, et navré de douleur, il s'en retourne la mort dans le coeur. Il veut rentrer chez lui; il y trouve des huissiers qui démeublaient sa maison de la part de ses créanciers. Il reste presque évanoui sous une platane; il y rencontre la belle dame du matin qui se promenait avec son cher oncle, et qui éclata de rire en voyant Memnon avec son emplâtre. La nuit vint; Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison. La fièvre le saisit; il s'endormit dans l'accès; et un esprit céleste lui apparut en songe.
Il était tout resplendissant de lumière. Il avait six belles ailes; mais ni pieds, ni tête, ni queue, et ne ressemblait à rien. Qui es-tu? lui dit Memnon; Ton bon génie, lui répondit l'autre. Rends-moi donc mon oeil, ma santé, mon bien, ma sagesse, lui dit Memnon. Ensuite il lui conta comment il avait perdu tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous arrivent jamais dans le monde que nous habitons, dit l'esprit. Et quel monde habitez-vous? dit l'homme affligé. Ma patrie, répondit-il, est à cinq cent millions de lieues du soleil, dans une petite étoile auprès de Sirius, que tu vois d'ici. Le beau pays! dit Memnon: quoi! vous n'avez point chez vous de coquines qui trompent un pauvre homme, point d'amis intimes qui lui gagnent son argent et qui lui crèvent un oeil, point de banqueroutiers, point de satrapes qui se moquent de vous en vous refusant justice? Non, dit l'habitant de l'étoile, rien de tout cela. Nous ne sommes jamais trompés par les femmes, parce que nous n'en avons point; nous ne faisons point d'excès de table, parce que nous ne mangeons point; nous n'avons point de banqueroutiers, parce qu'il n'y a chez nous ni or ni argent; on ne peut pas nous crever les yeux, parce que nous n'avons point de corps à la façon des vôtres; et les satrapes ne nous font jamais d'injustice, parce que dans notre petite étoile tout le monde est égal.
Memnon lui dit alors, Monseigneur sans femme et sans dîner, à quoi passez-vous votre temps? A veiller, dit le génie, sur les autres globes qui nous sont confiés: et je viens pour te consoler. Hélas! reprit Memnon, que ne veniez-vous la nuit passée, pour m'empêcher de faire tant de folies? J'étais auprès d'Assan ton frère aîné, dit l'être céleste. Il est plus à plaindre que toi. Sa gracieuse majesté le roi des Indes, à la cour duquel il a l'honneur d'être, lui a fait crever les deux yeux pour une petite indiscrétion, et il est actuellement dans un cachot les fers aux pieds et aux mains. C'est bien la peine, dit Memnon, d'avoir un bon génie dans une famille, pour que de deux frères l'un soit borgne, l'autre aveugle, l'un couché sur la paille, l'autre en prison. Ton sort changera, reprit l'animal de l'étoile. Il est vrai que tu seras toujours borgne, mais, à cela près, tu seras assez heureux, pourvu que tu ne fasses jamais le sot projet d'être parfaitement sage. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir? s'écria Memnon en soupirant. Aussi impossible, lui répliqua l'autre, que d'être parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement puissant, parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous en sommes bien loin. Il y a un globe où tout cela se trouve; mais dans les cent mille millions de mondes qui sont dispersés dans l'étendue, tout se suit par degrés. On a moins de sagesse et de plaisirs dans le second que dans le premier, moins dans le troisième que dans le second. Ainsi du reste jusqu'au dernier, où tout le monde est complètement fou. J'ai bien peur, dit Memnon, que notre petit globe terraquée ne soit précisément les Petites-Maisons de l'univers dont vous me faites l'honneur de me parler. Pas tout à fait, dit l'esprit; mais il en approche: il faut que tout soit en sa place. Eh mais, certains poètes, certains philosophes, ont donc grand tort de dire, Que tout est bien . Ils ont grande raison, dit le philosophe de là-haut, en considérant l'arrangement de l'univers entier. Ah! je ne croirai cela, répliqua le pauvre Memnon, que quand je ne serai plus borgne.
CONFISCATION. [p. 218] ↩
On a très bien remarqué dans le Dictionnaire encyclopédique, à l'article Confiscation , que le fisc soit public, soit royal, soit seigneurial, soit impérial, soit déloyal, était un petit panier de jonc ou d'osier, dans lequel on mettait autrefois le peu d'argent qu'on avait pu recevoir ou extorquer. Nous nous servons aujourd'hui de sacs; le fisc royal est le sac royal.
C'est une maxime reçue dans plusieurs pays de l'Europe, que qui confisque le corps, confisque les biens. Cet usage est surtout établi dans les pays où la coutume tient lieu de loi; et une famille entière est punie dans tous les cas pour la faute d'un seul homme.
Confisquer le corps n'est pas mettre le corps d'un homme dans le panier de son seigneur suzerain; c'est dans le langage barbare du barreau, se rendre maître du corps d'un citoyen, soit pour lui ôter la vie, soit pour le condamner à des peines aussi longues que sa vie: on s'empare de ses biens si on le fait périr, ou s'il évite la mort par la fuite.
Ainsi, ce n'est pas assez de faire mourir un homme pour ses fautes, il faut encore faire mourir de faim ses héritiers.
La rigueur de la coutume confisque dans plus d'un pays les biens d'un homme qui s'est arraché volontairement aux misères de cette vie; et ses enfants sont réduits à la mendicité parce que leur père est mort.
Dans quelques provinces catholiques romaines on condamne aux galères perpétuelles, par une sentence arbitraire, un père de famille, [31] soit pour avoir donné retraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son sermon dans quelques cavernes, ou dans quelque désert: alors la femme et les enfants sont réduits à mendier leur pain.
Cette jurisprudence qui consiste à ravir la nourriture aux orphelins, et à donner à un homme le bien d'autrui, fut inconnue dans tout le temps de la république romaine. Sylla l'introduisit dans ses proscriptions. Il faut avouer qu'une rapine inventée par Sylla n'était pas un exemple à suivre. Aussi cette loi qui semblait n'être dictée que par l'inhumanité et l'avarice, ne fut suivie ni par César, ni par le bon empereur Trajan, ni par les Antonins, dont toutes les nations prononcent encore le nom avec respect et avec amour. Enfin, sous Justinien, la confiscation n'eut lieu que pour le crime de lèse-majesté.
Il semble que dans les temps de l'anarchie féodale, les princes et les seigneurs des terres étant très peu riches, cherchassent à augmenter leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et qu'on voulut leur faire un revenu du crime. Les lois chez eux étant arbitraires, et la jurisprudence romaine ignorée, les coutumes ou bizarres ou cruelles prévalurent. Mais aujourd'hui que la puissance des souverains est fondée sur des richesses immenses et assurées, leur trésor n'a pas besoin de s'enfler des faibles débris d'une famille malheureuse. Ils sont abandonnés pour l'ordinaire au premier qui les demande. Mais est-ce à un citoyen à s'engraisser des restes du sang d'un autre citoyen?
La confiscation n'est point admise dans les pays où le droit romain est établi, excepté le ressort du parlement de Toulouse. Elle ne l'est point dans quelques pays coutumiers, comme le Bourbonnais, le Berri, le Maine, le Poitou, la Bretagne, où au moins elle respecte les immeubles. Elle était établie autrefois à Calais, et les Anglais l'abolirent lorsqu'ils en furent les maîtres. Il est assez étrange que les habitants de la capitale vivent sur une loi plus rigoureuse que ceux de ces petites villes: tant il est vrai que la jurisprudence a été souvent établie au hasard, sans régularité, sans uniformité, comme on bâtit des chaumières dans un village.
Voici comment l'avocat général Omer Talon parla en plein parlement dans le plus beau siècle de la France, en 1673, au sujet des biens d'une demoiselle de Canillac qui avaient été confisqués. Lecteur, faites attention à ce discours; il n'est pas dans le style des oraisons de Cicéron; mais il est curieux. [32]
EXTRAIT DU PLAIDOYER DE L'AVOCAT-GÉNÉRAL TALON SUR DES BIENS CONFISQUÉS.
Au chap. XIII du Deutéronome, Dieu dit, ‘Si tu te rencontres dans une ville, et dans un lieu où règne l'idolâtrie, mets tout au fil de l'épée, sans exception d'âge, de sexe ni de condition. Rassemble dans les places publiques toutes les dépouilles de la ville, brûle-la tout entière avec ses dépouilles, et qu'il ne reste qu'un monceau de cendres de ce lieu d'abomination. En un mot, fais-en un sacrifice au Seigneur, et qu'il ne demeure rien en tes mains des biens de cet anathème.
‘Ainsi, dans le crime de lèse-majesté le roi était maître des biens, et les enfants en étaient privés. Le procès ayant été fait à Naboth quia maledixerat regi , le roi Achab se mit en possession de son héritage. David étant averti que Miphibozeth s'était engagé dans la rébellion, donna tous ses biens à Siba qui lui en apporta la nouvelle: tua sint omnia quae fuerunt Miphibozeth .'
Il s'agit de savoir qui héritera des biens de Mlle de Canillac, biens autrefois confisqués sur son père, abandonnés par le roi à un garde du trésor royal, et donnés ensuite par le garde du trésor royal à la testatrice. Et c'est sur ce procès d'une fille d'Auvergne qu'un avocat général s'en rapporte à Achab roitelet d'une partie de la Palestine, qui confisqua la vigne de Naboth après avoir assassiné le propriétaire par le poignard de la justice juive; action abominable qui est passée en proverbe, pour inspirer aux hommes l'horreur de l'usurpation. Assurément la vigne de Naboth n'avait aucun rapport avec l'héritage de Mlle de Canillac. Le meurtre et la confiscation des biens de Miphibozeth, petit-fils du roi Saul, et fils de Jonathas ami et protecteur de David, n'ont pas une plus grande affinité avec le testament de cette demoiselle.
C'est avec cette pédanterie, avec cette démence de citations étrangères au sujet, avec cette ignorance des premiers principes de la nature humaine, avec ces préjugés mal conçus et mal appliqués, que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui ont eu de la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire ce qu'il est superflu qu'on leur dise.
CONSCIENCE. [p. 221] ↩
SECTION PREMIÈRE.
De la conscience du bien & du mal.
Locke a démontré, (s'il est permis de se servir de ce terme en morale et en métaphysique) que nous n'avons ni idées innées, ni principes innés; et il a été obligé de le démontrer trop au long, parce qu'alors cette erreur était universelle.
De là il suit évidemment que nous avons le plus grand besoin qu'on nous mette de bonnes idées et de bons principes dans la tête, dès que nous pouvons faire usage de la faculté de l'entendement.
Locke apporte l'exemple des sauvages qui tuent et qui mangent leur prochain sans aucun remords de conscience; et des soldats chrétiens bien élevés qui dans une ville prise d'assaut pillent, égorgent, violent non seulement sans remords, mais avec un plaisir charmant, avec honneur et gloire, avec les applaudissements de tous leurs camarades.
Il est très sûr que dans les massacres de la St Barthélemi, et dans les autos-da-fé , dans les saints actes de foi de l'Inquisition, nulle conscience de meurtrier ne se reprocha jamais d'avoir massacré hommes, femmes, enfants, d'avoir fait crier, évanouir, mourir dans les tortures des malheureux qui n'avaient d'autres crimes que de faire la pâque différemment des inquisiteurs.
Il résulte de tout cela que nous n'avons point d'autre conscience que celle qui nous est inspirée par le temps, par l'exemple, par notre tempérament, par nos réflexions.
L'homme n'est né avec aucun principe, mais avec la faculté de les recevoir tous. Son tempérament le rendra plus enclin à la cruauté ou à la douceur; son entendement lui fera comprendre un jour que le carré de douze est cent quarante-quatre, qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fît; mais il ne comprendra pas de lui-même ces vérités dans son enfance: il n'entendra pas la première, et il ne sentira pas la seconde.
Un petit sauvage qui aura faim, et à qui son père aura donné un morceau d'un autre sauvage à manger, en demandera autant le lendemain, sans imaginer qu'il ne faut pas traiter son prochain autrement qu'on ne voudrait être traité soi-même. Il fait machinalement, invinciblement tout le contraire de ce que cette éternelle vérité enseigne.
La nature a pourvu à cette horreur; elle a donné à l'homme la disposition à la pitié et le pouvoir de comprendre la vérité. Ces deux présents de Dieu sont le fondement de la société civile. C'est ce qui fait qu'il y a toujours eu peu d'anthropophages; c'est ce qui rend la vie un peu tolérable chez les nations civilisées. Les pères et les mères donnent à leurs enfants une éducation qui les rend bientôt sociables; et cette éducation leur donne une conscience.
Une religion pure, une morale pure, inspirées de bonne heure, façonnent tellement la nature humaine, que depuis environ sept ans jusqu'à seize ou dix-sept, on ne fait pas une mauvaise action sans que la conscience en fasse un reproche. Ensuite viennent les violentes passions qui combattent la conscience et qui l'étouffent quelquefois. Pendant le conflit les hommes tourmentés par cet orage, consultent en quelques occasions d'autres hommes, comme dans leurs maladies ils consultent ceux qui ont l'air de se bien porter.
C'est ce qui a produit des casuistes, c'est-à-dire, des gens qui décident des cas de conscience. Un des plus sages casuistes a été Cicéron dans son livre des Offices , c'est-à-dire, des devoirs de l'homme. Il examine les points les plus délicats; mais longtemps avant lui Zoroastre avait paru régler la conscience par le plus beau des préceptes: Dans le doute si une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi . Porte XXX. Nous en parlons ailleurs.
SECTION SECONDE.
Conscience. Si un juge doit juger selon la conscience ou selon les preuves.
Thomas d'Aquin, vous êtes un grand saint, un grand théologien; et il n'y a point de dominicain qui ait pour vous plus de vénération que moi. Mais vous avez décidé dans votre Somme, qu'un juge doit donner sa voix selon les allégations et les prétendues preuves contre un accusé, dont l'innocence lui est parfaitement connue. Vous prétendez que les dépositions des témoins qui ne peuvent être que fausses, les preuves résultantes du procès qui sont impertinentes, doivent l'emporter sur le témoignage de ses yeux mêmes. Il a vu commettre le crime par un autre; et, selon vous, il doit en conscience condamner l'accusé quand sa conscience lui dit que cet accusé est innocent.
Il faudrait donc, selon vous, que si le juge lui-même avait commis le crime dont il s'agit, sa conscience l'obligeât de condamner l'homme faussement accusé de ce même crime.
En conscience, grand saint, je crois que vous vous êtes trompé de la manière la plus absurde et la plus horrible: c'est dommage qu'en possédant si bien le droit canon, vous ayez si mal connu le droit naturel. Le premier devoir d'un magistrat est d'être juste avant d'être formaliste: si en vertu des preuves qui ne sont jamais que des probabilités, je condamnais un homme dont l'innocence me serait démontrée, je me croirais un sot et un assassin.
Heureusement tous les tribunaux de l'univers pensent autrement que vous. Je ne sais pas si Farinacius et Grillandus sont de votre avis. Quoi qu'il en soit, si vous rencontrez Cicéron, Ulpien, Tribonien, Dumoulin, le chancelier de l'Hôpital, le chancelier d'Aguesseau, demandez-leur bien pardon de l'erreur où vous êtes tombé.
SECTION TROISIÉME.
De la conscience trompeuse.
Ce qu'on a peut-être jamais dit de mieux sur cette question importante, se trouve dans le livre comique de Tristam Shandy , écrit par un curé nommé Sterne, le second Rabelais d'Angleterre; il ressemble à ces petites satires de l'antiquité qui renfermaient des essences précieuses.
Deux vieux capitaines à demi-paie, assistés du docteur Slop, font les questions les plus ridicules. Dans ces questions, les théologiens de France ne sont pas épargnés. On insiste particulièrement sur un mémoire présenté à la Sorbonne par un chirurgien qui demande la permission de baptiser les enfants dans le ventre de leurs mères, au moyen d'une canule qu'il introduira proprement dans l'utérus, sans blesser la mère ni l'enfant.
Enfin, ils se font lire par un caporal un ancien sermon sur la conscience, composé par ce même curé Sterne.
Parmi plusieurs peintures, supérieures à celles de Rimbran et aux crayons de Calot, il peint un honnête homme du monde passant ses jours dans les plaisirs de la table, du jeu et de la débauche, ne faisant rien que la bonne compagnie puisse lui reprocher, et par conséquent ne se reprochant rien. Sa conscience et son honneur l'accompagnent aux spectacles, au jeu, et surtout lorsqu'il paie libéralement la fille qu'il entretient. Il punit sévèrement quand il est en charge les petits larcins du commun peuple; il vit gaiement, et meurt sans le moindre remords.
Le docteur Slop interrompt le lecteur pour dire que cela est impossible dans l'Eglise anglicane, et ne peut arriver que chez des papistes.
Enfin, le curé Sterne cite l'exemple de David qui a, dit-il, tantôt une conscience délicate et éclairée, tantôt une conscience très dure et très ténébreuse.
Lorsqu'il peut tuer son roi dans une caverne, il se contente de lui couper un pan de sa robe: voilà une conscience délicate. Il passe une année entière sans avoir le moindre remords de son adultère avec Betzabé et du meurtre d'Urie: voilà la même conscience endurcie, et privée de lumière.
Tels sont, dit-il, la plupart des hommes. Nous avouons à ce curé que les grands du monde sont très souvent dans ce cas; le torrent des plaisirs et des affaires les entraîne; ils n'ont pas le temps d'avoir de la conscience, cela est bon pour le peuple; encore n'en a-t-il guère quand il s'agit de gagner de l'argent. Il est donc très bon de réveiller souvent la conscience des couturières et des rois par une morale qui puisse faire impression sur eux; mais pour faire cette impression, il faut mieux parler qu'on ne parle aujourd'hui.
SECTION QUATRIÉME.
Conscience: Liberté de conscience. (traduit de l'allemand.)
( Nous n'adoptons pas tout ce paragraphe; mais comme il y a quelques vérités, nous n'avons pas cru devoir l'omettre, et nous ne nous chargeons pas de justifier ce qui peut s'y trouver de peu mesuré et de trop dur .)
L'aumònier du prince de . . . lequel prince est catholique romain, menaçait un anabaptiste de le chasser des petits Etats du prince; il lui disait qu'il n'y a que trois sectes autorisées dans l'empire; que pour lui anabaptiste qui était d'une quatrième, il n'était pas digne de vivre dans les terres de monseigneur: et enfin, la conversation s'échauffant, l'aumônier menaça l'anabaptiste de le faire pendre. Tant pis pour son altesse, répondit l'anabaptiste; je suis un gros manufacturier; j'emploie deux cents ouvriers, je fais entrer deux cent mille écus par an dans ses Etats; ma famille ira s'établir ailleurs; monseigneur y perdra.
Et si monseigneur fait pendre tes deux cents ouvriers et ta famille? reprit l'aumônier; et s'il donne ta manufacture à de bons catholiques?
Je l'en défie, dit le vieillard; on ne donne pas une manufacture comme une métairie, parce qu'on ne donne pas l'industrie: cela serait beaucoup plus fou que s'il faisait tuer tous ses chevaux, parce que l'un d'eux t'aura jeté par terre, et que tu es un mauvais écuyer.
L'intérêt de monseigneur n'est pas que je mange du pain sans levain ou levé. Il est que je procure à ses sujets de quoi manger, et que j'augmente ses revenus par mon travail. Je suis honnête homme; et quand j'aurais le malheur de n'être pas né tel, ma profession me forcerait à le devenir; car dans les entreprises de négoce, ce n'est pas comme dans celles de cour et dans les tiennes: point de succès sans probité. Que t'importe que j'aie été baptisé dans l'âge qu'on appelle de raison, tandis que tu l'as été sans le savoir? que t'importe que j'adore Dieu à la manière de mes pères? Si tu suivais tes belles maximes, et si tu avais la force en main, tu irais donc d'un bout de l'univers à l'autre, faisant pendre à ton plaisir le Grec qui ne croit pas que l'Esprit procède du Père et du Fils; tous les Anglais, tous les Hollandais, Danois, Suédois, Islandais, Prussiens, Hanovriens, Saxons, Holstenois, Hessois, Virtembergeois, Bernois, Hambourgeois, Cosaques, Valaques, Grecs, Russes, qui ne croient pas le pape infaillible; tous les musulmans qui croient un seul Dieu; et les Indiens dont la religion est plus ancienne que la juive; et les lettrés chinois qui depuis quatre mille ans servent un Dieu unique sans superstition, et sans fanatisme! Voilà donc ce que tu ferais si tu étais le maître! Assurément, dit le moine; car je suis dévoré du zèle de la maison du Seigneur. Zelus domus suae comedit me .
Ça, dis-moi un peu, cher aumônier, repartit l'anabaptiste, es-tu dominicain ou jésuite, ou diable? Je suis jésuite, dit l'autre. Eh mon ami, si tu n'es pas diable, pourquoi dis-tu des choses si diaboliques?
C'est que le révérend père recteur m'a ordonné de les dire.
Et qui a ordonné cette abomination au révérend père recteur?
C'est le provincial.
De qui le provincial a-t-il reçu cet ordre?
De notre général; et le tout pour plaire à un plus grand seigneur que lui.
Dieux de la terre qui avec trois doigts avez trouvé le secret de vous rendre maîtres d'une grande partie du genre humain; si dans le fond du coeur vous avouez que vos richesses et votre puissance ne sont point essentielles à votre salut et au nôtre, jouissez-en avec modération. Nous ne voulons pas vous démîtrer, vous détiarer: mais ne nous écrasez pas. Jouissez et laissez-nous paisibles; démêlez vos intérêts avec les rois; et laissez-nous nos manufactures.
CONSEILLER OU JUGE. [p. 227] ↩
BARTOLOMÉ.
Quoi! il n'y a que deux ans que vous étiez au collège, et vous voilà déjà conseiller de la cour de Naples?
GERONIMO.
Oui, c'est un arrangement de famille; il m'en a peu coûté.
BARTOLOMÉ.
Vous êtes donc devenu bien savant depuis que je ne vous ai vu?
GERONIMO.
Je me suis quelquefois fait inscrire dans l'école de droit, où l'on m'apprenait que le naturel est commun aux hommes et aux bêtes, et que le droit des gens n'est que pour les gens. On me parlait de l'édit du préteur, et il n'y a plus de préteur; des fonctions des édiles, et il n'y a plus d'édiles; du pouvoir des maîtres sur les esclaves, et il n'y a plus d'esclaves. Je ne sais presque rien des lois de Naples, et me voilà juge.
BARTOLOMÉ.
Ne tremblez-vous pas d'être chargé de décider du sort des familles, et ne rougissez-vous pas d'être si ignorant?
GERONIMO.
Si j'étais savant, je rougirais peut-être davantage. J'entends dire aux savants que presque toutes les lois se contredisent, que ce qui est juste à Gayette est injuste à Otrante, que dans la même juridiction on perd à la seconde chambre le même procès qu'on gagne à la troisième. J'ai toujours dans l'esprit ce beau discours d'un avocat vénitien, Illustrissimi signori, l'anno passato avete judicao cosi ; e questo anno nella medesima lite avete judicao tutto il contrario ; e sempre ben !
Le peu que j'ai lu de nos lois m'a paru souvent très embrouillé. Je crois que si je les étudiais pendant quarante ans, je serais embarrassé pendant quarante ans: cependant je les étudie; mais je pense qu'avec du bon sens et de l'équité, on peut être un très bon magistrat, sans être profondément savant. Je ne connais point de meilleur juge que Sancho Pança: cependant il ne savait pas un mot du code de l'île Balataria. Je ne chercherai point à accorder ensemble Cujas et Camille Descurtis, ils ne sont point mes législateurs. Je ne connais de lois que celles qui ont la sanction du souverain. Quand elles seront claires, je les suivrai à la lettre; quand elles seront obscures, je suivrai les lumières de ma raison, qui sont celles de ma conscience.
BARTOLOMÉ.
Vous me donnez envie d'être ignorant, tant vous raisonnez bien. Mais comment vous tirerez-vous des affaires d'Etat, de finance, et de commerce?
GERONIMO.
Dieu merci, nous ne nous en mêlons guère à Naples. Une fois le marquis de Carpi notre vice-roi voulut nous consulter sur les monnaies; nous parlâmes de l' aes grave des Romains, et les banquiers se moquèrent de nous. On nous assembla dans un temps de disette pour régler le prix du blé; nous fûmes assemblés six semaines, et on mourait de faim. On consulta enfin deux forts laboureurs, et deux bons marchands de blé; et il y eut dès le lendemain plus de pain au marché qu'on n'en voulait.
Chacun doit se mêler de son métier; le mien est de juger les contestations, et non pas d'en faire naître; mon fardeau est assez grand.
CONSÉQUENCE. [p. 228] ↩
Quelle est donc notre nature, et qu'est-ce que notre chétif esprit? Quoi! l'on peut tirer les conséquences les plus justes, les plus lumineuses, et n'avoir pas le sens commun? Cela n'est que trop vrai. Le fou d'Athènes qui croyait que tous les vaisseaux qui abordaient au Pirée lui appartenaient, pouvait calculer merveilleusement combien valait le chargement de ces vaisseaux, et en combien de jours ils pouvaient arriver de Smyrne au Pirée.
Nous avons vu des imbéciles qui ont fait des calculs et des raisonnements bien plus étonnants. Ils n'étaient donc pas imbéciles? me dites-vous. Je vous demande pardon, ils l'étaient. Ils posaient tout leur édifice sur un principe absurde; ils enfilaient régulièrement des chimères. Un homme peut marcher très bien et s'égarer, et alors mieux il marche et plus il s'égare.
Le Fo des Indiens eut pour père un éléphant qui daigna faire un enfant à une princesse Indienne, laquelle accoucha du dieu Fo par le côté gauche. Cette princesse était la propre soeur d'un empereur des Indes: donc Fo était le neveu de l'empereur; et les petits-fils de l'éléphant et du monarque étaient cousins issus de germain; donc selon les lois de l'Etat la race de l'empereur étant éteinte, ce sont les descendants de l'éléphant qui doivent succéder. Le principe reçu, on ne peut mieux conclure.
Il est dit que l'éléphant divin était haut de neuf pieds de roi. Tu présumes avec raison que la porte de son écurie devait avoir plus de neuf pieds, afin qu'il pût y entrer à son aise. Il mangeait cinquante livres de riz par jour, vingt-cinq livres de sucre, et buvait vingt-cinq livres d'eau. Tu trouves par ton arithmétique qu'il avalait trente-six mille cinq cents pesant par année; on ne peut compter mieux. Mais ton éléphant a-t-il existé? était-il beau-frère de l'empereur? sa femme a-t-elle fait un enfant par le côté gauche? C'est-là ce qu'il fallait examiner; vingt auteurs qui vivaient à la Cochinchine l'ont écrit l'un après l'autre; tu devais confronter ces vingt auteurs, peser leurs témoignages, consulter les anciennes archives, voir s'il est question de cet éléphant dans les registres; examiner si ce n'est point une fable que des imposteurs ont eu intérêt d'accréditer. Tu es parti d'un principe extravagant pour en tirer des conclusions justes.
C'est moins la logique qui manque aux hommes que la source de la logique. Il ne s'agit pas de dire, Six vaisseaux qui m'appartiennent sont chacun de deux cents tonneaux, le tonneau est de deux mille livres pesant; donc j'ai douze cent mille livres de marchandises au port du Pirée. Le grand point est de savoir si ces vaisseaux sont à toi. Voilà le principe dont ta fortune dépend; tu compteras après. Voyez Principe .
Un ignorant, fanatique et conséquent, est souvent un homme à étouffer. Il aura lu que Phinée transporté d'un saint zèle, ayant trouvé un Juif couché avec une Madianite, les tua tous deux, et fut imité par les lévites qui massacrèrent tous les ménages moitié madianites, moitié juifs. Il sait que son voisin catholique couche avec sa voisine huguenote; il les tuera tous deux sans difficulté: on ne peut agir plus conséquemment. Quel est le remède à cette maladie horrible de l'âme? C'est d'accoutumer de bonne heure les enfants à ne rien admettre qui choque la raison, à ne leur conter jamais d'histoires de revenants, de fantômes, de sorciers, de possédés, de prodiges ridicules. Une fille d'une imagination tendre et sensible, entend parler de possessions; elle tombe dans une maladie de nerfs, elle a des convulsions, elle se croit possédée. J'en ai vu mourir une de la révolution que ces abominables histoires avaient faite dans ses organes. Voyez Esprit faux , et Fanatique .
CONSPIRATIONS CONTRE LESPEUPLES, OU PROSCRIPTIONS. [p. 230] ↩
Il y a des choses qu'il faut sans cesse mettre sous les yeux des hommes. Ayant retrouvé ce morceau qui intéresse l'humanité entière, nous avons cru que c'était ici sa place, d'autant plus qu'il y a quelques additions.
CONSPIRATIONS OU PROSCRIPTIONS JUIVES.
L'histoire est pleine de conspirations contre les tyrans; mais nous ne parlerons ici que des conspirations des tyrans contre les peuples. Si l'on remonte à la plus haute antiquité reçue parmi nous, si l'on ose chercher les premiers exemples des proscriptions dans l'histoire des Juifs; si nous séparons ce qui peut appartenir aux passions humaines, de ce que nous devons révérer dans les décrets éternels; si nous ne considérons que l'effet terrible d'une cause divine, nous trouverons d'abord une proscription de vingt-trois mille Juifs après l'idolâtrie d'un veau d'or; une de vingt-quatre mille pour punir l'Israélite qu'on avait surpris dans les bras d'une Madianite; une de quarante-deux mille hommes de la tribu d'Ephraïm, égorgés à un gué du Jourdain. C'était une vraie proscription; car ceux de Galaad qui exerçaient la vengeance de Jephté contre les éphraïmites, voulaient connaître et démêler leurs victimes en leur faisant prononcer l'un après l'autre le mot schibolet au passage de la rivière; et ceux qui disaient sibolet , selon la prononciation éphraïmite, étaient reconnus et tués sur le champ. Mais il faut considérer que cette tribu d'Ephraïm ayant osé s'opposer à Jephté, choisi par Dieu même pour être le chef de son peuple, méritait sans doute un tel châtiment.
C'est pour cette raison que nous ne regardons point comme une injustice l'extermination entière des peuples du Canaan; ils s'étaient, sans doute, attiré cette punition par leurs crimes; ce fut le Dieu vengeur des crimes qui les proscrivit; les Juifs n'étaient que les bourreaux.
CELLE DE MITHRIDATE.
De telles proscriptions commandées par la Divinité même, ne doivent pas sans doute être imitées par les hommes; aussi le genre humain ne vit point de pareils massacres jusqu'à Mithridate. Rome ne lui avait pas encore déclaré la guerre, lorsqu'il ordonna qu'on assassinât tous les Romains qui se trouvaient dans l'Asie mineure. Plutarque fait monter le nombre des victimes à cent cinquante mille, Appien le réduit à quatre-vingt mille.
Plutarque n'est guère croyable, et Appien probablement exagère. Il n'est pas vraisemblable que tant de citoyens romains demeurassent dans l'Asie mineure, où ils avaient alors très peu d'établissements. Mais quand ce nombre serait réduit à la moitié, Mithridate n'en serait pas moins abominable. Tous les historiens conviennent que le massacre fut général, et que ni les femmes, ni les enfants ne furent épargnés.
CELLE DE SYLLA, DE MARIUS ET DES TRIUMVIRS.
Mais environ dans ce temps-là même, Sylla et Marius exercèrent sur leurs compatriotes la même fureur qu'ils éprouvaient en Asie. Marius commença les proscriptions, et Sylla les surpassa. La raison humaine est confondue quand elle veut juger des Romains. On ne conçoit pas comment un peuple chez qui tout était à l'enchère, et dont la moitié égorgeait l'autre, pût être dans ce temps-là même le vainqueur de tous les rois. Il y eut une horrible anarchie depuis les proscriptions de Sylla jusqu'à la bataille d'Actium, et ce fut pourtant alors que Rome conquit les Gaules, l'Espagne, l'Egypte, la Syrie, toute l'Asie mineure et la Grèce.
Comment expliquerons-nous ce nombre prodigieux de déclamations qui nous restent sur la décadence de Rome, dans ces temps sanguinaires et illustres? Tout est perdu, disent vingt auteurs latins, Rome tombe par ses propres forces, le luxe a vengé l'univers . Tout cela ne veut dire autre chose, sinon que la liberté publique n'existait plus: mais la puissance subsistait; elle était entre les mains de cinq ou six généraux d'armée, et le citoyen romain qui avait jusque-là vaincu pour lui-même, ne combattait plus que pour quelques usurpateurs.
La dernière proscription fut celle d'Antoine, d'Octave et de Lépide; elle ne fut pas plus sanguinaire que celle de Sylla.
Quelque horrible que fût le règne des Caligula et des Nérons, on ne voit point de proscriptions sous leur empire; il n'y en eut point dans les guerres des Galba, des Othons, des Vitellius.
CELLE DES JUIFS SOUS TRAJAN.
Les Juifs seuls renouvelèrent ce crime sous Trajan. Ce prince humain les traitait avec bonté. Il y en avait un très grand nombre dans l'Egypte et dans la province de Cyrène. La moitié de l'île de Chypre était peuplée de Juifs. Un nommé André qui se donna pour un messie, pour un libérateur des Juifs, ranima leur exécrable enthousiasme qui paraissait assoupi. Il leur persuada qu'ils seraient agréables au Seigneur, et qu'ils rentreraient enfin victorieux dans Jérusalem, s'ils exterminaient tous les infidèles dans les lieux où ils avaient le plus de synagogues. Les Juifs séduits par cet homme massacrèrent, dit-on, plus de deux cent vingt mille personnes dans la Cyrénaïque et dans Chypre. Dion et Eusèbe disent que non contents de les tuer, ils mangeaient leur chair, se faisaient une ceinture de leurs intestins, et se frottaient le visage de leur sang. Si cela est ainsi, ce fut, de toutes les conspirations contre le genre humain dans notre continent, la plus inhumaine et la plus épouvantable, et elle dut l'être, puisque la superstition en était le principe. Ils furent punis, mais moins qu'ils ne le méritaient, puisqu'ils subsistent encore.
CELLE DE THÉODOSE, &C.
Je ne vois aucune conspiration pareille dans l'histoire du monde, jusqu'au temps de Théodose, qui proscrivit les habitants de Thessalonique, non pas dans un mouvement de colère, comme des menteurs mercenaires l'écrivent si souvent, mais après six mois des plus mûres réflexions. Il mit dans cette fureur méditée un artifice et une lâcheté qui la rendaient encore plus horrible. Les jeux publics furent annoncés par son ordre, les habitants invités; les courses commencèrent au milieu de ces réjouissances, ses soldats égorgèrent sept à huit mille habitants: quelques auteurs disent quinze mille. Cette proscription fut incomparablement plus sanguinaire et plus inhumaine que celle des triumvirs; ils n'avaient compris que leurs ennemis dans leurs listes, mais Théodose ordonna que tout pérît sans distinction. Les triumvirs se contentèrent de taxer les veuves et les filles des proscrits, Théodose fit massacrer les femmes et les enfants, et cela dans la plus profonde paix, et lorsqu'il était au comble de sa puissance. Il est vrai qu'il expia ce crime; il fut quelque temps sans aller à la messe.
CELLE DE L'IMPERATRICE THÉODORA.
Une conspiration beaucoup plus sanglante encore que toutes les précédentes, fut celle d'une impératrice Théodora, au milieu du neuvième siècle. Cette femme superstitieuse et cruelle, veuve du cruel Théophile, et tutrice de l'infâme Michel, gouverna quelques années Constantinople. Elle donna ordre qu'on tuât tous les manichéens dans ses Etats. Fleury, dans son Histoire ecclésiastique , avoue qu'il en périt environ cent mille. Il s'en sauva quarante mille qui se réfugièrent dans les Etats du calife, et qui devenus les plus implacables comme les plus justes ennemis de l'empire grec, contribuèrent à sa ruine. Rien ne fut plus semblable à notre St Barthélemi, dans laquelle on voulut détruire les protestants, et qui les rendit furieux.
CELLE DES CROISÉS CONTRE LES JUIFS.
Cette rage des conspirations contre un peuple entier sembla s'assoupir jusqu'au temps des croisades. Une horde de croisés dans la première expédition de Pierre l'Hermite, ayant pris son chemin par l'Allemagne, fit voeu d'égorger tous les Juifs qu'ils rencontreraient sur leur route. Ils allèrent à Spire, à Vorms, à Cologne, à Mayence, à Francfort; ils fendirent le ventre aux hommes, aux femmes, aux enfants de la nation juive qui tombèrent entre leurs mains, et cherchèrent dans leurs entrailles l'or qu'on supposait que ces malheureux avaient avalé.
Cette action des croisés ressemblait parfaitement à celle des Juifs de Chypre et de Cyrène, et fut peut-être encore plus affreuse, parce que l'avarice se joignait au fanatisme. Les Juifs alors furent traités comme ils se vantent d'avoir traité autrefois des nations entières: mais selon la remarque de Suarez, ils avaient égorgé leurs voisins par une piété bien entendue, et les croisés les massacrèrent par une piété mal entendue . Il y a au moins de la piété dans ces meurtres, et cela est bien consolant.
CELLE DES CROISADES CONTRE LES ALBIGEOIS.
La conspiration contre les Albigeois fut de la même espèce, et eut une atrocité de plus; c'est qu'elle fut contre des compatriotes, qu'elle dura plus longtemps. Suarez aurait dû regarder cette proscription comme la plus édifiante de toutes, puisque de saints inquisiteurs condamnèrent aux flammes tous les habitants de Bésiers, de Carcassonne, de Lavaur, et de cent bourgs considérables; presque tous les citoyens furent brûlés en effet, ou pendus, ou égorgés.
LES VÊPRES SICILIENNES.
S'il est quelque nuance entre les grands crimes, peut-être la journée des vêpres siciliennes est la moins exécrable de toutes, quoiqu'elle le soit excessivement. L'opinion la plus probable, est que ce massacre ne fut point prémédité. Il est vrai que Jean de Procida, émissaire du roi d'Arragon, préparait dès lors une révolution à Naples et en Sicile; mais il paraît que ce fut un mouvement subit dans le peuple animé contre les Provençaux, qui le déchaîna tout d'un coup, et qui fit couler tant de sang. Le roi Charles d'Anjou, frère de St Louis s'était rendu odieux par le meurtre de Conradin et du duc d'Autriche, deux jeunes héros et deux grands princes dignes de son estime, qu'il fit condamner à mort comme des voleurs. Les Provençaux qui vexaient la Sicile étaient détestés. L'un d'eux fit violence à une femme le lendemain de Pâques; on s'attroupa, on s'émut, on sonna le tocsin, on cria meurent les tyrans ; tout ce qu'on rencontra de Provençaux fut massacré; les innocents périrent avec les coupables.
LES TEMPLIERS.
Je mets sans difficulté au rang des conjurations contre une société entière le supplice des templiers. Cette barbarie fut d'autant plus atroce qu'elle fut commise avec l'appareil de la justice. Ce n'était point une de ces fureurs que la vengeance soudaine ou la nécessité de se défendre semble justifier: c'était un projet réfléchi d'exterminer tout un ordre trop fier et trop riche. Je pense bien que dans cet ordre il y avait de jeunes débauchés qui méritaient quelque correction; mais je ne croirai jamais qu'un grand-maître, et tant de chevaliers parmi lesquels on comptait des princes, tous vénérables par leur âge et par leurs services, fussent coupables des bassesses absurdes et inutiles dont on les accusait. Je ne croirai jamais qu'un ordre entier de religieux ait renoncé en Europe à la religion chrétienne, pour laquelle il combattait en Asie, en Afrique; et pour laquelle même encore plusieurs d'entre eux gémissaient dans les fers des Turcs et des Arabes, aimant mieux mourir dans les cachots que de renier leur religion.
Enfin, je crois sans difficulté à plus de quatre-vingts chevaliers qui, en mourant, prennent Dieu à témoin de leur innocence. N'hésitons point à mettre leur proscription au rang des funestes effets d'un temps d'ignorance et de barbarie.
MASSACRE DANS LE NOUVEAU MONDE.
Dans ce recensement de tant d'horreurs, mettons surtout les douze millions d'hommes détruits dans le vaste continent du nouveau monde. Cette proscription est à l'égard de toutes les autres ce que serait l'incendie de la moitié de la terre à celui de quelques villages.
Jamais ce malheureux globe n'éprouva une dévastation plus horrible et plus générale, et jamais crime ne fut mieux prouvé. Las Casas évêque de Chiapa dans la nouvelle Espagne, ayant parcouru pendant plus de trente années les îles et la terre ferme découvertes, avant qu'il fût évêque; et depuis qu'il eut cette dignité, témoin oculaire de ces trente années de destruction, vint enfin en Espagne dans sa vieillesse, se jeter aux pieds de Charles-Quint et du prince Philippe son fils, et fit entendre ses plaintes qu'on n'avait pas écoutées jusqu'alors. Il présenta sa requête au nom d'un hémisphère entier: elle fut imprimée à Valladolid. La cause de plus de cinquante nations proscrites dont il ne subsistait que de faibles restes, fut solennellement plaidée devant l'empereur. Las Casas dit que ces peuples détruits étaient d'une espèce douce, faible et innocente, incapable de nuire et de résister, et que la plupart ne connaissaient pas plus les vêtements et les armes que nos animaux domestiques. J'ai parcouru, dit-il, toutes les petites îles Lucaies, et je n'y ai trouvé que onze habitants, reste de plus de cinq cent mille.
Il compte ensuite plus de deux millions d'hommes détruits dans Cuba et dans Hispaniola; et enfin plus de dix millions dans le continent. Il ne dit pas, j'ai ouï dire qu'on a exercé ces énormités incroyables, il dit: je les ai vues: j'ai vu cinq caciques brûlés pour s'être enfuis avec leurs sujets; j'ai vu ces créatures innocentes massacrées par milliers; enfin, de mon temps, on a détruit plus de douze millions d'hommes dans l'Amérique .
On ne lui contesta pas cette étrange dépopulation, quelque incroyable qu'elle paraisse. Le docteur Sepulvéda qui plaidait contre lui, s'attacha seulement à prouver que tous ces Indiens méritaient la mort, parce qu'ils étaient coupables du péché contre nature, et qu'ils étaient anthropophages.
Je prends Dieu à témoin, répond le digne évêque Las Casas, que vous calomniez ces innocents après les avoir égorgés. Non, ce n'était pas parmi eux que régnait la pédérastie, et que l'horreur de manger de la chair humaine s'était introduite; il se peut que dans quelques contrées de l'Amérique que je ne connais pas, comme au Brésil ou dans quelques îles, on ait pratiqué ces abominations de l'Europe; mais ni à Cuba, ni à la Jamaïque, ni dans l'Hispaniola, ni dans aucune île que j'ai parcourue, ni au Pérou, ni au Mexique où est mon évêché, je n'ai entendu jamais parler de ces crimes; et j'en ait fait les enquêtes les plus exactes. C'est vous qui êtes plus cruel que les anthropophages; car je vous ai vu dresser des chiens énormes pour aller à la chasse des hommes, comme on va à celle des bêtes fauves. Je vous ai vus donner vos semblables à dévorer à vos chiens. J'ai entendu des Espagnols dire à leurs camarades, prête-moi une longe d'Indien pour le déjeûner de mes dogues, je t'en rendrai demain un quartier. C'est enfin chez vous seuls que j'ai vu de la chair humaine étalée dans vos boucheries, soit pour vos dogues, soit pour vous-mêmes. Tout cela, continue-t-il, est prouvé au procès, et je jure par le grand Dieu qui m'écoute, que rien n'est plus véritable.
Enfin, Las Casas obtint de Charles-Quint des lois qui arrêtèrent le carnage réputé jusqu'alors légitime, attendu que c'était des chrétiens qui massacraient des infidèles.
CONSPIRATION CONTRE MÉRINDOL.
La proscription juridique des habitants de Mérindol et de Cabrière, sous François I e r , en 1546, n'est à la vérité qu'une étincelle en comparaison de cet incendie universel de la moitié de l'Amérique. Il périt dans ce petit pays environ cinq à six mille personnes des deux sexes et de tout âge. Mais cinq mille citoyens surpassent en proportion dans un canton si petit, le nombre de douze millions dans la vaste étendue des îles de l'Amérique, dans le Mexique, et dans le Pérou. Ajoutez surtout que les désastres de notre patrie nous touchent plus que ceux d'un autre hémisphère.
Ce fut la seule proscription revêtue des formes de la justice ordinaire; car les templiers furent condamnés par des commissaires que le pape avait nommés, et c'est en cela que le massacre de Mérindol porte un caractère plus affreux que les autres. Le crime est plus grand quand il est commis par ceux qui sont établis pour réprimer les crimes et pour protéger l'innocence.
Un avocat général du parlement d'Aix nommé Guérin, fut le premier auteur de cette boucherie. C'était , dit l'historien César Nostradamus, un homme noir ainsi de corps que d'âme, autant froid orateur que persécuteur ardent et calomniateur effronté . Il commença par dénoncer en 1540 dix-neuf personnes au hasard comme hérétiques. Il y avait alors un violent parti dans le parlement d'Aix, qu'on appelait les brûleurs . Le président d'Oppède était à la tête de ce parti. Les dix-neuf accusés furent condamnés à la mort sans être entendus; et dans ce nombre il se trouva quatre femmes et cinq enfants qui s'enfuirent dans des cavernes.
Il y avait alors, à la honte de la nation, un inquisiteur de la foi en Provence; il se nommait frère Jean de Rome. Ce malheureux accompagné de satellites allait souvent dans Mérindol et dans les villages d'alentour; il entrait inopinément et de nuit dans les maisons où il était averti qu'il y avait un peu d'argent; il déclarait le père, la mère et les enfants hérétiques, leur donnait la question, prenait l'argent, et violait les filles. Vous trouverez une partie des crimes de ce scélérat dans le fameux plaidoyer d'Aubri, et vous remarquerez qu'il ne fut puni que par la prison.
Ce fut cet inquisiteur qui, n'ayant pu entrer chez les dix-neuf accusés, les avait fait dénoncer au parlement par l'avocat général Guérin, quoiqu'il prétendît être le seul juge du crime d'hérésie. Guérin et lui soutinrent que dix-huit villages étaient infectés de cette peste. Les dix-neuf citoyens échappés devaient, selon eux, faire révolter tout le canton. Le président d'Oppède, trompé par une information frauduleuse de Guérin, demanda au roi des troupes pour appuyer la recherche et la punition des dix-neuf prétendus coupables. François I e r , trompé à son tour, accorda enfin les troupes. Le vice-légat d'Avignon y joignit quelques soldats. Enfin en 1544 d'Oppède et Guérin à leur tête mirent le feu à tous les villages; tout fut tué, et Aubri rapporte dans son plaidoyer, que plusieurs soldats assouvirent leur brutalité sur les femmes et les filles expirantes qui palpitaient encore. C'est ainsi qu'on servait la religion.
Quiconque a lu l'histoire, sait assez qu'on fit justice; que le parlement de Paris fit pendre l'avocat général, et que le président d'Oppède échappa au supplice qu'il avait mérité. Cette grande cause fut plaidée pendant cinquante audiences. On a encore les plaidoyers, ils sont curieux. D'Oppède et Guérin alléguaient pour leur justification tous les passages de l'Ecriture, où il est dit:
Frappez les habitants par le glaive, détruisez tout jusqu'aux animaux. [33]
Tuez le vieillard, l'homme, la femme, et l'enfant à la mamelle. [34]
Tuez l'homme, la femme, l'enfant sevré, l'enfant qui tète, le boeuf, la brebis, le chameau et l'âne. [35]
Ils alléguaient encore les ordres et les exemples donnés par l'Eglise contre les hérétiques. Ces exemples et ces ordres n'empêchèrent pas que Guérin ne fût pendu. C'est la seule proscription de cette espèce qui ait été punie par les lois, après avoir été faite à l'abri de ces lois mêmes.
CONSPIRATION DE LA ST. BARTHELEMI.
Il n'y eut que vingt-huit ans d'intervalle entre les massacres de Mérindol et la journée de la St Barthélemi. Cette journée fait encore dresser les cheveux à la tête de tous les Français, excepté ceux d'un abbé qui a osé imprimer en 1758 une espèce d'apologie de cet événement exécrable. C'est ainsi que quelques esprits bizarres ont eu le caprice de faire l'apologie du diable. Ce ne fut , dit-il , qu'une affaire de proscription . Voilà une étrange excuse! Il semble qu'une affaire de proscription soit une chose d'usage comme on dit, une affaire de barreau, une affaire d'intérêt, une affaire de calcul, une affaire d'Eglise.
Il faut que l'esprit humain soit bien susceptible de tous les travers, pour qu'il se trouve au bout de près de deux cents ans un homme qui de sang froid entreprend de justifier ce que l'Europe entière abhorre. L'archevêque Péréfixe prétend qu'il périt cent mille Français dans cette conspiration religieuse. Le duc de Sulli n'en compte que soixante et dix mille. M. l'abbé abuse du martyrologe des calvinistes, lequel n'a pu tout compter, pour affirmer qu'il n'y eut que quinze mille victimes. Eh! monsieur l'abbé! ne serait-ce rien que quinze mille personnes égorgées, en pleine paix, par leurs concitoyens!
Le nombre des morts ajoute, sans doute, beaucoup à la calamité d'une nation, mais rien à l'atrocité du crime. Vous prétendez, homme charitable, que la religion n'eut aucune part à ce petit mouvement populaire. Oubliez-vous le tableau que le pape Grégoire XIII fit placer dans le Vatican, et au bas duquel était écrit, Pontifex Colignii necem probat . Oubliez-vous sa procession solennelle de l'église St Pierre à l'église St Louis, le Te Deum qu'il fit chanter, les médailles qu'il fit frapper pour perpétuer la mémoire de l'heureux carnage de la St Barthélemi. Vous n'avez peut-être pas vu ces médailles; j'en ai vu entre les mains de M. l'abbé de Rothelin. Le pape Grégoire y est représenté d'un côté, et de l'autre c'est un ange qui tient une croix dans la main gauche et une épée dans la droite. En voilà-t-il assez, je ne dis pas pour vous convaincre, mais pour vous confondre?
CONSPIRATION D'IRLANDE.
La conjuration des Irlandais catholiques, contre les protestants, sous Charles I e r , en 1641, est une fidèle imitation de la St Barthélemi. Des historiens anglais contemporains, tels que le chancelier Clarendon et un chevalier Jean Temple, assurent qu'il y eut cent cinquante mille hommes de massacrés. Le parlement d'Angleterre dans sa déclaration du 25 juillet 1643, en compte quatre-vingts mille: mais M. Brooke qui paraît très instruit, crie à l'injustice dans un petit livre que j'ai entre les mains. Il dit qu'on se plaint à tort; et il semble prouver assez bien qu'il n'y eut que quarante mille citoyens d'immolés à la religion, en y comprenant les femmes et les enfants.
CONSPIRATION DANS LES VALLÉES DU PIEMONT.
J'omets ici un grand nombre de proscriptions particulières. Les petits désastres ne se comptent point dans les calamités générales; mais je ne dois point passer sous silence la proscription des habitants des vallées du Piémont en 1655.
C'est une chose assez remarquable dans l'histoire, que ces hommes presque inconnus au reste du monde, aient persévéré constamment de temps immémorial dans des usages qui avaient changé partout ailleurs. Il en est de ces usages comme de la langue: une infinité de termes antiques se conservent dans des cantons éloignés, tandis que les capitales et les grandes villes varient dans leur langage de siècle en siècle.
Voilà pourquoi l'ancien roman que l'on parlait du temps de Charlemagne, subsiste encore dans le patois du pays de Vaud, qui a conservé le nom de pays roman . On retrouve des vestiges de ce langage dans toutes les vallées des Alpes et des Pyrénées. Les peuples voisins de Turin qui habitaient les cavernes vaudoises, gardèrent l'habillement, la langue, et presque tous les rites du temps de Charlemagne.
On sait assez que dans le huitième et dans le neuvième siècle, la partie septentrionale de l'Occident ne connaissait point le culte des images; et une bonne raison, c'est qu'il n'y avait ni peintre ni sculpteur: rien même n'était décidé encore sur certaines questions délicates, que l'ignorance ne permettait pas d'approfondir. Quand ces points de controverse furent arrêtés et réglés ailleurs, les habitants des vallées l'ignorèrent; et étant ignorés eux-mêmes des autres hommes, ils restèrent dans leur ancienne croyance; mais enfin, ils furent mis au rang des hérétiques et poursuivis comme tels.
Dès l'année 1487, le pape Innocent VIII envoya dans le Piémont un légat nommé Albertus de Capitoneis, archidiacre de Crémone, prêcher une croisade contre eux. La teneur de la bulle du pape est singulière. Il recommande aux inquisiteurs, à tous les ecclésiastiques, et à tous les moines, ‘de prendre unanimement les armes contre les Vaudois, de les écraser comme des aspics, et de les exterminer saintement'. In haereticos armis insurgant, eosque velut aspides venenosos conculcent, et ad tam sanctam exterminationem adhibeant omnes conatus .
La même bulle octroie à chaque fidèle le droit ‘de s'emparer des meubles et immeubles des hérétiques, sans forme de procès'. Bona quaecumque mobilia, et immobilia quibuscumque licite occupandi, etc .
Et par la même autorité elle déclara que tous les magistrats qui ne prêteront pas main-forte seront privés de leurs dignités: Seculares honoribus, titulis, feudis, privilegiis privandi .
Les Vaudois ayant été vivement persécutés, en vertu de cette bulle, se crurent des martyrs. Ainsi leur nombre augmenta prodigieusement. Enfin la bulle d'Innocent VIII fut mise en exécution à la lettre, en 1655. Le marquis de Pianesse entra le 15 d'avril dans ces vallées avec deux régiments, ayant des capucins à leur tête. On marcha de caverne en caverne, et tout ce qu'on rencontra fut massacré. On pendait les femmes nues à des arbres, on les arrosait du sang de leurs enfants, et on emplissait leur matrice de poudre à laquelle on mettait le feu.
Il faut faire entrer, sans doute, dans ce triste catalogue les massacres des Cévennes et du Vivarais qui durèrent pendant dix ans, au commencement de ce siècle. Ce fut en effet un mélange continuel de proscriptions et de guerres civiles. Les combats, les assassinats, et les mains des bourreaux ont fait périr près de cent mille de nos compatriotes, dont dix mille ont expiré sur la roue, ou par la corde, ou dans les flammes, si on en croit tous les historiens contemporains des deux partis.
Est-ce l'histoire des serpents et des tigres que je viens de faire? non, c'est celle des hommes. Les tigres et les serpents ne traitent point ainsi leur espèce. C'est pourtant dans le siècle de Cicéron, de Pollion, d'Atticus, de Varius, de Tibulle, de Virgile, d'Horace, qu'Auguste fit ses proscriptions. Les philosophes de Thou et Montagne, le chancelier de l'Hôpital vivaient du temps de la St Barthélemi: et les massacres des Cévennes sont du siècle le plus florissant de la monarchie française. Jamais les esprits ne furent plus cultivés, les talents en plus grand nombre, la politesse plus générale. Quel contraste, quel chaos, quelles horribles inconséquences composent ce malheureux monde! On parle des pestes, des tremblements de terre, des embrasements, des déluges, qui ont désolé le globe; heureux, dit-on, ceux qui n'ont pas vécu dans le temps de ces bouleversements! Disons plutôt; heureux ceux qui n'ont pas vu les crimes que je retrace! Comment s'est-il trouvé des barbares pour les ordonner, et tant d'autres barbares pour les exécuter? Comment y a-t-il encore des inquisiteurs et des familiers de l'Inquisition?
Un homme modéré, humain, né avec un caractère doux, ne conçoit pas plus qu'il y ait eu parmi les hommes des bêtes féroces ainsi altérées de carnage, qu'il ne conçoit des métamorphoses de tourterelles en vautours; mais il comprend encore moins que ces monstres aient trouvé à point nommé une multitude d'exécuteurs. Si des officiers et des soldats courent au combat sur un ordre de leurs maîtres, cela est dans l'ordre de la nature; mais que sans aucun examen ils aillent assassiner de sang-froid un peuple sans défense, c'est ce qu'on n'oserait pas imaginer des furies mêmes de l'enfer. Ce tableau soulève tellement le coeur de ceux qui se pénètrent de ce qu'ils lisent, que pour peu qu'on soit enclin à la tristesse, on est fâché d'être né; on est indigné d'être homme.
La seule chose qui puisse consoler, c'est que de telles abominations n'ont été commises que de loin à loin; n'en voilà qu'environ vingt exemples principaux dans l'espace de près de quatre mille années. Je sais que les guerres continuelles qui ont désolé la terre sont des fléaux encore plus destructeurs par leur nombre et par leur durée; mais enfin, comme je l'ai déjà dit, le péril étant égal des deux côtés dans la guerre, ce tableau révolte bien moins que celui des proscriptions, qui ont toutes été faites avec lâcheté, puisqu'elles ont été faites sans danger, et que les Sylla et les Augustes n'ont été au fond que des assassins qui ont attendu des passants au coin d'un bois, et qui ont profité des dépouilles.
La guerre paraît l'état naturel de l'homme. Toutes les sociétés connues ont été en guerre, hormis les brames et les primitifs que nous appelons quakers , et quelques autres petits peuples. Mais il faut avouer que très peu de sociétés se sont rendues coupables de ces assassinats publics appelés proscriptions . Il n'y en a aucun exemple dans la haute antiquité, excepté chez les Juifs. Le seul roi de l'Orient qui se soit livré à ce crime est Mithridate; et depuis Auguste il n'y a eu de proscriptions dans notre hémisphère que chez les chrétiens qui occupent une très petite partie du globe. Si cette rage avait saisi souvent le genre humain, il n'y aurait plus d'hommes sur la terre, elle ne serait habitée que par les animaux qui sont sans contredit beaucoup moins méchants que nous. C'est à la philosophie, qui fait aujourd'hui tant de progrès, d'adoucir les moeurs des hommes; c'est à notre siècle de réparer les crimes des siècles passés. Il est certain que quand l'esprit de tolérance sera établi, on ne pourra plus dire:
Aetas parentum pejor avis tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem .
On dira plutôt, mais en meilleurs vers que ceux-ci:
Nos aïeux ont été des monstres exécrables,
Nos pères ont été méchants;
On voit aujourd'hui leurs enfants,
Etant plus éclairés devenir plus traitables.
Mais pour oser dire que nous sommes meilleurs que nos ancêtres, il faudrait que nous trouvant dans les mêmes circonstances qu'eux, nous nous abstinssions avec horreur des cruautés dont ils ont été coupables; et il n'est pas démontré que nous fussions plus humains en pareil cas. La philosophie ne pénètre pas toujours chez les grands qui ordonnent, et encore moins chez les hordes des petits qui exécutent. Elle n'est le partage que des hommes placés dans la médiocrité, également éloignés de l'ambition qui opprime, et de la basse férocité qui est à ses gages.
Il est vrai qu'il n'est plus de nos jours de persécutions générales. Mais on voit quelquefois de cruelles atrocités. La société, la politesse, la raison inspirent des moeurs douces; cependant quelques hommes ont cru que la barbarie était un de leurs devoirs. On les a vus abuser de leurs misérables emplois si souvent humiliés, jusqu'à se jouer de la vie de leurs semblables en colorant leur inhumanité du nom de justice; ils ont été sanguinaires sans nécessité: ce qui n'est pas même le caractère des animaux carnassiers. Toute dureté qui n'est pas nécessaire est un outrage au genre humain. Les cannibales se vengent, mais ils ne font pas expirer dans d'horribles supplices un compatriote qui n'a été qu'imprudent.
Puissent ces réflexions satisfaire les âmes sensibles et adoucir les autres!
CONTRADICTION. [p. 245] ↩
EXEMPLES TIRÉS DE L'HISTOIRE DE LA SAINTE ECRITURE, DE PLUSIEURS ÉCRIVAINS, DU FAMEUX CURÉ MÊLIER, D'UN PRÉDICANT NOMMÉ ANTOINE, &c.
On a déjà montré ailleurs [36] les contradictions de nos usages, de nos moeurs, de nos lois: on n'en a pas dit assez.
Tout a été fait, surtout dans notre Europe, comme l'habit d'Arlequin: son maître n'avait point de drap; quand il fallut l'habiller, il prit des vieux lambeaux de toutes couleurs: Arlequin fut ridicule, mais il fut vêtu.
Où est le peuple dont les lois et les usages ne se contredisent pas? Y a-t-il une contradiction plus frappante et en même temps plus respectable que le saint empire romain? en quoi est-il saint? en quoi est-il empire? en quoi est-il romain?
Les Allemands sont une brave nation que ni les Germanicus, ni les Trajans ne purent jamais subjuguer entièrement. Tous les peuples germains qui habitaient au-delà de l'Elbe, furent toujours invincibles, quoique mal armés; c'est en partie de ces tristes climats que sortirent les vengeurs du monde. Loin que l'Allemagne soit l'empire romain, elle a servi à le détruire.
Cet empire était réfugié à Constantinople, quand un Allemand, un Austrasien alla d'Aix-la-chapelle à Rome, dépouiller pour jamais les Césars grecs de ce qu'il leur restait en Italie. Il prit le nom de César, d' imperator ; mais ni lui ni ses successeurs n'osèrent jamais résider à Rome. Cette capitale ne peut ni se vanter, ni se plaindre que depuis Augustule dernier excrément de l'empire romain, aucun César ait vécu et soit enterré dans ses murs.
Il est difficile que l'empire soit saint , puisqu'il professe trois religions, dont deux sont déclarées impies, abominables, damnables et damnées, par la cour de Rome que toute la cour impériale regarde comme souveraine sur ces cas.
Il n'est pas certainement romain, puisque l'empereur n'a pas dans Rome une maison.
En Angleterre, on sert les rois à genoux. La maxime constante est que le roi ne peut jamais faire mal. The king can do no wrong . Ses ministres seuls peuvent avoir tort; il est infaillible dans ses actions comme le pape dans ses jugements. Telle est la loi fondamentale, la loi salique d'Angleterre. Cependant le parlement juge son roi Edouard II vaincu et fait prisonnier par sa femme; on déclare qu'il a tous les torts du monde, et qu'il est déchu de tous droits à la couronne. Guillaume Trussel vient dans sa prison lui faire le compliment suivant:
‘Moi, Guillaume Trussel, procureur du parlement et de toute la nation anglaise, je révoque l'hommage à toi fait autrefois; je te défie et je te prive du pouvoir royal, et nous ne tiendrons plus à toi dorénavant.' [37]
Le parlement juge et condamne le roi Richard II fils du grand Edouard III. Trente et un chefs d'accusation sont produits contre lui, parmi lesquels on en trouve deux singuliers; Qu'il avait emprunté de l'argent sans payer, et qu'il avait dit en présence de témoins qu'il était le maître de la vie et des biens de ses sujets.
Le parlement dépose Henri VI qui avait un très grand tort, mais d'une autre espèce, celui d'être imbécile.
Le parlement déclare Edouard IV traître, confisque tous ses biens; et ensuite le rétablit quand il est heureux.
Pour Richard III, celui-là eut véritablement tort plus que tous les autres: c'était un Néron, mais un Néron courageux; et le parlement ne déclara ses torts que quand il eut été tué.
La chambre représentant le peuple d'Angleterre, imputa plus de torts à Charles I e r qu'il n'en avait; et le fit périr sur un échafaud. Le parlement jugea que Jacques II avait de très grands torts, et surtout celui de s'être enfui. Il déclara la couronne vacante, c'est-à-dire, il le déposa.
Aujourd'hui Junius écrit au roi d'Angleterre que ce monarque a tort d'être bon et sage. Si ce ne sont pas là des contradictions, je ne sais où en trouver.
DES CONTRADICTIONS DANS QUELQUES RITES.
Après ces grandes contradictions politiques qui se divisent en cent mille petites contradictions, il n'y en a point de plus fortes que celles de quelques-uns de nos rites. Nous détestons le judaïsme; il n'y a pas quinze ans qu'on brûlait encore les Juifs. Nous les regardons comme les assassins de notre Dieu, et nous nous assemblons tous les dimanches pour psalmodier des cantiques juifs: si nous ne les récitons pas en hébreu, c'est que nous sommes des ignorants. Mais les quinze premiers évêques, prêtres, diacres, et troupeau de Jérusalem, berceau de la religion chrétienne, récitèrent toujours les psaumes juifs dans l'idiome juif de la langue syriaque; et jusqu'au temps du calife Omar, presque tous les chrétiens depuis Tyr jusqu'à Alep priaient dans cet idiome juif. Aujourd'hui qui réciterait les psaumes tels qu'ils ont été composés, qui les chanterait dans la langue juive, serait soupçonné d'être circoncis, et d'être juif: il serait brûlé comme tel: il l'aurait été du moins il y a vingt ans, quoique Jésus-Christ ait été circoncis, quoique les apôtres et les disciples aient été circoncis. Je mets à part tout le fonds de notre sainte religion, tout ce qui est un objet de foi, tout ce qu'il ne faut considérer qu'avec une soumission craintive, je n'envisage que l'écorce, je ne touche qu'à l'usage; je demande s'il y en eut jamais un plus contradictoire?
DES CONTRADICTIONS DANS LES AFFAIRES ET DANS LES HOMMES.
Si quelque société littéraire veut entreprendre le dictionnaire des contradictions, je souscris pour vingt volumes in-folio .
Le monde ne subsiste que de contradictions; que faudrait-il pour les abolir? Assembler les états du genre humain. Mais de la manière dont les hommes sont faits, ce serait une nouvelle contradiction s'ils étaient d'accord. Assemblez tous les lapins de l'univers, il n'y aura pas deux avis différents parmi eux.
Je ne connais que deux sortes d'êtres immuables sur la terre, les géomètres et les animaux; ils sont conduits par deux règles invariables, la démonstration et l'instinct: et encore les géomètres ont-ils eu quelques disputes, mais les animaux n'ont jamais varié.
DES CONTRADICTIONS DANS LES HOMMES ET DANS LES AFFAIRES.
Les contrastes, les jours et les ombres sous lesquels on représente dans l'histoire les hommes publics, ne sont pas des contradictions, ce sont des portraits fidèles de la nature humaine.
Tous les jours on condamne et on admire Alexandre le meurtrier de Clitus, mais le vengeur de la Grèce, le vainqueur des Perses et le fondateur d'Alexandrie.
César le débauché qui vole le trésor public de Rome pour asservir sa patrie, mais dont la clémence égale la valeur, et dont l'esprit égale le courage.
Mahomet imposteur, brigand, mais le seul des législateurs qui ait eu du courage et qui ait fondé un grand empire.
L'enthousiaste Cromwell, fourbe dans le fanatisme même, assassin de son roi en forme juridique, mais aussi profond politique que valeureux guerrier.
Mille contrastes se présentent souvent en foule, et ces contrastes sont dans la nature; ils ne sont pas plus étonnants qu'un beau jour suivi de la tempête.
DES CONTRADICTIONS APPARENTES DANS LES LIVRES.
Il faut soigneusement distinguer dans les écrits, et surtout dans les livres sacrés, les contradictions apparentes et les réelles. Il est dit dans le Pentateuque que Moïse était le plus doux des hommes, et qu'il fit égorger vingt-trois mille Hébreux qui avaient adoré le veau d'or, et vingt-quatre mille qui avaient ou épousé comme lui, ou fréquenté des femmes madianites. Mais de sages commentateurs ont prouvé solidement que Moïse était d'un naturel très doux, et qu'il n'avait fait qu'exécuter les vengeances de Dieu en faisant massacrer ces quarante-sept mille Israëlites coupables, comme nous l'avons déjà vu.
Des critiques hardis ont cru apercevoir une contradiction dans le récit où il est dit que Moïse changea toutes les eaux de l'Egypte en sang, et que les magiciens de Pharaon firent ensuite le même prodige, sans que l'Exode mette aucun intervalle entre le miracle de Moïse et l'opération magique des enchanteurs.
Il paraît d'abord impossible que ces magiciens changent en sang ce qui est déjà devenu sang; mais cette difficulté peut se lever, en supposant que Moïse avait laissé les eaux reprendre leur première nature, pour donner au pharaon le temps de rentrer en lui-même. Cette supposition est d'autant plus plausible, que si le texte ne la favorise pas expressément, il ne lui est pas contraire.
Les mêmes incrédules demandent, comment tous les chevaux ayant été tués par la grêle dans la sixième plaie, Pharaon put poursuivre la nation juive avec de la cavalerie? Mais cette contradiction n'est pas même apparente, puisque la grêle qui tua tous les chevaux qui étaient aux champs, ne put tomber sur ceux qui étaient dans les écuries.
Une des plus fortes contradictions qu'on ait cru trouver dans l'histoire des Rois, est la disette totale d'armes offensives et défensives chez les Juifs à l'avènement de Saül, comparée avec l'armée de trois cent trente mille combattants que Saül conduit contre les Ammonites qui assiégeaient Jabès en Galaad.
I Rois ch. III, v. 22. Il est rapporté en effet qu'alors, et même après cette bataille, il n'y avait pas une lance, pas une seule épée chez tout le peuple hébreu; que les Philistins empêchaient les Hébreux de forger des I Rois ch. XIII, v. 19, 20 et 21. épées et des lances; que les Hébreux étaient obligés d'aller chez les Philistins pour faire aiguiser le soc de leurs charrues, leurs hoyaux, leurs coignées, et leurs serpettes.
Cet aveu semble prouver que les Hébreux étaient en très petit nombre, et que les Philistins étaient une nation puissante, victorieuse, qui tenait les Israëlites sous le joug, et qui les traitait en esclaves; qu'enfin il n'était pas possible que Saül eût assemblé trois cent trente mille combattants, etc.
Note de Dom Calmet sur le verset 19. Le révérend père Dom Calmet dit, qu'il est croyable qu'il y a un peu d'exagération dans ce qui est dit ici de Saül et de Jonathas . Mais ce savant homme oublie que les autres commentateurs attribuent les premières victoires de Saül et de Jonathas à un de ces miracles évidents que Dieu daigna faire si souvent en faveur de son pauvre peuple. Jonathas avec son seul écuyer tua d'abord vingt ennemis, et les Philistins étonnés tournèrent leurs armes les uns contre les autres. L'auteur du livre des Rois dit positivement, Ch. XIV, v. 15. que ce fut comme un miracle de Dieu, accidit quasi miraculum à Deo . Il n'y a donc point là de contradiction.
Les ennemis de la religion chrétienne, les Celses, les Porphires, les Juliens, ont épuisé la sagacité de leur esprit sur cette matière. Des auteurs juifs se sont prévalus de tous les avantages que leur donnait la supériorité de leurs connaissances dans la langue hébraïque pour mettre au jour ces contradictions apparentes; ils ont été suivis même par des chrétiens tels que milord Herbert, Volaston, Tindal, Toland, Colins, Shaftersburi, Volston, Gordon, Bolingbroke, et plusieurs auteurs de divers pays. Fréret secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres de France, le savant Le Clerc même, Simon de l'Oratoire, ont cru apercevoir quelques contradictions qu'on pouvait attribuer aux copistes. Une foule d'autres critiques a voulu relever et réformer des contradictions qui leur ont paru inexplicables.
On lit dans un livre dangereux fait avec beaucoup d'art:
Analyse de la religion chrétienne , pag. 22 attribuée à St Evremont. ‘St Matthieu et St Luc donnent chacun une généalogie de Jésus-Christ différentes; et pour qu'on ne croie pas que ce sont de ces différences légères, qu'on peut attribuer à méprise ou inadvertance, il est aisé de s'en convaincre par ses yeux en lisant Matthieu au chap. I et Luc au chap. III: on verra qu'il y a quinze générations de plus dans l'une que dans l'autre; que depuis David elles se séparent absolument, qu'elles se réunissent à Salathiel; mais qu'après son fils elles se séparent de nouveau, et ne se réunissent plus qu'à Joseph.
‘Dans la même généalogie St Matthieu tombe encore dans une contradiction manifeste; car il dit qu'Osias était père de Jonathan: et dans les Paralipomènes livre premier chap. III, v. 11 et 12, on trouve trois générations entre eux, savoir Joas, Amazias, Azarias, desquels Luc ne parle pas plus que Matthieu. De plus, cette généalogie ne fait rien à celle de Jésus, puisque, selon notre loi, Joseph n'avait eu aucun commerce avec Marie.'
Pour répondre à cette objection faite depuis le temps d'Origène, et renouvellé de siècle en siècle, il faut lire Julius Africanus. Voici les deux généalogies conciliées dans la table suivante, telle qu'elle se trouve dans la bibliothèque des auteurs ecclésiastiques.
| Salomon et ses descendants rapportés par Saint Mattieu . | David . |
Nathan et ses descendants rapportés par Saint Luc . |
| Mathan premier mari. | Estha . |
Melchi , ou plutôt Mathat second mari. |
| Jacob fils de Mathan premier mari. | Leur femme commune, dont on ne sait point le nom; mariée premièrement à Héli , dont elle n'a point eu d'enfant, et ensuite à Jacob son frère. | Hélie . |
| Fils naturel de Joseph . Jacob . | Fils d' Héli selon la loi. |
Autre manière de concilier les deux généalogies par St Epiphane.
Jacob Panther descendu de Salomon, est père de Joseph et de Cléophas.
Joseph a de sa première femme dix enfants, Jacques, Josué, Siméon, Juda, Marie et Salome.
Il épouse ensuite la vierge Marie mère de Jésus, fille de Joachim et d'Anne.
Il y a plusieurs autres manières d'expliquer ces deux généalogies. Voyez l'ouvrage de Dom Calmet, intitulé, Dissertation où l'on essaie de concilier St Matthieu avec St Luc sur la généalogie de Jésus-Christ .
Les mêmes savants incrédules qui ne sont occupés qu'à comparer les dates, à examiner les livres et les médailles, à confronter les anciens auteurs, à chercher la vérité avec la prudence humaine, et qui perdent par leur science la simplicité de la foi, reprochent à St Luc de contredire les autres évangiles, et de s'être trompé dans ce qu'il avance sur la naissance du Sauveur. Voici comme s'en explique témérairement l'auteur de l' Analyse de la religion chrétienne :
‘St Luc dit que Cirénius avait le gouvernement de Syrie lorsque Auguste fit faire le dénombrement de tout l'empire. On va voir combien il se rencontre de faussetés évidentes dans ce peu de mots. Tacite et Suétone les plus exacts de tous les historiens, ne disent pas un mot du prétendu dénombrement de tout l'empire, qui assurément eût été un événement bien singulier, puisqu'il n'y en eut jamais sous aucun empereur; du moins aucun auteur ne rapporte qu'il y en ait eu. 2 o . Cirénius ne vint dans la Syrie que dix ans après le temps marqué par Luc; elle était alors gouvernée par Quintilius Varus, comme Tertullien le rapporte, et comme il est confirmé par les médailles.'
On avouera qu'en effet il n'y eut jamais de dénombrement de tout l'empire romain, et qu'il n'y eut qu'un cens des citoyens romains, selon l'usage. Il se peut que des copistes aient écrit dénombrement pour cens . A l'égard de Cirénius que les copistes ont transcrit Cirinus, il est certain qu'il n'était pas gouverneur de la Syrie dans le temps de la naissance de notre Sauveur, et que c'était alors Quintilius Varus; mais il est très naturel que Quintilius Varus ait envoyé en Judée ce même Cirénius qui lui succéda dix ans après dans le gouvernement de la Syrie. On ne doit pas dissimuler que cette explication laisse encore quelques difficultés.
Premièrement, le cens fait sous Auguste ne se rapporte point au temps de la naissance de Jésus-Christ.
Secondement, les Juifs n'étaient point compris dans ce cens. Joseph et son épouse n'étaient point citoyens romains. Marie ne devait donc point, dit-on, partir de Nazareth qui est à l'extrémité de la Judée, à quelques milles du mont Thabor, au milieu du désert, pour aller accoucher à Bethléem, qui est à quatre-vingts milles de Nazareth.
Mais il se peut très aisément que Cirinus ou Cirénius étant venu à Jérusalem de la part de Quintilius Varus pour imposer un tribut par tête, Joseph et Marie eussent reçu l'ordre du magistrat de Bethléem de venir se présenter pour payer le tribut dans le bourg de Bethléem lieu de leur naissance; il n'y a rien là qui soit contradictoire.
Les critiques peuvent tâcher d'infirmer cette solution, en représentant que c'était Hérode seul qui imposait les tributs; que les Romains ne levaient rien alors sur la Judée; qu'Auguste laissait Hérode maître absolu chez lui, moyennant le tribut que cet Iduméen payait à l'empire. Mais on peut dans un besoin s'arranger avec un prince tributaire, et lui envoyer un intendant, pour établir de concert avec lui la nouvelle taxe.
Nous ne dirons point ici comme tant d'autres, que les copistes ont commis beaucoup de fautes, et qu'il y en a plus de dix mille dans la version que nous avons. Nous aimons mieux dire avec les docteurs et les plus éclairés, que les Evangiles nous ont été donnés pour nous enseigner à vivre saintement, et non pas à critiquer savamment.
Ces prétendues contradictions firent un effet bien terrible sur le déplorable Jean Mêlier curé d'Etrepigni et de But en Champagne; cet homme, vertueux à la vérité, et très charitable, mais sombre et mélancolique, n'ayant guère d'autres livres que la Bible et quelques Pères, les lut avec une attention qui lui devint fatale; il ne fut pas assez docile, lui qui devait enseigner la docilité à son troupeau. Il vit les contradictions apparentes, et ferma les yeux sur la conciliation. Il crut voir des contraditions affreuses entre Jésus né Juif, et ensuite reconnu Dieu; entre ce Dieu connu d'abord pour le fils de Joseph charpentier et le frère de Jacques, mais descendu d'un empirée qui n'existe point; pour détruire le péché sur la terre, et la laissant couverte de crimes; entre ce Dieu né d'un vil artisan, et descendant de David par son père qui n'était pas son père; entre le Créateur de tous les mondes et le petit-fils de l'adultère Betzabé, de l'impudente Ruth, de l'incestueuse Thamar, de la prostituée de Jérico et de la femme d'Abraham ravie par un roi d'Egypte, ravie ensuite à l'âge de quatre-vingt-dix ans.
Mêlier étale avec une impiété monstrueuse toutes ces prétendues contradictions qui le frappèrent, et dont il lui aurait été aisé de voir la solution pour peu qu'il êut eu l'esprit docile. Enfin sa tristesse s'augmentant dans la solitude, il eut le malheur de prendre en horreur la sainte religion qu'il devait prêcher et aimer; et n'écoutant plus que sa raison séduite, il abjura le christianisme par un testament olographe, dont il laissa trois copies à sa mort arrivée en 1732. L'extrait de ce testament a été imprimé plusieurs fois, et c'est un scandale bien cruel. Un curé qui demande pardon à Dieu et à ses paroissiens, en mourant, de leur avoir enseigné des dogmes chrétiens! un curé charitable qui a le christianisme en exécration, parce que plusieurs chrétiens sont méchants, que le faste de Rome le révolte, et que les difficultés des saints livres l'irritent! un curé qui parle du christianisme comme Porphire, Jamblique, Epictète, Marc-Aurèle, Julien! et cela lorsqu'il est prêt de paraître devant Dieu! quel coup funeste pour lui et pour ceux que son exemple peut égarer!
C'est ainsi que le malheureux prédicant Antoine, trompé par les contradictions apparentes qu'il crut voir entre la nouvelle loi et l'ancienne, entre l'olivier franc et l'olivier sauvage, eut le malheur de quitter la religion chrétienne pour la religion juive; et plus hardi que Jean Mêlier, il aima mieux mourir que se rétracter.
On voit par le testament de Jean Mêlier, que c'étaient surtout les contrariétés apparentes des Evangiles, qui avaient bouleversé l'esprit de ce malheureux pasteur d'ailleurs d'une vertu rigide, et qu'on ne peut regarder qu'avec compassion. Mêlier est profondément frappé des deux généalogies qui semblent se combattre; il n'en avait pas vu la conciliation; il se soulève; il se dépite, en voyant que St Matthieu fait aller le père, la mère et l'enfant en Egypte, après avoir reçu l'hommage des trois mages ou rois d'Orient, et pendant que le vieil Hérode craignant d'être détrôné par un enfant qui vient de naître à Bethléem, fait égorger tous les enfants du pays, pour prévenir cette révolution. Il est étonné que ni St Luc, ni St Jean, ni St Marc ne parlent de ce massacre. Il est confondu quand il voit que St Luc fait rester St Joseph, la bienheureuse vierge Marie, et Jésus notre Sauveur à Bethléem, après quoi ils se retirèrent à Nazareth. Il devait voir que la Sainte Famille pouvait aller d'abord en Egypte et quelque temps après à Nazareth sa patrie.
Si St Matthieu seul parle des trois mages et de l'étoile qui les conduisit du fond de l'Orient à Bethléem, et du massacre des enfants; si les autres évangélistes n'en parlent pas, ils ne contredisent point St Matthieu; le silence n'est point une contradiction.
Si les trois premiers évangélistes, St Matthieu, St Marc et St Luc ne font vivre Jésus-Christ que trois mois depuis son baptème en Galilée jusqu'à son supplice à Jérusalem; et si St Jean le fait vivre trois ans et trois mois, il est aisé de rapprocher St Jean des trois autres évangélistes, puisqu'il ne dit point expressément que Jésus-Christ prêcha en Galilée pendant trois ans et trois mois, et qu'on l'infère seulement de ses récits. Fallait-il renoncer à sa religion sur de simples inductions, sur de simples raisons de controverse, sur des difficultés de chronologie?
Il est impossible, dit Mêlier, d'accorder St Matthieu et St Luc, quand le premier dit que Jésus en sortant du désert alla à Capharnaum, et le second qu'il alla à Nazareth.
St Jean dit que ce fut André qui s'attacha le premier à Jésus-Christ, les trois autres évangélistes disent que ce fut Simon Pierre.
Il prétend encore qu'ils se contredisent sur le jour où Jésus célébra sa pâque, sur l'heure de son supplice, sur le lieu, sur le temps de son apparition, de sa résurrection. Il est persuadé que des livres qui se contredisent, ne peuvent être inspirés par le Saint-Esprit; mais il n'est pas de foi que le Saint-Esprit ait inspiré toutes les syllabes; il ne conduisit pas la main de tous les copistes, il laissa agir les causes secondes: c'était bien assez qu'il daignât nous révéler les principaux mystères, et qu'il instituât dans la suite des temps une église pour les expliquer. Toutes ces contradictions reprochées si souvent aux Evangiles avec une si grande amertume, sont mises au grand jour par les sages commentateurs; loin de se nuire, elles s'expliquent chez eux l'une par l'autre, elles se prêtent un mutuel secours dans les concordances, et dans l'harmonie des quatre Evangiles.
Et s'il y a plusieurs difficultés qu'on ne peut expliquer, des profondeurs qu'on ne peut comprendre, des aventures qu'on ne peut croire, des prodiges qui révoltent la faible raison humaine, des contradictions qu'on ne peut concilier; c'est pour exercer notre foi et pour humilier notre esprit.
CONTRADICTIONS DANS LES JUGEMENS SUR LES OUVRAGES.
J'ai quelquefois entendu dire d'un bon juge pleine de goût: cet homme ne décide que par humeur. Il trouvait hier le Poussin un peintre admirable: aujourd'hui il le trouve très médiocre. C'est que le Poussin en effet a mérité de grands éloges, et des critiques.
On ne se contredit point quand on est en extase devant les belles scènes d'Horace et de Curiace, du Cid et de Chimène, d'Auguste et de Cinna; et qu'on voit ensuite avec un soulèvement de coeur mêlé de la plus vive indignation quinze tragédies de suite sans aucun intérêt, sans aucune beauté, et qui ne sont pas même écrites en français.
C'est l'auteur qui se contredit: c'est lui qui a le malheur d'être entièrement différent de lui-même. Le juge se contredirait, s'il applaudissait également l'excellent et le détestable. Il doit admirer dans Homère la peinture des Prières , qui marchent après l' Injure les yeux mouillés de pleurs; la ceinture de Vénus; les adieux d'Hector et d'Andromaque; l'entrevue d'Achille et de Priam. Mais doit-il applaudir de même à des dieux qui se disent des injures et qui se battent; à l'uniformité des combats qui ne décident rien; à la brutale férocité des héros; à l'avarice qui les domine presque tous; enfin à un poème qui finit par une trêve de onze jours, laquelle fait sans doute attendre la continuation de la guerre et la prise de Troye que cependant on ne trouve point?
Le bon juge passe souvent de l'approbation au blâme, quelque bon livre qu'il puisse lire. Voyez Goût .
CONTRASTE. [p. 257] ↩
Contraste: opposition de figures, de situations, de fortune, de moeurs, etc. Une bergère ingénue fait un beau contraste dans un tableau avec une princesse orgueilleuse. Le rôle de l'Imposteur et celui d'Ariste font un contraste admirable dans le Tartuffe .
Le petit peut contraster avec le grand dans la peinture, mais on ne peut dire qu'il lui est contraire. Les oppositions de couleurs contrastent, mais aussi il y a des couleurs contraires les unes aux autres, c'est-à-dire, qui font un mauvais effet parce qu'elles choquent les yeux lorsqu'elles sont rapprochées.
Contradictoire ne peut se dire que dans la dialectique. Il est contradictoire qu'une chose soit et ne soit pas, qu'elle soit en plusieurs lieux à la fois, qu'elle soit d'un tel nombre, d'une telle grandeur, et qu'elle n'en soit pas. Cette opinion, ce discours, cet arrêt sont contradictoires.
Les diverses fortunes de Charles XII ont été contraires, mais non pas contradictoires; elles forment dans l'histoire un beau contraste.
C'est un grand contraste, et ce sont deux choses bien contraires; mais il n'est point contradictoire que le pape ait été adoré à Rome et brûlé à Londres le même jour, et que pendant qu'on l'appelait vice-Dieu en Italie, il ait été représenté en cochon dans les rues de Moscou, pour l'amusement de Pierre le Grand.
Mahomet mis à la droite de Dieu dans la moitié du globe, et damné dans l'autre, est dans le plus grand des contrastes.
Voyagez loin de votre pays, tout sera contraste pour vous.
Le blanc qui le premier vit un nègre fut bien étonné; mais le premier raisonneur qui dit que ce nègre venait d'une paire blanche, m'étonne bien davantage; son opinion est contraire à la mienne. Un peintre qui représente des blancs, des nègres et des olivâtres, peut faire de beaux contrastes.
CONVULSIONS. [p. 258] ↩
On dansa vers l'an 1724 sur le cimetière de St Médard; il s'y fit beaucoup de miracles: en voici un rapporté dans une chanson de Mme la duchesse du Maine,
Un décrotteur à la royale
Du talon gauche estropié,
Obtint pour grâce spéciale
D'être boiteux de l'autre pied.
Les convulsions miraculeuses, comme on sait, continuèrent jusqu'à ce qu'on eût mis une garde au cimetière.
De par le roi, défense à Dieu
De plus fréquenter en ce lieu.
Les jésuites, comme on le sait encore, ne pouvant plus faire de tels miracles depuis que leur Xavier avait épuisé les grâces de la compagnie à ressusciter neuf morts de compte fait, s'avisèrent, pour balancer le crédit des jansénistes, de faire graver une estampe de Jésus-Christ habillé en jésuite. Un plaisant du parti janséniste, comme on le sait encore, mit au bas de l'estampe:
Admirez l'artifice extrême
De ces moines ingénieux;
Ils vous ont habillé comme eux,
Mon Dieu, de peur qu'on ne vous aime.
Les jansénistes pour mieux prouver que jamais Jésus-Christ n'avait pu prendre l'habit de jésuite, remplirent Paris de convulsions, et attirèrent le monde à leur préau. Le conseiller au parlement, Carré de Montgeron, alla présenter au roi un recueil in -4 o de tous ces miracles, attestés par mille témoins; il fut mis, comme de raison, dans un château, où l'on tâcha de rétablir son cerveau par le régime; mais la vérité l'emporte toujours sur les persécutions; les miracles se perpétuèrent trente ans de suite, sans discontinuer. On faisait venir chez soi soeur Rose, soeur Illuminée, soeur Promise, soeur Confite; elles se faisaient fouetter, sans qu'il y parût le lendemain; on leur donnait des coups de bûches sur leur estomac bien cuirassé, bien rembourré, sans leur faire de mal; on les couchait devant un grand feu, le visage frotté de pommade, sans qu'elles brûlassent; enfin, comme tous les arts se perfectionnent, on a fini par leur enfoncer des épées dans les chairs, et par les crucifier. Un fameux maître d'école même a eu aussi l'avantage d'être mis en croix: tout cela pour convaincre le monde qu'une certaine bulle était ridicule, ce qu'on aurait pu prouver sans tant de frais. Cependant, et jésuites et jansénistes, se réunirent tous contre l' Esprit des lois , et contre. . . et contre. . . et contre. . . et contre. . . Et nous osons après cela nous moquer des Lapons, des Samoyèdes et des nègres, ainsi que nous l'avons dit tant de fois!
DES COQUILLES. [p. 259] ↩
ET DES SYSTEMES BATIS SUR DES COQUILLES.
Il est arrivé aux coquilles la même chose qu'aux anguilles; elles ont fait éclore des systèmes nouveaux. On trouve dans quelques endroits de ce globe des amas de coquillages, on voit dans quelques autres des huîtres pétrifiées: de là on a conclu que malgré les lois de la gravitation et celles des fluides, et malgré la profondeur du lit de l'océan, la mer avait couvert toute la terre il y a quelques millions d'années.
La mer ayant inondé ainsi successivement la terre, a formé les montagnes par ses courants, par ses marées; et quoique son flux ne s'élève qu'à la hauteur de quinze pieds dans ses plus grandes intumescences sur nos côtes, elle a produit des roches hautes de dix-huit mille pieds.
Si la mer a été partout, il y a eu un temps où le monde n'était peuplé que de poissons. Peu à peu les nageoires sont devenues des bras, la queue fourchue s'étant allongée a formé des cuisses et des jambes; enfin les poissons sont devenus des hommes, et tout cela s'est fait en conséquence des coquilles qu'on a déterrées. Ces systèmes valent bien l'horreur du vide, les formes substantielles, la matière globuleuse, subtile, cannelée, striée, la négation de l'existence des corps, la baguette divinatoire de Jacques Aimard, l'harmonie préétablie, et le mouvement perpétuel.
Il y a, dit-on, des débris immenses de coquilles auprès de Mastricht. Je ne m'y oppose pas, quoique je n'y en aie vu qu'une très petite quantité. La mer a fait d'horribles ravages dans ces quartiers-là; elle a englouti la moitié de la Frise, elle a couvert des terrains autrefois fertiles, elle en a abandonné d'autres. C'est une vérité reconnue, personne ne conteste les changements arrivés sur la surface du globe dans une longue suite de siècles. Il se peut physiquement, et sans oser contredire nos livres sacrés, qu'un tremblement de terre ait fait disparaître l'île Atlantide neuf mille ans avant Platon, comme il le rapporte, quoique ses mémoires ne soient pas sûrs. Mais tout cela ne prouve pas que la mer ait produit le mont Caucase, les Pyrénées et les Alpes.
On prétend qu' il y a des fragments de coquillages à Montmartre et à Courtagnon auprès de Rheims . On en rencontre presque partout; mais non pas sur la cime des montagnes, comme le suppose le système de Maillet.
Il n'y en a pas un seul sur la chaîne des hautes montagnes depuis la Sierra-Morena jusqu'à la dernière cime de l'Apennin. J'en ai fait chercher sur le mont St Godard, sur le St Bernard, dans les montagnes de la Tarentaise, on n'en a pas découvert.
Un seul physicien m'a écrit qu'il a trouvé une écaille d'huître pétrifiée vers le mont Cenis. Je dois le croire, et je suis très étonné qu'on n'y en ait pas vu des centaines. Les lacs voisins nourrissent de grosses moules dont l'écaille ressemble parfaitement aux huîtres; on les appelle même petites huîtres dans plus d'un canton.
Est-ce d'ailleurs une idée tout à fait romanesque de faire réflexion à la foule innombrable de pèlerins qui partaient à pied de St Jacques en Galice, et de toutes les provinces pour aller à Rome par le mont Cenis chargés de coquilles à leurs bonnets? Il en venait de Syrie, d'Egypte, de Grèce, comme de Pologne et d'Autriche. Le nombre des romipètes a été mille fois plus considérable que celui des hadjis qui ont visité la Mecque et Médine, parce que les chemins de Rome sont plus faciles, et qu'on n'était pas forcé d'aller par caravanes. En un mot, une huître près du mont Cenis ne prouve pas que l'océan Indien ait enveloppé toutes les terres de notre hémisphère.
On rencontre quelquefois en fouillant la terre des pétrifications étrangères, comme on rencontre dans l'Autriche des médailles frappées à Rome. Mais pour une pétrification étrangère il y en a mille de nos climats.
Quelqu'un a dit qu'il aimerait autant croire le marbre composé de plumes d'autruches que de croire le porphyre composé de pointes d'oursin. Ce quelqu'un là avait grande raison, si je ne me trompe.
On découvrit, ou l'on crut découvrir il y a quelques années, les ossements d'un renne et d'un hippopotame près d'Etampes, et de là on conclut que le Nil et la Lapponie avaient été autrefois sur le chemin de Paris à Orléans. Mais on aurait dû plutôt soupçonner qu'un curieux avait eu autrefois dans son cabinet le squelette d'un renne et celui d'un hippopotame. Cent exemples pareils invitent à examiner longtemps avant que de croire.
AMAS DE COQUILLES.
Mille endroits sont remplis de mille débris de testacés, de crustacés, de pétrifications. Mais remarquons encore une fois, que ce n'est presque jamais ni sur la croupe, ni dans les flancs de cette continuité de montagnes dont la surface du globe est traversée; c'est à quelques lieues de ces grands corps, c'est au milieu des terres, c'est dans des cavernes, dans des lieux où il est très vraisemblable qu'il y avait de petits lacs qui ont disparu, de petites rivières dont le cours est changé, des ruisseaux considérables dont la source est tarie. Vous y voyez des débris de tortues, d'écrevisses, de moules, de colimaçons, de petits crustacés de rivière, de petites huîtres semblables à celles de Lorraine. Mais de véritables corps marins, c'est ce que vous ne voyez jamais. S'il y en avait, pourquoi n'y aurait-on jamais vu d'os de chiens marins, de requins, de baleines?
Vous prétendez que la mer a laissé dans nos terres des marques d'un très long séjour. Le monument le plus sûr serait assurément quelques amas de marsouins au milieu de l'Allemagne. Car vous en voyez des milliers se jouer sur la surface de la mer Germanique dans un temps serein. Quand vous les aurez découverts et que je les aurai vus à Nuremberg et à Francfort, je vous croirai: mais en attendant permettez-moi de ranger la plupart de ces suppositions avec celle du vaisseau pétrifié trouvé dans le canton de Berne à cent pieds sous terre, tandis qu'une de ses ancres était sur le mont St Bernard.
J'ai vu quelquefois des débris de moules et de colimaçons qu'on prenait pour des coquilles de mer.
Si on songeait seulement que dans une année pluvieuse il y a plus de limaçons dans dix lieues de pays que d'hommes sur la terre, on pourrait se dispenser de chercher ailleurs l'origine de ces fragments de coquillages dont le bord du Rhône et ceux des autres rivières sont tapissés dans l'espace de plusieurs milles. Il y a beaucoup de ces limaçons dont le diamètre est de plus d'un pouce. Leur multitude détruit quelquefois les vignes et les arbres fruitiers. Les fragments de leurs coques endurcies sont partout. Pourquoi donc imaginer que des coquillages des Indes sont venus s'amonceler dans nos climats quand nous en avons chez nous par millions? Tous ces petits fragments de coquilles dont on fait tant de bruit pour accréditer un système, sont pour la plupart si informes, si usés, si méconnaissables, qu'on pourrait également parier que ce sont des débris d'écrevisses ou de crocodiles, ou des ongles d'autres animaux. Si on trouve une coquille bien conservée dans le cabinet d'un curieux, on ne sait d'où elle vient; et je doute qu'elle puisse servir de fondement à un système de l'univers.
Je ne nie pas, encore une fois, qu'on ne rencontre à cent milles de la mer quelques huîtres pétrifiées, des conques, des univalves, des productions qui ressemblent parfaitement aux productions marines; mais est-on bien sûr que le sol de la terre ne peut enfanter ces fossiles? La formation des agates arborisées ou herborisées, ne doit-elle pas nous faire suspendre notre jugement? Un arbre n'a point produit l'agate qui représente parfaitement un arbre; la mer peut aussi n'avoir point produit ces coquilles fossiles qui ressemblent à des habitations de petits animaux marins. L'expérience suivante en peut rendre témoignage.
OBSERVATION IMPORTANTE SUR LA FORMATION DES PIERRES ET DES COQUILLES.
Monsieur Le Royer de la Sauvagère, ingénieur en chef, et de l'Académie des belles-lettres de la Rochelle, seigneur de la terre de Places en Touraine auprès de Chinon, atteste qu'auprès de son château une partie du sol s'est métamorphosée deux fois en un lit de pierre tendre dans l'espace de quatre-vingts ans. Il a été témoin lui-même de ce changement. Tous ses vassaux, et tous ses voisins l'ont vu. Il a bâti avec cette pierre qui est devenue très dure étant employée. La petite carrière dont on l'a tirée recommence à se former de nouveau. Il y renaît des coquilles qui d'abord ne se distinguent qu'avec un microscope, et qui croissent avec la pierre. Ces coquilles sont de différentes espèces; il y a des ostracites, des gryphites qui ne se trouvent dans aucune de nos mers; des cames, des tellines, des coeurs dont les germes se développent insensiblement, et s'étendent jusqu'à six lignes d'épaisseur.
N'y-t-il pas là de quoi étonner du moins ceux qui affirment que tous les coquillages qu'on rencontre dans quelques endroits de la terre, y ont été déposés par la mer?
Si on ajoute à tout ce que nous avons déjà dit, ce phénomène de la terre de Places; si d'un autre côté on considère que le fleuve de Gambie et la rivière de Bissao sont remplis d'huîtres, que plusieurs lacs en ont fourni autrefois, et en ont encore, ne sera-t-on pas porté à suspendre son jugement? notre siècle commence à bien observer; il appartiendra aux siècles suivants de décider, mais probablement on sera un jour assez savant pour ne décider pas.
DE LA GROTTE DES FÉES.
Les grottes où se forment les stalactites et les stalagmites sont communes. Il y en a dans presque toutes les provinces. Celle du Chablais est peut-être la moins connue des physiciens, et qui mérite le plus de l'être. Elle est située dans des rochers affreux au milieu d'une forêt d'épines, à deux petites lieues de Ripaille, dans la paroisse de Féterne. Ce sont trois grottes en voûte l'une sur l'autre, taillées à pic par la nature dans un roc inabordable. On n'y peut monter que par une échelle, et il faut s'élancer ensuite dans ces cavités en se tenant à des branches d'arbres. Cet endroit est appelé par les gens du lieu les grottes des fées . Chacune a dans son fond un bassin dont l'eau passe pour avoir la même vertu que celle de Ste Reine. L'eau qui distille dans la supérieure à travers le rocher, y a formé dans la voûte la figure d'une poule qui couve des poussins. Auprès de cette poule est une autre concrétion qui ressemble parfaitement à un morceau de lard avec sa couenne, de la longueur de près de trois pieds.
Dans le bassin de cette même grotte où l'on se baigne, on trouve des figures de pralines telles qu'on les vend chez des confiseurs, et à côté la forme d'un rouet ou tour à filer avec la quenouille. Les femmes des environs prétendent avoir vu dans l'enfoncement une femme pétrifiée, au-dessous du rouet. Mais les observateurs n'ont point vu en dernier lieu cette femme. Peut-être les concrétions stalactites avaient dessiné autrefois une figure informe de femme; et c'est ce qui fit nommer cette caverne la grotte des fées . Il fut un temps qu'on n'osait en approcher; mais depuis que la figure de la femme a disparu, on est devenu moins timide.
Maintenant, qu'un philosophe à système raisonne sur ce jeu de la nature, ne pourrait-il pas dire: Voilà des pétrifications véritables! Cette grotte était habitée, sans doute, autrefois par une femme; elle filait au rouet, son lard était pendu au plancher, elle avait auprès d'elle sa poule avec ses poussins; elle mangeait des pralines, lorsqu'elle fut changée en rocher elle et ses poulets, et son lard, et son rouet, et sa quenouille, et ses pralines; comme Edith femme de Loth fut changée en statue de sel. L'antiquité fourmille de ces exemples.
Il serait bien plus raisonnable de dire, Cette femme fut pétrifiée, que de dire, Ces petites coquilles viennent de la mer des Indes; cette écaille fut laissée ici par la mer il y a cinquante mille siècles; ces glossopètres sont des langues de marsouins qui s'assemblèrent un jour sur cette colline pour n'y laisser que leurs gosiers; ces pierres en spirale renfermaient autrefois le poisson Nautilus que personne n'a jamais vu.
DU FALLUN DE TOURAINE ET DE SES COQUILLES.
On regarde enfin le falun de Touraine comme le monument le plus incontestable de ce séjour de l'océan sur notre continent dans une multitude prodigieuse de siècles; et la raison, c'est qu'on prétend que cette mine est composée de coquilles pulvérisées.
Certainement si à trente-six lieues de la mer il était d'immenses bancs de coquillages marins, s'ils étaient posés à plat par couches régulières, il serait démontré que ces bancs ont été le rivage de la mer: et il est d'ailleurs très vraisemblable que des terrains bas et plats ont été tour à tour couverts et dégagés des eaux jusqu'à trente et quarante lieues; c'est l'opinion de toute l'antiquité. Une mémoire confuse s'en est conservée, et c'est ce qui a donné lieu a tant de fables.
Nil equidem durare diu sub imagine eadem
Crediderim. Sic ad ferrum venistis ab auro
Saecula. Sic toties versa est fortuna locorum .
Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus
Esse fretum. Vidi factas ex aequore terras :
Et procul a pelago conchae jacuere marinae :
Et vetus inventa est in montibus anchora summis . [38]
Quodque fuit campus, vallem decursus aquarum
Fecit: et eluvie mons est deductus in aequor :
Eque paludosa siccis humus aret arenis :
Quaeque sitim tulerant, stagnata paludibus hument .
C'est ainsi que Pythagore s'explique dans Ovide. Voici une imitation de ces vers qui en donnera l'idée.
Le temps qui donne à tous le mouvement et l'être,
Produit, accroît, détruit, fait mourir, fait renaître,
Change tout dans les cieux, sur la terre et dans l'air.
L'âge d'or à son tour suivra l'âge de fer.
Flore embellit des champs l'aridité sauvage.
La mer change son lit, son flux et son rivage.
Le limon qui nous porte est né du sein des eaux.
Où croissent les moissons, voguèrent les vaisseaux.
La main lente du temps aplanit les montagnes;
Il creuse les vallons, il étend les campagnes;
Tandis que l'Eternel, le souverain des temps
Demeure inébranlable en ces grands changements.
Mais pourquoi cet océan n'a-t-il formé aucune montagne sur tant de côtes plates livrées à ses marées? Et pourquoi s'il a déposé des amas prodigieux de coquilles en Touraine, n'a-t-il pas laissé les mêmes monuments dans les autres provinces à la même distance?
D'un côté je vois plusieurs lieues de rivages au niveau de la mer dans la basse Normandie: Je traverse la Picardie, la Flandre, la Hollande, la basse Allemagne, la Poméranie, la Prusse, la Pologne, la Russie, une grande partie de la Tartarie, sans qu'une seule haute montagne, faisant partie de la grande chaîne, se présente à mes yeux. Je puis franchir ainsi l'espace de deux mille lieues dans un terrain assez uni, à quelques collines près. Si la mer répandue originairement sur notre continent avait fait les montagnes, comment n'en a-t-elle pas fait une seule dans cette vaste étendue?
De l'autre côté ces prétendus bancs de coquilles à trente, à quarante lieues de la mer, méritent le plus sérieux examen. J'ai fait venir de cette province dont je suis éloigné de cent cinquante lieues, une caisse de ce falun. Le fond de cette minière est évidemment une espèce de terre calcaire et marneuse, mêlée de talc, laquelle a quelques lieues de longueur sur environ une et demie de largeur. Les morceaux purs de cette terre pierreuse sont un peu salés au goût. Les laboureurs l'emploient pour féconder leurs terres, et il est très vraisemblable que son sel les fertilise: on en fait autant dans mon voisinage avec du gypse. Si ce n'était qu'un amas de coquilles, je ne vois pas qu'il pût fumer la terre. J'aurais beau jeter dans mon champ toutes les coques desséchées des limaçons et des moules de ma province, ce serait comme si j'avais semé sur des pierres.
Quoique je sois sûr de peu de choses, je puis affirmer que je mourrais de faim, si je n'avais pour vivre qu'un champ de vieilles coquilles cassées. [39]
En un mot, il est certain, autant que mes yeux peuvent avoir de certitude, que cette marne est une espèce de terre, et non pas un assemblage d'animaux marins, qui seraient au nombre de plus de cent mille milliards de milliards. Je ne sais pourquoi l'académicien qui le premier après Palissi fit connaître cette singularité de la nature, a pu dire, Ce ne sont que de petits fragments de coquilles très reconnaissables pour en être des fragments; car ils ont leurs cannelures très bien marquées, seulement ils ont perdu leur luisant et leur vernis .
Il est reconnu que dans cette mine de pierre calcaire et de talc on n'a jamais vu une seule écaille d'huître, mais qu'il y en a quelques-unes de moules, parce que cette mine est entourée d'étangs. Cela seul décide la question contre Bernard Palissi, et détruit tout le merveilleux que Réaumur et ses imitateurs ont voulu y mettre.
Si quelques petits fragments de coquilles mêlés à la terre marneuse, étaient réellement des coquilles de mer, il faudrait avouer qu'elles sont dans cette falunière depuis des temps reculés qui épouvantent l'imagination, et que c'est un des plus anciens monuments des révolutions de notre globe. Mais aussi, comment une production enfouie quinze pieds en terre pendant tant de siècles, peut-elle avoir l'air si nouveau? Comment y a-t-on trouvé la coquille d'un limaçon toute fraîche? pourquoi la mer n'aurait-elle confié ces coquilles tourangeotes qu'à ce seul petit morceau de terre et non ailleurs? N'est-il pas de la plus extrême vraisemblance que ce falun qu'on avait pris pour un réservoir de petits poissons, n'est précisément qu'une mine de pierre calcaire d'une médiocre étendue?
D'ailleurs l'expérience de M. de la Sauvagère qui a vu des coquillages se former dans une pierre tendre, et qui en rend témoignage avec ses voisins, ne doit-elle pas au moins nous inspirer quelques doutes?
Voici une autre difficulté, un autre sujet de douter. On trouve entre Paris et Arcueil, sur la rive gauche de la Seine, un banc de pierre très long, tout parsemé de coquilles maritimes, ou qui du moins leur ressemblent parfaitement. On m'en a envoyé un morceau pris au hasard à cent pieds de profondeur. Il s'en faut bien que les coquilles y soient amoncelées par couches: elles y sont éparses et dans la plus grande confusion. Cette confusion seule contredit la régularité prétendue qu'on attribue au falun de Touraine.
Enfin, si ce falun a été produit à la longue dans la mer, elle est donc venue à près de quarante lieues dans un pays plat, et elle n'y a point formé de montagnes. Il n'est donc nullement probable que les montagnes soient des productions de l'océan. De ce que la mer serait venue à quarante lieues, s'ensuivrait-il qu'elle aurait été partout?
IDÉES DE PALISSI SUR LES COQUILLES PRÉTENDUES.
Avant que Bernard Palissi eût prononcé que cette mine de marne de trois lieues d'étendue n'était qu'un amas de coquilles, les agriculteurs étaient dans l'usage de se servir de cet engrais, et ne soupçonnaient pas que ce fussent uniquement des coquilles qu'ils employassent. N'avaient-ils pas des yeux? Pourquoi ne crut-on pas Palissi sur sa parole? Ce Palissi d'ailleurs était un peu visionnaire. Il fit imprimer le livre intitulé: Le Moyen de devenir riche et la manière véritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier et à augmenter leur trésor et possessions, par maître Bernard Palissi inventeur des rustiques figulines du roi . Il tint à Paris une école, où il fit afficher qu'il rendrait l'argent à ceux qui lui prouveraient la fausseté de ses opinions. En un mot, Palissi crut avoir trouvé la pierre philosophale. Son grand oeuvre décrédita ses coquilles jusqu'au temps où elles furent remises en honneur par un académicien célèbre qui enrichit les découvertes des Swammerdam, des Leuvenhoeck, par l'ordre dans lequel il les plaça, et qui voulut rendre de grands services à la physique. L'expérience, comme on l'a déjà dit, est trompeuse; il faut donc examiner encore ce falun. Il est certain qu'il pique la langue par une légère âcreté, c'est un effet que des coquilles ne produiront pas. Il est indubitable que le falun est une terre calcaire et marneuse. Il est indubitable aussi qu'elle renferme quelques coquilles de moules à dix à quinze pieds de profondeur. L'auteur estimable de l' Histoire naturelle , aussi profond dans ses vues qu'attrayant par son style, dit expressément: Je prétends que les coquilles sont l'intermède que la nature emploie pour former la plupart des pierres. Je prétends que les craies, les marnes, et les pierres à chaux ne sont composées que de poussière et de détriments de coquilles .
On peut aller trop loin, quelque habile physicien que l'on soit. J'avoue que j'ai examiné pendant douze ans de suite la pierre à chaux que j'ai employée, et que ni moi, ni aucun des assistants n'y avons aperçu le moindre vestige de coquilles.
A-t-on donc besoin de toutes ces suppositions pour prouver les révolutions que notre globe a essuyées dans des temps prodigieusement reculés? Quand la mer n'aurait abandonné et couvert tour à tour les terrains bas de ses rivages que le long de deux mille lieues sur quarante de large dans les terres, ce serait un changement sur la surface du globe de quatre-vingt mille lieues carrées.
Les éruptions des volcans, les tremblements, les affaissements des terrains doivent avoir bouleversé une assez grande quantité de la surface du globe; des lacs, des rivières ont disparu, des villes ont été englouties; des îles se sont formées; des terres ont été séparées: les mers intérieures ont pu opérer des révolutions beaucoup plus considérables. N'en voilà-t-il pas assez? Si l'imagination aime à se représenter ces grandes vicissitudes de la nature, elle doit être contente.
J'avoue encore qu'il est démontré aux yeux qu'il a fallu une prodigieuse multitude de siècles pour opérer toutes les révolutions arrivées dans ce globe, et dont nous avons des témoignages incontestables. Les quatre cent soixante et dix mille ans dont les Babiloniens précepteurs des Egyptiens se vantaient, ne suffisent peut-être pas: mais je ne veux point contredire la Genèse que je regarde avec vénération. Je suis partagé entre ma faible raison qui est mon seul flambeau, et les livres sacrés juifs auxquels je n'entends rien du tout. Je me borne toujours à prier Dieu que des hommes ne persécutent pas des hommes, qu'on ne fasse pas de cette terre si souvent bouleversée une vallée de misères et de larmes, dans laquelle des serpents destinés à ramper quelques minutes dans leurs trous, dardent continuellement leur venin les uns contre les autres.
DU SYSTEME DE MAILLET, QUI DE L'INSPECTION DES COQUILLES CONCLUT QUE LES POISSONS SONT LES PREMIERS PÈRES DES HOMMES.
Maillet, dont nous avons déjà parlé, crut s'apercevoir au grand Caire que notre continent n'avait été qu'une mer dans l'éternité passée; il vit des coquilles; et voici comme il raisonna: Ces coquilles prouvent que la mer a été pendant des milliers de siècles à Memphis; donc les Egyptiens et les singes viennent incontestablement des poissons marins.
Les anciens habitants des bords de l'Euphrate ne s'éloignaient pas beaucoup de cette idée, quand ils débitèrent que le fameux poisson Oannès sortait tous les jours du fleuve pour les venir catéchiser sur le rivage. Dercéto qui est la même que Vénus, avait une queue de poisson. La Vénus d'Hésiode nacquit de l'écume de la mer.
C'est peut-être suivant cette cosmogonie qu'Homère dit que l'Océan est le père de toutes choses; mais par ce mot d' océan , il n'entend, dit-on, que le Nil, et non notre mer Océane qu'il ne connaissait pas.
Thalès apprit aux Grecs que l'eau est le premier principe de la nature. Ses raisons sont, que la semence de tous les animaux est aqueuse, qu'il faut de l'humidité à toutes les plantes, et qu'enfin les étoiles sont nourries des exhalaisons humides de notre globe. Cette dernière raison est merveilleuse: et il est plaisant qu'on parle encore de Thalès et qu'on veuille savoir ce qu'Athénée et Plutarque en pensaient.
Cette nourriture des étoiles n'aurait pas réussi dans notre temps; et malgré les sermons du poisson Oannès, les arguments de Thalès, les imaginations de Maillet, malgré l'extrême passion qu'on a aujourd'hui pour les généalogies, il y a peu de gens qui croient descendre d'un turbot ou d'une morue. Pour étayer ce système, il fallait absolument que toutes les espèces et tous les éléments se changeassent les uns en les autres. Les Métamorphoses d'Ovide devenaient le meilleur livre de physique qu'on ait jamais écrit.
Notre globe a eu sans doute ses métamorphoses, ses changements de forme; et chaque globe a eu les siennes, puisque tout étant en mouvement, tout a dû nécessairement changer: il n'y a que l'immobile qui soit immuable, la nature est éternelle, mais nous autres nous sommes d'hier. Nous découvrons mille signes de variations sur notre petite sphère. Ces signes nous apprennent que cent villes ont été englouties, que des rivières ont disparu, que dans de longs espaces de terrain on marche sur des débris. Ces épouvantables révolutions accablent notre esprit. Elles ne sont rien du tout pour l'univers, et presque rien pour notre globe. La mer qui laisse des coquilles sur un rivage qu'elle abandonne, est une goutte d'eau qui s'évapore au bord d'une petite tasse; les tempêtes les plus horribles ne sont que le léger mouvement de l'air produit par l'aile d'une mouche. Toutes nos énormes révolutions sont un grain de sable à peine dérangé de sa place. Cependant, que de vains efforts pour expliquer ces petites choses, que de systèmes, que de charlatanisme pour rendre compte de ces légères variations si terribles à nos yeux! que d'animosités dans ces disputes! les conquérants qui ont envahi le monde n'ont pas été plus orgueilleux et plus acharnés que les vendeurs d'orviétan qui ont prétendu le connaître.
La terre est un soleil croûté, dit celui-ci; c'est une comète qui a effleuré le soleil, dit celui-là. En voici un qui crie que cette huître est une médaille du déluge. Un autre lui répond qu'elle est pétrifiée depuis quatre milliards d'années. Eh pauvres gens qui osez parler en maîtres, vous voulez m'enseigner la formation de l'univers, et vous ne savez pas celle d'un ciron, celle d'une paille!
CORPS. [p. 272] ↩
Corps et matière, c'est ici même chose, quoiqu'il n'y ait pas de synonyme à la rigueur. Il y eu des gens qui par ce mot corps ont aussi entendu esprit. Ils ont dit, Esprit signifie originairement souffle , il n'y a qu'un corps qui puisse souffler; donc esprit et corps, pourraient bien au fond être la même chose. C'est dans ce sens que La Fontaine disait au célèbre duc de la Rochefoucault:
J'entends les esprits corps, et pétris de matière.
C'est dans le même sens qu'il dit à madame de la Sablière:
Je subtiliserais un morceau de matière,
Quintessence d'atome extrait de la lumière,
Je ne sais quoi plus vif et plus subtil encor.
Personne ne s'avisa de harceler le bon La Fontaine, et de lui faire un procès sur ces expressions. Si un pauvre philosophe et même un poète en disait autant aujourd'hui, que de gens pour se faire de fête, que de folliculaires pour vendre douze sous leurs extraits, que de fripons uniquement dans le dessein de faire du mal au philosophe, au péripatéticien, au disciple de Gassendi, à l'écolier de Locke et des premiers Pères, au damné!
De même que nous ne savons ce que c'est qu'un esprit, nous ignorons ce que c'est qu'un corps: nous voyons quelques propriétés; mais quel est ce sujet en qui ces propriétés résident? Il n'y a que des corps, disaient Démocrite et Epicure; il n'y a point de corps, disaient les disciples de Zénon d'Elée.
L'évêque de Cloine, Berklay, est le dernier, qui par cent sophismes captieux a prétendu prouver que les corps n'existent pas. Ils n'ont, dit-il, ni couleurs, ni odeurs, ni chaleur; ces modalités sont dans vos sensations, et non dans les objets. Il pouvait s'épargner la peine de prouver cette vérité; elle était assez connue. Mais de là il passe à l'étendue, à la solidité qui sont des essences du corps, et il croit prouver qu'il n'y a pas d'étendue dans une pièce de drap vert, parce que ce drap n'est pas vert en effet; cette sensation du vert n'est qu'en vous; donc cette sensation de l'étendue n'est aussi qu'en vous. Et après avoir ainsi détruit l'étendue, il conclut que la solidité qui y est attachée tombe d'elle-même; et qu'ainsi il n'y a rien au monde que nos idées. De sorte que, selon ce docteur, dix mille hommes tués par dix mille coups de canon, ne sont dans le fond que dix mille appréhensions de notre entendement; et quand un homme fait un enfant à sa femme, ce n'est qu'une idée qui se loge dans une autre idée, dont il naîtra une troisième idée.
Il ne tenait qu'à M. l'évêque de Cloine de ne point tomber dans l'excès de ce ridicule. Il croit montrer qu'il n'y a point d'étendue, parce qu'un corps lui a paru avec sa lunette quatre fois plus gros qu'il ne l'était à ses yeux, et quatre fois plus petit à l'aide d'un autre verre. De là il conclut qu'un corps ne pouvant à la fois avoir quatre pieds, seize pieds, et un seul pied d'étendue, cette étendue n'existe pas; donc il n'y a rien. Il n'avait qu'à prendre une mesure, et dire, De quelque étendue qu'un corps me paraisse, il est étendu de tant de ces mesures.
Il lui était bien aisé de voir qu'il n'en est pas de l'étendue et de la solidité comme des sons, des couleurs, des saveurs, des odeurs, etc. Il est clair que ce sont en nous des sentiments excités par la configuration des parties; mais l'étendue n'est point un sentiment. Que ce bois allumé s'éteigne, je n'ai plus chaud; que cet air ne soit plus frappé, je n'entends plus; que cette rose se fane, je n'ai plus d'odorat pour elle; mais ce bois, cet air, cette rose, sont étendus sans moi. Le paradoxe de Berklay ne vaut pas la peine d'être réfuté.
C'est ainsi que les Zénons d'Elée, les Parménides argumentaient autrefois; et ces gens-là avaient beaucoup d'esprit: ils vous prouvaient qu'une tortue doit aller aussi vite qu'Achille; qu'il n'y a point de mouvement: ils agitaient cent autres questions aussi utiles. La plupart des Grecs jouèrent des gobelets avec la philosophie, et transmirent leurs tréteaux à nos scolastiques. Bayle lui-même a été quelquefois de la bande; il a brodé des toiles d'araignées comme un autre; il argumente à l'article Zénon contre l'étendue divisible de la matière et la contiguité des corps; il dit tout ce qui ne serait pas permis de dire à un géomètre de six mois.
Il est bon de savoir ce qui avait entraîné l'évêque Berklay dans ce paradoxe. J'eus, il y a longtemps, quelques conversations avec lui; il me dit que l'origine de son opinion venait de ce qu'on ne peut concevoir ce que c'est que ce sujet qui reçoit l'étendue. Et en effet, il triomphe dans son livre, quand il demande à Hilas ce que c'est que ce sujet, ce substratum , cette substance; C'est le corps étendu, répond Hilas; alors l'évêque, sous le nom de Philonoüs, se moque de lui; et le pauvre Hilas voyant qu'il a dit que l'étendue est le sujet de l'étendue, et qu'il a dit une sottise, demeure tout confus et avoue qu'il n'y comprend rien, qu'il n'y a point de corps, que le monde matériel n'existe pas; qu'il n'y a qu'un monde intellectuel.
Philonoüs devait dire seulement à Hilas, Nous ne savons rien sur le fond de ce sujet, de cette substance étendue, solide, divisible, mobile, figurée, etc.; je ne la connais pas plus que le sujet pensant, sentant et voulant; mais ce sujet n'en existe pas moins, puisqu'il a des propriétés essentielles dont il ne peut être dépouillé.
Nous sommes tous comme la plupart des dames de Paris; elles font grande chère sans savoir ce qui entre dans les ragoûts; de même nous jouissons des corps, sans savoir ce qui les compose. De quoi est fait le corps? De parties, et ces parties se résolvent en d'autres parties. Que sont ces dernières parties? Toujours des corps; vous divisez sans cesse, et vous n'avancez jamais.
Enfin, un subtil philosophe remarquant qu'un tableau est fait d'ingrédients, dont aucun n'est un tableau, et une maison de matériaux dont aucun n'est une maison, imagina que les corps sont bâtis d'une infinité de petits êtres qui ne sont pas corps; et cela s'appelle des monades . Ce système ne laisse pas d'avoir son bon; et s'il était révélé, je le croirais très possible; tous ces petits êtres seraient des points mathématiques, des espèces d'âmes qui n'attendraient qu'un habit pour se mettre dedans: ce serait une métempsycose continuelle. Ce système en vaut bien un autre; je l'aime bien autant que la déclinaison des atomes, les formes substantielles, la grâce versatile, et les vampires.
COUTUME. [p. 275] ↩
Il y a cent quarante-quatre coutumes en France qui ont force de loi; ces lois sont presque toutes différentes. Un homme qui voyage dans ce pays change de loi presque autant de fois qu'il change de chevaux de poste. La plupart de ces coutumes ne commencèrent à être rédigées par écrit que du temps de Charles VII; la grande raison, c'est qu'auparavant très peu de gens savaient écrire. On écrivit donc une partie de la coutume du Ponthieu; mais ce grand ouvrage ne fut achevé par les Picards que sous Charles VIII. Il n'y en eut que seize de rédigées du temps de Louis XII. Enfin, aujourd'hui la jurisprudence s'est tellement perfectionnée, qu'il n'y a guère de coutume qui n'ait plusieurs commentateurs; et tous, comme on croit bien, d'un avis différent. Il y en a déjà vingt-six sur la coutume de Paris. Les juges ne savent auquel entendre; mais pour les mettre à leur aise, on vient de faire la coutume de Paris en vers. C'est ainsi qu'autrefois la prêtresse de Delphe rendait ses oracles.
Les mesures sont aussi différentes que les coutumes; de sorte que ce qui est vrai dans le faubourg de Montmartre, devient faux dans l'abbaye de St Denis. Dieu ait pitié de nous!
DES CRIMES OU DÉLITS. [p. 276] ↩
DE TEMS ET DE LIEU.
Un Romain tue malheureusement en Egypte un chat consacré; et le peuple en fureur punit ce sacrilège en déchirant le Romain en pièces. Si on avait mené ce Romain au tribunal, et si les juges avaient eu le sens commun, ils l'auraient condamné à demander pardon aux Egyptiens et aux chats, à payer une forte amende soit en argent, soit en souris. Ils lui auraient dit qu'il faut respecter les sottises du peuple quand on n'est pas assez fort pour les corriger.
Le vénérable chef de la justice lui aurait parlé à peu près ainsi: Chaque pays a ses impertinences légales, et ses délits de temps et de lieu. Si dans votre Rome devenue souveraine de l'Europe, de l'Afrique, et de l'Asie mineure, vous alliez tuer un poulet sacré dans le temps qu'on lui donne du grain pour savoir au juste la volonté des dieux, vous seriez sévèrement puni. Nous croyons que vous n'avez tué notre chat que par mégarde. La cour vous admoneste. Allez en paix; soyez plus circonspect.
C'est une chose très indifférente d'avoir une statue dans son vestibule. Mais si lorsqu'Octave surnommé Auguste était maître absolu, un Romain eût placé chez lui une statue de Brutus, il eût été puni comme séditieux. Si un citoyen avait, sous un empereur régnant, la statue du compétiteur à l'empire, c'était, disait-on, un crime de lèse-majesté, de haute trahison.
Un Anglais, ne sachant que faire, s'en va à Rome; il rencontre le prince Charles-Edouard chez un cardinal; il en est fort content. De retour chez lui, il boit dans un cabaret à la santé du prince Charles-Edouard. Le voilà accusé de haute trahison. Mais qui a-t-il trahi hautement , lorsqu'il a dit, en buvant, qu'il souhaitait que ce prince se portât bien? S'il a conjuré pour le mettre sur le trône, alors il est coupable envers la nation: mais jusque-là on ne voit pas que dans l'exacte justice le parlement puisse exiger de lui autre chose que de boire quatre coups à la santé de la maison de Hanovre, s'il en a bu deux à la santé de la maison de Stuart.
DES CRIMES DE TEMS ET DE LIEU QU'ON DOIT IGNORER.
On sait combien il faut respecter Notre-Dame de Lorette, quand on est dans la marche d'Ancône. Trois jeunes gens y arrivent; ils font de mauvaises plaisanteries sur la maison de Notre-Dame qui a voyagé par l'air, qui est venue en Dalmatie, qui a changé deux ou trois fois de place, et qui enfin ne s'est trouvée commodément qu'à Lorette. Nos trois étourdis chantent à souper une chanson faite autrefois par quelque huguenot contre la translation de la santa casa de Jérusalem au fond du golfe Adriatique. Un fanatique est instruit par hasard de ce qui s'est passé à leur souper; il fait des perquisitions; il cherche des témoins; il engage un monsignor à lâcher un monitoire. Ce monitoire alarme les consciences. Chacun tremble de ne pas parler. Tourières, bedeaux, cabaretiers, laquais, servantes ont bien entendu tout ce qu'on n'a point dit, ont vu tout ce qu'on n'a point fait; c'est un vacarme, un scandale épouvantable dans toute la marche d'Ancône. Déjà l'on dit à une demi-lieue de Lorette que ces enfants ont tué Notre-Dame; à une lieue plus loin on assure qu'ils ont jeté la santa casa dans la mer. Enfin, ils sont condamnés. La sentence porte que d'abord on leur coupera la main, qu'ensuite on leur arrachera la langue, qu'après cela on les mettra à la torture pour savoir d'eux (au moins par signes) combien il y avait de couplets à la chanson; et qu'enfin ils seront brûlés à petit feu.
Un avocat de Milan, qui dans ce temps se trouvait à Lorette, demanda au principal juge à quoi donc il aurait condamné ces enfants s'ils avaient violé leur mère, et s'ils l'avaient égorgée pour la manger? Oh oh! répondit le juge, il y a bien de la différence; violer, assassiner et manger son père et sa mère n'est qu'un délit contre les hommes.
Avez-vous une loi expresse, dit le Milanais, qui vous force à faire périr par un si horrible supplice des jeunes gens à peine sortis de l'enfance pour s'être moqués indiscrètement de la santa casa dont on rit d'un rire de mépris dans le monde entier, excepté dans la marche d'Ancône? Non, dit le juge, la sagesse de notre jurisprudence laisse tout à notre discrétion. -- Fort bien, vous deviez donc avoir la discrétion de songer que l'un de ces enfants est le petit-fils d'un général qui a versé son sang pour la patrie, et le neveu d'une abbesse aimable et respectable: cet enfant et ses camarades sont des étourdis qui méritent une correction paternelle. Vous arrachez à l'Etat des citoyens qui pourraient un jour le servir, vous vous souillez du sang innocent, et vous êtes plus cruels que les cannibales. Vous vous rendez exécrables à la dernière postérité. Quel motif a été assez puissant pour éteindre ainsi en vous la raison, la justice, l'humanité, et pour vous changer en bêtes féroces? -- Le malheureux juge répondit enfin, Nous avions eu des querelles avec le clergé d'Ancône: il nous accusait d'être trop zélés pour les libertés de l'Eglise lombarde, et par conséquent de n'avoir point de religion. J'entends, dit le Milanais, vous avez été assassins pour paraître chrétiens; à ces mots le juge tomba par terre comme frappé de la foudre: ses confrères perdirent depuis leurs emplois, ils crièrent qu'on faisait injustice, ils oubliaient celle qu'ils avaient faite; et ne s'apercevaient pas que la main de Dieu était sur eux.
Pour que sept personnes se donnent légalement l'amusement d'en faire périr une huitième en public à coups de barre de fer sur un théâtre; pour qu'ils jouissent du plaisir secret et mal démêlé dans leur coeur, de voir comment cet homme souffrira son supplice, et d'en parler ensuite à table avec leurs femmes et leurs voisins; pour que des exécuteurs qui font gaiement ce métier, comptent d'avance l'argent qu'ils vont gagner; pour que le public coure à ce spectacle comme à la foire etc.; il faut que le crime mérite évidemment ce supplice du consentement de toutes les nations policées, et qu'il soit nécessaire au bien de la société: car il s'agit ici de l'humanité entière. Il faut surtout que l'acte du délit soit démontré comme une proposition de géométrie.
Si contre cent probabilités que l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette seule peut balancer toujours les autres.
QUESTION SI DEUX TÉMOINS SUFFISENT POUR FAIRE PENDRE UN HOMME?
On s'est imaginé longtemps, et le proverbe en est resté, qu'il suffit de deux témoins pour faire pendre un homme en sûreté de conscience. Encore une équivoque! Les équivoques gouvernent donc le monde? Il est dit dans St Matthieu, (ainsi que nous l'avons déjà remarqué) Il suffira de deux ou trois témoins pour réconcilier deux amis brouillés ; et d'après ce texte, on a réglé la jurisprudence criminelle, au point de statuer que c'est une loi divine de tuer un citoyen sur la déposition uniforme de deux témoins qui peuvent être des scélérats! Une foule de témoins uniformes ne peut constater une chose improbable niée par l'accusé; on l'a déjà dit. Que faut-il donc faire en ce cas? Attendre, remettre le jugement à cent ans, comme faisaient les Athéniens.
Rapportons ici un exemple frappant de ce qui vient de se passer sous nos yeux à Lyon. Une femme ne voit pas revenir sa fille chez elle vers les onze heures du soir; elle court partout; elle soupçonne sa voisine d'avoir caché sa fille; elle la redemande; elle l'accuse de l'avoir prostituée. Quelques semaines après, des pêcheurs trouvent dans le Rhône à Condrieux une fille noyée et toute en pourriture. La femme dont nous avons parlé croit que c'est sa fille. Elle est persuadée par les ennemis de sa voisine qu'on a déshonoré sa fille chez cette voisine même, qu'on l'a étranglée, qu'on l'a jetée dans le Rhône. Elle le dit; elle le crie; la populace le répète. Il se trouve bientôt des gens qui savent parfaitement les moindres détails de ce crime. Toute la ville est en rumeur; toutes les bouches crient vengeance. Il n'y a rien jusque-là que d'assez commun dans une populace sans jugement. Mais voici le rare, le prodigieux. Le propre fils de cette voisine, un enfant de cinq ans et demi accuse sa mère d'avoir fait violer sous ses yeux cette malheureuse fille retrouvée dans le Rhône, de l'avoir fait tenir par cinq hommes pendant que le sixième jouissait d'elle. Il a entendu les paroles que prononçait la violée; il peint ses attitudes; il a vu sa mère et ces scélérats étrangler cette infortunée immédiatement après la consommation. Il a vu sa mère et les assassins la jeter dans un puits, l'en retirer, l'envelopper dans un drap, il a vu ces monstres la porter en triomphe dans les places publiques, danser autour du cadavre, et le jeter enfin dans le Rhône. Les juges sont obligés de mettre aux fers tous les prétendus complices; des témoins déposent contre eux. L'enfant est d'abord entendu, et il soutient avec la naïveté de son âge tout ce qu'il a dit d'eux et de sa mère. Comment imaginer que cet enfant n'ait pas dit la pure vérité? Le crime n'est pas vraisemblable; mais il l'est encore moins qu'à l'âge de cinq ans et demi on calomnie ainsi sa mère; qu'un enfant répète avec uniformité toutes les circonstances d'un crime abominable et inouï, s'il n'en a pas été le témoin oculaire, s'il n'en a point été vivement frappé, si la force de la vérité ne les arrache de sa bouche.
Tout le peuple s'attend à repaître ses yeux du supplice des accusés.
Quelle est la fin de cet étrange procès criminel? Il n'y avait pas un mot de vrai dans l'accusation. Point de fille violée, point de jeunes gens assemblés chez la femme accusée, point de meurtre, pas la moindre aventure, pas le moindre bruit. L'enfant avait été suborné, et par qui? chose étrange, mais vraie! par deux autres enfants qui étaient fils des accusateurs. Il avait été sur le point de faire brûler sa mère pour avoir des confitures.
Tous les chefs d'accusation réunis étaient impossibles. Le présidial de Lyon sage et éclairé, après avoir déféré à la fureur publique au point de rechercher les preuves les plus surabondantes pour et contre les accusés, les absout pleinement et d'une voix unanime.
Peut-être autrefois aurait-on fait rouer et brûler tous ces accusés innocents, à l'aide d'un monitoire, pour avoir le plaisir de faire ce qu'on appelle une justice , qui est la tragédie de la canaille.
CRIMINALISTE. [p. 281] ↩
Dans les antres de la chicane, on appelle grand criminaliste , un barbare en robe qui sait faire tomber les accusés dans le piège, qui ment impudemment pour découvrir la vérité, qui intimide des témoins, et qui les force, sans qu'ils s'en aperçoivent, à déposer contre le prévenu: s'il y a une loi antique et oubliée, portée dans un temps de guerres civiles, il la fait revivre, il la réclame dans un temps de paix. Il écarte, il affaiblit tout ce qui peut servir à justifier un malheureux; il amplifie, il aggrave tout ce qui peut servir à le condamner; son rapport n'est pas d'un juge, mais d'un ennemi. Il mérite d'être pendu à la place du citoyen qu'il fait pendre.
CRIMINEL. [p. ibid .] ↩
PROCÈS CRIMINEL.
On a puni souvent par la mort des actions très innocentes; c'est ainsi qu'en Angleterre Richard III et Edouard IV firent condamner par des juges ceux qu'ils soupçonnaient de ne leur être pas attachés. Ce ne sont pas là des procès criminels, ce sont des assassinats commis par des meurtriers privilégiés. Le dernier degré de la perversité est de faire servir les lois à l'injustice.
On a dit que les Athéniens punissaient de mort tout étranger qui entrait dans l'église, c'est-à-dire, dans l'assemblée du peuple. Mais si cet étranger n'était qu'un curieux, rien n'était plus barbare que de le faire mourir. Il est dit dans l' Esprit des lois qu'on usait de cette rigueur, parce que cet homme usurpait les droits de la souveraineté . Mais un Français qui entre à Londres dans la chambre des communes pour entendre ce qu'on y dit, ne prétend point faire le souverain. On le reçoit avec bonté. Si quelque membre de mauvaise humeur demande le Clear the house , éclaircissez la chambre, mon voyageur l'éclaircit en s'en allant; il n'est point pendu. Il est croyable que si les Athéniens ont porté cette loi passagère, c'était dans un temps où l'on craignait qu'un étranger ne fût un espion, et non parce qu'il s'arrogeait les droits de souverain. Chaque Athénien opinait dans sa tribu; tous ceux de la tribu se connaissaient; un étranger n'aurait pu aller porter sa fêve.
Nous ne parlons ici que des vrais procès criminels. Chez les Romains tout procès criminel était public. Le citoyen accusé des plus énormes crimes avait un avocat qui plaidait en sa présence, qui faisait même des interrogations à la partie adverse, qui discutait tout devant ses juges. On produisait à portes ouvertes tous les témoins pour ou contre, rien n'était secret. Cicéron plaida pour Milon qui avait assassiné Clodius en plein jour à la vue de mille citoyens. Le même Cicéron prit en main la cause de Roscius Amérinus accusé de parricide. Un seul juge n'interrogeait pas en secret des témoins, qui sont d'ordinaire des gens de la lie du peuple, auxquels on fait dire tout ce qu'on veut.
Un citoyen romain n'était pas appliqué à la torture sur l'ordre arbitraire d'un autre citoyen romain qu'un contrat eût revêtu de ce droit cruel. On ne faisait pas cet horrible outrage à la nature humaine dans la personne de ceux qui étaient regardés comme les premiers des hommes, mais seulement dans celle des esclaves regardés à peine comme des hommes. Il eût mieux valu ne point employer la torture contre les esclaves mêmes. (Voyez Torture . )
L'instruction d'un procès criminel se ressentait à Rome de la magnanimité et de la franchise de la nation.
Il en est ainsi à peu près à Londres. Le secours d'un avocat n'y est refusé à personne en aucun cas; tout le monde est jugé par ses pairs. Tout citoyen peut de trente-six bourgeois jurés en récuser douze sans cause, douze en alléguant des raisons, et par conséquent choisir lui-même les douze autres pour ses juges. Ces juges ne peuvent aller ni en deçà, ni en delà de la loi; nulle peine n'est arbitraire, nul jugement ne peut être exécuté que l'on n'en ait rendu compte au roi qui peut et qui doit faire grâce à ceux qui en sont dignes, et à qui la loi ne la peut faire; ce cas arrive assez souvent. Un homme violemment outragé aura tué l'offenseur dans un mouvement de colère pardonnable; il est condamné par la rigueur de la loi, et sauvé par la miséricorde qui doit être le partage du souverain.
Remarquons bien attentivement que dans ce pays où les lois sont aussi favorables à l'accusé que terribles pour le coupable, non seulement un emprisonnement fait sur la dénonciation fausse d'un accusateur est puni par les plus grandes réparations et les plus fortes amendes; mais que si un emprisonnement illégal a été ordonné par un ministre d'Etat à l'ombre de l'autorité royale, le ministre est condamné à payer deux guinées par heure pour tout le temps que le citoyen a demeuré en prison.
PROCÉDURE CRIMINELLE CHEZ CERTAINES NATIONS.
Il y a des pays où la jurisprudence criminelle fut fondée sur le droit canon, et même sur les procédures de l'Inquisition, quoique ce nom y soit détesté depuis longtemps. Le peuple dans ces pays est demeuré encore dans une espèce d'esclavage. Un citoyen poursuivi par l'homme du roi est d'abord plongé dans un cachot; ce qui est déjà un véritable supplice pour un homme qui peut être innocent. Un seul juge, avec son greffier, entend secrètement chaque témoin assigné l'un après l'autre.
Comparons seulement ici en quelques points la procédure criminelle des Romains avec celle d'un pays de l'Occident qui fut autrefois une province romaine.
Chez les Romains les témoins étaient entendus publiquement en présence de l'accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même, ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine.
En France, en plusieurs endroits de l'Allemagne, tout se fait secrètement. Cette pratique établie sous François I e r , fut autorisée par les commissaires qui rédigèrent l'ordonnance de Louis XIV en 1670: une méprise seule en fut la cause.
On s'était imaginé en lisant le code De Testibus , que ces mots: testes intrare judicii secretum , signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. Mais secretum signifie ici le cabinet du juge. Intrare secretum , pour dire, parler secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence.
Les déposants sont pour l'ordinaire des gens de la lie du peuple, et à qui le juge enfermé avec eux peut faire dire tout ce qu'il voudra. Ces témoins sont entendus une seconde fois toujours en secret, ce qui s'appelle récolement ; et si après le récolement ils se rétractent dans leurs dépositions, ou s'ils les changent dans des circonstances essentielles, ils sont punis comme faux témoins. De sorte que lorsqu'un homme d'un esprit simple, et ne sachant pas s'exprimer, mais ayant le coeur droit, et se souvenant qu'il en a dit trop ou trop peu, qu'il a mal entendu le juge, ou que le juge l'a mal entendu, révoque par esprit de justice ce qu'il a dit par imprudence, il est puni comme un scélérat: ainsi il est forcé souvent de soutenir un faux témoignage par la seule crainte d'être traité en faux témoin.
L'accusé en fuyant, s'expose à être condamné, soit que le crime ait été prouvé, soit qu'il ne l'ait pas été. Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumace ne devait pas être condamné, si le crime n'était pas clairement prouvé. Mais d'autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire; ils ont osé dire que la fuite de l'accusé était une preuve du crime; que le mépris qu'il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le même châtiment que s'il était convaincu. Ainsi suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'innocent sera absous ou condamné.
C'est un grand abus dans la jurisprudence, que l'on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois cruelles, d'hommes sans aveu qui ont donné leurs sentiments pour des lois.
Sous le règne de Louis XIV on a fait en France deux ordonnances, qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner, en matière civile, par défaut, quand la demande n'est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n'est point dit que, faute de preuves, l'accusé sera renvoyé. Chose étrange! La loi dit qu'un homme, à qui l'on demande quelque argent, ne sera condamné par défaut qu'au cas que la dette soit avérée; mais s'il s'agit de la vie, c'est une controverse au barreau, de savoir si l'on doit condamner le contumace, quand le crime n'est pas prouvé; et la loi ne résout pas la difficulté.
EXEMPLE TIRÉ DE LA CONDAMNATION D'UNE FAMILLE ENTIÈRE.
Voici ce qui arriva à cette famille infortunée dans le temps que des confréries insensées de prétendus pénitents, le corps enveloppé dans une robe blanche, et le visage masqué, avaient élevé dans une des principales églises de Toulouse un catafalque superbe à un jeune protestant homicide de lui-même, qu'ils prétendaient avoir été assassiné par son père et sa mère pour avoir abjuré la religion réformée; dans ce temps même où toute la famille de ce protestant révéré en martyr, était dans les fers, et que tout un peuple enivré d'une superstition également folle et barbare, attendait avec une dévote impatience le plaisir de voir expirer sur la roue ou dans les flammes cinq ou six personnes de la probité la plus reconnue.
Dans ce temps funeste, dis-je, il y avait auprès de Castres un honnête homme de cette même religion protestante, nommé Sirven, exerçant dans cette province la profession de feudiste. Ce père de famille avait trois filles. Une femme qui gouvernait la maison de l'évêque de Castres, lui propose de lui amener la seconde fille de Sirven nommée Elizabeth, pour la faire catholique apostolique et romaine: elle l'amène en effet: l'évêque la fait enfermer chez les jésuitesses qu'on nomme les dames régentes , ou les dames noires . Ces dames lui enseignent ce qu'elles savent; elles lui trouvèrent la tête un peu dure, et lui imposèrent des pénitences rigoureuses pour lui inculquer des vérités qu'on pouvait lui apprendre avec douceur; elle devint folle; les dames noires la chassent; elle retourne chez ses parents; sa mère en la faisant changer de chemise trouve tout son corps couvert de meurtrissures: la folie augmente: elle se change en fureur mélancolique; elle s'échappe un jour de la maison, tandis que le père était à quelques milles de là occupé publiquement de ses fonctions dans le château d'un seigneur voisin. Enfin vingt jours après l'évasion d'Elizabeth, des enfants la trouvent noyée dans un puits, le 4 janvier 1761.
C'était précisément le temps où l'on se préparait à rouer Calas dans Toulouse. Le mot de parricide , et qui pis est de huguenot , volait de bouche en bouche dans toute la province. On ne douta pas que Sirven, sa femme et ses deux filles n'eussent noyé la troisième par principe de religion. C'était une opinion universelle que la religion protestante ordonne positivement aux pères et aux mères de tuer leurs enfants, s'ils veulent être catholiques. Cette opinion avait jeté de si profondes racines dans les têtes mêmes des magistrats, entraînés malheureusement alors par la clameur publique, que le conseil et l'Eglise de Genève furent obligés de démentir cette fatale erreur, et d'envoyer au parlement de Toulouse une attestation juridique, que non seulement les protestants ne tuent point leurs enfants, mais qu'on les laisse maîtres de tous leurs biens quand ils quittent leur secte pour une autre. On sait que Calas fut roué malgré cette attestation.
Un nommé Landes juge de village, assisté de quelques gradués aussi savants que lui, s'empressa de faire toutes les dispositions pour bien suivre l'exemple qu'on venait de donner dans Toulouse. Un médecin de village, aussi éclairé que les juges, ne manqua pas d'assurer à l'inspection du corps, au bout de vingt jours, que cette fille avait été étranglée et jetée ensuite dans le puits. Sur cette déposition le juge décrète de prise de corps le père, la mère et les deux filles.
La famille justement effrayée par la catastrophe de Calas et par les conseils de ses amis, prend incontinent la fuite; ils marchent au milieu des neiges pendant un hiver rigoureux; et de montagnes en montagnes ils arrivent jusqu'à celles des Suisses. Celle des deux filles, qui était mariée et grosse, accouche avant le terme parmi les glaces.
La première nouvelle que cette famille apprend quand elle est en lieu de sûreté, c'est que le père et la mère sont condamnés à être pendus; les deux filles à demeurer sous la potence pendant l'exécution de leur mère, et à être reconduites par le bourreau hors du territoire, sous peine d'être pendues si elles reviennent. C'est ainsi qu'on instruit la contumace .
Ce jugement était également absurde et abominable. Si le père, de concert avec sa femme, avait étranglé sa fille, il fallait le rouer comme Calas; et brûler la mère, au moins après qu'elle aurait été étranglée; parce que ce n'est pas encore l'usage de rouer les femmes dans le pays de ce juge. Se contenter de pendre en pareille occasion, c'était avouer que le crime n'était pas avéré, et que dans le doute la corde était un parti mitoyen qu'on prenait faute d'être instruit. Cette sentence blessait également la loi et la raison.
La mère mourut de désespoir; et toute la famille, dont le bien était confisqué, allait mourir de misère, si elle n'avait pas trouvé des secours.
On s'arrête ici pour demander s'il y a quelque loi et quelque raison qui puisse justifier une telle sentence? On peut dire au juge: Quelle rage vous a porté à condamner à la mort un père et une mère? C'est qu'ils se sont enfuis, répond le juge. Eh misérable! voulais-tu qu'ils restassent pour assouvir ton imbécile fureur? Qu'importe qu'ils paraissent devant toi chargés de fers pour te répondre, ou qu'ils lèvent les mains au ciel contre toi loin de ta face! Ne peux-tu pas voir sans eux la vérité qui doit te frapper? Ne peux-tu pas voir que le père était à une lieue de sa fille au milieu de vingt personnes, quand cette malheureuse fille s'échappa des bras de sa mère? Peux-tu ignorer que toute la famille l'a cherchée pendant vingt jours et vingt nuits? Tu ne réponds à cela que ces mots, contumace, contumace . Quoi! parce qu'un homme est absent, il faut qu'on le condamne à être pendu, quand son innocence est évidente! C'est la jurisprudence d'un sot et d'un monstre. Et la vie, les biens, l'honneur des citoyens dépendront de ce code d'Iroquois!
La famille Sirven traîna son malheur loin de sa patrie pendant plus de huit années. Enfin, la superstition sanguinaire qui déshonorait le Languedoc, ayant été un peu adoucie, et les esprits étant devenus plus éclairés, ceux qui avaient consolé les Sirven pendant leur exil, leur conseillèrent de venir demander justice au parlement de Toulouse même, lorsque le sang des Calas ne fumait plus, et que plusieurs se repentaient de l'avoir répandu. Les Sirven furent justifiés.
Erudimini qui judicatis terram .
CRITIQUE. [p. 288] ↩
L'article Critique fait par M. de Marmontel dans l'Encyclopédie, est si bon qu'il ne serait pas pardonnable d'en donner ici un nouveau, si on n'y traitait pas une matière toute différente sous le même titre. Nous entendons ici cette critique née de l'envie, aussi ancienne que le genre humain. Il y a environ trois mille ans qu'Hésiode a dit, Le potier porte envie au potier, le forgeron au forgeron, le musicien au musicien.
Le duc de Sulli dans ses mémoires, trouve le cardinal d'Ossat, et le secrétaire d'Etat Villeroi, de mauvais ministres; Louvois faisait ce qu'il pouvait pour ne pas estimer le grand Colbert; mais ils n'imprimaient rien l'un contre l'autre: le duc de Marlborough ne fit rien imprimer contre le comte de Peterboroug: c'est une sottise qui n'est d'ordinaire attachée qu'à la littérature, à la chicane, et à la théologie. C'est dommage que les économies politiques et royales soient tachées quelquefois de ce défaut.
La Motte Houdart était un homme de mérite en plus d'un genre; il a fait de très belles stances.
Quelquefois au feu qui la charme
Résiste une jeune beauté,
Et contre elle-même elle s'arme
D'une pénible fermeté.
Hélas! cette contrainte extrême
La prive du vice qu'elle aime,
Pour fuir la honte qu'elle hait.
Sa sévérité n'est que faste,
Et l'honneur de passer pour chaste
La résout à l'être en effet.
En vain ce sévère stoïque
Sous mille défauts abattu,
Se vante d'une âme héroïque
Toute vouée à la vertu;
Ce n'est point la vertu qu'il aime,
Mais son coeur ivre de lui-même
Voudrait usurper les autels;
Et par sa sagesse frivole
Il ne veut que parer l'idole
Qu'il offre au culte des mortels.
Les champs de Pharsale et d'Arbelle
Ont vu triompher deux vainqueurs,
L'un et l'autre digne modèle
Que se proposent les grands coeurs.
Mais le succès a fait leur gloire;
Et si le sceau de la victoire
N'eût consacré ces demi-dieux,
Alexandre aux yeux du vulgaire,
N'aurait été qu'un téméraire,
Et César qu'un séditieux.
Cet auteur, dit-il, était un sage qui prêta plus d'une fois le charme des vers à la philosophie. S'il avait toujours écrit de pareilles stances, il serait le premier des poètes lyriques; cependant c'est alors qu'il donnait ces beaux morceaux, que l'un de ses contemporains l'appelait
Certain oison, gibier de basse-cour .
Il dit de La Motte en un autre endroit,
De ses discours l'ennuyeuse beauté .
Il dit dans un autre:
. . . Je n'y vois qu'un défaut ,
C'est que l'auteur les devait faire en prose .
Ces odes-là sentent bien le Quinaut .
Il le poursuit partout; il lui reproche partout la sécheresse, et le défaut d'harmonie.
Seriez-vous curieux de voir les odes que fit quelques années après ce même censeur qui jugeait La Motte en maître, et qui le décriait en ennemi? Lisez.
Cette influence souveraine
N'est pour lui qu'une illustre chaîne
Qui l'attache au bonheur d'autrui;
Tous les brillants qui l'embellissent,
Tous les talents qui l'ennoblissent,
Sont en lui, mais non pas à lui.
Il n'est rien que le temps n'absorbe, ne dévore;
Et les faits qu'on ignore
Sont bien peu différents des faits non avenus.
La bonté qui brille en elle
De ses charmes les plus doux,
Est une image de celle
Qu'elle voit briller en vous.
Et par vous seule enrichie
Sa politesse affranchie
Des moindres obscurités,
Est la lueur réfléchie
De vos sublimes clartés.
Ils ont vu par ta bonne foi
De leurs peuples troublés d'effroi
La crainte heureusement déçue,
Et déracinée à jamais
La haine si souvent reçue
En survivance de la paix.
Dévoile à ma vue empressée
Ces déités d'adoption,
Synonymes de la pensée,
Symboles de l'abstraction.
N'est-ce pas une fortune,
Quand d'une charge commune
Deux moitiés portent le faix?
Que la moindre le réclame,
Et que du bonheur de l'âme,
Le corps seul fasse les frais?
Il ne fallait pas, sans doute, donner de si détestables ouvrages pour modèles à celui qu'on critiquait avec tant d'amertume; il eût mieux valu laisser jouir en paix son adversaire de son mérite, et conserver celui qu'on avait. Mais que voulez-vous? le genus irritabile vatum , est malade de la même bile qui le tourmentait autrefois. Le public pardonne ces pauvretés aux gens à talent, parce que le public ne songe qu'à s'amuser.
On est accoutumé chez toutes les nations, aux mauvaises critiques de tous les ouvrages qui ont du succès. Le Cid trouva son Scudéri; et Corneille fut longtemps après vexé par l'abbé d'Aubignac prédicateur du roi, soi-disant législateur du théâtre, et auteur de la plus ridicule tragédie, toute conforme aux règles qu'il avait données. Il n'y a sortes d'injures qu'il ne dise à l'auteur de Cinna et des Horaces . L'abbé d'Aubignac prédicateur du roi, aurait bien dû prêcher contre d'Aubignac.
On a vu chez les nations modernes qui cultivent les lettres, des gens qui se sont établis critiques de profession, comme on a créé des langueyeurs de porcs, pour examiner si ces animaux qu'on amène au marché ne sont pas malades. Les langueyeurs de la littérature ne trouvent aucun auteur bien sain; ils rendent compte deux ou trois fois par mois de toutes les maladies régnantes, des mauvais vers faits dans la capitale et dans les provinces, des romans insipides dont l'Europe est inondée, des systèmes de physique nouveaux, des secrets pour faire mourir les punaises. Ils gagnent quelque argent à ce métier, surtout quand ils disent du mal des bons ouvrages, et du bien des mauvais. On peut les comparer aux crapauds qui passent pour sucer le venin de la terre, et pour le communiquer à ceux qui les touchent. Il y eut un nommé Denni, qui fit ce métier pendant soixante ans à Londres, -- et qui ne laissa pas d'y gagner sa vie. L'autre qui a cru être un nouvel Arétin et s'enrichir en Italie par sa Frusta letteraria , n'y a pas fait fortune.
L'ex-jésuite Giot Desfontaines qui embrassa cette profession au sortir de Bissêtre, y amassa quelque argent. C'est lui qui lorsque le lieutenant de police le menaçait de le renvoyer à Bissêtre, et lui demandait pourquoi il s'occupait d'un travail si odieux, répondit, Il faut que je vive . Il attaquait les hommes les plus estimables à tort et à travers sans avoir seulement lu, ni pu lire les ouvrages de mathématiques et de physique dont il rendait compte.
Il prit un jour l' Alcifron de Berklay évêque de Cloine pour un livre contre la religion. Voici comme il s'exprime.
‘J'en ai trop dit pour vous faire mépriser un livre qui dégrade également l'esprit et la probité de l'auteur; c'est un tissu de sophismes libertins forgés à plaisir pour détruire les principes de la religion, de la politique et de la morale.'
Dans un autre endroit, il prend le mot anglais kake , qui signifie gâteau en anglais, pour le géant Cacus. Il a dit à propos de la tragédie de la Mort de César , que Brutus était un fanatique barbare, un quaker . Il ignorait que les quakers sont les plus pacifiques des hommes, et ne versent jamais le sang. C'est avec ce fonds de science qu'il cherchait à rendre ridicules les deux écrivains les plus estimables de leur temps, Fontenelle et La Motte.
Il fut remplacé dans cette charge de Zoïle subalterne par un autre ex-jésuite nommé Fréron, dont le nom seul est devenu un opprobre. On nous fit lire, il n'y a pas longtemps, une de ses feuilles dont il infecte la basse littérature. Le temps de Mahomet II , dit-il, est le temps de l'entrée des Arabes en Europe . Quelle foule de bévues en peu de paroles!
Quiconque a reçu une éducation tolérable, sait que les Arabes assiégèrent Constantinople sous le calife Moavia dès notre septième siècle, qu'ils conquirent l'Espagne dans l'année de notre ère 713, et bientôt après une partie de la France, environ sept cents ans avant Mahomet II.
Ce Mahomet II, fils d'Amurath II, n'était point Arabe, mais Turc.
Il s'en fallait beaucoup qu'il fût le premier prince turc qui eût passé en Europe; Orcan plus de cent ans avant lui avait subjugué la Thrace, la Bulgarie et une partie de la Grèce.
On voit que ce folliculaire parlait à tort et à travers des choses les plus aisées à savoir, et dont il ne savait rien. Cependant, il insultait l'Académie, les plus honnêtes gens, les meilleurs ouvrages, avec une insolence égale à son absurdité; mais son excuse était celle de Giot Desfontaines, Il faut que je vive . C'est aussi l'excuse de tous les malfaiteurs dont on fait justice.
On ne doit pas donner le nom de critiques à ces gens-là. Ce mot vient de krites , juge , estimateur , arbitre . Critique, signifie bon juge . Il faut être un Quintilien pour oser juger les ouvrages d'autrui; il faut du moins écrire comme Bayle écrivit sa République des lettres ; il a eu quelques imitateurs, mais en petit nombre. Les journaux de Trévoux ont été décriés par leur partialité poussée jusqu'au ridicule, et pour leur mauvais goût.
Quelquefois les journaux se négligent, ou le public s'en dégoûte par pure lassitude, ou les auteurs ne fournissent pas des matières assez agréables; alors les journaux, pour réveiller le public, ont recours à un peu de satire. C'est ce qui a fait dire à La Fontaine:
Tout faiseur de journal doit tribut au malin.
Mais il vaut mieux ne payer son tribut qu'à la raison et à l'équité.
Il y a d'autres critiques qui attendent qu'un bon ouvrage paraisse pour faire vite un livre contre lui. Plus le libelliste attaque un homme accrédité, plus il est sûr de gagner quelque argent; il vit quelques mois de la réputation de son adversaire. Tel était un nommé Faidit qui tantôt écrivait contre Bossuet, tantôt contre Tillemont, tantôt contre Fénelon. Tel a été un polisson qui s'intitule Pierre de Chiniac de la Bastide Duclaux, avocat au parlement. Cicéron avait trois noms comme lui. Puis viennent les critiques contre Pierre de Chiniac, puis les réponses de Pierre de Chiniac à ses critiques. Ces beaux livres sont accompagnés de brochures sans nombre, dans lesquelles les auteurs font le public juge entre eux et leurs adversaires; mais le juge qui n'a jamais entendu parler de leur procès, est fort en peine de prononcer. L'un veut qu'on s'en rapporte à sa dissertation insérée dans le Journal littéraire, l'autre à ses éclaircissements dans le Mercure. Celui-ci crie qu'il a donné une version exacte d'une demi-ligne de Zoroastre, et qu'on ne l'a pas plus entendu qu'il n'entend le persan. Il duplique à la contre-critique qu'on a faite de sa critique d'un passage de Chaufepié.
Enfin, il n'y a pas un seul de ces critiques qui ne se croie juge de l'univers, et écouté de l'univers.
Eh l'ami, qui te savait là!
CROIRE. [p. 294] ↩
Nous avons vu à l'article Certitude qu'on doit être souvent très incertain quand on est certain, et qu'on peut manquer de bon sens quand on juge suivant ce qu'on appelle le sens commun . Mais qu'appelez-vous croire ?
Voici un Turc qui me dit, ‘Je crois que l'ange Gabriel descendait souvent de l'empyrée pour apporter à Mahomet des feuillets de l'Alcoran, écrits en lettres d'or sur du velin bleu.'
Eh bien, Moustapha, sur quoi ta tête rase croit-elle cette chose incroyable?
‘Sur ce que j'ai les plus grandes probabilités qu'on ne m'a point trompé dans le récit de ces prodiges improbables; sur ce qu'Abubekre le beau-père, Ali le gendre, Aïsha ou Aïssé la fille, Omar, Otman, certifièrent la vérité du fait en présence de cinquante mille hommes, recueillirent tous les feuillets, les lurent devant les fidèles, et attestèrent qu'il n'y avait pas un mot de changé.
‘Sur ce que nous n'avons jamais eu qu'un Alcoran qui n'a jamais été contredit par un autre Alcoran. Sur ce que Dieu n'a jamais permis qu'on ait fait la moindre altération dans ce livre.
‘Sur ce que les préceptes et les dogmes sont la perfection de la raison. Le dogme consiste dans l'unité d'un Dieu pour lequel il faut vivre et mourir; dans l'immortalité de l'âme; dans les récompenses éternelles des justes, et la punition des méchants, et dans la mission de notre grand prophète Mahomet, prouvée par des victoires.
‘Les préceptes sont d'être juste et vaillant, de faire l'aumône aux pauvres, de nous abstenir de cette énorme quantité de femmes que les princes orientaux et surtout les roitelets juifs épousaient sans scrupule. De renoncer au bon vin d'Engaddi et de Tadmor, que ces ivrognes d'Hébreux ont tant vanté dans leurs livres; de prier Dieu cinq fois par jour, etc.
‘Cette sublime religion a été confirmée par le plus beau et le plus constant des miracles, et le plus avéré dans l'histoire du monde; c'est que Mahomet persécuté par les grossiers et absurdes magistrats scholastiques qui le décrétèrent de prise de corps, Mahomet obligé de quitter sa patrie n'y revint qu'en victorieux; qu'il fit de ses juges imbéciles et sanguinaires l'escabeau de ses pieds; qu'il combattit toute sa vie les combats du Seigneur; qu'avec un petit nombre il triompha toujours du grand nombre; que lui et ses successeurs convertirent la moitié de la terre, et que Dieu aidant nous convertirons un jour l'autre moitié.'
Rien n'est plus éblouissant. Cependant Moustapha en croyant si fermement, sent toujours quelques petits nuages de doute s'élever dans son âme, quand on lui fait quelques difficultés sur les visites de l'ange Gabriel, sur le sura ou le chapitre apporté du ciel, pour déclarer que le grand prophète n'est point cocu; sur la jument Borak qui le transporte en une nuit de la Mecque à Jérusalem. Moustapha bégaie, il fait de très mauvaises réponses, il en rougit; et cependant non seulement il dit qu'il croit, mais il veut aussi vous engager à croire. Vous pressez Moustapha, il reste la bouche béante, les yeux égarés, et va se laver en l'honneur d'Alla, en commençant son ablution par le coude, et en finissant par le doigt index.
Moustapha est-il en effet persuadé, convaincu de tout ce qu'il nous a dit? est-il parfaitement sûr que Mahomet fut envoyé de Dieu, comme il est sûr que la ville de Stamboul existe, comme il est sûr que l'impératrice Catherine II a fait aborder une flotte du fond de la mer hyperborée dans le Péloponèse, chose aussi étonnante que le voyage de la Mecque à Jérusalem en une nuit; et que cette flotte a détruit celle des Ottomans auprès des Dardanelles?
Le fonds de Moustapha est qu'il croit ce qu'il ne croit pas. Il s'est accoutumé à prononcer comme son molla, certaines paroles qu'il prend pour des idées. Croire, c'est très souvent douter.
Sur quoi crois-tu cela? dit Harpagon. Je le crois sur ce que je le crois, répond maître Jacques. La plupart des hommes pourraient répondre de même.
Croyez-moi pleinement, mon cher lecteur; il ne faut pas croire de léger.
Mais que dirons-nous de ceux qui veulent persuader aux autres ce qu'ils ne croient point? Et que dirons-nous des monstres qui persécutent leurs confrères dans l'humble et raisonnable doctrine du doute et de la défiance de soi-même?
CROMWELL. [p. 296] ↩
Olivier Cromwell fut regardé avec admiration par les puritains et les indépendants d'Angleterre; il est encore leur héros. Mais Richard Cromwell son fils est mon homme.
Le premier est un fanatique qui serait sifflé aujourd'hui dans la chambre des communes, s'il y prononçait une seule des inintelligibles absurdités qu'il débitait avec tant de confiance devant d'autres fanatiques, qui l'écoutaient la bouche béante, et les yeux égarés au nom du Seigneur. S'il disait qu'il faut chercher le Seigneur, et combattre les combats du Seigneur; s'il introduisait le jargon juif dans le parlement d'Angleterre à la honte éternelle de l'esprit humain, il serait bien plus prêt d'être conduit à Bedlam que d'être choisi pour commander des armées.
Il était brave sans doute; les loups le sont aussi: il y a même des singes aussi furieux que des tigres. De fanatique il devint politique habile, c'est-à-dire, que de loup il devint renard, monta par la fourberie des premiers degrés où l'enthousiasme enragé du temps l'avait placé, jusqu'au faîte de la grandeur; et le fourbe marcha sur les têtes des fanatiques prosternés. Il régna, mais il vécut dans les horreurs de l'inquiétude. Il n'eut ni des jours sereins, ni des nuits tranquilles. Les consolations de l'amitié et de la société n'approchèrent jamais de lui; il mourut avant le temps, plus digne, sans doute, du dernier supplice que le roi qu'il fit conduire d'une fenêtre de son palais même à l'échafaud.
Richard Cromwell, au contraire, né avec un esprit doux et sage, refuse de garder la couronne de son père aux dépens du sang de trois ou quatre factieux qu'il pouvait sacrifier à son ambition. Il aime mieux être réduit à la vie privée que d'être un assassin tout-puissant. Il quitte le protectorat sans regret pour vivre en citoyen. Libre et tranquille à la campagne, il y jouit de la santé; il y possède son âme en paix pendant quatre-vingt-dix années, aimé de ses voisins, dont il est l'arbitre et le père.
Lecteurs, prononcez. Si vous aviez à choisir entre le destin du père et celui du fils, lequel prendriez-vous?
C U. [p. 297] ↩
On répétera ici ce qu'on a déjà dit ailleurs, et ce qu'il faut répéter toujours, jusqu'au temps où les Français se seront corrigés; c'est qu'il est indigne d'une langue aussi polie et aussi universelle que la leur, d'employer si souvent un mot deshonnête et ridicule pour signifier des choses communes, qu'on pourrait exprimer autrement sans le moindre embarras.
Pourquoi nommer cul-d'âne et cul-de-cheval des orties de mer? Pourquoi donner le nom de cul-blanc à l'oenante, et de cul-rouge à l'épeiche? Cette épeiche est une espèce de pivert, et l'oenante une espèce de moineau cendré. Il y a un oiseau qu'on nomme fétu-en-cul , ou paille-en-cul . On avait cent manières de le désigner d'une expression beaucoup plus précise. N'est-il pas impertinent d'appeler cul-de-vaisseau le fond de la poupe?
Plusieurs auteurs nomment encore à-cul un petit mouillage, un ancrage, une grève, un sable, une anse où les barques se mettent à l'abri des corsaires. Il y a un petit à-cul à Palo comme à Ste Marintée . (Voyage d'Italie.)
On se sert continuellement du mot cul-de-lampe pour exprimer un fleuron, un petit cartouche, un pendantif, un encorbellement, une base de pyramide, un placard, une vignette.
Un graveur se sera imaginé que cet ornement ressemble à la base d'une lampe; il l'aura nommé cul-de-lampe pour avoir plus tôt fait; et les acheteurs auront répété ce mot après lui. C'est ainsi que les langues se forment. Ce sont les artisans qui ont nommé leurs ouvrages et leurs instruments.
Certainement il n'y avait nulle nécessité de donner le nom de cul-de-four aux voûtes sphériques, d'autant plus que ces voûtes n'ont rien de celle d'un four qui est toujours surbaissée.
Le fond d'un artichaut est formé et creusé en ligne courbe, et le nom de cul ne lui convient en aucune manière. Les chevaux ont quelquefois une tache verdâtre dans les yeux, on l'appelle cul-de-verre . Une autre maladie des chevaux, qui est une espèce d'érésipèle, est appelée le cul-de-poule . Le haut d'un chapeau est un cul-de-chapeau . Il y a des boutons à compartiments qu'on appelle boutons-à-cul-de-dé .
Comment a-t-on pu donner le nom de cul-de-sac à l' angiportus des Romains? Les Italiens ont pris le nom d' angiporto , pour signifier strada senza uscita . On lui donnait autrefois chez nous le nom d' impasse , qui est expressif et sonore. C'est une grossièreté énorme que le mot de cul-de-sac ait prévalu.
Le terme de culage a été aboli. Pourquoi tous ceux que nous venons d'indiquer, ne le sont-ils pas? Ce terme infâme de culage signifiait le droit que s'étaient donnés plusieurs seigneurs dans les temps de la tyrannie féodale, d'avoir à leur choix les prémices de tous les mariages dans l'étendue de leurs terres. On substitua ensuite le mot de cuissage à celui de culage . Le temps seul peut corriger toutes les façons vicieuses de parler. Voyez Cuissage .
Il est triste qu'en fait de langue, comme en d'autres usages plus importants, ce soit la populace qui dirige les premiers d'une nation.
CUISSAGE OU CULAGE, [p. 299] ↩
DROIT DE PRÉLIBATION, DE MARQUETTE, &C.
Dion Cassius ce flatteur d'Auguste, ce détracteur de Cicéron, (parce que Cicéron avait défendu la cause de la liberté) cet écrivain sec et diffus, ce gazetier des bruits populaires; ce Dion Cassius rapporte que des sénateurs opinèrent pour récompenser César de tout le mal qu'il avait fait à la république, de lui donner le droit de coucher à l'âge de cinquante-sept ans avec toutes les dames qu'il daignerait honorer de ses faveurs. Et il se trouve encore parmi nous des gens assez bons pour croire cette ineptie. L'auteur même de l' Esprit des lois la prend pour une vérité; et en parle comme d'un décret qui aurait passé dans le sénat romain sans l'extrême modestie du dictateur, qui se sentit peu propre à remplir les voeux du sénat. Mais si les empereurs romains n'eurent pas ce droit par un sénatus consulte appuyé d'un plébiscite, il est très vraisemblable qu'ils l'obtinrent par la courtoisie des dames. Les Marc-Aurèles, les Juliens n'usèrent point de ce droit; mais tous les autres l'étendirent autant qu'ils le purent.
Il est étonnant que dans l'Europe chrétienne on ait fait très longtemps une espèce de loi féodale, et que du moins on ait regardé comme un droit coutumier, l'usage d'avoir le pucelage de sa vassale. La première nuit des noces de la fille au vilain appartenait sans contredit au seigneur.
Ce droit s'établit comme celui de marcher avec un oiseau sur le poing, et de se faire encenser à la messe. Les seigneurs, il est vrai, ne statuèrent pas que les femmes de leurs vilains leur appartiendraient, ils se bornèrent aux filles; la raison en est plausible. Les filles sont honteuses, il faut un peu de temps pour les apprivoiser. La majesté des lois les subjugue tout d'un coup; les fiancées donnaient donc sans résistance la première nuit de leurs noces au seigneur châtelain, ou au baron, quand il les jugeait dignes de cet honneur.
On prétend que cette jurisprudence commença en Ecosse; je le croirais volontiers: les seigneurs écossais avaient un pouvoir encore plus absolu sur leurs clans, que les barons allemands et français sur leurs sujets.
Il est indubitable que des abbés, des évêques s'attribuèrent cette prérogative en qualité de seigneurs temporels: et il n'y a pas bien longtemps que des prélats se sont désistés de cet ancien privilège pour des redevances en argent, auxquelles ils avaient autant de droit qu'aux pucelages des filles.
Mais remarquons bien que cet excès de tyrannie ne fut jamais approuvé par aucune loi publique. Si un seigneur ou un prélat avait assigné pardevant un tribunal réglé une fille fiancée à un de ses vassaux, pour venir lui payer sa redevance, il eût perdu, sans doute sa cause avec dépens.
Saisissons cette occasion d'assurer qu'il n'y a jamais eu de peuple un peu civilisé qui ait établi des lois formelles contre les moeurs; je ne crois pas qu'il y en ait un seul exemple. Des abus s'établissent, on les tolère; ils passent en coutume; les voyageurs les prennent pour des lois fondamentales. Ils ont vu, disent-ils, dans l'Asie de saints mahométans bien crasseux marcher tout nus, et de bonnes dévotes venir leur baiser ce qui ne mérite pas de l'être; mais je les défie de trouver dans l'Alcoran une permission à des gueux de courir tout nus et de faire baiser leur vilenie par des dames.
On me citera pour me confondre le Phallum que les Egyptiens portaient en procession, et l'idole Jaganat des Indiens. Je répondrai que cela n'est pas plus contre les moeurs que de s'aller faire couper le prépuce en cérémonie à l'âge de huit ans. On a porté dans quelques-unes de nos villes le saint prépuce en procession; on le garde encore dans quelques sacristies, sans que cette facétie ait causé le moindre trouble dans les familles. Je puis encore assurer qu'aucun concile, aucun arrêt de parlement n'a jamais ordonné qu'on fêterait le saint prépuce.
J'appelle loi contre les moeurs une loi publique, qui me prive de mon bien, qui m'ôte ma femme pour la donner à un autre; et je dis que la chose est impossible.
Quelques voyageurs prétendent qu'en Lapponie des maris sont venus leur offrir leurs femmes par politesse; c'est une plus grande politesse à moi de les croire. Mais je leur soutiens qu'ils n'ont jamais trouvé cette loi dans le code de la Lapponie; de même que vous ne trouverez ni dans les constitutions d'Allemagne, ni dans les ordonnances des rois de France, ni dans les registres du parlement d'Angleterre, aucune loi positive qui adjuge le droit de cuissage aux barons.
Des lois absurdes, ridicules, barbares, vous en trouverez partout; des lois contre les moeurs nulle part.
LE CURÉ DE CAMPAGNE. [p. 301] ↩
SECTION PREMIÈRE.
Un curé, que dis-je, un curé? un iman même, un talapoin, un brame doit avoir honnêtement de quoi vivre. Le prêtre en tout pays doit être nourri de l'autel, puisqu'il sert la république. Qu'un fanatique fripon ne s'avise pas de dire ici que je mets au niveau un curé et un brame, que j'associe la vérité avec l'imposture. Je ne compare que les services rendus à la société; je ne compare que la peine et le salaire.
Je dis que quiconque exerce une fonction pénible doit être bien payé de ses concitoyens; je ne dis pas qu'il doive regorger de richesses, souper comme Lucullus, être insolent comme Clodius. Je plains le sort d'un curé de campagne obligé de disputer une gerbe de blé à son malheureux paroissien, de plaider contre lui, d'exiger la dîme des lentilles, et de pois, d'être haï, et de haïr, de consumer sa misérable vie dans des querelles continuelles, qui avilissent l'âme autant qu'elles l'aigrissent.
Je plains encore davantage le curé à portion congrue, à qui des moines, nommés gros décimateurs , osent donner un salaire de quarante ducats, pour aller faire, pendant toute l'année, à deux ou trois milles de sa maison, le jour, la nuit, au soleil, à la pluie, dans les neiges, au milieu des glaces, les fonctions les plus désagréables, et souvent les plus inutiles. Cependant l'abbé, gros décimateur, boit son vin de Volney, de Baune, de Chambertin, de Silleri, mange ses perdrix et ses faisans, dort sur le duvet avec sa voisine, et fait bâtir un palais. La disproportion est trop grande.
On imagina du temps de Charlemagne que le clergé, outre ses terres, devait posséder la dîme des terres d'autrui: et cette dîme est au moins le quart en comptant les frais de culture. Pour assurer ce paiement, on stipula qu'il était de droit divin. Et comment était-il de droit divin? Dieu était-il descendu sur la terre pour donner le quart de mon bien à l'abbé du Mont-Cassin, à l'abbé de St Denis, à l'abbé de Foulde? non pas, que je sache. Mais on trouva qu'autrefois dans le désert d'Ethan, d'Oreb, de Cadés-Barné, on avait donné aux lévites quarante-huit villes, et la dîme de tout ce que la terre produisait.
Eh bien, gros décimateurs, allez à Cadés-Barné; habitez les quarante-huit villes qui sont dans ce désert inhabitable; prenez la dîme des cailloux que la terre y produit; et grand bien vous fasse.
Mais Abraham ayant combattu pour Sodome donna la dîme à Melchisédec prêtre et roi de Salem. Eh bien combattez pour Sodome, mais que Melchisédec ne me prenne le blé que j'ai semé.
Dans un pays chrétien de douze cent mille lieues carrés, dans tout le nord, dans la moitié de l'Allemagne, dans la Hollande, dans la Suisse, on paie le clergé de l'argent du trésor royal. Les tribunaux n'y retentissent point des procès mus entre les seigneurs et les curés, entre le gros et le petit décimateur, entre le pasteur demandeur, et l'ouaille intimée, en conséquence du troisième concile de Latran dont l'ouaille n'a jamais entendu parler.
Le roi de Naples cette année 1772, vient d'abolir la dîme dans une de ses provinces; les curés sont mieux payés, et la province le bénit.
Les prêtres égyptiens, dit-on, ne prenaient point la dîme. Non; mais on nous assure qu'ils avaient le tiers de toute l'Egypte en propre. O miracle! ô chose du moins difficile à croire! ils avaient le tiers du pays, et ils n'eurent pas bientôt les deux autres!
Ne croyez pas, mon cher lecteur, que les Juifs, qui étaient un peuple de col roide, ne se soient jamais plaints de l'impôt de la dîme.
Donnez-vous la peine de lire le Talmud de Babilone; et si vous n'entendez pas le chaldaïque, lisez la traduction faite par Gilbert Gaumin, avec les notes, le tout imprimé par les soins de Fabricius. Vous y verrez l'aventure d'une pauvre veuve avec le grand-prêtre Aaron, et comment le malheur de cette veuve fut cause de la querelle entre Dathen, Coré et Abiron d'un côté, et Aaron de l'autre.
Pag. 165. N o . 297. ‘Une veuve n'avait qu'une seule brebis, elle voulut la tondre: Aaron vient qui prend la laine pour lui; elle m'appartient, dit-il, selon la loi, Tu donneras les prémices de la laine à Dieu . La veuve implore en pleurant la protection de Coré. Coré va trouver Aaron. Ses prières sont inutiles; Aaron répond que par la loi la laine est à lui. Coré donne quelque argent à la femme et s'en retourne plein d'indignation.
‘Quelque temps après la brebis fait un agneau, Aaron revient et s'empare de l'agneau. La veuve vient encore pleurer auprès de Coré qui veut en vain fléchir Aaron. Le grand-prêtre lui répond, Il est écrit dans la loi, Tout mâle premier né de ton troupeau appartiendra à ton Dieu ; il mangea l'agneau, et Coré s'en alla en fureur.
‘La veuve au désespoir tue sa brebis. Aaron arrive encore, il en prend l'épaule et le ventre; Coré vient encore se plaindre. Aaron lui répond, il est écrit, Tu donneras le ventre et l'épaule aux prêtres .
‘La veuve ne pouvant plus contenir sa douleur, dit anathème à sa brebis. Aaron alors dit à la veuve, Il est écrit, Tout ce qui sera anathème dans Israël sera à toi , et il emporta la brebis tout entière.'
Ce qui n'est pas si plaisant, mais ce qui est fort singulier, c'est que dans un procès entre le clergé de Rheims et les bourgeois, cet exemple tiré du Talmud fut cité par l'avocat des citoyens. Gaumin assure qu'il en fut témoin. Cependant, on peut lui répondre que les décimateurs ne prennent pas tout au peuple; les commis des fermes ne le souffriraient pas. Chacun partage, comme il est bien juste.
Au reste, nous pensons que ni Aaron, ni aucun de nos curés ne se sont approprié les brebis et les agneaux des veuves de notre pays.
Nous ne pouvons mieux finir cet article honnête du Curé de campagne que par ce dialogue, dont une partie a déjà été imprimée.
SECTION SECONDE.
DIALOGUE.
ARISTON.
Eh bien, mon cher Téotime, vous allez donc être curé de campagne?
TÉOTIME.
Oui; on me donne une petite paroisse, et je l'aime mieux qu'une grande. Je n'ai qu'une portion limitée d'intelligence et d'activité; je ne pourrais certainement pas diriger soixante et dix mille âmes, attendu que je n'en ai qu'une; un grand troupeau m'effraye, mais je pourrai faire quelque bien à un petit. J'ai étudié assez de jurisprudence pour empêcher, autant que je le pourrai, mes pauvres paroissiens de se ruiner en procès. J'ai assez de connaissance de l'agriculture pour leur donner quelquefois des conseils utiles. Le seigneur du lieu et sa femme sont d'honnêtes gens qui ne sont point dévots, et qui m'aideront à faire du bien. Je me flatte que je vivrai assez heureux, et qu'on ne sera pas malheureux avec moi.
ARISTON.
N'êtes-vous pas fâché de n'avoir point de femme? ce serait une grande consolation; il serait doux après avoir prôné, chanté, confessé, communié, baptisé, enterré, consolé des malades, apaisé des querelles, consumé votre journée au service du prochain, de trouver dans votre logis une femme douce, agréable et honnête, qui aurait soin de votre linge et de votre personne, qui vous égaierait dans la santé, qui vous soignerait dans la maladie, qui vous ferait de jolis enfants, dont la bonne éducation serait utile à l'Etat. Je vous plains vous qui servez les hommes, d'être privé d'une consolation si nécessaire aux hommes.
TÉOTIME.
L'Eglise grecque a grand soin d'encourager les curés au mariage; l'Eglise anglicane et les protestants ont la même sagesse; l'Eglise latine a une sagesse contraire; il faut m'y soumettre. Peut-être aujourd'hui que l'esprit philosophique a fait tant de progrès, un concile ferait des lois plus favorables à l'humanité. Mais en attendant, je dois me conformer aux lois présentes; il en coûte beaucoup, je le sais; mais tant de gens qui valaient mieux que moi s'y sont soumis, que je ne dois pas murmurer.
ARISTON.
Vous êtes savant, et vous avez une éloquence sage; comment comptez-vous prêcher devant des gens de campagne?
TÉOTIME.
Comme je prêcherais devant les rois. Je parlerai toujours de morale, et jamais de controverse; Dieu me préserve d'approfondir la grâce concomitante, la grâce efficace, à laquelle on résiste, la suffisante qui ne suffit pas; d'examiner si les anges qui mangèrent avec Abraham et avec Loth avaient un corps, ou s'ils firent semblant de manger; si le diable Asmodée était effectivement amoureux de la femme du jeune Tobie; quelle est la montagne sur laquelle Jésus-Christ fut emporté par un autre diable; et si Jésus-Christ envoya deux mille diables, ou deux diables seulement dans le corps de deux mille cochons, etc. etc. Il y a bien des choses que mon auditoire n'entendrait pas, ni moi non plus. Je tâcherai de faire des gens de bien, et de l'être; mais je ne ferai point de théologiens, et je le serai le moins que je pourrai.
ARISTON.
O le bon curé! Je veux acheter une maison de campagne dans votre paroisse. Dites-moi, je vous prie, comment vous en userez dans la confession?
TÉOTIME.
La confession est une chose excellente, un frein aux crimes, inventé dans l'antiquité la plus reculée; on se confessait dans la célébration de tous les anciens mystères; nous avons imité et sanctifié cette sage pratique; elle est très bonne pour engager les coeurs ulcérés de haine à pardonner, et pour faire rendre par les petits voleurs ce qu'ils peuvent avoir dérobé à leur prochain. Elle a quelques inconvénients. Il y a beaucoup de confesseurs indiscrets, surtout parmi les moines, qui apprennent quelquefois plus de sottises aux filles que tous les garçons d'un village ne pourraient leur en faire. Point de détails dans la confession; ce n'est point un interrogatoire juridique, c'est l'aveu de ses fautes qu'un pécheur fait à l'Etre suprême entre les mains d'un autre pécheur qui va s'accuser à son tour. Cet aveu salutaire n'est point fait pour contenter la curiosité d'un homme.
ARISTON.
Et des excommunications, en userez-vous?
TÉOTIME.
Non; il y a des rituels où l'on excommunie les sauterelles, les sorciers et les comédiens. Je n'interdirai point l'entrée de l'église aux sauterelles, attendu qu'elles n'y vont jamais. Je n'excommunierai point les sorciers, parce qu'il n'y a point de sorciers: et à l'égard des comédiens, comme ils sont pensionnés par le roi, et autorisés par le magistrat, je me garderai bien de les diffamer. Je vous avouerai même comme à mon ami, que j'ai du goût pour la comédie, quand elle ne choque point les moeurs. J'aime passionnément le Misanthrope , et toutes les tragédies où il y a des moeurs. Le seigneur de mon village fait jouer dans son château quelques-unes de ces pièces, par de jeunes personnes qui ont du talent: ces représentations inspirent la vertu par l'attrait du plaisir; elles forment le goût; elles apprennent à bien parler et à bien prononcer. Je ne vois rien là que de très innocent, et même de très utile; je compte bien assister quelquefois à ces spectacles pour mon instruction, mais dans une loge grillée, pour ne point scandaliser les faibles.
ARISTON.
Plus vous me découvrez vos sentiments, et plus j'ai envie de devenir votre paroissien. Il y a un point bien important qui m'embarrasse. Comment ferez-vous pour empêcher les paysans de s'enivrer les jours de fêtes? c'est là leur grande manière de les célébrer. Vous voyez les uns accablés d'un poison liquide, la tête penchée vers les genoux, les mains pendantes, ne voyant point, n'entendant rien, réduits à un état fort au-dessous de celui des brutes, reconduits chez eux en chancelant par leurs femmes éplorées, incapables de travail le lendemain, souvent malades et abrutis pour le reste de leur vie. Vous en voyez d'autres devenus furieux par le vin, exciter des querelles sanglantes, frapper et être frappés, et quelquefois finir par le meurtre ces scènes affreuses, qui sont la honte de l'espèce humaine. Il le faut avouer, l'Etat perd plus de sujets par les fêtes que par les batailles; comment pourrez-vous diminuer dans votre paroisse un abus si exécrable?
TÉOTIME.
Mon parti est pris; je leur permettrai, je les presserai même de cultiver leurs champs les jours de fêtes après le service divin que je ferai de très bonne heure. C'est l'oisiveté de la férie qui les conduit au cabaret. Les jours ouvrables ne sont point les jours de la débauche et du meurtre. Le travail modéré contribue à la santé du corps et à celle de l'âme: de plus, ce travail est nécessaire à l'Etat. Supposons cinq millions d'hommes qui font par jour pour dix sous d'ouvrage l'un portant l'autre, et ce compte est bien modéré; vous rendez ces cinq millions d'hommes inutiles trente jours de l'année. C'est donc trente fois cinq millions de pièces de dix sous que l'Etat perd en main-d'oeuvre. Or certainement, Dieu n'a jamais ordonné, ni cette perte, ni l'ivrognerie.
ARISTON.
Ainsi vous concilierez la prière et le travail; Dieu ordonne l'un et l'autre. Vous servirez Dieu et le prochain; mais dans les disputes ecclésiastiques, quel parti prendrez-vous?
TÉOTIME.
Aucun. On ne dispute jamais sur la vertu, parce qu'elle vient de Dieu: on se querelle sur des opinions qui viennent des hommes.
ARISTON.
Oh le bon curé! le bon curé!
CURIOSITÉ. [p. 308] ↩
Suave mari magno turbantibus aequora ventis ,
E terra magnum alterius spectare laborem ;
Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas ,
Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est ;
Suave etiam belli certamina magna tueri
Per campos instructa tuâ sine parte pericli ;
Sed nil dulcius est, bene quam munita tenere
Edita doctrinâ sapientum templa serenâ ,
Despicere unde queas alios, passimque videre
Errare atque viam palantes quaerere vitae
Certare ingenio, contendere nobilitate ,
Noctes atque dies niti praestante labore
Ad summas emergere opes rerumque potiri .
O miseras hominum mentes! ô pectora caeca !
On voit avec plaisir dans le sein du repos,
Des mortels malheureux lutter contre les flots;
On aime à voir de loin deux terribles armées
Dans les champs de la mort au combat animées;
Non que le mal d'autrui soit un plaisir si doux;
Mais son danger nous plaît quand il est loin de nous.
Heureux qui retiré dans le temple des sages
Voit en paix sous ses pieds se former les orages,
Qui rit en contemplant les mortels insensés
De leur joug volontaire esclaves empressés,
Inquiets, incertains du chemin qu'il faut suivre,
Sans penser, sans jouir, ignorant l'art de vivre,
Dans l'agitation consumant leurs beaux jours,
Poursuivant la fortune, et rampant dans les cours.
O vanité de l'homme! ô faiblesse! ô misère!
Pardon, Lucrèce, je soupçonne que vous vous trompez ici en morale comme vous vous trompez toujours en physique. C'est, à mon avis, la curiosité seule qui fait courir sur le rivage pour voir un vaisseau que la tempête va submerger. Cela m'est arrivé; et je vous jure que mon plaisir mêlé d'inquiétude et de malaise, n'était point du tout le fruit de ma réflexion; il ne venait point d'une comparaison secrète entre ma sécurité et le danger de ces infortunés; j'étais curieux et sensible.
A la bataille de Fontenoy les petits garçons et les petites filles montaient sur les arbres d'alentour pour voir tuer du monde.
Les dames se firent apporter des sièges sur un bastion de la ville de Liége, pour jouir du spectacle à la bataille de Rocou.
Quand j'ai dit, heureux qui voit en paix se former les orages , mon bonheur était d'être tranquille et de chercher le vrai; et non pas de voir souffrir des êtres pensants persécutés pour l'avoir cherché, opprimés par des fanatiques, ou par des hypocrites.
Si l'on pouvait supposer un ange volant sur six belles ailes du haut de l'empyrée, s'en allant regarder par un soupirail de l'enfer les tourments et les contorsions des damnés, et se réjouissant de ne rien sentir de leurs inconcevables douleurs, cet ange tiendrait beaucoup du caractère de Belzébuth.
Je ne connais point la nature des anges parce que je ne suis qu'homme; il n'y a que les théologiens qui la connaissent. Mais en qualité d'homme, je pense par ma propre expérience et par celle de tous les badauds mes confrères, qu'on ne court à aucun spectacle de quelque genre qu'il puisse être, que par pure curiosité.
Cela me semble si vrai, que le spectacle a beau être admirable, on s'en lasse à la fin. Le public de Paris ne va plus guère au Tartuffe qui est le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvres de Molière; pourquoi? c'est qu'il y est allé souvent; c'est qu'il le sait par coeur. Il en est ainsi d' Andromaque .
Perrin Dandin a bien malheureusement raison quand il propose à la jeune Isabelle de la mener voir comment on donne la question; Cela fait, dit-il, passer une heure ou deux. Si cette anticipation du dernier supplice, plus cruelle souvent que le supplice même, était un spectacle public, toute la ville de Toulouse aurait volé en foule pour contempler le vénérable Calas souffrant à deux reprises ces tourments abominables sur les conclusions du procureur général. Pénitents blancs, pénitents gris et noirs, femmes, filles, maîtres des jeux floraux, étudiants, laquais, servantes, filles de joie, docteurs en droit canon, tout se serait pressé. On se serait étouffé à Paris pour voir passer dans un tombereau le malheureux général Lalli avec un bâillon de six doigts dans la bouche.
Mais si ces tragédies de cannibales qu'on représente quelquefois chez la plus frivole des nations et la plus ignorante en général dans les principes de la jurisprudence et de l'équité; si les spectacles donnés par quelques tigres à des singes, comme ceux de la St Barthélemi et ses diminutifs, se renouvelaient tous les jours; on déserterait bientôt un tel pays; on le fuirait avec horreur; on abandonnerait sans retour la terre infernale où ces barbaries seraient fréquentes.
Quand les petits garçons et les petites filles déplument leurs moineaux, c'est purement par esprit de curiosité, comme lorsqu'elles mettent en pièces les jupes de leurs poupées. C'est cette passion seule qui conduit tant de monde aux exécutions publiques, comme nous l'avons vu. Etrange empressement de voir des misérables ! a dit l'auteur d'une tragédie.
Je me souviens, qu'étant à Paris lorsqu'on fit souffrir à Damiens une mort des plus recherchées et des plus affreuses qu'on puisse imaginer, toutes les fenêtres qui donnaient sur la place furent louées chèrement par les dames; aucune d'elles assurément ne faisait la réflexion consolante qu'on ne la tenaillerait point aux mamelles, qu'on ne verserait point du plomb fondu et de la poix résine bouillante dans ses plaies, et que quatre chevaux ne tireraient point ses membres disloqués et sanglants. Un des bourreaux jugea plus sainement que Lucrèce; car lorsqu'un des académiciens de Paris voulut entrer dans l'enceinte pour examiner la chose de plus près, et qu'il fut repoussé par les archers, laissez entrer, Monsieur , dit-il, c'est un amateur . C'est-à-dire, c'est un curieux; ce n'est pas par méchanceté qu'il vient ici, ce n'est pas par un retour sur soi-même, pour goûter le plaisir de n'être pas écartelé: c'est uniquement par curiosité comme on va voir des expériences de physique.
La curiosité est naturelle à l'homme, aux singes et aux petits chiens. Menez avec vous un petit chien dans votre carrosse, il mettra continuellement ses pattes à la portière pour voir ce qui se passe. Un singe fouille partout, il a l'air de tout considérer. Pour l'homme, vous savez comme il est fait; Rome, Londres, Paris, passent leur temps à demander ce qu'il y a de nouveau.
CYRUS. [p. 311] ↩
Plusieurs doctes, et Rollin après eux, dans un siècle où l'on cultive sa raison, nous ont assuré que Javan, qu'on suppose être le père des Grecs, était petit-fils de Noé. Je le crois, comme je crois que Persée était le fondateur du royaume de Perse, et Niger de la Nigritie. C'est seulement un de mes chagrins que les Grecs n'aient jamais connu ce Noé le véritable auteur de leur race. J'ai marqué ailleurs mon étonnement et ma douleur qu'Adam notre pere à tous ait été absolument ignoré de tous, depuis le Japon jusqu'au détroit de Lemaire, excepté d'un petit peuple, qui n'a lui-même été connu que très tard. La science des généalogies est sans doute très certaine; mais bien difficile.
Ce n'est ni sur Javan, ni sur Noé, ni sur Adam que tombent aujourd'hui mes doutes; c'est sur Cyrus; et je ne recherche pas laquelle des fables débitées sur Cyrus est préférable, celle d'Hérodote ou de Ctésias, ou celle de Xénophon, ou de Diodore, ou de Justin, qui toutes se contredisent. Je ne demande point pourquoi on s'est obstiné à donner ce nom de Cyrus à un barbare qui s'appelait Kosrou, et ceux de Cyropolis, de Persépolis, à des villes qui ne se nommèrent jamais ainsi.
Je laisse là tout ce qu'on a dit du grand Cyrus, et jusqu'au roman de ce nom, et jusqu'aux Voyages que l'Ecossais Ramsay lui a fait entreprendre. Je demande seulement quelques instructions aux Juifs sur ce Cyrus dont ils ont parlé.
Je remarque d'abord qu'aucun historien n'a dit un mot des Juifs dans l'histoire de Cyrus, et que les Juifs sont les seuls qui osent faire mention d'eux-mêmes en parlant de ce prince.
Ils ressemblent en quelque sorte à certaines gens qui disaient d'un ordre de citoyens supérieur à eux: Nous connaissons messieurs, mais messieurs ne nous connaissent pas . Il en est de même d'Alexandre par rapport aux Juifs. Aucun historien d'Alexandre n'a mêlé le nom d'Alexandre avec celui des Juifs; mais Joseph ne manque pas de dire qu'Alexandre vint rendre ses respects à Jérusalem; qu'il adora je ne sais quel pontife juif nommé Jaddus, lequel lui avait autrefois prédit en songe la conquête de la Perse. Tous les petits se rengorgent; les grands songent moins à leur grandeur.
Quand Tarif vient conquérir l'Espagne, les vaincus lui disent qu'ils l'ont prédit. On en dit autant à Gengiskan, à Tamerlan, à Mahomet II.
A Dieu ne plaise que je veuille comparer les prophéties juives à tous les diseurs de bonne aventure qui font leur cour aux victorieux, et qui leur prédisent ce qui leur est arrivé. Je remarque seulement que les Juifs produisent des témoignages de leur nation sur Cyrus, environ cent soixante ans avant qu'il fût au monde.
On trouve dans Isaïe (chap. XLV ): Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus qui est mon Christ; que j'ai pris par la main pour lui assujettir les nations, pour mettre en fuite les rois, pour ouvrir devant lui les portes. Je marcherai devant vous; j'humilierai les grands; je romprai les coffres; je vous donnerai l'argent caché, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, etc .
Quelques savants ont peine à digérer que le Seigneur gratifie du nom de son Christ un profane de la religion de Zoroastre. Ils osent dire que les Juifs firent comme tous les faibles qui flattent les puissants, qu'ils supposèrent des prédictions en faveur de Cyrus.
Ces savants ne respectent pas plus Daniel qu'Isaïe. Ils traitent toutes les prophéties attribuées à Daniel avec le même mépris que St Jérôme montre pour l'aventure de Suzanne, pour celle du dragon de Bélus, et pour les trois enfants de la fournaise.
Ces savants ne paraissent pas assez pénétrés d'estime pour les prophètes. Plusieurs même d'entre eux prétendent qu'il est métaphysiquement impossible de voir clairement l'avenir; qu'il y a une contradiction formelle à voir ce qui n'est point; que le futur n'existe pas, et par conséquent ne peut être vu; que les fraudes en ce genre sont innombrables chez toutes les nations; qu'il faut enfin se défier de tout dans l'histoire ancienne.
Ils ajoutent que s'il y a jamais eu une prédiction formelle, c'est celle de la découverte de l'Amérique dans Sénèque le Tragique.
. . . Venient annis
Saecula seris quibus oceanus
Vincula rerum laxet, et ingens
Pateat tellus, etc .
Les quatre étoiles du pôle antarctique sont annoncées encore plus clairement dans le Dante. Cependant personne ne s'est avisé de prendre Sénèque et Aligeri Dante pour des devins.
Nous sommes bien loin d'être du sentiment de ces savants, nous nous bornons à être extrêmement circonspects sur les prophètes de nos jours.
Quant à l'histoire de Cyrus, il est vraiment fort difficile de savoir s'il mourut de sa belle mort, ou si Thomiris lui fit couper la tête. Mais je souhaite, je l'avoue, que les savants qui font couper le cou à Cyrus, aient raison. Il n'est pas mal que ces illustres voleurs de grand chemin, qui vont pillant, ensanglantant la terre, soient un peu châtiés quelquefois.
Cyrus a toujours été destiné à devenir le sujet d'un roman. Xénophon a commencé, et malheureusement Ramsay a fini. Enfin, pour faire voir quel triste sort attend les héros, Danchet a fait une tragédie de Cyrus.
Cette tragédie est entièrement ignorée. La Cyropédie de Xénophon est plus connue; parce qu'elle est d'un Grec. Les Voyages de Cyrus le sont beaucoup moins, quoiqu'ils aient été imprimés en anglais et en français, et qu'on y ait prodigué l'érudition.
Le plaisant du roman intitulé Voyages de Cyrus consiste à trouver un Messie partout, à Memphis, à Babilone, à Ecbatane, à Tyr comme à Jérusalem, et chez Platon comme dans l'Evangile. L'auteur ayant été quaker, anabaptiste, anglican, presbytérien, était venu se faire féneloniste à Cambrai sous l'illustre auteur du Télémaque . Etant devenu depuis précepteur de l'enfant d'un grand seigneur, il se crut fait pour instruire l'univers, et pour le gouverner; il donne en conséquence des leçons à Cyrus pour devenir le meilleur roi de l'univers, et le théologien le plus orthodoxe.
Ces deux rares qualités paraissent assez incompatibles.
Il le mène à l'école de Zoroastre, et ensuite à celle du jeune Juif Daniel le plus grand philosophe qui ait jamais été. Car non seulement il expliquait tous les songes; (ce qui est le fin de la science humaine) mais il devinait tous ceux qu'on avait faits; et c'est à quoi nul autre que lui n'est encore parvenu. On s'attendait que Daniel présenterait la belle Suzanne au prince: c'était la marche naturelle d'un roman; mais il n'en fit rien.
Cyrus en récompense a de longues conversations avec le grand roi Nabucodonosor, dans le temps qu'il était boeuf; et Ramsay fait ruminer Nabucodonosor en théologien très profond.
Et puis, étonnez-vous que le prince, pour qui cet ouvrage fut composé, aimât mieux aller à la chasse, ou à l'opéra que de le lire.
DAVID. [p. 315] ↩
Nous devons révérer David comme un prophète, comme un roi, comme un ancêtre du saint époux de Marie, comme un homme qui a mérité la miséricorde de Dieu par sa pénitence.
Je dirai hardiment que l'article David qui suscita tant d'ennemis à Bayle, premier auteur d'un dictionnaire de faits et de raisonnements, ne méritait pas le bruit étrange que l'on fit alors. Ce n'était pas David qu'on voulait défendre, c'était Bayle qu'on voulait perdre. Quelques prédicants de Hollande ses ennemis mortels, furent aveuglés par leur haine, au point de le reprendre d'avoir donné des louanges à des papes qu'il en croyait dignes, et d'avoir réfuté les calomnies débitées contre eux.
Cette ridicule et honteuse injustice fut signée de douze théologiens le 20 décembre 1698, dans le même consistoire où ils feignaient de prendre la défense du roi David. Comment osaient-ils manifester hautement une passion lâche que le reste des hommes s'efforce toujours de cacher? Ce n'était pas seulement le comble de l'injustice et du mépris de toutes les sciences; c'était le comble du ridicule que de défendre à un historien d'être impartial, et à un philosophe d'être raisonnable. Un homme seul n'oserait être insolent et injuste à ce point: mais dix ou douze personnes rassemblées avec quelque espèce d'autorité, sont capables des injustices les plus absurdes. C'est qu'elles sont soutenues les unes par les autres, et qu'aucune n'est chargée en son propre nom de la honte de la compagnie.
Une grande preuve que cette condamnation de Bayle fut personnelle, est ce qui arriva en 1761 à M. Hutte membre du parlement d'Angleterre. Les docteurs Chandler et Palmer avaient prononcé l'oraison funèbre du roi George II, et l'avaient, dans leurs discours, comparé au roi David, selon l'usage de la plupart des prédicateurs qui croient flatter les rois.
M. Hutte ne regarda point cette comparaison comme une louange; il publia la fameuse dissertation The Man after God's own heart . Dans cet écrit il veut faire voir que George II, roi beaucoup plus puissant que David, n'étant pas tombé dans les fautes du melk juif, et n'ayant pu par conséquent faire la même pénitence, ne pouvait lui être comparé.
Il suit pas à pas les livres des Rois. Il examine toute la conduite de David beaucoup plus sévèrement que Bayle; et il fonde son opinion sur ce que le Saint-Esprit ne donne aucune louange aux actions qu'on peut reprocher à David. L'auteur anglais juge le roi de Judée uniquement sur les notions que nous avons aujourd'hui du juste et de l'injuste.
Il ne peut approuver que David rassemble une bande de voleurs au nombre de quatre cents, qu'il se fasse armer par le grand-prêtre Abimélec de l'épée de Goliath, et qu'il en reçoive les pains consacrés. Livre I des Rois, chap. XXI et XXII.
Qu'il descende chez l'agriculteur Nabal pour mettre chez lui tout à feu et à sang, parce que Nabal a refusé des contributions à sa troupe de brigands; que Nabal meure peu de jours après, et que David épouse la veuve. Chap. XXV.
Il réprouve sa conduite avec le roi Achis, possesseur de cinq ou six villages dans le canton de Geth. David était alors à la tête de six cents bandits, allait faire des courses chez les alliés de son bienfaiteur Achis; il pillait tout, il égorgeait tout, vieillards, femmes, enfants à la mamelle. Et pourquoi massacrait-il les enfants à la mamelle? C'est , dit le texte, de peur que ces enfants n'en portassent la nouvelle au roi Achis . Chap. XXVII.
Cependant Saül perd une bataille contre les Philistins, et il se fait tuer par son écuyer. Un Juif en apporte la nouvelle à David qui lui donne la mort pour sa récompense. Livre II des Rois, chap. I.
Isboseth succède à son père Saül; David est assez fort pour lui faire la guerre. Enfin, Isboseth est assassiné.
David s'empare de tout le royaume; il surprend la petite ville ou le village de Raba, et il fait mourir tous les habitants par des supplices assez extraordinaires; on les scie en deux, on les déchire avec des herses de fer, on les brûle dans des fours à briques. Livre II des Rois, chap. XII.
Après ces expéditions, il y a une famine de trois ans dans le pays. En effet, à la manière dont on faisait la guerre, les terres devaient être mal ensemencées. On consulte le Seigneur, et on lui demande pourquoi il y a famine? La réponse était fort aisée; c'était assurément parce que dans un pays qui à peine produit du blé, quand on a fait cuire les laboureurs dans des fours à briques, et qu'on les a sciés en deux, il reste peu de gens pour cultiver la terre: mais le Seigneur répond que c'est parce que Saül avait tué autrefois des Gabaonites.
Que fait aussitôt David? il assemble les Gabaonites, il leur dit que Saül a eu grand tort de leur faire la guerre; que Saül n'était point comme lui, selon le coeur de Dieu, qu'il est juste de punir sa race; et il leur donne sept petits-fils de Saül à pendre, lesquels furent pendus, parce qu'il y avait eu famine. LivreII des Rois, chap. XXI.
M. Hutte a la justice de ne point insister sur l'adultère avec Betzabé et sur le meurtre d'Urie, puisque ce crime fut pardonné à David lorsqu'il se repentit. Le crime est horrible, abominable: mais enfin le Seigneur transféra son péché, l'auteur anglais le transfère aussi.
Personne ne murmura en Angleterre contre l'auteur; son livre fut réimprimé avec l'approbation publique: la voix de l'équité se fait entendre tôt ou tard chez les hommes. Ce qui paraissait téméraire il y a quatre-vingts ans, ne paraît aujourd'hui que simple et raisonnable, pourvu qu'on se tienne dans les bornes d'une critique sage et du respect qu'on doit aux livres divins.
D'ailleurs il n'en va pas en Angleterre aujourd'hui comme autrefois. Ce n'est plus le temps où un verset d'un livre hébreu, mal traduit d'un jargon barbare en un jargon plus barbare encore, mettait en feu trois royaumes. Le parlement prend peu d'intérêt à un roitelet d'un petit canton de la Syrie.
Rendons justice à Dom Calmet; il n'a point passé les bornes dans son Dictionnaire de la Bible à l'article David. Nous ne prétendons point , dit-il, approuver la conduite de David; il est croyable qu'il ne tomba dans ces excès de cruauté qu'avant qu'il eût reconnu le crime qu'il avait commis avec Betzabé . Nous ajouterons que probablement il les reconnut tous; car ils sont assez nombreux.
Faisons ici une question qui nous paraît très importante. Ne s'est-on pas souvent mépris sur l'article David? S'agit-il de sa personne, de sa gloire, du respect dû aux livres canoniques? Ce qui intéresse le genre humain n'est-ce pas que l'on ne consacre jamais le crime? Qu'importe le nom de celui qui égorgeait les femmes et les enfants de ses alliés, qui faisait pendre les petits-fils de son roi, qui faisait scier en deux, brûler dans des fours, déchirer sous des herses des citoyens malheureux? Ce sont ces actions que nous jugeons, et non les lettres qui composent le nom du coupable; le nom n'augmente ni ne diminue le crime.
Plus on révère David comme réconcilié avec Dieu par son repentir, et plus on condamne les cruautés dont il s'est rendu coupable.
DÉFLORATION. [p. 318] ↩
Il semble que le Dictionnaire encyclopédique, à l'article Défloration , fasse entendre qu'il n'était pas permis par les lois romaines de faire mourir une fille, à moins qu'auparavant on ne lui ôtât sa virginité. On donne pour exemple la fille de Séjan, que le bourreau viola dans la prison avant de l'étrangler, pour n'avoir pas à se reprocher d'avoir étranglé une pucelle, et pour satisfaire à la loi.
Premièrement, Tacite ne dit point que la loi ordonnât qu'on ne fît jamais mourir les pucelles. Une telle loi n'a jamais existé; et si une fille de vingt ans, vierge ou non, avait commis un crime capital, elle aurait été punie comme une vieille mariée; mais la loi portait qu'on ne punirait pas de mort les enfants, parce qu'on les croyait incapables de crimes.
La fille de Séjan était enfant aussi bien que son frère; et si la barbarie de Tibère, et la lâcheté du sénat les abandonnèrent au bourreau, ce fut contre toutes les lois. De telles horreurs ne se seraient pas commises du temps des Scipions et de Caton le censeur. Cicéron n'aurait pas fait mourir une fille de Catilina âgée de sept à huit ans. Il n'y avait que Tibère et le sénat de Tibère qui pussent outrager ainsi la nature. Le bourreau qui commit les deux crimes abominables de déflorer une fille de huit ans, et de l'étrangler ensuite, méritait d'être un des favoris de Tibère.
Heureusement Tacite ne dit point que cette exécrable exécution soit vraie; il dit qu'on l'a rapportée, tradunt ; et ce qu'il faut bien observer, c'est qu'il ne dit point que la loi défendît d'infliger le dernier supplice à une vierge; il dit seulement que la chose était inouïe, inauditum . Quel livre immense on composerait de tous les faits qu'on a crus, et dont il fallait douter!
DÉJECTION. [p. 319] ↩
EXCRÉMENS, LEUR RAPPORT AVEC LE CORPS DE L'HOMME, AVEC SES IDÉES ET SES PASSIONS.
L'homme n'a jamais pu produire par l'art, rien de ce que fait la nature. Il a cru faire de l'or, et il n'a jamais pu seulement faire de la boue, quoiqu'il en soit pétri. On nous a fait voir un canard artificiel qui marchait, qui béquetait, mais on n'a pu réussir à le faire digérer, et à former de vraies déjections.
Quel art pourrait produire une matière qui ayant été préparée par les glandes salivaires, ensuite par le suc gastrique, puis par la bile hépatique, et par le suc pancréatique, ayant fourni dans sa route un chyle qui s'est changé en sang, devient enfin ce composé fétide et putride, qui sort de l'intestin rectum par la force étonnante des muscles?
Il y a sans doute autant d'industrie et de puissance à former ainsi cette déjection qui rebute la vue, et à lui préparer les conduits que servent à sa sortie, qu'à produire la semence qui fit naître Alexandre, Virgile et Newton, et les yeux avec lesquels Galilée vit de nouveaux cieux. La décharge de ces excréments est nécessaire à la vie comme la nourriture.
Le même artifice les prépare, les pousse, et les évacue chez l'homme et chez les animaux.
Ne nous étonnons pas que l'homme avec tout son orgueil, naisse entre la matière fécale et l'urine, puisque ces parties de lui-même plus ou moins élaborées, plus souvent, ou plus rarement expulsées, plus ou moins putrides, décident de son caractère et de la plupart des actions de sa vie.
Sa merde commence à se former dans le doudénum quand ses aliments sortent de son estomac et s'imprègnent de la bile de son foie. Qu'il ait une diarrhée, il est languissant et doux, la force lui manque pour être méchant. Qu'il soit constipé, alors les sels et les soufres de sa merde entrent dans son chyle, portent l'acrimonie dans son sang, fournissent souvent à son cerveau des idées atroces. Tel homme (et le nombre en est grand) n'a commis des crimes qu'à cause de l'acrimonie de son sang, qui ne venait que de ses excréments par lesquels ce sang était altéré.
O homme! qui oses te dire l'image de Dieu, dis-moi si Dieu mange, et s'il a un boyau rectum!
Toi l'image de Dieu! et ton coeur et ton esprit dépend d'une selle!
Toi l'image de Dieu sur ta chaise percée! Le premier qui dit cette impertinence, la proféra-t-il par une extrême bêtise, ou par un extrême orgueil?
Plus d'un penseur (comme vous le verrez ailleurs) a douté qu'une âme immatérielle et immortelle, pût venir je ne sais d'où, se loger pour si peu de temps entre de la matière fécale et de l'urine.
Qu'avons-nous, disent-ils, au-dessus des animaux? plus d'idées, plus de mémoire, la parole, et deux mains adroites. Qui nous les a données? celui qui donne des ailes aux oiseaux et des écailles aux poissons. Si nous sommes ses créatures, comment pouvons-nous être son image?
Nous répondons à ces philosophes que nous ne sommes l'image de Dieu que par la pensée. Ils nous répliquent que la pensée est un don de Dieu, qui n'est point du tout sa peinture; et que nous ne sommes images de Dieu en aucune façon. Nous les laissons dire, et nous les renvoyons à messieurs de Sorbonne.
Plusieurs animaux mangent nos excréments; et nous mangeons ceux de plusieurs animaux, ceux des grives, des bécasses, des ortolans, des alouettes.
Voyez à l'article Ezéchiel pourquoi le Seigneur lui ordonna de manger de la merde sur son pain, et se borna ensuite à la fiente de vache.
Nous avons connu le trésorier Paparel qui mangeait les déjections des laitières; mais ce cas est rare, et c'est celui de ne pas disputer des goûts.
DÉLUGE UNIVERSEL. [p. 321] ↩
Nous commençons par déclarer que nous croyons le déluge universel, parce qu'il est rapporté dans les saintes Ecritures hébraïques transmises aux chrétiens.
Nous le regardons comme un miracle, 1 o . Parce que tous les faits où Dieu daigne intervenir dans les sacrés cahiers sont autant de miracles.
2 o . Parce que l'Océan n'aurait pu s'élever de quinze coudées, ou vingt et un pieds et demi de roi au-dessus des plus hautes montagnes, sans laisser son lit à sec, et sans violer en même temps toutes les lois de la pesanteur et de l'équilibre des liqueurs; ce qui exigeait évidemment un miracle.
3 o . Parce que quand même il aurait pu parvenir à la hauteur proposée, l'arche n'aurait pu contenir, selon les lois de la physique, toutes les bêtes de l'univers et leur nourriture pendant si longtemps, attendu que les lions, les tigres, les panthères, les léopards, les onces, les rhinocéros, les ours, les loups, les hyènes, les aigles, les éperviers, les milans, les vautours, les faucons, et tous les animaux carnassiers, qui ne se nourrissent que de chair, seraient morts de faim, même après avoir mangé toutes les autres espèces.
On imprima autrefois à la suite des Pensées de Pascal une dissertation d'un marchand de Rouen nommé Pelletier, dans laquelle il propose la manière de bâtir un vaisseau où l'on puisse faire entrer tous les animaux, et les nourrir pendant un an. On voit bien que ce marchand n'avait jamais gouverné de basse-cour. Nous sommes obligés d'envisager M. le Pelletier architecte de l'arche, comme un visionnaire qui ne se connaissait pas en ménagerie, et le déluge comme un miracle adorable, terrible, et incompréhensible à la faible raison du sieur le Pelletier, tout comme à la nôtre.
4 o . Parce que l'impossibilité physique d'un déluge universel par des voies naturelles, est démontrée en rigueur; en voici la démonstration.
Toutes les mers couvrent la moitié du globe; en prenant une mesure commune de leur profondeur vers les rivages et en haute mer, on compte cinq cents pieds.
Pour qu'elles couvrissent les deux hémisphères seulement de cinq cents pieds, il faudrait non seulement un océan de cinq cents pieds de profondeur sur toute la terre habitable; mais il faudrait encore une nouvelle mer pour envelopper notre Océan actuel; sans quoi les lois de la pesanteur et des fluides feraient écouler ce nouvel amas d'eau profond de cinq cents pieds, que la terre supporterait.
Voilà donc deux nouveaux océans pour couvrir seulement de cinq cents pieds le globe terraquée.
En ne donnant aux montagnes que vingt mille pieds de hauteur, ce serait donc quarante océans de cinq cents pieds de hauteur chacun, qu'il serait nécessaire d'établir les uns sur les autres pour égaler seulement la cime des hautes montagnes. Chaque océan supérieur contiendrait tous les autres, et le dernier de tous ces océans serait d'une circonférence qui contiendrait quarante fois celle du premier.
Pour former cette masse d'eau, il aurait fallu la créer du néant. Pour la retirer, il aurait fallu l'anéantir.
Donc l'événement du déluge est un double miracle, et le plus grand qui ait jamais manifesté la puissance de l'Eternel souverain de tous les globes.
Nous sommes très surpris que des savants aient attribué à ce déluge quelques coquilles répandues cà et là sur notre continent; et que d'autres savants aient prétendu que des couches régulières de coquilles (qui n'existent point) sont des marques certaines du séjour de la mer pendant des millions de siècles sur la terre que nous habitons. (Voyez Coquilles .)
Nous sommes encore plus surpris de ce que nous lisons à l'article Déluge du grand Dictionnaire encyclopédique; on y cite Hist. du ciel , tom. I depuis la page 105. un auteur qui dit des choses si profondes, qu'on les prendrait pour creuses. C'est toujours Pluche; il prouve l'universalité du déluge par l'histoire des géants qui firent la guerre aux dieux.
Briarée, selon lui, est visiblement le déluge, car il signifie la perte de la sérénité ; et en quelle langue signifie-t-il cette perte? En hébreu. Mais briarée est un mot grec qui veut dire robuste . Ce n'est point un mot hébreu. Quand par hasard il le serait, gardons-nous d'imiter Bochart qui fait dériver tant de mots grecs, latins, français même, de l'idiome hébraïque. Il est certain que les Grecs ne connaissaient pas plus l'idiome juif que la langue chinoise.
Le géant Othus est aussi en hébreu, selon Pluche, le dérangement des saisons . Mais c'est encore un mot grec qui ne signifie rien, du moins que je sache; et quand il signifierait quelque chose, quel rapport s'il vous plaît avec l'hébreu?
Porphirion est un tremblement de terre en hébreu; mais en grec c'est du porphyre . Le déluge n'a que faire là.
Mimas, c'est une grande pluie ; pour le coup en voilà une qui peut avoir quelque rapport au déluge. Mais en grec mimas veut dire imitateur, comédien ; et il n'y a pas moyen de donner au déluge une telle origine.
Encelade, autre preuve du déluge en hébreu; car, selon Pluche, c'est la fontaine du temps ; mais malheureusement en grec c'est du bruit .
Ephialtes, autre démonstration du déluge en hébreu; car éphialtes qui signifie sauteur, oppresseur, incube en grec, est, selon Pluche, un grand amas de nuées .
Or les Grecs ayant tout pris chez les Hébreux qu'ils ne connaissaient pas, ont évidemment donné à leurs géants tous ces noms que Pluche tire de l'hébreu comme il peut; le tout en mémoire du déluge.
Deucalion, selon lui, signifie l' affaiblissement du soleil . Cela n'est pas vrai; mais n'importe.
C'est ainsi que raisonne Pluche; c'est lui qui cite l'auteur de l'article Déluge sans le réfuter. Parle-t-il sérieusement? se moque-t-il? je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a guère de système dont on puisse parler sans rire.
J'ai peur que cet article du grand Dictionnaire, attribué à M. Boulanger ne soit sérieux; en ce cas nous demandons si ce morceau est philosophique? La philosophie se trompe si souvent, que nous n'osons prononcer contre M. Boulanger.
Nous osons encore moins demander ce que c'est que l'abîme qui se rompit, et les cataractes du ciel qui s'ouvrirent. Commentaire sur la Genèse page 197 etc. Isaac Vossius nie l'universalité du déluge; il dit, hoc est pie nugari . Calmet la soutient en assurant que les corps ne pèsent dans l'air que par la raison que l'air les comprime. Calmet n'était pas physicien, et la pesanteur de l'air n'a rien à faire avec le déluge. Contentons-nous de lire et de respecter tout ce qui est dans la Bible sans en comprendre un mot.
Je ne comprends pas comment Dieu créa une race pour la noyer et pour lui substituer une race plus méchante encore.
Comment sept paires de toutes les espèces d'animaux inondés vinrent des quatre quarts du globe, avec deux paires des immondes, sans que les loups mangeassent les brebis en chemin; et sans que les éperviers mangeassent les pigeons, etc. etc.
Comment huit personnes purent gouverner, nourrir, abreuver tant d'embarqués pendant près de deux ans; car il fallut encore un an après la cessation du déluge pour alimenter tous ces passagers, vu que l'herbe était courte.
Je ne suis pas comme M. Pelletier. J'admire tout; et je n'explique rien.
DÉMOCRATIE. [p. 324] ↩
Le pire des états c'est l'état populaire.
Cinna s'en explique ainsi à Auguste. Mais aussi Maxime soutient que
Le pire des états c'est l'état monarchique.
Bayle ayant plus d'une fois, dans son Dictionnaire, soutenu le pour et le contre, fait à l'article Périclès un portrait fort hideux de la démocratie, et surtout de celle d'Athènes.
Un républicain, grand amateur de la démocratie, qui est l'un de nos faiseurs de questions, nous envoie sa réfutation de Bayle et son apologie d'Athènes. Nous exposerons ses raisons. C'est le privilège de quiconque écrit de juger les vivants et les morts; mais on est jugé soi-même par d'autres, qui le seront à leur tour; et de siècle en siècle toutes les sentences sont réformées.
Bayle donc, après quelques lieux communs, dit ces propres mots: Qu'on chercherait en vain, dans l'histoire de Macédoine, autant de tyrannie que l'histoire d'Athènes nous en présente .
Peut-être Bayle était-il mécontent de la Hollande quand il écrivait ainsi, et probablement mon républicain qui le réfute est content de sa petite ville démocratique, quant à présent .
Il est difficile de peser dans une balance bien juste les iniquités de la république d'Athènes, et celles de la cour de Macédoine. Nous reprochons encore aujourd'hui aux Athéniens le bannissement de Cimon, d'Aristide, de Thémistocle, d'Alcibiade, les jugements à mort portés contre Phocion et contre Socrate, jugements qui ressemblent à quelque-uns de nos tribunaux absurdes et cruels.
Enfin, ce qu'on ne pardonne point aux Athéniens, c'est la mort de leurs six généraux victorieux, condamnés pour n'avoir pas eu le temps d'enterrer leurs morts après la victoire, et pour en avoir été empêchés par une tempête. Cet arrêt est à la fois si ridicule et si barbare, il porte un tel caractère de superstition et d'ingratitude, que ceux de l'Inquisition, ceux qui furent rendus contre Urbain Grandier, et contre la maréchale d'Ancre, contre Morin, contre tant de sorciers, etc. ne sont pas des inepties plus atroces.
On a beau dire pour excuser les Athéniens, qu'ils croyaient d'après Homère, que les âmes des morts étaient toujours errantes, à moins qu'elles n'eussent reçu les honneurs de la sépulture ou du bûcher. Une sottise n'excuse point une barbarie.
Le grand mal que les âmes de quelques Grecs se fussent promenées une semaine ou deux au bord de la mer! Le mal est de livrer des vivants aux bourreaux, et des vivants qui vous ont gagné une bataille, des vivants que vous deviez remercier à genoux.
Voilà donc les Athéniens convaincus d'avoir été les plus sots et les plus barbares juges de la terre.
Mail il faut mettre à présent dans la balance les crimes de la cour de Macédoine; on verra que cette cour l'emporte prodigieusement sur Athènes en fait de tyrannie et de scélératesse.
Il n'y a d'ordinaire nulle comparaison à faire entre les crimes des grands qui sont toujours ambitieux, et les crimes du peuple qui ne veut jamais, et qui ne peut vouloir que la liberté et l'égalité. Ces deux sentiments liberté et égalité , ne conduisent point droit à la calomnie, à la rapine, à l'assassinat, à l'empoisonnement, à la dévastation des terres de ses voisins, etc.; mais la grandeur ambitieuse, et la rage du pouvoir précipitent dans tous ces crimes en tout temps et en tous lieux.
On ne voit dans cette Macédoine, dont Bayle oppose la vertu à celle d'Athènes, qu'un tissu de crimes épouvantables, pendant deux cents années de suite.
C'est Ptolomée oncle d'Alexandre le Grand, qui assassine son frère Alexandre, pour usurper le royaume.
C'est Philippe son frère, qui passe sa vie à tromper et à violer, et qui finit par être poignardé par Pausanias.
Olimpias fait jeter la reine Cléopâtre et son fils dans une cuve d'airain brûlante. Elle assassine Aridée.
Antigone assassine Eumènes.
Antigone Gonathas son fils empoisonne le gouverneur de la citadelle de Corinthe; épouse sa veuve, la chasse, et s'empare de la citadelle.
Philippe son petit-fils empoisonne Démétrius, et souille toute la Macédoine de meurtres.
Persée tue sa femme de sa propre main, et empoisonne son frère.
Ces perifidies et ces barbaries sont fameuses dans l'histoire.
Ainsi donc pendant deux siècles la fureur du despotisme fait de la Macédoine le théâtre de tous les crimes; et dans le même espace de temps vous ne voyez le gouvernement populaire d'Athènes souillé que de cinq ou six iniquités judiciaires, de cinq ou six jugements atroces, dont le peuple s'est toujours repenti, et dont il a fait amende honorable. Il demanda pardon à Socrate après sa mort, et lui érigea le petit temple du Socrateion . Il demanda pardon à Phocion, et lui éleva une statue. Il demanda pardon aux six généraux condamnés avec tant de ridicule, et si indignement exécutés. Ils mirent aux fers le principal accusateur, qui n'échappa qu'à peine à la vengeance publique. Le peuple athénien était donc naturellement aussi bon que léger. Dans quel Etat despotique a-t-on jamais pleuré ainsi l'injustice de ses arrêts précipités?
Bayle a donc tort cette fois; mon républicain a donc raison. Le gouvernement populaire est donc par lui-même moins inique, moins abominable que le pouvoir tyrannique.
Le grand vice de la démocratie n'est certainement pas la tyrannie et la cruauté; il y eut des républicains montagnards, sauvages et féroces; mais ce n'est pas l'esprit républicain qui les fit tels, c'est la nature. L'Amérique septentrionale était toute en républiques. C'étaient des ours.
Le véritable vice d'une république civilisée est dans la fable turque du dragon à plusieurs têtes, et du dragon à plusieurs queues. La multitude des têtes se nuit, et la multitude des queues obéit à une seule tête qui veut tout dévorer.
La démocrati ne semble convenir qu'à un très petit pays, encore faut-il qu'il soit heureusement situé. Tout petit qu'il sera il fera beaucoup de fautes, parce qu'il sera composé d'hommes. La discorde y régnera comme dans un couvent de moines; mais il n'y aura ni St Barthélemi, ni massacres d'Irlande, ni vêpres siciliennes, ni Inquisition, ni condamnation aux galères pour avoir pris de l'eau dans la mer sans payer, à moins qu'on ne suppose cette république composée de diables dans un coin de l'enfer.
Après avoir pris le parti de mon Suisse contre l'ambidextre Bayle, j'ajouterai
Que les Athéniens furent guerriers comme les Parisiens l'ont été sous Louis XIV.
Qu'ils ont réussi dans tous les arts qui demandent le génie et la main, comme les Florentins du temps de Médicis.
Qu'ils ont été les maîtres des Romains dans les sciences et dans l'éloquence, du temps même de Cicéron.
Que ce petit peuple qui avait à peine un territoire, et qui n'est aujourd'hui qu'une troupe d'esclaves ignorants, cent fois moins nombreux que les Juifs, et ayant perdu jusqu'à son nom, l'emporte pourtant sur l'empire romain par son antique réputation qui triomphe des siècles et de l'esclavage.
L'Europe a vu une république dix fois plus petite encore qu'Athènes, attirer pendant cent cinquante ans les regards de l'Europe, et son nom placé à côté du nom de Rome, dans le temps que Rome commandait encore aux rois; qu'elle condamnait un Henri souverain de la France, et qu'elle absolvait et fouettait un autre Henri le premier homme de son siècle, dans le temps même que Venise conservait son ancienne splendeur, et que la nouvelle république des septs Provinces-Unies étonnait l'Europe et les Indes par son établissement et par son commerce.
Cette fourmillière imperceptible ne put être écrasée par le roi démon du Midi et dominateur des deux mondes, ni par les intrigues du Vatican qui faisaient mouvoir les ressorts de la moitié de l'Europe. Elle résista par la parole et par les armes; et à l'aide d'un Picard qui écrivait, et d'un petit nombre de Suisses qui combattit, elle s'affermit, elle triompha; elle put dire, Rome et moi . Elle tint tous les esprits partagés entre les riches pontifes successeurs des Scipions, Romanos rerum dominos , et les pauvres habitants d'un coin de terre longtemps ignoré dans le pays de la pauvreté et des goîtres.
Il s'agissait alors de savoir comment l'Europe penserait sur des questions que personne n'entendait. C'était la guerre de l'esprit humain. On eut des Calvin, des Bèze, des Turrettins pour ses Démosthènes, ses Platons et ses Aristotes.
L'absurdité de la plupart des questions de controverse qui tenaient l'Europe attentive ayant été enfin reconnue, la petite république se tourna vers ce qui paraît solide, l'acquisition des richesses. Le système de Lass plus chimérique et non moins funeste que ceux des supralapsaires et des infralapsaires, engagea dans l'arithmétique ceux qui ne pouvaient plus se faire un nom en théo-morianique. Ils devinrent riches, et ne furent plus rien.
On croit qu'il n'y a aujourd'hui de républiques qu'en Europe. Ou je me trompe, ou je l'ai dit aussi quelque part; mais c'eût été une très grande inadvertance. Les Espagnols trouvèrent en Amérique la république de Tlascala très bien établie. Tout ce qui n'a pas été subjugué dans cette partie du monde est encore république. Il n'y avait dans tout ce continent que deux royaumes lorsqu'il fut découvert; et cela pourrait bien prouver que le gouvernement républicain est le plus naturel. Il faut s'être bien raffiné, et avoir passé par bien des épreuves pour se soumettre au gouvernement d'un seul.
En Afrique les Hottentots, les Cafres et plusieurs peuplades de nègres sont des démocraties. On prétend que les pays où l'on vend le plus de nègres sont gouvernés par des rois. Tripoli, Tunis, Alger sont des républiques de soldats et de pirates. Il y en a aujourd'hui de pareilles dans l'Inde: les Marates, plusieurs hordes de Patanes, les Seiks n'ont point de rois; ils élisent des chefs quand ils vont piller.
Telles sont encore plusieurs sociétés de Tartares. L'empire turc même a été très longtemps une république de janissaires qui étranglaient souvent leur sultan, quand leur sultan ne les faisait pas décimer.
On demande tous les jours si un gouvernement républicain est préférable à celui d'un roi? La dispute finit toujours par convenir qu'il est fort difficile de gouverner les hommes. Les Juifs eurent pour maître Dieu même; voyez ce qui leur en est arrivé: ils ont été presque toujours battus et esclaves; et aujourd'hui ne trouvez-vous pas qu'ils font une belle figure?
DÉMONIAQUES, [p. 329] ↩
POSSEDÉS DU DÉMON, ENERGUMÈNES, EXORCISES, ou plutôt , MALADES DE LA MATRICE, DES PALES COULEURS, HYPOCONDRIAQUES, EPILEPTIQUES, CATALEPTIQUES, GUÉRIS PAR LES ÉMOLLIENS DE MR. POMME GRAND EXORCISTE.
Les vaporeux, les épileptiques, les femmes travaillées de l'utérus, passèrent toujours pour être les victimes des esprits malins, des démons malfaisants, des vengeances des dieux. Nous avons vu que ce mal s'appelait le mal sacré , et que les prêtres de l'antiquité s'emparèrent partout de ces maladies, attendu que les médecins étaient de grands ignorants.
Quand les symptômes étaient fort compliqués, c'est qu'on avait plusieurs démons dans le corps; un démon de fureur, un de luxure, un de contraction, un de roideur, un d'éblouissement, un de surdité ; et l'exorciseur avait à coup sûr un démon d' absurdité joint à un de friponnerie.
Nous avons vu que les Juifs chassaient les diables du corps des possédés avec la racine barath et des paroles, que notre Sauveur les chassait par une vertu divine, qu'il communiqua cette vertu à ses apôtres, mais que cette vertu est aujourd'hui fort affaiblie.
On a voulu renouveler depuis peu l'histoire de St Paulin. Ce saint vit à la voûte d'une église un pauvre démoniaque qui marchait sous cette voûte ou sur cette voûte, la tête en bas et les pieds en haut, à peu près comme une mouche. St Paulin vit bien que cet homme était possédé; il envoya vite chercher à quelques lieues de là des reliques de St Félix de Nole: on les appliqua au patient comme des vessicatoires. Le démon qui soutenait cet homme contre la voûte s'enfuit aussitôt, et le démoniaque tomba sur le pavé.
Nous pouvons douter de cette histoire en conservant le plus profond respect pour les vrais miracles; et il nous sera permis de dire que ce n'est pas ainsi que nous guérissons aujourd'hui les démoniaques. Nous les saignons, nous les baignons, nous les purgeons doucement, nous leur donnons des émollients; voilà comme M. Pomme les traite; et il a opéré plus de cures que les prêtres d'Isis et de Diane ou autres, n'ont jamais fait de miracles.
Quand aux démoniaques qui se disent possédés pour gagner de l'argent, au lieu de les baigner on les fouette.
Il arrivait souvent que des épileptiques ayant les fibres et les muscles desséchés, pesaient moins qu'un pareil volume d'eau, et surnageaient quand on les mettait dans le bain. On criait miracle; on disait, C'est un possédé ou un sorcier; on allait chercher de l'eau bénite ou un bourreau. C'était une preuve indubitable, ou que le démon s'était rendu maître du corps de la personne surnageante, ou qu'elle s'était donnée à lui. Dans le premier cas elle était exorcisée; dans le second elle était brûlée.
C'est ainsi que nous avons raisonné et agi pendant quinze ou seize cents ans; et nous avons osé nous moquer des Cafres! c'est une exclamation qui peut souvent échapper.
En 1603, dans une petite ville de la Franche-Comté, une femme de qualité faisait lire les vies des saints à sa belle-fille devant ses parents; cette jeune personne un peu trop instruite, mais ne sachant pas l'ortographe, substitua le mot d' histoires à celui de vies . Sa marâtre qui la haïssait, lui dit aigrement, Pourquoi ne lisez-vous pas comme il y a ? la petite fille rougit, trembla, n'osa répondre; elle ne voulut pas déceler celle de ses compagnes qui lui avait appris le mot propre mal orthographié, qu'elle avait eu la pudeur de ne pas prononcer. Un moine confesseur de la maison prétendit que c'était le diable qui lui avait enseigné ce mot. La fille aima mieux se taire que se justifier: son silence fut regardé comme un aveu. L'Inquisition la convainquit d'avoir fait un pacte avec le diable. Elle fut condamnée à être brûlée, parce qu'elle avait beaucoup de bien de sa mère; et que la confiscation appartenait de droit aux inquisiteurs: elle fut la cent millième victime de la doctrine des démoniaques, des possédés, des exorcismes, et des véritables diables qui ont régné sur la terre.
DE ST. DENIS L'AREOPAGITE, [p. 333] ↩
ET DE LA FAMEUSE ÉCLIPSE.
L'auteur de l'article Apocryphe a négligé une centaine d'ouvrages reconnus pour tels, et qui étant entièrement oubliés, semblaient ne pas mériter d'entrer dans sa liste. Nous avons cru devoir ne pas omettre St Denis surnommé l' aréopagite , qu'on a prétendu longtemps avoir été disciple de St Paul et d'un Hiérothée compagnon de St Paul, qu'on n'a jamais connu. Il fut, dit-on, sacré évêque d'Athènes par St Paul lui-même. Il est dit dans sa Vie, qu'il alla rendre une visite dans Jérusalem à la Ste Vierge, et qu'il la trouva si belle et si majestueuse, qu'il fut tenté de l'adorer.
Après avoir longtemps gouverné l'Eglise d'Athènes, il alla conférer avec St Jean l'évangéliste à Ephèse, ensuite à Rome avec le pape Clément; de là il alla exercer son apostolat en France; et sachant , dit l'histoire, que Paris était une ville riche, peuplée, abondante, et comme la capitale des autres, il vint y planter une citadelle pour battre l'enfer et l'infidélité en ruine .
On le regarda très longtemps comme le premier évêque de Paris. Harduinus, l'un de ses historiens, ajoute qu'à Paris on l'exposa aux bêtes; mais qu'ayant fait le signe de la croix sur elles, les bêtes se prosternèrent à ses pieds. Les païens parisiens le jetèrent alors dans un four chaud; il en sortit frais et en parfaite santé. On le crucifia; quand il fut crucifié il se mit à prêcher du haut de la potence.
On le ramena en prison avec Rustique et Eleuthère ses compagnons. Il y dit la messe, St Rustique servit de diacre, et Eleuthère de sous-diacre. Enfin on les mena tous trois à Montmartre, et on leur trancha la tête, après quoi ils ne dirent plus de messe.
Mais, selon Harduinus, il arriva un bien plus grand miracle; le corps de St Denis se leva debout, prit sa tête entre ses mains, les anges l'accompagnaient en chantant: Gloria tibi Domine, alleluia . Il porta sa tête jusqu'à l'endroit où on lui bâtit une église, qui est la fameuse église de St Denis.
Métaphraste, Harduinus, Hincmar évêque de Rheims, disent qu'il fut martyrisé à l'âge de quatre-vingt-onze ans; mais Baronius tom. II, pag. 37. le cardinal Baronius prouve qu'il en avait cent dix, en quoi il est suivi par Ribadeneira savant auteur de la Fleur des saints . C'est sur quoi nous ne prenons point de parti.
On lui attribue dix-sept ouvrages, dont malheureusement nous avons perdu six. Les onze qui nous restent, ont été traduits du grec par Jean Scot, Hugues de St Victor, Albert dit le Grand, et plusieurs autres savants illustres.
Il est vrai que depuis que la saine critique s'est introduite dans le monde, on est convenu que tous les livres qu'on attribue à Voyez Cave. Denis furent écrits par un imposteur l'an 362 de notre ère, et il ne reste plus sur cela de difficultés.
DE LA GRANDE ÉCLIPSE OBSERVÉE PAR DENIS.
Ce qui a surtout excité une grande querelle entre les savants, c'est ce que rapporte un des auteurs inconnus de la Vie de St Denis. On a prétendu que ce premier évêque de Paris étant en Egypte dans la ville de Diospolis ou No-Ammon, à l'âge de vingt-cinq ans, et n'étant pas encore chrétien, il y fut témoin avec un de ses amis de la fameuse éclipse du soleil arrivée dans la pleine lune à la mort de Jésus-Christ, et qu'il s'écria en grec, Ou Dieu pâtit, ou il s'afflige avec le patient .
Ces paroles ont été diversement rapportées par divers auteurs; mais dès le temps d'Eusèbe de Césarée on prétendait que deux historiens, l'un nommé Phlégon et l'autre Thallus, avaient fait mention de cette éclipse miraculeuse. Eusèbe de Césarée cite Phlégon, mais nous n'avons plus ses ouvrages. Il disait, à ce qu'on prétend, que cette éclipse arriva la quatrième année de la deux-centième olympiade, qui serait la dix-huitième année de Tibère. Il y a sur cette anecdote plusieurs leçons, et on peut se défier de toutes, d'autant plus qu'il reste à savoir si on comptait encore par olympiades du temps de Phlégon; ce qui est fort douteux.
Ce calcul important intéressa tous les astronomes; Hodgson, Wiston, Gale, Maurice et le fameux Halley ont démontré qu'il n'y avait point eu d'éclipse de soleil cette année; mais que dans la première année de la deux-cent-deuxième olympiade, le 24 novembre, il en arriva une qui obscurcit le soleil pendant deux minutes à une heure et un quart à Jérusalem.
On a été encore plus loin; un jésuite nommé Greslon prétendit que les Chinois avaient conservé dans leurs annales la mémoire d'une éclipse arrivée a peu près dans ce temps-là, contre l'ordre de la nature. On pria les mathématiciens d'Europe d'en faire le calcul. Il était assez plaisant de prier des astronomes de calculer une éclipse qui n'était pas naturelle. Enfin, il fut avéré que les annales de la Chine ne parlent en aucune manière de cette éclipse.
Il résulte de l'histoire de St Denis l'Aréopagite, et du passage de Phlégon, et de la lettre du jésuite Greslon, que les hommes aiment fort à en imposer. Mais cette prodigieuse multitude de mensonges, loin de faire du tort à la religion chrétienne, ne sert au contraire qu'à en prouver la divinité, puisqu'elle s'est affermie de jour en jour malgré eux.
DÉNOMBREMENT. [p. 336] ↩
Les plus anciens dénombrements que l'histoire nous ait laissés, sont ceux des Israëlites. Ceux-là sont indubitables puisqu'ils sont tirés des livres juifs.
On ne croit pas qu'il faille compter pour un dénombrement la fuite des Israëlites au nombre de six cent mille hommes de pied, Exode ch. XII, v. 37 et 38. parce que le texte ne les spécifie pas tribu par tribu; il ajoute qu'une troupe innombrable de gens ramassés se joignit à eux; ce n'est qu'un récit.
Le premier dénombrement circonstancié est celui qu'on voit dans le livre du Vaiedaber, et que nous nommons les Nombres . Nomb. ch. I. Par le recensement que Moïse et Aaron firent du peuple dans le désert, on trouva en comptant toutes les tribus, excepté celle de Lévi, six cent trois mille cinq cent cinquante hommes en état de porter les armes; et si vous y joignez la tribu de Lévi supposée égale en nombre aux autres tribus, le fort portant le faible, vous aurez six cent cinquante-trois mille neuf cent trente-cinq hommes, auxquels il faut ajouter un nombre égal de vieillards, de femmes et d'enfants, ce qui composera deux millions six cent quinze mille sept cent quarante-deux personnes parties de l'Egypte.
Liv. II des Rois, ch. XXIV. Lorsque David, à l'exemple de Moïse, ordonna le recensement de tout le peuple, il se trouva huit cent mille guerriers des tribus d'Israël, et cinq cent mille de celle de Juda, selon le livre des Rois; Liv. I des Paralip. ch. XXI, v. 5. mais, selon les Paralipomènes, on compta onze cent mille guerriers dans Israël, et moins de cinq cent mille dans Juda.
Le livre des Rois exclut formellement Lévi et Benjamin; et les Paralipomènes ne les comptent pas. Si donc on joint ces deux tribus aux autres, proportion gardée, le total des guerriers sera de dix-neuf cent vingt mille. C'est beaucoup pour le petit pays de la Judée, dont la moitié est composée de rochers affreux et de cavernes. Mais c'était un miracle.
Ce n'est pas à nous d'entrer dans les raisons pour lesquelles le souverain arbitre des rois et des peuples punit David de cette opération qu'il avait commandée lui-même à Moïse. Il nous appartient encore moins de rechercher pourquoi Dieu étant irrité contre David, c'est le peuple qui fut puni pour avoir été dénombré. Le prophète Gad ordonna au roi de la part de Dieu de choisir la guerre, la famine ou la peste; David accepta la peste, et il en mourut soixante et dix mille Juifs en trois jours.
St Ambroise dans son livre de la Pénitence , et St Augustin dans son livre contre Fauste, reconnaissent que l'orgueil et l'ambition avaient déterminé David à faire cette revue. Leur opinion est d'un grand poids, et nous ne pouvons que nous soumettre à leur décision, en éteignant toutes les lumières trompeuses de notre esprit.
Liv. I d'Esdras ch. II, v. 64. Liv. II d'Esdras qui est l'hist. de Néhémie ch. VII, v. 66. L'Ecriture rapporte un nouveau dénombrement du temps d'Esdras, lorsque la nation juive revint de la captivité. Toute cette multitude , disent également Esdras et Néhémie, étant comme un seul homme, se montait à quarante-deux mille trois cent soixante personnes . Ils les nomment toutes par familles, et ils comptent le nombre des Juifs de chaque famille et le nombre des prêtres. Mais non seulement il y a dans ces deux auteurs des différences entre les nombres et les noms des familles; on voit encore une erreur de calcul dans l'un et dans l'autre. Par le calcul d'Esdras, au lieu de quarante-deux mille hommes, on n'en trouve, après avoir tout additionné, que vingt-neuf mille huit cent dix-huit; et par celui de Néhémie on en trouve trente et un mille quatre-vingt neuf.
Il faut sur cette méprise apparente, consulter les commentateurs, et surtout Dom Calmet, qui ajoutant à un de ces deux comptes ce qui manque à l'autre, et ajoutant encore ce qui leur manque à tous deux, résout toute la difficulté. Il manque à la supputation d'Esdras et de Néhémie, rapprochées par Calmet, dix mille sept cent soixante et dix-sept personnes; mais on les retrouve dans les familles qui n'ont pu donner leur généalogie: d'ailleurs s'il y avait quelque faute de copiste, elle ne pourrait nuire à la véracité du texte divinement inspiré.
Il est à croire que les grands rois voisins de la Palestine, avaient fait les dénombrements de leurs peuples autant qu'il est possible. Hérodote liv. VII ou Polimnie. Hérodote nous donne le calcul de tous ceux qui suivirent Xerxès, sans y faire entrer son armée navale. Il compte dix-sept cent mille hommes, et il prétend que pour parvenir à cette supputation, on les faisait passer en divisions de dix mille dans une enceinte qui ne pouvait tenir que ce nombre d'hommes très pressés. Cette méthode est bien fautive; car en se pressant un peu moins, il se pouvait aisément que chaque division de dix mille ne fût en effet que de huit à neuf. De plus, cette méthode n'est nullement guerrière; et il eût été beaucoup plus aisé de voir le complet, en faisant marcher les soldats par rangs et par files.
Il faut encore observer combien il était difficile de nourrir dix-sept cent mille hommes dans le pays de la Grèce qu'il allait conquérir. On pourrait bien douter et de ce nombre et de la manière de le compter, et du fouet donné à l'Hellespont, et du sacrifice de mille boeufs fait à Minerve par un roi persan qui ne la connaissait pas, et qui ne vénérait que le soleil comme l'unique symbole de la Divinité.
Le dénombrement des dix-sept cent mille hommes n'est pas d'ailleurs complet, de l'aveu même d'Hérodote, puisque Xerxès mena encore avec lui tous les peuples de la Thrace et de la Macédoine, qu'il força, dit-il, chemin faisant de le suivre, apparemment pour affamer plus vite son armée. On doit donc faire ici ce que les hommes sages font à la lecture de toutes les histoires anciennes, et même modernes, suspendre son jugement et douter beaucoup.
Le premier dénombrement que nous ayons d'une nation profane, est celui que fit Servius Tullius sixième roi de Rome. Il se trouva, dit Tite-Live, quatre-vingt mille combattants, tous citoyens romains. Cela suppose trois cent quarante mille citoyens au moins, tant vieillards que femmes et enfants; à quoi il faut ajouter au moins vingt mille domestiques tant esclaves que libres.
Or on peut raisonnablement douter que le petit Etat romain contînt cette multitude. Romulus n'avait régné (supposé qu'on puisse l'appeller roi ) que sur environ trois mille bandits rassemblés dans un petit bourg entre des montagnes. Ce bourg était le plus mauvais terrain de l'Italie. Tout son pays n'avait pas trois mille pas de circuit. Servius était le sixième chef ou roi de cette peuplade naissante. La règle de Newton, qui est indubitable pour les royaumes électifs, donne à chaque roi vingt et un ans de règne, et contredit par là tous les anciens historiens qui n'ont jamais observé l'ordre des temps, et qui n'ont donné aucune date précise. Les cinq rois de Rome doivent avoir régné environ cent ans.
Il n'est certainement pas dans l'ordre de la nature qu'un terrain ingrat qui n'avait pas cinq lieues en long et trois en large, et qui devait avoir perdu beaucoup d'habitants dans ses petites guerres presque continuelles, pût être peuplé de trois cent quarante mille âmes. Il n'y en a pas la moitié dans le même territoire où Rome aujourd'hui est la métropole du monde chrétien, où l'affluence des étrangers et des ambassadeurs de tant de nations doit servir à peupler la ville, où l'or coule de la Pologne, de la Hongrie, de la moitié de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, par mille canaux dans la bourse de la daterie, et doit faciliter encore la population, si d'autres causes ne l'interceptent.
L'histoire de Rome ne fut écrite que plus de cinq cents ans après sa fondation. Il ne serait point du tout surprenant que les historiens eussent donné libéralement quatre-vingt mille guerriers à Servius Tullius au lieu de huit mille, par un faux zèle pour la patrie. Le zèle eût été plus grand et plus vrai, s'ils avaient avoué les faibles commencements de leur république. Il est plus beau de s'être élevé d'une si petite origine à tant de grandeur, que d'avoir eu le double des soldats d'Alexandre pour conquérir environ quinze lieues de pays en quatre cents années.
Le cens ne s'est jamais fait que des citoyens romains. On prétend que sous Auguste il était de quatre millions soixante-trois mille l'an 29 avant notre ère vulgaire, selon Tillemont qui est assez exact; mais il cite Dion Cassius qui ne l'est guère.
Laurent Echard n'admet qu'un dénombrement de quatre millions cent trente-sept mille hommes l'an 14 de notre ère. Le même Echard parle d'un dénombrement général de l'empire pour la première année de la même ère; mais il ne cite aucun auteur romain, et ne spécifie aucun calcul du nombre des citoyens. Tillemont ne parle en aucune manière de ce dénombrement.
On a cité Tacite et Suétone; mais c'est très mal à propos. Le cens dont parle Suétone n'est point un dénombrement de citoyens, ce n'est qu'une liste de ceux auxquels le public fournissait du blé.
Tacite ne parle au livre II que d'un cens établi dans les seules Gaules pour y lever plus de tributs par tête. Jamais Auguste ne fit un dénombrement des autres sujets de son empire, parce que l'on ne payait point ailleurs la capitation qu'il voulut établir en Gaule.
Annales livre I. Tacite dit qu' Auguste avait un mémoire écrit de sa main, qui contenait les revenus de l'empire, les flottes, les royaumes tributaires . Il ne parle point d'un dénombrement.
Liv. XLIII. Dion Cassius spécifie un cens, mais il n'articule aucun nombre.
Joseph, liv. XVIII, ch. I. Joseph, dans ses Antiquités , dit que l'an 759 de Rome (temps qui répond à la onzième année de notre ère) Cirénius établi alors gouverneur de Syrie, se fit donner une liste de tous les biens des Juifs, ce qui causa une révolte. Cela n'a aucun rapport à un dénombrement général, et prouve seulement que ce Cirénius ne fut gouverneur de la Judée (qui était alors une petite province de Syrie) que dix ans après la naissance de notre Sauveur, et non pas au temps de sa naissance.
Voilà, ce me semble, ce qu'on peut recueillir de principal dans les profanes touchant les dénombrements attribués à Auguste. Si nous nous en rapportions à eux, Jésus-Christ serait né sous le gouvernement de Varus et non sous celui de Cirénius; il n'y aurait point eu de dénombrement universel. Mais St Luc dont l'autorité doit prévaloir sur Joseph, Suétone, Tacite, Dion Cassius et tous les écrivains de Rome, St Luc affirme positivement qu'il y eut un dénombrement universel de toute la terre, et que Cirénius était gouverneur de Judée. Il faut donc s'en rapporter uniquement à lui, sans même chercher à le concilier avec Flavien Joseph, ni avec aucun autre historien.
Au reste, ni le Nouveau Testament, ni l'Ancien ne nous ont été donnés pour éclaircir des points d'histoire, mais pour nous annoncer des vérités salutaires, devant lesquelles tous les événements et toutes les opinions doivent disparaître. C'est toujours ce que nous répondons aux faux calculs, aux contradictions, aux absurdités, aux fautes énormes de géographie, de chronologie, de physique; et même de sens commun, dont les philosophes nous disent sans cesse que la sainte Ecriture est remplie: nous ne cessons de leur dire, qu'il n'est point ici question de raison, mais de foi et de piété.
DÉNOMBREMENT.
Section seconde.
A l'égard du dénombrement des peuples modernes, les rois n'ont point à craindre aujourd'hui qu'un docteur Gad vienne leur proposer, de la part de Dieu, la famine, la guerre ou la peste, pour les punir d'avoir voulu savoir leur compte. Aucun d'eux ne le sait.
On conjecture, on devine, et toujours à quelques millions d'hommes près.
J'ai porté le nombre d'habitants qui composent l'empire de Russie, à vingt-quatre millions, sur les mémoires qui m'ont été envoyés, mais je n'ai point garanti cette évaluation, car je connais très peu de choses que je voulusse garantir.
J'ai cru que l'Allemagne possède autant de monde en comptant les Hongrois. Si je me suis trompé d'un million ou deux, on sait que c'est une bagatelle en pareil cas.
Je demande pardon au roi d'Espagne si je ne lui accorde que sept millions de sujets dans notre continent. C'est bien peu de chose; mais Don Ustaris employé dans le ministère, ne lui en donne pas davantage.
On compte environ neuf à dix millions d'êtres libres dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne.
On balance en France entre seize et vingt millions. C'est une preuve que le docteur Gad n'a rien à reprocher au ministère de France. Quant aux villes capitales, les opinions sont encore partagées. Paris, selon quelques calculateurs, a sept cent mille habitants; et, selon d'autres, cinq cent. Il en est ainsi de Londres, de Constantinople, du grand Caire.
Pour les sujets du pape, ils feront la foule en paradis; mais la foule est médiocre sur terre. Pourquoi cela? C'est qu'ils sont sujets du pape. Caton le censeur aurait-il jamais cru que les Romains en viendraient là? Voyez Population .
DESTIN. [p. 340] ↩
De tous les livres de l'Occident, qui sont parvenus jusqu'à nous, le plus ancien est Homère; c'est là qu'on trouve les moeurs de l'antiquité profane, des héros grossiers, des dieux grossiers, faits à l'image de l'homme. Mais c'est là que parmi les rêveries et les inconséquences on trouve aussi les semences de la philosophie, et surtout l'idée du destin qui est maître des dieux, comme les dieux sont les maîtres du monde.
Quand le magnanime Hector veut absolument combattre le magnanime Achille, et que pour cet effet il se met à fuir de toutes ses forces et fait trois fois le tour de la ville avant de combattre, afin d'avoir plus de vigueur; quand Homère compare Achille aux pieds légers qui le poursuit à un homme qui dort; quand madame Dacier s'extasie d'admiration sur l'art et le grand sens de ce passage; alors Jupiter veut sauver le grand Hector qui lui a fait tant de sacrifices: et il consulte les destinées; il pèse dans une Iliade liv. XXII. balance les destins d'Hector et d'Achille; il trouve que le Troyen doit absolument être tué par le Grec; il ne peut s'y opposer; et dès ce moment Apollon, le génie gardien d'Hector, est obligé de l'abandonner. Ce n'est pas qu'Homère ne prodigue souvent, et surtout en ce même endroit, des idées toutes contraires, suivant le privilège de l'antiquité; mais enfin, il est le premier chez qui on trouve la notion du destin. Elle était donc très en vogue de son temps.
Les pharisiens, chez le petit peuple juif, n'adoptèrent le destin que plusieurs siècles après. Car ces pharisiens eux-mêmes, qui furent les premiers lettrés d'entre les Juifs, étaient très nouveaux. Ils mêlèrent dans Alexandrie une partie des dogmes des stoïciens, aux anciennes idées juives. St Jérôme prétend même que leur secte n'est pas de beaucoup antérieure à notre ère vulgaire.
Les philosophes n'eurent jamais besoin ni d'Homère, ni des pharisiens, pour se persuader que tout se fait par des lois immuables, que tout est arrangé, que tout est un effet nécessaire. Voici comment ils raisonnaient.
Ou le monde subsiste par sa propre nature, par ses lois physiques, ou un Etre suprême l'a formé selon ses lois suprêmes; dans l'un et l'autre cas ces lois sont immuables; dans l'un et l'autre cas, tout est nécessaire; les corps graves tendent vers le centre de la terre, sans pouvoir tendre à se reposer en l'air. Les poiriers ne peuvent jamais porter d'ananas. L'instinct d'un épagneul ne peut être l'instinct d'une autruche; tout est arrangé, engrené et limité.
L'homme ne peut avoir qu'un certain nombre de dents, de cheveux et d'idées; il vient un temps où il perd nécessairement ses dents, ses cheveux et ses idées.
Il est contradictoire que ce qui fut hier n'ait pas été, que ce qui est aujourd'hui ne soit pas; il est aussi contradictoire que ce qui doit être, puisse ne pas devoir être.
Si tu pouvais déranger la destinée d'une mouche, il n'y aurait nulle raison qui pût t'empêcher de faire le destin de toutes les autres mouches, de tous les autres animaux, de tous les hommes, de toute la nature; tu te trouverais au bout du compte plus puissant que Dieu.
Des imbéciles disent, Mon médecin a tiré ma tante d'une maladie mortelle, il a fait vivre ma tante dix ans de plus qu'elle ne devait vivre; d'autres qui font les capables disent, L'homme prudent fait lui-même son destin.
Nullum numen abest si sit prudentia, sed nos
Te facimus fortuna Deam coeloque locamus.
La fortune n'est rien; c'est en vain qu'on l'adore.
La prudence est le Dieu qu'on doit seul implorer.
Mais souvent le prudent succombe sous sa destinée, loin de la faire; c'est le destin qui fait les prudents.
De profonds politiques assurent que si on avait assassiné Cromwell, Ludlow, Ireton, et une douzaine d'autres parlementaires, huit jours avant qu'on coupât la tête à Charles I er , ce roi aurait pu vivre encore et mourir dans son lit; ils ont raison; ils peuvent ajouter encore que si toute l'Angleterre avait été engloutie dans la mer, ce monarque n'aurait pas péri sur un échafaud auprès de Whitehall la salle blanche : mais les choses étaient arrangées de façon que Charles devait avoir le cou coupé.
Le cardinal d'Ossat était sans doute plus prudent qu'un fou des Petites-Maisons; mais n'est-il pas évident que les organes du sage d'Ossat étaient autrement faits que ceux de cet écervelé? de même que les organes d'un renard sont différents de ceux d'une grue et d'une alouette.
Ton médecin a sauvé ta tante; mais certainement il n'a pas en cela contredit l'ordre de la nature, il l'a suivi. Il est clair que ta tante ne pouvait pas s'empêcher de naître dans une telle ville, qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir dans un tel temps une certaine maladie, que le médecin ne pouvait pas être ailleurs que dans la ville où il était, que ta tante devait l'appeler, qu'il devait lui prescrire les drogues qui l'ont guérie.
Un paysan croit qu'il a grêlé par hasard sur son champ; mais le philosophe sait qu'il n'y a point de hasard, et qu'il était impossible, dans la constitution de ce monde, qu'il ne grêlât pas ce jour-là en cet endroit.
Il y a des gens qui étant effrayés de cette vérité en accordent la moitié, comme des débiteurs qui offrent moitié à leurs créanciers, et demandent répit pour le reste. Il y a, disent-ils, des événements nécessaires, et d'autres qui ne le sont pas. Il serait plaisant qu'une partie de ce monde fût arrangée, et que l'autre ne le fût point; qu'une partie de ce qui arrive dût arriver, et qu'une autre partie de ce qui arrive ne dût pas arriver. Quand on y regarde de près, on voit que la doctrine contraire à celle du destin est absurde; mais il y a beaucoup de gens destinés à raisonner mal, d'autres à ne point raisonner du tout, d'autres à persécuter ceux qui raisonnent.
Quelques-uns vous disent, Ne croyez pas au fatalisme; car alors tout vous paraissant inévitable vous ne travaillerez à rien, vous croupirez dans l'indifférence, vous n'aimerez ni les richesses ni les honneurs, ni les louanges; vous ne voudrez rien acquérir, vous vous croirez sans mérite comme sans pouvoir; aucun talent ne sera cultivé, tout périra par l'apathie.
Ne craignez rien, messieurs, nous aurons toujours des passions et des préjugés, puisque c'est notre destinée d'être soumis aux préjugés et aux passions: nous saurons bien qu'il ne dépend pas plus de nous d'avoir beaucoup de mérite et de grands talents, que d'avoir les cheveux bien plantés et la main belle: nous serons convaincus qu'il ne faut tirer vanité de rien, et cependant nous aurons toujours de la vanité.
J'ai nécessairement la passion d'écrire ceci, et toi tu as la passion de me condamner; nous sommes tous deux également sots, également les jouets de la destinée. Ta nature est de faire du mal, la mienne est d'aimer la vérité, et de la publier malgré toi.
Le hibou qui se nourrit de souris dans sa masure, a dit au rossignol, Cesse de chanter sous tes beaux ombrages, viens dans mon trou, afin que je t'y dévore; et le rossignol a répondu, Je suis né pour chanter ici, et pour me moquer de toi.
Vous me demandez ce que deviendra la liberté? Je ne vous entends pas. Je ne sais ce que c'est que cette liberté dont vous parlez; il y a si longtemps que vous disputez sur sa nature, qu'assurément vous ne la connaissez pas. Si vous voulez, ou plutôt, si vous pouvez examiner paisiblement avec moi ce que c'est, passez à la lettre L.
DÉVOT. [p. 343] ↩
L'Evangile au chretien ne dit en aucun lieu;
Sois dévot: elle dit; sois doux, simple, équitable;
Car d'un dévot souvent au chrétien véritable
La distance est cent fois plus grande, à mon avis,
Que du pôle antarctique au détroit de Davis.
BOILEAU satire XI.
Il est bon de remarquer, dans nos Questions, que Boileau est le seul poète qui ait jamais fait évangile féminin. On ne dit point: la sainte Evangile; mais le saint Evangile. Ces inadvertences échappent aux meilleurs écrivains; il n'y a que des pédants qui en triomphent. Il est aisé de mettre à la place:
L'Evangile au chrétien ne dit en aucun lieu;
Sois dévot; mais il dit: sois doux, simple, équitable.
A l'égard de Davis, il n'y a point de détroit de Davis; mais un détroit de David. Les Anglais mettent un s au singulier, et c'est la source de la méprise. Car au temps de Boileau, personne en France n'apprenait l'anglais, qui est aujourd'hui l'objet de l'étude des gens de lettres. C'est un habitant du mont Krapac qui a inspiré aux Français le goût de cette langue, et qui leur ayant fait connaître la philosophie et la poésie anglaise, a été pour cela persécuté par des Welches.
Venons à présent au mot dévot ; il signifie dévoué ; et dans le sens rigoureux du terme, cette qualification ne devrait appartenir qu'aux moines et aux religieuses qui font des voeux. Mais comme il n'est pas plus parlé de voeux que de dévots dans l'Evangile, ce titre ne doit en effet appartenir à personne. Tout le monde doit être également juste. Un homme qui se dit dévot ressemble à un roturier qui se dit marquis; il s'arroge une qualité qu'il n'a pas. Il croit valoir mieux que son prochain. On pardonne cette sottise à des femmes; leur faiblesse et leur frivolité les rendent excusables; les pauvres créatures passent d'un amant à un directeur avec bonne foi; mais on ne pardonne pas aux fripons qui les dirigent, qui abusent de leur ignorance, qui fondent le trône de leur orgueil sur la crédulité du sexe. Ils se forment un petit sérail mystique, composé de sept ou huit vieilles beautés, subjuguées par le poids de leur désoeuvrement; et presque toujours ces sujettes paient des tributs à leur nouveau maître. Point de jeune femme sans amant: point de vieilles dévotes sans un directeur. Oh! que les Orientaux sont plus sensés que nous! Jamais un pacha n'a dit: nous soupâmes hier avec l'aga des janissaires qui est l'amant de ma soeur, et le vicaire de la mosquée, qui est le directeur de ma femme.
DICTIONNAIRE. [p. 345] ↩
La méthode des dictionnaires inconnue à l'antiquité, est d'une utilité qu'on ne peut contester; et l'Encyclopédie imaginée par MM. d'Alembert et Diderot, achevée par eux et par leurs associés avec tant de succès malgré ses défauts, en est un assez bon témoignage. Ce qu'on y trouve à l'article Dictionnaire doit suffire; il est fait de main de maître.
Je ne veux parler ici que d'une nouvelle espèce de dictionnaires historiques qui renferment des mensonges et des satires par ordre alphabétique; tel est le Dictionnaire historique, littéraire et critique, contenant une idée abrégée de la vie des hommes illustres en tout genre , et imprimé en 1758 en six volumes 8 o sans nom d'auteur.
Les compilateurs de cet ouvrage commencent par déclarer qu'il a été entrepris sur les avis de l'auteur de la Gazette ecclésiastique, écrivain redoutable , disent-ils, dont la flèche déjà comparée à celle de Jonathas, n'est jamais retournée en arrière, et est toujours teinte du sang des morts, du carnage des plus vaillants: A sanguine interfectorum, ab adipe fortium sagitta Jonathae nunquam rediit retrorsum .
On conviendra sans peine que Jonathas fils de Saül, tué à la bataille de Gelboé, a un rapport immédiat avec un convulsionnaire de Paris qui barbouillait les Nouvelles ecclésiastiques dans un grenier en 1758.
L'auteur de cette préface y parle du grand Colbert. On croit d'abord que c'est du ministre d'Etat qui a rendu de si grands services à la France; point du tout, c'est d'un évêque de Montpellier. Il se plaint qu'un autre dictionnaire n'ait pas assez loué le célèbre abbé d'Asfeld, l'illustre Boursier, le fameux Gennes, l'immortel la Borde, et qu'on n'ait pas dit assez d'injures à l'archevêque de Sens Languet et à un nommé Fillot, tous gens connus, à ce qu'il prétend, des colonnes d'Hercule à la mer Glaciale. Il promet qu'il sera vif, fort et piquant par principe de religion; qu'il rendra son visage plus ferme que le visage de ses ennemis, et son front plus dur que leur front, selon la parole d'Ezéchiel .
Il déclare qu'il a mis à contribution tous les journaux et tous les ana, et il finit par espérer que le ciel répandra ses bénédictions sur son travail.
Dans ces espèces de dictionnaires qui ne sont que des ouvrages de parti, on trouve rarement ce qu'on cherche, et souvent ce qu'on ne cherche pas. Au mot Adonis , par exemple, on apprend que Vénus fut amoureuse de lui; mais pas un mot du culte d'Adonis, ou Adonaï chez les Phéniciens; rien sur ces fêtes si antiques et si célèbres, sur les lamentations suivies de réjouissances qui étaient des allégories manifestes, ainsi que les fêtes de Cérès, celles d'Isis et tous les mystères de l'antiquité. Mais en récompense on trouve la religieuse Adkichomia qui traduisit en vers les psaumes de David au seizième siècle, et Adkichomius qui était apparemment son parent et qui fit la Vie de Jésus-Christ en bas-allemand.
On peut bien penser que tous ceux de la faction dont était le rédacteur sont accablés de louanges, et les autres d'injures. L'auteur, ou la petite horde d'auteurs qui ont broché ce vocabulaire d'inepties, dit de Nicolas Boindin procureur général des trésoriers de France, de l'Académie des belles-lettres, qu'il était poète et athée .
Ce magistrat n'a pourtant fait jamais imprimer de vers; et n'a rien écrit sur la métaphysique ni sur la religion.
Il ajoute que Boindin sera mis par la postérité au rang des Vanini, des Spinosa et des Hobbes. Il ignore que Hobbes n'a jamais professé l'athéisme, qu'il a seulement soumis la religion à la puissance souveraine, qu'il appelle le Léviathan . Il ignore que Vanini ne fut point athée. Que le mot d' athée même ne se trouve pas dans l'arrêt qui le condamna; qu'il fut accusé d'impiété pour s'être élevé fortement contre la philosophie d'Aristote, et pour avoir disputé aigrement et sans retenue contre un conseiller au parlement de Toulouse nommé Francon ou Franconi, qui eut le crédit de le faire brûler, parce qu'on fait brûler qui on veut, témoin la Pucelle d'Orléans, Michel Servet, le conseiller Du Bourg, la maréchale d'Ancre, Urbain Grandier, Morin et les livres des jansénistes. Voyez d'ailleurs l'apologie de Vanini par le savant La Crose; et à l'article Athéisme .
Le vocabuliste traite Boindin de scélérat ; ses parents voulaient attaquer en justice et faire punir un auteur qui mérite si bien le nom qu'il ose donner à un magistrat, à un savant estimable. Mais le calomniateur se cachait sous un nom supposé comme la plupart des libellistes.
Immédiatement après avoir parlé si indignement d'un homme respectable pour lui, il le regarde comme un témoin irréfragable, parce que Boindin dont la mauvaise humeur était connue, a laissé un mémoire très mal fait et très téméraire, dans lequel il accuse La Motte le plus honnête homme du monde, un géomètre et un marchand quincaillier d'avoir fait les vers infâmes qui firent condamner Jean-Baptiste Rousseau. Enfin, dans la liste des ouvrages de Boindin, il omet exprès ses excellentes dissertations imprimées dans le Recueil de l'Académie des belles-lettres , dont il était un membre très distingué.
L'article Fontenelle n'est qu'une satire de cet ingénieux et savant académicien dont l'Europe littéraire estime la science et les talents. L'auteur a l'impudence de dire que son Histoire des oracles ne fait pas honneur à sa religion . Si Vandale auteur de l' Histoire des oracles , et son rédacteur Fontenelle avaient vécu du temps des Grecs et de la république romaine, on pourrait dire avec raison, qu'ils étaient plutôt de bons philosophes que de bons païens; mais, en bonne foi, quel tort font-ils à la religion chrétienne en faisant voir que les prêtres païens étaient des fripons? Ne voit-on pas que les auteurs de ce libelle intitulé Dictionnaire , plaident leur propre cause? Jam proximus ardet Ucalegon . Mais serait-ce insulter à la religion chrétienne que de prouver la friponnerie des convulsionnaires? Le gouvernement a fait plus; il les a punis sans être accusé d'irréligion.
Le libelliste ajoute, qu'il soupçonne Fontenelle de n'avoir rempli ses devoirs de chrétien que par mépris pour le christianisme même. C'est une étrange démence dans ces fanatiques de crier toujours qu'un philosophe ne peut être chrétien; il faudrait les excommunier et les punir pour cela seul: car c'est assurément vouloir détruire le christianisme, que d'assurer qu'il est impossible de bien raisonner et de croire une religion si raisonnable et si sainte.
Des-Ivetaux précepteur de Louis XIII, est accusé d'avoir vécu et d'être mort sans religion. Il semble que les compilateurs n'en aient aucune, ou du moins qu'en violant tous les préceptes de la véritable, ils cherchent partout des complices.
Le galant homme auteur de ces articles, se complaît à rapporter tous les mauvais vers contre l'Académie française, et des anecdotes aussi ridicules que fausses. C'est apparemment encore par zèle de religion.
Je ne dois pas perdre une occasion de réfuter le conte absurde qui a tant couru, et qu'il répète fort mal à propos à l'article de l'abbé Gédouin , sur lequel il se fait un plaisir de tomber, parce qu'il avait été jésuite dans sa jeunesse; faiblesse passagère dont je l'ai vu se repentir toute sa vie.
Le dévot et scandaleux rédacteur du Dictionnaire, prétend que l'abbé Gédouin coucha avec la célèbre Ninon l'Enclos, le jour même qu'elle eut quatre-vingts ans accomplis. Ce n'était pas assurément à un prêtre de conter cette aventure dans un prétendu Dictionnaire des hommes illustres . Une telle sottise n'est nullement vraisemblable; et je puis certifier que rien n'est plus faux. On mettait autrefois cette anecdote sur le compte de l'abbé de Châteauneuf, qui n'était pas difficile en amour, et qui, disait-on, avait eu les faveurs de Ninon âgée de soixante ans, ou plutôt lui avait donné les siennes. J'ai beaucoup vu dans mon enfance l'abbé Gédouin, l'abbé de Châteauneuf et Mlle l'Enclos; je puis assurer qu'à l'âge de quatre-vingts ans son visage portait les marques les plus hideuses de la vieillesse; que son corps en avait toutes les infirmités, et qu'elle avait dans l'esprit les maximes d'un philosophe austère.
A l'article Deshoulières , le rédacteur prétend que c'est elle qui est désignée sous le nom de précieuse dans la satire de Boileau contre les femmes. Jamais personne n'eut moins ce défaut que madame Deshoulières; elle passa toujours pour la femme du meilleur commerce; elle était très simple et très agréable dans la conversation.
L'article La Motte est plein d'injures atroces contre cet académicien; homme très aimable, poète-philosophe qui a fait des ouvrages estimables dans tous les genres. Enfin l'auteur, pour vendre son livre en six volumes, en a fait un libelle diffamatoire.
Son héros est Carré de Montgeron qui présenta au roi un recueil des miracles opérés par les convulsionnaires dans le cimetière de St Médard; et son héros était un sot qui est mort fou.
L'intérêt du public, de la littérature et de la raison, exigeait qu'on livrât à l'indignation publique ces libellistes à qui l'avidité d'un gain sordide pourrait susciter des imitateurs; d'autant plus que rien n'est si aisé que de copier des livres par ordre alphabétique, et d'y ajouter des platitudes, des calomnies et des injures.
EXTRAIT DES RÉFLEXIONS D'UN ACADÉMICIEN, SUR LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE.
J'aurais voulu rapporter l'étymologie naturelle et incontestable de chaque mot, comparer l'emploi, les diverses significations, l'énergie de ce mot avec l'emploi, les acceptions diverses, la force ou la faiblesse du terme qui répond à ce mot dans les langues étrangères; enfin, citer les meilleurs auteurs qui ont fait usage de ce mot; faire voir le plus ou moins d'étendue qu'ils lui ont donné, remarquer s'il est plus propre à la poésie qu'à la prose.
Par exemple, j'observais que l' inclémence des airs est ridicule dans une histoire, parce que ce terme d' inclémence a son origine dans la colère du ciel qu'on suppose manifestée par l'intempérie, les dérangements, les rigueurs des saisons, la violence du froid, la corruption de l'air, les tempêtes, les orages, les vapeurs pestilentielles, etc. Ainsi donc inclémence étant une métaphore, est consacrée à la poésie.
Je donnais au mot impuissance toutes les acceptions qu'il reçoit. Je faisais voir dans quelle faute est tombé un historien qui parle de l'impuissance du roi Alphonse, en n'exprimant pas si c'était celle de résister à son frère, ou celle dont sa femme l'accusait.
Je tâchais de faire voir que les épithètes irrésistible , incurable , exigeaient un grand ménagement. Le premier qui a dit, l' impulsion irrésistible du génie , a très bien rencontré, parce qu'en effet il s'agissait d'un grand génie qui s'était livré à son talent malgré tous les obstacles. Les imitateurs qui ont employé cette expression pour des hommes médiocres, sont des plagiaires qui ne savent pas placer ce qu'ils dérobent.
Le mot incurable n'a été encore enchâssé dans un vers que par l'industrieux Racine.
D'un incurable amour remèdes impuissants .
Voilà ce que Boileau appelle des mots trouvés .
Dès qu'un homme de génie a fait un usage nouveau d'un terme de la langue, les copistes ne manquent pas d'employer cette même expression mal à propos en vingt endroits, et n'en font jamais honneur à l'inventeur.
Je ne crois pas qu'il y ait un seul de ces mots trouvés, une seule expression neuve de génie dans aucun auteur tragique depuis Racine, excepté ces années dernières. Ce sont pour l'ordinaire des termes lâches, oiseux, rebattus, si mal mis en place qu'il en résulte un style barbare; et à la honte de la nation, ces ouvrages visigoths et vandales, furent quelque temps prônés, célébrés, admirés dans les journaux, dans les Mercures, surtout quand ils furent protégés par je ne sais quelle dame qui ne s'y connaissait point du tout. On en est revenu aujourd'hui; et à un ou deux près, ils sont pour jamais anéantis.
Je ne prétendais pas faire toutes ces réflexions, mais mettre le lecteur en état de les faire.
Je faisais voir à la lettre E que nos e muets qui nous sont reprochés par un Italien, sont précisément ce qui forme la délicieuse harmonie de notre langue. Empire, couronne, diadème, épouvantable, sensible ; cet e muet qu'on fait sentir, sans l'articuler, laisse dans l'oreille un son mélodieux, comme celui d'un timbre qui résonne encore quand il n'est plus frappé. C'est ce que nous avons déjà répondu à un Italien homme de lettres, qui était venu à Paris pour enseigner sa langue, et qui ne devait pas y décrier la nôtre.
Il ne sentait pas la beauté et la nécessité de nos rimes féminines; elles ne sont que des e muets. Cet entrelacement de rimes masculines et féminines fait le charme de nos vers.
De semblables observations sur l'alphabet et sur les mots, auraient pu être de quelque utilité; mais l'ouvrage eût été trop long.
DIEU. DIEUX. [p. 351] ↩
SECTION PREMIÈRE.
Je crains toujours de me tromper; mais tous les monuments me font voir avec évidence que les anciens peuples policés reconnaissaient un Dieu suprême. Il n'y a pas un seul livre, une medaille, un bas-relief, une inscription où il soit parlé de Junon, de Minerve, de Neptune, de Mars et des autres dieux, comme d'un être formateur, souverain de toute la nature. Au contraire, les plus anciens livres profanes que nous ayons, Hésiode et Homère, représentent leur Zeus comme seul lançant la foudre, comme seul maître des dieux et des hommes; il punit même les autres dieux; il attache Junon à une chaîne, il chasse Apollon du ciel.
L'ancienne religion des brachmanes, la première qui admit des créatures célestes, la première qui parla de leur rébellion, s'explique d'une manière sublime sur l'unité et la puissance de Dieu, comme nous l'avons vu à l'article Ange .
Les Chinois, tout anciens qu'ils sont, ne viennent qu'après les Indiens; ils ont reconnu un seul Dieu de temps immémorial, point de dieux subalternes, point de génies ou démons médiateurs entre Dieu et les hommes, point d'oracles, point de dogmes abstraits, point de disputes théologiques chez les lettrés; l'empereur fut toujours le premier pontife, la religion fut toujours auguste et simple: c'est ainsi que ce vaste empire, quoique subjugué deux fois, s'est toujours conservé dans son intégrité, qu'il a soumis ses vainqueurs à ses lois, et que malgré les crimes et les malheurs attachés à la race humaine, il est encore l'Etat le plus florissant de la terre.
Les mages de Caldée, les Sabéens ne reconnaissaient qu'un seul Dieu suprême, et l'adoraient dans les étoiles qui sont son ouvrage.
Les Persans l'adoraient dans le soleil. La sphère posée sur le frontispice du temple de Memphis, était l'emblème d'un Dieu unique et parfait, nommé Knef par les Egyptiens.
Le titre de Deus optimus maximus , n'a jamais été donné par les Romains qu'au seul Jupiter, Hominum sator atque deorum . On ne peut trop répéter cette grande vérité que nous indiquons ailleurs. [40]
Cette adoration d'un Dieu suprême est confirmée depuis Romulus jusqu'à la destruction entière de l'empire, et à celle de sa religion. Malgré toutes les folies du peuple qui vénérait des dieux secondaires et ridicules, et malgré les épicuriens qui au fond n'en reconnaissaient aucun, il est avéré que les magistrats et les sages adorèrent dans tous les temps un Dieu souverain.
Dans le grand nombre de témoignages qui nous restent de cette vérité, je choisirai d'abord celui de Maxime de Tyr qui florissait sous les Antonins, ces modèles de la vraie piété, puisqu'ils l'étaient de l'humanité. Voici ses paroles dans son discours intitulé, De Dieu selon Platon . Le lecteur qui veut s'instruire est prié de les bien peser.
Les hommes ont eu la faiblesse de donner à Dieu une figure humaine, parce qu'ils n'avaient rien vu au-dessus de l'homme. Mais il est ridicule de s'imaginer avec Homère, que Jupiter ou la suprême Divinité, a les sourcils noirs et les cheveux d'or, et qu'il ne peut les secouer sans ébranler le ciel .
Quand on interroge les hommes sur la nature de la Divinité, toutes leurs réponses sont différentes. Cependant, au milieu de cette prodigieuse variété d'opinions, vous trouverez un même sentiment par toute la terre, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le père de tous, etc .
Que deviendront après cet aveu formel et après les discours immortels des Cicérons, des Antonins, des Epictètes, que deviendront, dis-je, les déclamations que tant de pédants ignorants répètent encore aujourd'hui? A quoi serviront ces éternels reproches d'un polythéisme grossier et d'une idolâtrie puérile, qu'à nous convaincre que ceux qui les font n'ont pas la plus légère connaissance de la saine antiquité? Ils ont pris les rêveries d'Homère pour la doctrine des sages.
Faut-il un témoignage encore plus fort et plus expressif? vous le trouverez dans la lettre de Maxime de Madaure à St Augustin; tous deux étaient philosophes et orateurs; du moins ils s'en piquaient, ils s'écrivaient librement; ils étaient amis autant que peuvent l'être un homme de l'ancienne religion et un de la nouvelle.
Lisez la lettre de Maxime de Madaure, et la réponse de l'évêque d'Hippone.
LETTRE DE MAXIME DE MADAURE.
‘Or qu'il y ait un Dieu souverain qui soit sans commencement, et qui sans avoir rien engendré de semblable à lui, soit néanmoins le père et le formateur de toutes choses, quel homme est assez grossier, assez stupide pour en douter? C'est celui dont nous adorons sous des noms divers l'éternelle puissance, répandue dans toutes les parties du monde; ainsi honorant séparément par diverses sortes de cultes, ce qui est comme ses divers membres, nous l'adorons tout entier . . . qu'ils vous conservent ces dieux subalternes , sous les noms desquels, et par lesquels tout autant de mortels que nous sommes sur la terre, nous adorons le Père commun des dieux et des hommes , par différentes sortes de cultes, à la vérité, mais qui s'accordent tous dans leur variété même, et ne tendent qu'à la même fin.'
Qui écrivait cette lettre? Un Numide, un homme du pays d'Alger.
RÉPONSE D'AUGUSTIN.
‘Il y a dans votre place publique deux statues de Mars, nu dans l'une et armé dans l'autre, et tout auprès la figure d'un homme qui avec trois doigts qu'il avance vers Mars, tient en bride cette divinité dangereuse à toute la ville. Sur ce que vous me dites que de pareils dieux sont comme les membres du seul véritable Dieu, je vous avertis avec toute la liberté que vous me donnez, de ne pas tomber dans de pareils sacrilèges; car ce seul Dieu dont vous parlez, est sans doute celui qui est reconnu de tout le monde, et sur lequel les ignorants conviennent avec les savants, comme quelques anciens ont dit. Or, direz-vous que celui dont la force, pour ne pas dire la cruauté, est réprimée par un homme mort soit Traduction de Dubois précepteur du dernier duc de Guise. un membre de celui-là? Il me serait aisé de vous pousser sur ce sujet; car vous voyez bien ce qu'on pourrait dire sur cela; mais je me retiens de peur que vous ne disiez que ce sont les armes de la rhétorique que j'emploie contre vous plutôt que celles de la vérité.'
Nous ne savons pas ce que signifiaient ces deux statues dont il ne reste aucun vestige; mais toutes les statues dont Rome était remplie, le Panthéon et tous les temples consacrés à tous les dieux subalternes, et même aux douze grands dieux, n'empêchèrent jamais que Deus optimus maximus, Dieu très bon et très grand , ne fût reconnu dans tout l'empire.
Le malheur des Romains était donc d'avoir ignoré la loi mosaïque, et ensuite d'ignorer la loi des disciples de notre Sauveur Jésus-Christ, de n'avoir pas eu la foi, d'avoir mêlé au culte d'un Dieu suprême le culte de Mars, de Vénus, de Minerve, d'Apollon qui n'existaient pas, et d'avoir conservé cette religion jusqu'au temps des Théodoses. Heureusement les Goths, les Huns, les Vandales, les Hérules, les Lombards, les Francs qui détruisirent cet empire, se soumirent à la vérité, et jouirent d'un bonheur qui fut refusé aux Scipions, aux Catons, aux Metellus, aux Emiles, aux Cicérons, aux Varrons, aux Virgiles et aux Horaces. (Voyez l'article Idolâtrie .)
Tous ces grands hommes ont ignoré Jésus-Christ qu'ils ne pouvaient connaître; mais ils n'ont point adoré le diable, comme le répètent tous les jours tant de pédants. Comment auraient-ils adoré le diable puisqu'ils n'en avaient jamais entendu parler?
D'UNE CALOMNIE DE WARBURTON CONTRE CICERON, AU SUJET D'UN DIEU SUPRÊME.
Préface de la 2 e partie du tome II de la légation de Moïse, pag. 19. Warburton a calomnié Cicéron et l'ancienne Rome, ainsi que ses contemporains. Il suppose hardiment que Cicéron a prononcé ces paroles dans son oraison pour Flaccus: IL EST INDIGNEDE LA MAJESTÉ DEL 'EMPIRE D'ADORERUN SEUL DIEU. Majestatem imperii non decuit ut unus tantum Deus colatur .
Qui le croirait? il n'y a pas un mot de cela dans l'oraison pour Flaccus, ni dans aucun ouvrage de Cicéron. Il s'agit de quelques vexations dont on accusait Flaccus, qui avait exercé la préture dans l'Asie mineure. Il était secrètement poursuivi par les Juifs, dont Rome était alors inondée; car ils avaient obtenu à force d'argent des privilèges à Rome, dans le temps même que Pompée après Crassus ayant pris Jérusalem, avait fait pendre leur roitelet Alexandre fils d'Aristobule. Flaccus avait défendu qu'on fît passer des espèces d'or et d'argent à Jérusalem, parce que ces monnaies en revenaient altérées, et que le commerce en souffrait; il avait fait saisir l'or qu'on y portait en fraude. Cet or, dit Cicéron, est encore dans le trésor; Flaccus s'est conduit avec autant de désintéressement que Pompée.
Ensuite Cicéron avec son ironie ordinaire prononce ces paroles: ‘Chaque pays a sa religion, nous avons la nôtre. Lorsque Jérusalem était encore libre, et que les Juifs étaient en paix, ces Juifs n'avaient pas moins en horreur la splendeur de cet empire, la dignité du nom romain, les institutions de nos ancêtres. Aujourd'hui cette nation a fait voir plus que jamais par la force de ses armes ce qu'elle doit penser de l'empire romain. Elle nous a montré par sa valeur combien elle est chère aux dieux immortels; elle nous l'a prouvé en étant vaincue, dispersée, tributaire.'
Stantibus hierosolimis, pacatisque Judaeis, tamen istorum religio sacrorum à splendore hujus imperii, gravitate nominis nostri, majorum institutis abhorrebat: nunc verò hoc magis, quid illa gens, quid de imperio nostro sentiret, ostendit armis: quam cara diis immortalibus esset, docuit, quòd est victa, quòd elocata, quòd servata .
Il est donc très faux que jamais ni Cicéron, ni aucun Romain ait dit, qu'il ne convenait pas à la majesté de l'empire de reconnaître un Dieu suprême. Leur Jupiter ce Zeus des Grecs, ce Jehova des Phéniciens, fut toujours regardé comme le maître des dieux secondaires. On ne peut trop inculquer cette grande vérité.
LES ROMAINS ONT-ILS PRIS TOUS LEURS DIEUX DES GRECS?
Les Romains n'auraient-ils pas eu plusieurs dieux qu'ils ne tenaient pas des Grecs?
Par exemple, ils ne pouvaient avoir été plagiaires en adorant Coelum, quand les Grecs adoraient Ouranon; en s'adressant à Saturnus et à Tellus quand les Grecs s'adressaient à Gé et à Cronos.
Ils appelaient Cérès celle que les Grecs nommaient Deo et Demiter.
Leur Neptune était Poseidon; leur Vénus était Aphrodite; leur Junon s'appelait en grec Era; leur Proserpine Coré; enfin, leur favori Mars, Arès; et leur favorite Bellone Enio. Il n'y a pas là un nom qui se ressemble.
Les beaux esprits grecs et romains s'étaient-ils rencontrés, ou les uns avaient-ils pris des autres, la chose dont ils déguisaient le nom?
Il est assez naturel que les Romains, sans consulter les Grecs, se soient fait des dieux du ciel, du temps, d'un être qui préside à la guerre, à la génération, aux moissons, sans aller demander des dieux en Grèce, comme ensuite ils allèrent demander des lois. Quand vous trouvez un nom qui ne ressemble à rien, il paraît juste de le croire originaire du pays.
Mais Jupiter le maître de tous les dieux, n'est-il pas un mot appartenant à toutes les nations, depuis l'Euphrate jusqu'au Tibre? C'était Jov, Jovis chez les premiers Romains, Zeus chez les Grecs, Jehova chez les Phéniciens, les Syriens, les Egyptiens.
Cette ressemblance ne paraît-elle pas servir à confirmer que tous ces peuples avaient la connaissance de l'Etre suprême? connaissance confuse à la vérité; mais quel homme peut l'avoir distincte?
SECTION SECONDE.
Examen de Spinosa.
Spinosa ne put s'empêcher d'admettre une intelligence agissante dans la matière, et faisant un tout avec elle.
Pag. 13. édition de Foppens. Je dois conclure , dit-il, que l'être absolu n'est ni pensée, ni étendue exclusivement l'un de l'autre, mais que l'étendue et la pensée sont les attributs nécessaires de l'être absolu .
C'est en quoi il paraît différer de tous les athées de l'antiquité, Ocellus Lucanus, Héraclite, Démocrite, Leucipe, Straton, Epicure, Pythagore, Diagore, Zenon d'Elée, Anaximandre et tant d'autres. Il en diffère surtout par sa méthode qu'il avait entièrement puisée dans la lecture de Descartes, dont il a imité jusqu'au style.
Spinosa dit qu'il aime Dieu. Pag. 44. Ce qui étonnera surtout la foule de ceux qui crient Spinosa, Spinosa , et qui ne l'ont jamais lu, c'est sa déclaration suivante. Il ne la fait pas pour éblouir les hommes, pour apaiser des théologiens, pour se donner des protecteurs, pour désarmer un parti; il parle en philosophe sans se nommer, sans s'afficher; il s'exprime en latin pour être entendu d'un très petit nombre. Voici sa profession de foi:
PROFESSION DE FOI DE SPINOZA.
‘Si je concluais aussi que l'idée de Dieu comprise sous celle de l'infinité de l'univers, me dispense de l'obéissance, de l'amour et du culte, je ferais encore un plus pernicieux usage de ma raison; car il m'est évident que les lois que j'ai reçues, non par le rapport ou l'entremise des autres hommes, mais immédiatement de lui, sont celles que la lumière naturelle me fait connaître pour véritables guides d'une conduite raisonnable. Si je manquais d'obéissance à cet égard, je pécherais non seulement contre le principe de mon être et contre la société de mes pareils, mais contre moi-même, en me privant du plus solide avantage de mon existence. Il est vrai que cette obéissance ne m'engage qu'aux devoirs de mon état, et qu'elle me fait envisager tout le reste comme des pratiques frivoles, inventées superstitieusement, ou par l'utilité de ceux qui les ont instituées.
‘A l'égard de l'amour de Dieu, loin que cette idée le puisse affaiblir, j'estime qu'aucun autre n'est plus propre à l'augmenter, puisqu'elle me fait connaître que Dieu est intime à mon être; qu'il me donne l'existence et toutes mes propriétés; mais qu'il me les donne libéralement sans reproche, sans intérêt, sans m'assujettir à autre chose qu'à ma propre nature. Elle bannit la crainte, l'inquiétude, la défiance, et tous les défauts d'un amour vulgaire ou intéressé. Elle me fait sentir que c'est un bien que je ne puis perdre, et que je possède d'autant mieux que je le connais et que je l'aime.'
Est-ce le vertueux et tendre Fénelon, est-ce Spinosa qui a écrit ces pensées? Comment deux hommes si opposés l'un à l'autre ont-ils pu se rencontrer dans l'idée d'aimer Dieu pour lui-même, avec des notions de Dieu si différentes? (Voyez Amour de Dieu .)
Il le faut avouer; ils allaient tous deux au même but, l'un en chrétien, l'autre en homme qui avait le malheur de ne le pas être. Le saint archevêque en philosophe persuadé que Dieu est distingué de la nature, l'autre en disciple très égaré de Descartes, qui s'imaginait que Dieu est la nature entière.
Le premier était orthodoxe; le second se trompait, j'en dois convenir: mais tous deux étaient dans la bonne foi; tous deux estimables dans leur sincérité comme dans leurs moeurs douces et simples; quoiqu'il n'y ait eu d'ailleurs nul rapport entre l'imitateur de l' Odyssée et un cartésien sec, hérissé d'arguments; entre un très bel esprit de la cour de Louis XIV, revêtu de ce qu'on nomme une grande dignité , et un pauvre juif déjudaïsé, vivant avec trois cents florins de rente [41] dans l'obscurité la plus profonde.
S'il est entre eux quelque ressemblance, c'est que Fénelon fut accusé devant le sanhédrin de la nouvelle loi, et l'autre devant une synagogue sans pouvoir comme sans raison; mais l'un se soumit et l'autre se révolta.
DU FONDEMENT DE LA PHILOSOPHIE DE SPINOSA.
Voyez l'article Spinosa Dictionnaire de Bayle. Le grand dialecticien Bayle a réfuté Spinosa. Ce système n'est donc pas démontré comme une proposition d'Euclide. S'il l'était, on ne saurait le combattre. Il est donc au moins obscur.
J'ai toujours eu quelque soupçon que Spinosa avec sa substance universelle, ses modes et ses accidents, avait entendu autre chose que ce que Bayle entend; et que par conséquent Bayle peut avoir eu raison, sans avoir confondu Spinosa. J'ai toujours cru surtout que Spinosa ne s'entendait pas souvent lui-même, et que c'est la principale raison pour laquelle on ne l'a pas entendu.
Il me semble qu'on pourrait battre les remparts du spinosisme par un côté que Bayle a négligé. Spinosa pense qu'il ne peut Spinosa croit que Dieu est tout et qu'il n'y a qu'une seule substance. exister qu'une seule substance; et il paraît par tout son livre qu'il se fonde sur la méprise de Descartes que tout est plein . Or, il est aussi faux que tout soit plein, qu'il est faux que tout soit vide. Il est démontré aujourd'hui que le mouvement est aussi impossible dans le plein absolu, qu'il est impossible que dans une balance égale un poids de deux livres élève un poids de quatre.
Or si tous les mouvements exigent absolument des espaces vides, que deviendra la substance unique de Spinosa? Comment la substance d'une étoile entre laquelle et nous est un espace vide si immense, sera-t-elle précisément la substance de notre terre, la substance de moi-même, [42] la substance d'une mouche mangée par une araignée?
Je me trompe peut-être; mais je n'ai jamais conçu comment Spinosa admettant une substance infinie dont la pensée et la matière sont les deux modalités, admettant la substance qu'il appelle Dieu , et dont tout ce que nous voyons est mode ou accident, a pu cependant rejeter les causes finales? Si cet être infini, universel, pense, comment n'aurait-il pas des desseins? s'il a des desseins, comment n'aurait-il pas une volonté? Nous sommes, dit Spinosa, des modes de cet Etre absolu, nécessaire, infini. Je dis à Spinosa, Nous voulons, nous avons des desseins, nous qui ne sommes que des modes; donc cet Etre infini, nécessaire, absolu ne peut en être privé; donc il a volonté, desseins, puissance.
Causes finales. Je sais bien que plusieurs philosophes, et surtout Lucrèce, ont nié les causes finales; et je sais que Lucrèce, quoique peu châtié, est un très grand poète dans ses descriptions et dans sa morale; mais en philosophie il me paraît, je l'avoue, fort au-dessous d'un portier de collège et d'un bedeau de paroisse. Affirmer que ni l'oeil n'est fait pour voir, ni l'oreille pour entendre, ni l'estomac pour digérer, n'est-ce pas là la plus énorme absurdité, la plus révoltante folie qui soit jamais tombée dans l'esprit humain? Tout douteur que je suis, cette démence me paraît évidente, et je le dis.
Pour moi je ne vois dans la nature comme dans les arts, que des causes finales; et je crois un pommier fait pour porter des pommes comme je crois une montre faite pour marquer l'heure.
Je dois avertir ici que si Spinosa dans plusieurs endroits de ses ouvrages se moque des causes finales, il les reconnaît plus expressément que personne dans sa première partie de L'Etre en général et en particulier .
Voici ses paroles.
Causes finales admises par Spinosa, pag. 14. ‘Qu'il me soit permis de m'arrêter ici quelque instant, pour admirer la merveilleuse dispensation de la nature, laquelle ayant enrichi la constitution de l'homme de tous les ressorts nécessaires pour prolonger jusqu'à certain terme la durée de sa fragile existence, et pour animer la connaissance qu'il a de lui-même par celle d'une infinité de choses éloignées, semble avoir exprès négligé de lui donner des moyens pour bien connaître celle dont il est obligé de faire un usage plus ordinaire, et même les individus de sa propre espèce. Cependant, à le bien prendre, c'est moins l'effet d'un refus que celui d'une extrême libéralité; puisque s'il y avait quelque être intelligent qui en pût pénétrer un autre contre son gré, il jouirait d'un tel avantage au-dessus de lui, que par cela même il serait exclu de sa société; au lieu que dans l'état présent, chaque individu jouissant de lui-même avec une pleine indépendance, ne se communique qu'autant qu'il lui convient.'
Spinosa se contredit. Que conclurai-je de là? que Spinosa se contredisait souvent, qu'il n'avait pas toujours des idées nettes, que dans le grand naufrage des systèmes il se sauvait tantôt sur une planche, tantôt sur une autre; qu'il ressemblait par cette faiblesse à Mallebranche, à Arnaud, à Bossuet, à Claude, qui se sont contredits quelquefois dans leurs disputes; qu'il était comme tant de métaphysiciens et de théologiens. Je conclurai que je dois me défier à plus forte raison de toutes mes idées en métaphysique, que je suis un animal très faible, marchant sur des sables mouvants qui se dérobent continuellement sous moi, et qu'il n'y a peut-être rien de si fou que de croire avoir toujours raison.
Vous êtes très confus, Baruc [43] Spinosa; mais êtes-vous aussi dangereux qu'on le dit? je soutiens que non; et ma raison, c'est que vous êtes confus, que vous avez écrit en mauvais latin, et qu'il n'y a pas dix personnes en Europe qui vous lisent d'un bout à l'autre, quoiqu'on vous ait traduit en français. Quel est l'auteur dangereux? c'est celui qui est lu par les oisifs de la cour et par les dames.
SECTION TROISIÉME.
Du Systême de la nature.
L'auteur du Système de la nature a eu l'avantage de se faire lire des savants, des ignorants, des femmes; il a donc dans le style des mérites que n'avait pas Spinosa. Souvent de la clarté, quelquefois de l'éloquence, quoiqu'on puisse lui reprocher de répéter, de déclamer, et de se contredire comme tous les autres. Pour le fond des choses, il faut s'en défier très souvent en physique et en morale. Il s'agit ici de l'intérêt du genre humain. Examinons donc si sa doctrine est vraie et utile, et soyons courts si nous pouvons.
Iere partie, pag. 60. L'ordre et le désordre n'existent point , etc.
Quoi! en physique un enfant né aveugle ou privé de ses jambes, un monstre n'est pas contraire à la nature de l'espèce? N'est-ce pas la régularité ordinaire de la nature qui fait l'ordre, et l'irrégularité qui est le désordre? N'est-ce pas un très grand dérangement, un désordre funeste qu'un enfant à qui la nature a donné la faim, et a bouché l'oesophage? Les évacuations de toute espèce sont nécessaires, et souvent les conduits manquent d'orifices; on est obligé d'y remédier: ce désordre a sa cause sans doute. Point d'effet sans cause; mais c'est un effet très désordonné.
L'assassinat de son ami, de son frère, n'est-il pas un désordre horrible en morale? Les calomnies d'un Garasse, d'un le Tellier, d'un Doucin contre les jansénistes, et celles des jansénistes contre des jésuites, les impostures des Patouillet et Paulian ne sont-elles pas de petits désordres? La St Barthélemi, les massacres d'Irlande etc. etc., ne sont-ils pas des désordres exécrables? Ce crime a sa cause dans des passions, mais l'effet est exécrable; la cause est fatale; ce désordre fait frémir. Reste à découvrir, si l'on peut, l'origine de ce désordre; mais il existe.
Pag. 69. L'expérience prouve que les matières que nous regardons comme inertes et mortes, prennent de l'action, de l'intelligence, de la vie, quand elles sont combinées d'une certaine façon .
C'est là précisément la difficulté. Comment un germe parvient-il à la vie? l'auteur et le lecteur n'en savent rien. Dès là les deux volumes du Système , et tous les systèmes du monde, ne sont-ils pas des rêves?
Pag. 78. Il faudrait définir la vie, et c'est ce que j'estime impossible .
Cette définition n'est-elle pas très aisée, très commune? la vie n'est-elle pas organisation avec sentiment? Mais que vous teniez ces deux propriétés du mouvement seul de la matière, c'est ce dont il est impossible de donner une preuve: et si on ne peut le prouver, pourquoi l'affirmer? pourquoi dire tout haut, je sais , quand on se dit tous bas, j'ignore ?
Pag. 80. L'on demandera ce que c'est que l'homme , etc.
Cet article n'est pas assurément plus clair que les plus obscurs de Spinosa, et bien des lecteurs s'indigneront de ce ton si décisif que l'on prend sans rien expliquer.
Pag. 82. La matière est éternelle et nécessaire, mais ses formes et ses combinaisons sont passagères et contigentes , etc.
Il est difficile de comprendre comment la matière étant nécessaire, et aucun être libre n'existant, selon l'auteur, il y aurait quelque chose de contingent. On entend par contingence ce qui peut être et ne pas être. Mais tout devant être d'une nécessité absolue, toute manière d'être qu'il appelle ici mal à propos contingent , est d'une nécessité aussi absolue que l'être même. C'est là où l'on se trouve encore plongé dans un labyrinthe où l'on ne voit point d'issue.
Lorsqu'on ose assurer qu'il n'y a point de Dieu, que la matière agit par elle-même par une nécessité éternelle, il faut la démontrer comme une proposition d'Euclide; sans quoi vous n'appuyez votre système que sur un peut-être. Quel fondement pour la chose qui intéresse le plus le genre humain!
Pag. 152. Si l'homme d'après sa nature est forcé d'aimer son bien-être, il est forcé d'en aimer les moyens. Il serait inutile et peut-être injuste de demander à un homme d'être vertueux s'il ne peut l'être sans se rendre malheureux. Dès que le vice le rend heureux, il doit aimer le vice .
Cette maxime est encore plus exécrable en morale que les autres ne sont fausses en physique. Quand il serait vrai qu'un homme ne pourrait être vertueux sans souffrir, il faudrait l'encourager à l'être. La proposition de l'auteur serait visiblement la ruine de la société. D'ailleurs, comment saura-t-il qu'on ne peut être heureux sans avoir des vices? n'est-il pas au contraire prouvé par l'expérience, que la satisfaction de les avoir domptés est cent fois plus grande que le plaisir d'y avoir succombé; plaisir toujours empoisonné, plaisir qui mène au malheur. On acquiert en domptant ses vices la tranquillité, le témoignage consolant de sa conscience; on perd en s'y livrant son repos, sa santé; on risque tout. L'auteur lui-même en vingt endroits veut qu'on sacrifie tout à la vertu. Qu'est-ce donc qu'un système rempli de ces contradictions?
Pag. 167 Ceux qui rejettent avec tant de raison les idées innées, auraient dû sentir que cette intelligence ineffable que l'on place au gouvernail du monde, et dont nos sens ne peuvent constater ni l'existence ni les qualités, est un être de raison .
En vérité, de ce que nous n'avons point d'idées innées, comment s'ensuit-il qu'il n'y a point de Dieu? cette conséquence n'est-elle pas absurde? y a-t-il quelque contradiction à dire que Dieu nous donne des idées par nos sens? n'est-il pas au contraire de la plus grande évidence que s'il est un Etre tout-puissant dont nous tenons la vie, nous lui devons nos idées et nos sens comme tout le reste? Il faudrait avoir prouvé auparavant que Dieu n'existe pas; et c'est ce que l'auteur n'a point fait; c'est même ce qu'il n'a pas encore tenté de faire jusqu'à cette page du chapitre X.
Dans la crainte de fatiguer les lecteurs par l'examen de tous ces morceaux détachés, je viens au fondement du livre, à l'erreur étonnante sur laquelle il a élevé son système. Je dois absolument répéter ici ce qu'on a dit ailleurs.
Voyez l'article Anguilles . HISTOIRE DES ANGUILLES SUR LESQUELLES EST FONDÉ LE SYSTÊME.
Il y avait en France vers l'an 1750 un jésuite anglais nommé Néedham, déguisé en séculier, qui servait alors de précepteur au neveu de M. Dillon archevêque de Toulouse. Cet homme faisait des expériences de physique, et surtout de chimie.
Après avoir mis de la farine de seigle ergoté dans des bouteilles bien bouchées, et du jus de mouton bouilli dans d'autres bouteilles, il crut que son jus de mouton et son seigle avaient fait naître des anguilles, lesquelles même en reproduisaient bientôt d'autres; et qu'ainsi une race d'anguilles se formait indifféremment d'un jus de viande, ou d'un grain de seigle.
Pag. 7. Un physicien qui avait de la réputation, ne douta pas que ce Néedham ne fût un profond athée. Il conclut que puisque l'on faisait des anguilles avec de la farine de seigle, on pouvait faire des hommes avec de la farine de froment, que la nature et la chimie produisaient tout; et qu'il était démontré qu'on peut se passer d'un Dieu formateur de toutes choses.
Cette propriété de la farine trompa aisément un homme malheureusement égaré alors dans des idées qui doivent faire trembler pour la faiblesse de l'esprit humain. Il voulait creuser un trou jusqu'au centre de la terre pour voir le feu central, disséquer des Patagons pour connaître la nature de l'âme; enduire les malades de poix résine pour les empêcher de transpirer; exalter son âme pour prédire l'avenir. Si on ajoutait qu'il fut encore plus malheureux en cherchant à opprimer deux de ses confrères, cela ne ferait pas d'honneur à l'athéisme, et servirait seulement à nous faire rentrer en nous-mêmes avec confusion.
Il est bien étrange que des hommes en niant un créateur, se soient attribué le pouvoir de créer des anguilles.
Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que des physiciens plus instruits adoptèrent le ridicule système du jésuite Néedham, et le joignirent à celui de Maillet, qui prétendait que l'Océan avait formé les Pyrénées et les Alpes, et que les hommes étaient originairement des marsouins, dont la queue fourchue se changea en cuisses et en jambes dans la suite des temps; ainsi que nous l'avons dit. De telles imaginations peuvent être mises avec les anguilles formées par de la farine.
Il n'y a pas longtemps qu'on assura qu'à Bruxelles un lapin avait fait une demi-douzaine de lapereaux à une poule.
Cette transmutation de farine et de jus de mouton en anguilles fut démontrée aussi fausse et aussi ridicule qu'elle l'est en effet, par M. Spalanzani un peu meilleur observateur que Néedham.
On n'avait pas besoin même de ces observations pour démontrer l'extravagance d'une illusion si palpable. Bientôt les anguilles de Néedham allèrent trouver la poule de Bruxelles.
Cependant, en 1768, le traducteur exact, élégant et judicieux de Lucrèce, se laissa surprendre au point que non seulement il rapporte dans ses notes du livreVIII , pag. 361, les prétendues expériences de Néedham, mais qu'il fait ce qu'il peut pour en constater la validité.
Voilà donc le nouveau fondement du Système de la nature . L'auteur dès le second chapitre s'exprime ainsi.
Iere partie, pag. 23. En humectant de la farine avec de l'eau, et en refermant ce mélange, on trouve au bout de quelque temps à l'aide du microscope, qu'il a produit des êtres organisés dont on croyait la farine et l'eau incapables. C'est ainsi que la nature inanimée peut passer à la vie, qui n'est elle-même qu'un assemblage de mouvements .
Quand cette sottise inouïe serait vraie, je ne vois pas, à raisonner rigoureusement, qu'elle prouvât qu'il n'y a point de Dieu; car il se pourrait très bien qu'il y eût un Etre suprême intelligent et puissant, qui ayant formé le soleil et tous les astres, daigna former aussi des animalcules sans germe. Il n'y a point là de contradiction dans les termes. Il faudrait chercher ailleurs une preuve démonstrative que Dieu n'existe pas, et c'est ce qu'assurément personne n'a trouvé ni ne trouvera.
L'auteur traite avec mépris les causes finales, parce que c'est un argument rebattu. Mais cet argument si méprisé est de Cicéron et de Newton. Il pourrait par cela seul faire entrer les athées en quelque défiance d'eux-mêmes. Le nombre est assez grand des sages qui en observant le cours des astres, et l'art prodigieux qui règne dans la structure des animaux et des végétaux, reconnaissent une main puissante qui opère ces continuelles merveilles.
L'auteur prétend que la matière aveugle et sans choix produit des animaux intelligents. Produire sans intelligence des êtres qui en ont! cela est-il concevable? ce système est-il appuyé sur la moindre vraisemblance? Une opinion si contradictoire exigerait des preuves aussi étonnantes qu'elle-même. L'auteur n'en donne aucune; il ne prouve jamais rien, et il affirme tout ce qu'il avance. Quel chaos, quelle confusion, mais quelle témérité!
Spinosa du moins avouait une intelligence agissante dans ce grand tout, qui constituait la nature; il y avait là de la philosophie. Mais je suis forcé de dire que je n'en trouve aucune dans le nouveau système.
La matière est étendue, solide, gravitante, divisible; j'ai tout cela aussi bien que cette pierre. Mais a-t-on jamais vu une pierre sentante et pensante? Si je suis étendu, solide, divisible, je le dois à la matière. Mais j'ai sensations et pensées; à qui le dois-je? ce n'est pas à de l'eau, à de la fange; il est vraisemblable que c'est à quelque chose de plus puissant que moi. C'est à la combinaison seule des éléments, me dites-vous. Prouvez-le-moi donc; faites-moi donc voir nettement qu'une cause intelligente ne peut m'avoir donné l'intelligence. Voilà où vous êtes réduit.
L'auteur combat avec succès le dieu des scolastiques, un dieu composé de qualités discordantes, un dieu auquel on donne, comme à ceux d'Homère, les passions des hommes; un dieu capricieux, inconstant, vindicatif, inconséquent, absurde; mais il ne peut combattre le Dieu des sages. Les sages en contemplant la nature admettent un pouvoir intelligent et suprême. Il est peut-être impossible à la raison humaine destituée du secours divin de faire un pas plus avant.
L'auteur demande où réside cet Etre? et de ce que personne sans être infini ne peut dire où il réside, il conclut qu'il n'existe pas. Cela n'est pas philosophique; car de ce que nous ne pouvons dire où est la cause d'un effet, nous ne devons pas conclure qu'il n'y a point de cause. Si vous n'aviez jamais vu de canonnier, et que vous vissiez l'effet d'une batterie de canon, vous ne devriez pas dire, Elle agit toute seule par sa propre vertu.
Ne tient-il donc qu'à dire, Il n'y a point de Dieu, pour qu'on vous en croie sur votre parole?
Enfin, sa grande objection est dans les malheurs et dans les crimes du genre humain, objection aussi ancienne que philosophique; objection commune, mais fatale et terrible, à laquelle on ne trouve de réponse que dans l'espérance d'une vie meilleure. Et quelle est encore cette espérance? nous n'en pouvons avoir aucune certitude par la raison. Mais j'ose dire que quand il nous est prouvé qu'un vaste édifice construit avec le plus grand art est bâti par un architecte quel qu'il soit, nous devons croire à cet architecte quand même l'édifice serait teint de notre sang, souillé de nos crimes, et qu'il nous écraserait par sa chute. Je n'examine pas encore si l'architecte est bon, si je dois être satisfait de son édifice, si je dois en sortir plutôt que d'y demeurer; si ceux qui sont logés comme moi dans cette maison pour quelques jours, en sont contents. J'examine seulement s'il est vrai qu'il y ait un architecte, ou si cette maison remplie de tant de beaux appartements et de vilains galetas, s'est bâtie toute seule.
SECTION QUATRIÉME.
De la nécessité de croire un Etre suprême.
Le grand objet, le grand intérêt, ce me semble, n'est pas d'argumenter en métaphysique, mais de peser s'il faut pour le bien commun de nous autres animaux misérables et pensants, admettre un Dieu rémunérateur et vengeur, qui nous serve à la fois de frein et de consolation, ou rejeter cette idée en nous abandonnant à nos calamités sans espérances, à nos crimes sans remords?
Hobbes dit, que si dans une république où l'on ne reconnaîtrait point de Dieu, quelque citoyen en proposait un, il le ferait pendre.
Il entendait apparemment par cette étrange exagération, un citoyen qui voudrait dominer au nom de Dieu; un charlatan qui voudrait se faire tyran. Nous entendons des citoyens qui sentant la faiblessse humaine, sa perversité et sa misère, cherchent un point fixe pour assurer leur morale, et un appui qui les soutienne dans les langueurs et dans les horreurs de cette vie.
Depuis Job jusqu'à nous, un très grand nombre d'hommes a maudit son existence; nous avons donc un besoin perpétuel de consolation et d'espoir. Votre philosophie nous en prive. La fable de Pandore valait mieux, elle nous laissait l'espérance; et vous nous la ravisssez! La philosophie, selon vous, ne fournit aucune preuve d'un bonheur à venir. Non; mais vous n'avez aucune démonstration du contraire. Il se peut qu'il y ait en nous une monade indestructible qui sente et qui pense, sans que nous sachions le moins du monde comment cette monade est faite. La raison ne s'oppose point absolument à cette idée, quoique la raison seule ne la prouve pas. Cette opinion n'a-t-elle pas un prodigieux avantage sur la vôtre? La mienne est utile au genre humain, la vôtre est funeste; elle peut (quoi que vous en disiez) encourager les Néron, les Alexandre VI et les Cartouche; la mienne peut les réprimer.
Marc-Antonin, Epictète, croyaient que leur monade (de quelque espèce qu'elle fût) se rejoindrait à la monade du Grand Etre; et ils furent les plus vertueux des hommes.
Dans le doute où nous sommes tous deux, je ne vous dis pas avec Pascal, prenez le plus sûr . Il n'y a rien de sûr dans l'incertitude. Il ne s'agit pas ici de parier, mais d'examiner; il faut juger, et notre volonté ne détermine pas notre jugement. Je ne vous propose pas de croire des choses extravagantes pour vous tirer d'embarras; je ne vous dis pas, Allez à la Mecque baiser la pierre noire pour vous instruire; tenez une queue de vache à la main; affublez-vous d'un scapulaire, soyez imbécile et fanatique pour acquérir la faveur de l'Etre des êtres. Je vous dis, Continuez à cultiver la vertu, à être bienfaisant, à regarder toute superstition avec horreur ou avec pitié; mais adorez avec moi le dessein qui se manifeste dans toute la nature, et par conséquent l'auteur de ce dessein, la cause primordiale et finale de tout; espérez avec moi que notre monade qui raisonne sur le grand Etre éternel, pourra être heureuse par ce grand Etre même. Il n'y a point là de contradiction. Vous ne m'en démontrerez pas l'impossibilité; de même que je ne puis vous démontrer mathématiquement que la chose est ainsi. Nous ne raisonnons guère en métaphysique que sur des probabilités: nous nageons tous dans une mer dont nous n'avons jamais vu le rivage. Malheur à ceux qui se battent en nageant. Abordera qui pourra; mais celui qui me crie, Vous nagez en vain, il n'y a point de port, me décourage et m'ôte toutes mes forces.
De quoi s'agit-il dans notre dispute? de consoler notre malheureuse existence. Qui la console? vous ou moi?
Vous avouez vous-même dans quelques endroits de votre ouvrage, que la croyance d'un Dieu a tenu quelques hommes sur le bord du crime: cet aveu me suffit. Quand cette opinion n'aurait prévenu que dix assassinats, dix calomnies, dix jugements iniques sur la terre, je tiens que la terre entière doit l'embrasser.
La religion, dites-vous, a produit des milliasses de forfaits; dites la superstition, qui règne sur notre triste globe; elle est la plus cruelle ennemie de l'adoration pure qu'on doit à l'Etre suprême. Détestons ce monstre qui a toujours déchiré le sein de sa mère; ceux qui la combattent sont les bienfaiteurs du genre humain; c'est un serpent qui entoure la religion de ses replis, il faut lui écraser la tête sans blesser celle qu'il infecte et qu'il dévore.
Vous craignez qu' en adorant Dieu on ne redevienne bientôt superstitieux et fanatique . Mais n'est-il pas à craindre qu'en le niant on ne s'abandonne aux passions les plus atroces, et aux crimes les plus affreux? Entre ces deux excès, n'y a-t-il pas un milieu très raisonnable? Où est l'asile entre ces deux écueils? le voici. Dieu, et des lois sages.
Vous affirmez qu'il n'y a qu'un pas de l'adoration à la superstition. Il y a l'infini pour les esprits bien faits: et ils sont aujourd'hui en grand nombre; ils sont à la tête des nations, ils influent sur les moeurs publiques; et d'année en année le fanatisme qui couvrait la terre se voit enlever ses détestables usurpations.
Je répondrai encore un mot à vos paroles de la page 223, Si l'on présume des rapports entre l'homme et cet Etre incroyable, il faudra lui élever des autels, lui faire des présents etc.; si l'on ne conçoit rien à cet Etre, il faudra s'en rapporter à des prêtres qui . . . etc. etc. etc. Le grand mal de s'assembler au temps des moissons pour remercier Dieu du pain qu'il nous a donné! qui vous dit de faire des présents à Dieu! l'idée en est ridicule: mais où est le mal de charger un citoyen qu'on appellera vieillard ou prêtre , de rendre des actions de grâce à la Divinité au nom des autres citoyens, pourvu que ce prêtre ne soit pas un Grégoire VII qui marche sur la tête des rois, ou un Alexandre VI souillant par un inceste le sein de sa fille qu'il a engendrée par un stupre, et assassinant, empoisonnant, à l'aide de son bâtard, presque tous les princes voisins; pourvu que dans une paroisse ce prêtre ne soit pas un fripon volant dans la poche des pénitents qu'il confesse, et employant cet argent à séduire les petites filles qu'il catéchise; pourvu que ce prêtre ne soit pas un le Tellier, qui met tout un royaume en combustion par des fourberies dignes du pilori; un Warburton qui viole les lois de la société en manifestant les papiers secrets d'un membre du parlement pour le perdre, et qui calomnie quiconque n'est pas de son avis? Ces derniers cas sont rares. L'état du sacerdoce est un frein qui force à la bienséance.
Un sot prêtre excite le mépris; un mauvais prêtre inspire l'horreur: un bon prêtre, doux, pieux, sans superstition, charitable, tolérant, est un homme qu'on doit chérir et respecter. Vous craignez l'abus, et moi aussi. Unissons-nous pour le prévenir; mais ne condamnons pas l'usage quand il est utile à la société, quand il n'est pas perverti par le fanatisme ou par la méchanceté frauduleuse.
J'ai une chose très importante à vous dire. Je suis persuadé que vous êtes dans une grande erreur; mais je suis également convaincu que vous vous trompez en honnête homme. Vous voulez qu'on soit vertueux, même sans Dieu, quoique vous ayez dit malheureusement que dès que le vice rend l'homme heureux, il doit aimer le vice . Proposition affreuse que vos amis auraient dû vous faire effacer. Partout ailleurs vous inspirez la probité. Cette dispute philosophique ne sera qu'entre vous et quelques philosophes répandus dans l'Europe; le reste de la terre n'en entendra pas parler. Le peuple ne nous lit point. Si quelque théologien voulait vous persécuter, il serait un méchant, il serait un imprudent qui ne servirait qu'à vous affermir, et à faire de nouveaux athées.
Vous avez tort; mais les Grecs n'ont point persécuté Epicure, les Romains n'ont point persécuté Lucrèce. Vous avez tort; mais il faut respecter votre génie et votre vertu en vous réfutant de toutes ses forces.
Le plus bel hommage, à mon gré, qu'on puisse rendre à Dieu, c'est de prendre sa défense sans colère; comme le plus indigne portrait qu'on puisse faire de lui est de le peindre vindicatif et furieux. Il est la vérité même: la vérité est sans passion. C'est être disciple de Dieu que de l'annoncer d'un coeur doux, et d'un esprit inaltérable.
Je pense avec vous que le fanatisme est un monstre mille fois plus dangereux que l'athéisme philosophique. Spinosa n'a pas commis une seule mauvaise action. Châtel et Ravaillac, tous deux dévots, assassinèrent Henri IV.
L'athée de cabinet est presque toujours un philosophe tranquille; le fanatique est toujours turbulent; mais l'athée de cour, le prince athée pourrait être le fléau du genre humain. Borgia et ses semblables ont fait presque autant de mal que les fanatiques de Munster et des Cévennes: je dis les fanatiques des deux partis. Le malheur des athées de cabinet est de faire des athées de cour. C'est Chiron qui élève Achille; il le nourrit de moelle de lion. Un jour Achille traînera le corps d'Hector autour des murailles de Troye, et immolera douze captifs innocents à sa vengeance.
Dieu nous garde d'un abominable prêtre qui hache un roi en morceaux avec son couperet sacré, ou de celui qui, le casque en tête et la cuirasse sur le dos, à l'âge de soixante et dix ans, ose signer de ses trois doigts ensanglantés la ridicule excommunication d'un roi de France, ou de . . . ou de . . . ou de . . .
Mais que Dieu nous préserve aussi d'un despote colère et barbare, qui ne croyant point Dieu, serait son Dieu à lui-même; qui se rendrait indigne de sa place sacrée en foulant aux pieds les devoirs que cette place impose; qui sacrifierait sans remords ses amis, ses parents, ses serviteurs, son peuple à ses passions. Ces deux tigres, l'un tondu, l'autre couronné, sont également à craindre. Par quel frein pourrons-nous les retenir? etc. etc.
Si l'idée d'un Dieu, auquel nos âmes peuvent se rejoindre, a fait des Titus, des Trajans, des Antonins, des Marc-Aurèles, et ces grands empereurs chinois, dont la mémoire est si précieuse dans le second des plus anciens et des plus vastes empires du monde; ces exemples suffisent pour ma cause. Et ma cause est celle de tous les hommes.
Je ne crois pas que dans toute l'Europe il y ait un seul homme d'Etat, un seul homme un peu versé dans les affaires du monde, qui n'ait le plus profond mépris pour toutes les légendes dont nous avons été inondés plus que nous le sommes aujourd'hui de brochures. Si la religion n'enfante plus de guerres civiles, c'est à la philosophie seule qu'on en est redevable; les disputes théologiques commencent à être regardées du même oeil que les querelles de Gilles et de Pierrot à la foire. Une usurpation également odieuse et ridicule, fondée d'un côté sur la fraude et de l'autre sur la bêtise, est minée chaque instant par la raison qui établit son règne. La bulle in Coena Domini , le chef-d'oeuvre de l'insolence et de la folie, n'ose plus paraître dans Rome même. Si un régiment de moines fait la moindre évolution contre les lois de l'Etat, il est cassé sur-le-champ. Mais quoi! parce qu'on a chassé les jésuites, faut-il chasser Dieu? au contraire, il faut l'en aimer davantage.
AMOUR DE DIEU. [p. 373] ↩
Les disputes sur l'amour de Dieu ont allumé autant de haines qu'aucune querelle théologique. Les jésuites et les jansénistes se sont battus pendant cent ans, à qui aimerait Dieu d'une façon plus convenable, et à qui désolerait plus son prochain.
Dès que l'auteur du Télémaque qui commençait à jouir d'un grand crédit à la cour de Louis XIV, voulut qu'on aimât Dieu d'une manière qui n'était pas celle de l'auteur des Oraisons funèbres ; celui-ci qui était un grand ferrailleur, lui déclara la guerre, et le fit condamner dans l'ancienne ville de Romulus, où Dieu était ce qu'on aimait le mieux après la domination, les richesses, l'oisiveté, le plaisir et l'argent.
Si madame Guion avait su le conte de la bonne vieille qui apportait un réchaud pour brûler le paradis, et une cruche d'eau pour éteindre l'enfer, afin qu'on n'aimât Dieu que pour lui-même, elle n'aurait peut-être pas tant écrit. Elle eût dû sentir qu'elle ne pouvait rien dire de mieux. Mais elle aimait Dieu et le galimatias si cordialement, qu'elle fut quatre fois en prison pour sa tendresse: traitement rigoureux et injuste. Pourquoi punir comme une criminelle une femme qui n'avait d'autre crime que celui de faire des vers dans le style de l'abbé Cotin, et de la prose dans le goût de Polichinelle? Il est étrange que l'auteur de Télémaque et des froides amours d'Eucharis ait dit, dans ses Maximes des saints , d'après le bienheureux François de Sales, Je n'ai presque point de désirs; mais si j'étais à renaître je n'en aurais point du tout. Si Dieu venait à moi, j'irais aussi à lui; s'il ne voulait pas venir à moi, je me tiendrais là et n'irais pas à lui .
C'est sur cette proposition que roule tout son livre; on ne condamna point St François de Sales; mais on condamna Fénelon. Pourquoi? c'est que François de Sales n'avait point un violent ennemi à la cour de Turin, et que Fénelon en avait un à Versailles.
Ce qu'on a écrit de plus sensé sur cette controverse mystique, se trouve peut-être dans la satire de Boileau, sur l' amour de Dieu , quoique ce ne soit pas assurément son meilleur ouvrage.
Qui fait exactement ce que ma loi commande,
A pour moi, dit ce Dieu, l'amour que je demande.
S'il faut passer des épines de la théologie, à celles de la philosophie qui sont moins longues et moins piquantes, il paraît clair qu'on peut aimer un objet sans aucun retour sur soi-même, sans aucun mélange d'amour-propre, intéressé. Nous ne pouvons comparer les choses divines aux terrestres, l'amour de Dieu à un autre amour. Il manque précisément un infini d'échelons pour nous élever de nos inclinations humaines à cet amour sublime. Cependant, puisqu'il n'y a pour nous d'autre point d'appui que la terre, tirons nos comparaisons de la terre. Nous voyons un chef-d'oeuvre de l'art en peinture, en sculpture, en architecture, en poésie, en éloquence, nous entendons une musique qui enchante nos oreilles et notre âme, nous l'admirons, nous l'aimons sans qu'il nous en revienne le plus léger avantage, c'est un sentiment pur; nous allons même jusqu'à sentir quelquefois de la vénération, de l'amitié pour l'auteur; et s'il était là nous l'embrasserions.
C'est à peu près la seule manière dont nous puissions expliquer notre profonde admiration et les élans de notre coeur envers l'éternel architecte du monde. Nous voyons l'ouvrage avec un étonnement de respect, et d'anéantissement; et notre coeur s'élève autant qu'il le peut vers l'ouvrier.
Mais quel est ce sentiment? je ne sais quoi de vaste et d'interminé, un saisissement qui ne tient rien de nos affections ordinaires; une âme plus sensible qu'une autre, plus désoccupée, peut-être si touchée du spectacle de la nature, qu'elle voudrait s'élancer jusqu'au maître éternel qui l'a formée. Une telle affection de l'esprit, un si puissant attrait peut-il encourir la censure? A-t-on pu condamner le tendre archevêque de Cambrai? Malgré les expressions de St François de Sales que nous avons rapportées, il s'en tenait à cette assertion, qu'on peut aimer l'auteur uniquement pour la beauté de ses ouvrages. Quelle hérésie avait-on à lui reprocher? les extravagances du style d'une dame de Montargis, et quelques expressions peu mesurées de sa part, lui nuisirent.
Où était le mal? on n'en sait plus rien aujourd'hui. Cette querelle est anéantie comme tant d'autres. Si chaque ergoteur voulait bien se dire à soi-même, Dans quelques années personne ne se souciera de mes ergotismes, on ergoterait beaucoup moins. Ah, Louis XIV! Louis XIV ! il fallait laisser deux hommes de génie sortir de la sphère de leurs talents, au point d'écrire ce qu'on a jamais écrit de plus obscur et de plus ennuyeux dans votre royaume.
Pour finir tous ces débats-là,
Tu n'avais qu'à les laisser faire.
Remarquons à tous les articles de morale et d'histoire par quelle chaîne invisible, par quels ressorts inconnus toutes les idées qui troublent nos têtes et tous les événements qui empoisonnent nos jours sont liés ensemble, se heurent et forment nos destinées. Fénelon meurt dans l'exil pour avoir eu deux ou trois conversations mystiques avec une femme un peu extravagante. Le cardinal de Bouillon, le neveu du grand Turenne, est persécuté pour n'avoir pas lui-même persécuté à Rome l'archevêque de Cambrai son ami: il est contraint de sortir de France, et il perd toute sa fortune.
C'est par ce même enchaînement que le fils d'un procureur de Vire trouve, dans une douzaine de phrases obscures d'un livre imprimé dans Amsterdam, de quoi remplir de victimes tous les cachots de la France; et à la fin, il sort de ces cachots mêmes un cri dont le retentissement fait tomber par terre toute une société habile et tyrannique fondée par un fou ignorant.
DE DIODORE DE SICILE, ET D'HÉRODOTE. [p. 373] ↩
Il est juste de commencer par Hérodote comme le plus ancien.
Quand Henri Etienne intitula sa comique rapsodie, Apologie d'Hérodote , on sait assez que son dessein n'était pas de justifier les contes de ce père de l'histoire; il ne voulait que se moquer de nous, et faire voir que les turpitudes de son temps étaient pires que celles des Egyptiens et des Perses. Il usa de la liberté que se donnait tout protestant contre ceux de l'Eglise catholique apostolique et romaine. Il leur reproche aigrement leurs débauches, leur avarice, leurs crimes expiés à prix d'argent, leurs indulgences publiquement vendues dans les cabarets, les fausses reliques supposées par leurs moines; il les appelle idolâtres . Il ose dire que si les Egyptiens adoraient, à ce qu'on dit, des chats et des oignons, les catholiques adoraient des os de morts. Il ose les appeler, dans son discours préliminaire, théophages , et même théokeses . [44] Nous avons quatorze éditions de ce livre; car nous aimons les injures qu'on nous dit en commun, autant que nous regimbons contre celles qui s'adressent à nos personnes en notre propre et privé nom.
Henri Etienne ne se servit donc d'Hérodote que pour nous rendre exécrables et ridicules. Nous avons un dessein tout contraire; nous prétendons montrer que les histoires modernes de nos bons auteurs depuis Guichardin, sont en général aussi sages, aussi vraies que celles de Diodore et d'Hérodote sont folles et fabuleuses.
1 o . Que veut dire le père de l'histoire dès le commencement de son ouvrage: Les historiens perses rapportent que les Phéniciens furent les auteurs de toutes les guerres. De la mer Rouge ils entrèrent dans la nôtre ? etc. Il semblerait que les Phéniciens se fussent embarqués au golfe du Suez, qu'arrivés au détroit de Babel-Mandel ils eussent côtoyé l'Ethiopie, passé la ligne, doublé le cap des Tempêtes appelé depuis le cap de Bonne-Espérance , remonté au loin entre l'Afrique et l'Amérique qui est le seul chemin, repassé la ligne, entré de l'Océan dans la Méditerranée par les colonnes d'Hercule; ce qui aurait été un voyage de plus de quatre mille de nos grandes lieues marines, dans un temps où la navigation était dans son enfance.
2 o . La première chose que font les Phéniciens, c'est d'aller vers Argos enlever la fille du roi Inachus, après quoi les Grecs à leur tour vont enlever Europe fille du roi de Tyr.
3 o . Immédiatement après vient Candale roi de Lydie, qui rencontrant un de ses soldats aux gardes nommé Gigès, lui dit, Il faut que je te montre ma femme toute nue; il n'y manque pas. La reine l'ayant su, dit au soldat, comme de raison, Il faut que tu meures, ou que tu assassines mon mari, et que tu règnes avec moi; ce qui fut fait sans difficulté.
4 o . Suit l'histoire d'Orion porté par un marsouin sur la mer du fond de la Calabre jusqu'au cap de Matapan, ce qui fait un voyage assez extraordinaire d'environ cent lieues.
5 o . De conte en conte (et qui n'aime pas les contes?) on arrive à l'oracle infaillible de Delphe, qui tantôt devine que Crésus fait cuire un quartier d'agneau et une tortue dans une tourtière de cuivre, et tantôt lui prédit qu'il sera détrôné par un mulet.
6 o . Parmi les inconcevables fadaises dont toute l'histoire ancienne regorge, en est-il beaucoup qui approchent de la famine qui tourmenta pendant vingt-huit ans les Lydiens? Ce peuple qu'Hérodote nous peint plus riche en or que les Péruviens, au lieu d'acheter des vivres chez l'étranger, ne trouva d'autre secret que celui de jouer aux dames de deux jours l'un, sans manger pendant vingt-huit années de suite.
7 o . Connaissez-vous rien de plus merveilleux que l'histoire de Cyrus? son grand-père le Mède Astiage qui, comme vous voyez, avait un nom grec, rêve une fois que sa fille Mandane (autre nom grec) inonde toute l'Asie en pissant; une autre fois, que de sa matrice il sort une vigne dont toute l'Asie mange les raisins. Et là-dessus, le bonhomme Astiage ordonne à un Harpage, autre Grec, de faire tuer son petit-fils Cyrus; car il n'y a certainement point de grand-père qui n'égorge toute sa race après de tels rêves. Harpage n'obéit point. Le bon Astiage qui était prudent et juste fait mettre en capilotade le fils d'Harpage, et le fait manger à son père, selon l'usage des anciens héros.
8 o . Hérodote, non moins bon naturaliste qu'historien exact, ne manque pas de vous dire que la terre à froment de vers Babilone, rapporte trois cents pour un. Je connais un petit pays qui rapporte trois pour un. J'ai envie d'aller me transporter dans le Diarbek quand les Turcs en seront chassés par Catherine II, qui a de très beaux blés aussi, mais non pas trois cents pour un.
9 o . Ce qui m'a toujours semblé très honnête et très édifiant chez Hérodote, c'est la belle coutume religieuse établie dans Babilone, et dont nous avons parlé, que toutes les femmes mariées allassent se prostituer dans le temple de Milita pour de l'argent au premier étranger qui se présentait. On comptait deux millions d'habitants dans cette ville. Il devait y avoir de la presse aux dévotions. Cette loi est surtout très vraisemblable chez les Orientaux qui ont toujours renfermé leurs femmes, et qui plus de dix siècles avant Hérodote imaginèrent de faire des eunuques qui leur répondissent de la chasteté de leurs femmes. [45] Je m'arrête; si quelqu'un veut suivre l'ordre de ces numéros, il sera bientôt à cent.
Tout ce que dit Diodore de Sicile, sept siècles après Hérodote, est de la même force dans tout ce qui regarde les antiquités et la physique. L'abbé Terrasson nous disait, Je traduis le texte de Diodore dans toute sa turpitude. Il nous en lisait quelquefois des morceaux chez M. de la Faye; et quand on riait, il disait, Vous verrez bien autre chose. Il était tout le contraire de Dacier.
Le plus beau morceau de Diodore est la charmante description de l'île Pancaie, Panchaica tellus , célébrée par Virgile. Ce sont des allées d'arbres odoriférants, à perte de vue, de la myrrhe et de l'encens pour en fournir au monde entier sans s'épuiser; des fontaines qui forment une infinité de canaux bordés de fleurs; des oiseaux ailleurs inconnus qui chantent sous d'éternels ombrages; un temple de marbre de quatre mille pieds de longueur, orné de colonnes et de statues colossales, etc. etc.
Cela fait souvenir du duc de la Ferté qui, pour flatter le goût de l'abbé Servien, lui disait un jour, Ah! si vous aviez vu mon fils qui est mort à l'âge de quinze ans! quels yeux! quelle fraîcheur de teint! quelle taille admirable! l'Antinoüs du Belvedère n'était auprès de lui qu'un magot de la Chine. Et puis, quelle douceur de moeurs! faut-il que ce qu'il y a jamais eu de plus beau m'ait été enlevé. L'abbé Servien s'attendrit; le duc de la Ferté s'échauffant par ses propres paroles, s'attendrit aussi. Tous deux enfin se mirent à pleurer; après quoi il avoua qu'il n'avait jamais eu de fils.
Un certain abbé Bazin avait relevé avec sa discrétion ordinaire un autre conte de Diodore. C'était à propos du roi d'Egypte Sésostris, qui probablement n'a pas plus existé que l'île Pancaie. Le père de Sésostris qu'on ne nomme point, imagina, le jour que son fils naquit, de lui faire conquérir toute la terre dès qu'il serait majeur. C'est un beau projet. Pour cet effet, il fit élever auprès de lui tous les garçons qui étaient nés le même jour en Egypte; et pour en faire des conquérants, on ne leur donnait à déjeuner qu'après leur avoir fait courir cent quatre-vingts stades, qui font environ huit de nos grandes lieues.
Quand Sésostris fut majeur, il partit avec ses coureurs pour aller conquérir le monde. Ils étaient encore au nombre de dix-sept cents; et probablement la moitié était morte, selon le train ordinaire de la nature, et surtout de la nature de l'Egypte, qui de tout temps fut désolée par une peste destructive, au moins une fois en dix ans.
Il fallait donc qu'il fût né trois mille quatre cents garçons en Egypte le même jour que Sésostris. Et comme la nature produit presque autant de filles que de garçons, il naquit ce jour-là environ six mille personnes au moins; mais on accouche tous les jours: et six mille naissances par jour produisent au bout de l'année deux millions cent quatre-vingt-dix mille enfants. Si vous les multipliez par trente-quatre, selon la règle de Kerseboum, vous aurez en Egypte plus de soixante et quatorze millions d'habitants, dans un pays qui n'est pas si grand que l'Espagne ou que la France.
Tout cela parut énorme à l'abbé Bazin qui avait un peu vu le monde, et qui savait comme il va.
Mais un Larcher qui n'était jamais sorti du collège Mazarin, prit violemment le parti de Sésostris et de ses coureurs. Il prétendit qu'Hérodote en parlant aux Grecs, ne comptait pas par stades de la Grèce, et que les héros de Sésostris ne couraient que quatre grandes lieues pour avoir à déjeuner. Il accabla ce pauvre abbé Bazin d'injures telles que jamais savant en us , ou en es n'en avait pas encore dites. Il ne s'en tint pas même aux dix-sept cents petits garçons; il alla jusqu'à prouver par les prophètes que les femmes, les filles, les nièces des rois de Babilone, toutes les femmes des satrapes et des mages, allaient par dévotion coucher dans les allées du temple de Babilone pour de l'argent, avec tous les chameliers et tous les muletiers de l'Asie. Il traita de mauvais chrétien, de damné, et d'ennemi de l'Etat, quiconque osait défendre l'honneur des dames de Babilone.
Il prit aussi le parti des boucs qui avaient communément les faveurs des jeunes Egyptiennes. Sa grande raison, disait-il, c'est qu'il était allié par les femmes à un parent de l'évêque de Meaux Bossuet auteur d'un discours éloquent sur l' Histoire non-universelle ; mais ce n'est pas là une raison péremptoire.
Gardez-vous des contes bleus en tout genre.
Diodore de Sicile fut le plus grand compilateur de ces contes. Ce Sicilien n'avait pas un esprit de la trempe de son compatriote Archimède qui chercha et trouva tant de vérités mathématiques.
Diodore examine sérieusement l'histoire des Amazones et de leur reine Mirine; l'histoire des Gorgones qui combattirent contre les Amazones; celle des Titans, celle de tous les dieux. Il approfondit l'histoire de Priape et d'Hermaphrodite. On ne peut donner plus de détails sur Hercule: ce héros parcourt tout l'hémisphère, tantôt à pied et tout seul comme un pèlerin, tantôt comme un général d'une grande armée. Tous ses travaux y sont fidèlement discutés; mais ce n'est rien en comparaison de l'histoire des dieux de Crète.
Diodore justifie Jupiter du reproche que d'autres graves historiens lui ont fait d'avoir détrôné et mutilé son père. On voit comment ce Jupiter alla combattre des géants, les uns dans son île, les autres en Phrygie, et ensuite en Macédoine et en Italie.
Aucun des enfants qu'il eut de sa soeur Junon et de ses favorites n'est omis.
On voit ensuite comment il devint dieu, et dieu suprême.
C'est ainsi que toutes les histoires anciennes ont été écrites. Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'elles étaient sacrées; et en effet, si elles n'avaient pas été sacrées, elles n'auraient jamais été lues.
Il n'est pas mal d'observer que quoiqu'elles fussent sacrées, elles étaient toutes différentes; et de province en province, d'île en île, chacune avait une histoire des dieux, des demi-dieux et des héros contradictoire avec celle de ses voisins. Mais aussi, ce qu'il faut bien observer, c'est que les peuples ne se battirent jamais pour cette mythologie.
L'histoire honnête de Thucidide, et qui a quelques lueurs de vérité, commence à Xerxès: mais avant cette époque que de temps perdu!
DIRECTEUR. [p. 381] ↩
Ce n'est ni d'un directeur de finances, ni d'un directeur d'hôpitaux, ni d'un directeur des bâtiments du roi etc. etc. que je prétends parler, mais d'un directeur de conscience; car celui-là dirige tous les autres, il est le précepteur du genre humain. Il sait et enseigne ce qu'on doit faire et ce qu'on doit omettre dans tous les cas possibles.
Il est clair qu'il serait utile que dans toutes les cours il y eût un homme consciencieux , que le monarque consultât en secret dans plus d'une occasion, et qui lui dît hardiment, non licet . Louis le Juste n'aurait pas commencé son triste et malheureux règne par assassiner son premier ministre et par emprisonner sa mère. Que de guerres aussi funestes qu'injustes de bons directeurs nous auraient épargnées! que de cruautés ils auraient prévenues!
Mais souvent on croit consulter un agneau et on consulte un renard. Tartuffe était le directeur d'Orgon. Je voudrais bien savoir quel fut le directeur de conscience qui conseilla la St Barthélemi.
Il n'est pas plus parlé de directeurs que de confesseurs dans l'Evangile. Chez les peuples que notre courtoisie ordinaire nomme païens , nous ne voyons pas que Scipion, Fabricius, Caton, Titus, Trajan, les Antonins eussent des directeurs. Il est bon d'avoir un ami scrupuleux qui vous rappelle à vos devoirs. Mais votre conscience doit être le chef de votre conseil.
Un huguenot fut bien étonné quand une dame catholique lui apprit qu'elle avait un confesseur pour l'absoudre de ses péchés, et un directeur pour l'empêcher d'en commettre. Comment votre vaisseau, lui dit-il, madame, a-t-il pu faire eau si souvent ayant deux si bons pilotes?
Les doctes observent qu'il n'appartient pas à tout le monde d'avoir un directeur. Il en est de cette charge dans une maison comme de celle d'écuyer; cela n'appartient qu'aux grandes dames. L'abbé Gobelin homme processif et avide, ne dirigeait que madame de Maintenon. Les directeurs à la ville servent souvent quatre ou cinq dévotes à la fois; ils les brouillent tantôt avec leurs maris, tantôt avec leurs amants, et remplissent quelquefois les places vacantes.
Pourquoi les femmes ont-elles des directeurs, et les hommes n'en ont-ils point? c'est par la raison que madame de la Valière se fit carmélite quand elle fut quittée par Louis XIV; et que M. de Turenne étant trahi par madame de Coetquen ne se fit pas moine.
St Jérôme et Rufin son antagoniste étaient grands directeurs de femmes et de filles; ils ne trouvèrent pas un sénateur romain, pas un tribun militaire à gouverner. Il faut à tous ces gens-là du devoto femineo sexu . Les hommes ont pour eux trop de barbe au menton, et souvent trop de force dans l'esprit. Boileau a fait dans la satire des femmes le portrait d'un directeur.
Nul n'est si bien soigné qu'un directeur de femmes;
Quelque léger dégoût vient-il le travailler,
Une froide vapeur le fait-elle bâiller,
Un escadron coiffé d'abord court à son aide:
L'une chauffe un bouillon, l'autre apprête un remède:
Chez lui sirops exquis, ratafias vantés,
Confitures, surtout, volent de tous côtés. etc.
Ces vers sont bons pour Brossette. Il y avait ce me semble quelque chose de mieux à nous dire.
DISPUTE. [p. 383] ↩
On a toujours disputé, et sur tous les sujets. Mundum tradidit disputationi eorum . Il y a eu de violentes querelles pour savoir si le tout est plus grand que sa partie; si un corps peut être en plusieurs endroits à la fois; si la matière est toujours impénétrable; si la blancheur de la neige peut subsister sans neige; si la douceur du sucre peut se faire sentir sans sucre, si on peut penser sans tête.
Je ne fais aucun doute que dès qu'un janséniste aura fait un livre pour démontrer que deux et un font trois, il ne se trouve un moliniste qui démontre que deux et un font cinq.
Nous avons cru instruire le lecteur et lui plaire en mettant sous ses yeux cette pièce de vers sur les disputes. Elle est fort connue de tous les gens de goût de Paris; mais elle ne l'est point des savants qui disputent encore sur la prédestination gratuite, et sur la grâce concomitante, et sur la question si la mer a produit les montagnes.
Lisez les vers suivants sur les disputes; voilà comme on en faisait dans le bon temps.
DISCOURS EN VERS SUR LES DISPUTES.
Vingt têtes, vingt avis, nouvel an, nouveau goût,
Autre ville, autres moeurs, tout change, on détruit tout.
Examine pour toi ce que ton voisin pense;
Le plus beau droit de l'homme est cette indépendance.
Mais ne dispute point; les desseins éternels
Cachés au sein de Dieu sont trop loin des mortels;
Le peu que nous savons d'une façon certaine,
Frivole comme nous ne vaut pas tant de peine.
Le monde est plein d'erreurs, mais de là je conclus
Que prêcher la raison n'est qu'une erreur de plus.En parcourant au loin la planète où nous sommes
Que verrons-nous? Les torts et les travers des hommes.
Ici c'est un synode, et là c'est un divan,
Nous verrons le mufti, le derviche, l'iman,
Le bonze, le lama, le talapoin, le pope,
Les antiques rabbins, et les abbés d'Europe,
Nos moines, nos prélats, nos docteurs agrégés;
Etes-vous disputeurs, mes amis? Voyagez.Qu'un jeune ambitieux ait ravagé la terre,
Qu'un regard de Vénus ait allumé la guerre,
Qu'à Paris, au palais l'honnête citoyen
Plaide pendant vingt ans pour un mur mitoyen,
Qu'au fond d'un diocèse un vieux prêtre gémisse
Quand un abbé de cour enlève un bénéfice,
Et que dans le parterre un poète envieux
Ait en battant des mains un feu noir dans les yeux,
Tel est le coeur humain: mais l'ardeur insensée
D'asservir ses voisins à sa propre pensée,
Comment la concevoir? Pourquoi, par quel moyen
Veux-tu que ton esprit soit la règle du mien?Je hais surtout, je hais tout causeur incommode,
Tous ces demi-savants gouvernés par la mode,
Ces gens qui pleins de feu, peut-être pleins d'esprit,
Soutiendront contre vous ce que vous aurez dit.
Un peu musiciens, philosophes, poètes
Et grands hommes d'Etat formés par les gazettes;
Sachant tout, lisant tout, prompts à parler de tout,
Et qui contrediraient Voltaire sur le goût,
Montesquieu sur les lois, de Broglie sur la guerre,
Ou la jeune d'Egmont sur le talent de plaire.Voyez-les s'emporter sur les moindres sujets,
Sans cesse répliquant sans répondre jamais,
‘Je ne céderais pas au prix d'une couronne. . .
J e sens. . . le sentiment ne consulte personne. . .
Et le roi serait là. . . je verrais là le feu. . .,
Messieurs, la vérité mise une fois en jeu,
Doit-il nous importer de plaire ou de déplaire?. . .'C'est bien dit; mais pourquoi cette raideur austère?
Hélas! c'est pour juger de quelques nouveaux airs
Ou des deux Poinsinet lequel fait mieux des vers.Auriez-vous par hasard connu feu monsieur d'Aube, [46]
Qu'une ardeur de dispute éveillait avant l'aube?
Contiez-vous un combat de votre régiment,
Il savait mieux que vous, où, contre qui, comment.
Vous seul en auriez eu toute la renommée,
N'importe, il vous citait ses lettres de l'armée;
Et Richelieu présent il aurait raconté
Ou Gènes défendue, ou Mahon emporté.
D'ailleurs homme de sens, d'esprit et de mérite,
Mais son meilleur ami redoutait sa visite.
L'un bientôt rebuté d'une vaine clameur
Gardait en l'écoutant un silence d'humeur.
J'en ai vu dans le feu d'une dispute aigrie,
Prêts de l'injurier le quitter de furie;
Et rejetant la porte à son double battant,
Ouvrir à leur colère un champ libre en sortant.
Ses neveux qu'à sa suite attachait l'espérance
Avaient vu dérouter toute leur complaisance.
Un voisin asthmatique en l'embrassant un soir
Lui dit, Mon médecin me défend de vous voir.
Et parmi cent vertus cette unique faiblesse
Dans un triste abandon réduisit sa vieillesse.
Au sortir d'un sermon la fièvre le saisit
Las d'avoir écouté sans avoir contredit.
Et tout prêt d'expirer, gardant son caractère,
Il faisait disputer le prêtre et le notaire.Que la bonté divine arbitre de son sort
Lui donne le repos que nous rendit sa mort!
Si du moins il s'est tu devant ce grand arbitre.Un jeune bachelier bientôt docteur en titre,
Doit, suivant une affiche, un tel jour, en tel lieu,
Répondre à tout venant sur l'essence de Dieu.
Venez-y, venez voir comme sur un théâtre
Une dispute en règle, un choc opiniâtre,
L'enthymème serré, les dilemmes pressants,
Poignards à double lame, et frappant en deux sens,
Et le grand syllogisme en forme régulière,
Et le sophisme vain de sa fausse lumière,
Des moines échauffés vrai fléau de docteurs,
De pauvres Hibernois complaisants disputeurs,
Qui fuyant leur pays pour les saintes promesses
Viennent vivre à Paris d'arguments et de messes;
Et l'honnête public qui même écoutant bien,
A la saine raison de n'y comprendre rien.
Voilà donc les leçons qu'on prend dans vos écoles!Mais tous les arguments sont-ils faux ou frivoles?
Socrate disputait jusque dans les festins,
Et tout nu quelquefois argumentait aux bains.
Etait-ce dans un sage une folle manie?
La contrariété fait sortir le génie.
La veine d'un caillou recèle un feu qui dort,
Image de ces gens, froids au premier abord;
Et qui dans la dispute, à chaque repartie
Sont pleins d'une chaleur qu'on n'avait point sentie.C'est un bien, j'y consens. Quant au mal le voici.
Plus on a disputé, moins on s'est éclairci.
On ne redresse point l'esprit faux ni l'oeil louche,
Ce mot j'ai tort , ce mot nous déchire la bouche.
Nos cris et nos efforts ne frappent que le vent,
Chacun dans son avis demeure comme avant.
C'est mêler seulement aux opinions vaines
Le tumulte insensé des passions humaines.
Le vrai peut quelquefois n'être point de saison;
Et c'est un très grand tort que d'avoir trop raison.Autrefois la justice et la vérité nues,
Chez les premiers humains furent longtemps connues;
Elles régnaient en soeurs: mais on sait que depuis
L'une a fui dans le ciel, et l'autre dans un puits.
La vaine opinion règne sur tous les âges,
Son temple est dans les airs porté sur les nuages,
Une foule de dieux, de démons, de lutins
Sont au pied de son trône; et tenant dans leurs mains
Mille riens enfantés par un pouvoir magique,
Nous les montrent de loin sous des verres d'optique.
Autour d'eux, nos vertus, nos biens, nos maux divers
En boules de savon sont épars dans les airs;
Et le souffle des vents y promène sans cesse
De climats en climats le temple et la déesse.
Elle fuit et revient. Elle place un mortel
Hier sur un bûcher, demain sur un autel.
Le jeune Antinoüs eut autrefois des prêtres.
Nous rions maintenant des moeurs de nos ancêtres;
Et qui rit de nos moeurs ne fait que prévenir
Ce qu'en doivent penser les siècles à venir.
Une beauté frappante et dont l'éclat étonne,
Les Français la peindront sous les traits de Brionne,
Sans croire qu'autrefois un petit front serré,
Un front à cheveux d'or fut toujours adoré;
Ainsi l'opinion changeante et vagabonde
Soumet la beauté même autre reine du monde.
Ainsi dans l'univers ses magiques effets
Des grands événements sont les ressorts secrets.
Comment donc espérer qu'un jour aux pieds d'un sage
Nous la voyons tomber du haut de son nuage,
Et que la vérité se montrant aussitôt
Vienne au bord de son puits voir ce qu'on fait en haut.Il est pour les savants et pour les sages même
Une autre illusion: cet esprit de système,
Qui bâtit en rêvant des mondes enchantés,
Et fonde mille erreurs sur quelques vérités.
C'est par lui qu'égarés après de vaines ombres
L'inventeur du calcul chercha Dieu dans les nombres,
L'auteur du mécanisme attacha follement
La liberté de l'homme aux lois du mouvement;
L'un du soleil éteint veut composer la terre,
‘La terre, dit un autre, est un globe de verre.' [47]
De là ces différends soutenus à grands cris
Et sur un tas poudreux d'inutiles écrits,
La dispute s'assied dans l'asile du sage.La contrariété tient souvent au langage;
On peut s'entendre moins, formant un même son,
Que si l'un parlait basque, et l'autre bas-breton.
C'est là, qui le croirait? un fléau redoutable;
Et la pâle famine, et la peste effroyable
N'égalent point les maux et les troubles divers
Que les malentendus sèment dans l'univers.Peindrai-je des dévots les discordes funestes,
Les saints emportements de ces âmes célestes,
Le fanatisme au meurtre excitant les humains,
Des poisons, des poignards, des flambeaux dans les mains,
Nos villages déserts, nos villes embrasées,
Sous nos foyers détruits nos mères écrasées,
Dans nos temples sanglants abandonnés du ciel,
Les ministres rivaux égorgés sur l'autel,
Tous les crimes unis, meurtre, inceste, pillage,
Les fureurs du plaisir se mêlant au carnage,
Sur des corps expirants d'infâmes ravisseurs
Dans leurs embrassements reconnaissant leurs soeurs,
L'étranger dévorant le sein de ma patrie,
Et sous la piété déguisant sa furie,
Les pères conduisant leurs enfants aux bourreaux,
Et les vaincus toujours traînés aux échafauds?. . .
Dieu puissant! permettez que ces temps déplorables,
Un jour par nos neveux soient mis au rang des fables.Mais je vois s'avancer un fâcheux disputeur,
Son air d'humilité couvre mal sa hauteur;
Et son austérité, pleine de l'Evangile,
Paraît offrir à Dieu le venin qu'il distille.
‘Monsieur, tout ceci cache un dangereux poison;
Personne, selon vous, n'a ni tort ni raison;
Et sur la vérité n'ayant point de mesure,
Il faut suivre pour loi l'instinct de la nature!'Monsieur, je n'ai pas dit un mot de tout cela. . .
‘Eh! quoique vous ayez déguisé ce sens-là,
En vous interprétant la chose devient claire.'. . .Mais en termes précis j'ai dit tout le contraire.
Cherchons la vérité; mais d'un commun accord,
Qui discute a raison, et qui dispute a tort.
Voilà ce que j'ai dit; et d'ailleurs qu'à la guerre,
A la ville, à la cour, souvent il faut se taire. . .
‘Mon cher monsieur, ceci cache toujours deux sens;
Je distingue. . .' Monsieur, distinguez, j'y consens.
J'ai dit mon sentiment, je vous laisse les vôtres,
En demandant pour moi ce que j'accorde aux autres. . .
‘Mon fils, nous vous avons défendu de penser;
Et pour vous convertir je cours vous dénoncer.'Heureux! ô trop heureux qui loin des fanatiques,
Des causeurs importuns et des jaloux critiques,
En paix sur l'Hélicon pourrait cueillir des fleurs!
Tels on voit dans les champs de sages laboureurs,
D'une ruche irritée évitant les blessures,
En dérober le miel à l'abri des piqûres.
DE LA DISTANCE. [p. 391] ↩
Un homme qui connaît combien on compte de pas d'un bout de sa maison à l'autre, s'imagine que la nature lui a enseigné tout-d'un-coup cette distance, & qu'il n'a eu besoin que d'un coup d'oeil comme lorsqu'il a vu des couleurs. Il se trompe; on ne peut connâitre le sdifférens éloignemens des objets que par expérience, par comparaison, par habitude. C'est ce qui fait qu'un matelot, en voyant sur mer un vaiffeau voguer loin du sien, vous dira sans hésiter à quelle distance on est à-peu-près de ce vaisseau; & le passager n'en poura former qu'un doute très confus.
La distance n'est qu'une ligne de l'objet à nous. Cette ligne se termine à un point; nous ne sentons donc que ce point; et soit que l'objet existe à mille lieues, ou qu'il soit à un pied, ce point est toujours le même dans nos yeux.
Nous n'avons donc aucun moyen immédiat pour apercevoir tout d'un coup la distance, comme nous en avons pour sentir par l'attouchement, si un corps est dur ou mou; par le goût, s'il est doux ou amer; par l'ouïe, si de deux sons l'un est grave et l'autre aigu. Car, qu'on y prenne bien garde, les parties d'un corps, qui cèdent à mon doigt, sont la plus prochaine cause de ma sensation de mollesse; et les vibrations de l'air, excitées par le corps sonore, sont la plus prochaine cause de ma sensation du son. Or si je ne puis avoir ainsi immédiatement une idée de distance, il faut donc que je connaisse cette distance par le moyen d'une autre idée intermédiaire; mais il faut au moins que j'aperçoive cette idée intermédiaire; car une idée que je n'aurai point, ne servira certainement pas à m'en faire avoir une autre.
On dit, qu'une telle maison est à un mille d'une telle rivière; mais si je ne sais pas où est cette rivière, je ne sais certainement pas où est cette maison. Un corps cède aisément à l'impression de ma main; je conclus immédiatement sa mollesse. Un autre résiste; je sens immédiatement sa dureté. Il faudrait donc que je sentisse les angles formés dans mon oeil, pour en conclure immédiatement les distances des objets. Mais la plupart des hommes ne savent pas même si ces angles existent: donc il est évident que ces angles ne peuvent être la cause immédiate de ce que vous connaissez les distances.
Celui qui, pour la première fois de sa vie, entendrait le bruit du canon, ou le son d'un concert, ne pourrait juger, si on tire ce canon, ou si on exécute ce concert, à une lieue, ou à trente pas. Il n'y a que l'expérience qui puisse l'accoutumer à juger de la distance qui est entre lui et l'endroit d'où part ce bruit. Les vibrations, les ondulations de l'air portent un son à ses oreilles, ou plutôt à son sensorium ; mais ce bruit n'avertit pas plus son sensorium de l'endroit où le bruit commence, qu'il ne lui apprend la forme du canon ou des instruments de musique. C'est la même chose précisément par rapport aux rayons de lumière qui partent d'un objet; ils ne nous apprennent point du tout où est cet objet.
Ils ne nous font pas connaître davantage les grandeurs, ni même les figures. Je vois de loin une petite tour ronde. J'avance, j'aperçois, et je touche un grand bâtiment quadrangulaire. Certainement ce que je vois, et ce que je touche, n'est pas ce que je voyais. Ce petit objet rond, qui était dans mes yeux, n'est point ce grand bâtiment carré. Autre chose est donc, par rapport à nous, l'objet mesurable et tangible, autre chose est l'objet visible. J'entends de ma chambre le bruit d'un carrosse: j'ouvre la fenêtre, et je le vois; je descends, et j'entre dedans. Or ce carrosse que j'ai entendu, ce carrosse que j'ai vu, ce carrosse que j'ai touché, sont trois objets absolument divers de trois de mes sens, qui n'ont aucun rapport immédiat les uns avec les autres.
Il y a bien plus: il est démontré qu'il se forme dans mon oeil un angle une fois plus grand, à très peu de chose près, quand je vois un homme à quatre pieds de moi, que quand je vois le même homme à huit pieds de moi. Cependant je vois toujours cet homme de la même grandeur. Comment mon sentiment contredit-il ainsi le mécanisme de mes organes? L'objet est réellement une fois plus petit dans mes yeux, et je le vois une fois plus grand. C'est en vain qu'on veut expliquer ce mystère par le chemin, ou par la forme que prend le cristallin dans nos yeux. Quelque supposition que l'on fasse, l'angle sous lequel je vois un homme à quatre pieds de moi, est toujours à peu près double de l'angle sous lequel je le vois à huit pieds. La géométrie ne résoudra jamais ce problème: la physique y est également impuissante; car vous avez beau supposer que l'oeil prend une nouvelle conformation, que le cristallin s'avance, que l'angle s'agrandit; tout cela s'opérera également pour l'objet qui est à huit pas, et pour l'objet qui est à quatre. La proportion sera toujours la même; si vous voyez l'objet à huit pas sous un angle de moitié plus grand, vous voyez aussi l'objet à quatre pas sous un angle de moitié plus grand ou environ. Donc ni la géométrie, ni la physique ne peuvent expliquer cette difficulté.
Ces lignes et ces angles géométriques ne sont pas plus réellement la cause de ce que nous voyons les objets à leur place, que de ce que nous les voyons de telles grandeurs, et à telle distance. L'âme ne considère pas si telle partie va se peindre au bas de l'oeil; elle ne rapporte rien à des lignes qu'elle ne voit point. L'oeil se baisse seulement, pour voir ce qui est près de la terre, et se relève pour voir ce qui est au-dessus de la terre. Tout cela ne pouvait être éclairci, et mis hors de toute contestation, que par quelque aveugle-né à qui on aurait donné le sens de la vue. Car si cet aveugle, au moment qu'il eût ouvert les yeux, eût jugé des distances, des grandeurs et des situations, il eût été vrai que les angles optiques, formés tout d'un coup dans sa rétine, eussent été les causes immédiates de ses sentiments. Aussi le docteur Berclay assurait, après M. Locke, (et allant même en cela plus loin que Locke) que ni situation, ni grandeur, ni distance, ni figure, ne serait aucunement discernée par cet aveugle, dont les yeux recevraient tout d'un coup la lumière.
On trouva enfin en 1729 l'aveugle-né, dont dépendait la décision indubitable de cette question. Le célèbre Cheselden, un de ces fameux chirurgiens qui joignent l'adresse de la main aux plus grandes lumières de l'esprit, ayant imaginé qu'on pouvait donner la vue à cet aveugle-né, en lui abaissant ce qu'on appelle des cataractes , qu'il soupçonnait formées dans ses yeux presque au moment de sa naissance, il proposa l'opération. L'aveugle eut de la peine à y consentir. Il ne concevait pas trop, que le sens de la vue pût beaucoup augmenter ses plaisirs. Sans l'envie qu'on lui inspira d'apprendre à lire et à écrire, il n'eût point désiré de voir. Il vérifiait par cette indifférence, qu'il est impossible d'être malheureux, par la privation des biens dont on n'a pas d'idée ; vérité bien importante. Quoi qu'il en soit, l'opération fut faite et réussit. Ce jeune homme d'environ quatorze ans vit la lumière pour la première fois. Son expérience confirma tout ce que Locke et Berclay avaient si bien prévu. Il ne distingua de longtemps ni grandeur, ni situation, ni même figure. Un objet d'un pouce, mis devant son oeil, et qui lui cachait une maison, lui paraissait aussi grand que la maison. Tout ce qu'il voyait lui semblait d'abord être sur ses yeux, et les toucher comme les objets du tact touchent la peau. Il ne pouvait distinguer d'abord ce qu'il avait jugé rond à l'aide de ses mains, d'avec ce qu'il avait jugé angulaire; ni discerner avec ses yeux, si ce que ses mains avaient senti être en haut ou en bas, était en effet en haut ou en bas. Il était si loin de connaître les grandeurs, qu'après avoir enfin conçu par la vue, que sa maison était plus grande que sa chambre, il ne concevait pas comment la vue pouvait donner cette idée. Ce ne fut qu'au bout de deux mois d'expérience, qu'il put apercevoir que les tableaux représentaient des corps saillants. Et lorsque après ce long tâtonnement d'un sens nouveau en lui, il eut senti que des corps, et non des surfaces seules, étaient peints dans les tableaux, il y porta la main, et fut étonné de ne point trouver avec ses mains ces corps solides, dont il commençait à apercevoir les représentations. Il demandait quel était le trompeur, du sens du toucher, ou du sens de la vue.
Ce fut donc une décision irrévocable, que la manière dont nous voyons les choses, n'est point du tout la suite immédiate des angles formés dans nos yeux. Car ces angles mathématiques étaient dans les yeux de cet homme, comme dans les nôtres; et ne lui servaient de rien sans le secours de l'expérience et des autres sens.
L'avanture de l'aveugle - né fut connue en France vers l'an 1735. L'auteur des Elémens de Newton , qui avait beaucoup vu Cheselden , fit mention de cette découverte importante; mais à peine y prit - on garde. Et même lorsqu'on fit ensuite à Paris la même opération de la cataracte sur un jeune homme qu'on prétendait privé de la vue dès son berceau, on négligea de suivre le développement journalier du sens de la vue en lui, & la marche de la nature. Le fruit de cette opération fut perdu pour les philosophes.
Comment nous représentons-nous donc les grandeurs, et les distances? De la même façon dont nous imaginons les passions des hommes, par les couleurs qu'elles peignent sur leurs visages, et par l'altération qu'elles portent dans leurs traits. Il n'y a personne, qui ne lise tout d'un coup sur le front d'un autre, la douleur, ou la colère. C'est la langue que la nature parle à tous les yeux; mais l'expérience seule apprend ce langage. Aussi l'expérience seule nous apprend, que quand un objet est trop loin, nous le voyons confusément et faiblement. De là nous formons des idées, qui ensuite accompagnent toujours la sensation de la vue. Ainsi tout homme qui, à dix pas, aura vu son cheval haut de cinq pieds, s'il voit, quelques minutes après, ce cheval gros comme un mouton, son âme, par un jugement involontaire, conclut à l'instant que ce cheval est très loin.
Il est bien vrai, que quand je vois mon cheval de la grosseur d'un mouton, il se forme alors dans mon oeil une peinture plus petite, un angle plus aigu; mais c'est là ce qui accompagne, non ce qui cause mon sentiment. De même il se fait un autre ébranlement dans mon cerveau, quand je vois un homme rougir de honte, que quand je le vois rougir de colère; mais ces différentes impressions ne m'apprendraient rien de ce qui se passe dans l'âme de cet homme, sans l'expérience, dont la voix seule se fait entendre.
Loin que cet angle soit la cause immédiate de ce que je juge qu'un grand cheval est très loin, quand je vois ce cheval fort petit; il arrive au contraire, à tous les moments, que je vois ce même cheval également grand, à dix pas, à vingt, à trente, à quarante pas, quoique l'angle à dix pas soit double, triple, quadruple. Je regarde de fort loin, par un petit trou, un homme posté sur un toit; le lointain et le peu de rayons m'empêchent d'abord de distinguer si c'est un homme: l'objet me paraît très petit, je crois voir une statue haute de deux pieds tout au plus: l'objet se remue, je juge que c'est un homme: et dès ce même instant cet homme me paraît de la grandeur ordinaire. D'où viennent ces deux jugements si différents? Quand j'ai cru voir une statue, je l'ai imaginée de deux pieds, parce que je la voyais sous un tel angle: nulle expérience ne pliait mon âme à démentir les traits imprimés dans ma rétine; mais dès que j'ai jugé que c'était un homme, la liaison mise par l'expérience dans mon cerveau, entre l'idée d'un homme et l'idée de la hauteur de cinq à six pieds, me force, sans que j'y pense, à imaginer, par un jugement soudain, que je vois un homme de telle hauteur, et à voir une telle hauteur en effet.
Il faut absolument conclure de tout ceci, que les distances, les grandeurs, les situations ne sont pas, à proprement parler, des choses visibles, c'est-à-dire, ne sont pas les objets propres et immédiats de la vue. L'objet propre et immédiat de la vue n'est autre chose que la lumière colorée; tout le reste, nous ne le sentons qu'à la longue et par expérience. Nous apprenons à voir, précisément comme nous apprenons à parler et à lire. La différence est, que l'art de voir est plus facile, et que la nature est également à tous notre maître.
Les jugements soudains, presque uniformes, que toutes nos âmes, à un certain âge, portent des distances, des grandeurs, des situations, nous font penser, qu'il n'y a qu'à ouvrir les yeux, pour voir de la manière dont nous voyons. On se trompe; il y faut le secours des autres sens. Si les hommes n'avaient que le sens de la vue, ils n'auraient aucun moyen pour connaître l'étendue en longueur, largeur et profondeur; et un pur esprit ne la connaîtrait pas peut-être, à moins que Dieu ne la lui révélât. Il est très difficile de séparer dans notre entendement l'extension d'un objet d'avec les couleurs de cet objet. Nous ne voyons jamais rien que d'étendu, et de là nous sommes tous portés à croire, que nous voyons en effet l'étendue. Nous ne pouvons guère distinguer dans notre âme ce jaune, que nous voyons dans un louis d'or, d'avec ce louis d'or dont nous voyons le jaune. C'est comme, lorsque nous entendons prononcer ce mot louis d'or , nous ne pouvons nous empêcher d'attacher malgré nous l'idée de cette monnaie au son que nous entendons prononcer.
Si tous les hommes parlaient la même langue, nous serions toujours prêts à croire qu'il y aurait une connexion nécessaire entre les mots et les idées. Or tous les hommes ont ici le même langage, en fait d'imagination. La nature leur dit à tous: Quand vous aurez vu des couleurs pendant un certain temps, votre imagination vous représentera à tous, de la même façon, les corps auxquels ces couleurs semblent attachées. Ce jugement prompt et involontaire que vous formerez, vous sera utile dans le cours de votre vie; car s'il fallait attendre, pour estimer les distances, les grandeurs, les situations, de tout ce qui vous environne, que vous eussiez examiné des angles et des rayons visuels, vous seriez morts avant que de savoir si les choses dont vous avez besoin sont à dix pas de vous, ou à cent millions de lieues, et si elles sont de la grosseur d'un ciron, ou d'une montagne. Il vaudrait beaucoup mieux pour vous être nés aveugles.
Nous avons donc peut-être grand tort, quand nous disons que nos sens nous trompent. Chacun de nos sens fait la fonction à laquelle la nature l'a destiné. Ils s'aident mutuellement, pour envoyer à notre âme, par les mains de l'expérience, la mesure des connaissances que notre être comporte. Nous demandons à nos sens ce qu'ils ne sont point faits pour nous donner. Nous voudrions que nos yeux nous fissent connaître la solidité, la grandeur, la distance, etc.; mais il faut que le toucher s'accorde en cela avec la vue, et que l'expérience les seconde. Si le père Mallebranche avait envisagé la nature par ce côté, il eût attribué peut-être moins d'erreurs à nos sens, qui sont les seules sources de toutes nos idées.
Il ne faut pas, sans doute, étendre à tous les cas cette espèce de métaphysique que nous venons de voir. Nous ne devons l'appeler au secours, que quand les mathématiques nous sont insuffisantes.
DIVORCE. [p. 397] ↩
Il est dit dans l'Encyclopédie à l'article Divorce , que l' usage du divorce ayant été porté dans les Gaules par les Romains, ce fut ainsi que Bissine ou Bazine quitta le roi de Thuringe son mari, pour suivre Childéric qui l'épousa . C'est comme si on disait que les Troyens ayant établi le divorce à Sparte, Hélène répudia Ménélas suivant la loi, pour s'en aller avec Pâris en Phrygie.
La fable agréable de Pâris, et la fable ridicule de Childéric qui n'a jamais été roi de France, et qu'on prétend avoir enlevé Bazine femme de Bazin, n'ont rien de commun avec la loi du divorce.
On cite encore Cherébert, régule de la petite ville de Lutèce près d'Issy, Lutetia Parisiorum , qui répudia sa femme. L'abbé Velly, dans son Histoire de France , dit que ce Chirebert, ou Caribert, répudia sa femme Ingoberge pour épouser Mirefleur fille d'un artisan, et ensuite Theudegilde fille d'un berger, qui fut élevée sur le premier trône de l'empire français .
Il n'y avait point alors ni premier, ni second trône chez ces barbares, que l'empire romain ne reconnut jamais pour rois. Il n'y avait point d'empire français .
L'empire des Francs ne commença que par Charlemagne. Il est fort douteux que le mot Mirefleur fût en usage dans la langue welche ou gauloise, qui était un patois du jargon celte. Ce patois n'avait pas des expressions si douces.
Il est dit encore que le réga, ou régule Chilpéric, seigneur de la province du Soissonnais, et qu'on appelle roi de France , fit un divorce avec la reine Andove ou Andovère; et voici la raison de ce divorce.
Cette Andovère après avoir donné au seigneur de Soissons trois enfants mâles, accoucha d'une fille. Les Francs étaient en quelque façon chrétiens depuis Clovis. Andovère étant relevée de couche présenta sa fille au baptême. Chilpéric de Soissons, qui apparemment était fort las d'elle, lui déclara que c'était un crime irrémissible d'être marraine de son enfant, qu'elle ne pouvait plus être sa femme par les lois de l'Eglise, et il épousa Frédégonde; après quoi il chassa Frédégonde, épousa une Visigothe, et puis reprit Frédégonde.
Tout cela n'a rien de bien légal, et ne doit pas plus être cité que ce qui se passait en Irlande et dans les îles Orcades.
Le code justinien que nous avons adopté en plusieurs points, autorise le divorce. Mais le droit canonique que les catholiques ont encore plus adopté, ne le permet pas.
L'auteur de l'article dit, que le divorce se pratique dans les Etats d'Allemagne de la confession d'Augsbourg .
On peut ajouter que cet usage est établi dans tous les pays du Nord, chez tous les réformés de toutes les confessions possibles, et dans toute l'Eglise grecque.
Le divorce est probablement de la même date à peu près que le mariage. Je crois pourtant que le mariage est de quelques semaines plus ancien, c'est-à-dire, qu'on se querella avec sa femme au bout de quinze jours, qu'on la battit au bout d'un mois, et qu'on s'en sépara après six semaines de cohabitation.
Justinien qui rassembla toutes les lois faites avant lui, auxquelles il ajouta les siennes, non seulement confirme celle du divorce, mais il lui donne encore plus d'étendue, au point que toute femme dont le mari était non pas esclave, mais simplement prisonnier de guerre pendant cinq ans, pouvait après les cinq ans révolus contracter un autre mariage.
Justinien était chrétien, et même théologien; comment donc arriva-t-il que l'Eglise dérogeât à ses lois? ce fut quand l'Eglise devint souveraine et législatrice. Les papes n'eurent pas de peine à substituer leurs décrétales au code dans l'Occident, plongé dans l'ignorance et dans la barbarie. Ils profitèrent tellement de la stupidité des hommes, qu'Honorius III, Grégoire IX, Innocent III, défendirent par leurs bulles qu'on enseignât le droit civil. On peut dire de cette hardiesse, Cela n'est pas croyable, mais cela est vrai.
Comme l'Eglise jugea seule du mariage, elle jugea seule du divorce. Point de prince qui ait fait un divorce, et qui ait épousé une seconde femme sans l'ordre du pape, avant Henri VIII roi d'Angleterre, qui ne se passa du pape qu'après avoir longtemps sollicité son procès en cour de Rome.
Cette coutume établie dans des temps d'ignorance, se perpétua dans les temps éclairés, par la seule raison qu'elle existait. Tout abus s'éternise de lui-même; c'est l'écurie d'Augias; il faut un Hercule pour la nettoyer.
Henri IV ne put être père d'un roi de France que par une sentence du pape: encore fallut-il, comme on l'a déjà remarqué, non pas prononcer un divorce, mais mentir en prononçant qu'il n'y avait point eu de mariage.
DOGMES. [p. 399] ↩
On sait que toute croyance enseignée par l'Eglise, est un dogme qu'il faut embrasser. Il est triste qu'il y ait des dogmes reçus par l'Eglise latine et rejetés par l'Eglise grecque. Mais si l'unanimité manque, la charité la remplace. C'est surtout entre les coeurs qu'il faudrait de la réunion.
Je crois que nous pouvons à ce propos rapporter un songe qui a déjà trouvé grâce devant quelques personnes pacifiques.
Le 18 février de l'an 1763 de l'ère vulgaire, le soleil entrant dans le signe des Poissons, je fus transporté au ciel, comme le savent tous mes amis. Ce ne fut point la jument Borak de Mahomet qui fut ma monture; ce ne fut point le char enflammé d'Elie qui fut ma voiture; je ne fus porté ni sur l'éléphant de Sammonocodom le Siamois, ni sur le cheval de St George patron de l'Angleterre, ni sur le cochon de St Antoine: j'avoue avec ingénuité que mon voyage se fit je ne sais comment.
On croira bien que je fus ébloui; mais ce qu'on ne croira pas, c'est que je vis juger tous les morts. Et qui étaient les juges? c'étaient, ne vous en déplaise, tous ceux qui ont fait du bien aux hommes, Confucius, Solon, Socrate, Titus, les Antonins, Epictète, Charon, de Thou, le chancelier de l'Hôpital; tous les grands hommes qui ayant enseigné et pratiqué les vertus que Dieu exige, semblaient seuls être en droit de prononcer ses arrêts.
Je ne dirai point sur quels trônes ils étaient assis, ni combien de millions d'êtres célestes étaient prosternés devant l'éternel architecte de tous les globes, ni quelle foule d'habitants de ces globes innombrables comparut devant les juges. Je ne rendrai compte ici que de quelques petites particularités tout à fait intéressantes dont je fus frappé.
Je remarquai que chaque mort qui plaidait sa cause et qui étalait ses beaux sentiments, avait à côté de lui tous les témoins de ses actions. Par exemple, quand le cardinal de Lorraine se vantait d'avoir fait adopter quelques-unes de ses opinions par le concile de Trente, et que pour prix de son orthodoxie il demandait la vie éternelle, tout aussitôt paraissaient autour de lui vingt courtisanes ou dames de la cour, portant toutes sur le front le nombre de leurs rendez-vous avec le cardinal. On voyait ceux qui avaient jeté avec lui les fondements de la Ligue; tous les complices de ses desseins pervers venaient l'environner.
Vis-à-vis du cardinal de Lorraine était Jean Chauvin, qui se vantait dans son patois grossier d'avoir donné des coups de pied à l'idole papale, après que d'autres l'avaient abattue. J'ai écrit contre la peinture et la sculpture, disait-il; j'ai fait voir évidemment que les bonnes oeuvres ne servent à rien du tout; et j'ai prouvé qu'il est diabolique de danser le menuet; chassez vite d'ici le cardinal de Lorraine, et placez-moi à côté de St Paul.
Comme il parlait, on vit auprès de lui un bûcher enflammé; un spectre épouvantable portant au cou une fraise espagnole à moitié brûlée, sortait du milieu des flammes avec des cris affreux: Monstre, s'écriait-il, monstre exécrable, tremble, reconnais ce Servet que tu as fait périr par le plus cruel des supplices, parce qu'il avait disputé contre toi sur la manière dont trois personnes peuvent faire une seule substance. Alors tous les juges ordonnèrent que le cardinal de Lorraine serait précipité dans l'abîme, mais que Calvin serait puni plus rigoureusement.
Je vis une foule prodigieuse de morts qui disaient, J'ai cru, j'ai cru; mais sur leur front il était écrit, J'ai fait; et ils étaient condamnés.
Le jésuite le Tellier paraissait fièrement la bulle Unigenitus à la main. Mais à ses côtés s'éleva tout d'un coup un monceau de deux mille lettres de cachet. Un janséniste y mit le feu, le Tellier fut brûlé jusqu'aux os, et le janséniste, qui n'avait pas moins cabalé que le jésuite, eut sa part de la brûlure.
Je voyais arriver à droite et à gauche des troupes de fakirs, de talapoins, de bonzes, de moines blancs, noirs et gris, qui s'étaient tous imaginés que pour faire leur cour à l'Etre suprême il fallait ou chanter, ou se fouetter, ou marcher tout nus. J'entendis une voix terrible qui leur demanda, Quel bien avez-vous fait aux hommes? A cette voix succéda un morne silence, aucun n'osa répondre, et ils furent tous conduits aux Petites-Maisons de l'univers; c'est un des plus grands bâtiments qu'on puisse imaginer.
L'un criait, c'est aux métamorphoses de Xaca qu'il faut croire; l'autre, c'est à celles de Sammonocodom; Bacchus arrêta le soleil et la lune, disait celui-ci; les dieux ressuscitèrent Pelops, disait celui-là. Voici la bulle in coena Domini , disait un nouveau venu, et l'huissier des juges criait, Aux Petites-Maisons, aux Petites-Maisons.
Quand tous ces procès furent vidés, j'entendis alors promulguer cet arrêt.
De par l'Eternel créateur,
Conservateur, rémunérateur,
Vengeur, pardonneur, etc. etc.
Soit notoire à tous les habitants des cent mille millions de milliards de mondes qu'il nous a plu de former, que nous ne jugerons jamais aucun desdits habitants sur leurs idées creuses, mais uniquement sur leurs actions, car telle est notre justice.
J'avoue que ce fut la première fois que j'entendis un tel édit; tous ceux que j'avais lus sur le petit grain de sable où je suis né, finissaient par ces mots; car tel est notre plaisir .
DONATIONS. [p. 402] ↩
La république romaine qui s'empara de tant d'Etats, en donna aussi quelques-uns.
Scipion fit Massinisse roi de Numidie.
Lucullus, Sylla, Pompée, donnèrent une demi-douzaine de royaumes.
Cléopâtre reçut l'Egypte de César. Antoine, et ensuite Octave, donnèrent le petit royaume de Judée à Hérode.
Sous Trajan on frappa la fameuse médaille, Regna assignata ; les royaumes accordés.
Des villes, des provinces données en souveraineté à des prêtres, à des collèges pour la plus grande gloire de Dieu, ou des dieux; c'est ce qu'on ne voit dans aucun pays.
Mahomet et les califes ses vicaires, prirent beaucoup d'Etats pour la propagation de leur foi; mais on ne leur fit aucune donation. Ils ne tenaient rien que de leur Alcoran et de leur sabre.
La religion chrétienne qui fut d'abord une société de pauvres, ne vécut longtemps que d'aumônes. La première donation est celle d'Anania et de Saphira sa femme. Elle fut en argent comptant, et ne réussit pas aux donateurs.
DONATION DE CONSTANTIN.
La célèbre donation de Rome et de toute l'Italie au pape Silvestre par l'empereur Constantin, fut soutenue comme une partie du symbole jusqu'au seizième siècle. Il fallait croire que Constantin étant à Nicomédie, fut guéri de la lèpre à Rome, par le baptême qu'il reçut de l'évêque Silvestre, (quoiqu'il ne fût point baptisé) et que pour récompense il donna sur-le-champ sa ville de Rome et toutes ses provinces occidentales à ce Silvestre. Si l'acte de cette donation avait été dressé par le docteur de la Comédie-Italienne, il n'aurait pas été plus plaisamment conçu. On ajoute que Constantin déclara tous les chanoines de Rome consuls et patrices; patricios et consules effici ; qu'il tint lui-même la bride de la haquenée sur laquelle monta le nouvel empereur évêque, tenentes frenum equi illius .
Quand on fait réflexion que cette belle histoire a été en Italie une espèce d'article de foi, et une opinion révérée du reste de l'Europe pendant huit siècles, qu'on a poursuivi comme des hérétiques ceux qui en doutaient, il ne faut plus s'étonner de rien.
DONATION DE PEPIN.
Aujourd'hui on n'excommunie plus personne pour avoir douté que Pépin l'usurpateur ait donné et pu donner au pape l'exarchat de Ravenne. C'est tout au plus une mauvaise pensée, un péché véniel qui n'entraîne point la perte du corps et de l'âme.
Voici ce qui pourrait excuser les jurisconsultes allemands qui ont des scrupules sur cette donation.
1 o . Le bibliothécaire Anastase dont le témoignage est toujours cité, écrivait cent quarante ans après l'événement.
2 o . Il n'était point vraisemblable que Pépin mal affermi en France, et à qui l'Aquitaine faisait la guerre, allât donner en Italie des Etats qu'il avouait appartenir à l'empereur résidant à Constantinople.
3 o . Le pape Zacharie reconnaissait l'empereur romain-grec pour souverain de ces terres disputées par les Lombards, et lui en avait prêté serment, comme il se voit par les lettres de cet évêque de Rome Zacharie à l'évêque de Mayence Boniface. Donc Pépin ne pouvait donner au pape les terres impériales.
4 o . Quand le pape Etienne II fit venir une lettre du ciel, écrite de la propre main de St Pierre à Pépin, pour se plaindre des vexations du roi des Lombards Astolphe, St Pierre ne dit point du tout dans sa lettre que Pépin eût fait présent de l'exarchat de Ravenne au pape; et certainement St Pierre n'y aurait pas manqué, pour peu que la chose eût été seulement équivoque; il entend trop bien ses intérêts.
5 o . Enfin, on ne vit jamais l'acte de cette donation; et ce qui est plus fort, on n'osa pas même en fabriquer un faux. Il n'est pour toute preuve que des récits vagues mêlés de fables. On n'a donc au lieu de certitude que des écrits de moines absurdes, copiés de siècle en siècle.
L'avocat italien qui écrivit en 1722, pour faire voir qu'originairement Parme et Plaisance avaient été concédés au Saint-Siège Page 120, seconde partie. comme une dépendance de l'exarchat, assure que les empereurs grecs furent justement dépouillés de leurs droits, parce qu'ils avaient soulevé les peuples contre Dieu . C'est de nos jours qu'on écrit ainsi! mais c'est à Rome. Le cardinal Bellarmin va plus loin; Les premiers chrétiens , dit-il, ne supportaient les empereurs que parce qu'ils n'étaient pas les plus forts . L'aveu est franc; et je suis persuadé que Bellarmin a raison.
DONATION DE CHARLEMAGNE.
Dans le temps que la cour de Rome croyait avoir besoin de titres, elle prétendit que Charlemagne avait confirmé la donation de l'exarchat, et qu'il y avait ajouté la Sicile, Venise, Bénévent, la Corse, la Sardaigne. Mais comme Charlemagne ne possédait aucun de ces Etats, il ne pouvait les donner; et quant à la ville de Ravenne, il est bien clair qu'il la garda, puisque dans son testament il fait un legs à sa ville de Ravenne , ainsi qu'à sa ville de Rome . C'est beaucoup que les papes aient eu Ravenne et la Romagne avec le temps. Mais pour Venise, il n'y a pas d'apparence qu'ils fassent valoir dans la place St Marc le diplôme qui leur en accorde la souveraineté.
On a disputé pendant des siècles sur tous ces actes, instruments, diplômes. Mais c'est une opinion constante, dit Giannone ce martyr de la vérité, que toutes ces pièces furent forgées du temps Lib. IX, cap. III. de Grégoire VII. E costante opinione presso i piu gravi scrittori che tutti questi istromenti e diplomi furono supposti ne' tempi d'Ildebrando .
DONATION DE BENEVENT PAR L'EMPEREUR HENRI III.
La première donation bien avérée qu'on ait faite au siège de Rome, fut celle de Bénévent; et ce fut un échange de l'empereur Henri III avec le pape Léon IX; il n'y manqua qu'une formalité, c'est qu'il eût fallu que l'empereur qui donnait Bénévent, en fût le maître. Elle appartenait aux ducs de Bénévent; et les empereurs romains-grecs réclaimaient leurs droits sur ce duché. Mais l'histoire n'est autre chose que la liste de ceux qui se sont accomodés du bien d'autrui.
DONATION DE LA COMTESSE MATHILDE.
La plus considérable des donations et la plus authentique, fut celle de tous les biens de la fameuse comtesse Mathilde à Grégoire VII. C'était une jeune veuve qui donnait tout à son directeur. Il passe pour constant que l'acte en fut réitéré deux fois, et ensuite confirmé par son testament.
Cependant, il reste encore quelque difficulté. On a toujours cru à Rome que Mathilde avait donné tous ses Etats, tous ses biens présents et à venir à son ami Grégoire VII, par un acte solennel dans son château de Canossa en 1077, pour le remède de son âme et de l'âme de ses parents. Et pour corroborer ce saint instrument, on nous en montre un second de l'an 1102, par lequel il est dit, que c'est à Rome qu'elle a fait cette donation, laquelle s'est égarée, et qu'elle la renouvelle, et toujours pour le remède de son âme.
Comment un acte si important était-il égaré? la cour romaine est-elle si négligente? comment cet instrument écrit à Canosse avait-il été écrit à Rome? que signifient ces contradictions? Tout ce qui est bien clair, c'est que l'âme des donataires se portait mieux que l'âme de la donatrice qui avait besoin pour se guérir de se dépouiller de tout en faveur de ses médecins.
Enfin, voilà donc en 1102 une souveraine réduite par un acte en forme à ne pouvoir pas disposer d'un arpent de terre; et depuis cet acte jusqu'à sa mort en 1115, on trouve encore des donations de terres considérables faites par cette même Mathilde à des chanoines et à des moines. Elle n'avait donc pas tout donné. Et enfin, cet acte de 1102 pourrait bien avoir été fait après sa mort par quelque habile homme.
La cour de Rome ajouta encore à tous ses droits le testament de Mathilde qui confirmait ses donations. Les papes ne produisirent jamais ce testament.
Il fallait encore savoir si cette riche comtesse avait pu disposer de ses biens, qui étaient la plupart des fiefs de l'empire.
L'empereur Henri V son héritier, s'empara de tout; ne reconnut ni testament, ni donations, ni fait, ni droit. Les papes en temporisant gagnèrent plus que les empereurs en usant de leur autorité, et avec le temps ces césars devinrent si faibles, qu'enfin les papes ont obtenu de la succession de Mathilde ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine de St Pierre .
DONATION DE LA SUZERAINETÉ DE NAPLES AUX PAPES.
Les gentilshommes normands qui furent les premiers instruments de la conquête de Naples et de Sicile, firent le plus bel exploit de chevalerie dont on ait jamais entendu parler. Quarante à cinquante hommes seulement, délivrent Salerne au moment qu'elle est prise par une armée de Sarasins. Sept autres gentilshommes normands, tous frères, suffisent pour chasser ces mêmes Sarasins de toute la contrée, et pour l'ôter à l'empereur grec qui les avait payés d'ingratitude. Il est bien naturel que les peuples dont ces héros avaient ranimé la valeur, s'accoutumassent à leur obéir par admiration et par reconnaissance.
Voilà les premiers droits à la couronne des deux Siciles. Les évêques de Rome ne pouvaient pas donner ces Etats en fief plus que le royaume de Boutan ou de Cachemire.
Ils ne pouvaient même en accorder l'investiture quand on la leur aurait demandée; car dans le temps de l'anarchie des fiefs, quand un seigneur voulait tenir son bien allodial en fief pour avoir une protection, il ne pouvait s'adresser qu'à son seigneur suzerain. Or certainement le pape n'était pas seigneur suzerain de Naples, de la Pouille, et de la Calabre.
On a beaucoup écrit sur cette vassalité prétendue, mais on n'a jamais remonté à la source. J'ose dire que c'est le défaut de presque tous les jurisconsultes, comme de tous les théologiens. Chacun tire bien ou mal, d'un principe reçu, les conséquences les plus favorables à son parti. Mais ce principe est-il vrai? Ce premier fait sur lequel ils s'appuient, est-il incontestable? C'est ce qu'ils se donnent bien de garde d'examiner. Ils ressemblent à nos anciens romanciers qui supposaient tous que Francus avait apporté en France le casque d'Hector. Ce casque était impénétrable sans doute: mais Hector en effet l'avait-il porté? Le lait de la vierge est aussi très respectable; mais vingt sacristies qui se vantent d'en posséder une roquille, la possèdent-ils en effet?
Les hommes de ce temps-là aussi méchants qu'imbéciles, ne s'effrayaient pas des plus grands crimes; et redoutaient une excommunication qui les rendait exécrables aux peuples encore plus méchants qu'eux, et beaucoup plus sots.
Robert Guiscard et Richard vainqueurs de la Pouille et de la Calabre, furent d'abord excommuniés par le pape Léon IX. Ils s'étaient déclarés vassaux de l'empire: mais l'empereur Henri III mécontent de ces feudataires conquérants, avait engagé Léon IX à lancer l'excommunication à la tête d'une armée d'Allemands. Les Normands qui ne craignaient point ces foudres comme les princes d'Italie les craignaient, battirent les Allemands et prirent le pape prisonnier. Mais pour empêcher désormais les empereurs et les papes de venir les troubler dans leurs possessions, ils offrirent leurs conquêtes à l'Eglise sous le nom d' oblata . C'est ainsi que l'Angleterre avait payé le denier de St Pierre , c'est ainsi que les premiers rois d'Espagne et de Portugal, en recouvrant leurs Etats contre les Sarasins, promirent à l'Eglise de Rome deux livres d'or par an. Ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ni le Portugal ne regardèrent jamais le pape comme leur seigneur suzerain.
Le duc Robert oblat de l'Eglise, ne fut pas non plus feudataire du pape; il ne pouvait pas l'être, puisque les papes n'étaient pas souverains de Rome. Cette ville alors était gouvernée par son sénat, et l'évêque n'avait que du crédit; le pape était à Rome précisément ce que l'électeur est à Cologne. Il y a une différence prodigieuse entre être oblat d'un saint et être feudataire d'un évêque.
Baronius, dans ses Actes, rapporte l'hommage prétendu fait par Robert duc de la Pouille et de la Calabre à Nicolas II; mais cette pièce est suspecte comme tant d'autres, on ne l'a jamais vue; elle n'a jamais été dans aucune archive. Robert s'intitula, Duc par la grâce de Dieu et de St Pierre . Mais certainement St Pierre ne lui avait rien donné, et n'était point roi de Rome.
Les autres papes, qui n'étaient pas plus rois que St Pierre, reçurent sans difficulté l'hommage de tous les princes qui se présentèrent pour régner à Naples, surtout quand ces princes furent les plus forts.
DONATION DE L'ANGLETERRE ET DE L'IRLANDE AUX PAPES, PAR LE ROI JEAN.
En 1213 le roi Jean, vulgairement nommé Jean sans terre , et plus justement sans vertu , étant excommunié, et voyant son royaume mis en interdit, le donna au pape Innocent III et à ses successeurs. Non contraint par aucune crainte, mais de mon plein gré et de l'avis de mes barons, pour la rémission de mes péchés contre Dieu et l'Eglise; je résigne l'Angleterre et l'Irlande à Dieu, à St Pierre, à St Paul et à monseigneur le pape Innocent et à ses successeurs dans la chaire apostolique .
Il se déclara feudataire lieutenant du pape; paya d'abord huit mille livres sterling comptant au légat Pandolphe; promit d'en payer mille tous les ans. Donna la première année d'avance au légat qui la foula aux pieds, et jura entre ses genoux qu'il se soumettait à tout perdre faute de payer à l'échéance.
Le plaisant de cette cérémonie fut que le légat s'en alla avec son argent, et oublia de lever l'excommunication.
EXAMEN DE LA VASSALITÉ DE NAPLES ET DE L'ANGLETERRE.
On demande laquelle vaut le mieux de la donation de Robert Guiscard, ou de celle de Jean sans Terre; tous deux avaient été excommuniés; tous deux donnaient leurs Etats à St Pierre, et n'en étaient plus que les fermiers. Si les barons anglais s'indignèrent du marché infâme de leur roi avec le pape et le cassèrent, les barons napolitains ont pu casser celui du duc Robert: et s'ils l'ont pu autrefois, ils le peuvent aujourd'hui.
De deux choses l'une; ou l'Angleterre et la Pouille étaient données au pape selon la loi de l'Eglise, ou selon la loi des fiefs, ou comme à un évêque, ou comme à un souverain. Comme à un évêque, c'était précisément contre la loi de Jésus-Christ qui défendit si souvent à ses disciples de rien prendre, et qui leur déclara que son royaume n'est point de ce monde.
Si comme à un souverain; c'était un crime de lèse-majesté impériale. Les Normands avaient déjà fait hommage à l'empereur. Ainsi nul droit spirituel, ni temporel n'appartenait aux papes dans cette affaire. Quand le principe est si vicieux, tous les effets le sont. Naples n'appartient donc pas plus au pape que l'Angleterre.
Il y a encore une autre façon de se pourvoir contre cet ancien marché, c'est le droit des gens plus fort que le droit des fiefs. Ce droit des gens ne veut pas qu'un souverain appartienne à un autre souverain; et la loi la plus ancienne est qu'on soit le maître chez soi, à moins qu'on ne soit le plus faible.
DES DONATIONS FAITES PAR LES PAPES.
Si on a donné des principautés aux évêques de Rome, ils en ont donné bien davantage. Il n'y a pas un seul trône en Europe dont ils n'aient fait présent. Dès qu'un prince avait conquis un pays, ou même voulait le conquérir, les papes le lui accordaient au nom de St Pierre. Quelquefois même ils firent les avances, et l'on peut dire qu'ils ont donné tous les royaumes excepté celui des cieux.
Peu de gens en France savent que Jules II donna les Etats du roi Louis XII à l'empereur Maximilien, qui ne put s'en mettre en possession; et l'on ne se souvient pas assez que Sixte-Quint, GrégoireXIV et Clément VIII furent prêts de faire une libéralité de la France à quiconque Philippe II aurait choisi pour le mari de sa fille Claire Eugénie.
Quant aux empereurs, il n'y en a pas un depuis Charlemagne, que la cour de Rome n'ait prétendu avoir nommé. C'est pourquoi Swift, dans son Conte du tonneau , dit, que milord Pierre devint tout à fait fou, et que Martin et Jean ses frères voulurent le faire enfermer par avis de parents. Nous ne rapportons cette témérité que comme un blasphème plaisant d'un prêtre anglais contre l'évêque de Rome.
Toutes ces donations disparaissent devant celle des Indes orientales et occidentales, dont Alexandre VI investit l'Espagne et le Portugal de sa pleine puissance et autorité divine: c'était donner presque toute le terre. Il pouvait donner de même les globes de Jupiter et de Saturne avec leurs satellites.
DONATIONS ENTRE PARTICULIERS.
Les donations des citoyens se traitent tout différemment. Les codes des nations sont convenus d'abord unanimement, que personne ne peut donner le bien d'autrui, de même que personne ne peut le prendre. C'est la loi des particuliers.
En France la jurisprudence fut incertaine sur cet object, comme sur presque tous les autres, jusqu'à l'année 1731, où l'équitable chancelier d'Aguesseau ayant conçu le dessein de rendre enfin la loi uniforme, ébaucha très faiblement ce grand ouvrage par l'édit sur les donations . Il est rédigé en quarante-sept articles. Mais en voulant rendre uniformes toutes les formalités concernant les donations, on excepta la Flandre de la loi générale; et en exceptant la Flandre on oublia l'Artois qui devrait jouir de la même exception; de sorte que six ans après la loi générale, on fut obligé d'en faire pour l'Artois une particulière.
On fit surtout ces nouveaux édits concernant les donations et les testaments, pour écarter tous les commentateurs qui embrouillent les lois; et on en a déjà fait dix commentaires.
Ce qu'on peut remarquer sur les donations, c'est qu'elles s'étendent beaucoup plus loin qu'aux particuliers à qui on fait un présent. Il faut payer pour chaque présent aux fermiers du domaine royal, droit de contrôle, droit d'insinuation, droit de centième denier, droit de deux sous pour livre, droit de huit sous pour livre.
De sorte que toutes les fois que vous donnez à un citoyen, vous êtes bien plus libéral que vous ne pensez. Vous avez le plaisir de contribuer à enrichir les fermiers généraux; mais cet argent ne sort point du royaume, comme celui qu'on paie à la cour de Rome.
LES SEPT DORMANTS. [p. 411] ↩
La fable imagina qu'un Epimènide avait dormi d'un somme pendant vingt-sept ans, et qu'à son réveil il fut tout étonné de trouver ses petits-enfants mariés qui lui demandaient son nom; ses amis morts, sa ville et les moeurs des habitants changées. C'était un beau champ à la critique, et un plaisant sujet de comédie. La légende a emprunté tous les traits de la fable, et les a grossis.
L'auteur de la Légende dorée ne fut pas le premier qui au treizième siècle, au lieu d'un dormeur nous en donna sept, et en fit bravement sept martyrs. Il avait pris cette édifiante histoire chez Grégoire de Tours, écrivain véridique qui l'avait prise chez Sigebert, qui l'avait prise chez Métaphraste, qui l'avait prise chez Nicéphore. C'est ainsi que la vérité arrive aux hommes de main en main.
Le révérend père Pierre Ribadeneira de la Compagnie de Jésus, enchérit encore sur la Légende dorée dans sa célèbre Fleur des saints , dont il est fait mention dans le Tartuffe de Molière. Elle fut traduite, augmentée et enrichie de tailles-douces par le révérend père Antoine Girard de la même société; rien n'y manque.
Quelques curieux seront peut-être bien aises de voir la prose du révérend père Girard, la voici.
‘Du temps de l'empereur Dèce, l'église reçut une furieuse et épouvantable bourrasque; entre les autres chrétiens l'on prit sept frères, jeunes, bien dispos et de bonne grâce, qui étaient enfants d'un chevalier d'Ephèse, et qui s'appelaient Maximien, Marie, Martinien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin. L'empereur leur ôta d'abord leurs ceintures dorées . . . ils se cachèrent dans une caverne; l'empereur en fit murer l'entrée pour les faire mourir de faim.'
Aussitôt ils s'endormirent tous sept, et ne se réveillèrent qu'après avoir dormi cent soixante et dix-sept ans.
Le père Girard loin de croire que ce soit un conte à dormir debout , en prouve l'authenticité par les arguments les plus démonstratifs: et quand on n'aurait d'autre preuve que les noms des sept assoupis, cela suffirait: on ne s'avise pas de donner des noms à des gens qui n'ont jamais existé. Les sept dormants ne pouvaient être ni trompés, ni trompeurs. Aussi ce n'est pas pour contester cette histoire que nous en parlons, mais seulement pour remarquer qu'il n'y a pas un seul événement fabuleux de l'antiquité qui n'ait été rectifié par les anciens légendaires. Toute l'histoire d'OEdipe, d'Hercule, de Thésée se trouve chez eux accomodée à leur manière. Ils ont peu inventé, mais ils ont beaucoup perfectionné.
J'avoue ingénument que je ne sais pas d'où Nicéphore avait tiré cette belle histoire. Je suppose que c'était de la tradition d'Ephèse; car la caverne des sept dormants, et la petite église qui leur est dédiée, subsistent encore. Les moins éveillés des pauvres Grecs y viennent faire leurs dévotions. Le chevalier Ricaut et plusieurs autres voyageurs anglais ont vu ces deux monuments; mais pour leurs dévotions, ils ne les y ont pas faites.
Terminons ce petit article par le raisonnement d'Abadie. Voilà des mémoriaux institués pour célébrer à jamais l'aventure des sept dormants. Aucun Grec n'en a jamais douté dans Ephèse; ces Grecs n'ont pu être abusés; ils n'ont pu abuser personne; donc l'histoire des sept dormants est incontestable.
DROIT. [p. 412] ↩
DROIT DES GENS, DROIT NATUREL, DROIT PUBLIC.
Je ne connais rien de mieux sur ce sujet que ces vers de l'Arioste au chant XLIV.
Fan lega oggi ré, papi, imperatori
Doman' saranno capitali nimici
Perche quella apparenza esteriori
Non hanno i cor' non banno gli animi tali
Che non guardando al torto piu che a dritto
Attendon' solamente al'lor profitto .
Rois, empereurs et successeurs de Pierre
Au nom de Dieu signent un beau traité;
Le lendemain ces gens se font la guerre.
Pourquoi cela? C'est que la piété,
La bonne foi ne les tourmente guère.
Et que malgré St Jacques et St Matthieu
Leur intérêt est leur unique dieu.
S'il n'y avait que deux hommes sur la terre, comment vivraient-ils ensemble? ils s'aideraient, se nuiraient, se caresseraient, se diraient des injures, se battraient, se réconcilieraient, ne pourraient vivre l'un sans l'autre, ni l'un avec l'autre. Ils feraient comme tous les hommes font aujourd'hui. Ils ont le don du raisonnement, oui; mais ils ont aussi le don de l'instinct, et ils sentiront, et ils raisonneront, et ils agiront toujours comme ils sont destinés par la nature.
Un Dieu n'est pas venu sur notre globe pour assembler le genre humain et pour lui dire, ‘J'ordonne aux nègres et aux Cafres d'aller tout nus et de manger des insectes.
‘J'ordonne aux Samoyèdes de se vêtir de peaux de rangifères et d'en manger la chair tout insipide qu'elle est, avec du poisson séché et puant, le tout sans sel. Les Tartares du Thibet croiront tout ce que leur dira le dalaï-lama; et les Japonais croiront tout ce que leur dira le dairi.
‘Les Arabes ne mangeront point de cochon, et les Vestphaliens ne se nourriront que de cochon.
‘Je vais tirer une ligne du mont Caucase à l'Egypte, et de l'Egypte au mont Atlas: tous ceux qui habiteront à l'orient de cette ligne pourront épouser plusieurs femmes, ceux qui seront à l'occident n'en auront qu'une.
‘Si vers le golfe Adriatique depuis Zara jusqu'à la Polesine, ou vers les marais du Rhin et de la Meuse, ou vers le mont Jura, ou même dans l'île d'Albion, ou chez les Sarmates, ou chez les Scandinaviens quelqu'un s'avise de vouloir rendre un seul homme despotique, ou de prétendre lui-même à l'être, qu'on lui coupe le cou au plus vite, en attendant que la destinée et moi nous en ayons autrement ordonné.
‘Si quelqu'un a l'insolence et la démence de vouloir établir ou rétablir une grande assemblée d'hommes libres sur le Mançanarès ou sur la Propontide, qu'il soit ou empalé ou tiré à quatre chevaux.
‘Quiconque produira ses comptes suivant une certaine règle d'arithmétique à Constantinople, au grand Caire, à Tafilet, à Deli, à Andrinople, sera sur-le-champ empâlé sans forme de procès; et quiconque osera compter suivant une autre règle à Rome, à Lisbonne, à Madrid, en Champagne, en Picardie et vers le Danube depuis Ulm jusqu'à Belgrade, sera brûlé dévotement pendant qu'on lui chantera des miserere .
‘Ce qui sera juste tout le long de la Loire sera injuste sur les bords de la Tamise: car mes lois sont universelles, etc. etc. etc.'
Il faut avouer que nous n'avons pas de preuve bien claire, pas même dans le Journal chrétien , ni dans la Clef du cabinet des princes qu'un Dieu soit venu sur la terre promulguer ce droit public. Il existe cependant; il est suivi à la lettre tel qu'on vient de l'énoncer; et on a compilé, compilé, compilé sur ce droit des nations de très beaux commentaires, qui n'ont jamais fait rendre un écu à ceux qui ont été ruinés par la guerre ou par des édits, ou par les commis des fermes.
Ces compilations ressemblent assez aux cas de conscience de Pontas. Voici un cas de loi à examiner: il est défendu de tuer. Tout meurtrier est puni, à moins qu'il n'ait tué en grande compagnie et au son des trompettes; c'est la règle.
Du temps qu'il y avait encore des anthropophages dans la forêt des Ardennes, un bon villageois rencontra un anthropophage qui emportait un enfant pour le manger. Le villageois ému de pitié, tua le mangeur d'enfants, et délivra le petit garçon qui s'enfuit aussitôt. Deux passants voient de loin le bonhomme, et l'accusent devant le prévôt d'avoir commis un meurtre sur le grand chemin. Le corps du délit était sous les yeux du juge, deux témoins parlaient, on devait payer cent écus au juge pour ses vacations; la loi était précise: le villageois fut pendu sur-le-champ pour avoir fait ce qu'auraient fait à sa place Hercule, Thésée, Roland et Amadis. Fallait-il pendre le prévôt qui avait suivi la loi à la lettre? Et que jugea-t-on à la grande audience? Pour résoudre mille cas de cette espèce on a fait mille volumes.
Tom. I, pag. 2. traduction de Barbeirac avec commentaires. Puffendorf établit d'abord des êtres moraux. Ce sont , dit-il, certains modes que les êtres intelligents attachent aux choses naturelles, ou aux mouvements physiques, en vue de diriger ou de restreindre la liberté des actions volontaires de l'homme pour mettre quelque ordre, quelque convenance et quelque beauté dans la vie humaine .
Ensuite pour donner des idées nettes aux Suédois et aux Page 6. Allemands du juste et de l'injuste, il remarque qu' il y a deux sortes d'espace, l'un à l'égard duquel on dit que les choses sont quelque part, par exemple ici, là; l'autre à l'égard duquel on dit qu'elles existent en un certain temps, par exemple aujourd'hui, hier, demain. Nous concevons aussi deux sortes d'états moraux, l'un qui marque quelque situation morale, et qui a quelque conformité avec le lieu naturel; l'autre qui désigne un certain temps en tant qu'il provient de là quelque effet moral, etc.
Page 16. Ce n'est pas tout; Puffendorf distingue très curieusement les modes moraux simples et les modes d'estimation, les qualités formelles et les qualités opératives. Les qualités formelles sont de simples attributs; mais les opératives doivent soigneusement se diviser en originales et en dérivées.
Et cependant Barbeirac a commenté ces belles choses, et on les enseigne dans des universités. On y est partagé entre Grotius et Puffendorf sur des questions de cette importance. Croyez-moi, lisez les Offices de Cicéron.
DROIT PUBLIC.
Seconde section.
Rien ne contribuera peut-être plus à rendre un esprit faux, obscur, confus, incertain, que la lecture de Grotius, de Puffendorf et de presque tous les commentaires sur le droit public.
Il ne faut jamais faire un mal dans l'espérance d'un bien, dit la vertu que personne n'écoute. Il est permis de faire la guerre à une puissance qui devient trop prépondérante, dit l' Esprit des lois .
Quand les droits doivent-ils être constatés par la prescription? Les publicistes appellent ici à leur secours le droit divin et le droit humain, les théologiens se mettent de la partie. Abraham, disent-ils, et sa sémence, avait droit sur le Canaan, car il y avait voyagé, et Dieu le lui avait donné dans une apparition. Mais nos sages maîtres, il y a cinq cent quarante-sept ans, selon la Vulgate, entre Abraham qui acheta un caveau dans le pays et Josué qui en saccagea une partie. N'importe, son droit était clair et net. Mais la prescription? ... point de prescription. Mais ce qui s'est passé autrefois en Palestine doit-il servir de règle à l'Allemagne et à l'Italie? ... Oui; car il l'a dit. Soit, messieurs, je ne dispute pas contre vous, Dieu m'en préserve.
Les descendants d'Attila s'établissent, à ce qu'on dit, en Hongrie. Dans quel temps les anciens habitants commencèrent-ils à être tenus en conscience d'être serfs des descendants d'Attila?
Nos docteurs qui ont écrit sur la guerre et la paix sont bien profonds; à les en croire tout appartient de droit au souverain pour lequel ils écrivent. Il n'a pu rien aliéner de son domaine. L'empereur doit posséder Rome, l'Italie et la France, (c'était l'opinion de Barthole) premièrement parce que l'empereur s'intitule roi des Romains ; secondement parce que l'archevêque de Cologne est chancelier d'Italie, et que l'archevêque de Trèves est chancelier des Gaules. De plus, l'empereur d'Allemagne porte un globe doré à son sacre; donc il est maître du globe de la terre.
A Rome il n'y a point de prêtre qui n'ait appris dans son cours de théologie que le pape doit être souverain du monde, attendu qu'il est écrit que Simon fils de Jone en Galilée, ayant surnom Pierre, on lui dit, Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée . On avait beau dire à GrégoireVII , Il ne s'agit que des âmes, il n'est question que du royaume céleste. Maudit damné, répondait-il, il s'agit du terrestre; et il vous damnait! et il vous faisait pendre, s'il pouvait.
Des esprits encore plus profonds fortifient cette raison par un argument sans réplique. Celui dont l'évêque de Rome se dit vicaire, a déclaré que son royaume n'est point de ce monde; donc ce monde doit appartenir au vicaire quand le maître y a renoncé. Qui doit l'emporter du genre humain ou des décrétales? Les décrétales sans difficulté.
On demande ensuite, s'il y a eu quelque justice à massacrer en Amérique dix ou douze millions d'hommes désarmés? On répond qu'il n'y a rien de plus juste et de plus saint, puisqu'ils n'étaient pas catholiques apostoliques et romains.
Il n'y a pas un siècle qu'il était toujours ordonné dans toutes les déclarations de guerre des princes chrétiens, de courre-sus à tous les sujets du prince à qui la guerre était signifiée par un héraut à cotte de mailles et à manches pendantes. Ainsi la signification une fois faite, si un Auvergnat rencontrait une Allemande il était tenu de la tuer, sauf à la violer avant ou après.
Voici une question fort épineuse dans les écoles: le ban et l'arrière-ban étant commandés pour aller tuer et se faire tuer sur la frontière, les Souabes étant persuadés que la guerre ordonnées était de la plus horrible injustice, devaient-ils marcher? quelques docteurs disaient oui; quelques justes disaient non; que disaient les politiques?
Quand on eut bien disputé sur ces grandes questions préliminaires, dont jamais aucun souverain ne s'est embarrassé ni ne s'embarrassera, il fallut discuter les droits respectifs de cinquante ou soixante familles, sur le comté d'Alost, sur la ville d'Orchies, sur le duché de Berg et de Juliers, sur le comté de Tournay, sur celui de Nice, sur toutes les frontières de toutes les provinces; et le plus faible perdit toujours sa cause.
On agita pendant cent ans si les ducs d'Orléans, Louis XII, François I e r , avaient droit au duché de Milan, en vertu du contrat de mariage de Valentine de Milan, petite-fille du bâtard d'un brave paysan nommé Jacob Muzio. Le procès fut jugé par la bataille de Pavie.
Les ducs de Savoie, de Lorraine, de Toscane, prétendirent aussi au Milanais; mais on a cru qu'il y avait dans le Frioul une famille de pauvres gentilshommes issue en droite ligne d'Albouin roi des Lombards, qui avait un droit bien antérieur.
Les publicistes ont fait de gros livres sur les droits au royaume de Jérusalem. Les Turcs n'en ont point fait; mais Jérusalem leur appartient, du moins jusqu'à présent dans l'année 1770; et Jérusalem n'est point un royaume.
DROIT CANONIQUE. [p. 418] ↩
IDÉE GÉNÉRALE DU DROIT CANONIQUE, PAR MR. BERTRAND CI-DEVANT PREMIER PASTEUR DE L'ÉGLISE DE BERNE.
Fausee idée du droit canon. NOUS NE PRÉTENDONS NI ADOPTER, NI CONTREDIRE SES PRINCIPES ; C'EST AU PUBLIC D'EN JUGER.
Le droit canonique ou canon est suivant les idées vulgaires, la jurisprudence ecclésiastique. C'est le recueil des canons, des règles des conciles, des décrets des papes, et des maximes des Pères.
Véritable idée du droit canon. Selon la raison, selon les droits des rois et des peuples, la jurisprudence ecclésiastique n'est et ne peut être que l'exposé des privilèges accordés aux ecclésiastiques par les souverains représentant la nation.
Source du véritable droit canon. S'il est deux autorités suprêmes, deux administrations qui aient leurs droits séparés, l'une fera sans cesse effort contre l'autre. Il en résultera nécessairement des chocs perpétuels, des guerres civiles, l'anarchie, la tyrannie, malheurs dont l'histoire nous présente l'affreux tableau.
Si un prêtre s'est fait souverain, si le dairi du Japon a été roi jusqu'à notre seizième siècle, si le dalaï-lama est souverain au Thibet, si Numa fut roi et pontife, si les califes furent les chefs de l'Etat et de la religion, si les papes règnent dans Rome, ce sont autant de preuves de ce que nous avançons; alors l'autorité n'est point divisée, il n'y a qu'une puissance. Les souverains de Russie et d'Angleterre président à la religion; l'unité essentielle de puissance est conservée.
La vraie religion ne peut établir l'indépendance du clergé. Toute religion est dans l'Etat, tout prêtre est dans la société civile; et tous les ecclésiastiques sont au nombre des sujets du souverain chez lequel ils exercent leur ministère. S'il était une religion qui établît quelque indépendance en faveur des ecclésiastiques, en les soustrayant à l'autorité souveraine et légitime, cette religion ne saurait venir de Dieu auteur de la société.
Tout ce qui regarde la religion et le clergé est soumis à l'autorité souveraine. Il est par là même de toute évidence que dans une religion, dont Dieu est représenté comme l'auteur, les fonctions des ministres, leurs personnes, leurs biens, leurs prétentions, la manière d'enseigner la morale, de prêcher le dogme, de célébrer les cérémonies, les peines spirituelles, que tout en un mot ce qui intéresse l'ordre civil doit être soumis à l'autorité du prince et à l'inspection des magistrats.
Si cette jurisprudence fait une science, on en trouvera ici les éléments.
L'enseignement du droit canon soumis à l'inspection publique. C'est aux magistrats seuls d'autoriser les livres admissibles dans les écoles, selon la nature et la forme du gouvernement. C'est ainsi que M. Paul-Joseph Rieger, conseiller de cour, enseigne judicieusement le droit canonique dans l'université de Vienne. Ainsi nous voyons la république de Venise examiner et réformer toutes les règles établies dans ses Etats, qui ne lui conviennent plus. Il est à désirer que des exemples aussi sages soient enfin suivis dans toute la terre.
SECTION PREMIÈRE.
Du ministère ecclésiastique.
Idée de la religion. La religion n'est instituée que pour maintenir les hommes dans l'ordre, et leur faire mériter les bontés de Dieu par la vertu. Tout ce qui dans une religion ne tend pas à ce but, doit être regardé comme étranger, ou dangereux.
Moyens qu'ils doivent employer. L'instruction, les exhortations, les menaces des peines à venir, les promesses d'une béatitude immortelle, les prières, les conseils, les secours spirituels sont les seuls moyens que les ecclésiastiques puissent mettre en usage pour essayer de rendre les hommes vertueux ici-bas et heureux pour l'éternité.
La religion exclut toute contrainte. Tout autre moyen répugne à la liberté de la raison, à la nature de l'âme, aux droits inaltérables de sa conscience, à l'essence de la religion, à celle du ministère ecclésiastique, à tous les droits du souverain.
La vertu suppose la liberté comme le transport d'un fardeau suppose la force active. Dans la contrainte point de vertu, et sans vertu point de religion. Rends-moi esclave, je n'en serai pas meilleur.
Le souverain même n'a aucun droit d'employer la contrainte pour amener les hommes à la religion qui suppose essentiellement choix et liberté. Ma pensée n'est pas plus soumise à l'autorité que la maladie ou la santé.
Afin de démêler toutes les contradictions dont on a rempli les livres sur le droit canonique, et de fixer nos idées sur le ministère ecclésiastique, recherchons au milieu de mille équivoques ce que c'est que l'Eglise.
Ce que c'est que l'Eglise. L'Eglise est l'assemblée de tous les fidèles appelés certains jours à prier en commun, et à faire en tout temps de bonnes actions.
Ce que c'est qu'un ecclésiastique. 1 re conséquence. 2 de conséquence. Les prêtres sont des personnes établies sous l'autorité du souverain pour diriger ces prières et tout le culte religieux.
Une Eglise nombreuse ne saurait être sans ecclésiastiques; mais ces ecclésiastiques ne sont pas l'Eglise.
Il n'est pas moins évident que si les ecclésiastiques qui sont dans la société civile avaient acquis des droits qui allassent à troubler ou à détruire la société, ces droits doivent être supprimés.
3 me conséquence. Il est encore de la plus grande évidence que si Dieu a attaché à l'Eglise des prérogatives ou des droits, ces droits ni ces prérogatives ne sauraient appartenir privativement ni au chef de l'Eglise, ni aux ecclésiastiques, parce qu'ils ne sont pas l'Eglise, comme les magistrats ne sont le souverain ni dans un Etat démocratique, ni dans une monarchie.
4 me conséquence. Enfin, il est très évident que ce sont nos âmes qui sont soumises aux soins du clergé, uniquement pour les choses spirituelles.
Notre âme agit intérieurement, ses actes sont la pensée, les volontés, les inclinations, l'acquiescement à certaines vérités. Tous ces actes sont au-dessus de toute contrainte, et ne sont du ressort du ministère ecclésiastique qu'autant qu'il doit instruire et jamais commander.
5 me conséquence. Cette âme agit aussi extérieurement. Les actions extérieures sont soumises à la loi civile. Ici la contrainte peut avoir lieu; les peines temporelles ou corporelles maintiennent la loi en punissant les violateurs.
La docilité à l'ordre ecclésiastique doit par conséquent toujours être libre et volontaire; il ne saurait y en avoir d'autre. La soumission au contraire à l'ordre civil peut être contrainte et forcée.
6 me conséquence. Par la même raison, les peines ecclésiastiques toujours spirituelles, n'atteignent ici-bas que celui qui est intérieurement convaincu de sa faute. Les peines civiles au contraire accompagnées d'un mal physique ont leurs effets physiques, soit que le coupable en reconnaisse la justice ou non.
De là il résulte manifestement que l'autorité du clergé n'est et ne peut être que spirituelle; qu'il ne saurait avoir aucun pouvoir temporel; qu'aucune force coactive ne convient à son ministère qui en serait détruit.
7 me conséquence. Il suit encore de là que le souverain attentif à ne souffrir aucun partage de son autorité, ne doit permettre aucune entreprise qui mette les membres de la société dans une dépendance extérieure et civile d'un corps ecclésiastique.
Tels sont les principes incontestables du véritable droit canonique, dont les règles et les décisions doivent en tout temps être jugés d'après ces vérités éternelles et immuables, fondées sur le droit naturel et l'ordre nécessaire de la société.
SECTION SECONDE.
Des possessions des ecclésiastiques.
Remontons toujours aux principes de la société, qui dans l'ordre civil comme dans l'ordre religieux, sont les fondements de tous droits.
Principe sur la propriété. La société en général est propriétaire du territoire d'un pays, source de la richesse nationale. Une portion de ce revenu national est attribuée au souverain pour soutenir les dépenses de l'administration. Chaque particulier est possesseur de la partie du territoire et du revenu que les lois lui assurent; et aucune possession, ni aucune jouissance ne peut en aucun temps être soustraite à l'autorité de la loi.
Nous ne possédons pas par le droit de la nature. Dans l'état de société nous ne tenons aucun bien, aucune possession de la seule nature, puisque nous avons renoncé aux droits naturels pour nous soumettre à l'ordre civil qui nous garantit et nous protège; c'est de la loi que nous tenons toutes nos possessions.
Ni par la religion. Personne non plus ne peut rien tenir sur la terre de la religion; ni domaine, ni possessions, puisque ses biens sont tous spirituels. Les possessions du fidèle comme véritable membre de l'Eglise, sont dans le ciel; là est son trésor. Le royaume de Jésus-Christ qu'il annonça toujours comme prochain, n'était et ne pouvait être de ce monde. Aucune possession ne peut donc être de droit divin.
Sous la loi de Moïse. Les lévites sous la loi hébraïque, avaient, il est vrai, la dîme par une loi positive de Dieu; mais c'était une théocratie qui n'existe plus; et Dieu agissait comme le souverain de la terre. Toutes ces lois ont cessé, et ne sauraient être aujourd'hui un titre de possession.
Aucune possession n'est de droit divin. Si quelque corps aujourd'hui, comme celui des ecclésiastiques, prétend posséder la dîme ou tout autre bien, de droit divin positif, il faut qu'il produise un titre enregistré dans une révélation divine, expresse et incontestable. Ce titre miraculeux ferait, j'en conviens, exception à la loi civile, autorisée de Dieu, qui dit, que toute personne doit être soumise aux puissances supérieures, parce qu'elles sont ordonnées de Dieu, et établies en son nom .
Mais par la loi civile. Au défaut d'un titre pareil, un corps ecclésiastique quelconque ne peut donc jouir sur la terre que du consentement du souverain, et sous l'autorité des lois civiles: ce sera là le seul titre de ses possessions. Si le clergé renonçait imprudemment à ce titre, il n'en aurait plus aucun; et il pourrait être dépouillé par quiconque aurait assez de puissance pour l'entreprendre. Son intérêt essentiel est donc de dépendre de la société civile qui seule lui donne du pain.
Tous les biens soumis aux charges publiques. Par la même raison, puisque tous les biens du territoire d'une nation sont soumis sans exception aux charges publiques pour les dépenses du souverain et de la nation, aucune possession ne peut être exemptée que par la loi; et cette loi même est toujours révocable lorsque les circonstances viennent à changer. Pierre ne peut être exempté que la charge de Jean ne soit augumentée. Ainsi l'équité réclamant sans cesse pour la proportion contre toute surcharge, le souverain est à chaque instant en droit d'examiner les exemptions, et de remettre les choses dans l'ordre naturel et proportionnel, en abolissant les immunités accordées, souffertes ou extorquées.
Loi injuste. Toute loi qui ordonnerait que le souverain fît tout aux frais du public pour la sûreté et la conservation des biens d'un particulier ou d'un corps, sans que ce corps ou ce particulier contribuât aux charges communes, serait une subversion des lois.
Le magistrat doit avoir un état des biens ecclésiastiques. Je dis plus, la quotité quelconque de la contribution d'un particulier, ou d'un corps quelconque, doit être réglée proportionnellement, non par lui, mais par le souverain ou les magistrats, selon la loi et la forme générale. Ainsi le souverain doit connaître, et peut demander un état des biens et des possessions de tout corps, comme de tout particulier.
C'est donc encore dans ces principes immuables que doivent être puisées les règles du droit canonique, par rapport aux possessions et aux revenus du clergé.
L'Eglise n'a point de biens temporels. Les ecclésiastiques doivent sans doute avoir de quoi vivre honorablement; mais ce n'est ni comme membres, ni comme représentants de l'Eglise; car l'Eglise par elle-même n'a ni règne ni possession sur cette terre.
Mais s'il est de la justice que les ministres de l'autel vivent de l'autel, il est naturel qu'ils soient entretenus par la société, tout comme les magistrats et les soldats le sont. C'est donc à la loi civile à faire la pension proportionnelle du corps ecclésiastique.
Biens donnés au clergé. Lors même que les possessions des ecclésiastiques leur ont été données par testament, ou de quelque autre manière, les donateurs n'ont pu dénaturer les biens en les soustrayant aux charges publiques, ou à l'autorité des lois. C'est toujours sous la garantie des lois, sans lesquelles il ne saurait y avoir possession assurée et légitime, qu'ils en jouiront.
C'est donc encore au souverain ou aux magistrats en son nom, à examiner en tout temps si les revenus ecclésiastiques sont suffisants; s'ils ne l'étaient pas, ils doivent y pourvoir par des augmentations de pensions; mais s'ils étaient manifestement excessifs, c'est à eux à disposer du superflu pour le bien commun de la société.
Les biens ecclésiastiqus sont-ils sacrés? Mais, selon les principes du droit vulgairement appelé canonique , qui a cherché à faire un Etat dans l'Etat, un empire dans l'empire, les biens ecclésiastiques sont sacrés et intangibles, parce qu'ils appartiennent à la religion et à l'Eglise; ils viennent de Dieu et non des hommes.
D'abord, ils ne sauraient appartenir, ces biens terrestres, à la religion qui n'a rien de temporel. Ils ne sont pas à l'Eglise qui est le corps universel de tous les fidèles, à l'église qui renferme les rois, les magistrats, les soldats, tous les sujets; car nous ne devons jamais oublier que les ecclésiastiques ne sont pas plus l'Eglise que les magistrats ne sont l'Etat.
Enfin, ces biens ne viennent de Dieu, que comme tous les autres biens en dérivent, parce que tout est soumis à sa providence.
Ainsi, tout ecclésiastique possesseur d'un bien ou d'une rente, en jouit comme sujet et citoyen de l'Etat, sous la protection unique de la loi civile.
Un bien qui est quelque chose de matériel et de temporel, ne saurait être sacré ni saint, dans aucun sens, ni au propre, ni au figuré. Si l'on dit qu'une personne, un édifice sont sacrés, cela signifie qu'ils sont consacrés, employés à des usages spirituels.
Abuser d'une métaphore pour autoriser des droits et des prétentions destructives de toute société, c'est une entreprise dont l'histoire de la religion fournit plus d'un exemple, et même des exemples bien singuliers qui ne sont pas ici de mon ressort.
SECTION TROISIÉME.
Des assemblées ecclésiastiques ou religieuses.
Ce qui fait la légitimité des assemblées. Il est certain qu'aucun corps ne peut former dans l'Etat aucune assemblée publique et régulière, que du consentement du souverain.
Les assemblées religieuses pour le culte doivent être autorisées par le souverain dans l'ordre civil, afin qu'elles soient légitimes.
Exemple de la Hollande. En Hollande, où le souverain accorde à cet égard la plus grande liberté, de même à peu près qu'en Russie, en Angleterre, en Prusse, ceux qui veulent former une Eglise doivent en obtenir la permission: dès lors cette Eglise est dans l'Etat, quoiqu'elle ne soit pas la religion de l'Etat. En général, dès qu'il y a un nombre suffisant de personnes ou de familles qui veulent avoir un certain culte et des assemblées, elles peuvent sans doute en demander la permission au magistrat souverain; et c'est à ce magistrat à en juger. Ce culte une fois autorisé, on ne peut le troubler sans pécher contre l'ordre public. La facilité que le souverain a eue en Hollande d'accorder ces permissions, n'entraîne aucun désordre; et il en serait ainsi partout, si le magistrat seul examinait, jugeait et protégeait.
Inspection sur ces assemblées. Le souverain a le droit en tout temps de savoir ce qui se passe dans les assemblées, de les diriger selon l'ordre public, d'en réformer les abus, et d'abroger les assemblées s'il en naissait des désordres. Cette inspection perpétuelle est une portion essentielle de l'administration souveraine que toute religion doit reconnaître.
Sur les formulaires. S'il y a dans le culte des formulaires de prières, des cantiques, des cérémonies, tout doit être soumis de même à l'inspection du magistrat. Les ecclésiastiques peuvent composer ces formulaires; mais c'est au souverain à les examiner, à les approuver, à les réformer au besoin. On a vu des guerres sanglantes pour des formulaires, et elles n'auraient pas eu lieu si les souverains avaient mieux connu leurs droits.
Sur les fêtes. Les jours de fêtes ne peuvent pas non plus être établis sans le concours et le consentement du souverain, qui en tout temps peut les réformer, les abolir, les réunir, en régler la célébration selon que le public le demande. La multiplication de ces jours de fêtes fera toujours la dépravation des moeurs, et l'appauvrissement d'une nation.
Sur l'instruction publique. L'inspection sur l'instruction publique de vive voix, ou par des livres de dévotion, appartient de droit au souverain. Ce n'est pas lui qui enseigne, mais c'est à lui à voir comment sont enseignés ses sujets. Il doit faire enseigner surtout la morale, qui est aussi nécessaire que les disputes sur le dogme ont été souvent dangereuses.
Sur les disputes. S'il y a quelque dispute entre les ecclésiastiques sur la manière d'enseigner, ou sur certains points de doctrine, le souverain peut imposer silence aux deux partis, et punir ceux qui désobéissent.
Sur les prédications. Comme les assemblées religieuses ne sont point établies sous l'autorité souveraine pour y traiter des matières politiques, les magistrats doivent réprimer les prédicateurs séditieux qui échauffent la multitude par des déclamations punissables; ils sont la peste des Etats.
Sur la discipline. Tout culte suppose une discipline pour y conserver l'ordre, l'uniformité et la décence. C'est au magistrat à maintenir cette discipline, et à y apporter les changements que le temps et les circonstances peuvent exiger.
Sur les conciles. Pendant près de huit siècles, les empereurs d'Orient assemblèrent des conciles pour apaiser des troubles qui ne firent qu'augmenter, par la trop grande attention qu'on y apporta. Le mépris aurait plus sûrement fait tomber des vaines disputes que les passions avaient allumées. Depuis le partage des Etats d'Occident en divers royaumes, les princes ont laissé aux papes la convocation de ces assemblées. Les droits du pontife de Rome ne sont à cet égard que conventionnels, et tous les souverains réunis peuvent en tout temps en décider autrement. Aucun d'eux en particulier n'est obligé de soumettre ses Etats à aucun canon, sans l'avoir examiné et approuvé. Mais comme le concile de Trente sera apparemment le dernier, il est très inutile d'agiter toutes les questions qui pourraient regarder un concile futur et général.
Sur les synodes. Quant aux assemblées, ou synodes, ou conciles nationaux, ils ne peuvent sans contredit être convoqués que quand le souverain les juge nécessaires; ses commissaires doivent y présider, et en diriger toutes les délibérations, et c'est à lui à donner la sanction aux décrets.
Sur les assemblées périodiques. Il peut y avoir des assemblées périodiques du clergé pour le maintien de l'ordre et sous l'autorité du souverain; mais la puissance civile doit toujours en déterminer les vues, en diriger les délibérations, et en faire exécuter les décisions. L'assemblée periodique du clergé de France, n'est autre chose qu'une assemblée de commissaires économiques pour tout le clergé du royaume.
Sur les voeux. Les voeux par lesquels s'obligent quelques ecclésiastiques de vivre en corps selon une certaine règle, sous le nom de moines ou de religieux , si prodigieusement multipliés dans l'Europe; ces voeux doivent aussi être toujours soumis à l'examen et à l'inspection des magistrats souverains. Ces couvents qui renferment tant de gens inutiles à la société, et tant de victimes qui regrettent la liberté qu'ils ont perdue, ces ordres qui portent tant de noms si bizarres, ne peuvent être établis dans un pays, et tous leurs voeux ne peuvent être valables, ou obligatoires, que quand ils ont été examinés et approuvés au nom du souverain.
Sur les couvents. En tout temps le prince est donc en droit de prendre connaissance des règles de ces maisons religieuses, de leur conduite: il peut réformer ces maisons et les abolir s'il les juge incompatibles avec les circonstances présentes, et le bien actuel de la société.
Sur les biens des moines. Les biens et les acquisitions de ces corps religieux sont de même soumis à l'inspection des magistrats pour en connaître la valeur et l'emploi. Si la masse de ces richesses qui ne circulent plus était trop forte, si les revenus excédaient trop les besoins raisonnables de ces réguliers, si l'emploi de ces rentes était contraire au bien général, si cette accumulation appauvrissait les autres citoyens, dans tous ces cas il serait du devoir des magistrats, pères communs de la patrie, de diminuer ces richesses, de les partager, de les faire rentrer dans la circulation qui fait la vie d'un Etat, de les employer même à d'autres usages pour le bien de la société.
Sur leurs règles spirituelles. Par les mêmes principes le souverain doit expressément défendre qu'aucun ordre religieux ait un supérieur dans le pays étranger, c'est presque un crime de lèse-majesté.
Sur l'admission dans les ordres. Le souverain peut prescrire les règles pour entrer dans ces ordres; il peut, selon les anciens usages, fixer un âge, et empêcher que l'on ne fasse des voeux que du consentement exprès des magistrats. Chaque citoyen naît sujet de l'Etat, et il n'a pas le droit de rompre des engagements naturels envers la société sans l'aveu de ceux qui la gouvernent.
De la dissolution d'un ordre. Si le souverain abolit un ordre religieux, ces voeux cessent d'être obligatoires. Le premier voeu est d'être citoyen; c'est un serment primordial et tacite, autorisé de Dieu, un voeu dans l'ordre de la providence, un voeu inaltérable et imprescriptible qui unit l'homme en société avec la patrie et avec le souverain. Si nous avons pris un engagement postérieur, le voeu primitif a été réservé; rien n'a pu énerver ni suspendre la force de ce serment primitif. Si donc le souverain déclare ce dernier voeu, qui n'a pu être que conditionnel et dépendant du premier, incompatible avec le serment naturel; s'il trouve ce dernier voeu dangereux dans la société, et contraire au bien public qui est la suprême loi, tous sont dès lors déliés en conscience de ce voeu; pourquoi? parce que la conscience les attachait primitivement au serment naturel, et au souverain. Le souverain dans ce cas ne dissout point un voeu; il le déclare nul, il remet l'homme dans l'état naturel.
En voilà assez pour dissiper tous les sophismes par lesquels les canonistes ont cherché à embarrasser cette question si simple pour quiconque ne veut écouter que la raison.
SECTION QUATRIÉME.
Des peines ecclésiastiques.
Peines spirituelles. Puisque ni l'Eglise qui est l'assemblée de tous les fidèles, ni les ecclésiastiques qui sont ministres dans cette Eglise au nom du souverain et sous son autorité, n'ont aucune force coactive, aucune puissance exécutrice, aucun pouvoir terrestre, il est évident que ces ministres de la religion ne peuvent infliger que des peines uniquement spirituelles. Menacer les pécheurs de la colère du ciel, c'est la seule peine dont un pasteur peut faire usage. Si l'on ne veut pas donner le nom de peines à ces censures, ou à ces déclamations, les ministres de la religion n'auront aucune peine à infliger.
De l'excommunication. L'Eglise peut-elle bannir de son sein ceux qui la déshonorent ou la troublent? Grande question sur laquelle les canonistes n'ont point hésité de prendre l'affirmative. Observons d'abord que les ecclésiastiques ne sont pas l'Eglise. L'Eglise assemblée dans laquelle sont les magistrats souverains, pourrait sans doute de droit, exclure de ses congrégations un pécheur scandaleux, après des avertissements charitables, réitérés et suffisants. Cette exclusion ne peut dans ce cas même emporter aucune peine civile, aucun mal corporel, ni la privation d'aucun avantage terrestre. Mais ce que peut l'Eglise de droit, les ecclésiastiques qui sont dans l'Eglise ne le peuvent qu'autant que le souverain les y autorise et le leur permet.
C'est donc encore même dans ce cas au souverain à veiller sur la manière donc ce droit sera exercé; vigilance d'autant plus nécessaire qu'il est plus aisé d'abuser de cette discipline. C'est par conséquent à lui, en consultant les règles du support et de la charité, à prescrire les formes et les restrictions convenables: sans cela, toute déclaration du clergé, toute excommunication serait nulle et sans effet, même dans l'ordre spirituel. C'est confondre des cas entièrement différents que de conclure de la pratique des apôtres la manière de procéder aujourd'hui. Le souverain n'était pas de la religion des apôtres, l'Eglise n'était pas encore dans l'Etat; les ministres du culte ne pouvaient pas recourir au magistrat. D'ailleurs, les apôtres étaient des ministres extraordinaires tels qu'on n'en voit plus. Si l'on me cite d'autres exemples d'excommunications lancées sans l'autorité du souverain, que dis-je, si l'on rappelle ce que l'on ne peut entendre sans frémir d'horreur, des exemples mêmes d'excommunications fulminées insolemment contre des souverains et des magistrats, je répondrai hardiment que ces attentats sont une rébellion manifeste, une violation ouverte des devoirs les plus sacrés de la religion, de la charité, et du droit naturel.
L'excommunication appartient privativement à l'Eglise. On voit donc évidemment que c'est au nom de toute l'Eglise que l'excommunication doit être prononcée contre les pécheurs publics, puisqu'il s'agit seulement de l'exclusion de ce corps; ainsi elle doit être prononcée par les ecclésiastiques sous l'autorité des magistrats et au nom de l'Eglise, pour les seuls cas dans lesquels on peut présumer que l'Eglise entière bien instruite la prononcerait, si elle pouvait avoir en corps cette discipline qui lui appartient privativement.
Ce n'est que la privation des biens spirituels sur la terre. Ajoutons encore pour donner une idée complète de l'excommunication, et des vraies règles du droit canonique à cet égard, que cette excommunication légitimement prononcée par ceux à qui le souverain au nom de l'Eglise en a expressément laissé l'exercice, ne renferme que la privation des biens spirituels sur la terre. Elle ne saurait s'étendre à autre chose. Tout ce qui serait au delà serait abusif, et plus ou moins tyrannique. Les ministres de l'Eglise ne font que déclarer qu'un tel homme n'est plus membre de l'Eglise. Il peut donc jouir malgré l'excommunication de tous les droits naturels, de tous les droits civils, de tous les biens temporels comme homme, ou comme citoyen. Si le magistrat intervient et prive outre cela un tel homme d'une charge ou d'un emploi dans la société, c'est alors une peine civile ajoutée pour quelque faute contre l'ordre civil.
L'excommunication peut être déclarée nulle par la conscience. Supposons encore que les ecclésiastiques qui ont prononcé l'excommunication, aient été séduits par quelque erreur ou quelque passion, (ce qui peut toujours arriver puisqu'ils sont hommes) celui qui a été ainsi exposé à une excommunication précipitée est justifié par sa conscience devant Dieu. La déclaration faite contre lui n'est et ne peut être d'aucun effet pour la vie à venir. Privé de la communion extérieure avec les vrais fidèles, il peut encore jouir ici-bas de toutes les consolations de la communion intérieure. Justifié par sa conscience, il n'a rien à redouter dans la vie à venir du jugement de Dieu qui est son véritable juge.
Si le magistrat ou le souverain peut être excommunié. C'est encore une grande question dans le droit canonique, si le clergé, si son chef, si un corps ecclésiastique quelconque, peut excommunier les magistrats ou le souverain, sous prétexte, ou pour raison de l'abus de leur pouvoir. Cette question seule est scandaleuse, et le simple doute une rébellion manifeste. En effet, le premier devoir de l'homme en société est de respecter et de faire respecter le magistrat; et vous prétendriez avoir le droit de le diffamer et de l'avilir! qui vous aurait donné ce droit aussi absurde qu'exécrable? serait-ce Dieu qui gouverne le monde politique par les souverains, qui veut que la société subsiste par la subordination?
Les premiers ecclésiastiques, à la naissance du christianisme, se sont-ils crus autorisés à excommunier les Tibères, les Nérons, les Claudes, et ensuite les Constances qui étaient hérétiques? Comment donc a-t-on pu souffrir si longtemps des prétentions aussi monstrueuses, des idées aussi atroces, et les attentats affreux qui en ont été la suite; attentats également réprouvés par la raison, le droit naturel et la religion? S'il était une religion qui enseignât de pareilles horreurs, elle devrait être proscrite de la société comme directement opposée au repos du genre humain. Le cri des nations s'est déjà fait entendre contre ces prétendues lois canoniques, dictées par l'ambition et le fanatisme. Il faut espérer que les souverains mieux instruits de leurs droits, soutenus par la fidélité des peuples, mettront enfin un terme à des abus si énormes, et qui ont causé tant de malheurs. Le philosophe inimitable qui nous a donné l' Essai sur l'histoire générale et les moeurs des nations , a été le premier qui a relevé avec force l'atrocité des entreprises de cette nature.
SECTION CINQUIÉME.
De l'inspection sur le dogme.
Attention du souverain sur le dogme. Le souverain n'est point le juge de la vérité du dogme; il peut juger pour lui-même comme tout autre homme; mais il doit prendre connaissance du dogme dans tout ce qui intéresse l'ordre civil, soit quant à la nature de la doctrine si elle avait quelque chose de contraire au bien public, soit quant à la manière de la proposer.
Règle générale dont les magistrats souverains n'auraient jamais dû se départir. Rien dans le dogme ne mérite l'attention de la police que ce qui peut intéresser l'ordre public; c'est l'influence de la doctrine sur les moeurs qui décide de son importance. Toute doctrine qui n'a qu'un rapport éloigné avec la vertu, ne saurait être fondamentale. Les vérités qui sont propres à rendre les hommes doux, humains, soumis aux lois, obéissants au souverain, intéressent l'Etat, et viennent évidemment de Dieu.
SECTION SIXIÉME.
Inspection des magistrats fur l'administration des sacremens.
Inspection nécessaire. L'administration des sacrements doit être aussi soumise à l'inspection assidue du magistrat en tout ce qui intéresse l'ordre public.
Sur les registres. On convient d'abord que le magistrat doit veiller sur la forme des registres publics des mariages, des baptêmes, des morts, sans aucun égard à la croyance des divers citoyens de l'Etat.
Les mêmes raisons de police et d'ordre n'exigeraient-elles pas qu'il y eût des registres exacts entre les mains du magistrat, de tous ceux qui font des voeux pour entrer dans les cloîtres, dans les pays où les cloîtres sont admis.
Dans le sacrement de la pénitence, le ministre qui refuse ou accorde l'absolution, n'est comptable de ses jugements qu'à Dieu; de même aussi le pénitent n'est comptable qu'à Dieu s'il communie ou non, et s'il communie bien ou mal.
Aucun pasteur pécheur ne peut avoir le droit de refuser publiquement et de son autorité privée, l'eucharistie à un autre pécheur. Jésus-Christ impeccable ne refusa pas la communion à Judas.
L'extrême-onction et le viatique demandés par les malades sont soumis aux mêmes règles. Le seul droit du ministre est de faire des exhortations au malade, et le devoir du magistrat est d'avoir soin que le pasteur n'abuse pas de ces circonstances pour persécuter les malades.
Autrefois c'était l'Eglise en corps qui appelait ses pasteurs, et leur conférait le droit d'instruire et de gouverner le troupeau. Ce sont aujourd'hui des ecclésiastiques qui en consacrent d'autres, mais la police publique doit y veiller.
C'est sans doute un grand abus introduit depuis longtemps, que de conférer les ordres sans fonction; c'est enlever des membres à l'Etat sans en donner à l'Eglise. Le magistrat est en droit de réformer cet abus.
De la nature du mariage. Le mariage, dans l'ordre civil, est une union légitime de l'homme et de la femme pour avoir des enfants, pour les élever, et pour leur assurer les droits des propriétés sous l'autorité de la loi. Afin de constater cette union, elle est accompagnée d'une cérémonie religieuse, regardée par les uns comme un sacrement, par les autres comme une pratique du culte public; vraie logomachie qui ne change rien à la chose. Il faut donc distinguer deux parties dans le mariage, le contrat civil ou l'engagement naturel, et le sacrement ou la cérémonie sacrée. Le mariage peut donc subsister avec tous ses effets naturels et civils, indépendamment de la cérémonie religieuse. Les cérémonies mêmes de l'Eglise ne sont devenues nécessaires dans l'ordre civil que parce que le magistrat les a adoptées. Il s'est même écoulé un long temps sans que les ministres de la religion aient eu aucune part à la célébration des mariages. Du temps de Justinien le consentement des parties en présence de témoins, sans aucune cérémonie de l'Eglise, légitimait encore le mariage parmi les chrétiens. C'est cet empereur qui fit vers le milieu du sixième siècle, les premières lois pour que les prêtres intervinssent comme simples témoins, sans ordonner encore de bénédiction nuptiale. L'empereur Léon qui mourut sur le trône en 886, semble être le premier qui ait mis la cérémonie religieuse au rang des conditions nécessaires. La loi même qu'il fit atteste que c'était un nouvel établissement.
De l'idée juste que nous nous formons ainsi du mariage, il résulte d'abord que le bon ordre et la piété même rendent aujourd'hui nécessaires les formalités religieuses, adoptées dans toutes les communions chrétiennes. Mais l'essence du mariage ne peut en être dénaturée; et cet engagement qui est le principal dans la société est, et doit demeurer toujours soumis dans l'ordre politique à l'autorité du magistrat.
Il suit de là encore que deux époux élevés dans le culte même des infidèles et des hérétiques, ne sont point obligés de se remarier s'ils l'ont été selon la loi de leur patrie; c'est au magistrat dans tous les cas d'examiner la chose.
Le prêtre est aujourd'hui le magistrat que la loi a désigné librement en certains pays pour recevoir la foi de mariage. Il est très évident que la loi peut modifier ou changer, comme il lui plaît, l'étendue de cette autorité ecclésiastique.
Des testaments et enterrements. Les testaments et les enterrements sont incontestablement du ressort de la loi civile et de celui de la police. Jamais ils n'auraient dû souffrir que le clergé usurpât l'autorité de la loi à aucun de ces égards. On peut voir encore dans le Siècle de Louis XIV et dans celui de Louis XV , des exemples frappants des entreprises de certains ecclésiastiques fanatiques sur la police des enterrements. On a vu des refus de sacrements, d'inhumation, sous prétexte d'hérésie; barbarie dont les païens mêmes auraient eu horreur.
SECTION SEPTIÉME.
Jurisdiction des ecclésiastiques.
Le souverain peut sans doute abandonner à un corps ecclésiastique ou à un seul prêtre une juridiction sur certains objets et sur certaines personnes, avec une compétence convenable à l'autorité confiée. Je n'examine point s'il a été prudent de remettre ainsi une portion de l'autorité civile entre les mains d'un corps ou d'une personne, qui avait déjà une autorité sur les choses spirituelles. Livrer à ceux qui devaient seulement conduire les hommes au ciel, une autorité sur la terre, c'était réunir deux pouvoirs dont l'abus était trop facile: mais il est certain du moins qu'aucun homme en tant qu'ecclésiastique, ne peut avoir aucune sorte de juridiction. S'il la possède, elle est ou concédée par le souverain, ou usurpée; il n'y a point de milieu. Le royaume de Jésus-Christ n'est point de ce monde; il a refusé d'être juge sur la terre, il a ordonné de rendre à César ce qui appartient à César; il a interdit à ses apôtres toute domination; il n'a prêché que l'humilité, la douceur et la dépendance. Les ecclésiastiques ne peuvent tenir de lui ni puissance, ni autorité, ni domination, ni juridiction dans le monde. Ils ne peuvent donc posséder légitimement aucune autorité que par une concession du souverain, de qui tout pouvoir doit dériver dans la société.
Puisque c'est du souverain seul que les ecclésiastiques tiennent quelque juridiction sur la terre, il suit de là que le souverain et ses magistrats doivent veiller sur l'usage que le clergé fait de son autorité, comme nous l'avons prouvé.
Il fut un temps, dans l'époque malheureuse du gouvernement féodal, où les ecclésiastiques s'étaient emparés en divers lieux des principales fonctions de la magistrature. On a borné dès lors l'autorité des seigneurs de fiefs laïques, si redoutable au souverain, et si dure pour les peuples. Mais une partie de l'indépendance des juridictions ecclésiastiques a subsisté. Quand donc est-ce que les souverains seront assez instruits, ou assez courageux pour reprendre à eux toute autorité usurpée, et tant de droits dont on a si souvent abusé pour vexer les sujets qu'ils doivent protéger?
C'est de cette inadvertance des souverains que sont venues les entreprises audacieuses de quelques ecclésiastiques contre le souverain même. L'histoire scandaleuse de ces attentats énormes est consignée dans des monuments qui ne peuvent être contestés, et il est à présumer que les souverains éclairés aujourd'hui par les écrits des sages, ne permettront plus des tentatives qui ont si souvent été accompagnées ou suivies de tant d'horreurs.
La bulle in Coena Domini est encore en particulier une preuve subsistante des entreprises continuelles du clergé contre l'autorité souveraine et civile, etc. (Voyez Bulle .) Voyez surtout l'article des Deux puissances .
EXTRAIT DU TARIF DES DROITS QU'ON PAYE EN FRANCE ...
Extrait du tarif des droits qu'on paie en France à la cour de Rome pour les bulles, dispenses, absolutions etc., lequel tarif fut arrêté au conseil du roi le 4 septembre 1691, et qui est rapporté tout entier dans l'Instruction de Jacques Le Pelletier, imprimée à Lyon en 1699, avec approbation et privilège du roi; à Lyon chez Antoine Boudet, huitième édition. On en a retiré les exemplaires, et les taxes subsistent .
1 o . Pour absolution du crime d'apostasie, on paiera au pape quatre-vingts livres.
2 o . Un bâtard qui voudra prendre les ordres, paiera pour la dispense vingt-cinq livres; s'il veut posséder un bénéfice simple, il paiera de plus cent quatre-vingts livres. S'il veut que dans la dispense on ne fasse pas mention de son illégitimité, il paiera mille cinquante livres.
3 o . Pour dispense et absolution de bigamie, mille cinquante livres.
4 o . Pour dispense à l'effet de juger criminellement, ou d'exercer la médecine, quatre-vingt-dix livres.
5 o . Absolution d'hérésie, quatre-vingts livres.
6 o . Bref de quarante heures pour sept ans, douze livres.
7 o . Absolution pour avoir commis un homicide à son corps défendant ou sans mauvais dessein, quatre-vingt-quinze livres. Ceux qui étaient dans la compagnie du meurtrier doivent aussi se faire absoudre et payer pour cela quatre-vingt-cinq livres.
8 o . Indulgences pour sept années, douze livres.
9 o . Indulgences perpétuelles pour une confrérie, quarante livres.
10 o . Dispense d'irrégularité ou d'inhabilité, vingt-cinq livres; si l'irrégularité est grande, cinquante livres.
11 o . Permission de lire les livres défendus, vingt-cinq livres.
12 o . Dispense de simonie, quarante livres; sauf à augmenter suivant les circonstances.
13 o . Bref pour manger les viandes défendues, soixante-cinq livres.
14 o . Dispense de voeux simples de chasteté ou de religion, quinze livres. Bref déclaratoire de la nullité de la profession d'un religieux ou d'une religieuse, cent livres: si on demande ce bref dix ans après la profession, on paie le double.
DISPENSES DE MARIAGE.
Dispense du quatrième degré de parenté avec cause, soixante-cinq livres; sans cause quatre-vingt-dix livres; avec absolution des familiarités que les futurs ont eues ensemble, cent quatre-vingts livres.
Pour les parents du troisième au quatrième degré, tant du côté du père que de celui de la mère, la dispense sans cause est de huit cent quatre-vingts livres; avec cause cent quarante-cinq livres.
Pour les parents au second degré d'un côté, et au quatrième de l'autre, les nobles paieront mille quatre cent trente livres; pour les roturiers mille cent cinquante-cinq livres.
Celui qui voudra épouser la soeur de la fille avec laquelle il a été fiancé, paiera pour la dispense mille quatre cent trente livres.
Ceux qui sont parents au troisième degré, s'ils sont nobles, ou s'ils vivent honnêtement, paieront mille quatre cent trente livres; si la parenté est tant du côté du père que de celui de la mère, deux mille quatre cent trente livres.
Parents au second degré paieront quatre mille cinq cent trente livres; si la future a accordé des faveurs au futur, ils paieront de plus pour l'absolution deux mille trente livres.
Ceux qui ont tenu sur les fonts de baptême l'enfant de l'un ou de l'autre, la dispense est de deux mille sept cent trente livres. Si l'on veut se faire absoudre d'avoir pris des plaisirs prématurés, on paiera de plus mille trois cent trente livres.
Celui qui a joui des faveurs d'une veuve pendant la vie du premier mari, paiera pour l'épouser légitimement cent quatre-vingt-dix livres.
En Espagne et en Portugal, les dispenses de mariage sont beaucoup plus chères. Les cousins germains ne les obtiennent pas à moins de deux mille écus de dix jules de Componade.
Les pauvres ne pouvant pas payer des taxes aussi fortes, on leur fait des remises. Il vaut bien mieux tirer la moitié du droit que de ne rien avoir du tout en refusant la dispense.
On ne rapporte pas ici les sommes que l'on paie pour les bulles des évêques, des abbés, des prieurs, des curés etc.; on les trouve dans les almanachs; mais on ne voit pas de quelle autorité il impose des taxes sur les laïcs qui épousent leurs cousines.
DU DROIT DE LA GUERRE. [p. 437] ↩
Dialogue entre un Anglais & un Allemand.
L'ALLEMAND.
Qu'entendez-vous par le droit de la guerre?
L'ANGLAIS.
Votre Grotius en a fait un ample traité, dans lequel il cite plus de deux cents auteurs grecs ou latins, et même des auteurs juifs.
L'ALLEMAND.
Croyez-vous que le prince Eugène, et le duc de Marlborough l'eussent étudié quand ils vinrent humilier la fierté de Louis XIV ? Le droit de la paix je le connais assez; c'est de tenir sa parole, et de laisser tous les hommes jouir des droits de la nature; mais pour le droit de la guerre, je ne sais ce que c'est. Le code du meurtre me semble une étrange imagination. J'espère que bientôt on nous donnera la jurisprudence des voleurs de grand chemin.
L'ANGLAIS.
Comment accorderons-nous donc cette horreur si ancienne, si universelle de la guerre, avec des idées du juste et de l'injuste? avec cette bienveillance pour nos semblables que nous prétendons être née avec nous? avec le to kalon , le beau et l'honnête?
L'ALLEMAND.
N'allons pas si vite. Ce crime qui consiste à commettre un si grand nombre de crimes en front de bandière, n'est pas tout à fait si universel qu'on le croit. Les brames et les primitifs nommés quakers , n'ont jamais été coupables de cette abomination. Les nations qui sont au delà du Gange versent très rarement le sang; et je n'ai point lu que la république de San Marino ait jamais fait la guerre, quoiqu'elle ait à peu près autant de terrain qu'en avait Romulus. Les Lapons, les Samoyèdes, les peuples du Kamshatka n'ont jamais attaqué leurs voisins. Les peuples de l'Indus et de l'Hidaspe furent bien surpris de voir les premiers voleurs armés qui vinrent s'emparer de leur beau pays. Plusieurs peuples de l'Amérique n'avaient jamais entendu parler de ce péché horrible, quand les Espagnols vinrent les exterminer l'Evangile à la main.
Il n'est point dit que les Cananéens eussent jamais fait la guerre à personne, lorsqu'une horde de Juifs parut tout d'un coup, mit les bourgades en cendres, égorgea les femmes sur les corps de leurs maris, et les enfants sur le ventre de leurs mères. Comment expliquerons-nous cette fureur dans nos principes?
L'ANGLAIS.
Comme les médecins rendent raison de la peste, des deux véroles et de la rage. Ce sont des maladies attachées à la constitution de nos organes. On n'est pas toujours attaqué de la rage et de la peste; il suffit souvent qu'un prétendu politique enragé ait mordu un autre ministre pour que la rage se communique dans trois mois à quatre ou cinq cent mille hommes.
Mais quand on a ces maladies, il y a quelques remèdes. En connaissez-vous pour la guerre?
L'ALLEMAND.
Je n'en connais que deux dont la tragédie s'est emparée. La crainte et la pitié. La crainte nous oblige souvent à faire la paix: et la pitié que la nature a mise dans nos coeurs comme un contrepoison contre l'héroïsme carnassier, fait qu'on ne traite pas toujours les vaincus à toute rigueur. Notre intérêt même est d'user envers eux de miséricorde, afin qu'ils servent sans trop de répugnance leurs nouveaux maîtres; je sais bien qu'il y a eu des brutaux qui ont fait sentir rudement le poids de leurs chaînes aux nations subjuguées. A cela je n'ai autre chose à répondre que ce vers d'une tragédie intitulée Spartacus , composée par un Français qui pense profondément.
La loi de l'univers est malheur aux vaincus.
J'ai dompté un cheval: si je suis sage je le nourris bien, je le caresse, et je le monte; si je suis un fou furieux, je l'égorge.
L'ALLEMAND.
Cela n'est pas consolant: car nous avons presque tous été subjugués. Vous autres Anglais vous l'avez été par les Romains, par les Saxons et les Danois; et ensuite par un bâtard de Normandie. Le berceau de notre religion est entre les mains des Turcs: une poignée de Francs a soumis la Gaule. Les Tyriens, les Carthaginois, les Romains, les Goths, les Arabes ont tour à tour subjugué l'Espagne; des Latins vinrent des bords du Tibre voler les bestiaux des bords du Rhin et du Danube; ils firent les cultivateurs esclaves. Enfin, de la Chine à Cadix, presque tout l'univers a toujours appartenu au plus fort. Je ne connais aucun conquérant qui soit venu l'épée dans une main et un code dans l'autre; ils n'ont fait des lois qu'après la victoire, c'est-à-dire, après la rapine; et ces lois, ils les ont faites précisément pour soutenir leur tyrannie. Que diriez-vous, si quelque bâtard de Normandie venait s'emparer de votre Angleterre pour venir vous donner ses lois?
L'ANGLAIS.
Je ne dirais rien; je tâcherais de le tuer à sa descente dans ma patrie; s'il me tuait je n'aurais rien à répliquer: s'il me subjuguait, je n'aurais que deux partis à prendre, celui de me tuer moi-même, ou celui de le bien servir.
L'ALLEMAND.
Voilà de tristes alternatives. Quoi! point de loi de la guerre, point de droit des gens?
L'ANGLAIS.
J'en suis fâché; mais il n'y en a point d'autres que de se tenir continuellement sur ses gardes. Tous les rois, tous les ministres pensent comme moi; et c'est pourquoi, douze cent mille mercenaires en Europe font aujourd'hui la parade tous les jours en temps de paix.
Qu'un prince licencie ses troupes dans votre continent, qu'il laisse tomber ses fortifications en ruines, et qu'il passe son temps à lire Grotius, vous verrez si dans un an ou deux il n'aura pas perdu son royaume.
L'ALLEMAND.
Quoi! votre Angleterre serait perdue si vous n'aviez pas a standing army , une armée sur pied?
L'ANGLAIS.
Oh! nous somme dans un cas différent; c'est une standing army qui peut nous perdre; il ne nous faut que des flottes. Mais de façon ou d'autre, il faut se mettre en état d'être aussi injuste que ses voisins. Alors l'ambition est contenue par l'ambition, alors les chiens d'égale force montrent les dents, et ne se déchirent que lorsqu'ils ont à disputer une proie.
L'ALLEMAND.
Mais les Romains, les Romains ces grands législateurs!
L'ANGLAIS.
Ils faisaient des lois, comme les Algériens assujettissent leurs esclaves à la règle; mais quand ils combattaient pour réduire les nations en esclavage, leur loi était leur épée. Voyez le grand César, le mari de tant de femmes, et la femme de tant d'hommes, il fait mettre en croix deux mille citoyens du pays de Vannes, afin que le reste apprenne à être plus souple; ensuite quand toute la nation est bien apprivoisée, viennent les lois et les beaux règlements. On bâtit des cirques, des amphithéâtres; on élève des aqueducs, on construit des bains publics; et les peuples subjugués dansent avec leurs chaînes.
L'ALLEMAND.
On dit pourtant que dans la guerre il y a des lois qu'on observe. Par exemple, on fait une trêve de quelques jours pour enterrer ses morts. On stipule qu'on ne se battra pas dans un certain endroit. On accorde une capitulation à une ville assiégée; on lui permet de racheter ses cloches. On n'éventre point les femmes grosses quand on prend possession d'une place qui s'est rendue. Vous faites des politesses à un officier blessé qui est tombé entre vos mains; et s'il meurt vous le faites enterrer.
L'ANGLAIS.
Ne voyez-vous pas que ce sont là les lois de la paix, les lois de la nature, les lois primitives qu'on exécute réciproquement? La guerre ne les a pas dictées; elles se font entendre malgré la guerre; et sans cela les trois quarts du globe ne seraient qu'un désert couvert d'ossements.
Si deux plaideurs acharnés et prêts d'être ruinés par leurs procureurs, font entre eux un accord qui leur laisse à chacun un peu de pain, appellerez-vous cet accord une loi du barreau ? Si une horde de théologiens allant faire brûler en cérémonie quelques raisonneurs qu'ils appellent hérétiques , apprend que le lendemain le parti hérétique les fera brûler à son tour; s'ils font grâce afin qu'on la leur fasse, direz-vous que c'est là une loi théologique? Vous avouerez qu'ils ont écouté la nature et l'intérêt malgré la théologie. Il en est de même dans la guerre. Le mal qu'elle ne fait pas, c'est le besoin et l'intérêt qui l'arrête. La guerre, vous dis-je, est une maladie affreuse qui saisit les nations l'une après l'autre, et que la nature guérit à la longue.
L'ALLEMAND.
Quoi! vous n'admettez donc point de guerre juste?
L'ANGLAIS.
Je n'en ai jamais connu de cette espèce; cela me paraît contradictoire et impossible.
L'ALLEMAND.
Quoi! lorsque le pape Alexandre VI et son infâme fils Borgia pillaient la Romagne, égorgeaient, empoisonnaient tous les seigneurs de ce pays, en leur accordant des indulgences, il n'était pas permis de s'armer contre ces monstres?
L'ANGLAIS.
Ne voyez-vous pas que c'étaient ces monstres qui faisaient la guerre? Ceux qui se défendaient, la soutenaient. Il n'y a certainement dans ce monde que des guerres offensives, la défensive n'est autre chose que la résistance à des voleurs armés.
L'ALLEMAND.
Vous vous moquez de nous. Deux princes se disputent un héritage, leur droit est litigieux, leurs raisons sont également plausibles; il faut bien que la guerre en décide: alors cette guerre est juste des deux côtés.
L'ANGLAIS.
C'est vous qui vous moquez. Il est impossible physiquement, que l'un des deux n'ait pas tort; et il est absurde et barbare que des nations périssent parce que l'un de ces deux princes a mal raisonné. Qu'ils se battent en champ clos s'ils veulent; mais qu'un peuple entier soit immolé à leurs intérêts, voilà où est l'horreur. Par exemple, l'archiduc Charles dispute le trône d'Espagne au duc d'Anjou, et avant que le procès soit jugé, il en coûte la vie à plus de cinq cent mille hommes. Je vous demande si la chose est juste?
L'ALLEMAND.
J'avoue que non. Il fallait trouver quelque autre biais pour accommoder le différend.
L'ANGLAIS.
Le temps seul amène la guérison de cette horrible épidémie; la nation et ceux qui entrent dans la querelle sont malades de la rage. Ses horribles symptômes durent douze ans jusqu'à ce que les enragés épuisés n'en pouvant plus, soient forcés de s'accorder. Le hasard, le mélange de bons et de mauvais succès, les intrigues, la lassitude ont éteint cet incendie, que d'autres hasards, d'autres intrigues, la cupidité, la jalousie, l'espérance avaient allumé. La guerre est comme le mont Vésuve; ses éruptions engloutissent des villes, et ses embrasements s'arrêtent. Il y a des temps où les bêtes féroces descendues des montagnes dévorent une partie de vos travaux, ensuite elles se retirent dans leurs cavernes.
L'ALLEMAND.
Quelle funeste condition que celle des hommes!
L'ANGLAIS.
Celle des perdrix est pire; les renards, les oiseaux de proie les dévorent, les chasseurs les tuent, les cuisiniers les rôtissent; et cependant il y en a toujours. La nature conserve les espèces, et se soucie très peu des individus.
L'ALLEMAND.
Vous êtes dur, et la morale ne s'accommode pas de ces maximes.
L'ANGLAIS.
Ce n'est pas moi qui suis dur; c'est la destinée. Vos moralistes font très bien de crier toujours, ‘Misérables mortels, soyez justes et bienfaisants, cultivez la terre et ne l'ensanglantez pas. Princes, n'allez pas dévaster l'héritage d'autrui, de peur qu'on ne vous tue dans le vôtre; restez chez vous, pauvres gentillâtres, rétablissez votre masure; tirez de vos fonds le double de ce que vous en tiriez; entourez vos champs de haies vives; plantez des mûriers; que vos soeurs vous fassent des bas de soie; améliorez vos vignes; et si des peuples voisins veulent venir boire votre vin malgré vous, défendez-vous avec courage; mais n'allez pas vendre votre sang à des princes qui ne vous connaissent pas, qui ne jetteront jamais sur vous un coup d'oeil, et qui vous traitent comme des chiens de chasse qu'on mène contre le sanglier, et qu'on laisse ensuite mourir dans un chenil.'
Ces discours feront peut-être impression sur trois ou quatre têtes bien organisées, tandis que cent mille autres ne les entendront seulement pas, et brigueront l'honneur d'être lieutenants de hussards.
Pour les autres moralistes à gages que l'on nomme prédicateurs , ils n'ont jamais seulement osé prêcher contre la guerre. Ils déclament contre les appétits sensuels après avoir pris leur chocolat. Ils anathématisent l'amour, et au sortir de la chaire où ils ont crié, gesticulé et sué, ils se font essuyer par leurs dévotes. Ils s'époumonent à prouver des mystères dont ils n'ont pas la plus légère idée. Mais ils se gardent bien de décrier la guerre, qui réunit tout ce que la perfidie a de plus lâche dans les manifestes, tout ce que l'infâme friponnerie a de plus bas dans les fournitures des armées, tout ce que le brigandage a d'affreux dans le pillage, le viol, le larcin, l'homicide, la dévastation, la destruction. Au contraire, ces bons prêtres bénissent en cérémonie les étendards du meurtre: et leurs confrères chantent pour de l'argent des chansons juives, quand la terre a été inondée de sang.
Les Français nos voisins sont de grands comédiens en chaire; mais je ne me souviens point en effet d'avoir lu dans leur prolixe et argumentant Bourdalouë, le premier qui ait mis les apparences de la raison dans ses sermons, je ne me souviens point, dis-je, d'avoir lu une seule page contre la guerre.
Leur élégant et compassé Massillon, en bénissant les drapeaux du régiment de Catinat, fait à la vérité quelques voeux pour la paix; mais il permet l'ambition. ‘Ce désir, dit-il, de voir vos services récompensés, s'il est modéré, s'il ne vous porte pas à vous frayer des routes d'iniquité pour parvenir à vos fins, n'a rien dont la morale chrétienne puisse être blessée.' Enfin il prie Dieu d'envoyer l'ange exterminateur au-devant du régiment de Catinat. ‘O mon Dieu, faites-le précéder toujours de la victoire et de la mort; répandez sur ses ennemis les esprits de terreur et de vertige.'
J'ignore si la victoire peut précéder un régiment et si Dieu répand des esprits de vertige; mais je sais que les prédicateurs autrichiens en disaient autant aux cuirassiers de l'empereur, et que l'ange exterminateur ne savait auquel entendre.
Les prédicateurs juifs allèrent encore plus loin. On voit avec édification les prières humaines dont leurs psaumes sont remplis. Il n'est question que de mettre l'épée divine sur sa cuisse, d'éventrer les femmes, d'écraser les enfants à la mamelle contre la muraille. L'ange exterminateur ne fut pas heureux dans ses campagnes; il devint l'ange exterminé; et les Juifs pour prix de leurs psaumes furent toujours vaincus et esclaves. Ils ne réparèrent que par l'usure le mal que leur avait fait la guerre.
De quelque côté que vous vous tourniez, vous verrez que les prêtres ont toujours prêché le carnage, depuis un Aaron que Toland prétend avoir été pontife d'une horde d'Arabes, jusqu'au prédicant Jurieu prophète d'Amsterdam. Les négociants de cette ville aussi sensés que ce pauvre garçon était fou, le laissaient dire, et vendaient leur girofle et leur cannelle.
L'ALLEMAND.
Eh bien, n'allons point à la guerre; ne nous faisons point tuer au hasard pour avoir de quoi vivre. Contentons-nous de nous bien défendre contre les voleurs appelés conquérants .
L'ANGLAIS.
C'est bien dit. Mais c'est cela qui est difficile.
DRUIDES. [p.446] ↩
(La scène est dans le Tartare.)
LES FURIES entourées de serpens & le fouet à la main.
Allons, Barbaroquincorix, druide celte, et toi détestable Calchas, hiérophante grec, voici les moments où vos justes supplices se renouvellent; l'heure des vengeances a sonné.
LE DRUIDE ET CALCHAS.
Ah! la tête! les flancs, les yeux, les oreilles, les fesses; pardon, mesdames, pardon!
CALCHAS.
Voici deux vipères qui m'arrachent les yeux.
LE DRUIDE.
Un serpent m'entre dans les entrailles par le fondement; je suis dévoré.
CALCHAS.
Je suis déchiré; faut-il que mes yeux reviennent tous les jours pour m'être arrachés!
LE DRUIDE.
Faut-il que ma peau renaisse pour tomber en lambeaux! aïe! ouf!
TISIPHONE.
Cela t'apprendra, vilain druide, à donner une autre fois la misérable plante parasite nommée le gui de chêne pour un remède universel. Eh bien, immoleras-tu encore à ton dieu Theutatès des petites filles et des petits garçons? les brûleras-tu encore dans des paniers d'osier au son du tambour?
LE DRUIDE.
Jamais, jamais, madame, un peu de charité.
TISIPHONE.
Tu n'en as jamais eu. Courage, mes serpents; encore un coup de fouet à ce sacré coquin.
ALECTON.
Qu'on m'étrille vigoureusement ce Calchas,
Iphigénie de Racine. Qui vers nous s'est avancé
L'oeil farouche, l'air sombre, et le poil hérissé.
CALCHAS.
On m'arrache le poil, on me brûle, on me berne, on m'écorche, on m'empale.
ALECTON.
Scélérat! égorgeras-tu encore une jeune fille au lieu de la marier, et le tout pour avoir du vent?
CALCHAS ET LE DRUIDE
Ah! quels tourments! que de peines, et point mourir!
ALECTON ET TISIPHONE.
Ah! ah! j'entends de la musique, Dieu me pardonne; c'est Orphée; nos serpents sont devenus doux comme des moutons.
CALCHAS.
Je ne souffre plus du tout; voilà qui est bien étrange!
LE DRUIDE.
Je suis tout ragaillardi. O la grande puissance de la bonne musique! et qui es-tu, divin homme, qui guéris les blessures, et qui réjouis l'enfer?
ORPHÉE
Mes camarades, je suis prêtre comme vous; mais je n'ai jamais trompé personne, et je n'ai égorgé ni garçon ni fille. Lorsque j'étais sur la terre, au lieu de faire abhorrer les dieux, je les ai fait aimer; j'ai adouci les moeurs des hommes que vous rendiez féroces. Je fais le même métier dans les enfers. J'ai rencontré là-bas deux barbares prêtres qu'on fessait à toute outrance; l'un avait autrefois haché un roi en morceaux, l'autre avait fait couper la tête à sa propre reine à la porte-aux-chevaux. J'ai fini leur pénitence, je leur ai joué du violon; ils m'ont promis que quand ils reviendraient au monde ils vivraient en honnêtes gens.
LE DRUIDE ET CALCHAS.
Nous vous en promettons autant, foi de prêtres.
ORPHÉE
Oui, mais passato il pericolo gabbato il santo.
( La scène finit par une danse figurée d'Orphée, des damnés et des furies, et par une symphonie très agréable . )
ÉCONOMIE. [p. 448] ↩
Ce mot ne signifie dans l'acception ordinaire que la manière d'administrer son bien; elle est commune à un père de famille et à un surintendant des finances d'un royaume. Les différentes sortes de gouvernement, les tracasseries de famille et de cour, les guerres injustes et mal conduites, l'épée de Thémis mise dans les mains des bourreaux pour faire périr l'innocent, les discordes intestines, sont des objets étrangers à l'économie.
Il ne s'agit pas ici des déclamations de ces politiques qui gouvernent un Etat du fond de leur cabinet par des brochures.
ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
La première économie, celle par qui subsistent toutes les autres, est celle de la campagne. C'est elle qui fournit les trois seules choses dont les hommes ont un vrai besoin, le vivre, le vêtir et le couvert; il n'y en a pas une quatrième, à moins que ce ne soit le chauffage dans les pays froids. Toutes les trois bien entendues donnent la santé, sans laquelle il n'y a rien.
On appelle quelquefois le séjour de la campagne la vie patriarcale ; mais dans nos climats cette vie patriarcale serait impraticable et nous ferait mourir de froid, de faim et de misère.
Abraham va de la Caldée au pays de Sichem; de là il faut qu'il fasse un long voyage par des déserts arides jusqu'à Memphis pour aller acheter du blé. J'écarte toujours respectueusement, comme je le dois, tout ce qui est divin dans l'histoire d'Abraham et de ses enfants; je ne considère ici que son économie rurale.
Je ne lui vois pas une seule maison: il quitte la plus fertile contrée de l'univers et des villes où il y avait des maisons commodes, pour aller errer dans des pays dont il ne pouvait entendre la langue.
Il va de Sodome dans le désert de Gérar sans avoir le moindre établissement. Lorsqu'il renvoie Agar et l'enfant qu'il a eu d'elle, c'est encore dans un désert; et il ne leur donne pour tout viatique qu'un morceau de pain et une cruche d'eau. Lorsqu'il va sacrifier son fils au Seigneur, c'est encore dans un désert. Il va couper le bois lui-même pour brûler la victime, et le charge sur le dos de son fils qu'il doit immoler.
Sa femme meurt dans un lieu nommé Arbé ou Hébron; il n'a pas seulement six pieds de terre à lui pour l'ensevelir: il est obligé d'acheter une caverne pour mettre sa femme. C'est le seul morceau de terre qu'il ait jamais possédé.
Cependant il eut beaucoup d'enfants; car sans compter Isaac et sa postérité, il eut de son autre femme Céthura à l'âge de cent quarante ans selon le calcul ordinaire, cinq enfants mâles qui s'en allèrent vers l'Arabie.
Il n'est point dit qu'Isaac eût un seul quartier de terre dans le pays où mourut son père; au contraire, il s'en va dans le désert de Gérar avec sa femme Rebecca, chez ce même Abimélec roi de Gérar qui avait été amoureux de sa mère.
Ce roi du désert devient aussi amoureux de sa femme Rebecca que son mari fait passer pour sa soeur, comme Abraham avait donné sa femme Sara pour sa soeur à ce même roi Abimélec quarante ans auparavant. II est un peu étonnant que dans cette famille on fasse toujours passer sa femme pour sa soeur afin d'y gagner quelque chose; mais puisque ces faits sont consacrés, c'est à nous de garder un silence respectueux.
L'Ecriture dit, qu'il s'enrichissait dans cette terre horrible devenue fertile pour lui, et qu'il devint extrêmement puissant. Mais il est dit aussi qu'il n'avait pas de l'eau à boire, qu'il eut une grande querelle avec les pasteurs du roitelet de Gérar pour un puits; et on ne voit pas qu'il eût une maison en propre.
Ses enfants, Esaü et Jacob, n'ont pas plus d'établissement que leur père. Jacob est obligé d'aller chercher à vivre dans la Mésopotamie dont Abraham était sorti: il sert sept années pour avoir une des filles de Laban, et sept autres années pour obtenir la seconde fille. Il s'enfuit avec Rachel et les troupeaux de son beau-père qui court après lui. Ce n'est pas là une fortune bien assurée.
Esaü est représenté aussi errant que Jacob. Aucun des douze patriarches, enfants de Jacob, n'a de demeure fixe, ni un champ dont il soit propriétaire. Ils ne reposent que sous des tentes, comme les Arabes bédouins.
Il est clair que cette vie patriarcale ne convient nullement à la température de notre air. Il faut à un bon cultivateur tel que les Pignoux d'Auvergne, une maison saine tournée à l'orient, de vastes granges, de non moins vastes écuries, des étables proprement tenues; et le tout peut aller à cinquante mille francs au moins de notre monnaie d'aujourd'hui. Il doit semer tous les ans cent arpents en blé, en mettre autant en bons pâturages, posséder quelques arpents de vignes, et environ cinquante arpents pour les menus grains et les légumes; une trentaine d'arpents de bois, une plantation de mûriers, des vers à soie, des ruches. Avec tous ces avantages bien économisés, il entretiendra une nombreuse famille dans l'abondance de tout. Sa terre s'améliorera de jour en jour; il supportera sans rien craindre les dérangements des saisons et le fardeau des impôts; parce qu'une bonne année répare les dommages de deux mauvaises. Il jouira dans son domaine d'une souveraineté réelle qui ne sera soumise qu'aux lois. C'est l'état le plus naturel de l'homme, le plus tranquille, le plus heureux, et malheureusement le plus rare.
Le fils de ce véritable patriarche se voyant riche, se dégoûte bientôt de payer la taxe humiliante de la taille; il a malheureusement appris quelque latin; il court à la ville, achète une charge qui l'exempte de cette taxe et qui donnera la noblesse à son fils au bout de vingt ans. Il vend son domaine pour payer sa vanité. Une fille élevée dans le luxe, l'épouse, le déshonore et le ruine; il meurt dans la mendicité; et son fils porte la livrée dans Paris.
Telle est la différence entre l'économie de la campagne et les illusions des villes.
L'économie à la ville est toute différente. Vivez-vous dans votre terre, vous n'achetez presque rien; le sol vous produit tout, vous pouvez nourrir soixante personnes sans presque vous en apercevoir. Portez à la ville le même revenu, vous achetez tout chèrement, et vous pouvez nourrir à peine cinq ou six domestiques. Un père de famille qui vit dans sa terre avec douze mille livres de rente, aura besoin d'une grande attention pour vivre à Paris dans la même abondance avec quarante mille. Cette proportion a toujours subsisté entre l'économie rurale et celle de la capitale. Il en faut toujours venir à la singulière lettre de madame de Maintenon à sa belle-soeur madame d'Aubigné, dont on a tant parlé; on ne peut trop la remettre sous les yeux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Vous croirez bien que je connais Paris mieux que vous; dans ce même esprit, voici, ma chère soeur, un projet de dépense, tel que je l'exécuterais si j'étais hors de la cour. Vous êtes douze personnes, monsieur et madame, trois femmes, quatre laquais, deux cochers, un valet de chambre.
| Quinze livres de viande à cinq sous la livre | 3 liv. 15 sous |
| Deux pièces de rôti | 2 -- 10. |
| Du pain | 1 -- 10. |
| Le vin | 2 -- 10. |
| Le bois | 2. |
| Le fruit | 1 -- 10. |
| La bougie | -- 10. |
| La chandelle | -- 8. |
| 14 livr. 13 sous |
‘Je compte quatre sous en vin pour vos quatre laquais et vos deux cochers. C'est ce que madame de Montespan donne aux siens. Si vous aviez du vin en cave il ne vous coûterait pas trois sous: j'en mets six pour votre valet de chambre, et vingt pour vous deux qui n'en buvez pas pour trois.
‘Je mets une livre de chandelle par jour, quoiqu'il n'en faille qu'une demi-livre. Je mets dix sous en bougie; il y en a six à la livre qui coûte une liv. dix sous, et qui dure trois jours.
‘Je mets deux livres pour le bois; cependant vous n'en brûlerez que trois mois de l'année; et il ne faut que deux feux.
‘Je mets une livre dix sous pour le fruit; le sucre ne coûte que onze sous la livre: et il n'en faut qu'un quarteron pour une compote.
‘Je mets deux pièces de rôti: on en épargne une quand monsieur ou madame soupe ou dîne en ville; mais aussi j'ai oublié une volaille bouillie pour le potage. Nous entendons le ménage. Vous pouvez fort bien sans passer quinze livres avoir une entrée, tantôt de saucisses, tantôt de langues de mouton ou de fraise de veau, le gigot bourgeois, la pyramide éternelle, et la compote que vous aimez tant. [48]
‘Cela posé, et ce que j'apprends à la cour, ma chère enfant, votre dépense ne doit pas passer cent livres par semaine: c'est quatre cents livres par mois. Posons cinq cents, afin que les bagatelles que j'oublie ne se plaignent point que je leur fais injustice. Cinq cents livres par mois font,
| Pour votre dépense de bouche | 6000 L. |
| Pour vos habits | 1000. |
| Pour loyer de maison | 1000. |
| Pour gages et habits des gens | 1000. |
| Pour les habits, l'opéra et les magnificences de monsieur [ 49] | 3000. |
| 12000 L. |
‘Tout cela n'est-il pas honnête? etc.'
Le marc d'argent valait alors à peu près la moitié du numéraire d'aujourd'hui; tout le nécessaire absolu était de la moitié moins cher: et le luxe ordinaire qui est devenu nécessaire et qui n'est plus luxe, coûtait trois à quatre fois moins que de nos jours. Ainsi le comte d'Aubigné aurait pu pour ses douze mille livres de rente qu'il mangeait à Paris assez obscurément, vivre en prince dans sa terre.
Il y a dans Paris trois ou quatre cents familles municipales qui occupent la magistrature depuis un siècle, et dont le bien est en rentes sur l'hôtel de ville. Je suppose qu'elles eussent chacune vingt mille livres de rente, ces vingt mille livres faisaient juste le double de ce qu'elles font aujourd'hui; ainsi elles n'ont réellement que la moitié de leur ancien revenu. De cette moitié on retrancha une moitié dans le temps inconcevable du système de Lass. Ces familles ne jouissent donc réellement que du quart du revenu qu'elles possédaient à l'avènement de Louis XIV au trône; et le luxe étant augmenté des trois quarts, reste à peu près rien pour elles; à moins qu'elles n'aient réparé leur ruine par de riches mariages, ou par des successions, ou par une industrie secrète: et c'est ce qu'elles ont fait.
En tout pays tout simple rentier qui n'augmente pas son bien dans une capitale, le perd à la longue. Les terriens se soutiennent parce que l'argent augmentant numériquement, le revenu de leurs terres augmente en proportion; mais ils sont exposés à un autre malheur; et ce malheur est dans eux-mêmes. Leur luxe et leur inattention non moins dangereuse encore, les conduisent à la ruine. Ils vendent leurs terres à des financiers qui entassent, et dont les enfants dissipent tout à leur tour. C'est une circulation perpétuelle d'élévation et de décadence; le tout faute d'une économie raisonnable qui consiste uniquement à ne pas dépenser plus qu'on ne reçoit.
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE.
L'économie d'un Etat n'est précisément que celle d'une grande famille. C'est ce qui porta le duc de Sulli à donner le nom d' Economies à ses mémoires. Toutes les autres branches d'un gouvernement sont plutôt des obstacles que des secours à l'administration des deniers publics. Des traités qu'il faut quelquefois conclure à prix d'or, des guerres malheureuses, ruinent un Etat pour longtemps; les heureuses même l'épuisent. Le commerce intercepté et mal entendu l'appauvrit encore; les impôts excessifs comblent la misère.
Qu'est-ce qu'un Etat riche et bien économisé? C'est celui où tout homme qui travaille est sûr d'une fortune convenable à sa condition, à commencer par le roi et à finir par le manoeuvre.
Prenons par exemple l'Etat où le gouvernement des finances est le plus compliqué, l'Angleterre. Le roi est presque sûr d'avoir toujours un million sterling par an à dépenser pour sa maison, sa table, ses ambassadeurs et ses plaisirs. Ce million revient tout entier au peuple par la consommation: car si les ambassadeurs dépensent leurs appointements ailleurs, les ministres étrangers consument leur argent à Londres. Tout possesseur de terres est certain de jouir de son revenu aux taxes près imposées par ses représentants en parlement, c'est-à-dire, par lui-même.
Le commerçant joue un jeu de hasard et d'industrie contre presque tout l'univers; et il est longtemps incertain s'il mariera sa fille à un pair du royaume, ou s'il mourra à l'hôpital.
Ceux qui sans être négociants placent leur fortune précaire dans les grandes compagnies de commerce, ressemblent parfaitement aux oisifs de la France qui achètent des effets royaux, et dont le sort dépend de la bonne ou mauvaise fortune du gouvernement.
Ceux dont l'unique profession est de vendre et d'acheter des billets publics sur les nouvelles heureuses ou malheureuses qu'on débite, et de trafiquer la crainte et l'espérance, sont en sous-ordre dans le même cas que les actionnaires; et tous sont des joueurs, hors le cultivateur qui fournit de quoi jouer.
Une guerre survient; il faut que le gouvernement emprunte de l'argent comptant, car on ne paie pas des flottes et des armées avec des promesses. La chambre des communes imagine une taxe sur la bière, sur le charbon, sur les cheminées, sur les fenêtres, sur les acres de blé et de pâturage, sur l'importation, etc.
On calcule ce que cet impôt pourra produire à peu près; toute la nation en est instruite; un acte du parlement dit aux citoyens, Ceux qui voudront prêter à la patrie recevront quatre pour cent de leur argent pendant dix ans, au bout desquels ils seront remboursés.
Ce même gouvernement fait un fonds d'amortissement du surplus de ce que produisent les taxes. Ce fonds doit servir à rembourser les créanciers. Le temps du remboursement venu, on leur dit, Voulez-vous votre fonds, ou voulez-vous nous le laisser à trois pour cent? Les créanciers qui croient leur dette assurée, laissent pour la plupart leur argent entre les mains du gouvernement.
Nouvelle guerre, nouveaux emprunts, nouvelles dettes; le fonds d'amortissement est vide, on ne rembourse rien.
Enfin, ce monceau de papiers représentatifs d'un argent qui n'existe pas, a été porté jusqu'à cent trente millions de livres sterling, qui font cent millions et demi de guinées en l'an 1770 de notre ère vulgaire.
Disons en passant que la France est à peu près dans ce cas; elle doit de fonds environ cent vingt-sept millions de louis d'or; or ces deux sommes montant à deux cent cinquante-quatre millions de louis d'or, n'existent pas dans l'Europe. Comment payer? Examinons d'abord l'Angleterre.
Si chacun redemande son fonds, la chose est visiblement impossible à moins de la pierre philosophale, ou de quelque multiplication pareille. Que faire? Une partie de la nation a prêté à toute la nation. L'Angleterre doit à l'Angleterre cent trente millions sterling à trois pour cent d'intérêt: elle paie donc de ce seul article Ceci était écrit en 1770. très modique trois millions neuf cent mille livres sterling d'or chaque année. Les impôts sont d'environ sept millions; il reste donc pour satisfaire aux charges de l'Etat, trois millions et cent mille livres sterling, sur quoi l'on peut en économisant éteindre peu à peu une partie des dettes publiques.
La banque de l'Etat en produisant des avantages immenses aux directeurs, est utile à la nation; parce qu'elle augmente le crédit, que ses opérations sont connues, et qu'elle ne pourrait faire plus de billets qu'il n'en faut sans perdre ce crédit et sans se ruiner elle-même. C'est là le grand avantage d'un pays commerçant, où tout se fait en vertu d'une loi positive, où nulle opération n'est cachée, où la confiance est établie sur des calculs faits par les représentants de l'Etat, examinés par tous les citoyens. L'Angleterre, quoi qu'on dise, voit donc son opulence assurée, tant qu'elle aura des terres fertiles, des troupeaux abondants, et un commerce avantageux.
Si les autres pays parviennent à n'avoir pas besoin de ses blés et à tourner contre elle la balance du commerce, il peut arriver alors un très grand bouleversement dans les fortunes des particuliers; mais la terre reste, l'industrie reste; et l'Angleterre alors moins riche en argent l'est toujours en valeurs renaissantes que le sol produit; elle revient au même état où elle était au seizième siècle.
Il en est absolument de tout un royaume comme d'une terre d'un particulier; si le fonds de la terre est bon, elle ne sera jamais ruinée; la famille qui la faisait valoir peut être réduite à l'aumône; mais le sol prospérera sous une autre famille.
Il y a d'autres royaumes qui ne seront jamais riches, quelque effort qu'ils fassent: ce sont ceux qui situés sous un ciel rigoureux, ne peuvent avoir tout au plus que l'exact nécessaire. Les citoyens n'y peuvent jouir des commodités de la vie qu'en les faisant venir de l'étranger à un prix qui est excessif pour eux. Donnez à la Sibérie et au Kamshatka réunis, qui font quatre fois l'étendue de l'Allemagne, un Cyrus pour souverain, un Solon pour législateur, un duc de Sulli, un Colbert pour surintendant des finances, un duc de Choiseul pour ministre de la guerre et de la paix, un Anson pour amiral; ils y mourront de faim avec tout leur génie.
Au contraire, faites gouverner la France par un fou sérieux tel que Lass, par un fou plaisant tel que le cardinal Dubois, par des ministres tels que nous en avons vu quelquefois, on pourra dire d'eux ce qu'un sénateur de Venise disait de ses confrères au roi Louis XII, à ce que prétendent les raconteurs d'anecdotes. Louis XII en colère menaçait de ruiner la république; Je vous en défie, dit le sénateur, la chose me paraît impossible; il y a vingt ans que mes confrères font tous les efforts imaginables pour la détruire, et ils n'en ont pu venir à bout.
Il n'y eut jamais rien de plus extravagant sans doute que de créer une compagnie imaginaire du Mississipi qui devait rendre au moins cent pour un à tout intéressé; de tripler tout d'un coup la valeur numéraire des espèces, de rembourser en papier chimérique les dettes et les charges de l'Etat, et de finir enfin par la défense aussi folle que tyrannique à tout citoyen de garder chez soi plus de cinq cents francs en or ou en argent. Ce comble d'extravagances était inouï: le bouleversement général fut aussi grand qu'il devait l'être: chacun criait que c'en était fait de la France pour jamais. Au bout de dix ans il n'y paraissait pas.
Un bon pays se rétablit toujours par lui-même, pour peu qu'il soit tolérablement régi: un mauvais ne peut s'enrichir que par une industrie extrême et heureuse.
La proportion sera toujours la même entre l'Espagne, la France, l'Angleterre proprement dite, et la Suède. On compte communément vingt millions d'habitants en France, c'est peut-être trop. Ustaris n'en admet que sept en Espagne, Nicols en donne huit à l'Angleterre, on n'en attribue pas cinq à la Suède. L'Espagnol (l'un portant l'autre) a la valeur de quatre-vingts de nos livres à dépenser par an. Le Français meilleur cultivateur a cent livres, l'Anglais cent quatre-vingts, le Suédois cinquante. Si nous voulions parler du Hollandais, nous trouverions qu'il n'a que ce qu'il gagne, parce que ce n'est pas son territoire qui le nourrit et qui l'habille. La Hollande est une foire continuelle où personne n'est riche que de sa propre industrie, ou de celle de son père.
Quelle énorme disproportion entre les fortunes! un Anglais qui a sept mille guinées de revenu absorbe la subsistance de mille personnes. Ce calcul effraie au premier coup d'oeil; mais au bout de l'année il a réparti ses sept mille guinées dans l'Etat; et chacun a eu à peu près son contingent.
En général l'homme coûte très peu à la nature. Dans l'Inde où les rayas et les nababs entassent tant de trésors, le commun peuple vit pour deux sous par jour tout au plus.
Ceux des Américains qui ne sont sous aucune domination, n'ayant que leurs bras, ne dépensent rien; la moitié de l'Afrique a toujours vécu de même; et nous ne sommes supérieurs à tous ces hommes-là que d'environ quarante écus par an. Mais ces quarante écus font une prodigieuse différence; c'est elle qui couvre la terre de belles villes, et la mer de vaisseaux.
C'est avec nos quarante écus que Louis XIV eut deux cents vaisseaux, et bâtit Versailles. Et tant que chaque individu, l'un portant l'autre, pourra être censé jouir de quarante écus de rente, l'Etat pourra être florissant.
Il est évident que plus il y a d'hommes et de richesses dans un Etat, plus on y voit d'abus. Les frottements sont si considérables dans les grandes machines, qu'elles sont presque toujours détraquées. Ces dérangements font une telle impression sur les esprits, qu'en Angleterre, où il est permis à tout citoyen de dire ce qu'il pense, il se trouve tous les mois quelque calculateur qui avertit charitablement ses compatriotes que tout est perdu, et que la nation est ruinée sans ressource. La permission de penser étant moins grande en France, on s'y plaint en contrebande; on imprime furtivement, mais fort souvent, que jamais sous les enfants de Clotaire, ni du temps du roi Jean, de CharlesVI , de la bataille de Pavie, des guerres civiles et de la St Barthélemi, le peuple ne fut si misérable qu'aujourd'hui.
Si on répond à ces lamentations par une lettre de cachet qui ne passe pas pour une raison bien légitime, mais qui est très péremptoire, le plaignant s'enfuit en criant aux alguazils qu'ils n'en ont pas pour six semaines, et que Dieu merci ils mourront de faim avant ce temps-là comme les autres.
Bois-Guilbert qui attribua si impudemment son insensée Dîme royale au maréchal de Vauban, prétendait dans son Détail de la France , que le grand ministre Colbert avait déjà appauvri l'Etat de quinze cents millions, en attendant pis.
Un calculateur de notre temps qui paraît avoir les meilleures intentions du monde, quoiqu'il veuille absolument qu'on s'enivre après la messe, prétend que les valeurs renaissantes de la France qui forment le revenu de la nation ne se montent qu'à environ quatre cents millions; en quoi il paraît qu'il ne se trompe que d'environ seize cent millions de livres à vingt sous la pièce, le marc d'argent monnayé étant à quarante-neuf livres dix. Et il assure que l'impôt pour payer les charges de l'Etat ne peut être que de soixante et quinze millions, dans le temps qu'il l'est de trois cents, lesquels ne suffisent pas à beaucoup près pour acquitter les dettes annuelles.
Une seule erreur dans toutes ces spéculations, dont le nombre est très considérable, ressemble aux erreurs commises dans les mesures astronomiques prises sur la terre. Deux lignes répondent à des espaces immenses dans le ciel.
C'est en France et en Angleterre que l'économie publique est le plus compliquée. On n'a pas d'idée d'une telle administration dans le reste du globe depuis le mont Atlas jusqu'au Japon. Il n'y a guère que cent trente ans que commença cet art de rendre la moitié d'une nation débitrice de l'autre; de faire passer avec du papier les fortunes de main en main, de rendre l'Etat créancier de l'Etat, de faire un chaos de ce qui devrait être soumis à une règle uniforme. Cette méthode s'est étendue en Allemagne et en Hollande. On a poussé ce raffinement et cet excès jusqu'à établir un jeu entre le souverain et les sujets; et ce jeu est appelé loterie . Votre enjeu est de l'argent comptant; si vous gagnez vous obtenez des espèces ou des rentes; qui perd ne souffre pas un grand dommage. Le gouvernement prend d'ordinaire dix pour cent pour sa peine. On fait ces loteries les plus compliquées que l'on peut pour étourdir et pour amorcer le public. Toutes ces méthodes ont été adoptées en Allemagne et en Hollande; presque tout Etat a été obéré tour à tour. Cela n'est pas trop sage; mais qui l'est? les petits qui n'ont pas le pouvoir de se ruiner.
ECONOMIE DE PAROLES. [p. 460] ↩
PARLER PAR ÉCONOMIE.
C'est une expression consacrée aux Pères de l'Eglise et même aux premiers instituteurs de notre sainte religion; elle signifie parler selon les temps et selon les lieux .
Actes des apôtres ch. XXI. Par exemple, St Paul étant chrétien vient dans le temple des Juifs s'acquitter des rites judaïques, pour faire voir qu'il ne s'écarte point de la loi mosaïque; il est reconnu au bout de sept jours, et accusé d'avoir profané le temple. Aussitôt on le charge de coups, on le traîne en tumulte; le tribun de la cohorte, tribunus cohortis [50] arrive et le fait lier de deux chaînes. Ch. XXII. Le lendemain ce tribun fait assembler le sanhédrin, et amène Paul devant ce tribunal; Ch. XXIII. le grand-prêtre Annaniah commence par lui faire donner un soufflet, [51] et Paul l'appelle muraille blanchie .
Il me donna un soufflet; mais je lui dit bien son fait.
Ibid. Or Paul sachant qu'une partie des juges était composée de saducéens, et l'autre de pharisiens, il s'écria, Je suis pharisien et fils de pharisien, on ne veut me condamner qu'à cause de l'espérance et de la résurrection des morts. Paul ayant ainsi parlé il s'éleva une dispute entre les pharisiens et les saducéens, et l'assemblée fut rompue; car les saducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit; et les pharisiens confessent le contraire .
Il est bien évident par le texte que Paul n'était point pharisien puisqu'il était chrétien, et qu'il n'avait point du tout été question dans cette affaire ni de résurrection, ni d'espérance, ni d'ange, ni d'esprit.
Le texte fait voir que St Paul ne parlait ainsi que pour compromettre ensemble les pharisiens et les saducéens. C'était parler par économie , par prudence; c'était un artifice pieux qui n'eût pas été peut-être permis à tout autre qu'à un apôtre.
C'est ainsi que presque tous les Pères de l'Eglise ont parlé par économie . St Jérôme développe admirablement cette méthode dans sa lettre cinquante-quatrième à Pammaque. Pesez ses paroles.
Après avoir dit qu'il est des occasions où il faut présenter un pain et jeter une pierre, voici comme il continue.
‘Lisez, je vous prie, Démosthène, lisez Cicéron; et si les rhétoriciens vous déplaisent parce que leur art est de dire le vraisemblable plutôt que le vrai, lisez Platon, Théophraste, Xénophon, Aristote, et tous ceux qui ayant puisé dans la fontaine de Socrate en ont tiré divers ruisseaux. Y a-t-il chez eux quelque candeur, quelque simplicité? quels termes chez eux n'ont pas deux sens? et quels sens ne présentent-ils pas pour remporter la victoire? Origène, Méthodius, Eusèbe, Apollinaire ont écrit des milliers de versets contre Celse et Porphire. Considérez avec quel artifice, avec quelle subtilité problématique ils combattent l'esprit du diable. Ils disent, non ce qu'ils pensent, mais ce qui est nécessaire. Non quod sentiunt, sed quod necesse est dicunt .
‘Je ne parle point des auteurs latins, Tertullien, Cyprien, Minutius, Victorin, Lactance, Hilaire; je ne veux point les citer ici; je ne veux que me défendre; je me contenterai de vous rapporter l'exemple de l'apôtre St Paul, etc.'
St Augustin écrit souvent par économie . Il se proportionne tellement au temps et aux lieux, que dans une de ses épîtres il avoue qu'il n'a expliqué la Trinité que parce qu'il fallait bien dire quelque chose .
Ce n'est pas assurément qu'il doutât de la sainte Trinité; mais il sentait combien ce mystère est ineffable, et il avait voulu contenter la curiosité du peuple.
Cette méthode fut toujours reçue en théologie. On emploie contre les encratiques un argument qui donnerait gain de cause aux carpocratiens: et quand on dispute ensuite contre les carpocratiens, on change ses armes.
Tantôt on dit que Jésus n'est mort que pour plusieurs , quand on étale le grand nombre des réprouvés; tantôt on affirme qu'il est mort pour tous , lorsqu'on veut manifester sa bonté universelle. Là vous prenez le sens propre pour le sens figuré; ici vous prenez le sens figuré pour le sens propre, selon que la prudence l'exige.
Un tel usage n'est pas admis en justice. On punirait un témoin qui dirait le pour et le contre dans une affaire capitale. Mais il y a une différence infinie entre les vils intérêts humains qui exigent la plus grande clarté, et les intérêts divins qui sont cachés dans un abîme impénétrable. Les mêmes juges qui veulent à l'audience des preuves indubitables approchant de la démonstration, se contenteront au sermon de preuves morales et même de déclamations sans preuves.
St Augustin parle par économie quand il dit, Je crois parce que cela est absurde. Je crois parce que cela est impossible . Ces paroles qui seraient extravagantes dans toute affaire mondaine, sont très respectables en théologie. Elles signifient, ce qui est absurde et impossible aux yeux mortels, ne l'est point aux yeux de Dieu: or Dieu m'a révélé ces prétendues absurdités, ces impossibilités apparentes; donc je dois les croire.
Un avocat ne serait pas reçu à parler ainsi au barreau. On enfermerait à l'hôpital des fous des témoins qui diraient, Nous affirmons qu'un accusé étant au berceau à la Martinique, a tué un homme à Paris; et nous sommes d'autant plus certains de cet homicide qu'il est absurde et impossible. Mais la révélation, les miracles, la foi fondée sur des motifs de crédibilité, sont un ordre de choses tout différent.
Le même St Augustin dit dans sa lettre cent cinquante-troisième: Il est écrit [52] que le monde entier appartient aux fidèles; et les infidèles n'ont pas une obole qu'ils possèdent légitimement .
Si sur ce principe deux dépositaires viennent m'assurer qu'ils sont fidèles, et si en cette qualité ils me font banqueroute à moi misérable mondain, il est certain qu'ils seront condamnés par le Châtelet et par le parlement malgré toute l'économie avec laquelle St Augustin a parlé.
Liv. IV, ch. XXV. St Irénée prétend qu'il ne faut condamner ni l'inceste des deux filles de Loth avec leur père, ni celui de Thamar avec son beau-père, par la raison que la sainte Ecriture ne dit pas expressément que cette action soit criminelle. Cette économie n'empêchera pas que l'inceste parmi nous ne soit puni par les lois. Il est vrai que si Dieu ordonnait expressément à des filles d'engendrer des enfants avec leur père, non seulement elles seraient innocentes; mais elles deviendraient très coupables en n'obéissant pas. C'est là où est l'économie d'Irénée; son but très louable est de faire respecter tout ce qui est dans les saintes Ecritures hébraïques: mais comme Dieu qui les a dictées n'a donné nul éloge aux filles de Loth et à la bru de Juda, il est permis de les condamner.
Tous les premiers chrétiens sans exception pensaient sur la guerre comme les esséniens et les thérapeutes, comme pensent et agissent aujourd'hui les primitifs appelés quakers , et les autres primitifs appelés dunkars , comme ont toujours pensé et agi les brachmanes. Tertullien est celui qui s'explique le plus fortement sur ces homicides légaux que notre abominable nature a rendus De l'idolâtrie, ch. XIX. nécessaires; Il n'y a point de règle, point d'usage qui puisse rendre légitime cet acte criminel .
Cependant après avoir assuré qu'il n'est aucun chrétien qui puisse porter les armes, il dit par économie dans le même livre, Ch. XLII pour intimider l'empire romain, Nous sommes d'hier, et nous remplissons vos villes et vos armées .
Cela n'était pas vrai, et ne fut vrai que sous Constance-Clore; mais l'économie exigeait que Tertullien exagérât dans la vue de rendre son parti redoutable.
Apologét. ch. XXI. C'est dans le même esprit qu'il dit que Pilate était chrétien dans le coeur. Tout son Apologétique est plein de pareilles assertions qui redoublaient le zèle des néophytes.
Terminons tous ces exemples du style économique qui sont innombrables, par ce passage de St Jérôme dans sa dispute contre Liv. I. Jovinien sur les secondes noces. ‘Si les organes de la génération dans les hommes, l'ouverture de la femme, le fond de sa vulve, et la différence des deux sexes faits l'un pour l'autre, montrent évidemment qu'ils sont destinés pour former des enfants, voici ce que je réponds. Il s'ensuivrait que nous ne devons jamais cesser de faire l'amour, de peur de porter en vain des membres destinés pour lui. Pourquoi un mari s'abstiendrait-il de sa femme? pourquoi une veuve persévérerait-elle dans le veuvage si nous sommes nés pour cette action comme les autres animaux? en quoi me nuira un homme qui couchera avec ma femme? Certainement si les dents sont faites pour manger, et pour faire passer dans l'estomac ce qu'elles ont broyé; s'il n'y a nul mal qu'un homme donne du pain à ma femme, il n'y en a pas davantage si étant plus vigoureux que moi il apaise sa faim d'une autre manière, et qu'il me soulage de mes fatigues, puisque les génitoires sont faits pour jouir toujours de leur destinée.'
Quoniam ipsa organa et genitalium fabrica et nostra feminarumque discretio, et receptacula vulvae, ad suscipiendos et coalendos foetus condita, sexus differentiam praedicant, hoc breviter respondebo. Numquam ergo cessemus à libidine, ne frustra hujuscemodi membra portemus. Cur enim maritus se abstineat ab uxore? Cur casta vidua perseveret, si ad hoc tantum nati sumus, ut pecudum more vivamus? Aut quid mihi nocebit si cum uxore meâ alius concubuerit? Quomodo enim dentium officium est mandere, et in alvum ea, quae sunt mansa, transmittere, et non habet crimen, qui conjugi meae panem dederit: ita si genitalium hoc est officium, ut semper fruantur naturâ suâ, meam lassitudinem alterius vires superent: et uxoris, ut ita dixerim, ardentissimam gulam, fortuita libido restinguat .
Après un tel passage il est inutile d'en citer d'autres. Remarquons seulement que ce style économique qui tient de si près au polémique, doit être manié avec la plus grande circonspection, et qu'il n'appartient point aux profanes d'imiter dans leurs disputes ce que les saints ont hasardé, soit dans la chaleur de leur zèle, soit dans la naïveté de leur style.
ECROUELLES. [p. 465] ↩
Ecrouelles, scrofules, appelées humeurs froides , quoiqu'elles soient très caustiques; l'une de ces maladies presque incurables qui défigurent la nature humaine, et qui mènent à une mort prématurée par les douleurs et par l'infection.
On prétend que cette maladie fut traitée de divine, parce qu'il n'était pas au pouvoir humain de la guérir.
Peut-être quelques moines imaginèrent que des rois en qualité d'images de la Divinité, pouvaient avoir le droit d'opérer la cure des scrofuleux, en les touchant de leurs mains qui avaient été ointes. Mais pourquoi ne pas attribuer à plus forte raison ce privilège aux empereurs qui avaient une dignité si supérieure à celle des rois? pourquoi ne le pas donner aux papes qui se disaient les maîtres des empereurs, et qui étaient bien autre chose que de simples images de Dieu, puisqu'ils en étaient les vicaires. Il y a quelque apparence que quelque songe-creux de Normandie, pour rendre l'usurpation de Guillaume le Bâtard plus respectable, lui concéda de la part de Dieu la faculté de guérir les écrouelles avec le bout du doigt.
C'est quelque temps après Guillaume qu'on trouve cet usage tout établi. On ne pouvait gratifier les rois d'Angleterre de ce don miraculeux, et le refuser aux rois de France leurs suzerains. C'eût été blesser le respect dû aux lois féodales. Enfin, on fit remonter ce droit à St Edouard en Angleterre, et à Clovis en France.
Appendix n o . 6. Le seul témoignage un peu croyable que nous ayons de l'antiquité de cet usage, se trouve dans les écrits en faveur de la maison de Lancaster, composés par le chevalier Jean Fortescue sous le roi Henri VI, reconnu roi de France à Paris dans son berceau et ensuite roi d'Angleterre, et qui perdit ses deux royaumes. Jean Fortescue grand chancelier d'Angleterre, dit que de temps immémorial les rois d'Angleterre étaient en possession de toucher les gens du peuple malades des écrouelles. On ne voit pourtant pas que cette prérogative rendît leurs personnes plus sacrées dans les guerres de la Rose rouge et de la Rose blanche.
Les reines qui n'étaient que femmes de rois ne guérissaient pas les écrouelles, parce qu'elles n'étaient pas ointes aux mains comme les rois; mais Elizabeth reine de son chef et ointe les guérissait sans difficulté.
Il arriva une chose assez triste à Martorillo le Calabrois, que nous nommons St François de Paule; le roi Louis XI le fit venir au Plessis-les-Tours pour le guérir des suites de son apoplexie: le Acta Sti. Francisci Pauli , pag. 155. saint arriva avec les écrouelles: Ipse fuit detentus gravi inflatura quam in parte inferiori genae suae dextrae circa guttur patiebatur chirurgi dicebant morbum esse scropharum .
Le saint ne guérit point le roi, et le roi ne guérit point le saint.
Quand le roi d'Angleterre Jacques II fut reconduit de Rochester à Wittehall, on proposa de lui laisser faire quelque acte de royauté, comme de toucher les écrouelles; il ne se présenta personne. Il alla exercer sa prérogative en France, à St Germain, où il toucha quelques Irlandaises. Sa fille Marie, le roi Guillaume, la reine Anne, les rois de la maison de Brunswick ne guérirent personne. Cette mode sacrée passa, quand le raisonnement arriva.
EDUCATION. [p. 467] ↩
Dialogue entre un conseiller & un ex-jésuite.
Monsieur, vous voyez le triste état où la banqueroute de deux marchands missionnaires m'ont réduit. Je n'avais assurément aucune correspondance avec frère La Valette et frère Saci; j'étais un pauvre prêtre du collège de Clermont dit Louis le Grand ; je savais un peu de latin et de catéchisme que je vous ai enseignés pendant six ans, sans aucun salaire: à peine sorti du collège, à peine ayant fait semblant d'étudier en droit avez-vous acheté une charge de conseiller au parlement, que vous avez donné votre voix pour me faire mendier mon pain hors de ma patrie, ou pour me réduire à y vivre bafoué avec seize louis et seize francs par an, qui ne suffisent pas pour me vêtir et me nourrir, moi et ma soeur la couturière devenue impotente. Tout le monde m'a dit que ce désastre était advenu aux frères jésuites non seulement par la banqueroute de La Valette et Saci missionnaires; mais parce que frère La Chaise confesseur avait été un trigaud, et frère Le Tellier confesseur un persécuteur impudent: mais je n'ai jamais connu ni l'un ni l'autre; ils étaient morts avant que je fusse né.
On prétend encore que des disputes de jansénistes et de molinistes sur la grâce versatile et sur la science moyenne, ont fort contribué à nous chasser de nos maisons: mais je n'ai jamais su ce que c'était que la grâce. Je vous ai fait lire autrefois Despautère et Cicéron, les vers de Commire et de Virgile; le Pédagogue chrétien et Sénèque; les psaumes de David en latin de cuisine, et les Odes d'Horace à la brune Lalagé et au blond Ligurinus, flavam religantis comam , renouant sa blonde chevelure. En un mot, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous bien élever, et voilà ma récompense.
LE CONSEILLER
Vraiment vous m'avez donné là une plaisante éducation; il est vrai que je m'accommodais fort du blond Ligurinus. Mais lorsque j'entrai dans le monde, je voulus m'aviser de parler et on se moqua de moi; j'avais beau citer les odes à Ligurinus et le Pédagogue chrétien : je ne savais ni si François I e r avait été fait prisonnier à Pavie, ni où est Pavie; le pays même où je suis né était ignoré de moi; je ne connaissais ni les lois principales, ni les intérêts de ma patrie: pas un mot de mathématiques, pas un mot de saine philosophie; je savais du latin et des sottises.
L'EX-JÉSUITE
Je ne pouvais vous apprendre que ce qu'on m'avait enseigné. J'avais étudié au même collège jusqu'à quinze ans; à cet âge un jésuite m'enquinauda; je fus novice, on m'abêtit pendant deux ans, et ensuite on me fit régenter. Ne voudriez-vous pas que je vous eusse donné l'éducation qu'on reçoit dans l'école militaire?
LE CONSEILLER
Non, il faut que chacun apprenne de bonne heure tout ce qui peut le faire réussir dans la profession à laquelle il est destiné. Clairaut était le fils d'un maître de mathématiques; dès qu'il sut lire et écrire, son père lui montra son art: il devint très bon géomètre à douze ans; il apprit ensuite le latin, qui ne lui servit jamais à rien. La célèbre marquise du Châtelet apprit le latin en un an et le savait très bien; tandis qu'on nous tenait sept années au collège pour nous faire balbutier cette langue sans jamais parler à notre raison.
Quant à l'étude des lois dans laquelle nous entrions en sortant de chez vous, c'était encore pis. Je suis de Paris et on m'a fait étudier pendant trois ans les lois oubliées de l'ancienne Rome; ma coutume me suffirait s'il n'y avait pas dans notre pays cent quarante-quatre coutumes différentes.
J'entendis d'abord mon professeur qui commence par distinguer la jurisprudence en droit naturel et droit des gens: le droit naturel est commun, selon lui, aux hommes et aux bêtes; et le droit des gens commun à toutes les nations, dont aucune n'est d'accord avec ses voisins.
Ensuite on me parla de la loi des douze tables abrogée bien vite chez ceux qui l'avaient faite, de l'édit du préteur quand nous n'avons point de préteur, de tout ce qui concerne les esclaves quand nous n'avons point d'esclaves domestiques, (au moins dans l'Europe chrétienne) du divorce quand le divorce n'est pas encore reçu chez nous, etc. etc. etc.
Je m'aperçus bientôt qu'on me plongeait dans un abîme dont je ne pourrais jamais me tirer. Je vis qu'on m'avait donné une éducation très inutile pour me conduire dans le monde.
J'avoue que ma confusion a redoublé quand j'ai lu nos ordonnances; il y en a la valeur de quatre-vingts volumes, qui presque toutes se contredisent: je suis obligé quand je juge de m'en rapporter au peu de bon sens et d'équité que la nature m'a donné; et avec ces deux secours je me trompe à presque toutes les audiences.
J'ai un frère qui étudie en théologie pour être grand vicaire; il se plaint bien davantage de son éducation: il faut qu'il consume six années à bien statuer s'il y a neuf choeurs d'anges, et quelle est la différence précise entre un trône et une domination; si le Phison dans le paradis terrestre était à droite ou à gauche du Géon; si la langue dans laquelle le serpent eut des conversations avec Eve était la même que celle dont l'ânesse se servit avec Balaam; comment Melchisédec était né sans père et sans mère; en quel endroit demeure Enoch qui n'est point mort: où sont les chevaux qui transportèrent Elie dans un char de feu après qu'il eut séparé les eaux du Jourdain avec son manteau, et dans quel temps il doit revenir pour annoncer la fin du monde? Mon frère dit que toutes ces questions l'embarrassent beaucoup, et ne lui ont encore pu procurer un canonicat de Notre-Dame sur lequel nous comptions.
Vous voyez entre nous que la plupart de nos éducations sont ridicules, et que celles qu'on reçoit dans les arts et métiers sont infiniment meilleures.
L'EX-JÉSUITE
D'accord; mais je n'ai pas de quoi vivre avec mes quatre cents francs, qui font vingt-deux sous deux deniers par jour; tandis que tel homme, dont le père allait derrière un carrosse, a trente-six chevaux dans son écurie, quatre cuisiniers et point d'aumônier.
LE CONSEILLER
Eh bien, je vous donne quatre cents autres francs de ma poche; c'est ce que Jean Despautère ne m'avait point enseigné dans mon éducation.
EGALITÉ. [p. 470] ↩
SECTION PREMIÈRE.
Il est clair que les hommes jouissant des facultés attachées à leur nature, sont égaux; ils le sont quand ils s'acquittent des fonctions animales, et quand ils exercent leur entendement. Le roi de la Chine, le Grand Mogol, le padicha de Turquie, ne peut dire au dernier des hommes, Je te défends de digérer, d'aller à la garde-robe et de penser. Tous les animaux de chaque espèce sont égaux entre eux.
Un cheval ne dit point au cheval son confrère
Qu'on peigne mes beaux crins, qu'on m'étrille et me ferre;
Toi, cours, et va porter mes ordres souverains
Aux mulets de ces bords, aux ânes mes voisins.
Toi, prépare les grains dont je fais des largesses
A mes fiers favoris, à mes douces maîtresses.
Qu'on châtre les chevaux désignés pour servir
Les coquettes juments dont seul je dois jouir.
Que tout soit dans la crainte et dans la dépendance.
Et si quelqu'un de vous hennit en ma présence,
Pour punir cet impie et ce séditieux,
Qui foule aux pieds les lois des chevaux et des dieux,
Pour venger dignement le ciel et la patrie,
Qu'il soit pendu sur l'heure auprès de l'écurie.
Les animaux ont naturellement au-dessus de nous l'avantage de l'indépendance. Si un taureau qui courtise une génisse est chassé à coups de cornes par un taureau plus fort que lui, il va chercher une autre maîtresse dans un autre pré; et il vit libre. Un coq battu par un coq, se console dans un autre poulailler. Il n'en est pas ainsi de nous. Un petit vizir exile à Lemnos un bostangi; le vizir Azem exile le petit vizir à Ténédos. Le padicha exile le vizir Azem à Rhodes. Les janissaires mettent en prison le padicha, et en élisent un autre qui exilera les bons musulmans à son choix; encore lui sera-t-on bien obligé s'il se borne à ce petit exercice de son autorité sacrée.
Si cette terre était ce qu'elle semble devoir être, si l'homme y trouvait partout une subsistance facile et assurée, et un climat convenable à sa nature, il est clair qu'il eût été impossible à un homme d'en asservir un autre. Que ce globe soit couvert de fruits salutaires, que l'air qui doit contribuer à notre vie, ne nous donne point des maladies et une mort prématurée, que l'homme n'ait besoin d'autre logis et d'autre lit que celui des daims et des chevreuils; alors les Gengiskan et les Tamerlan n'auront de valets que leurs enfants qui seront assez honnêtes gens pour les aider dans leur vieillesse.
Dans cet état naturel dont jouissent tous les quadrupèdes non domptés, les oiseaux et les reptiles, l'homme serait aussi heureux qu'eux; la domination serait alors une chimère, une absurdité à laquelle personne ne penserait; car pourquoi chercher des serviteurs quand vous n'avez besoin d'aucun service?
S'il passait par l'esprit de quelque individu à tête tyrannique et à bras nerveux, d'asservir son voisin moins fort que lui, la chose serait impossible; l'opprimé serait sur le Danube, avant que l'oppresseur eût pris ses mesures sur le Volga.
Tous les hommes seraient donc nécessairement égaux, s'ils étaient sans besoins; la misère attachée à notre espèce subordonne un homme à un autre homme: ce n'est pas l'inégalité qui est un malheur réel, c'est la dépendance. Il importe fort peu que tel homme s'appelle sa hautesse , tel autre sa sainteté ; mais il est dur de servir l'un ou l'autre.
Une famille nombreuse a cultivé un bon terroir; deux petites familles voisines ont des champs ingrats et rebelles; il faut que les deux pauvres familles servent la famille opulente, ou qu'ils l'égorgent; cela va sans difficulté. Une des deux familles indigentes va offrir ses bras à la riche pour avoir du pain; l'autre va l'attaquer et est battue. La famille servante est l'origine des domestiques et des manoeuvres; la famille battue est l'origine des esclaves.
Il est impossible dans notre malheureux globe que les hommes vivant en société ne soient pas divisés en deux classes, l'une de riches qui commandent, l'autre de pauvres qui servent; et ces deux se subdivisent en mille, et ces mille ont encore des nuances différentes.
Tu viens quand les lots sont faits nous dire, Je suis homme comme vous, j'ai deux mains et deux pieds, autant d'orgueil et plus que vous, un esprit aussi désordonné pour le moins, aussi inconséquent, aussi contradictoire que le vôtre. Je suis citoyen de St Marin, ou de Raguse, ou de Vaugirard; donnez-moi ma part de la terre. Il y a dans notre hémisphère connu environ cinquante mille millions d'arpents à cultiver, tant passables que stériles. Nous ne sommes qu'environ un milliard d'animaux à deux pieds sans plumes sur ce continent; ce sont cinquante arpents pour chacun, faites-moi justice, donnez-moi mes cinquante arpents.
On lui répond, Va-t-en les prendre chez les Cafres, chez les Hottentots ou chez les Samoyèdes; arrange-toi avec eux à l'amiable; ici toutes les parts sont faites. Si tu veux avoir parmi nous le manger, le vêtir, le loger et le chauffer, travaille pour nous comme faisait ton père; sers-nous, ou amuse-nous, et tu seras payé; sinon tu serais obligé de demander l'aumône; ce qui dégraderait trop la sublimité de ta nature, et t'empêcherait réellement d'être égal aux rois, et même aux vicaires de village, selon les prétentions de ta noble fierté.
SECTION SECONDE.
Tous les pauvres ne sont pas malheureux. La plupart sont nés dans cet état, et le travail continuel les empêche de trop sentir leur situation; mais quand ils la sentent, alors on voit des guerres, comme celle du parti populaire contre le parti du sénat à Rome; celles des paysans en Allemagne, en Angleterre, en France. Toutes ces guerres finissent tôt ou tard par l'asservissement du peuple, parce que les puissants ont l'argent, et que l'argent est maître de tout dans un Etat; je dis dans un Etat, car il n'en est pas de même de nation à nation. La nation qui se servira le mieux du fer, subjuguera toujours celle qui aura plus d'or et moins de courage.
Tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs; et avec beaucoup de goût pour la paresse: par conséquent tout homme voudrait avoir l'argent et les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ses caprices, et ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions il est aussi impossible que les hommes soient égaux, qu'il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre.
Le genre humain tel qu'il est, ne peut subsister à moins qu'il n'y ait une infinité d'hommes utiles qui ne possèdent rien du tout. Car certainement un homme à son aise ne quittera pas sa terre pour venir labourer la vôtre; et si vous avez besoin d'une paire de souliers, ce ne sera pas un maître de requêtes qui vous la fera. L'égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle, et en même temps la plus chimérique.
Comme les hommes sont excessifs en tout quand ils le peuvent, on a outré cette inégalité, on a prétendu dans plusieurs pays qu'il n'était pas permis à un citoyen de sortir de la contrée où le hasard l'a fait naître; le sens de cette loi est visiblement, Ce pays est si mauvais et si mal gouverné que nous défendons à chaque individu d'en sortir, de peur que tout le monde n'en sorte . Faites mieux, donnez à tous vos sujets envie de demeurer chez vous, et aux étrangers d'y venir.
Chaque homme dans le fond de son coeur a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes: il ne s'ensuit pas de là que le cuisinier d'un cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner. Mais le cuisinier peut dire: Je suis homme comme mon maître; je suis né comme lui en pleurant; il mourra comme moi dans les mêmes angoisses et les mêmes cérémonies. Nous faisons tous deux les mêmes fonctions animales. Si les Turcs s'emparent de Rome, et si alors je suis cardinal et mon maître cuisinier, je le prendrai à mon service. Tout ce discours est raisonnable et juste; mais en attendant que le grand Turc s'empare de Rome, le cuisinier doit faire son devoir, ou toute société humaine est pervertie.
A l'égard d'un homme qui n'est ni cuisinier d'un cardinal, ni revêtu d'aucune autre charge dans l'Etat; à l'égard d'un particulier qui ne tient à rien, mais qui est fâché d'être reçu partout avec l'air de la protection ou du mépris, qui voit évidemment que plusieurs monsignors n'ont ni plus de science, ni plus d'esprit, ni plus de vertu que lui, et qui s'ennuie quelquefois dans leur antichambre, quel parti doit-il prendre? celui de s'en aller.
EGLISE. [p. 474] ↩
PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE CHRETIENNE.
Nous ne porterons point nos regards sur les profondeurs de la théologie; Dieu nous en préserve; l'humble foi seule nous suffit. Nous ne faisons jamais que raconter.
Dans les premières années qui suivirent la mort de Jésus-Christ Dieu et homme, on comptait chez les Hébreux neuf écoles ou neuf sociétés religieuses, pharisiens, saducéens, esséniens, judaïtes, thérapeutes, récabites, hérodiens, disciples de Jean, et les disciples de Jésus, nommés les frères , les Galiléens , les fidèles , qui ne prirent le nom de chrétiens que dans Antioche, vers l'an 60 de notre ère, conduits secrètement par Dieu même dans des voies inconnues aux hommes.
Les pharisiens admettaient la métempsycose, les saducéens niaient l'immortalité de l'âme et l'existence des esprits, et cependant étaient fidèles au Pentateuque.
Liv. V, ch. XVII. Pline le naturaliste (apparemment sur la foi de Flavien Joseph) appelle les esséniens gens aeterna in quâ nemo nascitur ; famille éternelle dans laquelle il ne naît personne; parce que les esséniens se mariaient très rarement. Cette définition a été depuis appliquée à nos moines.
Il est difficile de juger si c'est des esséniens ou des judaïtes que Hist. ch. XII. parle Joseph quand il dit: Ils méprisent les maux de la terre; ils triomphent des tourments par leur constance; ils préfèrent la mort à la vie lorsque le sujet en est honorable. Ils ont souffert le fer et le feu, et vu briser leurs os, plutôt que de prononcer la moindre parole contre leur législateur, ni manger des viandes défendues .
Il paraît que ce portrait tombe sur les judaïtes, et non pas sur les esséniens. Car voici les paroles de Joseph: Judas fut l'auteur d'une nouvelle secte, entièrement différente des trois autres , c'est-à-dire, des saducéens, des pharisiens et des esséniens. Il continue et dit, Ils sont Juifs de nation; ils vivent unis entre eux, et regardent la volupté comme un vice : le sens naturel de cette phrase fait croire que c'est des judaïtes dont l'auteur parle.
Quoi qu'il en soit, on connut ces judaïtes avant que les disciples du Christ commençassent à faire un parti considérable dans le monde. Quelques bonnes gens les ont pris pour des hérétiques qui adoraient Judas Iscariote.
Les thérapeutes étaient une société différente des esséniens et des judaïtes; ils ressemblaient aux gymnosophistes des Indes, et aux brames. Ils ont , dit Philon, un mouvement d'amour céleste, qui les jette dans l'enthousiasme des bacchantes et des corybantes, et qui les met dans l'état de la contemplation à laquelle ils aspirent. Cette secte naquit dans Alexandrie qui était toute remplie de Juifs; et s'étendit beaucoup dans l'Egypte.
Les récabites subsistaient encore; ils faisaient voeu de ne jamais boire de vin; et c'est peut-être à leur exemple que Mahomet défendit cette liqueur à ses musulmans.
Les hérodiens regardaient Hérode premier du nom comme un messie, un envoyé de Dieu, qui avait rebâti le temple. Il est évident que les Juifs célébraient sa fête à Rome du temps de Néron, témoins les vers de Perse; Herodis venere dies , etc.
Voici le jour d'Hérode, où tout infâme Juif
Fait fumer sa lanterne avec l'huile ou le suif.
Les disciples de Jean-Baptiste s'étendirent un peu en Egypte, mais principalement dans la Syrie, dans l'Arabie et vers le golfe Persique. On les connaît aujourd'hui sous le nom de chrétiens de St Jean ; il y en eut aussi dans l'Asie mineure. Il est dit dans les Actes des apôtres (chap.IX ), que Paul en rencontra plusieurs à Ephèse; il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils lui répondirent, Nous n'avons pas seulement ouï dire qu'il y ait un Saint-Esprit . Il leur dit, Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils lui répondirent, Le baptême de Jean .
Les véritables chrétiens cependant, jetaient, comme on sait, les fondements de la seule religion véritable.
Celui qui contribua le plus à fortifier cette société naissante, fut ce Paul même qui l'avait persécutée avec le plus de violence. Il était né à Tarsis en Cilicie, [53] et fut élevé par le fameux docteur pharisien Gamaliel disciple de Hillel. Les Juifs prétendent qu'il rompit avec Gamaliel, qui refusa de lui donner sa fille en mariage. On voit quelques traces de cette anecdote à la suite des Actes de Ste Thècle . Ces actes portent qu'il avait le front large, la tête chauve, les sourcils joints, le nez aquilin, la taille courte et grosse, et les jambes torses. Lucien, dans son dialogue de Philopatris , semble faire un portrait assez semblable. On a douté qu'il fût citoyen romain, car en ce temps-là on n'accordait ce titre à aucun Juif; ils avaient été chassés de Rome par Tibère: et Tarsis ne fut colonie romaine que près de cent ans après sous Caracalla, comme le remarque Cellarius dans sa Géographie, livre III, et Grotius dans son commentaire sur les actes, auxquels seuls nous devons nous en rapporter.
Dieu qui était descendu sur la terre pour y être un exemple d'humilité et de pauvreté, donnait à son Eglise les plus faibles commencements, et la dirigeait dans ce même état d'humiliation, dans lequel il avait voulu naître. Tous les premiers fidèles furent des hommes obscurs; ils travaillaient tous de leurs mains. L'apôtre St Paul témoigne qu'il gagnait sa vie à faire des tentes. St Pierre ressuscita la couturière Dorcas qui faisait les robes des frères. L'assemblée des fidèles se tenait à Joppé, dans la maison d'un corroyeur nommé Simon, comme on le voit au chap. IX des Actes des apôtres .
Les fidèles se répandirent secrètement en Grèce, et quelques-uns allèrent de là à Rome, parmi les Juifs à qui les Romains permettaient une synagogue. Ils ne se séparèrent point d'abord des Juifs; ils gardèrent la circoncision; et comme on l'a déjà remarqué ailleurs, les quinze premiers évêques secrets de Jérusalem furent tous circoncis, ou du moins de la nation juive.
Lorsque l'apôtre Paul prit avec lui Timothée qui était fils d'un père gentil, il le circoncit lui-même dans la petite ville de Listre. Mais Tite son autre disciple, ne voulut point se soumettre à la circoncision. Les frères disciples de Jésus furent unis aux Juifs, jusqu'au temps où Paul essuya une persécution à Jérusalem, pour avoir amené des étrangers dans le temple. Il était accusé par les Juifs de vouloir détruire la loi mosaïque par Jésus-Christ. C'est pour se laver de cette accusation que l'apôtre St Jacques proposa à l'apôtre Paul de se faire raser la tête, et de s'aller purifier dans le temple avec quatre Juifs qui avaient fait voeu de se raser; Prenez-les avec vous , lui dit Jacques (chap. XXI, Act. des apôt.), purifiez-vous avec eux, et que tout le monde sache que ce que l'on dit de vous est faux, et que vous continuez à garder la loi de Moïse . Ainsi donc Paul qui d'abord avait été le persécuteur sanguinaire de la sainte société établie par Jésus, Paul qui depuis voulut gouverner cette société naissante; Paul chrétien judaïse afin que le monde sache qu'on le calomnie quand on dit qu'il ne suit plus la loi mosaïque .
St Paul n'en fut pas moins accusé d'impiété et d'hérésie, et son procès criminel dura longtemps; mais on voit évidemment par les accusations mêmes intentées contre lui, qu'il était venu à Jérusalem pour observer les rites judaïques.
Il dit à Festus ces propres paroles (chap. XXV des Actes): Je n'ai péché ni contre la loi juive, ni contre le temple .
Les apôtres annonçaient Jésus-Christ comme un juste indignement persécuté, un prophète de Dieu, un fils de Dieu envoyé aux Juifs pour la réformation des moeurs.
La circoncision est utile , dit l'apôtre St Paul, (ch. II, épît. aux Rom.) si vous observez la loi; mais si vous la violez, votre circoncision devient prépuce. Si un incirconcis garde la loi, il sera comme circoncis. Le vrai Juif est celui qui est Juif intérieurement .
Quand cet apôtre parle de Jésus-Christ dans ses épîtres, il ne révèle point le mystère ineffable de sa consubstantialité avec Dieu; ‘Nous sommes délivrés par lui (dit-il, chap. V, épît. aux Rom.) de la colère de Dieu: le don de Dieu s'est répandu sur nous, par la grâce donnée à un seul homme qui est Jésus-Christ. . . La mort a régné par le péché d'un seul homme, les justes régneront dans la vie par un seul homme qui est Jésus-Christ.'
Et au chap. VIII, ‘Nous les héritiers de Dieu, et les cohéritiers de Christ.' Et au chap. XVI, ‘A Dieu, qui est le seul sage, honneur et gloire par Jésus-Christ. . . Vous êtes à Jésus-Christ, et Jésus-Christ à Dieu.' (1 e aux Corinth. chap. III).
Et, (1 e aux Corinth. chap. XV, v. 27) ‘Tout lui est assujetti, en exceptant sans doute Dieu qui lui a assujetti toutes choses.'
On a eu quelque peine à expliquer le passage de l'épître aux Philippiens; Ne faites rien par une vaine gloire; croyez mutuellement par humilité que les autres vous sont supérieurs, ayez les mêmes sentiments que Christ Jésus, qui étant dans l'empreinte de Dieu n'a point cru sa proie de s'égaler à Dieu . Ce passage paraît très bien approfondi, et mis dans tout son jour, dans une lettre qui nous reste des Eglises de Vienne et de Lyon, écrite l'an 117, et qui est un précieux monument de l'antiquité. On loue dans cette lettre la modestie de quelques fidèles: Ils n'ont pas voulu , dit la lettre, prendre le grand titre de martyrs , (pour quelques tribulations) à l'exemple de Jésus-Christ, lequel étant empreint de Dieu, n'a pas cru sa proie la qualité d'égal à Dieu . Origène dit aussi dans son Commentaire sur Jean, La grandeur de Jésus a plus éclaté quand il s'est humilié, que s'il eût fait sa proie d'être égal à Dieu . En effet, l'explication contraire peut paraître un contresens. Que signifierait, Croyez les autres supérieurs à vous; imitez Jésus qui n'a pas cru que c'était une proie, une usurpation, de s'égaler à Dieu ? Ce serait visiblement se contredire, ce serait donner un exemple de grandeur pour un exemple de modestie; ce serait pécher contre la dialectique.
La sagesse des apôtres fondait ainsi l'Eglise naissante. Cette sagesse ne fut point altérée par la dispute qui survint entre les apôtres Pierre, Jacques et Jean d'un côté, et Paul de l'autre. Cette contestation arriva dans Antioche. L'apôtre Pierre, autrement Céphas, ou Simon Barjone, mangeait avec les gentils convertis, et n'observait point avec eux les cérémonies de la loi, ni la distinction des viandes; il mangeait, lui, Barnabé, et d'autres disciples, indifféremment du porc, des chairs étouffées, des animaux qui avaient le pied fendu et qui ne ruminaient pas; mais plusieurs Juifs chrétiens arrivés, St Pierre se remit avec eux à l'abstinence des viandes défendues, et aux cérémonies de la loi mosaïque.
Cette action paraissait très prudente; il ne voulait pas scandaliser les Juifs chrétiens ses compagnons; mais St Paul s'éleva contre lui avec un peu de dureté. Je lui résistai , dit-il, à sa face, parce qu'il était blâmable . (Epître aux Galates chap. II).
Cette querelle paraît d'autant plus extraordinaire de la part de St Paul, qu'ayant été d'abord persécuteur, il devait être modéré, et que lui-même il était allé sacrifier dans le temple à Jérusalem, qu'il avait circoncis son disciple Timothée, qu'il avait accompli les rites juifs, lesquels il reprochait alors à Céphas. St Jérôme prétend que cette querelle entre Paul et Céphas était feinte. Il dit dans sa première homélie, tom. III, qu'ils firent comme deux avocats qui s'échauffent et se piquent au barreau, pour plus d'autorité sur leurs clients; il dit que Pierre Céphas étant destiné à prêcher aux Juifs, et Paul aux gentils, ils firent semblant de se quereller, Paul pour gagner les gentils, et Pierre pour gagner les Juifs. Mais St Augustin n'est point du tout de cet avis. Je suis fâché , dit-il dans l'épître à Jérôme, qu'un aussi grand homme se rende le patron du mensonge, patronum mendacii .
Cette dispute entre St Jérôme et St Augustin ne doit pas diminuer notre vénération pour eux, encore moins pour St Paul et pour St Pierre.
Au reste, si Pierre était destiné aux Juifs judaïsants, et Paul aux étrangers, il paraît probable que Pierre ne vint point à Rome. Les Actes des apôtres ne font aucune mention du voyage de Pierre en Italie.
Quoi qu'il en soit, ce fut vers l'an 60 de notre ère, que les chrétiens commencèrent à se séparer de la communion juive, et c'est ce qui leur attira tant de querelles et tant de persécutions de la part des synagogues répandues à Rome, en Grèce, dans l'Egypte et dans l'Asie. Ils furent accusés d'impiété, d'athéisme par leurs frères juifs, qui les excommuniaient dans leurs synagogues trois fois les jours du sabbat. Mais Dieu les soutint toujours au milieu des persécutions.
Petit à petit, plusieurs Eglises se formèrent, et la séparation devint entière entre les Juifs et les chrétiens, avant la fin du premier siècle; cette séparation était ignorée du gouvernement romain. Le sénat de Rome, ni les empereurs n'entraient point dans ces querelles d'un petit troupeau que Dieu avait jusque-là conduit dans l'obscurité, et qu'il élevait par des degrés insensibles.
Le christianisme s'établit en Grèce et dans Alexandrie. Les chrétiens y eurent à combattre une nouvelle secte de Juifs devenus philosophes à force de fréquenter les Grecs; c'était celle de la gnose ou des gnostiques; il s'y mêla de nouveaux chrétiens. Toutes ces sectes jouissaient alors d'une entière liberté de dogmatiser, de conférer et d'écrire quand les courtiers juifs établis dans Rome et dans Alexandrie ne les accusaient pas auprès des magistrats; mais sous Domitien la religion chrétienne commença à donner quelque ombrage au gouvernement.
Le zèle de quelques chrétiens, qui n'était pas selon la science, n'empêcha pas l'Eglise de faire les progrès que Dieu lui destinait. Les chrétiens célébrèrent d'abord leurs mystères dans des maisons retirées, dans des caves, pendant la nuit; de là leur vint le titre de lucifugaces (selon Minutius Felix). Philon les appelle gesséens . Leurs noms les plus communs, dans les quatre premiers siècles chez les gentils, étaient ceux de Galiléens , et de Nazaréens ; mais celui de chrétiens a prévalu sur tous les autres.
Ni la hiérarchie, ni les usages ne furent établis tout d'un coup; les temps apostoliques furent différents des temps qui les suivirent.
La messe, qui se célèbre au matin, était la cène qu'on faisait le soir; ces usages changèrent à mesure que l'Eglise se fortifia. Une société plus étendue exigea plus de règlements, et la prudence des pasteurs se conforma aux temps et aux lieux.
St Jérôme et Eusèbe rapportent que quand les Eglises reçurent une forme, on y distingua peu à peu cinq ordres différents. Les surveillants, épiscopoi , d'où sont venus les évêques: les anciens de la société, presbyteroi , les prêtres, les servants, ou diacres; les pistoi , croyants, initiés; c'est-à-dire, les baptisés, qui avaient part aux soupers des agapes, les catéchumènes qui attendaient le baptême, et les énergumènes qui attendaient qu'on les délivrât du démon. Aucun, dans ces cinq ordres, ne portait d'habit différent des autres; aucun n'était contraint au célibat, témoin le livre de Tertullien dédié à sa femme, témoin l'exemple des apôtres. Aucune représentation, soit en peinture, soit en sculpture, dans leurs assemblées, pendant les deux premiers siècles; point d'autels, encore moins de cierges, d'encens et d'eau lustrale. Les chrétiens cachaient soigneusement leurs livres aux gentils; ils ne les confiaient qu'aux initiés; il n'était pas même permis aux catéchumènes de réciter l'oraison dominicale.
DU POUVOIR DE CHASSER LES DIABLES DONNÉ A L'ÉGLISE.
Ce qui distinguait le plus les chrétiens, et ce qui a duré jusqu'à nos derniers temps, était le pouvoir de chasser les diables avec le signe de la croix. Origène dans son Traité contre Celse, avoue au nombre 133 qu'Antinoüs divinisé par l'empereur Adrien, faisait des miracles en Egypte par la force des charmes et des prestiges; mais il dit que les diables sortent du corps des possédés à la prononciation du seul nom de Jésus.
Tertullien va plus loin, et du fond de l'Afrique où il était, il dit dans son Apologétique, au chap. XXIII, Si vos dieux ne confessent pas qu'ils sont des diables à la présence d'un vrai chrétien, nous voulons bien que vous répandiez le sang de ce chrétien. Y a-t-il une démonstration plus claire ?
En effet, Jésus-Christ envoya ses apôtres pour chasser les démons. Les Juifs avaient aussi de son temps le don de les chasser; car lorsque Jésus eut délivré des possédés, et eut envoyé les diables dans les corps d'un troupeau de deux mille cochons, et qu'il eut opéré d'autres guérisons pareilles, les pharisiens dirent, il chasse les démons par la puissance de Belzébuth. Si c'est par Belzébuth que je les chasse , répondit Jésus, par qui vos fils les chassent-ils ? Il est incontestable que les Juifs se vantaient de ce pouvoir: ils avaient des exorcistes, et des exorcismes. On invoquait le nom de Dieu, de Jacob et d'Abraham. On mettait des herbes consacrées dans le nez des démoniaques (Joseph rapporte une partie de ces cérémonies.) Ce pouvoir sur les diables, que les Juifs ont perdu, fut transmis aux chrétiens, qui semblent aussi l'avoir perdu depuis quelque temps.
Dans le pouvoir de chasser les démons, était compris celui de détruire les opérations de la magie; car la magie fut toujours en vigueur chez toutes les nations. Tous les Pères de l'Eglise rendent témoignage à la magie. St Justin avoue dans son Apologétique au livre III qu'on évoque souvent les âmes des morts, et il en tire un argument en faveur de l'immortalité de l'âme. Lactance, au liv. VII de ses Institutions divines, dit, que si on osait nier l'existence des âmes après la mort, le magicien vous en convaincrait bientôt en les faisant paraître . Irénée, Clément Alexandrin, Tertullien, l'évêque Cyprien, tous affirment la même chose. Il est vrai qu'aujourd'hui tout est changé, et qu'il n'y a pas plus de magiciens que de démoniaques. Mais Dieu est le maître d'avertir les hommes par des prodiges dans certains temps, et de les faire cesser dans d'autres.
DES MARTYRS DE L'ÉGLISE.
Quand les sociétés chrétiennes devinrent un peu nombreuses, et que plusieurs s'élevèrent contre le culte de l'empire romain, les magistrats sévirent contre elles, et les peuples surtout les persécutèrent. On ne persécutait point les Juifs qui avaient des privilèges particuliers, et qui se renfermaient dans leurs synagogues; on leur permettait l'exercice de leur religion, comme on fait encore aujourd'hui à Rome; on souffrait tous les cultes divers répandus dans l'empire, quoique le sénat ne les adoptât pas.
Mais les chrétiens se déclarant ennemis de tous ces cultes, et surtout de celui de l'empire, furent exposés plusieurs fois à ces cruelles épreuves.
Un des premiers, et des plus célèbres martyrs, fut Ignace évêque d'Antioche, condamné par l'empereur Trajan lui-même, alors en Asie, et envoyé par ses ordres à Rome, pour être exposé aux bêtes, dans un temps où l'on ne massacrait point à Rome les autres chrétiens. On ne sait point précisément de quoi il était accusé auprès de cet empereur, renommé d'ailleurs pour sa clémence; il fallait que St Ignace eût de bien violents ennemis. Quoi qu'il en soit, l'histoire de son martyre rapporte qu'on lui trouva le nom de Jésus-Christ gravé sur le coeur, en caractères d'or; et c'est de là que les chrétiens prirent en quelques endroits le nom de théophores , qu'Ignace s'était donné à lui-même.
On nous a conservé une lettre de lui, [54] par laquelle il prie les évêques et les chrétiens de ne point s'opposer à son martyre; soit que dès lors les chrétiens fussent assez puissants pour le délivrer, soit que parmi eux quelques-uns eussent assez de crédit pour obtenir sa grâce. Ce qui est encore très remarquable, c'est qu'on souffrit que les chrétiens de Rome vinssent au-devant de lui, quand il fut amené dans cette capitale; ce qui prouverait évidemment qu'on punissait en lui la personne, et non pas la secte.
Les persécutions ne furent pas continuées. Origène dans son livre III contre Celse, dit, On ne peut compter facilement les chrétiens qui sont morts pour leur religion, parce qu'il en est mort peu, et seulement de temps en temps, et par intervalle .
Dieu eut un si grand soin de son Eglise, que malgré ses ennemis, il fit en sorte qu'elle tînt cinq conciles dans le premier siècle, seize dans le second, et trente dans le troisième; c'est-à-dire, des assemblées secrètes et tolérées. Ces assemblées furent quelquefois défendues, quand la fausse prudence des magistrats craignit qu'elles ne devinssent tumultueuses. Il nous est resté peu de procès-verbaux des proconsuls et des préteurs qui condamnèrent les chrétiens à mort. Ce serait les seuls actes sur lesquels on pût constater les accusations portées contre eux, et leurs supplices.
Nous avons un fragment de Denys d'Alexandrie, dans lequel il rapporte l'extrait du greffe d'un proconsul d'Egypte, sous l'empereur Valérien; le voici.
‘Denys, Fauste, Maxime, Marcel, et Cherémon, ayant été introduits à l'audience, le préfet Emilien leur a dit: Vous avez pu connaître par les entretiens que j'ai eus avec vous, et par tout ce que je vous ai écrit, combien nos princes ont témoigné de bonté à votre égard; je veux bien encore vous le redire: ils font dépendre votre conservation et votre salut de vous-mêmes, et votre destinée est entre vos mains: ils ne demandent de vous qu'une seule chose, que la raison exige de toute personne raisonnable, c'est que vous adoriez les dieux protecteurs de leur empire, et que vous abandonniez cet autre culte si contraire à la nature et au bon sens.'
Denys a répondu: ‘Chacun n'a pas les mêmes dieux, et chacun adore ceux qu'il croit l'être véritablement.'
Le préfet Emilien a repris: ‘Je vois bien que vous êtes des ingrats, qui abusez des bontés que les empereurs ont pour vous. Eh bien, vous ne demeurerez pas davantage dans cette ville, et je vous envoie à Cephro dans le fond de la Lybie; ce sera là le lieu de votre bannissement, selon l'ordre que j'en ai reçu de nos empereurs: au reste, ne pensez pas y tenir vos assemblées, ni aller faire vos prières dans ces lieux que vous nommez des cimetières, cela vous est absolument défendu, et je ne le permettrai à personne.'
Rien ne porte plus les caractères de vérité, que ce procès-verbal. On voit par là qu'il y avait des temps où les assemblées étaient prohibées. C'est ainsi qu'en France il est défendu aux calvinistes de s'assembler; on a même quelquefois fait pendre et rouer des ministres, ou prédicants, qui tenaient des assemblées malgré les lois; et depuis 1745 il y en a eu six de pendus. C'est ainsi qu'en Angleterre et en Irlande, les assemblées sont défendues aux catholiques romains; et il y a eu des occasions, où les délinquants ont été condamnés à la mort.
Malgré ces défenses portées par les lois romaines, Dieu inspira à plusieurs empereurs de l'indulgence pour les chrétiens. Dioclétien même, qui passe chez les ignorants pour un persécuteur, Dioclétien dont la première année de règne est encore l'époque de l'ère des martyrs, fut, pendant plus de dix-huit ans, le protecteur déclaré du christianisme, au point que plusieurs chrétiens eurent des charges principales auprès de sa personne. Il épousa même une chrétienne, il souffrit que dans Nicomédie sa résidence, il y eût une superbe église, élevée vis-à-vis son palais.
Le césar Galérius ayant malheureusement été prévenu contre les chrétiens, dont il croyait avoir à se plaindre, engagea Dioclétien à faire détruire la cathédrale de Nicomédie. Un chrétien plus zélé que sage, mit en pièces l'édit de l'empereur, et de là vint cette persécution si fameuse, dans laquelle il y eut plus de deux cents personnes exécutées à mort dans l'empire romain, sans compter ceux que la fureur du petit peuple, toujours fanatique, et toujours barbare, fit périr, contre les formes juridiques.
Il y eut en divers temps un si grand nombre de martyrs, qu'il faut bien se donner de garde d'ébranler la vérité de l'histoire de ces véritables confesseurs de notre sainte religion, par un mélange dangereux de fables, et de faux martyrs.
Le bénédictin Dom Ruinart, par exemple, homme d'ailleurs aussi instruit qu'estimable et zélé, aurait dû choisir avec plus de discrétion ses Actes sincères. Ce n'est pas assez qu'un manuscrit soit tiré de l'abbaye de St Benoît-sur-Loire, ou d'un couvent de célestins de Paris, conforme à un manuscrit des feuillants, pour que cet acte soit authentique; il faut que cet acte soit ancien, écrit par des contemporains, et qu'il porte d'ailleurs tous les caractères de la vérité.
Il aurait pu se passer de rapporter l'aventure du jeune Romanus, arrivée en 303. Ce jeune Romain avait obtenu son pardon de Dioclétien dans Antioche. Cependant, il dit que le juge Asclépiade le condamna à être brûlé. Des Juifs présents à ce spectacle, se moquèrent du jeune St Romanus, et reprochèrent aux chrétiens que leur Dieu les laissait brûler, lui qui avait délivré Sidrac, Misac, et Abdenago de la fournaise; qu'aussitôt il s'éleva, dans le temps le plus serein, un orage qui éteignit le feu; qu'alors le juge ordonna qu'on coupât la langue au jeune Romanus; que le premier médecin de l'empereur se trouvant là, fit officieusement la fonction de bourreau, et lui coupa la langue dans la racine; qu'aussitôt le jeune homme qui était bègue auparavant, parla avec beaucoup de liberté; que l'empereur fut étonné que l'on parlât si bien sans langue; que le médecin pour réitérer cette expérience coupa sur-le-champ la langue à un passant, lequel en mourut subitement.
Eusèbe, dont le bénédictin Ruinart a tiré ce conte, devait respecter assez les vrais miracles, opérés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament (desquels personne ne doutera jamais) pour ne pas leur associer des histoires si suspectes, lesquelles pourraient scandaliser les faibles.
Cette dernière persécution ne s'étendit pas dans tout l'empire. Il y avait alors en Angleterre quelque christianisme, qui s'éclipsa bientôt pour reparaître sous les rois saxons. Les Gaules méridionales et l'Espagne, étaient remplies de chrétiens. Le césar Constance-Clore les protégea beaucoup dans toutes ces provinces. Il avait une concubine, qui était chrétienne, c'est la mère de Constantin, connue sous le nom de Ste Hélène; car il n'y eut jamais de mariage avéré entre elle et lui, et il la renvoya même dès l'an 292 quand il épousa la fille de Maximien-Hercule; mais elle avait conservé sur lui beaucoup d'ascendant, et lui avait inspiré une grande affection pour notre sainte religion.
DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉGLISE SOUS CONSTANTIN.
La divine Providence préparait ainsi, par des voies qui semblent humaines, le triomphe de son Eglise.
Constance-Clore mourut en 306 à Yorck en Angleterre, dans un temps où les enfants qu'il avait de la fille d'un césar étaient en bas âge, et ne pouvaient prétendre à l'empire. Constantin eut la confiance de se faire élire à Yorck par cinq ou six mille soldats allemands, gaulois et anglais pour la plupart. Il n'y avait pas d'apparence que cette élection faite sans le consentement de Rome, du sénat, et des armées, pût prévaloir; mais Dieu lui donna la victoire sur Maxentius élu à Rome, et le délivra enfin de tous ses collègues. On ne peut dissimuler qu'il ne se rendit d'abord indigne des faveurs du ciel, par le meurtre de tous ses proches, et enfin de sa femme et de son fils.
On peut douter de ce que Zozime rapporte à ce sujet. Il dit que Constantin agité de remords, après tant de crimes, demanda aux pontifes de l'empire, s'il y avait quelques expiations pour lui, et qu'ils lui dirent qu'ils n'en connaissaient pas. Il est bien vrai qu'il n'y en avait point eu pour Néron, et qu'il n'avait osé assister aux sacrés mystères en Grèce. Cependant, les tauroboles étaient en usage; et il est bien difficile de croire qu'un empereur tout-puissant n'ait pu trouver un prêtre qui voulût lui accorder des sacrifices expiatoires. Peut-être même est-il encore moins croyable que Constantin occupé de la guerre, de son ambition, de ses projets, et environné de flatteurs, ait eu le temps d'avoir des remords. Zozime ajoute qu'un prêtre égyptien arrivé d'Espagne, qui avait accès à sa porte, lui promit l'expiation de tous ses crimes dans la religion chrétienne. On a soupçonné que ce prêtre était Ozius évêque de Cordoue.
Quoi qu'il en soit, Dieu réserva Constantin pour l'éclairer et pour en faire le protecteur de l'Eglise. Ce prince fit bâtir sa ville de Constantinople, qui devint le centre de l'empire et de la religion chrétienne. Alors l'Eglise prit une forme auguste. Et il est à croire que lavé par son baptême et repentant à sa mort, il obtint miséricorde, quoiqu'il soit mort arien. Il serait bien dur que tous les partisans des deux évêques Eusèbe eussent été damnés.
Dès l'an 314, avant que Constantin résidât dans sa nouvelle ville, ceux qui avaient persécuté les chrétiens furent punis par eux de leurs cruautés. Les chrétiens jetèrent la femme de Maximien dans l'Oronte; ils égorgèrent tous ses parents; ils massacrèrent dans l'Egypte et dans la Palestine, les magistrats qui s'étaient le plus déclarés contre le christianisme. La veuve et la fille de Dioclétien s'étant cachées à Thessalonique, furent reconnues, et leurs corps jetés dans la mer. Il eût été à souhaiter que les chrétiens eussent moins écouté l'esprit de vengeance; mais Dieu qui punit selon sa justice, voulut que les mains des chrétiens fussent teintes du sang de leurs persécuteurs, sitôt que ces chrétiens furent en liberté d'agir.
Constantin convoqua, assembla dans Nicée, vis-à-vis de Constantinople, le premier concile oecuménique, auquel présida Ozius. On y décida la grande question qui agitait l'Eglise, touchant la divinité de Jésus-Christ. (Voyez Arianisme . )
On sait assez comme l'Eglise ayant combattu trois cents ans contre les rites de l'empire romain, combattit ensuite contre elle-même, et fut toujours militante et triomphante.
Dans la suite des temps l'Eglise grecque presque tout entière, et toute l'Eglise d'Afrique devinrent esclaves sous les Arabes, et ensuite sous les Turcs, qui élevèrent la religion mahométane sur les ruines de la chrétienne. L'Eglise romaine subsista, mais toujours souillée de sang par plus de six cents ans de discorde entre l'empire d'Occident et le sacerdoce. Ces querelles mêmes la rendirent très puissante. Les évêques, les abbés en Allemagne se firent tous princes, et les papes acquirent peu à peu la domination absolue dans Rome et dans un pays considérable. Ainsi Dieu éprouva son Eglise par les humiliations, par les troubles, par les crimes, et par la splendeur.
Cette Eglise latine perdit au seizième siècle la moitié de l'Allemagne, le Dannemarck, la Suède, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, la meilleure partie de la Suisse, la Hollande; elle a gagné plus de terrain en Amérique par les conquêtes des Espagnols, qu'elle n'en a perdu en Europe, mais avec plus de territoire elle a bien moins de sujets.
La Providence divine semblait destiner le Japon, Siam, l'Inde et la Chine, à se ranger sous l'obéissance du pape, pour le récompenser de l'Asie mineure, de la Syrie, de la Grèce, de l'Egypte, de l'Afrique, de la Russie, et des autres Etats perdus, dont nous avons parlé. St François Xavier qui porta le St Evangile aux Indes orientales, et au Japon quand les Portugais y allèrent chercher des marchandises, fit un très grand nombre de miracles, tous attestés par les RR. PP. jésuites; quelques-uns disent qu'il ressuscita neuf morts; mais le R. P. Ribadeneira, dans sa Fleur des saints , se borne à dire qu'il n'en ressuscita que quatre; c'est bien assez. La Providence voulut qu'en moins de cent années il y eût des milliers de catholiques romains dans les îles du Japon. Mais le diable sema son ivraie au milieu du bon grain. Les jésuites, à ce qu'on croit, formèrent une conjuration suivie d'une guerre civile, dans laquelle tous les chrétiens furent exterminés en 1638. Alors la nation ferma ses ports à tous les étrangers, excepté aux Hollandais qu'on regardait comme des marchands, et non pas comme des chrétiens, et qui furent d'abord obligés de marcher sur la croix pour obtenir la permission de vendre leurs denrées dans la prison où on les renferme lorsqu'ils abordent à Nangazaki.
La religion catholique, apostolique et romaine fut proscrite à la Chine dans nos derniers temps, mais d'une manière moins cruelle. Les RR. PP. jésuites n'avaient pas à la vérité ressuscité des morts à la cour de Pékin, ils s'étaient contentés d'enseigner l'astronomie, de fondre du canon, et d'être mandarins. Leurs malheureuses disputes avec des dominicains et d'autres, scandalisèrent à tel point le grand empereur Yontchin, que ce prince qui était la justice et la bonté mêmes, fut assez aveugle pour ne plus permettre qu'on enseignât notre sainte religion, dans laquelle nos missionnaires ne s'accordaient pas. Il les chassa avec une bonté paternelle, leur fournissant des subsistances et des voitures jusqu'aux confins de son empire.
Toute l'Asie, toute l'Afrique, la moitié de l'Europe, tout ce qui appartient aux Anglais, aux Hollandais dans l'Amérique, toutes les hordes américaines non domptées, toutes les terres australes, qui sont une cinquième partie du globe, sont demeurées la proie du démon, pour vérifier cette sainte parole: Il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus .
DE LA SIGNIFICATION DU MOT EGLISE. PORTRAIT DE L'ÉGLISE PRIMITIVE. DÉGÉNÉRATION. EXAMEN DES SOCIÉTÉS QUI ONT VOULU RÉTABLIR L'ÉGLISE PRIMITIVE ET PARTICULIÈREMENT DES PRIMITIFS APPELLÉS QUAKERS.
Ce mot grec signifiait chez les Grecs assemblée du peuple . Quand on traduisit les livres hébreux en grec, on rendit synagogue par église, et on se servit du même nom pour exprimer la sociétè juive , la congrégation politique , l' assemblée juive , le peuple juif . Ainsi il est Ch. XX, v. 4. dit dans les Nombres: Pourquoi avez-vous mené l'Eglise dans le désert? Ch. XXIII, v. 1, 2, et 3. Et dans le Deutéronome: L'eunuque, le Moabite, l'Ammonite n'entreront pas dans l'Eglise; les Iduméens, les Egyptiens n'entreront dans l'Eglise qu'à la troisième génération .
Chapitre XXXVIII. Jésus-Christ dit dans St Matthieu: ‘Si votre frère a péché contre vous, (vous a offensé) reprenez-le entre vous et lui. Prenez, amenez avec vous un ou deux témoins, afin que tout s'éclaircisse par la bouche de deux ou trois témoins; et s'il ne les écoute pas, plaignez-vous à l'assemblée du peuple, à l'Eglise: et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit comme un gentil ou un receveur des deniers publics. Je vous dis, ainsi soit-il, en vérité, tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié au ciel; et ce que vous aurez délié sur terre sera délié au ciel.' (Allusion aux clés des portes dont on liait et déliait la courroie.)
Il s'agit ici de deux hommes dont l'un a offensé l'autre et persiste. On ne pouvait le faire comparaître dans l'assemblée, dans l'Eglise chrétienne, il n'y en avait point encore; on ne pouvait faire juger cet homme dont son compagnon se plaignait, par un évêque et par les prêtres qui n'existaient pas encore; de plus, ni les prêtres juifs, ni les prêtres chrétiens ne furent jamais juges des querelles entre particuliers; c'était une affaire de police. Les évêques ne devinrent juges que vers le temps de Valentinien III.
Les commentateurs ont donc conclu que l'écrivain sacré de cet Evangile fait parler ici notre Seigneur par anticipation, que c'est une allégorie, une prédiction de ce qui arrivera quand l'Eglise chrétienne sera formée et établie.
In Sinedriis hebraeorum , liv. II. Selden fait une remarque importante sur ce passage; c'est qu'on n'excommuniait point chez les Juifs les publicains, les receveurs des deniers royaux. Le petit peuple pouvait les détester; mais étant des officiers nécessaires nommés par le prince, il n'était jamais tombé dans la tête de personne de vouloir les séparer de l' assemblée . Les Juifs étaient alors sous la domination du proconsul de Syrie, qui étendait sa juridiction jusqu'aux confins de la Galilée et jusque dans l'île de Chypre, où il avait des vice-gérants. Il aurait été très imprudent de marquer publiquement son horreur pour les officiers légaux du proconsul. L'injustice même eût été jointe à l'imprudence: car les chevaliers romains fermiers du domaine public, les receveurs de l'argent de César étaient autorisés par les lois.
St Augustin dans son sermon LXXXI, peut fournir des réflexions pour l'intelligence de ce passage. Il parle de ceux qui gardent leur haine, qui ne veulent point pardonner. Coepisti habere fratrem tuum tanquam publicanum . Ligas illum in terrâ ; sed ut juste alliges , vide : nam injusta vincula disrumpit justitia . Cum autem correxeris et concordaveris cum fratre tuo , solvisti eum in terra .
‘Vous regardez votre frère comme un publicain. C'est l'avoir lié sur la terre. Mais voyez si vous le liez justement: car la justice rompt les liens injustes. Mais si vous avez corrigé votre frère, si vous vous êtes accordé avec lui, vous l'avez délié sur la terre.'
Il semble par la manière dont St Augustin s'explique, que l'offensé ait fait mettre l'offenseur en prison, et qu'on doive entendre que s'il est jeté dans les liens sur la terre, il est aussi dans les liens célestes; mais que si l'offensé est inexorable, il devient lié lui-même. Il n'est point question de l'Eglise dans l'explication de St Augustin; il ne s'agit que de pardonner ou de ne pardonner pas une injure. St Augustin ne parle point ici du droit sacerdotal de remettre les péchés de la part de Dieu. C'est un droit reconnu ailleurs, un droit dérivé du sacrement de la confession. St Augustin tout profond qu'il est dans les types et dans les allégories, ne regarde pas ce fameux passage comme une allusion à l'absolution donnée ou refusée par les ministres de l'Eglise catholique romaine dans le sacrement de pénitence.
DU NOM D'EGLISE DANS LES SOCIETÉS CHRÉTIENNES.
On ne reconnaît dans plusieurs Etats chrétiens que quatre Eglises, la grecque, la romaine, la luthérienne, la réformée ou calviniste. Il en est ainsi en Allemagne; les primitifs ou quakers, les anabaptistes, les sociniens, les memnonistes, les piétistes, les moraves, les juifs et autres, ne forment point d'Eglise. La religion juive a conservé le titre de synagogue. Les sectes chrétiennes qui sont tolérées, n'ont que des assemblées secrètes, des conventicles; il en est de même à Londres.
On ne reconnaît l'Eglise catholique ni en Suède ni en Dannemarck, ni dans les parties septentrionales de l'Allemagne, ni en Hollande, ni dans les trois quarts de la Suisse, ni dans les trois royaumes de la Grande-Bretagne.
DE LA PRIMITIVE EGLISE, ET DE CEUX QUI ONT CRU LA RÉTABLIR.
Les Juifs, ainsi que tous les peuples de Syrie, furent divisés en plusieurs petites congrégations religieuses, comme nous l'avons vu: toutes tendaient à une perfection mystique.
Un rayon plus pur de lumière anima les disciples de St Jean, qui subsistent encore vers Mosul. Enfin vint sur la terre le fils de Matth. ch. XX et Marc ch. IX et X. Dieu annoncé par St Jean. Ses disciples furent constamment tous égaux. Jésus leur avait dit expressément: Il n'y aura parmi vous ni premier, ni dernier. . . Je suis venu pour servir et non pour être servi. . . Celui qui voudra être le maître des autres les servira .
Une preuve d'égalité c'est que les chrétiens dans les commencements, ne prirent d'autre nom que celui de frères . Ils s'assemblaient et attendaient l'esprit: ils prophétisaient quand ils étaient inspirés. Ch. XIV. St Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, leur dit: Si dans votre assemblée chacun de vous a le don du cantique, celui de la doctrine, celui de l'apocalypse, celui des langues, celui d'interpréter, que tout soit à l'édification. Si quelqu'un parle de la langue comme deux ou trois et par parties, qu'il y en ait un qui interprète .
Que deux ou trois prophètes parlent, que les autres jugent; et que si quelque chose est révélé à un autre, que le premier se taise: car vous pouvez tous prophétiser chacun à part; afin que tous apprennent et que tous exhortent, l'esprit de prophétie est soumis aux prophètes: car le Seigneur est un Dieu de paix . . . Ainsi donc, mes frères, ayez tous l'emulation de prophétiser, et n'empêchez point de parler des langues .
J'ai traduit mot à mot, par respect pour le texte, et pour ne point entrer dans des disputes de mots.
Ch. XI, v. 5. St Paul, dans la même épître, convient que les femmes peuvent prophétiser, quoiqu'il leur défende au chapitre XIV de parler dans les assemblées. Toute femme , dit-il, priant ou prophétisant sans avoir un voile sur la tête, souille sa tête: car c'est comme si elle était chauve .
Il est clair par tous ces passages et par beaucoup d'autres, que les premiers chrétiens étaient tous égaux, non seulement comme frères en Jésus-Christ, mais comme également partagés. L'esprit se communiquait également à eux; ils parlaient également diverses langues; ils avaient également le don de prophétiser, sans distinction de rang ni d'âge, ni de sexe.
Les apôtres qui enseignaient les néophytes, avaient sans doute sur eux cette prééminence naturelle que le précepteur a sur l'écolier; mais de juridiction, de puissance temporelle, de ce qu'on appelle honneurs dans le monde, de distinction dans l'habillement, de marque de supériorité, ils n'en avaient assurément aucune, ni ceux qui leur succédèrent. Ils possédaient une autre grandeur bien différente, celle de la persuasion.
Actes des apôtres, ch. VI. Les frères mettaient leur argent en commun. Ce furent eux-mêmes qui choisirent sept d'entre eux pour avoir soin des tables et de pourvoir aux nécessités communes. Ils élurent dans Jérusalem même ceux que nous nommons Etienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. Ce qu'on peut remarquer, c'est que parmi ces sept élus par la communauté juive, il y a six Grecs.
Après les apôtres on ne trouve aucun exemple d'un chrétien qui ait eu sur les autres chrétiens d'autre pouvoir que celui d'enseigner, d'exhorter, de chasser les démons du corps des énergumènes, de faire des miracles. Tout est spirituel; rien ne se ressent des pompes du monde. Ce n'est guère que dans le troisième siècle que l'esprit d'orgueil, de vanité, d'intérêt se manifesta de tous côtés chez les fidèles.
Les agapes étaient déjà de grands festins, on leur reprochait Tertullien chapitre XXXIX. le luxe et la bonne chère. Tertullien l'avoue. ‘Oui, dit-il, nous faisons grande chère; mais dans les mystères d'Athènes et d'Egypte ne fait-on pas bonne chère aussi? Quelque dépense que nous fassions, elle est utile et pieuse, puisque les pauvres en profitent.' Quamtiscumque sumptibus constet , lucrum est pietatis , siquidem inopes refrigerio isto juvamus .
Dans ce temps-là même des sociétés de chrétiens qui osaient se dire plus parfaites que les autres, les montanistes, par exemple, qui se vantaient de tant de prophéties et d'une morale si austère, qui regardaient les secondes noces comme des adultères, et la fuite de la persécution comme une apostasie, qui avaient si publiquement des convulsions sacrées et des extases, qui prétendaient parler à Dieu face à face, furent convaincus, à ce qu'on prétend, de mêler le sang d'un enfant d'un an au pain de l'eucharistie. Ils attirèrent sur les véritables chrétiens ce cruel reproche qui les exposa aux persécutions.
Augustin de heresibus . Heresi XXVI. Voici comme ils s'y prenaient, selon St Augustin; ils piquaient avec des épingles tout le corps de l'enfant, ils pétrissaient la farine avec ce sang et en faisaient un pain; s'il en mourait, ils l'honoraient comme un martyr.
Les moeurs étaient si corrompues, que les saints Pères ne cessaient de s'en plaindre. Ecoutez St Cyprien dans son livre des Voyez les oeuvres de St Cyprien et l'Hist. ecclésiast. de Fleuri, tome II, pag. 168. édition in-12, 1725. Tombés : ‘Chaque prêtre, dit-il, court après les biens et les honneurs avec une fureur insatiable. Les évêques sont sans religion, les femmes sans pudeur, la friponnerie règne; on jure, on se parjure; les animosités divisent les chrétiens; les évêques abandonnent les chaires pour courir aux foires, et pour s'enrichir par le négoce; enfin, nous nous plaisons à nous seuls, et nous déplaisons à tout le monde.'
Avant ces scandales, le prêtre Novatien en avait donné un bien funeste aux fidèles de Rome: il fut le premier antipape. L'épiscopat de Rome quoique secret, et exposé à la persécution, était un objet d'ambition et d'avarice par les grandes contributions des chrétiens, et par l'autorité de la place.
Ne répétons point ici ce qui est déposé dans tant d'archives, ce qu'on entend tous les jours dans la bouche des personnes instruites; ce nombre prodigieux de schismes et de guerres; six cents années de querelles sanglantes entre l'empire et le sacerdoce; l'argent des nations coulant par mille canaux, tantôt à Rome, tantôt dans Avignon lorsque les papes y fixèrent leur séjour pendant soixante et douze ans; et le sang coulant dans toute l'Europe soit pour l'intérêt d'une tiare si inconnue à Jésus-Christ, soit pour des questions inintelligibles dont il n'a jamais parlé. Notre religion n'en est pas moins vraie, moins sacrée, moins divine, pour avoir été souillée si longtemps dans le crime, et plongée dans le carnage.
Quand la fureur de dominer, cette terrible passion du coeur humain, fut parvenue à son dernier excès, lorsque le moine Hildebrand élu contre les lois évêque de Rome, arracha cette capitale aux empereurs, et défendit à tous les évêques d'Occident de porter l'ancien nom de pape pour se l'attribuer à lui seul, lorsque les évêques d'Allemagne à son exemple se rendirent souverains, que tous ceux de France et d'Angleterre tâchèrent d'en faire autant, il s'éleva depuis ces temps affreux jusqu'à nos jours, des sociétés chrétiennes, qui sous cent noms différents voulurent rétablir l'égalité primitive dans le christianisme.
Mais ce qui avait été praticable dans une petite société cachée au monde, ne l'était plus dans de grands royaumes. L'Eglise militante et triomphante ne pouvait plus être l'Eglise ignorée et humble. Les évêques, les grandes communautés monastiques riches et puissantes se réunissant sous les étendards du pontife de la Rome nouvelle, combattirent alors pro aris et pro focis , pour leurs autels et pour leurs foyers. Croisades, armées, sièges, batailles, rapines, tortures, assassinats par la main des bourreaux, assassinats par la main des prêtres des deux partis, poisons, dévastations par le fer et par la flamme, tout fut employé pour soutenir ou pour humilier la nouvelle administration ecclésiastique; et le berceau de la primitive Eglise fut tellement caché sous les flots de sang et sous les ossements des morts, qu'on put à peine le retrouver.
DES PRIMITIFS APPELLÉS QUAKERS.
Les guerres religieuses et civiles de la Grande-Bretagne, ayant désolé l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande dans le règne infortuné de Charles I er , Guillaume Penn, fils d'un vice-amiral, résolut d'aller rétablir ce qu'il appelait la primitive Eglise , sur les rivages de l'Amérique septentrionale, dans un climat doux, qui lui parut fait pour ses moeurs. Sa secte était nommée celle des trembleurs ; dénomination ridicule, mais qu'ils méritaient par les tremblements de corps qu'ils affectaient en prêchant, et par un nasillonnement qui ne fut dans l'Eglise romaine que le partage d'une espèce de moines appelés capucins . Mais on peut en parlant du nez et en se secouant, être doux, frugal, modeste, juste, charitable. Personne ne nie que cette société de primitifs ne donnât l'exemple de toutes ces vertus.
Penn voyait que les évêques anglicans et les presbytériens avaient été la cause d'une guerre affreuse pour un surplis, des manches de linon, et une liturgie; il ne voulut ni liturgie, ni linon, ni surplis. Les apôtres n'en avaient point. Jésus-Christ n'avait baptisé personne; les associés de Penn ne voulurent point être baptisés.
Les premiers fidèles étaient égaux; ces nouveaux venus prétendirent l'être autant qu'il est possible. Les premiers disciples reçurent l'esprit et parlaient dans l'assemblée; ils n'avaient ni autels, ni temples, ni ornements, ni cierges, ni encens, ni cérémonies; Penn et les siens se flattèrent de recevoir l'esprit, et renoncèrent à toute cérémonie, à tout appareil. La charité était précieuse aux disciples du Sauveur; ceux de Penn firent une bourse commune pour secourir les pauvres. Ainsi ces imitateurs des esséniens et des premiers chrétiens, quoique errant dans les dogmes et dans les rites, étaient pour toutes les autres sociétés chrétiennes un modèle étonnant de morale et de police.
Enfin, cet homme singulier alla s'établir avec cinq cents des siens dans le canton alors le plus sauvage de l'Amérique. La reine Christine de Suède avait voulu y fonder une colonie qui n'avait pas réussi; les primitifs de Penn eurent plus de succès.
C'était sur les bords de la rivière Laware, vers le quarantième degré. Cette contrée n'appartenait au roi d'Angleterre que parce qu'elle n'était réclamée alors par personne, et que les peuples nommés par nous sauvages , qui auraient pu la cultiver, avaient toujours demeuré assez loin dans l'épaisseur des forêts. Si l'Angleterre n'avait eu ce pays que par droit de conquête, Penn et ses primitifs auraient eu en horreur un tel asile. Ils ne regardaient ce prétendu droit de conquête que comme une violation du droit de la nature, et comme une rapine.
Le roi Charles II déclara Penn souverain de tout ce pays désert, par l'acte le plus authentique du 4 mars 1681. Penn, dès l'année suivante y promulgua ses lois. La première fut la liberté civile entière, de sorte que chaque colon possédant cinquante acres de terre était membre de la législation; la seconde une défense expresse aux avocats et aux procureurs de prendre jamais d'argent; la troisième l'admission de toutes les religions, et la permission même à chaque habitant d'adorer Dieu dans sa maison, sans assister jamais à aucun culte public:
Voici cette loi telle qu'elle est portée.
‘La liberté de conscience étant un droit que tous les hommes ont reçu de la nature avec l'existence, et que tous les gens paisibles doivent maintenir; il est fermement établi, que personne ne sera forcé d'assister à aucun exercice public de religion.
‘Mais il est expressément donné plein pouvoir à un chacun de faire librement l'exercice public ou privé de sa religion, sans qu'on puisse y apporter aucun trouble ni empêchement sous aucun prétexte; pourvu qu'il fasse profession de croire en un seul Dieu éternel, tout-puissant, créateur, conservateur, gouverneur de l'univers, et qu'il remplisse tous les devoirs de la société civile, auxquels on est obligé envers ses compatriotes.'
Cette loi est encore plus indulgente, plus humaine que celle qui fut donnée aux peuples de la Caroline par Locke le Platon de l'Angleterre, si supérieur au Platon de la Grèce. Locke n'a permis d'autres religions publiques que celles qui seraient approuvées par sept pères de famille. C'est une autre sorte de sagesse que celle de Penn.
Mais ce qui est pour jamais honorable pour ces deux législateurs, et ce qui doit servir d'exemple éternel au genre humain, c'est que cette liberté de conscience n'a pas causé le moindre trouble. On dirait au contraire que Dieu a répandu ses bénédictions les plus sensibles fur la colonie de la Pensilvanie. Elle était de cinq cents personnes en 1682; et en moins d'un siècle elle s'est accrue jusqu'à près de trois cent mille: c'est la proportion de cinquante à un. La moitié des colons est de la religion primitive; vingt autres religions composent l'autre moitié. Il y a douze beaux temples dans Philadelphie, et d'ailleurs chaque maison est un temple. Cette ville a mérité son nom d' amitié fraternelle . Sept autres villes et mille bourgades fleurissent sous cette loi de concorde. Trois cents vaisseaux partent du port tous les ans.
Cet établissement qui semble mériter une durée éternelle, fut sur le point de périr dans la funeste guerre de 1755, quand d'un côté les Français avec leurs alliés sauvages, et les Anglais avec les leurs commencèrent par se disputer quelques glaçons de l'Acadie.
Les primitifs, fidèles à leur christianisme pacifique, ne voulurent point prendre les armes. Des sauvages tuèrent quelques-uns de leurs colons sur la frontière. Les primitifs n'usèrent point de représailles; ils refusèrent même longtemps de payer des troupes; ils dirent au général anglais ces propres paroles: Les hommes sont des morceaux d'argile qui se brisent les uns contre les autres , pourquoi les aiderons-nous à se briser ?
Enfin, dans l'assemblée générale par qui tout se règle, les autres religions l'emportèrent; on leva des milices; les primitifs contribuèrent; mais ils ne s'armèrent point. Ils obtinrent ce qu'ils s'étaient proposé, la paix avec leurs voisins. Ces prétendus sauvages leur dirent, Envoyez-nous quelque descendant du grand Penn qui ne nous trompa jamais ; nous traiterons avec lui . On leur députa un petit-fils de ce grand homme, et la paix fut conclue.
Plusieurs primitifs avaient des esclaves nègres pour cultiver leurs terres; mais ils ont été honteux d'avoir en cela imité les autres chrétiens; ils ont donné la liberté à leurs esclaves en 1769.
Toutes les autres colonies les imitent aujourd'hui dans la liberté de conscience; et quoiqu'il y ait des presbytériens et des gens de la haute Eglise, personne n'est gêné dans sa croyance. C'est ce qui a égalé le pouvoir des Anglais en Amérique à la puissance espagnole qui possède l'or et l'argent. Il y aurait un moyen sûr d'énerver toutes les colonies anglaises, ce serait d'y établir l'Inquisition.
NB. L'exemple des primitifs nommés quakers a produit dans la Pensilvanie une société nouvelle dans un canton qu'elle appelle Eufrate , c'est la secte des dunkards, ou des dumplers, beaucoup plus détachée du monde que celle de Penn, espèce de religieux hospitaliers, tous vêtus uniformément; elle ne permet pas aux mariés d'habiter la ville d'Eufrate, ils vivent à la campagne qu'ils cultivent. Le trésor public fournit à tous leurs besoins dans les disettes. Cette société n'administre le baptême qu'aux adultes; elle rejette le péché originel comme une impiété, et l'éternité des peines comme une barbarie. Leur vie pure ne leur laisse pas imaginer que Dieu puisse tourmenter ses créatures cruellement, et éternellement. Egarés dans un coin du nouveau monde, loin du troupeau de l'Eglise catholique, ils sont jusqu'à présent, malgré cette malheureuse erreur, les plus justes et les plus inimitables des hommes.
QUERELLES ENTRE L'ÉGLISE GRECQUE ET LA LATINE, DANS L'ASIE ET DANS L'EUROPE.
Les gens de bien gémissent depuis environ quatorze siècles que les deux Eglises grecque et latine aient été toujours rivales, et que la robe de Jésus-Christ qui était sans couture ait été toujours déchirée. Cette division est bien naturelle. Rome et Constantinople se haïssaient; quand les maîtres se détestent, leurs aumôniers ne s'aiment pas. Les deux communions se disputaient la supériorité de la langue, l'antiquité des sièges, la science, l'éloquence, le pouvoir.
Il est vrai que les Grecs eurent longtemps tout l'avantage; ils se vantaient d'avoir été les maîtres des Latins, et de leur avoir tout enseigné. Les Evangiles furent écrits en grec. Il n'y avait pas un dogme, un rite, un mystère, un usage qui ne fût grec; depuis le mot de baptême jusqu'au mot d' eucharistie , tout était grec. On ne connut de Pères de l'Eglise que parmi les Grecs jusqu'à St Jérôme qui même n'était pas romain, puisqu'il était de Dalmatie. St Augustin qui suivit de près St Jérôme, était Africain. Les sept grands conciles oecuméniques furent tenus dans des villes grecques; les évêques de Rome n'y parurent jamais, parce qu'ils ne savaient que leur latin, qui même était déjà très corrompu.
L'inimitié entre Rome et Constantinople éclata dès l'an 452 au concile de Calcédoine, assemblé pour décider si Jésus-Christ avait eu deux natures et une personne, ou deux personnes avec une nature. On y décida que l'Eglise de Constantinople était en tout égale à celle de Rome pour les honneurs; et le patriarche de l'une égal en tout au patriarche de l'autre. Le pape St Léon souscrivit aux deux natures; mais ni lui, ni ses successeurs ne souscrivirent à l'égalité. On peut dire que dans cette dispute de rang et de prééminence on allait directement contre les paroles de Jésus-Christ rapportées dans l'Evangile, Il n'y aura parmi vous ni premier, ni dernier . Les saints sont saints; mais l'orgueil se glisse partout: le même esprit qui fait écumer de colère le fils d'un maçon devenu évêque d'un village, quand on ne l'appelle pas monseigneur , a brouillé l'univers chrétien.
Les Romains furent toujours moins disputeurs, moins subtils que les Grecs; mais ils furent bien plus politiques. Les évêques d'Orient en argumentant demeurèrent sujets, celui de Rome sans arguments sut établir enfin son pouvoir sur les ruines de l'empire d'Occident. Et on pouvait dire des papes ce que Virgile dit des Scipions et des Césars;
Romanos rerum dominos gentemque togatam .
Vers digne de Virgile, rendu comiquement par un de nos vieux traducteurs.
Tous gens en robe et souverains des rois.
La haine devint une scission du temps de Photius papa ou surveillant de l'Eglise byzantine, et Nicolas I e r papa ou surveillant de l'Eglise romaine. Comme malheureusement il n'y eut presque jamais de querelle ecclésiastique sans ridicule, il arriva que le combat commença par deux patriarches qui étaient tous deux eunuques; Ignace et Photius qui se disputaient la chaire de Constantinople étaient tous deux chaponnés. Cette mutilation leur interdisant la vraie paternité, ils ne pouvaient être que Pères de l'Eglise.
On dit que les châtrés sont tracassiers, malins, intrigants. Ignace et Photius troublèrent toute la cour grecque.
Le Latin Nicolas I e r ayant pris le parti d'Ignace, Photius déclara ce pape hérétique, attendu qu'il admettait la procession du souffle de Dieu, du Saint-Esprit par le Père et par le Fils, contre la décision unanime de toute l'Eglise, qui ne l'avait fait procéder que du Père.
Outre cette procession hérétique, Nicolas mangeait et faisait manger des oeufs et du fromage en carême. Enfin, pour comble d'infidélité, le papa romain se faisait raser la barbe; ce qui était une apostasie manifeste aux yeux des papas grecs, vu que Moïse, les patriarches et Jésus-Christ étaient toujours peints barbus par les peintres grecs et latins.
Lorsqu'en 879 le patriarche Photius fut rétabli dans son siège par le huitième concile oecuménique grec, composé de quatre cents évêques, dont trois cents l'avaient condamné dans le concile oecuménique précédent, alors le pape Jean VIII le reconnut pour son frère. Deux légats envoyés par lui à ce concile, se joignirent à l'Eglise grecque, et déclarèrent Judas , quiconque dirait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Mais ayant persisté dans l'usage de se raser le menton et de manger des oeufs en carême, les deux Eglises restèrent toujours divisées.
Le schisme fut entièrement consommé l'an 1053 et 1054, lorsque Michel Cerularicus patriarche de Constantinople condamna publiquement l'évêque de Rome Léon IX et tous les Latins, ajoutant à tous les reproches de Photius, qu'ils osaient se servir de pain azyme dans l'eucharistie contre la pratique des apôtres; qu'ils commettaient le crime de manger du boudin, et de tordre le cou aux pigeons au lieu de le leur couper pour les cuire. On ferma toutes les églises latines dans l'empire grec, et on défendit tout commerce avec quiconque mangeait du boudin.
Le pape Léon IX négocia sérieusement cette affaire avec l'empereur Constantin Monomaque, et obtint quelques adoucissements. C'était précisément le temps où ces célèbres gentilshommes normands, enfants de Tancrède de Hauteville, se moquant du pape et de l'empereur grec, prenaient tout ce qu'ils pouvaient dans la Pouille et dans la Calabre, et mangeaient du boudin effrontément. L'empereur grec favorisa le pape autant qu'il put; mais rien ne réconcilia les Grecs avec nos Latins. Les Grecs regardaient leurs adversaires comme des barbares qui ne savaient pas un mot de grec.
L'irruption des croisés sous prétexte de délivrer les saints lieux, et dans le fond pour s'emparer de Constantinople, acheva de rendre les Romains odieux.
Mais la puissance de l'Eglise latine augmenta tous les jours, et les Grecs furent enfin conquis peu à peu par les Turcs. Les papes étaient depuis longtemps de puissants et riches souverains; toute l'Eglise grecque fut esclave depuis Mahomet II, excepté la Russie qui était alors un pays barbare, et dont l'Eglise n'était pas comptée.
Quiconque est un peu instruit des affaires du Levant, sait que le sultan confère le patriarcat des Grecs par la crosse et par l'anneau, sans crainte d'être excommunié, comme le furent les empereurs allemands par les papes pour cette cérémonie.
Bien est-il vrai que l'Eglise de Stamboul a conservé en apparence la liberté d'élire son archevêque; mais elle n'élit que celui qui est indiqué par la Porte ottomane. Cette place coûte à présent environ quatre-vingt mille francs, qu'il faut que l'élu reprenne sur les Grecs. S'il se trouve quelque chanoine accrédité qui offre plus d'argent au grand vizir, on dépossède le titulaire et on donne la place au dernier enchérisseur, précisément comme Marozia et Théodora donnaient le siège de Rome dans le dixième siècle. Si le patriarche titulaire résiste, on lui donne cinquante coups de bâton sur la plante des pieds et on l'exile. Quelquefois on lui coupe la tête, comme il arriva au patriarche Lucas Cyrille en 1638.
Le Grand Turc donne ainsi tous les autres évêchés moyennant finance; et la somme à laquelle chaque évêché fut taxé sous MahometII , est toujours exprimée dans la patente; mais le supplément qu'on a payé n'y est pas énoncé. On ne sait jamais au juste combien un prêtre grec achète son évêché.
Ces patentes sont plaisantes. J'accorde à N*** prêtre chrétien le présent mandement pour perfection de félicité. Je lui commande de résider en la ville ci-nommée, comme évêque des infidèles chrétiens, selon leur ancien usage et leurs vaines et extravagantes cérémonies; voulant et ordonnant que tous les chrétiens de ce district le reconnaissent, et que nul prêtre ni moine ne se marie sans sa permission . (C'est-à-dire sans payer.)
L'esclavage de cette Eglise est égal à son ignorance; mais les Grecs n'ont que ce qu'ils ont mérité. Ils ne s'occupaient que de leurs disputes sur la lumière du Thabor et sur celle de leur nombril, lorsque Constantinople fut prise.
On espère qu'au moment où nous écrivons ces douloureuses vérités, l'impératrice de Russie Catherine II rendra aux Grecs leur liberté. On souhaite qu'elle puisse leur rendre le courage et l'esprit qu'ils avaient du temps de Miltiade, de Thémistocle, et qu'ils aient de bons soldats et moins de moines au mont Athos.
DE LA PRÉSENTE ÉGLISE GRECQUE.
Si quelque chose peut nous donner une grande idée des mahométans, c'est la liberté qu'ils ont laissée à l'Eglise grecque. Ils ont paru dignes de leurs conquêtes puisqu'ils n'en ont point abusées. Mais il faut avouer que les Grecs n'ont pas trop mérité la protection que les musulmans leur accordent; voici ce qu'en dit M. Porter ambassadeur d'Angleterre en Turquie.
‘Je voudrais tirer le rideau sur ces disputes scandaleuses des Grecs et des Romains au sujet de Bethléem et de la Terre sainte, comme ils l'appellent. Les procédés iniques, odieux qu'elles occasionnent entre eux, sont la honte du nom chrétien. Au milieu de ces débats, l'ambassadeur chargé de protéger la communion romaine, malgré sa dignité éminente, devient véritablement un objet de compassion.
‘Il se lève dans tous les pays de la croyance romaine des sommes immenses pour soutenir contre les Grecs des prétentions équivoques à la possession précaire d'un coin de terre réputée sacrée, et pour conserver entre les mains des moines de leur communion les restes d'une vieille étable à Bethléem, où l'on a érigé une chapelle, et où, sur l'autorité incertaine d'une tradition orale, on prétend que naquit le Christ; de même qu'un tombeau, qui peut être, et plus vraisemblablement peut n'être pas, ce qu'on appelle son sépulcre . Car la situation exacte de ces deux endroits est aussi peu certaine que la place qui recèle les cendres de César.'
Ce qui rend les Grecs encore plus méprisables aux yeux des Turcs, c'est le miracle qu'ils font tous les ans au temps de Pâques. Le malheureux évêque de Jérusalem s'enferme dans le petit caveau qu'on fait passer pour le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des paquets de petite bougie; il bat le briquet, allume un de ces petits cierges, et sort de son caveau en criant, Le feu du ciel est descendu , et la sainte bougie est allumée . Tous les Grecs aussitôt achètent de ces bougies, et l'argent se partage entre le commandant turc et l'évêque.
On peut juger par ce seul trait de l'état déplorable de cette Eglise sous la domination du Turc.
L'Eglise grecque, en Russie, a pris depuis peu une consistance beaucoup plus respectable depuis que l'impératrice Catherine II l'a délivrée du soin de son temporel; elle lui a ôté quatre cent mille esclaves qu'elle possédait. Elle est payée aujourd'hui du trésor impérial, entièrement soumise au gouvernement, contenue par des lois sages; elle ne peut faire que du bien; elle devient tous les jours savante et utile. Elle a aujourd'hui un prédicateur nommé Platon qui a fait des sermons que l'ancien Platon grec n'aurait pas désavoués.
EGLOGUE. [p. 504] ↩
Il semble qu'on ne doive rien ajouter à ce que M. le chevalier de Jaucour et M. Marmontel ont dit de l'églogue dans le Dictionnaire encyclopédique; il faut après les avoir lus, lire Théocrite et Virgile, et ne point faire d'églogues. Elles n'ont été jusqu'à présent parmi nous que des madrigaux amoureux, qui auraient beaucoup mieux convenu aux filles d'honneur de la reine-mère qu'à des bergers.
L'ingénieux Fontenelle, aussi galant que philosophe, qui n'aimait pas les anciens, donne le plus de ridicules qu'il peut au tendre Théocrite le maître de Virgile; il lui reproche une églogue qui est entièrement dans le goût rustique; mais il ne tenait qu'à lui de donner de justes éloges à d'autres églogues qui respirent la passion la plus naïve exprimée avec toute l'élégance et la molle douceur convenable aux sujets.
Il y en a de comparables à la belle ode de Sapho traduite dans toutes les langues. Que ne nous donnait-il une idée de la Pharmaceutrée imitée par Virgile, et non égalée peut-être? on ne pourrait pas en juger par ce morceau que je vais rapporter; mais c'est une esquisse qui fera connaître la beauté du tableau à ceux dont le goût démêle la force de l'original dans la faiblesse même de la copie.
Reine des nuits dis quel fut mon amour;
Comme en mon sein les frissons et la flamme
Se succédaient, me perdaient tour à tour,
Quels doux transports égarèrent mon âme;
Comment mes yeux cherchaient en vain le jour;
Comme j'aimais, et sans songer à plaire!
Je ne pouvais ni parler ni me taire. . .
Reine des nuits dis quel fut mon amour.Mon amant vint. O moments délectables!
Il prit mes mains, tu le sais, tu le vis,
Tu fus témoin de ses serments coupables,
De ses baisers, de ceux que je rendis,
Des voluptés dont je fus enivrée.
Moments charmants passez-vous sans retour?
Daphnis trahit la foi qu'il m'a jurée.
Reine des cieux dis quel fut mon amour.
Ce n'est là qu'un échantillon de ce Théocrite dont Fontenelle faisait si peu de cas. Les Anglais qui nous ont donné des traductions en vers de tous les poètes anciens, en ont aussi une de Théocrite; elle est de M. Fawkes: toutes les grâces de l'original s'y retrouvent. Il ne faut pas omettre qu'elle est en vers rimés ainsi que les traductions anglaises de Virgile et d'Homère. Les vers blancs dans tout ce qui n'est pas tragédie, ne sont, comme disait Pope, que le partage de ceux qui ne peuvent pas rimer.
Je ne sais si après avoir parlé des églogues qui enchantèrent la Grèce et Rome, il sera bien convenable de citer une églogue allemande, et surtout une églogue dont l'amour n'est pas le principal sujet; elle fut écrite dans une ville qui venait de passer sous une domination étrangère.
EGLOGUE ALLEMANDE
HERNAND, DERNIN.
DERNIN.
Consolons-nous, Hernand, l'astre de la nature
Va de nos aquilons tempérer la froidure;
Le zéphyr à nos champs promet quelques beaux jours.
Nous chanterons aussi nos vins et nos amours:
Nous n'égalerons point la Grèce et l'Ausonie;
Nous sommes sans printemps, sans fleurs et sans génie;
Nos voix n'ont jamais eu ces sons harmonieux
Qu'aux pasteurs de Sicile ont accordé les dieux.
Ne pourrons-nous jamais, en lisant leurs ouvrages,
Surmonter l'âpreté de nos climats sauvages,
Vers ces coteaux du Rhin que nos soins assidus
Ont forcés à s'orner des trésors de Bacchus?Forçons le dieu des vers exilé de la Grèce,
A venir de nos chants adoucir la rudesse.
Nous connaissons l'amour, nous connaîtrons les vers.
Orphée était de Thrace; il brava les hivers;
Il aimait; c'est assez: Venus monta sa lyre.
Il polit son pays; il eut un doux empire
Sur des coeurs étonnés de céder à ses lois.
HERNAND.
On dit qu'il amollit les tigres de ses bois.
Humaniserons-nous les loups qui nous déchirent?Depuis qu'aux étrangers les destins nous soumirent,
Depuis que l'esclavage affaissa nos esprits,
Nos chants furent changés en de lugubres cris.
D'un commis odieux l'insolence affamée
Vient ravir la moisson que nous avons semée,
Vient décimer nos fruits, notre lait, nos troupeaux;
C'est pour lui que ma main couronna ces coteaux
Des pampres consolants de l'amant d'Ariane.Si nous osons nous plaindre, un traitant nous condamne;
Nous craignons de gémir, nous dévorons nos pleurs.
Ah! dans la pauvreté, dans l'excès des douleurs,
Le moyen d'imiter Théocrite et Virgile!
Il faut pour un coeur tendre un esprit plus tranquille.
Le rossignol tremblant dans son obscur séjour,
N'élève point sa voix sous le bec du vautour.
Fuyons, mon cher Dernin, ces malheureuses rives.
Portons nos chalumeaux et nos lyres plaintives
Aux bords de l'Adige, loin des yeux des tyrans.
Et le reste .
Voici une chose plus extraordinaire: une églogue française sans madrigaux et sans galanterie.
EGLOGUE A MR. DE ST. LAMBERT,
auteur du poëme des quatre saisons.
Chantre des vrais plaisirs, harmonieux émule
Du pasteur de Mantoue et du tendre Tibulle,
Qui peignez la nature et qui l'embellissez;
Que vos Saisons m'ont plu! que mes sens émoussés,
A votre aimable voix se sentirent renaître!
Que j'aime, en vous lisant, ma retraite champêtre!
Je fais, depuis quinze ans, tout ce que vous chantez.Dans ces champs malheureux si longtemps désertés,
Sur les pas du travail j'ai conduit l'abondance,
J'ai séché de mes mains les pleurs de l'innocence.
Ces vignobles, ces bois, ma main les a plantés,
Ces granges, ces hameaux désormais habités,
Ces landes, ces marais changés en pâturages,
Ces colons rassemblés, ce sont là mes ouvrages;
Ouvrages fortunés dont le succès constant
De la mode et du goût n'est jamais dépendant,
Ouvrages plus chéris que Mérope et Zaïre,
Et que n'atteindront point les traits de la satire.Heureux qui peut chanter les jardins et les bois,
Les charmes des amours, l'honneur des grands exploits!
Et parcourant des arts la flatteuse carrière
Aux mortels aveuglés rendre un peu de lumière.
Mais encor plus heureux qui peut loin de la cour,
Embellir sagement un champêtre séjour,
Entendre autour de lui cent voix qui le bénissent!De ses heureux succès quelques fripons gémissent,
Un vil cagot titré, tyran des gens de bien,
Va l'accuser en cour de n'être pas chrétien;
Le sage ministère écoute avec surprise,
Il reconnaît Tartuffe et rit de sa sottise. [55]
Cependant le vieillard achève ses moissons,
Le pauvre en est nourri: ses chanvres, ses toisons,
Habillent décemment le berger, la bergère,
Il unit par l'hymen Méris avec Glicère,
Il donne une chasuble au bon curé du lieu,
Qui, buvant avec lui, voit bien qu'il croit un Dieu;
Ainsi dans l'allégresse il achève sa vie.Ce n'est qu'au successeur du chantre d'Ausonie,
De peindre ces tableaux ignorés dans Paris,
D'en ranimer les traits par son beau coloris,
D'inspirer aux humains le goût de la retraite.
Mais de nos chers Français la noblesse inquiète
Pouvant régner chez soi, va ramper dans les cours,
Les folles vanités consument ses beaux jours,
Le vrai séjour de l'homme est un exil pour elle.Plutus est dans Paris: c'est de là qu'il appelle,
Les voisins de l'Adour, et du Rhône et du Var.
Tous viennent à genoux environner son char.
Les uns montent dessus, les autres dans la boue
Baisent en soupirant les rayons de sa roue.
Le fils de mon manoeuvre en ma ferme élevé,
A d'utiles travaux à quinze ans enlevé,
Des laquais de Paris s'en va grossir l'armée,
Il sert d'un vieux traitant la maîtresse affamée,
De sergent des impôts il obtient un emploi,
Il vient dans son hameau tout fier de par le roi ,
Fait des procès-verbaux, tyrannise, emprisonne,
Ravit aux citoyens le pain que je leur donne,
Entraîne en des cachots le père et les enfants.
Vous le savez, grand Dieu, j'ai vu des innocents,
Sur le faux exposé de ces loups mercenaires,
Pour cinq sous de tabac envoyés aux galères.Chers enfants de Cérès, ô chers agriculteurs,
Vertueux nourriciers de vos persécuteurs,
Jusqu'à quand serez-vous vers ces tristes frontières,
Ecrasés sans pitié sous ces mains meutrières;
Ne vous ai-je assemblés que pour vous voir périr,
En maudissant les champs que vos mains font fleurir?
Un temps viendra sans doute, où des lois plus humaines
De vos bras opprimés relâcheront les chaînes.
Dans un monde nouveau vous aurez un soutien,
Car pour ce monde-ci je n'en espère rien.
ELIE & ENOCH. [p. 516] ↩
Elie et Enoch sont deux personnages bien importants dans l'antiquité. Ils sont tous deux les seuls qui n'aient point goûté de la mort, et qui aient été transportés hors du monde. Un très savant homme a prétendu que ce sont des personnages allégoriques. Le père et la mère d'Elie sont inconnus. Il croit que son pays Galaad ne veut dire autre chose que la circulation des temps; on le fait venir de Galgala qui signifie révolution . Mais le nom du village de Galgala signifiait-il quelque chose?
Le mot d'Elie a un rapport sensible avec celui d'Elios, le soleil. L'holocauste offert par Elie et allumé par le feu du ciel, est une image de ce que peuvent les rayons du soleil réunis. La pluie qui tombe après de grandes chaleurs est encore une vérité physique.
Le char de feu, et les chevaux enflammés qui enlèvent Elie au ciel, sont une image frappante des quatre chevaux du soleil. Le retour d'Elie à la fin du monde, semble s'accorder avec l'ancienne opinion que le soleil viendrait s'éteindre dans les eaux, au milieu de la destruction générale que les hommes attendaient: car presque toute l'antiquité fut longtemps persuadée que le monde serait bientôt détruit.
Nous n'adoptons point ces allégories, et nous nous en tenons à ce qui est rapporté dans l'Ancien Testament.
Enoch est un personnage aussi singulier qu'Elie, à cela près que la Genèse nomme son père et son fils, et que la famille d'Elie est inconnue. Les Orientaux et les Occidentaux ont célébré cet Enoch.
La sainte Ecriture qui est toujours notre guide infaillible, nous apprend qu'Enoch fut père de Mathusala ou Mathusalem, et qu'il ne vécut sur la terre que trois cent soixante et cinq ans, ce qui a paru une vie bien courte pour un des premiers patriarches. Il est dit, qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'enleva. ‘C'est ce qui fait, dit Dom Calmet, que les Pères et le commun des commentateurs assurent qu'Enoch est encore en vie, que Dieu l'a transporté hors du monde aussi bien qu'Elie, qu'ils viendront avant le jugement dernier s'opposer à l'antéchrist, qu'Elie prêchera aux Juifs, et Enoch aux gentils.'
St Paul, dans son Epître aux Hébreux, (qu'on lui a contestée) dit expressément, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, afin qu'il ne vît point la mort; et on ne le vit plus parce que le Seigneur le transporta .
St Justin, ou celui qui a pris son nom, dit qu'Enoch et Elie sont dans le paradis terrestre, et qu'ils y attendent le second avènement de Jésus-Christ.
Jérôme commentaire sur Amos. St Jérôme au contraire croit qu'Enoch et Elie sont dans le ciel. C'est ce même Enoch septième homme après Adam, qu'on prétend avoir écrit un livre cité par St Jude. (Voyez Livres apocryphes .)
Liv. I de cultu foeminarum , etc. Tertullien dit que cet ouvrage fut conservé dans l'arche, et qu'Enoch en fit même une seconde copie après le déluge.
Voilà ce que la sainte Ecriture et les Pères nous disent d'Enoch; mais les profanes de l'Orient en disent bien davantage. Ils croient en effet qu'il y a eu un Enoch, et qu'il fut le premier qui fit des esclaves à la guerre; ils l'appellent tantôt Enoc, tantôt Edris; ils disent que c'est lui qui donna des lois aux Egyptiens sous le nom de ce Thaut, appelé par les Grec Hermès Trismégiste. On lui donne un fils nommé Sabi auteur de la religion des Sabiens ou Sabéens.
Il y avait une ancienne tradition en Phrygie sur un certain Anach, dont on disait que les Hébreux avaient fait Enoch. Les Phrygiens tenaient cette tradition des Chaldéens ou Babyloniens, qui reconnaissaient aussi un Enoch ou Anach pour inventeur de l'astronomie.
On pleurait Enoch un jour de l'année en Phrygie, comme on pleurait Adoni ou Adonis chez les Phéniciens.
L'écrivain ingénieux et profond qui croit Elie un personnage purement allégorique, pense la même chose d'Enoch. Il croit qu'Enoch, Anach, Annoch, signifiat l' année ; que les Orientaux le pleuraient ainsi qu'Adonis, et qu'ils se réjouissaient au commencement de l'année nouvelle.
Que le Janus connu ensuite en Italie, était l'ancien Anach, ou Annoch de l'Asie.
Que non seulement Enoch signifiait autrefois chez tous ces peuples le commencement et la fin de l'an, mais le dernier jour de la semaine.
Que les noms d'Anne, de Jean, de Januarius, Janvier, ne sont venus que de cette source.
Il est difficile de pénétrer dans les profondeurs de l'histoire ancienne. Quand on y saisirait la vérité à tâtons, on ne serait jamais sûr de la tenir. Il faut absolument qu'un chrétien s'en tienne à l'Ecriture, quelque difficulté qu'on trouve à l'entendre.
Fin du Tome second. ↩
Notes↩
[49] Cet article est un de ceux qu'on retrouve ailleurs, mais il est ici plus complet.
[50] Une partie de cet article se trouve ailleurs, mais moins étendue; de plus il est bon d'inculquer ces vérités au lecteur dans plus d'un ouvrage.
[51] Principe du mal chez les Egyptiens.
[52] Principe du mal chez les Perses.
[53] C'est-à-dire d'un autre principe.
[54] Un philosophe anglais a prétendu que le monde physique avait dû être changé au premier avènement, comme le monde moral. C'est apparemment le philosophe anglais de Rabelais.
[55] Voilà avec l'opinion des deux principes toutes les solutions qui se présentent à l'esprit humain dans cette grande difficulté; et la Révélation seule peut enseigner ce que l'esprit humain ne saurait comprendre. Mais qu'il est affreux d'avoir encore à disputer tous les jours sur la Révélation, de voir la société chrétienne insociable, divisée en cent sectes sur la Révélation, de se calomnier, de se persécuter, de se détruire pour la Révélation, de faire des St Barthélemi pour la Révélation, d'assassiner Henri III et Henri IV pour la Révélation? de faire couper la tête au roi Charles Ier pour la Révélation, de traîner un roi de Pologne tout sanglant pour la Révélation! O Dieu révélez-nous donc qu'il faut être humain et tolérant!
[56] Voyez les notes à la fin du poème.
[57] Voyez les notes à la fin du poème.
[58] On trouve difficilement une personne qui voulût recommencer la même carrière qu'elle a courue, et repasser par les mêmes événements.
[59] Joviens, adorateurs de Jupiter.
[60] Voyez les Voyages de Burnet évêque de Salisbury, l'Histoire des dominicains de Berne par Abraham Ruchat professeur à Lausanne, le Procès verbal de la condamnation des dominicains, et l'Original du procès conservé dans la bibliothèque de Berne. Le même fait est rapporté dans l'Histoire générale de l'esprit et des moeurs des nations. Puisse-t-elle être partout: personne ne la connaissait en France il y a vingt ans.
[61] C'était un Chilpéric. La chose arriva l'an 562.
[62] Dacier a traduit sicci et uvidi dans nos prières du soir et du matin.
[63] M. Larcher du collège Mazarin, a fort approfondi cette matière.
[64] Le pape Ganganelli informé des résolutions de tous les princes catholiques, et voyant que les peuples à qui ses prédécesseurs avaient crevé les deux yeux commençaient à en ouvrir un, ne publia point cette fameuse bulle le jeudi de l'absoute l'an 1770.
[1] Voyez la fable de Matthieu Garo dans La Fontaine.
[2] Pourquoi donner le nom de maigre à des poissons plus gros que les poulardes? et qui donnent de si terribles indigestions?
[3] Il fut imprimé in-12 à Paris chez Toussaints du Brai en 1609, avec privilège du roi; il doit être dans la bibliothèque de S. M.
[4] Ier Cod. De bonis eorum qui sibi mortem. leg. 3. ff. eod.
[5] Ou plutôt Baruch; car il s'appelait Baruch comme on le dit ailleurs. Il signait B. Spinosa. Quelques chrétiens fort mal instruits et qui ne savaient pas que Spinosa avait quitté le judaïsme sans embrasser le christianisme, prirent ce B. pour la première lettre de Benedictus, Benoît.
[6] Y a-t-il moins d'intelligence parce que les générations se succèdent?
[7] Il y immutabilité de dessein quand vous voyez immutabilité d'effets. Voyez Dieu.
[8] Etre libre, c'est faire sa volonté. S'il l'opère, il est libre.
[9] Voyez la réponse dans les articles Dieu.
[10] S'il est malin, il n'est pas incapable; et s'il est capable, ce qui comprend pouvoir et sagesse, il n'est pas malin.
[11] L'auteur tombe ici dans une inadvertance à laquelle nous sommes tous sujets. Nous disons souvent, j'aimerais mieux être oiseau, quadrupède, que d'être homme, avec les chagrins que j'essuie. Mais quand on tient ce discours on ne songe pas qu'on souhaite d'être anéanti; car si vous êtes autre que vous-même, vous n'avez plus rien de vous-même.
[12] Vous supposez ce qui est en question, et cela n'est que trop ordinaire à ceux qui font des systèmes.
[13] Est-ce à nous à lui trouver sa place? C'est à lui de nous donner la nôtre. Voyez la réponse.
[14] Etes-vous fait pour avoir des idées de tout, et ne voyez-vous pas dans cette nature une intelligence admirable?
[15] Ou le monde est infini, ou l'espace est infini. Choisissez.
[16] Puissante et industrieuse. Je m'en tiens là. Celui qui est assez puissant pour former l'homme et le monde est Dieu. Vous admettez Dieu malgré vous.
[17] Si nous sommes si ignorants, comment oserons-nous affirmer que tout se fait sans Dieu?
[18] Voyez l'article Certitude, Dictionnaire encyclopédique.
[19] Le pape y avait déjà nommé un évêque.
[20] Voyez le Siècle de Louis XIV, dans l'Essai sur l'esprit et les moeurs des nations, et ailleurs.
[21] Voyez l'Histoire de la Russie, écrite sur les mémoires envoyés par l'impératrice Elizabeth.
[22] Le titre de l'Evangile syriaque de St Luc porte, Evangile de Luc l'Evangéliste, qui évangélisa en grec dans Alexandrie la grande. On trouve encore ces mots dans les Constitutions apostoliques, Le second évêque d'Alexandrie fut Avilius institué par Luc.
[23] Ce même missionnaire Labat, frère prêcheur, provéditeur du St Office, qui ne manque pas une occasion de tomber rudement sur les reliques et sur les miracles des autres moines, ne parle qu'avec une noble assurance de tous les prodiges et de toutes les prééminences de l'ordre de St Dominique. Nul écrivain monastique n'a jamais poussé si loin la vigueur de l'amour-propre conventuel. Il faut voir comme il traite les bénédictins et le père Martène. Voyage de Labat. tom. V depuis la page 303 jusqu'à la page 313. Ingrats bénédictins!. . . ah père Martène! -- noire ingratitude, que toute l'eau du déluge ne peut effacer! -- vous enchérissez sur les lettres provinciales, et vous retenez le bien des jacobins! tremblez, révérends bénédictins de la congrégation de St Vannes. -- Si père Martène n'est pas content, il n'a qu'à parler .
C'est bien pis quand il punit le très judicieux et très plaisant voyageur Misson, de n'avoir pas excepté les jacobins de tous les moines auxquels il accorde beaucoup de ridicule. Labat traite Misson de bouffon ignorant qui ne peut être lu que par la canaille anglaise. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que ce moine fait tous ses efforts pour être plus hardi et plus drôle que Misson. Au surplus, c'était un des plus effrontés convertisseurs que nous eussions; mais en qualité de voyageur il ressemble à tous les autres qui croient que tout l'univers a les yeux ouverts sur tous les cabarets où ils ont couché, et sur leurs querelles avec les commis de la douane.
[24] Dans un programme des reproductions animales imprimé, il est dit page 6, dans l'avis du traducteur, que la tête et les autres parties se reproduisirent dans l'escargot terrestre, et que les cornes se reproduisirent dans le limaçon sans coquille; c'est communément tout le contraire. Et d'ailleurs les limaces nues incoques, et le colimaçon à coquille sont également terrestres.
[25] On est obligé de dire qu'on doute encore si cet escargot auquel il revient une tête, et dont une corne commence à paraître, n'est pas du nombre de ceux à qui l'on n'a coupé que la tête et deux antennes. Il est déjà revenu un museau à ceux-ci au bout de quinze jours. Ces expériences sont incontestables.
[26] Voyez la lettre de St Grégoire de Nazianze à Procope; il dit, ‘Je crains les conciles, je n'en ai jamais vu qui n'aient fait plus de mal que de bien, et qui aient eu une bonne fin; l'esprit de dispute, la vanité, l'ambition y dominent; celui qui veut y réformer les méchants, s'expose à être accusé sans les corriger.'
Ce saint savait que les Pères des conciles sont hommes.
[27] En effet, comment une indiscrétion aurait-elle causé un scandale public si elle avait été secrète?
[28] La constitution de Grégoire XV est du 20 août 1622. Voyez les Mémoires ecclésiastiques du jésuite d'Avrigni, si mieux n'aimez consulter le Bullaire.
[29] Voyez le Précis du siècle de Louis XV in-4o, tom. II, pag. 61.
[30] Voyez Pontas à l'article Confesseur.
[31] Voyez l'édit de 1724, 14 mai, publié à la sollicitation du cardinal de Fleuri, et revu par lui.
[32] Journal du palais, tom. I, pag. 444.
[33] Deut., ch. 13.
[34] Josué, ch. 16.
[35] Premier livre des Rois, ch. 15.
[36] On peut voir dans les Mélanges d'histoire, de littérature et de philosophie, l'article Contradiction, qui traite différemment la même matière.
[37] Rapin Thoiras n'a pas traduit littéralement cet acte.
[38] Cela ressemble un peu à l'ancre de vaisseau qu'on prétendait avoir trouvé sur le grand St Bernard; aussi s'est-on bien gardé d'insérer cette chimère dans la traduction.
[39] Tout ce que ces coquillages pourraient opérer, c'est de diviser une terre trop compacte. On en fait autant avec du gravier. Des coquilles fraîches et pilées pourraient servir par leur huile: mais des coquillages desséchés ne sont bons à rien.
[40] Le prétendu Jupiter né en Crète, n'était qu'une fable historique ou poétique, comme celles des autres dieux. Jovis, depuis Jupiter, était la traduction du mot grec Zeus; et Zeus était la traduction du mot phénicien Jeova.
[41] On vit après sa mort, par ses comptes, qu'il n'avait quelquefois dépensé que quatre sous et demi en un jour pour sa nourriture. Ce n'est pas là un repas de moines assemblés en chapitre.
[42] Ce qui fait que Bayle n'a pas pressé cet argument, c'est qu'il n'était pas instruit des démonstrations de Newton, de Keil, de Grégori, de Halley, que le vide est nécessaire pour le mouvement.
[43] Il s'appelait Baruc et non Benoît, car il ne fut jamais baptisé.
[44] Théokesesignifie qui rend Dieu à la selle, proprement ch. . . Dieu: ce reproche affreux, cette injure avilissante n'a pas cependant effrayé le commun des catholiques: preuve évidente que les livres n'étant point lus par le peuple, n'ont point d'influence sur le peuple.
[45] Remarquez qu'Hérodote vivait du temps de Xerxès, lorsque Babilone était dans sa plus grande splendeur: les Grecs ignoraient la langue chaldéenne. Quelque interprète se moqua de lui, ou Hérodote se moqua des Grecs. Lorsque les Musicos d'Amsterdam étaient dans leur plus grande vogue, on aurait bien pu faire accroire à un étranger que les premières dames de la ville venaient se prostituer aux matelots qui revenaient de l'Inde, pour les récompenser de leurs peines. Le plus plaisant de tout ceci, c'est que des pédants welches ont trouvé la coutume de Babilone très vraisemblable et très honnête.
[46] Oui je l'ai connu; il était précisément tel que le dépeint M. de Rulière auteur de cette épître. Ce fut sa rage de disputer contre tout venant sur les plus petites choses, qui lui fit ôter l'intendance dont il était revêtu.
[47] C'est une des rêveries de Buffon.
[48] Dans ce temps-là, et c'était le plus brillant de Louis XIV, on ne servait d'entremets que dans les grands repas d'appareil.
[49] Madame de Maintenon compte deux cochers, et oublie quatre chevaux, qui dans ce temps-là devaient avec l'entretien des voitures coûter environ deux mille francs par année.
[50] Il n'y avait pas à la vérité dans la milice romaine de tribun de cohorte. C'est comme si on disait parmi nous colonel d'une compagnie. Les centurions étaient à la tête des cohortes, et les tribuns à la tête des légions. Il y avait trois tribuns souvent dans une légion. Ils commandaient alors tour à tour, et étaient surbordonnés les uns aux autres. L'auteur des Actes a probablement entendu que le tribun fit marcher une cohorte.
[51] Un soufflet chez les peuples asiatiques était une punition légale. Encore aujourd'hui à la Chine et dans les pays au delà du Gange, on condamne un homme à une douzaine de soufflets.
[52] Cela est écrit dans les Proverbes, chapitre XVII; mais ce n'est que dans la traduction des septantes, à laquelle toute l'Eglise s'en tenait alors.
[53] St Jérôme dit qu'il était de Giscala en Galilée.
[54] Du Pin dans sa Bibliothèque ecclésiastique, prouve que cette lettre est authentique.
[55] On ne sait quel est le misérable brouillon dont l'auteur veut parler ici.