VOLTAIRE
La Raison par alphabet (1769)
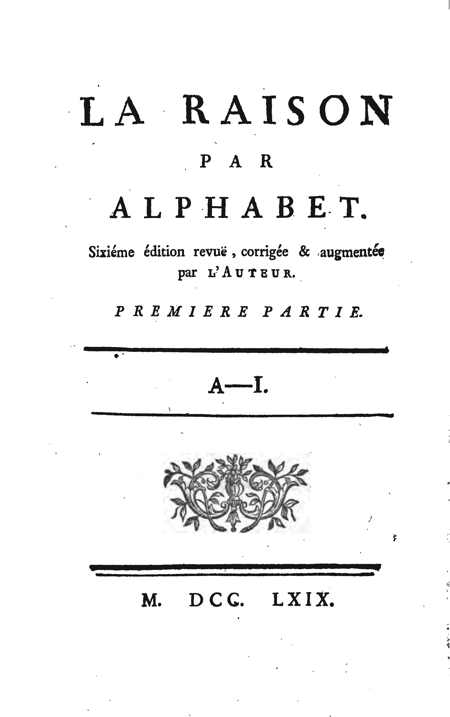 |
 |
This is an e-Book from |
Source
Voltaire, La Raison par alphabet. Sixième édition revuë, corrigée & augmentée par l’Auteur. (1769). Première Partie A-I; Seconde Partie L-V; “L’A,B,C, Dix-sept Dialogues traduit de l’anglais.”
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
- inserted Greek and Hebrew words as images
TABLE Des Articles contenus dans cette première Partie.
- Préface de l’édition qui a précédé celle-ci immédiatement. p. pag. 5.
- Abbé. p. 9.
- Abraham. p. 11.
- Adam. p. 16.
- Ame. p. 17.
- Amitié. p. 29.
- Amour. p. 30.
- Amour nommé Socratique. p. 33.
- Amour-propre. p. 37.
- Ange. p. 39.
- Antitrinitaires. p. 42.
- Antropofages. p. 46.
- Apis. p. 49.
- Apocalypse. p. 51.
- Arius. p. 51.
- Athée, Athéisme. Section première p. 58.
- Athée, Athéisme. Section seconde p. 70.
- Babel. p. 71.
- Batême. p. 73.
- Idée des Unitaires rigides sur le Batême. p. 75.
- Beau, Beauté. p. 78.
- Bêtes. p. 79.
- Bien. Souverain bien. p. 82.
- Bien. (Tout est) p. 84.
- Bornes de l’esprit humain. p. pag. 92.
- Caractère. p. 93.
- Carême. Questions sur le Carême. p. 96.
- Catéchisme Chinois. p. 98.
- —— du Curé. p. 128.
- —— du Japonois. p. 134.
- —— du Jardinier. p. 142.
- Certain, Certitude. p. 147.
- Chaîne des Êtres créés. p. 150.
- Chaîne des événemens. p. 153.
- Chine. (de la) p. 157.
- Christianisme. Recherches historiques sur le Christianisme. p. 162.
- Ciel (le) des Anciens. p. 198.
- Circoncision. p. 204.
- Conciles. p. 209.
- Confession. p. 215.
- Convulsions. p. 217.
- Corps. p. 219.
- Crédo. p. 222.
- Critique. p. 226.
- David. p. 233.
- Délits (des) locaux. p. 237.
- Destin. p. 239.
- Dieu. p. 244.
- Divinité de Jésus. p. 249.
- Dogmes. p. 250.
- Égalité. p. 254.
- Enfer. p. 258.
- Entousiasme. p. 262.
- Esprit faux. p. 264.
- États, Gouvernemens. Quel est le meilleur ? pag. 267.
- Évangile. p. 273.
- D’Ezéchiel. De quelques passages singuliers de ce Prophête, & de quelques usages anciens. p. 275.
- Fables. p. 281.
- Fanatisme. p. 283.
- Fausseté des vertus humaines. p. 286.
- Fin. Causes finales. p. 288.
- Foi. p. 291.
- Foy. p. 293.
- Folie. p. 295.
- Fraude. S’il faut user de fraudes pieuses avec le peuple ? p. 298.
- Genèse. p. 304.
- Gloire. p. 321.
- Grace. p. 322.
- Guerre. p. 326.
- Histoire des Rois Juifs, & Paralipomènes. p. 331.
- Idée. p. 333.
- Idole, Idolâtre, Idolâtrie. p. 336.
- Jephté, ou des sacrifices du sang humain. p. 356.
- Inondation. p. 357.
- Inquisition. p. 359.
- Job. p. 354.
- Joseph. p. 367.
- Judée. p. 371.
- Julien le philosophe, Empereur Romain. p. 373.
- Du Juste & de l’Injuste. p. 379.
TABLE Des Articles contenus dans cette seconde Partie
- Lettres, Gens de lettres, ou Lettrés. p. pag. 1.
- Liberté. (De la) p. 4.
- Liberté de penser. p. 8.
- Loix. (Des) Première Section. p. 14.
- —— (Seconde Section.) p. 17.
- Loix Civiles & Ecclésiastiques. p. 25.
- Luxe. p. 27.
- Maître. p. 30.
- Martire. p. 32.
- Matière. p. 35.
- Méchant. p. 40.
- Messie. p. 44.
- Métamorphose, Métempsicose. p. 57.
- Miracles. p. 59.
- Morale. p. 67.
- Moyse. p. 69.
- Nécessaire. p. 76.
- Orgueil. p. 81.
- Papisme. (Dialogue sur le) p. pag. 82.
- Patrie. p. 85.
- Paul. (Questions sur) p. 88.
- Péché originel. p. 90.
- Persécution. p. 93.
- Philosophe. p. 95.
- Pierre. p. 102.
- Préjugés. p. 108.
- Prêtre. p. 112.
- Prophêtes. p. 114.
- Religion. (Huit questions sur la). p. 117.
- Résurrection. p. 133.
- —— (Seconde section). p. 137.
- Salomon. p. 140.
- Secte. p. 153.
- Sens commun. p. 157.
- Sensation. p. 159.
- Songes. p. 163.
- Superstition p. 166.
- —— (Seconde section). p. 169.
- Théïste. p. 172.
- Théologien. p. 173.
- Tirannie. p. 174.
- Tolérance. p. 176.
- —— (Seconde section). p. 180.
- Torture. pag. 186.
- Transubstantiation. p. 190.
- Vertu. p. 191.
- Addition à la fin de l’article Job. p. 194.
- Notes
L’A, B, C. Dix-sept Dialogues traduit de l’Anglais. [p. Garnier éd.]
- Premier Dialogue. Sur Hobbes, Grotius, & Montesquieu. p. 199. [p. 311]
- Second Entretien. Sur l’ame. p. 222. [p. 327]
- Troisième Entretien. Si l’homme est né méchant & enfant du diable. p. 227. [p. 330]
- Quatrième Entretien. De la loi naturelle, & de la curiosité. p. 241. [p. 338]
- Cinquième Entretien. Des manières de perdre & de garder sa liberté, & de la théocratie. p. 247. [p. 342]
- Sixième Entretien. Des trois Gouvernemens, & de mille erreurs anciennes. p. 254. [p. 347]
- Septième Entretien. Que l’Europe moderne vaut mieux que l’Europe ancienne. p. 266. [p. 351]
- Huitième Entretien. Des Serfs de corps. p. 266. [p. 354]
- Neuvième Entretien. Des Esprits serfs. p. 271. [p. 358]
- Dixième Entretien. Sur la Religion. p. 276. [p. 362]
- Onzième Entretien. Du droit de la guerre. p. pag. 286. [p. 368]
- Douzième Entretien. Du Code de la perfidie. p. 299. [p. 375]
- Treizième Entretien. Des loix fondamentales. p. 304. [p. 379]
- Quatorzième Entretien. Que tout état doit être indépendant. p. 309. [p. 382]
- Quinzième Entretien. De la meilleure législation. p. 314. [p. 385]
- Seizième Entretien. Des abus. p. 319. [p. 388]
- Dix-septième Entretien. Sur des choses curieuses. p. 323. [p. 390]
- Notes
[I-5]
PRÉFACE↩
De l’Édition qui a précédé celle-ci immédiatement.
Il y a déjà cinq éditions de ce Dictionnaire, mais toutes incomplettes & informes ; nous n’avions pû en conduire aucune. Nous donnons enfin celle-ci, qui l’emporte sur toutes les autres pour la correction, pour l’ordre, & pour le nombre des articles. Nous les avons tous tirés des meilleurs auteurs de l’Europe, & nous n’avons fait aucun scrupule de copier quelquefois une page d’un livre connu, quand cette page s’est trouvée nécessaire à notre collection. Il y a des articles tout entiers de personnes encor vivantes, parmi lesquelles on compte de savants pasteurs. Ces morceaux sont depuis longtems assez connus des savants comme Apocalypse, Christianisme, Messie, Moïse, Miracles, &c. Mais dans l’article Miracles, nous avons ajouté une page entière du[I-6] célèbre docteur Midleton bibliothécaire de Cambridge.
On trouvera aussi plusieurs passages du savant évêque de Glocester Warburton. Les manuscrits de M. Du Marsay nous ont beaucoup servi ; mais nous avons rejeté unanimement tout ce qui a semblé favoriser l’Épicuréisme. Le dogme de la Providence est si sacré, si nécessaire au bonheur du genre humain, que nul honnête homme ne doit exposer les lecteurs à douter d’une vérité qui ne peut faire de mal en aucun cas, & qui peut toûjours opérer beaucoup de bien.
Nous ne regardons point ce dogme de la providence universelle comme un systême, mais comme une chose démontrée à tous les esprits raisonnables ; au contraire, les divers systêmes sur la nature de l’ame, sur la grace, sur des opinions métaphysiques, qui divisent toutes les communions, peuvent être soumis à l’examen : car puisqu’ils sont en contestation depuis dix-sept cents années, il est évident qu’ils ne portent point avec eux le caractère de certitude ; ce sont des énigmes que chacun [I-7] peut deviner selon la portée de son esprit.
L’article Genèse est d’un très habile homme favorisé de l’estime & de la confiance d’un grand prince : nous lui demandons pardon d’avoir accourci cet article. Les bornes que nous nous sommes prescrites ne nous ont pas permis de l’imprimer tout entier, il aurait rempli près de la moitié d’un volume.
Quant aux objets de pure littérature, on reconnaîtra aisément les sources où nous avons puisé. Nous avons tâché de joindre l’agréable à l’utile, n’ayant d’autre mérite, & d’autre part à cet ouvrage que le choix. Les personnes de tout état trouveront de quoi s’instruire en s’amusant. Ce livre n’exige pas une lecture suivie ; mais à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ; ils étendent les pensées dont on leur présente le germe ; ils corrigent ce qui leur semble défectueux, & fortifient par leurs réflexions ce qui leur paraît faible.
[I-8]
Ce n’est même que par des personnes éclairées que ce livre peut être lu ; le vulgaire n’est pas fait pour de telles connaissances ; la philosophie ne sera jamais son partage. Ceux qui disent qu’il y a des vérités qui doivent être cachées au peuple, ne peuvent prendre aucune alarme ; le peuple ne lit point ; il travaille six jours de la semaine, & va le septième au cabaret ; en un mot, les ouvrages de philosophie ne sont faits que pour les philosophes, & tout honnête homme doit chercher à être philosophe sans se piquer de l’être.
Nous finissons par faire de très humbles excuses aux personnes de considération qui nous ont favorisés de quelques nouveaux articles, de n’avoir pû les employer comme nous l’aurions voulu ; ils sont venus trop tard. Nous n’en sommes pas moins sensibles à leur bonté, & à leur zèle estimable.
[I-9]
ABBÉ↩
Où allez-vous, monsieur l’Abbé ? &c. Savez-vous bien qu’Abbé signifie père ? Si vous le devenez, vous rendez service à l’État ; vous faites la meilleure œuvre sans doute que puisse faire un homme ; il naîtra de vous un être pensant. Il y a dans cette action quelque chose de divin.
Mais si vous n’êtes Monsieur l’Abbé que pour avoir été tonsuré, pour porter un petit collet, & un manteau court, & pour attendre un bénéfice simple, vous ne méritez pas le nom d’Abbé.
Les anciens moines donnèrent ce nom au supérieur qu’ils élisaient. L’Abbé était leur père [I-10] spirituel. Que les mêmes noms signifient avec le tems des choses différentes ! L’Abbé spirituel était un pauvre à la tête de plusieurs autres pauvres. Mais les pauvres pères spirituels ont eu depuis, deux cents, quatre cents mille livres de rente ; & il y a aujourd’hui des pauvres pères spirituels en Allemagne qui ont un régiment des gardes.
Un pauvre qui a fait serment d’être pauvre, & qui en conséquence est souverain ! on l’a déjà dit, il faut le redire mille fois, cela est intolérable. Les loix réclament contre cet abus, la religion s’en indigne, & les véritables pauvres sans vêtement & sans nourriture poussent des cris au ciel à la porte de M. l’Abbé.
Mais j’entends Messieurs les Abbés d’Italie, d’Allemagne, de Flandre, de Bourgogne, qui disent, Pourquoi n’accumulerons-nous pas des biens & des honneurs ? pourquoi ne serons-nous pas princes ? les évêques le sont bien. Ils étaient originairement pauvres comme nous, ils se sont enrichis, ils se sont élevés ; l’un d’eux est devenu supérieur aux rois : laissez-nous les imiter autant que nous pourrons.
Vous avez raison, Messieurs, envahissez la terre ; elle appartient au fort ou à l’habile qui s’en empare ; vous avez profité des tems d’ignorance, de superstition, de démence, pour nous dépouiller de nos héritages & pour nous fouler à vos pieds, pour vous engraisser de la substance des malheureux ; tremblez que le jour de la raison n’arrive.
[I-11]
ABRAHAM.↩
Abraham est un de ces noms célèbres dans l’Asie mineure, & dans l’Arabie, comme Thaut chez les Égyptiens, le premier Zoroastre dans la Perse, Hercule en Grèce, Orphée dans la Thrace, Odin chez les nations septentrionales, & tant d’autres plus connus par leur célébrité, que par une histoire bien avérée. Je ne parle ici que de l’histoire profâne ; car pour celle des Juifs nos maîtres & nos ennemis, que nous croyons & que nous détestons, comme l’histoire de ce peuple a été visiblement écrite par le Saint-Esprit lui-même, nous avons pour elle les sentimens que nous devons avoir. Nous ne nous adressons ici qu’aux Arabes ; ils se vantent de descendre d’Abraham par Ismaël ; ils croient que ce patriarche bâtit la Mecque, & qu’il mourut dans cette ville. Le fait est que la race d’Ismaël a été infiniment plus favorisée de Dieu que la race de Jacob. L’une & l’autre race a produit à la vérité des voleurs ; mais les voleurs Arabes ont été prodigieusement supérieurs aux voleurs Juifs. Les descendants de Jacob ne conquirent qu’un très petit pays qu’ils ont perdu ; & les descendants d’Ismaël ont conquis une partie de l’Asie, de l’Europe & de l’Afrique, ont établi un empire plus vaste que celui des Romains, & ont chassé les Juifs de leurs cavernes, qu’ils appellaient la terre de promission.
[I-12]
À ne juger des choses que par les exemples de nos histoires modernes, il serait assez difficile qu’Abraham eût été le père de deux nations si différentes ; on nous dit qu’il était né en Caldée, & qu’il était fils d’un pauvre potier, qui gagnait sa vie à faire des petites idoles de terre. Il n’est guère vraisemblable que le fils de ce potier soit allé fonder la Mecque à quatre cents lieuës de là sous le tropique, en passant par des déserts impraticables. S’il fut un conquérant, il s’adressa sans doute au beau pays de l’Assyrie ; & s’il ne fut qu’un pauvre homme, comme on nous le dépeint, il n’a pas fondé des royaumes hors de chez lui.
La Genèse rapporte qu’il avait soixante & quinze ans lorsqu’il sortit du pays d’Aran après la mort de son père Tharé le potier. Mais la même Genèse dit aussi que Tharé ayant engendré Abraham à soixante & dix ans, ce Tharé vécut jusqu’à deux cent cinq ans, & qu’Abraham ne partit d’Aran qu’après la mort de son père. À ce compte il est clair par la Genèse même qu’Abraham était âgé de cent trente-cinq ans quand il quitta la Mésopotamie. Il alla d’un pays qu’on nomme idolâtre dans un autre pays idolâtre nommé Sichem en Palestine. Pourquoi y alla-t-il ? Pourquoi quitta-t-il les bords fertiles de l’Euphrate pour une contrée aussi éloignée, aussi stérile & pierreuse que celle de Sichem ? La langue Caldéenne devait être fort différente de celle de Sichem, ce n’était point un lieu de commerce ; Sichem est éloigné de la Caldée de plus de [I-13] cent lieuës : il faut passer des déserts pour y arriver : mais Dieu voulait qu’il fît ce voyage ; il voulait lui montrer la terre que devaient occuper ses descendants plusieurs siècles après lui. L’esprit humain comprend avec peine les raisons d’un tel voyage.
À peine est-il arrivé dans le petit pays montagneux de Sichem, que la famine l’en fait sortir. Il va en Égypte avec sa femme chercher de quoi vivre. Il y a deux cents lieuës de Sichem à Memphis ; est-il naturel qu’on aille demander du blé si loin & dans un pays dont on n’entend point la langue ? voilà d’étranges voyages entrepris à l’âge de près de cent quarante années.
Il amène à Memphis sa femme Sara, qui était extrêmement jeune & presque enfant en comparaison de lui, car elle n’avait que soixante-cinq ans. Comme elle était très belle, il résolut de tirer parti de sa beauté ; Feignez que vous êtes ma sœur, lui dit-il, afin qu’on me fasse du bien à cause de vous. Il devait bien plutôt lui dire, Feignez que vous êtes ma fille. Le roi devint amoureux de la jeune Sara, & donna au prétendu frère beaucoup de brebis, de bœufs, d’ânes, d’ânesses, de chameaux, de serviteurs, de servantes : ce qui prouve que l’Égypte dès lors était un royaume très puissant & très policé, par conséquent très ancien, & qu’on récompensait magnifiquement les frères qui venaient offrir leurs sœurs aux rois de Memphis.
La jeune Sara avait quatre-vingt-dix ans [I-14] quand Dieu lui promit qu’Abraham, qui en avait alors cent soixante, lui ferait un enfant dans l’année.
Abraham, qui aimait à voyager, alla dans le désert horrible de Cadés avec sa femme grosse, toûjours jeune & toûjours jolie. Un roi de ce désert ne manqua pas d’être amoureux de Sara comme le roi d’Égypte l’avait été. Le père des croyants fit le même mensonge qu’en Égypte : il donna sa femme pour sa sœur, & eut encor de cette affaire des brebis, des bœufs, des serviteurs & des servantes. On peut dire que cet Abraham devint fort riche du chef de sa femme. Les commentateurs ont fait un nombre prodigieux de volumes pour justifier la conduite d’Abraham, & pour concilier la chronologie. Il faut donc renvoyer le lecteur à ces commentaires. Ils sont tous composés par des esprits fins & délicats, excellents métaphysiciens, gens sans préjugé, & point du tout pédants.
Au reste ce nom Bram, Abram, était fameux dans l’Inde & dans la Perse : plusieurs doctes prétendent même que c’était le même législateur que les Grecs appelèrent Zoroastre. D’autres disent que c’était le Brama des Indiens : ce qui n’est pas démontré.
Mais ce qui paraît fort raisonnable à beaucoup de savants, c’est que cet Abraham était Caldéen ou Persan : les Juifs dans la suite des tems se vantèrent d’en être descendus, comme les Francs descendent d’Hector, & les Bretons de Tubal. Il est constant que la nation Juive [I-15] était une horde très moderne ; qu’elle ne s’établit vers la Phénicie que très tard ; qu’elle était entourée de peuples anciens ; qu’elle adopta leur langue ; qu’elle prit d’eux jusqu’au nom d’Israël, lequel est Caldéen, suivant le témoignage même du Juif Flavien Joseph. On sait qu’elle prit jusqu’aux noms des anges chez les Babyloniens ; qu’enfin elle n’appela Dieu du nom d’Éloï, ou Éloa, d’Adonaï, de Jehova ou Hiao que d’après les Phéniciens.
Elle ne connut probablement le nom d’Abraham ou d’Ibrahim que par les Babyloniens ; car l’ancienne religion de toutes les contrées depuis l’Euphrate jusqu’à l’Oxus était appelée Kish Ibrahim, Millat Ibrahim. C’est ce que toutes les recherches faites sur les lieux par le savant Hide nous confirment.
Les Juifs firent donc de l’histoire & de la fable ancienne, ce que leurs fripiers font de leurs vieux habits, ils les retournent & les vendent comme neufs le plus chèrement qu’ils peuvent.
C’est un singulier exemple de la stupidité humaine que nous ayons si longtems regardé les Juifs comme une nation qui avait tout enseigné aux autres, tandis que leur historien Joseph avoue lui-même le contraire.
Il est difficile de percer dans les ténèbres de l’antiquité ; mais il est évident que tous les royaumes de l’Asie étaient très florissants avant que la horde vagabonde des Arabes appelés Juifs, possédât un petit coin de terre en propre, avant qu’elle eût une ville, des [I-16] loix & une religion fixe. Lors donc qu’on voit un ancien rite, une ancienne opinion établie en Égypte ou en Asie, & chez les Juifs, il est bien naturel de penser que le petit peuple nouveau, ignorant, grossier, toûjours privé des arts, a copié, comme il a pu, la nation antique, florissante & industrieuse.
C’est sur ce principe qu’il faut juger la Judée, la Biscaye, Cornouailles, Bergame, le pays d’Arlequin &c. : certainement la triomphante Rome n’imita rien de la Biscaye, de Cornouailles, ni de Bergame ; & il faut être ou un grand ignorant, ou un grand fripon, pour dire que les Juifs enseignèrent les Grecs.
ADAM.↩
La pieuse Madame Bourignon était sûre qu’Adam avait été hermaphrodite, comme les premiers hommes du divin Platon. Dieu lui avait révélé ce grand secret ; mais comme je n’ai pas eu les mêmes révélations, je n’en parlerai point. Les rabbins Juifs ont lû les livres d’Adam ; ils savent le nom de son précepteur & de sa seconde femme ; mais comme je n’ai point lû ces livres de notre premier père, je n’en dirai mot. Quelques esprits creux, très savans, sont tout étonnés quand ils lisent le Veidam des anciens brachmanes de trouver que le premier homme fut créé aux [I-17] Indes, &c. qu’il s’appelait Adimo qui signifie l’engendreur, & que sa femme s’appelait Procriti qui signifie la vie. Ils disent que la secte des Brachmanes est incontestablement plus ancienne que celle des Juifs, que les Juifs ne purent écrire que très tard dans la langue Cananéenne, puisqu’ils ne s’établirent que très tard dans le petit pays de Canaan ; ils disent que les Indiens furent toûjours inventeurs, & les Juifs toûjours imitateurs, les Indiens toûjours ingénieux, & les Juifs toûjours grossiers ; ils disent qu’il est bien difficile qu’Adam qui était roux, & qui avait des cheveux, soit le père des nègres qui sont noirs comme de l’encre, & qui ont de la laine noire sur la tête. Que ne disent-ils point ? pour moi je ne dis mot ; j’abandonne ces recherches au révérend père Berruyer de la Société de Jésus ; c’est le plus grand innocent que j’aie jamais connu. On a brûlé son livre comme celui d’un homme qui voulait tourner la Bible en ridicule : mais je puis assurer qu’il n’y entendait pas finesse.
(Tiré d’une lettre du chevalier de R**.)
AME.↩
Ce serait une belle chose de voir son ame. Connais-toi toi-même, est un excellent précepte, mais il n’appartient qu’à Dieu de le mettre en pratique : quel autre que lui peut connaître son essence ?
[I-18]
Nous appelons ame, ce qui anime. Nous n’en savons guères davantage, grace aux bornes de notre intelligence. Les trois quarts du genre humain ne vont pas plus loin, & ne s’embarrassent pas de l’être pensant ; l’autre quart cherche, personne n’a trouvé ni ne trouvera.
Pauvre pédant, tu vois une plante qui végète, & tu dis végétation, ou même, ame végétative. Tu remarques que les corps ont & donnent du mouvement, & tu dis Force ; tu vois ton chien de chasse apprendre sous toi son métier, & tu cries, instinct, ame sensitive : tu as des idées combinées, & tu dis Esprit.
Mais de grace, qu’entends-tu par ces mots, Cette fleur végète ? mais y a-t-il un être réel qui s’appelle végétation, ce corps en pousse un autre, mais possède-t-il en soi un être distinct qui s’appelle force ? ce chien te rapporte une perdrix, mais y a-t-il un être qui s’appelle instinct ? ne rirais-tu pas d’un raisonneur, (eût-il été précepteur d’Alexandre) qui te dirait, Tous les animaux vivent, donc il y a dans eux un être, une forme substantielle qui est la vie ?
Si une tulippe pouvait parler, & qu’elle te dit, Ma végétation & moi, nous sommes deux êtres joints évidemment ensemble, ne te moquerais-tu pas de la tulippe ?
Voyons d’abord ce que tu sais, & de quoi tu es certain ; que tu marches avec tes pieds, que tu digères par ton estomach, que tu sens par tout ton corps, & que tu penses par ta tête. Voyons si ta seule raison a pu te donner assez de [I-19] lumières, pour conclure sans un secours surnaturel que tu as une ame ?
Les premiers philosophes, soit Caldéens, soit Égyptiens, dirent, Il faut qu’il y ait en nous quelque chose qui produise nos pensées ; ce quelque chose doit être très subtil, c’est un souffle, c’est du feu, c’est de l’éther, c’est une quintessence, c’est un simulacre léger, c’est une entéléchie, c’est un nombre, c’est une harmonie. Enfin, selon le divin Platon, c’est un composé du même, & de l’autre ; ce sont des atômes qui pensent en nous, a dit Épicure après Démocrite. Mais, mon ami, comment un atôme pense-t-il ? avoue que tu n’en sais rien.
L’opinion à laquelle on doit s’attacher sans doute, c’est que l’ame est un être immatériel. Mais certainement, vous ne concevez pas ce que c’est que cet être immatériel ? Non, répondent les savants ; mais nous savons que sa nature est de penser. Et d’où le savez-vous ? Nous le savons, parce qu’il pense. Ô savants ! j’ai bien peur que vous ne soyez aussi ignorans qu’Épicure ; la nature d’une pierre est de tomber, parce qu’elle tombe ; mais je vous demande, qui la fait tomber ?
Nous savons, poursuivent-ils, qu’une pierre n’a point d’ame ; d’accord je le crois comme vous. Nous savons qu’une négation, & une affirmation ne sont point divisibles, ne sont point des parties de la matière ; je suis de votre avis. Mais la matière, à nous d’ailleurs inconnue, possède des qualités qui ne sont pas [I-20] matérielles, qui ne sont pas divisibles ; elle a la gravitation vers un centre que Dieu lui a donnée. Or cette gravitation n’a point de parties, n’est point divisible. La force motrice des corps n’est pas un être composé de parties. La végétation des corps organisés, leur vie, leur instinct, ne sont pas non plus des êtres à part, des êtres divisibles, vous ne pouvez pas plus couper en deux la végétation d’une rose, la vie d’un cheval, l’instinct d’un chien, que vous ne pourrez couper en deux une sensation, une négation, une affirmation. Votre bel argument tiré de l’indivisibilité de la pensée ne prouve donc rien du tout.
Qu’appelez-vous donc votre ame ? quelle idée en avez-vous ? Vous ne pouvez par vous-même, sans révélation, admettre autre chose en vous, qu’un pouvoir à vous inconnu, de sentir, de penser.
À présent, dites-moi de bonne foi, Ce pouvoir de sentir & de penser, est-il le même que celui qui vous fait digérer & marcher ? vous m’avouez que non, car votre entendement aurait beau dire à votre estomach, digère, il n’en fera rien s’il est malade ; en vain votre être immatériel ordonnerait à vos pieds de marcher, ils resteront là, s’ils ont la goutte.
Les Grecs ont bien senti que la pensée n’avait souvent rien à faire avec le jeu de nos organes ; ils ont admis pour ces organes une ame animale, & pour les pensées une ame plus fine, plus subtile, un nous.
Mais voilà cette ame de la pensée, qui en [I-21] mille occasions a l’intendance sur l’ame animale. L’ame pensante commande à ses mains de prendre, & elles prennent. Elle ne dit point à son cœur de battre, à son sang de couler, à son chile de se former, tout cela se fait sans elle : voilà deux ames bien embarrassées, & bien peu maîtresses à la maison.
Or cette première ame animale n’existe certainement point, elle n’est autre chose que le mouvement de vos organes. Prends garde, ô homme ! que tu n’as pas plus de preuve par ta faible raison que l’autre ame existe. Tu ne peux le savoir que par la foi. Tu es né, tu vis, tu agis, tu penses, tu veilles, tu dors sans savoir comment. Dieu t’a donné la faculté de penser comme il t’a donné tout le reste, & s’il n’était pas venu t’apprendre dans les tems marqués par sa providence que tu as une ame immatérielle & immortelle, tu n’en aurais aucune preuve.
Voyons les beaux systêmes que ta philosophie a fabriqués sur ces ames.
L’un dit que l’ame de l’homme est partie de la substance de Dieu même, l’autre qu’elle est partie du grand tout, un troisième qu’elle est créée de toute éternité, un quatrième qu’elle est faite, & non créée ; d’autres assurent que Dieu les forme à mesure qu’on en a besoin, & qu’elles arrivent à l’instant de la copulation ; Elles se logent dans les animalcules séminaux, crie celui-ci : Non, dit celui-là, elles vont habiter dans les trompes de Fallope. Vous avez tous tort, dit un survenant, l’ame attend [I-22] six semaines que le fœtus soit formé, & alors elle prend possession de la glande pinéale ; mais [si] elle trouve un faux germe, elle s’en retourne, en attendant une meilleure occasion. La dernière opinion est que sa demeure est dans le corps calleux, c’est le poste que lui assigne La Peironie ; il fallait être premier chirurgien du roi de France pour disposer ainsi du logement de l’ame. Cependant, son corps calleux n’a pas fait la même fortune que ce chirurgien avait faite.
St. Thomas dans sa question 75e & suivantes, dit que l’ame est une forme subsistante, per se, qu’elle est toute en tout, que son essence diffère de sa puissance, qu’il y a trois ames végétatives, savoir, la nutritive, l’augmentative, la générative ; que la mémoire des choses spirituelles est spirituelle, & la mémoire des corporelles est corporelle ; que l’ame raisonnable est une forme immatérielle quant aux opérations, & matérielle quant à l’être. St. Thomas a écrit deux mille pages de cette force & de cette clarté ; aussi est-il l’ange de l’école.
On n’a pas fait moins de systêmes sur la manière dont cette ame sentira quand elle aura quitté son corps avec lequel elle sentait, comment elle entendra sans oreilles, flairera sans nez, & touchera sans mains ; quel corps ensuite elle reprendra, si c’est celui qu’elle avait à deux ans, ou à quatre-vingts ; comment le moi, l’identité de la même personne subsistera, comment l’ame d’un homme devenu imbécille à l’âge de quinze ans, & mort imbécille à l’âge [I-23] de soixante & dix, reprendra le fil des idées qu’elle avait dans son âge de puberté ; par quel tour d’adresse une ame dont la jambe aura été coupée en Europe, & qui aura perdu un bras en Amérique, retrouvera cette jambe & ce bras, lesquels ayant été transformés en légumes, auront passé dans le sang de quelque autre animal. On ne finirait point si on voulait rendre compte de toutes les extravagances que cette pauvre ame humaine a imaginées sur elle-même.
Ce qui est très singulier, c’est que dans les loix du peuple de Dieu, il n’est pas dit un mot de la spiritualité & de l’immortalité de l’ame, rien dans le Décalogue, rien dans le Lévitique ni dans le Deutéronome.
Il est très certain, il est indubitable, que Moïse en aucun endroit ne propose aux Juifs des récompenses & des peines dans une autre vie, qu’il ne leur parle jamais de l’immortalité de leurs ames, qu’il ne leur fait point espérer le ciel, qu’il ne les menace point des enfers, tout est temporel.
Il leur dit avant de mourir, dans son Deutéronome :
« Si après avoir eu des enfans & des petits-enfans, vous prévariquez, vous serez exterminés du pays, & réduits à un petit nombre dans les nations.
« Je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères jusqu’à la troisième & quatrième génération.
« Honorez père & mère afin que vous viviez longtems.
« Vous aurez de quoi manger sans en manquer jamais.
[I-24]
« Si vous suivez des dieux étrangers, vous serez détruits…..
« Si vous obéissez, vous aurez de la pluie au printems ; & en automne, du froment, de l’huile, du vin, du foin pour vos bêtes, afin que vous mangiez, & que vous soyez saouls.
« Mettez ces paroles dans vos cœurs, dans vos mains, entre vos yeux, écrivez-les sur vos portes, afin que vos jours se multiplient.
« Faites ce que je vous ordonne, sans y rien ajouter, ni retrancher.
« S’il s’élève un prophête qui prédise des choses prodigieuses, si sa prédiction est véritable, & si ce qu’il a dit arrive, & s’il vous dit, Allons, suivons des dieux étrangers….. tuez-le aussitôt, & que tout le peuple frappe après vous.
« Lorsque le Seigneur vous aura livré les nations, égorgez tout sans épargner un seul homme, & n’ayez aucune pitié de personne.
« Ne mangez point des oiseaux impurs, comme l’aigle, le griffon, l’ixion, &c.
« Ne mangez point des animaux qui ruminent & dont l’ongle n’est point fendu ; comme chameau, lièvre, porc-épic, &c.
« En observant toutes les ordonnances, vous serez bénis dans la ville & dans les champs, les fruits de votre ventre, de votre terre, de vos bestiaux seront bénis…
« Si vous ne gardez pas toutes les ordonnances & toutes les cérémonies, vous serez maudits dans la ville & dans les champs….. [I-25] « vous éprouverez la famine, la pauvreté, vous mourrez de misère, de froid, de pauvreté, de fièvre ; vous aurez la rogne, la gale, la fistule….. vous aurez des ulcères dans les genoux, & dans les gras de jambes.
« L’étranger vous prêtera à usure, & vous ne lui prêterez point à usure… parce que vous n’aurez pas servi le Seigneur.
« Et vous mangerez le fruit de votre ventre, & la chair de vos fils & de vos filles, &c. »
Il est évident que dans toutes ces promesses & dans toutes ces menaces il n’y a rien que de temporel, & qu’on ne trouve pas un mot sur l’immortalité de l’ame, & sur la vie future.
Plusieurs commentateurs illustres ont cru que Moïse était parfaitement instruit de ces deux grands dogmes ; & ils le prouvent par les paroles de Jacob, qui croyant que son fils avait été dévoré par les bêtes, disait dans sa douleur : Je descendrai avec mon fils dans la fosse, in infernum, dans l’enfer ; c’est-à-dire, je mourrai, puisque mon fils est mort.
Ils le prouvent encor par des passages d’Isaïe & d’Ézéchiel ; mais les Hébreux auxquels parlait Moïse, ne pouvaient avoir lû ni Ézéchiel, ni Isaïe, qui ne vinrent que plusieurs siècles après.
Il est très inutile de disputer sur les sentimens secrets de Moïse. Le fait est que dans les loix publiques, il n’a jamais parlé d’une vie à venir, qu’il borne tous les châtimens & toutes les récompenses au tems présent. S’il connaissait la vie future, pourquoi n’a-t-il pas expressément étalé ce grand dogme ? & s’il ne l’a [I-26] pas connu, quel était l’objet de sa mission ? C’est une question que font plusieurs grands personnages ; ils répondent que le maître de Moïse & de tous les hommes, se réservait le droit d’expliquer dans son temps aux Juifs une doctrine qu’ils n’étaient pas en état d’entendre lorsqu’ils étaient dans le désert.
Si Moïse avait annoncé le dogme de l’immortalité de l’ame, une grande école des Juifs ne l’aurait pas toûjours combattue. Cette grande école des saducéens n’aurait pas été autorisée dans l’État : Les saducéens n’auraient pas occupé les premières charges, on n’aurait pas tiré de grands pontifes de leur corps.
Il paraît que ce ne fut qu’après la fondation d’Alexandrie, que les Juifs se partagèrent en trois sectes ; les pharisiens, les saducéens & les esséniens. L’historien Joseph, qui était pharisien, nous apprend au livre treize de ses antiquités, que les pharisiens croyaient la métempsicose. Les saducéens croyaient que l’ame périssait avec le corps. Les esséniens, dit encor Joseph, tenaient les ames immortelles ; les ames, selon eux, descendaient en forme aërienne dans les corps, de la plus haute région de l’air ; elles y sont reportées par un attrait violent, & après la mort celles qui ont appartenu à des gens de bien, demeurent au-delà de l’océan, dans un pays où il n’y a ni chaud ni froid, ni vent ni pluie. Les ames des méchants vont dans un climat tout contraire. Telle était la théologie des Juifs.
Celui qui seul devait instruire tous les [I-27] hommes, vint condamner ces trois sectes ; mais sans lui, nous n’aurions jamais pû rien connaître de notre ame, puisque les philosophes n’en ont jamais eu aucune idée déterminée, & que Moïse, seul vrai législateur du monde avant le nôtre, Moïse qui parlait à Dieu face à face a laissé les hommes dans une ignorance profonde sur ce grand article. Ce n’est donc que depuis dix-sept cents ans qu’on est certain de l’existence de l’ame, & de son immortalité.
Ciceron n’avait que des doutes ; son petit-fils & sa petite-fille purent apprendre la vérité des premiers Galiléens qui vinrent à Rome.
Mais avant ce tems-là, & depuis dans tout le reste de la terre où les apôtres ne pénétrèrent pas, chacun devait dire à son ame, Qui es-tu ? d’où viens-tu ? que fais-tu ? où vas-tu ? Tu es je ne sais quoi, pensant & sentant, & quand tu sentirais & penserais cent mille millions d’années tu n’en sauras jamais davantage par tes propres lumières, sans le secours d’un Dieu.
Ô homme ! ce Dieu t’a donné l’entendement pour te bien conduire, & non pour pénétrer dans l’essence des choses qu’il a créées.
C’est ainsi qu’a pensé Loke, & avant Loke Gassendi, & avant Gassendi une foule de sages ; mais nous avons des bacheliers qui savent tout ce que ces grands-hommes ignoraient.
De cruels ennemis de la raison ont osé s’élever contre ces vérités reconnues par tous les sages. Ils ont porté la mauvaise foi & l’impudence jusqu’à imputer aux auteurs de cet [I-28] ouvrage, d’avoir assuré que l’ame est matière. Vous savez bien, persécuteurs de l’innocence, que nous avons dit tout le contraire. Vous avez dû lire ces propres mots contre Épicure, Démocrite & Lucrèce, mon ami, comment un atôme pense-t-il ? avoue que tu n’en sais rien. Vous êtes donc évidemment des calomniateurs.
Personne ne sait ce que c’est que l’Être appelé esprit, auquel même vous donnez ce nom matériel d’esprit qui signifie vent. Tous les premiers Pères de l’Église ont cru l’ame corporelle. Il est impossible à nous autres êtres bornés de savoir si notre intelligence est substance ou faculté : nous ne pouvons connaître à fond ni l’être étendu, ni l’être pensant, ou le mécanisme de la pensée.
On vous crie, avec les respectables Gassendi & Loke, que nous ne savons rien par nous-mêmes des secrets du Créateur. Êtes-vous donc des dieux qui savez tout ? On vous répète que nous ne pouvons connaître la nature & la destination de l’ame que par la révélation. Quoi ! cette révélation ne vous suffit-elle pas ? Il faut bien que vous soyez ennemis de cette révélation que nous réclamons, puisque vous persécutez ceux qui attendent tout d’elle, & qui ne croient qu’en elle.
Nous nous en rapportons, disons-nous, à la parole de Dieu ; & vous, ennemis de la raison & de Dieu, vous qui blasphémez l’un & l’autre, vous traitez l’humble doute, & l’humble soumission du philosophe, comme le loup traita l’agneau dans les fables d’Ésope ; vous [I-29] lui dites, Tu médis de moi l’an passé, il faut que je suce ton sang. La philosophie ne se venge point ; elle rit en paix de vos vains efforts ; elle éclaire doucement les hommes que vous voulez abrutir pour les rendre semblables à vous.
AMITIÉ.↩
C’est le mariage de l’ame ; c’est un contrat tacite entre deux personnes sensibles & vertueuses. Je dis sensibles ; car un moine, un solitaire peut n’être point méchant, & vivre sans connaître l’amitié. Je dis vertueuses ; car les méchants n’ont que des complices ; les voluptueux ont des compagnons de débauches ; les intéressés ont des associés, les politiques assemblent des factieux, le commun des hommes oisifs a des liaisons, les princes ont des courtisans, les hommes vertueux ont seuls des amis. Céthégus était le complice de Catilina, & Mécène le courtisan d’Octave ; mais Cicéron était l’ami d’Atticus.
Que porte ce contrat entre deux ames tendres & honnêtes ? Les obligations en sont plus fortes & plus faibles, selon leur degré de sensibilité, & le nombre des services rendus, &c.
L’enthousiasme de l’amitié a été plus fort chez les Grecs & chez les Arabes, que chez nous. Les contes que ces peuples ont imaginés sur l’amitié sont admirables ; nous n’en avons [I-30] point de pareils, nous sommes un peu secs en tout.
L’amitié était un point de religion & de législation chez les Grecs. Les Thébains avaient le régiment des amans. Beau régiment ! Quelques-uns l’ont pris pour un régiment de sodomites ; ils se trompent, c’est prendre l’accessoire pour le principal. L’amitié chez les Grecs était prescrite par la loi & la religion. La pédérastie était malheureusement tolérée par les mœurs ; il ne faut pas imputer à la loi des abus honteux. Nous en parlerons encor.
AMOUR.↩
Amor omnibus idem. Il faut ici recourir au physique, c’est l’étoffe de la nature que l’imagination a brodée. Veux-tu avoir une idée de l’amour ? Vois les moineaux de ton jardin, vois tes pigeons, contemple le taureau qu’on amène à ta genisse, regarde ce fier cheval que deux de ses valets conduisent à la cavale paisible qui l’attend & qui détourne sa queuë pour le recevoir, vois comme ses yeux étincellent, entends ses hennissements, contemple ces sauts, ces courbettes, ces oreilles dressées, cette bouche qui s’ouvre avec de petites convulsions, ces narines qui s’enflent, ce souffle enflammé qui en sort, ces crins qui se relèvent & qui flottent, ce mouvement impétueux dont il s’élance sur l’objet que la nature lui a destiné ; [I-31] mais ne sois point jaloux, & songe aux avantages de l’espèce humaine ; ils compensent en amour tous ceux que la nature a donnés aux animaux, force, beauté, légèreté, rapidité.
Il y a même des animaux qui ne connaissent point la jouïssance. Les poissons écaillés sont privés de cette douceur ; la femelle jette sur la vase des millions d’œufs ; le mâle qui les rencontre, passe sur eux & les féconde par sa semence, sans se mettre en peine à quelle femelle ils appartiennent.
La plûpart des animaux qui s’accouplent ne goûtent de plaisir que par un seul sens, & dès que cet appétit est satisfait, tout est éteint. Aucun animal, hors toi, ne connaît les embrassemens ; tout ton corps est sensible ; tes lèvres surtout jouïssent d’une volupté que rien ne lasse, & ce plaisir n’appartient qu’à ton espèce ; enfin, tu peux dans tous les tems te livrer à l’amour, & les animaux n’ont qu’un tems marqué. Si tu réfléchis sur ces prééminences, tu diras avec le comte de Rochester, L’amour dans un pays d’athées, ferait adorer la Divinité.
Comme les hommes ont reçu le don de perfectionner tout ce que la nature leur accorde, ils ont perfectionné l’amour. La propreté, le soin de soi-même, en rendant la peau plus délicate, augmente le plaisir du tact, & l’attention sur sa santé rend les organes de la volupté plus sensibles.
Tous les autres sentimens entrent ensuite dans celui de l’amour, comme des métaux qui [I-32] s’amalgament avec l’or : l’amitié, l’estime viennent au secours ; les talents du corps & de l’esprit sont encor de nouvelles chaînes.
Nam facit ipsa suis interdum foemina factis,
Morigerisque modis & mundo corpore cultu
Ut facile insuescat secum vir degere vitam.
(Lucrèce Liv. V.)
L’amour-propre surtout resserre tous ces liens. On s’applaudit de son choix, & les illusions en foule sont les ornements de cet ouvrage dont la nature a posé les fondements.
Voilà ce que tu as au-dessus des animaux ; mais si tu goûtes tant de plaisirs qu’ils ignorent, que de chagrins aussi, dont les bêtes n’ont point d’idée ! Ce qu’il y a d’affreux pour toi, c’est que la nature a empoisonné dans les trois quarts de la terre les plaisirs de l’amour, & les sources de la vie, par une maladie épouvantable, à laquelle l’homme seul est sujet, & qui n’infecte que chez lui les organes de la génération.
Il n’en est point de cette peste comme de tant d’autres maladies qui sont la suite de nos excès. Ce n’est point la débauche qui l’a introduite dans le monde. Les Phriné, les Laïs, les Flora, les Messalines n’en furent point attaquées, elle est née dans des îles où les hommes vivaient dans l’innocence, & de là elle s’est répanduë dans l’ancien monde.
Si jamais on a pu accuser la nature de mépriser son ouvrage, de contredire son plan, [I-33] d’agir contre ses vuës, c’est dans cette occasion. Est-ce là le meilleur des mondes possibles ? Eh quoi, si César, Antoine, Octave, n’ont point eu cette maladie, n’était-il pas possible qu’elle ne fît point mourir François I. ? Non, dit-on, les choses étaient ainsi ordonnées pour le mieux ; je le veux croire, mais cela est triste pour ceux à qui Rabelais a dédié son livre.
AMOUR
NOMMÉ SOCRATIQUE.↩
Comment s’est-il pu faire qu’un vice, destructeur du genre-humain s’il était général, qu’un attentat infâme contre la nature, soit pourtant si naturel ? il paraît être le dernier degré de la corruption réfléchie, & cependant il est le partage ordinaire de ceux qui n’ont pas eu encor le tems d’être corrompus. Il est entré dans des cœurs tout neufs, qui n’ont connu encor ni l’ambition, ni la fraude, ni la soif des richesses ; c’est la jeunesse aveugle, qui par un instinct mal démêlé se précipite dans ce désordre au sortir de l’enfance.
Le penchant des deux sexes l’un pour l’autre se déclare de bonne heure ; mais quoi qu’on ait dit des Africaines & des femmes de l’Asie méridionale, ce penchant est généralement [I-34] plus fort dans l’homme que dans la femme, c’est une loi que la nature a établie pour tous les animaux. C’est toûjours le mâle qui attaque la femelle.
Les jeunes mâles de notre espèce, élevés ensemble, sentant cette force que la nature commence à déployer en eux, & ne trouvant point l’objet naturel de leur instinct, se rejettent sur ce qui lui ressemble. Souvent un jeune garçon par la fraîcheur de son teint, par l’éclat de ses couleurs, & par la douceur de ses yeux, ressemble pendant deux ou trois ans à une belle fille ; si on l’aime, c’est parce que la nature se méprend ; on rend hommage au sexe en s’attachant à ce qui en a les beautés, & quand l’âge a fait évanouïr cette ressemblance, la méprise cesse.
Citraque juventam
Ætatis breve ver & primos carpere flores.
On sait assez que cette méprise de la nature est beaucoup plus commune dans les climats doux que dans les glaces du septentrion, parce que le sang y est plus allumé, & l’occasion plus fréquente ; aussi, ce qui ne paraît qu’une faiblesse dans le jeune Alcibiade, est une abomination dégoûtante dans un matelot Hollandais, & dans un vivandier Moscovite.
Je ne peux souffrir qu’on prétende que les Grecs ont autorisé cette licence. On cite le législateur Solon, parce qu’il a dit en deux mauvais vers,
[I-35]
Tu chériras un beau garçon,
Tant qu’il n’aura barbe au menton.
Mais en bonne foi, Solon était-il législateur quand il fit ces deux vers ridicules ? il était jeune alors, & quand le débauché fut devenu sage, il ne mit point une telle infamie parmi les loix de sa république ; c’est comme si on accusait Théodore de Bèze d’avoir prêché la pédérastie dans son église, parce que dans sa jeunesse il fit des vers pour le jeune Candide, & qu’il dit :
Amplector hunc & illam.
On abuse du texte de Plutarque, qui dans ses bavarderies, au Dialogue de l’amour, fait dire à un interlocuteur que les femmes ne sont pas dignes du véritable amour ; mais un autre interlocuteur soutient le parti des femmes comme il le doit. Montesquieu s’est bien trompé.
Il est certain, autant que la science de l’antiquité peut l’être, que l’amour socratique n’était point un amour infâme. C’est ce nom d’amour qui a trompé. Ce qu’on appelait les amants d’un jeune homme, étaient précisément ce que sont parmi nous les menins de nos princes ; ce qu’étaient les enfans d’honneur, des jeunes gens attachés à l’éducation d’un enfant distingué, partageant les mêmes études, les mêmes travaux militaires ; institution guerrière & sainte dont on abusa, comme des fêtes nocturnes, & des Orgies.
[I-36]
La troupe des amants institués par Laïus était une troupe invincible de jeunes guerriers, engagés par serment à donner leur vie les uns pour les autres ; & c’est ce que la discipline antique a jamais eu de plus beau.
Sextus Empiricus & d’autres, ont beau dire que la pédérastie était recommandée par les loix de la Perse ; qu’ils citent le texte de la loi, qu’ils montrent le code des Persans ; & s’ils le montrent, je ne le croirai pas encor, je dirai que la chose n’est pas vraie, par la raison qu’elle est impossible ; non, il n’est pas dans la nature humaine de faire une loi qui contredit, & qui outrage la nature, une loi qui anéantirait le genre humain si elle était observée à la lettre. Que de gens ont pris des usages honteux & tolérés dans un pays pour les loix du pays ! Sextus Empiricus qui doutait de tout, devait bien douter de cette jurisprudence. S’il vivait de nos jours, & qu’il vît deux ou trois jeunes jésuites abuser de quelques écoliers, aurait-il droit de dire que ce jeu leur est permis par les constitutions d’Ignace de Loyola ?
[I-37]
L’amour des garçons était si commun à Rome qu’on ne s’avisait pas de punir cette fadaise dans laquelle tout le monde donnait tête baissée. Octave-Auguste, ce meurtrier débauché & poltron qui osa exiler Ovide, trouve très bon que Virgile chantât Alexis, & qu’Horace fît de petites odes pour Ligurinus ; mais l’ancienne loi Scantinia qui défend la pédérastie subsista toûjours : l’Empereur Philippe la remit en vigueur & chassa de Rome les petits garçons qui faisaient le métier. Enfin je ne crois pas qu’il y ait jamais eu aucune nation policée qui ait fait des loix contre les mœurs. [[1]]
AMOUR-PROPRE↩
Un gueux des environs de Madrid demandait noblement l’aumône. Un passant lui dit, N’êtes-vous pas honteux de faire ce métier infâme quand vous pouvez travailler ? Monsieur, répondit le mendiant, je vous demande de l’argent & non pas des conseils ; puis [I-38] il lui tourna le dos en conservant toute la dignité Castillane. C’était un fier gueux que ce Seigneur, sa vanité était blessée pour peu de chose. Il demandait l’aumône par amour de soi-même, & ne souffrait pas la réprimande par un autre amour de soi-même.
Un missionnaire voyageant dans l’Inde, rencontra un faquir chargé de chaînes, nud comme un singe, couché sur le ventre, & se faisant fouetter pour les péchés de ses compatriotes les Indiens, qui lui donnaient quelques liards du pays. Quel renoncement à soi-même ! disait un des spectateurs. Renoncement à moi-même ? reprit le faquir, Apprenez que je ne me fais fesser dans ce monde que pour vous le rendre dans l’autre, quand vous serez chevaux & moi cavalier.
Ceux qui ont dit que l’amour de nous-mêmes est la base de tous nos sentimens & de toutes nos actions, ont donc eu grande raison dans l’Inde, en Espagne, & dans toute la terre habitable, & comme on n’écrit point pour prouver aux hommes qu’ils ont un visage, il n’est pas besoin de leur prouver qu’ils ont de l’amour-propre. Cet amour-propre est l’instrument de notre conservation, il ressemble à l’instrument de la perpétuité de l’espèce ; il est nécessaire, il nous est cher, il nous fait plaisir, & il faut le cacher.
[I-39]
ANGE↩
Ange, en grec, Envoyé, on n’en sera guère plus instruit quand on saura que les Perses avaient des Peris, les Hébreux des Malakim, les Grecs leurs Demonoi.
Mais ce qui nous instruira peut-être davantage, ce sera qu’une des premières idées des hommes a toûjours été de placer des êtres intermédiaires entre la Divinité & nous ; ce sont ces démons, ces génies que l’antiquité inventa ; l’homme fit toûjours les Dieux à son image. On voyait les princes signifier leurs ordres par des messagers, donc la Divinité envoie aussi ses courriers, Mercure, Iris, étaient des courriers, des messagers.
Les Hébreux, ce seul peuple conduit par la Divinité même, ne donnèrent point d’abord de noms aux Anges que Dieu daignait enfin leur envoyer ; ils empruntèrent les noms que leur donnaient les Caldéens, quand la nation Juive fut captive dans la Babilonie ; Michel & Gabriel, sont nommés pour la première fois par Daniel, esclave chez ces peuples. Le Juif Tobie qui vivait à Ninive, connut l’Ange Raphaël qui voyagea avec son fils pour l’aider à retirer de l’argent que lui devait le Juif Gabaël.
Dans les loix des Juifs, c’est-à-dire, dans le Lévitique & le Deutéronome, il n’est pas fait la moindre mention de l’existence des [I-40] Anges, à plus forte raison de leur culte ; aussi, les saducéens ne croyaient-ils point aux anges.
Mais dans les histoires des Juifs, il en est beaucoup parlé. Ces Anges étaient corporels, ils avaient des aîles au dos, comme les gentils feignirent que Mercure en avait aux talons ; quelquefois ils cachaient leurs aîles sous leurs vêtements. Comment n’auraient-ils pas eu de corps, puisqu’ils buvaient & mangeaient, & que les habitans de Sodome, voulurent commettre le péché de la pédérastie avec les anges qui allèrent chez Loth.
L’ancienne tradition Juive, selon Ben Maimon, admet dix degrés, dix ordres d’anges. 1. Les Chaios Acodesh, purs, saints. 2. Les Ofamins, rapides. 3. Les Oralim, les forts. 4. Les Chasmalim, les flammes. 5. Les Séraphim, étincelles. 6. Les Malachim, anges, messagers, députés. 7. Les Eloim, les dieux ou juges. 8. Les Ben Eloim, enfans des dieux. 9. Chérubim, images. 10. Ychim, les animés.
L’histoire de la chûte des anges ne se trouve point dans les livres de Moïse ; le premier témoignage qu’on en rapporte est celui du prophète Isaïe, qui apostrophant le Roi de Babilone, s’écrie, Qu’est devenu l’exacteur des tributs ! les sapins & les cèdres se réjouissent de sa chute, comment es-tu tombée du ciel, ô Helel, étoile du matin ? on a traduit cet Helel par le mot latin Lucifer ; & ensuite par un sens allégorique on a donné le nom de Lucifer au prince des Anges qui firent la guerre dans le [I-41] ciel ; & enfin ce nom qui signifie phosphère & aurore, est devenu le nom du diable.
La religion chrétienne est fondée sur la chûte des Anges. Ceux qui se révoltèrent furent précipités des sphères qu’ils habitaient dans l’enfer au centre de la terre, & devinrent diables. Un diable tenta Ève sous la figure du serpent & damna le genre humain. Jésus vint racheter le genre humain & triompher du diable qui nous tente encor. Cependant cette tradition fondamentale ne se trouve que dans le livre apocryphe d’Énoch, & encor y est-elle d’une manière toute différente de la tradition reçue.
St. Augustin dans sa 109e lettre, ne fait nulle difficulté d’attribuer des corps déliés & agiles aux bons & aux mauvais Anges. Le pape Grégoire second a réduit à neuf chœurs, à neuf hiérarchies ou ordres, les dix chœurs des Anges reconnus par les Juifs ; ce sont les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges, & enfin les Anges qui donnent le nom aux huit autres hiérarchies.
Les Juifs avaient dans le temple deux chérubins ayant chacun deux têtes, l’une de bœuf & l’autre d’aigle, avec six ailes. Nous les peignons aujourd’hui sous l’image d’une tête volante, ayant deux petites ailes au-dessous des oreilles. Nous peignons les Anges & les archanges sous la figure de jeunes gens, ayant deux aîles au dos. À l’égard des trônes & des dominations, on ne s’est pas encor avisé de les peindre.
[I-42]
Saint Thomas, à la question 108, article second, dit que les trônes sont aussi près de Dieu que les chérubins & les séraphins, parce que c’est sur eux que Dieu est assis. Scot a compté mille millions d’Anges. L’ancienne mythologie des bons & des mauvais génies ayant passé de l’Orient en Grèce, & à Rome, nous consacrames cette opinion, en admettant pour chaque homme un bon & un mauvais Ange, dont l’un l’assiste, & l’autre lui nuit depuis sa naissance jusqu’à sa mort ; mais on ne sait pas encor si ces bons & mauvais Anges passent continuellement de leur poste à un autre, ou s’ils sont relevés par d’autres. Consultez sur cet article la somme de St. Thomas.
On ne sait pas précisément où les Anges se tiennent, si c’est dans l’air, dans le vide, dans les planètes ; Dieu n’a pas voulu que nous en fussions instruits.
ANTITRINITAIRES↩
Pour faire connaître leurs sentimens, il suffit de dire qu’ils soutiennent que rien n’est plus contraire à la droite raison que ce que l’on enseigne parmi les chrétiens touchant la trinité des personnes dans une seule essence divine, dont la seconde est engendrée par la première & la troisième procède des deux autres.
Que cette doctrine inintelligible ne se trouve dans aucun endroit de l’écriture.
[I-43]
Qu’on ne peut produire aucun passage qui l’autorise, & auquel on ne puisse, sans s’écarter en aucune façon de l’esprit du texte, donner un sens plus clair, plus naturel, plus conforme aux notions communes & aux vérités primitives & immuables.
Que soutenir, comme font leurs adversaires, qu’il y a plusieurs personnes distinctes dans l’essence divine, & que ce n’est pas l’Éternel qui est le seul vrai Dieu, mais qu’il y faut joindre le fils & le St. Esprit, c’est introduire dans l’église de Jésus-Christ l’erreur la plus grossière & la plus dangereuse ; puisque c’est favoriser ouvertement le polythéïsme.
Qu’il implique contradiction de dire qu’il n’y a qu’un Dieu & que néanmoins il y a trois personnes, chacune desquelles est véritablement Dieu.
Que cette distinction, un en essence & trois en personnes, n’a jamais été dans l’écriture.
Qu’elle est manifestement fausse, puisqu’il est certain qu’il n’y a pas moins d’essences que de personnes, & de personnes que d’essences.
Que les trois personnes de la trinité sont ou trois substances différentes, ou des accidents de l’essence divine, ou cette essence même sans distinction.
Que dans le premier cas on fait trois Dieux.
Que dans le second on fait Dieu composé d’accidens, on adore des accidens, & on métamorphose des accidens en des personnes.
Que dans le troisième, c’est inutilement & sans fondement qu’on divise un sujet [I-44] indivisible et qu’on distingue en trois ce qui n’est point distingué en soi.
Que si on dit que les trois personnalités ne sont ni des substances différentes dans l’essence divine, ni des accidens de cette essence, on aura de la peine à se persuader qu’elles soient quelque chose.
Qu’il ne faut pas croire que les trinitaires les plus rigides & les plus décidés, aient eux-mêmes quelque idée claire de la manière dont les trois hypostases subsistent en Dieu, sans diviser sa substance & par conséquent sans la multiplier.
Que Saint Augustin lui-même, après avoir avancé sur ce sujet mille raisonnements aussi faux que ténébreux, a été forcé d’avouer qu’on ne pouvait rien dire sur cela d’intelligible.
Ils rapportent ensuite le passage de ce Père qui en effet est très singulier.
« Quand on demande, dit-il, ce que c’est que les trois, le langage des hommes se trouve court, & l’on manque de termes pour les exprimer : on a pourtant dit trois personnes, non pas pour dire quelque chose ; mais parce qu’il faut parler & ne pas demeurer muet. »
Dictum est tres personæ, non ut aliquid diceretur, sed ne taceretur, de trinit. Luc. V. Chap. IX.
Que les théologiens modernes n’ont pas mieux éclairci cette matière.
Que quand on leur demande ce qu’ils entendent par ce mot de personne, ils ne l’expliquent qu’en disant que c’est une certaine distinction incompréhensible, qui fait que l’on [I-45] distingue dans une nature unique en nombre, un Père, un Fils & un St. Esprit.
Que l’explication qu’ils donnent des termes d’engendrer & de procéder n’est pas plus satisfaisante ; puisqu’elle se réduit à dire que ces termes marquent certaines relations incompréhensibles qui sont entre les trois personnes de la trinité.
Que l’on peut recueillir de-là que l’état de la question entre les orthodoxes & eux, consiste à savoir, s’il y a en Dieu trois distinctions dont on n’a aucune idée, & entre lesquelles il y a certaines relations dont on n’a point d’idées non plus.
De tout cela ils concluent qu’il serait plus sage de s’en tenir à l’autorité des Apôtres qui n’ont jamais parlé de la trinité, & de bannir à jamais de la religion tous les termes qui ne sont pas dans l’écriture, comme ceux de trinité, de personne, d’essence, d’hypostase, d’union hypostatique & personnelle, d’incarnation, de génération, de procession, & tant d’autres semblables qui étant absolument vides de sens, puisqu’ils n’ont dans la nature aucun être réel représentatif, ne peuvent exciter dans l’entendement que des notions fausses, vagues, obscures & incomplètes.
(Tiré en grande partie de l’article Unitaires de l’Encyclopédie, lequel article est de l’abbé de Bragelogne.)
Ajoutons à cet article ce que dit dom Calmet dans sa dissertation sur le passage de l’épitre de Jean l’Évangéliste, il y en a trois qui donnent témoignage en terre, l’Esprit, l’eau & [I-46] le sang, & ces trois sont un. Il y en a trois qui donnent témoignage au Ciel, le Père, le verbe & l’esprit, & ces trois sont un. Dom Calmet avoue que ces deux passages ne sont dans aucune Bible ancienne, & il serait en effet bien étrange que St. Jean eût parlé de la Trinité dans une lettre, & n’en eût pas dit un seul mot dans son Évangile. On ne voit nulle trace de ce dogme ni dans les Évangiles canoniques, ni dans les apocryphes. Toutes ces raisons & beaucoup d’autres pourraient excuser les Antitrinitaires, si les Conciles n’avaient pas décidé. Mais comme les hérétiques ne font nul cas des Conciles, on ne sait plus comment s’y prendre pour les confondre.
ANTROPOFAGES↩
Nous avons parlé de l’amour. Il est dur de passer de gens qui se baisent, à gens qui se mangent. Il n’est que trop vrai qu’il y a eu des anthropofages ; nous en avons trouvé en Amérique, il y en a peut-être encor ; & les Cyclopes n’étaient pas les seuls dans l’antiquité qui se nourrissent quelquefois de chair humaine. Juvénal rapporte que chez les Égyptiens, ce peuple si sage, si renommé pour ses loix, ce peuple si pieux qui adorait des crocodiles & des oignons, les Tintirites mangèrent un de leurs ennemis tombé entre leurs mains ; il ne fait pas ce conte sur un ouï-dire, ce [I-47] crime fut commis presque sous ses yeux, il était alors en Égypte, & à peu de distance de Tintire. Il cite à cette occasion les Gascons & les Saguntins qui se nourrirent autrefois de la chair de leurs compatriotes.
En 1725 on amena quatre sauvages du Mississippi à Fontainebleau, j’eus l’honneur de les entretenir ; il y avait parmi eux une Dame du pays, à qui je demandai si elle avait mangé des hommes, elle me répondit très naïvement qu’elle en avait mangé. Je parus un peu scandalisé ; elle s’excusa en disant qu’il valait mieux manger son ennemi mort que de le laisser dévorer aux bêtes, & que les vainqueurs méritaient d’avoir la préférence. Nous tuons en bataille rangée, ou non rangée, nos voisins, & pour la plus vile récompense nous travaillons à la cuisine des corbeaux & des vers. C’est là qu’est l’horreur, c’est là qu’est le crime ; qu’importe quand on est tué d’être mangé par un soldat, ou par un corbeau & un chien ?
Nous respectons plus les morts que les vivans. Il aurait fallu respecter les uns & les autres. Les nations qu’on nomme policées ont eu raison de ne pas mettre leurs ennemis vaincus à la broche ; car s’il était permis de manger ses voisins, on mangerait bientôt ses compatriotes ; ce qui serait un grand inconvénient pour les vertus sociales. Mais les nations policées ne l’ont pas toûjours été ; toutes ont été longtems sauvages ; & dans le nombre infini de révolutions que ce globe a éprouvées, le genre humain a été tantôt nombreux, tantôt [I-48] très rare. Il est arrivé aux hommes ce qui arrive aujourd’hui aux éléphans, aux lions, aux tigres, dont l’espèce a beaucoup diminué. Dans les tems où une contrée était peu peuplée d’hommes, ils avaient peu d’arts, ils étaient chasseurs. L’habitude de se nourrir de ce qu’ils avaient tué, fit aisément qu’ils traitèrent leurs ennemis comme leurs cerfs & leurs sangliers. C’est la superstition qui a fait immoler des victimes humaines, c’est la nécessité qui les a fait manger.
Quel est le plus grand crime ou de s’assembler pieusement pour plonger un couteau dans le cœur d’une jeune fille ornée de bandelettes, à l’honneur de la Divinité, ou de manger un vilain homme qu’on a tué à son corps défendant ?
Cependant, nous avons beaucoup plus d’exemples de filles & de garçons sacrifiés, que de filles & de garçons mangés ; presque toutes les nations connuës ont sacrifié des garçons & des filles. Les Juifs en immolaient. Cela s’appelait l’anathème ; c’était un véritable sacrifice, & il est ordonné au 29e chap. du Lévitique, de ne point épargner les ames vivantes qu’on aura voüées ; mais il ne leur est prescrit en aucun endroit d’en manger, on les en menace seulement ; & Moïse, comme nous avons vu, dit aux Juifs ; que s’ils n’observent pas ses cérémonies, non-seulement ils auront la galle, mais que les mères mangeront leurs enfans. Il est vrai que du tems d’Ézéchiel les Juifs devaient être dans l’usage de manger de la chair [I-49] humaine, car il leur prédit au Chapitre 39 que Dieu les fera manger non-seulement les chevaux de leurs ennemis, mais encor les cavaliers & les autres guerriers. Cela est positif. Et en effet pourquoi les Juifs n’auraient-ils pas été antropofages ? c’eût été la seule chose qui eût manqué au peuple de Dieu pour être le plus abominable peuple de la terre.
J’ai lu dans des anecdotes de l’histoire d’Angleterre du tems de Cromwell, qu’une chandelière de Dublin vendait d’excellentes chandèles faites avec de la graisse d’Anglais. Quelque tems après un de ses chalans se plaignit à elle de ce que sa chandelle n’était plus si bonne ; Hélas ! dit-elle, c’est que les Anglais nous ont manqué ce mois-ci. Je demande qui était le plus coupable, ou ceux qui égorgeaient des Anglais, ou cette femme qui faisait des chandelles avec leur suif ?
APIS↩
Le bœuf Apis était-il adoré à Memphis comme dieu, comme symbole, ou comme bœuf ? Il est à croire que les fanatiques voyaient en lui un dieu, les sages un simple symbole, & que le sot peuple adorait le bœuf. Cambyse fit-il bien quand il eut conquis l’Égypte, de tuer ce bœuf de sa main ? Pourquoi non ? Il faisait voir aux imbécilles qu’on pouvait mettre leur dieu à la broche, sans que la [I-50] nature s’armât pour venger ce sacrilège. On a fort vanté les Égyptiens. Je ne connais guère de peuple plus méprisable ; il faut qu’il y ait toûjours eu dans leur caractère, & dans leur gouvernement un vice radical, qui en a toûjours fait de vils esclaves. Je consens que dans les tems presqu’inconnus, ils aient conquis la terre ; mais dans les tems de l’histoire ils ont été subjugués par tous ceux qui s’en sont voulu donner la peine, par les Assyriens, par les Grecs, par les Romains, par les Arabes, par les Mamelus, par les Turcs, enfin par tout le monde, excepté par nos croisés, attendu que ceux-ci étaient plus mal avisés que les Égyptiens n’étaient lâches. Ce fut la milice des Mamelus qui battit les Français. Il n’y a peut-être que deux choses passables dans cette nation ; la première, que ceux qui adoraient un bœuf ne voulurent jamais contraindre ceux qui adoraient un singe, à changer de religion ; la seconde, qu’ils ont fait toûjours éclore des poulets dans des fours.
On vante leurs pyramides ; mais ce sont des monumens d’un peuple esclave. Il faut bien qu’on y ait fait travailler toute la nation, sans quoi on n’aurait pu venir à bout d’élever ces vilaines masses. À quoi servaient-elles ? À conserver dans une petite chambre la momie de quelque prince ou de quelque gouverneur, ou de quelque intendant que son ame devait ranimer au bout de mille ans. Mais s’ils espéraient cette résurrection des corps, pourquoi leur ôter la cervelle avant de les [I-51] embaumer ? Les Égyptiens devaient-ils ressusciter sans cervelle ?
APOCALYPSE↩
Justin le Martyr, qui écrivait vers l’an 270 de notre ère, est le premier qui ait parlé de l’Apocalypse ; il l’attribue à l’apôtre Jean l’Évangéliste, dans son Dialogue avec Triphon ; ce Juif lui demande s’il ne croit pas que Jérusalem doit être rétablie un jour ? Justin lui répond qu’il le croit ainsi avec tous les chrétiens qui pensent juste. Il y a eu, dit-il, parmi nous un certain personnage nommé Jean, l’un des douze apôtres de Jésus ; il a prédit que les fidèles passeront mille ans dans Jérusalem.
Ce fut une opinion longtems reçue parmi les chrétiens, que ce règne de mille ans. Cette période était en grand crédit chez les Gentils. Les ames des Égyptiens reprenaient leurs corps au bout de mille années ; les ames du purgatoire chez Virgile, étaient exercées pendant ce même espace de tems, & mille per annos. La nouvelle Jérusalem de mille années devait avoir douze portes, en mémoire des douze apôtres ; sa forme devait être quarrée ; sa longueur, sa largeur & sa hauteur devaient être de douze mille stades, c’est-à-dire, cinq cents lieuës, de façon que les maisons devaient avoir aussi cinq cent lieues de haut. Il eût été assez désagréable de demeurer au dernier étage ; [I-52] mais enfin, c’est ce que dit l’Apocalypse au chap. 21.
Si Justin est le premier qui attribue l’Apocalypse à St. Jean, quelques personnes ont récusé son témoignage, attendu que dans ce même dialogue avec le Juif Triphon, il dit que selon le récit des apôtres, Jésus-Christ en descendant dans le Jourdain, fit bouillir les eaux de ce fleuve, & les enflamma, ce qui pourtant ne se trouve dans aucun écrit des apôtres.
Le même St. Justin cite avec confiance les oracles des Sibylles ; de plus, il prétend avoir vu les restes des petites maisons où furent enfermés les soixante & douze Interprètes dans le phare d’Égypte du tems d’Hérode. Le témoignage d’un homme qui a eu le malheur de voir ces petites maisons, semble indiquer que l’auteur devait y être renfermé.
Saint Irénée qui vient après, & qui croyait aussi le règne de mille ans, dit qu’il a appris d’un vieillard, que St. Jean avait fait l’Apocalypse. Mais on a reproché à St. Irénée d’avoir écrit qu’il ne doit y avoir que quatre Évangiles, parce qu’il n’y a que quatre parties du monde, & quatre vents cardinaux, & qu’Ézéchiel n’a vû que quatre animaux. Il appelle ce raisonnement une démonstration. Il faut avouer que la manière dont Irénée démontre, vaut bien celle dont Justin a vu.
Clément d’Alexandrie ne parle dans ses Electa, que d’une Apocalypse de St. Pierre dont on faisait très grand cas. Tertullien, l’un des [I-53] grands partisans du règne de mille ans, non-seulement assure que St. Jean a prédit cette résurrection, & ce règne de mille ans dans la ville de Jérusalem, mais il prétend que cette Jérusalem commençait déjà à se former dans l’air, que tous les chrétiens de la Palestine, & même les payens, l’avaient vuë pendant quarante jours de suite à la fin de la nuit : mais malheureusement la ville disparaissait dès qu’il était jour.
Origène, dans sa préface sur l’Évangile de St. Jean, & dans ses Homélies, cite les oracles de l’Apocalypse, mais il cite également les oracles des Sibylles. Cependant St. Denys d’Alexandrie, qui écrivait vers le milieu du troisième siècle, dit dans un de ses fragments, conservés par Eusèbe, que presque tous les docteurs rejetaient l’Apocalypse, comme un livre destitué de raison ; que ce livre n’a point été composé par St. Jean, mais par un nommé Cérinthe, lequel s’était servi d’un grand nom, pour donner plus de poids à ses rêveries.
Le concile de Laodicée, tenu en 360, ne compta point l’Apocalypse parmi les livres canoniques. Il était bien singulier que Laodicée, qui était une Église à qui l’Apocalypse était adressée, rejetât un trésor destiné pour elle ; & que l’évêque d’Éphèse qui assistait au concile, rejetât aussi ce livre de St. Jean, enterré dans Éphèse.
Il était visible à tous les yeux, que St. Jean se remuait toûjours dans sa fosse ; & faisait continuellement hausser & baisser la terre. [I-54] Cependant, les mêmes personnages qui étaient sûrs que St. Jean n’était pas bien mort, étaient sûrs aussi qu’il n’avait pas fait l’Apocalypse. Mais ceux qui tenaient pour le règne de mille ans, furent inébranlables dans leurs opinions. Sulpice Sévère, dans son histoire sacrée liv. 9, traite d’insensés & d’impies, ceux qui ne recevaient pas l’Apocalypse. Enfin, après bien des doutes, après des oppositions de Concile à Concile, l’opinion de Sulpice Sévère a prévalu. La matière ayant été éclaircie, l’Église a décidé que l’Apocalypse est incontestablement de St. Jean ; ainsi il n’y a pas d’appel.
Chaque communion chrétienne s’est attribué les prophéties contenuës dans ce livre ; les Anglais y ont trouvé les révolutions de la Grande-Bretagne ; les Luthériens les troubles d’Allemagne ; les Réformés de France le règne de Charles IX. & la régence de Catherine de Médicis : ils ont tous également raison. Bossuet & Newton ont commenté tous deux l’Apocalypse ; mais à tout prendre, les déclamations éloquentes de l’un, & les sublimes découvertes de l’autre, leur ont fait plus d’honneur que leurs commentaires.
ARIUS↩
Voici une question incompréhensible qui a exercé depuis plus de seize cents ans la curiosité, la subtilité sophistique, l’aigreur, [I-55] l’esprit de cabale, la fureur de dominer, la rage de persécuter, le fanatisme aveugle & sanguinaire, la crédulité barbare ; & qui a produit plus d’horreurs que l’ambition des princes qui pourtant en a produit beaucoup. Jésus est-il verbe ? S’il est verbe est-il émané de Dieu dans le tems ou avant le tems ? S’il est émané de Dieu est-il coéternel & consubstantiel avec lui ? Ou est-il d’une substance semblable ? Est-il distinct de lui ou ne l’est-il pas ? Est-il fait ou engendré ? Peut-il engendrer à son tour ? A-t-il la paternité ou la vertu productive sans paternité ? Le St. Esprit est-il fait, ou engendré, ou produit, ou procédant du père, ou procédant du fils, ou procédant de tous les deux ? Peut-il engendrer, peut-il produire ? Son hypostase est-elle consubstantielle avec l’hypostase du père & du fils ? Et comment ayant précisément la même nature, la même essence que le père & le fils peut-il ne pas faire les mêmes choses que ces deux personnes qui sont lui-même.
Je n’y comprends rien assurément ; personne n’y a jamais rien compris ; & c’est la raison pour laquelle on s’est égorgé.
On sophistiquait, on ergotait, on se haïssait, on s’excommuniait chez les chrétiens pour quelques-uns de ces dogmes inaccessibles à l’esprit humain avant les tems d’Arius & d’Athanase. Les grecs Égyptiens étaient d’habiles gens, ils coupaient un cheveu en quatre, mais cette fois-ci ils ne le coupèrent qu’en trois. Alexandros Évêque d’Alexandrie s’avise de prêcher [I-56] que Dieu étant nécessairement individuel, simple, une monade dans toute la rigueur du mot, cette monade est trine.
Le prêtre Arios ou Arious, que nous nommons Arius est tout scandalisé de la monade d’Alexandros ; il explique la chose différemment, il ergote en partie comme le prêtre Sabellious, qui avait ergoté comme le phrygien Praxeas grand ergoteur. Alexandros assemble vite un petit concile de gens de son opinion, & excommunie son prêtre. Eusébios évêque de Nicomédie prend le parti d’Arios, voilà toute l’Église en feu.
L’Empereur Constantin était un scélérat, je l’avoue, un parricide qui avait étouffé sa femme dans un bain, égorgé son fils, assassiné son beau-père, son beau-frère & son neveu, je ne le nie pas ; un homme bouffi d’orgueil & plongé dans les plaisirs, je l’accorde ; un détestable tyran ainsi que ses enfans, transeat : mais il avait du bon sens. On ne parvient point à l’empire, on ne subjugue pas tous ses rivaux sans avoir raisonné juste.
Quand il vit la guerre civile des cervelles scholastiques allumée, il envoya le célèbre évêque Ozius avec des lettres déhortatoires aux deux parties belligérantes. Vous êtes de grands fous, (leur dit-il expressément dans sa lettre) de vous quereller pour des choses que vous n’entendez pas. Il est indigne de la gravité de vos ministères, de faire tant de bruit sur un sujet si mince.
Constantin n’entendait pas par mince sujet [I-57] ce qui regarde la Divinité ; mais la manière incompréhensible dont on s’efforçait d’expliquer la nature de la Divinité. Le patriarche Arabe qui a écrit l’Histoire de l’Église d’Alexandrie fait parler ainsi Ozius en présentant la lettre de l’Empereur.
« Mes frères, le christianisme commence à peine à jouir de la paix, & vous allez le plonger dans une discorde éternelle. L’Empereur n’a que trop raison de vous dire que vous vous querellez pour un sujet fort mince. Certainement si l’objet de la dispute était essentiel, Jésus-Christ que nous reconnaissons tous pour notre législateur en aurait parlé ; Dieu n’aurait pas envoyé son fils sur la terre pour ne nous pas apprendre notre catéchisme. Tout ce qu’il ne nous a pas dit expressément est l’ouvrage des hommes, & l’erreur est leur partage. Jésus vous a commandé de vous aimer, & vous commencez par lui désobéir en vous haïssant, en excitant la discorde dans l’Empire. L’orgueil seul fait naître les disputes, & Jésus votre maître vous a ordonné d’être humbles. Personne de vous ne peut savoir si Jésus est fait ou engendré. Et que vous importe sa nature pourvu que la vôtre soit d’être justes & raisonnables ? qu’a de commun une vaine science de mots avec la morale qui doit conduire vos actions ? Vous chargez la doctrine de mystères, vous qui n’êtes faits que pour affermir la religion par la vertu. Voulez-vous que la religion chrétienne ne soit qu’un amas de sophismes ? [I-58] est-ce pour cela que le Christ est venu ? Cessez de disputer, adorez, édifiez, humiliez-vous, nourrissez les pauvres, apaisez les querelles des familles au lieu de scandaliser l’Empire entier par vos discordes. »
Ozius parlait à des opiniâtres. On assembla le concile de Nicée, & il y eut une guerre civile dans l’Empire Romain. Cette guerre en amena d’autres, & de siècle en siècle on s’est persécuté mutuellement jusqu’à nos jours.
ATHÉE, ATHÉISME↩
Section première.
Autrefois quiconque avait un secret dans un art, courait risque de passer pour un sorcier ; toute nouvelle secte était accusée d’égorger des enfans dans ses mystères ; & tout philosophe qui s’écartait du jargon de l’école, était accusé d’athéisme par les fanatiques & par les fripons, & condamné par les sots.
Anaxagore ose-t-il prétendre que le soleil n’est point conduit par Apollon, monté sur un quadrige ? on l’appelle athée, & il est contraint de fuir.
Aristote est accusé d’Athéisme par un prêtre, & ne pouvant faire punir son accusateur, il se retire à Calcis. Mais la mort de Socrate est ce que l’histoire de la Grèce a de plus odieux.
[I-59]
Aristophane, (cet homme que les commentateurs admirent, parce qu’il était Grec, ne songeant pas que Socrate était Grec aussi) Aristophane fut le premier qui accoutuma les Athéniens à regarder Socrate comme un athée.
Ce poëte comique, qui n’est ni comique ni poëte, n’aurait pas été admis parmi nous à donner ses farces à la foire St. Laurent ; il me paraît beaucoup plus bas & plus méprisable que Plutarque ne le dépeint. Voici ce que le sage Plutarque dit de ce farceur :
« Le langage d’Aristophane sent son misérable charlatan ; ce sont les pointes les plus basses & les plus dégoûtantes ; il n’est pas même plaisant pour le peuple, & il est insupportable aux gens de jugement & d’honneur ; on ne peut souffrir son arrogance, & les gens de bien détestent sa malignité. »
C’est donc là, pour le dire en passant, le Tabarin que madame Dacier admiratrice de Socrate, ose admirer : Voilà l’homme qui prépara de loin le poison, dont des juges infâmes firent périr l’homme le plus vertueux de la Grèce.
Les tanneurs, les cordonniers & les couturières d’Athènes applaudirent à une farce dans laquelle on représentait Socrate élevé en l’air dans un panier, annonçant qu’il n’y avait point de Dieu, & se vantant d’avoir volé un manteau en enseignant la philosophie. Un peuple entier, dont le mauvais gouvernement autorisait de si infâmes licences, méritait bien ce qui lui est arrivé, de devenir l’esclave des Romains, & de l’être aujourd’hui des Turcs.
[I-60]
Franchissons tout l’espace des tems entre la république Romaine & nous. Les Romains bien plus sages que les Grecs, n’ont jamais persécuté aucun philosophe pour ses opinions. Il n’en est pas ainsi chez les peuples barbares qui ont succédé à l’Empire Romain. Dès que l’Empereur Frédéric II. a des querelles avec les papes, on l’accuse d’être athée, & d’être l’auteur du livre des trois imposteurs, conjointement avec son chancelier de Vineis.
Notre grand chancelier de l’Hôpital se déclare-t-il contre les persécutions ; on l’accuse aussitôt d’athéisme. [[2]] Homo doctus, sed verus atheos. Un jésuite, autant au-dessous d’Aristophane, qu’Aristophane est au-dessous d’Homère ; un malheureux dont le nom est devenu ridicule parmi les fanatiques mêmes, le jésuite Garasse, en un mot, trouve partout des athéïstes ; c’est ainsi qu’il nomme tous ceux contre lesquels il se déchaîne. Il appelle Théodore de Bèze athéiste ; c’est lui qui a induit le public en erreur sur Vanini.
La fin malheureuse de Vanini ne nous émeut point d’indignation & de pitié comme celle de Socrate ; parce que Vanini n’était qu’un pédant étranger sans mérite ; mais enfin, Vanini n’était point athée, comme on l’a prétendu ; il était précisément tout le contraire.
C’était un pauvre prêtre napolitain, prédicateur & théologien de son métier ; disputeur à outrance sur les quiddités, & sur les [I-61] universaux & utrum chimera bombinans in vacuo possit comedere secundas intentiones. Mais d’ailleurs, il n’y avait en lui veine qui tendît à l’Athéïsme. Sa notion de Dieu est de la théologie la plus saine, & la plus approuvée ;
« Dieu est son principe & sa fin, père de l’une & de l’autre, & n’ayant besoin ni de l’une, ni de l’autre ; éternel sans être dans le tems ; présent partout sans être en aucun lieu. Il n’y a pour lui ni passé, ni futur ; il est partout, & hors de tout ; gouvernant tout, & ayant tout créé ; immuable, infini sans parties ; son pouvoir est sa volonté &c. »
Vanini se piquait de renouveler ce beau sentiment de Platon, embrassé par Averroës, que Dieu avait créé une chaîne d’êtres depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dont le dernier chaînon est attaché à son trône éternel ; idée, à la vérité, plus sublime que vraie, mais qui est aussi éloignée de l’athéïsme, que l’être du néant.
Il voyagea pour faire fortune & pour disputer ; mais malheureusement la dispute est le chemin opposé à la fortune ; on se fait autant d’ennemis irréconciliables qu’on trouve de savants ou de pédans, contre lesquels on argumente. Il n’y eut point d’autre source du malheur de Vanini ; sa chaleur & sa grossièreté dans la dispute lui valut la haine de quelques théologiens ; & ayant eu une querelle avec un nommé Francon ou Franconi, ce Francon ami de ses ennemis, ne manqua pas de l’accuser d’être athée enseignant l’Athéïsme.
[I-62]
Ce Francon, ou Franconi, aidé de quelques témoins, eut la barbarie de soutenir à la confrontation, ce qu’il avait avancé. Vanini, sur la sellette, interrogé sur ce qu’il pensait de l’existence de Dieu, répondit qu’il adorait avec l’Église un Dieu en trois personnes. Ayant pris à terre une paille, Il suffit de ce fétu, dit-il, pour prouver qu’il y a un créateur. Alors il prononça un très beau discours sur la végétation & le mouvement, & sur [la] nécessité d’un Être suprême, sans lequel il n’y aurait ni mouvement ni végétation.
Le Président Grammont qui était alors à Toulouse, rapporte ce discours dans son histoire de France, aujourd’hui si oubliée, & ce même Grammont, par un préjugé inconcevable, prétend que Vanini disait tout cela par vanité, ou par crainte, plutôt que par une persuasion intérieure.
Sur quoi peut être fondé ce jugement téméraire & atroce du président Grammont ? Il est évident que sur la réponse de Vanini, on devait l’absoudre de l’accusation d’Athéïsme. Mais qu’arriva-t-il ? Ce malheureux prêtre étranger se mêlait aussi de médecine ; on trouva un gros crapaud vivant, qu’il conservait chez lui dans un vase plein d’eau ; on ne manqua pas de l’accuser d’être sorcier. On soutint que ce crapaud était le Dieu qu’il adorait, on donna un sens impie à plusieurs passages de ses livres, ce qui est très aisé & très commun, en prenant les objections pour les réponses, en interprétant avec malignité quelque phrase louche, en [I-63] empoisonnant une expression innocente. Enfin la faction qui l’opprimait, arracha des juges l’arrêt qui condamna ce malheureux à la mort.
Pour justifier cette mort il fallait bien accuser cet infortuné de ce qu’il y avait de plus affreux. Le minime & très minime Mersenne a poussé la démence jusqu’à imprimer que Vanini était parti de Naples avec douze de ses apôtres, pour aller convertir toutes les nations à l’Athéïsme. Quelle pitié ! Comment un pauvre prêtre aurait-il pu avoir douze hommes à ses gages ? comment aurait-il pu persuader douze Napolitains de voyager à grands frais pour répandre partout cette abominable & révoltante doctrine au péril de leur vie ? Un roi serait-il assez puissant pour payer douze prédicateurs d’Athéïsme ? Personne, avant le père Mersenne, n’avait avancé une si énorme absurdité. Mais après lui on l’a répétée, on en a infecté les journaux, les dictionnaires historiques ; & le monde qui aime l’extraordinaire, a cru sans examen cette fable.
Bayle lui-même, dans ses pensées diverses, parle de Vanini comme d’un athée : il se sert de cet exemple pour appuyer son paradoxe qu’une société d’athées peut subsister ; il assure que Vanini était un homme de mœurs très réglées, & qu’il fut le martyr de son opinion philosophique. Il se trompe également sur ces deux points. Le prêtre Vanini nous apprend dans ses dialogues faits à l’imitation d’Érasme, qu’il avait eu une maîtresse nommée Isabelle. Il était libre dans ses écrits comme dans sa conduite ; mais il n’était point athée.
[I-64]
Un siècle après sa mort, le savant La Croze, & celui qui a pris le nom de Philalète, ont voulu le justifier ; mais comme personne ne s’intéresse à la mémoire d’un malheureux Napolitain, très mauvais auteur, presque personne ne lit ces apologies.
Le jésuite Hardouin, plus savant que Garasse, & non moins téméraire, accuse d’Athéïsme, dans son livre Athei detecti, les Descartes, les Arnaulds, les Pascals, les Nicoles, les Mallebranches ; heureusement ils n’ont pas eu le sort de Vanini.
De tous ces faits, je passe à la question de morale agitée par Bayle, savoir, si une société d’athées pourrait subsister ? Remarquons d’abord sur cet article, quelle est l’énorme contradiction des hommes dans la dispute ; ceux qui se sont élevés contre l’opinion de Bayle avec le plus d’emportement, ceux qui lui ont nié, avec le plus d’injures, la possibilité d’une société d’athées, ont soutenu depuis avec la même intrépidité que l’Athéïsme est la religion du gouvernement de la Chine.
Ils se sont assurément bien trompés sur le gouvernement Chinois ; ils n’avaient qu’à lire les édits des empereurs de ce vaste pays, ils auraient vu que ces édits sont des sermons, & que partout il y est parlé de l’Être suprême, gouverneur, vengeur, & rémunérateur.
Mais en même tems ils ne se sont pas moins trompés sur l’impossibilité d’une société d’athées ; & je ne sais comment M. Bayle a pû oublier un exemple frappant qui aurait pu rendre sa cause victorieuse.
[I-65]
En quoi une société d’athées paraît-elle impossible ? C’est qu’on juge que des hommes qui n’auraient pas de frein, ne pourraient jamais vivre ensemble, que les loix ne peuvent rien contre les crimes secrets, qu’il faut un Dieu vengeur qui punisse dans ce monde-ci ou dans l’autre les méchants échappés à la justice humaine.
Les loix de Moïse, il est vrai, n’enseignaient point une vie à venir, ne menaçaient point des châtiments après la mort, n’enseignaient point aux premiers Juifs l’immortalité de l’ame ; mais les Juifs, loin d’être athées, loin de croire se soustraire à la vengeance divine, étaient les plus religieux de tous les hommes. Non seulement ils croyaient l’existence d’un Dieu éternel : mais ils le croyaient toûjours présent parmi eux ; ils tremblaient d’être punis dans eux-mêmes, dans leurs femmes, dans leurs enfans, dans leur postérité, jusqu’à la quatrième génération ; & ce frein était très puissant.
Mais, chez les gentils, plusieurs sectes n’avaient aucun frein ; les sceptiques doutaient de tout ; les académiciens suspendaient leur jugement sur tout ; les Épicuriens étaient persuadés que la Divinité ne pourrait se mêler des affaires des hommes ; & dans le fond, ils n’admettaient aucune divinité. Ils étaient convaincus que l’ame n’est point une substance, mais une faculté qui naît & qui périt avec le corps, par conséquent ils n’avaient aucun joug que celui de la morale & de l’honneur. Les sénateurs & les chevaliers Romains étaient de véritables [I-66] athées, car les dieux n’existaient pas pour des hommes qui ne craignaient ni n’espéraient rien d’eux. Le sénat Romain était donc réellement une assemblée d’athées du tems de César & de Cicéron.
Ce grand orateur dans sa harangue pour Cluentius, dit à tout le sénat assemblé, quel mal lui fait la mort ? nous rejetons toutes les fables ineptes des enfers, qu’est-ce donc que la mort lui a ôté ? Rien que le sentiment des douleurs.
César, l’ami de Catilina, voulant sauver la vie de son ami, contre ce même Cicéron, ne lui objecte-t-il pas que ce n’est point punir un criminel que de le faire mourir, que la mort n’est rien, que c’est seulement la fin de nos maux, que c’est un moment plus heureux que fatal ? Cicéron, & tout le sénat ne se rendent-ils pas à ces raisons ? Les vainqueurs & les législateurs de l’univers connu, formaient donc visiblement une société d’hommes qui ne craignaient rien des dieux, qui étaient de véritables athées ?
Bayle examine ensuite si l’idolâtrie est plus dangereuse que l’Athéïsme, si c’est un crime plus grand de ne point croire à la Divinité que d’avoir d’elle des opinions indignes ; il est en cela du sentiment de Plutarque ; il croit qu’il vaut mieux n’avoir nulle opinion, qu’une mauvaise opinion ; mais, n’en déplaise à Plutarque, il est évident qu’il valait infiniment mieux pour les Grecs de craindre Cérès, Neptune & Jupiter, que de ne rien craindre du tout ; il est clair que la sainteté des serments est [I-67] nécessaire, et qu’on doit se fier davantage à ceux qui pensent qu’un faux serment sera puni, qu’à ceux qui pensent qu’ils peuvent faire un faux serment avec impunité. Il est indubitable que dans une ville policée, il est infiniment plus utile d’avoir une religion (même mauvaise) que de n’en avoir point du tout.
Il paraît donc que Bayle devait plutôt examiner quel est le plus dangereux, du fanatisme, ou de l’Athéïsme. Le fanatisme est certainement mille fois plus funeste ; car l’Athéïsme n’inspire point de passion sanguinaire, mais le fanatisme en inspire : l’Athéïsme ne s’oppose pas aux crimes, mais le fanatisme les fait commettre. Supposons avec l’auteur du Commentarium rerum Gallicarum, que le chancelier de l’Hôpital fût athée, il n’a fait que de sages loix, & n’a conseillé que la modération & la concorde. Les fanatiques commirent les massacres de la St. Barthélemi. Hobbes passa pour un athée, il mena une vie tranquille & innocente. Les fanatiques de son tems inondèrent de sang l’Angleterre, l’Écosse & l’Irlande. Spinosa était non seulement athée, mais il enseigna l’Athéïsme ; ce ne fut pas lui assurément qui eut part à l’assassinat juridique de Barneveldt, ce ne fut pas lui qui déchira les deux frères de Witt en morceaux, & qui les mangea sur le gril.
Les athées sont pour la plupart des savants hardis & égarés qui raisonnent mal, & qui ne pouvant comprendre la création, l’origine du mal & d’autres difficultés, ont recours à [I-68] l’hypothèse de l’éternité des choses, & de la nécessité.
Les ambitieux, les voluptueux n’ont guère le tems de raisonner, & d’embrasser un mauvais systême ; ils ont autre chose à faire qu’à comparer Lucrèce avec Socrate. C’est ainsi que vont les choses parmi nous.
Il n’en était pas ainsi du sénat de Rome qui était presque tout composé d’athées de théorie & de pratique, c’est-à-dire qui ne croyaient ni à la providence ni à la vie future ; ce sénat était une assemblée de philosophes, de voluptueux & d’ambitieux, tous très dangereux, & qui perdirent la république. L’Épicuréïsme subsista sous les empereurs : les athées du sénat avaient été des factieux dans les tems de Sylla & de César ; ils furent sous Auguste & Tibère des athées esclaves.
Je ne voudrais pas avoir à faire à un prince athée, qui trouverait son intérêt à me faire piler dans un mortier ; je suis bien sûr que je serais pilé. Je ne voudrais pas, si j’étais souverain, avoir à faire à des courtisans athées, dont l’intérêt serait de m’empoisonner ; il me faudrait prendre au hasard du contrepoison tous les jours. Il est donc absolument nécessaire pour les princes & pour les peuples, que l’idée d’un Être suprême créateur, gouverneur, rémunérateur & vengeur soit profondément gravée dans les esprits.
Il y a des peuples athées, dit Bayle dans ses pensées sur les comètes. Les Caffres, les Hottentots, les Topinamboux, & beaucoup d’ [I-69] autres petites nations, n’ont point de Dieu ; ils ne le nient ni ne l’affirment, ils n’en ont jamais entendu parler ; dites-leur qu’il y en a un, ils le croiront aisément ; dites-leur que tout se fait par la nature des choses, ils vous croiront de même. Prétendre qu’ils sont athées est la même imputation que si l’on disait qu’ils sont anti-Cartésiens, ils ne sont ni pour, ni contre Descartes. Ce sont de vrais enfans ; un enfant n’est ni athée, ni déïste, il n’est rien.
Quelle conclusion tirerons-nous de tout ceci ? Que l’Athéïsme est un monstre très pernicieux dans ceux qui gouvernent, qu’il l’est aussi dans les gens de cabinet, quoique leur vie soit innocente, parce que de leur cabinet ils peuvent percer jusqu’à ceux qui sont en place ; que s’il n’est pas si funeste que le fanatisme, il est presque toûjours fatal à la vertu. Ajoutons surtout qu’il y a moins d’athées aujourd’hui que jamais, depuis que les philosophes ont reconnu qu’il n’y a aucun être végétant sans germe, aucun germe sans dessein, &c. & que le bled ne vient point de pourriture.
Des géomètres non philosophes ont rejeté les causes finales, mais les vrais philosophes les admettent ; et, comme l’a dit un auteur connu, un catéchiste annonce Dieu aux enfans, & Newton le démontre aux sages.
[I-70]
ATHÉE, ATHÉISME↩
Section seconde
S’il y a des athées, à qui doit-on s’en prendre, sinon aux tyrans mercenaires des ames qui en nous révoltant contre leurs fourberies, forcent quelques esprits faibles à nier le Dieu que ces monstres déshonorent ? Combien de fois les sangsuës du peuple ont-elles porté les citoyens accablés jusqu’à se révolter contre le Roi ! (Voyez Fraude.)
Des hommes engraissés de notre substance nous crient : Soyez persuadés qu’une ânesse a parlé ; croyez qu’un poisson a avalé un homme & l’a rendu au bout de trois jours sain & gaillard sur le rivage ; ne doutez pas que le Dieu de l’univers n’ait ordonné à un prophète juif de manger de la merde, (Ézéchiel) & à un autre prophète d’acheter deux putains, & de leur faire des fils de putains. (Osée) Ce sont les mots qu’on fait prononcer au Dieu de vérité & de pureté ; croyez cent choses ou visiblement abominables ou mathématiquement impossibles ; sinon le Dieu de miséricorde vous brûlera non seulement pendant des millions de milliards de siècles au feu d’enfer, mais pendant toute l’éternité, soit que vous ayez un corps, soit que vous n’en ayez pas.
Ces inconcevables bêtises révoltent des esprits faibles & téméraires aussi bien que des esprits [I-71] fermes et sages. Ils disent : Si nos maîtres nous peignent Dieu comme le plus insensé & comme le plus barbare de tous les êtres, donc il n’y a point de Dieu ; mais ils devraient dire ; donc nos maîtres attribuent à Dieu leurs absurdités & leurs fureurs, donc Dieu est le contraire de ce qu’ils annoncent, donc Dieu est aussi sage & aussi bon qu’ils le disent fou & méchant. C’est ainsi que s’expliquent les sages. Mais si un fanatique les entend il les dénonce à un Magistrat sergent de prêtres, & ce sergent les fait brûler à petit feu, croyant venger & imiter la majesté divine qu’il outrage.
[I-71]
BABEL↩
La vanité a toûjours élevé les grands monumens. Ce fut par vanité que les hommes bâtirent la belle tour de Babel. Allons, élevons une tour dont le sommet touche au ciel, & rendons notre nom célèbre, avant que nous soyons dispersés dans toute la terre. L’entreprise fut faite du tems d’un nommé Phaleg qui comptait le bon homme Noé pour son cinquième ayeul. L’architecture & tous les arts qui l’accompagnent, avaient fait, comme on voit, de grands progrès en cinq générations. St. Jérôme, le même qui a vu des faunes & des satyres, n’avait pas vû plus que moi la tour de Babel ; mais il assure qu’elle avait vingt mille pieds de hauteur. C’est bien peu de [I-72] chose. L’ancien livre Jaculte écrit par un des plus doctes Juifs, démontre que sa hauteur était de quatre-vingt un mille pieds Juifs. Et il n’y a personne qui ne sache que le pied Juif était à peu près de la longueur du pied Grec. Cette dimension est bien plus vraisemblable que celle de Jérôme. Cette tour subsiste encor, mais elle n’est plus tout à fait si haute. Plusieurs voyageurs très véridiques l’ont vûe, moi qui ne l’ai point vue, je n’en parlerai pas plus que d’Adam mon grand-père, avec qui je n’ai point eu l’honneur de converser ; mais consultez le révérend père Dom Calmet. C’est un homme d’un esprit fin & d’une profonde philosophie, il vous expliquera la chose. Je ne sais pas pourquoi il est dit dans la Genèse que Babel signifie confusion, car Ba signifie père dans les langues orientales, & Bel signifie Dieu, Babel signifie la ville de Dieu, la ville sainte. Les anciens donnaient ce nom à toutes leurs capitales. Mais il est incontestable que Babel veut dire confusion, soit parce que les architectes furent confondus après avoir élevé leur ouvrage jusqu’à quatre-vingt & un mille pieds Juifs, soit parce que les langues se confondirent, & c’est évidemment depuis ce tems-là que les Allemands n’entendent plus les Chinois ; car il est clair, selon le savant Bochard, que le chinois est originairement la même langue que le haut allemand.
[I-73]
BATÊME↩
Baptême, mot grec qui signifie immersion. Les hommes qui se conduisent toûjours par les sens, imaginèrent aisément que ce qui lavait le corps, lavait aussi l’ame. Il y avait de grandes cuves dans les souterrains des temples d’Égypte pour les prêtres & pour les initiés. Les Indiens de tems immémorial se sont purifiés dans l’eau du Gange, & cette cérémonie est encor fort en vogue. Elle passa chez les Hébreux ; on y batisait tous les étrangers qui embrassaient la loi Judaïque, & qui ne voulaient pas se soumettre à la circoncision, les femmes surtout, à qui on ne faisait pas cette opération, & qui ne la subissaient qu’en Éthiopie, étaient baptisées ; c’était une régénération ; cela donnait une nouvelle ame, ainsi qu’en Égypte. Voyez sur cela Épiphane, Maimonide, & la Gemmare.
Jean baptisa dans le Jourdain, & même il baptisa Jésus, qui pourtant ne baptisa jamais personne, mais qui daigna consacrer cette ancienne cérémonie. Tout signe est indifférent par lui-même, & Dieu attache sa grace au signe qu’il lui plaît de choisir. Le Batême fut bientôt le premier rite & le sceau de la religion chrétienne. Cependant, les quinze premiers Évêques de Jérusalem furent tous circoncis, il n’est pas sûr qu’ils fussent baptisés.
On abusa de ce sacrement dans les premiers [I-74] siècles du christianisme ; rien n’était plus commun que d’attendre l’agonie pour recevoir le Batême. L’exemple de l’Empereur Constantin en est une assez bonne preuve. Voici comme il raisonnait. Le Batême purifie tout ; je peux donc tuer ma femme, mon fils & tous mes parents, après quoi je me ferai baptiser, & j’irai au ciel, comme de fait il n’y manqua pas. Cet exemple était dangereux ; peu à peu la coutume s’abolit d’attendre la mort pour se mettre dans le bain sacré.
Les Grecs conservèrent toûjours le Batême par immersion : les Latins vers la fin du huitième siècle, ayant étendu leur religion dans les Gaules & la Germanie, & voyant que l’immersion pouvait faire périr les enfans dans des pays froids, substituèrent la simple aspersion, ce qui les fit souvent anathématiser par l’Église grecque.
On demanda à St. Cyprien évêque de Carthage, si ceux-là étaient réellement baptisés, qui s’étaient fait seulement arroser tout le corps ? il répond dans sa 76e lettre, que plusieurs Églises ne croyaient pas que ces arrosés fussent chrétiens ; que pour lui il pense qu’ils sont chrétiens, mais qu’ils ont une grace infiniment moindre que ceux qui ont été plongés trois fois selon l’usage.
On était initié chez les chrétiens dès qu’on avait été plongé ; avant ce tems on n’était que catéchumène. Il fallait pour être initié avoir des répondants, des cautions, qu’on appelait d’un nom qui répond à parrains, afin que l’Église [I-75] s’assurât de la fidélité des nouveaux chrétiens, & que les mystères ne fussent point divulgués. C’est pourquoi dans les premiers siècles, les gentils furent généralement aussi mal instruits des mystères des chrétiens, que ceux-ci l’étaient des mystères d’Isis & d’Éleusine.
Cyrille d’Alexandrie, dans son écrit contre l’empereur Julien, s’exprime ainsi ; Je parlerais du Batême si je ne craignais que mon discours ne parvînt à ceux qui ne sont pas initiés.
Dès le second siècle, on commença à batiser des enfans ; il était naturel que les chrétiens désirassent que leurs enfans, qui auraient été damnés sans ce sacrement, en fussent pourvûs. On conclut enfin qu’il fallait le leur administrer au bout de huit jours, parce que chez les Juifs c’était à cet âge qu’ils étaient circoncis. L’Église Grecque est encor dans cet usage. Cependant au troisième siècle la coutume l’emporta de ne se faire batiser qu’à la mort.
Ceux qui mouraient dans la première semaine étaient damnés, selon les Pères de l’Église les plus rigoureux. Mais Pierre Chrisologue au cinquième siècle, imagina les limbes, espèce d’enfer mitigé, & proprement bord d’enfer, faubourg d’enfer, où vont les petits enfans morts sans Batême, & où étaient les patriarches avant la descente de Jésus-Christ aux enfers. De sorte que l’opinion que Jésus-Christ était descendu aux limbes, & non aux enfers, a prévalu depuis.
Il a été agité, si un chrétien dans les déserts d’Arabie pouvait être baptisé avec du sable ; on [I-76] a répondu que non : si on pouvait baptiser avec de l’eau-rose, & on a décidé qu’il fallait de l’eau pure, que cependant on pouvait se servir d’eau bourbeuse. On voit aisément que toute cette discipline a dépendu de la prudence des premiers pasteurs qui l’ont établie.
Idée des unitaires rigides sur le Batême.
« Il est évident pour quiconque veut raisonner sans préjugé, que le batême n’est ni une marque de grace conférée, ni un sceau d’alliance, mais une simple marque de profession.
« Que le batême n’est nécessaire, ni de nécessité de précepte, ni de nécessité de moyen.
« Qu’il n’a point été institué par Jésus-Christ, & que le chrétien peut s’en passer sans qu’il puisse en résulter pour lui aucun inconvénient.
« Qu’on ne doit pas baptiser les enfans ni les adultes, ni en général aucun homme.
« Que le baptême pouvait être d’usage dans la naissance du christianisme à ceux qui sortaient du paganisme, pour rendre publique leur profession de foi, & en être la marque authentique, mais qu’à présent il est absolument inutile & tout à fait indifférent. »
(Tiré du Dictionnaire encyclopédique à l’article des Unitaires.)
ADDITION IMPORTANTE
L’Empereur Julien le philosophe dans son [I-77] immortelle Satire des Césars, met ces paroles dans la bouche de Constance fils de Constantin :
« Quiconque se sent coupable de viol, de meurtre, de rapine, de sacrilège, & de tous les crimes les plus abominables, dès que je l’aurai lavé avec cette eau, il sera net & pur. »
C’est en effet cette fatale doctrine qui engagea tous les Empereurs chrétiens & tous les grands de l’empire à différer leur batême jusqu’à la mort. On croyait avoir trouvé le secret de vivre criminel & de mourir vertueux.
(Tiré de Mr. Boulanger.)
AUTRE ADDITION
Quelle étrange idée tirée de la lessive qu’un pot d’eau nettoie tous les crimes ! aujourd’hui qu’on batise tous les enfans, parce qu’une idée non moins absurde les supposa tous criminels, les voilà tous sauvés jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de raison & qu’ils puissent devenir coupables. Égorgez-les donc au plus vîte pour leur assurer le paradis. Cette conséquence est si juste qu’il y a eu une secte dévote qui s’en allait empoisonnant ou tuant tous les petits enfans nouvellement baptisés. Ces dévots raisonnaient parfaitement. Ils disaient : « Nous faisons à ces petits innocens le plus grand bien possible. Nous les empêchons d’être méchants & malheureux dans cette vie, & nous leur donnons la vie éternelle. »
(de Mr. l’abbé Nicaise.)
[I-78]
BEAU, BEAUTÉ↩
Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le to kalon ? il vous répondra que c’est la femelle avec deux gros yeux ronds, sortans de sa petite tête, une gueule large & plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée, le beau est pour lui une peau noire huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté.
Interrogez le diable, il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes & une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par du galimatias ; il leur faut quelque chose de conforme à l’archétipe du beau en essence, au to kalon.
J’assistais un jour à une tragédie auprès d’un philosophe ; Que cela est beau ! disait-il. Que trouvez-vous là de beau ? lui dis-je ; C’est, dit-il, que l’auteur a atteint son but. Le lendemain il prit une médecine qui lui fit du bien. Elle a atteint son but, lui dis-je ; voilà une belle médecine ! Il comprit qu’on ne peut dire qu’une médecine est belle, & que pour donner à quelque chose le nom de beauté, il faut qu’elle vous cause de l’admiration & du plaisir. Il convint que cette tragédie lui avait inspiré ces deux sentimens, & que c’était là le to kalon, le beau.
Nous fîmes un voyage en Angleterre : on y joüa la même pièce, parfaitement traduite ; elle [I-79] fit bâiller tous les spectateurs. Oh, oh, dit-il, le to kalon n’est pas le même pour les Anglais & pour les Français. Il conclut après bien des réflexions, que le beau est souvent très relatif, comme ce qui est décent au Japon est indécent à Rome ; & ce qui est de mode à Paris ne l’est pas à Pékin ; & il s’épargna la peine de composer un long traité sur le beau.
BÊTES↩
Quelle pitié, quelle pauvreté, d’avoir dit que les bêtes sont des machines, privées de connaissance & de sentiment, qui font toûjours leurs opérations de la même manière, qui n’apprennent rien, ne perfectionnent rien, &c !
Quoi, cet oiseau qui fait son nid en demi-cercle quand il l’attache à un mur, qui le bâtit en quart de cercle quand il est dans un angle, & en cercle sur un arbre ; cet oiseau fait tout de la même façon ? Ce chien de chasse que tu as discipliné pendant trois mois, n’en sait-il pas plus au bout de ce tems, qu’il n’en savait avant les leçons ? Le serin à qui tu apprends un air, le répète-t-il dans l’instant ? n’emploies-tu pas un tems considérable à l’enseigner ? n’as-tu pas vu qu’il se méprend & qu’il se corrige ?
Est-ce parce que je te parle, que tu juges que j’ai du sentiment, de la mémoire, des idées ? Eh bien, je ne te parle pas ; tu me vois [I-80] entrer chez moi l’air affligé, chercher un papier avec inquiétude, ouvrir le bureau où je me souviens de l’avoir enfermé, le trouver, le lire avec joie. Tu juges que j’ai éprouvé le sentiment de l’affliction & celui du plaisir, que j’ai de la mémoire & de la connaissance.
Porte donc le même jugement sur ce chien qui a perdu son maître, qui l’a cherché dans tous les chemins avec des cris douloureux, qui entre dans la maison agité, inquiet, qui descend, qui monte, qui va de chambre en chambre, qui trouve enfin dans son cabinet le maître qu’il aime, & qui lui témoigne sa joye par la douceur de ses cris, par ses sauts, par ses caresses.
Des barbares saisissent ce chien, qui l’emporte si prodigieusement sur l’homme en amitié ; ils le clouent sur une table, & ils le dissèquent vivant pour te montrer les veines mézaraïques. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste ; la nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal, afin qu’il ne sente pas ? a-t-il des nerfs pour être impassible ? Ne suppose point cette impertinente contradiction dans la nature.
Mais les maîtres de l’école demandent ce que c’est que l’ame des bêtes ? Je n’entends pas cette question. Un arbre a la faculté de recevoir dans ses fibres sa sève qui circule, de déployer les boutons de ses feuilles & de ses fruits ; me demanderez-vous ce que c’est que l’ame de cet arbre ? il a reçû ces dons ; l’animal a reçu ceux [I-81] du sentiment, de la mémoire, d’un certain nombre d’idées. Qui a fait tous ces dons ? qui a donné toutes ces facultés ? celui qui fait croître l’herbe des champs, & qui fait graviter la terre vers le soleil.
Les ames des bêtes sont des formes substantielles, a dit Aristote, & après Aristote l’école Arabe, & après l’école Arabe, l’école Angélique, & après l’école Angélique la Sorbonne, & après la Sorbonne personne au monde.
Les ames des bêtes sont matérielles, crient d’autres philosophes. Ceux-là n’ont pas fait plus de fortune que les autres. On leur a en vain demandé ce que c’est qu’une ame matérielle ; il faut qu’ils conviennent que c’est de la matière qui a sensation ; mais qui lui a donné cette sensation ? c’est une ame matérielle, c’est-à-dire que c’est de la matière qui donne de la sensation à de la matière, ils ne sortent pas de ce cercle.
Écoutez d’autres Bêtes raisonnant sur les Bêtes ; leur ame est un être spirituel qui meurt avec le corps : mais quelle preuve en avez-vous ? quelle idée avez-vous de cet être spirituel, qui, à la vérité, a du sentiment, de la mémoire, & sa mesure d’idées & de combinaisons, mais qui ne pourra jamais savoir ce que sait un enfant de six ans. Sur quel fondement imaginez-vous que cet être qui n’est pas corps périt avec le corps ? les plus grandes Bêtes sont ceux qui ont avancé que cette ame n’est ni corps ni esprit. Voilà un beau systême. Nous ne pouvons entendre par esprit que [I-82] quelque chose d’inconnu qui n’est pas corps. Ainsi le systême de ces messieurs, revient à ceci, que l’ame des bêtes est une substance qui n’est ni corps ni quelque chose qui n’est point corps.
D’où peuvent procéder tant d’erreurs contradictoires ? de l’habitude où les hommes ont toûjours été d’examiner ce qu’est une chose, avant de savoir si elle existe. On appelle la languette, la soupape d’un soufflet, l’ame du soufflet. Qu’est-ce que cette ame ? c’est un nom que j’ai donné à cette soupape qui baisse, laisse entrer l’air, se relève, & le pousse par un tuyau, quand je fais mouvoir le soufflet.
Il n’y a point là une ame distincte de la machine. Mais qui fait mouvoir le soufflet des animaux ? Je vous l’ai déjà dit, celui qui fait mouvoir les astres. Le philosophe qui a dit, Deus est anima brutorum, avait raison : mais il devait aller plus loin.
BIEN.
SOUVERAIN BIEN.↩
L’Antiquité a beaucoup disputé sur le souverain bien ; autant aurait-il valu demander ce que c’est que le souverain bleu, ou le souverain ragoût, le souverain marcher, le souverain lire, &c.
Chacun met son bien où il peut, & en a autant qu’il peut à sa façon.
[I-83]
Quid dem, quid non dem, renuis tu quod jubet alter…
Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem Pugnis…
Le plus grand bien est celui qui vous délecte avec tant de force, qu’il vous met dans l’impuissance totale de sentir autre chose, comme le plus grand mal est celui qui va jusqu’à nous priver de tout sentiment. Voilà les deux extrêmes de la nature humaine, & ces deux moments sont courts.
Il n’y a ni extrêmes délices, ni extrêmes tourments qui puissent durer toute la vie : le souverain bien & le souverain mal sont des chimères.
Nous avons la belle fable de Crantor ; il fait comparaître aux jeux Olimpiques la richesse, la volupté, la santé, la vertu ; chacune demande la pomme : la richesse dit, C’est moi qui suis le souverain bien, car avec moi on achète tous les biens : la volupté dit, La pomme m’appartient, car on ne demande la richesse que pour m’avoir : la santé assure que sans elle il n’y a point de volupté, & que la richesse est inutile : enfin la vertu représente qu’elle est au-dessus des trois autres, parce qu’avec de l’or, des plaisirs & de la santé, on peut se rendre très misérable si on se conduit mal. La vertu eut la pomme.
La fable est très ingénieuse, mais elle ne résout point la question absurde du souverain bien. La vertu n’est pas un bien, c’est un devoir, elle est d’un genre différent, d’un ordre supérieur ; elle n’a rien à voir aux sensations douloureuses, ou agréables. L’homme vertueux [I-84] avec la pierre & la goutte, sans appui, sans amis, privé du nécessaire, persécuté, enchaîné par un tyran voluptueux qui se porte bien, est très malheureux ; & le persécuteur insolent qui caresse une nouvelle maîtresse sur son lit de pourpre est très heureux. Dites que le sage persécuté est préférable à son insolent persécuteur, dites que vous aimez l’un, & que vous détestez l’autre ; mais avoüez que le sage dans les fers enrage. Si le sage n’en convient pas, il vous trompe, c’est un charlatan.
TOUT EST BIEN↩
Ce fut un beau bruit dans les écoles, & même parmi les gens qui raisonnent, quand Leibnitz en paraphrasant Platon bâtit son édifice du meilleur des mondes possibles, & qu’il imagina que tout allait au mieux. Il affirma dans le nord de l’Allemagne que Dieu ne pouvait faire qu’un seul monde. Platon lui avait au moins laissé la liberté d’en faire cinq : par la raison qu’il n’y a que cinq corps solides réguliers, le tétraèdre, ou la pyramide à trois faces, avec la baze égale, le cube, l’hexaèdre, le dodécaèdre, l’icosaèdre. Mais comme notre monde n’est de la forme d’aucun des cinq corps de Platon, il devait permettre à Dieu une sixième manière.
Laissons-là le divin Platon. Leibnitz, qui était assurément meilleur géomètre que lui, & [I-85] plus profond métaphysicien, rendit donc le service au genre humain de lui faire voir que nous devons être très contens, & que Dieu ne pouvait pas davantage pour nous : qu’il avait nécessairement choisi entre tous les partis possibles, le meilleur, sans contredit.
Que deviendra le péché originel ? lui criait-on. Il deviendra ce qu’il pourra, disaient Leibnitz & ses amis : mais en public il écrivait que le péché originel entrait nécessairement dans le meilleur des mondes.
Quoi ! être chassé d’un lieu de délices, où l’on aurait vécu à jamais, si on n’avait pas mangé une pomme ? Quoi ! faire dans la misère, des enfans misérables qui souffriront tout, qui feront tout souffrir aux autres ? quoi ! éprouver toutes les maladies, sentir tous les chagrins, mourir dans la douleur, & pour rafraîchissement être brûlé dans l’éternité des siècles ; ce partage est-il bien ce qu’il y avait de meilleur ? Cela n’est pas trop bon pour nous ; & en quoi cela peut-il être bon pour Dieu ?
Leibnitz sentait qu’il n’y avait rien à répondre ; aussi fit-il de gros livres dans lesquels il ne s’entendait pas.
Nier qu’il y ait du mal, cela peut être dit en riant par un Lucullus qui se porte bien, & qui fait un bon dîner avec ses amis & sa maîtresse dans le salon d’Apollon ; mais, qu’il mette la tête à la fenêtre, il verra des malheureux, qu’il ait la fièvre, il le sera lui-même.
Je n’aime point à citer ; c’est d’ordinaire une besogne épineuse ; on néglige ce qui précède [I-86] & ce qui suit l’endroit qu’on cite, & on s’expose à mille querelles ; il faut pourtant que je cite Lactance, Père de l’Église, qui dans son chap. 13. de la colère de Dieu, fait parler ainsi Épicure.
« Ou Dieu veut ôter le mal de ce monde, & ne le peut : ou il le peut, & ne le veut pas ; ou il ne le peut, ni ne le veut ; ou enfin il le veut & le peut. S’il le veut & ne le peut pas, c’est impuissance, ce qui est contraire à la nature de Dieu ; s’il le peut & ne le veut pas, c’est méchanceté, & cela est non moins contraire à sa nature ; s’il ne le veut ni ne le peut, c’est à la fois méchanceté & impuissance ; s’il le veut & le peut (ce qui seul de ces parties convient à Dieu), d’où vient donc le mal sur la terre ? »
L’argument est pressant, aussi Lactance y répond fort mal, en disant que Dieu veut le mal, mais qu’il nous a donné la sagesse avec laquelle on acquiert le bien. Il faut avouer que cette réponse est bien faible en comparaison de l’objection ; car elle suppose que Dieu ne pouvait donner la sagesse qu’en produisant le mal ; & puis, nous avons une plaisante sagesse !
L’origine du mal a toûjours été un abîme dont personne n’a pû voir le fond. C’est ce qui réduisit tant d’anciens philosophes & des législateurs à recourir à deux principes, l’un bon, l’autre mauvais. Tiphon était le mauvais principe chez les Égyptiens, Arimane chez les Perses. Les manichéens adoptèrent, comme on sait, cette théologie ; mais comme ces [I-87] gens-là n’avaient jamais parlé ni au bon, ni au mauvais principe, il ne faut pas les en croire sur leur parole.
Parmi les absurdités dont ce monde regorge, & qu’on peut mettre au nombre de nos maux, ce n’est pas une absurdité légère, que d’avoir supposé deux êtres tout-puissants, se battant à qui des deux mettrait plus du sien dans ce monde, & faisant un traité comme les deux médecins de Molière : passez-moi l’émétique, & je vous passerai la saignée.
Basilide, après les Platoniciens, prétendit, dès le premier siècle de l’Église, que Dieu avait donné notre monde à faire à ses derniers anges ; & que ceux-ci n’étant pas habiles, firent les choses telles que nous les voyons. Cette fable théologique tombe en poussière par l’objection terrible, qu’il n’est pas dans la nature d’un Dieu tout-puissant & tout sage, de faire bâtir un monde par des architectes qui n’y entendent rien.
Simon qui a senti l’objection, la prévient en disant, que l’ange qui présidait à l’atelier est damné pour avoir si mal fait son ouvrage ; mais la brûlure de cet ange ne nous guérit pas.
L’avanture de Pandore chez les Grecs, ne répond pas mieux à l’objection. La boëte où se trouvent tous les maux, & au fond de laquelle reste l’espérance, est à la vérité une allégorie charmante ; mais cette Pandore ne fut faite par Vulcain que pour se venger de Prométhée, qui avait fait un homme avec de la bouë.
[I-88]
Les Indiens n’ont pas mieux rencontré ; Dieu ayant créé l’homme, il lui donna une drogue qui lui assurait une santé permanente ; l’homme chargea son âne de la drogue, l’âne eut soif, le serpent lui enseigna une fontaine, & pendant que l’âne buvait, le serpent prit la drogue pour lui.
Les Syriens imaginèrent que l’homme & la femme ayant été créés dans le quatrième ciel, ils s’avisèrent de manger d’une galette, au lieu de l’ambroisie qui était leur mêts naturel. L’ambroisie s’exhalait par les pores, mais après avoir mangé de la galette, il fallait aller à la selle. L’homme & la femme prièrent un ange de leur enseigner où était la garderobe. Voyez-vous, leur dit l’ange, cette petite planète, grande comme rien, qui est à quelque soixante millions de lieües d’ici, c’est là le privé de l’univers, allez-y au plus vite : ils y allèrent, on les y laissa ; & c’est depuis ce tems que notre monde fut ce qu’il est.
On demandera toûjours aux Syriens, pourquoi Dieu permit que l’homme mangeât la galette, & qu’il nous en arrivât une foule de maux si épouvantables ?
Je passe vite de ce quatrième ciel à Mylord Bolingbroke, pour ne pas m’ennuyer. Cet homme, qui avait sans doute un grand génie, donna au célèbre Pope son plan du tout est bien, qu’on retrouve en effet mot pour mot dans les œuvres posthumes de Mylord Bolingbroke, & que Mylord Shaftsbury avait auparavant inséré dans ses caractéristiques. Lisez dans [I-89] Shaftsbury le chapitre des moralistes, vous y verrez ces paroles.
« On a beaucoup à répondre à ces plaintes des défauts de la nature. Comment est-elle sortie si impuissante & si défectueuse des mains d’un être parfait ? mais je nie qu’elle soit défectueuse… sa beauté résulte des contrariétés, & la concorde universelle naît d’un combat perpétuel… Il faut que chaque être soit immolé à d’autres ; les végétaux aux animaux, les animaux à la terre… & les loix du pouvoir central & de la gravitation, qui donnent aux corps célestes leur poids & leur mouvement, ne seront point dérangées pour l’amour d’un chétif animal, qui tout protégé qu’il est par ces mêmes loix, sera bientôt par elles réduit en poussière. »
Bolingbroke, Shaftsbury, & Pope, leur metteur en œuvre, ne résolvent pas mieux la question que les autres : leur tout est bien, ne veut dire autre chose, sinon que le tout est dirigé par des loix immuables ; qui ne le sait pas ? vous ne nous apprenez rien quand vous remarquez après tous les petits enfans, que les mouches sont nées pour être mangées par des araignées, les araignées par les hirondelles, les hirondelles par les pies-grièches, les pies-grièches par les aigles, les aigles pour être tués par les hommes, les hommes pour se tuer les uns les autres, & pour être mangés par les vers, & ensuite par les diables, au moins mille sur un.
Voilà un ordre net & constant parmi les [I-90] animaux de toute espèce ; il y a de l’ordre partout. Quand une pierre se forme dans ma vessie, c’est une mécanique admirable, des sucs pierreux passent petit à petit dans mon sang, ils se filtrent dans les reins, passent par les urètres, se déposent dans ma vessie, s’y assemblent par une excellente attraction Newtonienne ; le caillou se forme, se grossit, je souffre des maux mille fois pires que la mort, par le plus bel arrangement du monde ; un chirurgien ayant perfectionné l’art inventé par Tubal-Caïn, vient m’enfoncer un fer aigu & tranchant dans le périnée, saisit ma pierre avec ses pincettes, elle se brise sous ses efforts par un mécanisme nécessaire ; & par le même mécanisme je meurs dans des tourments affreux ; tout cela est bien, tout cela est la suite évidente des principes physiques inaltérables, j’en tombe d’accord, & je le savais comme vous.
Si nous étions insensibles, il n’y aurait rien à dire à cette physique. Mais ce n’est pas cela dont il s’agit ; nous vous demandons s’il n’y a point de maux sensibles, & d’où ils viennent ? Il n’y a point de maux, dit Pope dans sa quatrième épitre sur le tout est bien ; s’il y a des maux particuliers, ils composent le bien général.
Voilà un singulier bien général, composé de la pierre, de la goutte, de tous les crimes, de toutes les souffrances, de la mort, & de la damnation.
La chûte de l’homme est l’emplâtre que nous mettons à toutes ces maladies particulières du corps & de l’ame, que vous appelez santé [I-91] générale ; mais Shaftsbury & Bolingbroke se moquent du péché originel ; Pope n’en parle point ; il est clair que leur systême sape la religion chrétienne par ses fondements, & n’explique rien du tout.
Cependant, ce systême a été approuvé depuis peu par plusieurs théologiens, qui admettent volontiers les contraires ; à la bonne heure, il ne faut envier à personne la consolation de raisonner comme il peut sur le déluge de maux qui nous inonde. Il est juste d’accorder aux malades désespérés, de manger de ce qu’ils veulent. On a été jusqu’à prétendre que ce systême est consolant. Dieu, dit Pope, voit d’un même œil périr le héros & le moineau, un atôme, ou mille planètes précipitées dans la ruine, une boule de savon, ou un monde se former.
Voilà, je vous l’avouë, une plaisante consolation ; ne trouvez-vous pas un grand lénitif dans l’ordonnance de Mylord Shaftsbury, qui dit que Dieu n’ira pas déranger ses loix éternelles pour un animal aussi chétif que l’homme ? Il faut avoüer du moins que ce chétif animal a droit de crier humblement, & de chercher à comprendre en criant, pourquoi ces loix éternelles ne sont pas faites pour le bien-être de chaque individu ?
Ce systême du tout est bien, ne représente l’auteur de toute la nature, que comme un roi puissant & mal-faisant, qui ne s’embarrasse pas qu’il en coûte la vie à quatre ou cinq cent mille hommes, & que les autres traînent leurs jours dans la disette & dans les [I-92] larmes, pourvû qu’il vienne à bout de ses desseins.
Loin donc que l’opinion du meilleur des mondes possibles console, elle est désespérante pour les philosophes qui l’embrassent. La question du bien & du mal, demeure un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de bonne foi ; c’est un jeu d’esprit pour ceux qui disputent : ils sont des forçats qui jouent avec leurs chaînes. Pour le peuple non pensant, il ressemble assez à des poissons qu’on a transportés d’une rivière dans un réservoir ; ils ne se doutent pas qu’ils sont là pour être mangés le carême ; aussi ne savons-nous rien du tout par nous-mêmes des causes de notre destinée.
Mettons à la fin de presque tous les chapitres de métaphysique les deux lettres des juges romains quand ils n’entendaient pas une cause, N. L. non liquet, Cela n’est pas clair.
BORNES DE L’ESPRIT
HUMAIN↩
Elles sont partout, pauvre docteur. Veux-tu savoir comment ton bras & ton pied obéïssent à ta volonté, & comment ton foie n’y obéït pas ? cherches-tu comment la pensée se forme dans ton chétif entendement, & cet enfant dans l’uterus de cette femme ? Je te donne du tems pour me répondre ; qu’est-ce que la matière ? tes pareils ont écrit dix mille [I-93] volumes sur cet article ; ils ont trouvé quelques qualités de cette substance : les enfans les connaissent comme toi : mais cette substance, qu’est-ce au fond ? & qu’est-ce que tu as nommé esprit, du mot latin qui veut dire souffle, ne pouvant faire mieux parce que tu n’en as pas d’idée ?
Regarde ce grain de bled que je jette en terre, & dis-moi comment il se relève pour produire un tuyau chargé d’un épi. Apprends-moi comment la même terre produit une pomme au haut de cet arbre, & une châtaigne à l’arbre voisin ; je pourrais te faire un in-folio de questions, auxquelles tu ne devrais répondre que par quatre mots, Je n’en sais rien.
Et cependant tu as pris tes degrés, & tu es fourré, & ton bonnet l’est aussi, & on t’appelle maître. Et cet orgueilleux imbécille, revêtu d’un petit emploi, dans une petite ville, croit avoir acquis le droit de juger & de condamner ce qu’il n’entend pas.
La devise de Montagne était, Que sais-je ? & la tienne est, Que ne sais-je pas ?
[I-93]
CARACTÈRE↩
Du mot grec impression, gravure. C’est ce que la nature a gravé dans nous ; pouvons-nous l’effacer ? grande question. Si j’ai un nez de travers & deux yeux de chat, je peux les cacher avec un masque. Puis-je davantage sur le caractère que m’a donné la [I-94] nature ? Un homme né violent, emporté, se présente devant François premier Roi de France, pour se plaindre d’un passe-droit ; le visage du prince, le maintien respectueux des courtisans, le lieu même où il est, font une impression puissante sur cet homme ; il baisse machinalement les yeux, sa voix rude s’adoucit, il présente humblement sa requête, on le croirait né aussi doux que le sont (dans ce moment au moins) les courtisans, au milieu desquels il est même déconcerté ; mais si François premier se connaît en physionomies, il découvre aisément dans ses yeux baissés, mais allumés d’un feu sombre, dans les muscles tendus de son visage, dans ses lèvres serrées l’une contre l’autre, que cet homme n’est pas si doux qu’il est forcé de le paraître. Cet homme le suit à Pavie, est pris avec lui, mené avec lui en prison à Madrid ; la majesté de François premier ne fait plus sur lui la même impression ; il se familiarise avec l’objet de son respect. Un jour en tirant les bottes du Roi, & les tirant mal, le roi aigri par son malheur se fâche, mon homme envoie promener le roi, & jette ses bottes par la fenêtre.
Sixte-Quint était né pétulant, opiniâtre, altier, impétueux, vindicatif, arrogant ; ce caractère semble adouci dans les épreuves de son noviciat. Commence-t-il à jouir de quelque crédit dans son ordre ? il s’emporte contre un gardien & l’assomme à coups de poings : est-il inquisiteur à Venise ? il exerce sa charge avec insolence : le voilà cardinal, il est possédé dell [I-95] rabbia papale : cette rage l’emporte sur son naturel ; il ensevelit dans l’obscurité sa personne & son caractère ; il contrefait l’humble & le moribond ; on l’élit pape, ce moment rend au ressort, que la politique avait plié, toute son élasticité longtems retenue ; il est le plus fier & le plus despotique des souverains.
La religion, la morale, mettent un frein à la force du naturel, elles ne peuvent le détruire. L’yvrogne dans un cloître, réduit à un demi-septier de cidre à chaque repas, ne s’enivrera plus, mais il aimera toûjours le vin.
L’âge affaiblit le caractère, c’est un arbre qui ne produit plus que quelques fruits dégénérés, mais ils sont toûjours de même nature ; il se couvre de nœuds & de mousse, il devient vermoulu, mais il est toûjours chêne ou poirier. Si on pouvait changer son caractère, on s’en donnerait un, on serait le maître de la nature. Peut-on se donner quelque chose ? ne recevons-nous pas tout ? Essayez d’animer l’indolent d’une activité suivie, de glacer par l’apathie, l’ame bouillante de l’impétueux, d’inspirer du goût pour la musique & pour la poésie à celui qui manque de goût & d’oreilles ; vous n’y parviendrez pas plus que si vous entrepreniez de donner la vue à un aveugle né. Nous perfectionnons, nous adoucissons, nous cachons ce que la nature a mis dans nous, mais nous n’y mettons rien.
[I-96]
On dit à un cultivateur, Vous avez trop de poissons dans ce vivier, ils ne prospéreront pas ; voilà trop de bestiaux dans vos prés, l’herbe manque, ils maigriront. Il arrive après cette exhortation que les brochets mangent la moitié des carpes de mon homme, & les loups la moitié de ses moutons, le reste engraisse. S’applaudira-t-il de son économie ? Ce campagnard, c’est toi-même ; une de tes passions a dévoré les autres, & tu crois avoir triomphé de toi. Ne ressemblons-nous pas presque tous à ce vieux général de quatre-vingt-dix ans, qui ayant rencontré de jeunes officiers qui faisaient un peu de désordre avec des filles, leur dit tout en colère, Messieurs, est-ce là l’exemple que je vous donne ?
CARÊME.↩
Questions sur le Carême.
Les premiers qui s’avisèrent de jeûner, se mirent-ils à ce régime par ordonnance du médecin pour avoir eu des indigestions ?
Le défaut d’appétit qu’on se sent dans la tristesse fut-il la première origine des jours de jeûne prescrits dans les religions tristes ?
Les Juifs prirent-ils la coutume de jeûner des Égyptiens dont ils imitèrent tous les rites, jusqu’à la flagellation & au bouc émissaire ?
Pourquoi Jésus jeûna-t-il quarante jours dans [I-97] le désert où il fut emporté par le diable, par le Cnathbull ? St. Matthieu remarque qu’après ce carême il eut faim, il n’avait donc pas faim pendant ce Carême.
Pourquoi dans les jours d’abstinence l’Église Romaine regarde-t-elle comme un crime de manger des animaux terrestres, & comme une bonne œuvre de se faire servir des soles & des saumons ? le riche papiste qui aura eu sur sa table pour cinq cents francs de poisson sera sauvé, & le pauvre, mourant de faim, qui aura mangé pour quatre sous de petit salé sera damné !
Pourquoi faut-il demander permission à son évêque de manger des œufs ? Si un roi ordonnait à son peuple de ne jamais manger d’œufs, ne passerait-il pas pour le plus ridicule des tyrans ? quelle étrange aversion les évêques ont-ils pour les omelettes ?
Croira-t-on que chez les papistes il y ait eu des tribunaux assez imbéciles, assez lâches, assez barbares pour condamner à la mort de pauvres citoyens qui n’avaient commis d’autres crimes que d’avoir mangé du cheval en carême ? Le fait n’est que trop vrai : j’ai entre les mains un arrêt de cette espèce. Ce qu’il y a d’étrange, c’est que les juges qui ont rendu de pareilles sentences se sont crus supérieurs aux Iroquois.
Prêtres idiots & cruels ! à qui ordonnez-vous le carême ? est-ce aux riches ? ils se gardent bien de l’observer. Est-ce aux pauvres ? ils font carême toute l’année. Le malheureux cultivateur ne mange presque jamais de viande, & n’a [I-98] pas de quoi acheter du poisson. Fous que vous êtes, quand corrigerez-vous vos loix absurdes ?
CATÉCHISME CHINOIS↩
OU
Entretien de Cu-su, disciple de Confutzée, avec le prince Kou, fils du roi de Lou, tributaire de l’empereur chinois Gnenvan, 417 ans avant notre ère vulgaire.
Traduit en latin par le père Fouquet, ci-devant ex-jésuite. Le manuscrit est dans la bibliothèque du Vatican, numéro 42759.
KOU.
Que dois-je entendre quand on me dit d’adorer le ciel ? (Chang-ti.)
CU-SU.
Ce n’est pas le ciel matériel que nous voyons ; car ce ciel n’est autre chose que l’air, & cet air est composé de toutes les exhalaisons de la terre. Ce serait une folie bien absurde d’adorer des vapeurs.
KOU.
Je n’en serais pourtant pas surpris. Il me semble que les hommes ont fait des folies encor plus grandes.
[I-99]
CU-SU.
Il est vrai ; mais vous êtes destiné à gouverner, vous devez être sage.
KOU.
Il y a tant de peuples qui adorent le ciel & les planètes !
CU-SU.
Les planètes ne sont que des terres comme la nôtre. La lune, par exemple, ferait aussi bien d’adorer notre sable & notre bouë, que nous de nous mettre à genoux devant le sable & la boue de la lune.
KOU.
Que prétend-on quand on dit, le ciel & la terre, monter au ciel, être digne du ciel ?
CU-SU.
On dit une énorme sotise [[3]]. Il n’y a point de ciel ; chaque planète est entourée de son atmosphère, comme d’une coque, & roule dans l’espace autour de son soleil. Chaque soleil est le centre de plusieurs planètes, qui voyagent continuellement autour de lui. Il n’y a ni haut ni bas, ni montée ni descente. Vous sentez que si les habitans de la lune disaient qu’on monte à la terre, qu’il faut se rendre digne de la terre, ils diraient une extravagance. Nous [I-100] prononçons de même un mot qui n’a pas de sens, quand nous disons qu’il faut se rendre digne du ciel, c’est comme si nous disions, Il faut se rendre digne de l’air, digne de la constellation du dragon, digne de l’espace.
KOU.
Je croîs vous comprendre ; il ne faut adorer que le Dieu qui a fait le ciel & la terre.
CU-SU.
Sans doute ; il faut n’adorer que Dieu. Mais quand nous disons qu’il a fait le ciel & la terre, nous disons pieusement une grande pauvreté. Car si nous entendons par le ciel l’espace prodigieux dans lequel Dieu alluma tant de soleils, & fit tourner tant de mondes, il est beaucoup plus ridicule de dire, le ciel & la terre, que de dire, les montagnes & un grain de sable. Notre globe est infiniment moins qu’un grain de sable en comparaison de ces millions de milliards d’univers, parmi lesquels nous disparaissons. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de joindre ici notre faible voix à celle des êtres innombrables, qui rendent hommage à Dieu dans l’abîme de l’étendüe.
KOU.
On nous a donc bien trompés, quand on nous a dit que Fo était descendu chez nous du quatrième ciel, & avait paru en éléphant blanc.
[I-101]
CU-SU.
Ce sont des contes que les bonzes font aux enfans & aux vieilles : nous ne devons adorer que l’auteur éternel de tous les êtres.
KOU.
Mais comment un être a-t-il pû faire les autres ?
CU-SU.
Regardez cette étoile ; elle est à quinze cent mille millions de Lis de notre petit globe. Il en part des rayons qui vont faire sur vos yeux deux angles égaux au sommet : ils font les mêmes angles sur les yeux de tous les animaux ; ne voilà-t-il pas un dessein marqué ? ne voilà-t-il pas une loi admirable ? Or qui fait un ouvrage, sinon un ouvrier ? Qui fait des loix, sinon un législateur ? Il y a donc un ouvrier, un législateur éternel ?
KOU.
Mais, qui a fait cet ouvrier ? & comment est-il fait ?
CU-SU.
Mon prince, je me promenais hier auprès du vaste palais qu’a bâti le roi votre père. J’entendis deux grillons, dont l’un disait à l’autre, Voilà un terrible édifice. Oui, dit l’autre, tout glorieux que je suis, j’avoue que c’est quelqu’un de plus puissant que les grillons qui a fait ce prodige ; mais je n’ai point d’idée de [I-102] cet être-là ; je vois qu’il est, mais je ne sais ce qu’il est.
KOU.
Je vous dis que vous êtes un grillon plus instruit que moi ; & ce qui me plaît en vous, c’est que vous ne prétendez pas savoir ce que vous ignorez.
SECOND ENTRETIEN.
CU-SU.
Vous convenez donc qu’il y a un Être tout-puissant, existant par lui-même, suprême artisan de toute la nature ?
KOU.
Oui ; mais s’il existe par lui-même, rien ne peut donc le borner, il est donc partout ? il existe donc dans toute la matière, dans toutes les parties de moi-même ?
CU-SU.
Pourquoi non ?
KOU.
Je serais donc moi-même une partie de la Divinité ?
CU-SU.
Ce n’est peut-être pas une conséquence. Ce morceau de verre est pénétré de toutes parts de la lumière ; est-il lumière cependant lui-même ? ce n’est que du sable, & rien de plus ; [I-103] tout est en Dieu, sans doute ; ce qui anime tout doit être partout. Dieu n’est pas comme l’empereur de la Chine qui habite son palais & qui envoie ses ordres par des Colao. Dès là qu’il existe, il est nécessaire que son existence remplisse tout l’espace, & tous ses ouvrages, & puisqu’il est dans vous, c’est un avertissement continuel de ne rien faire dont vous puissiez rougir devant lui.
KOU.
Que faut-il faire pour oser ainsi se regarder soi-même sans répugnance & sans honte devant l’Être suprême ?
CU-SU.
Être juste.
KOU.
Et quoi encore ?
CU-SU.
Être juste.
KOU.
Mais la secte de Laokium dit qu’il n’y a ni juste, ni injuste, ni vice, ni vertu.
CU-SU.
La secte de Laokium dit-elle qu’il n’y a ni santé, ni maladie ?
KOU.
Non, elle ne dit point une si grande erreur.
[I-104]
CU-SU.
L’erreur de penser qu’il n’y a ni santé de l’ame, ni maladie de l’ame, ni vertu ni vice, est aussi grande & plus funeste. Ceux qui ont dit que tout est égal sont des monstres ; est-il égal de nourrir son fils, ou de l’écraser sur la pierre ? de secourir sa mère, ou de lui plonger un poignard dans le cœur ?
KOU.
Vous me faites frémir : je déteste la secte de Laokium ; mais il y a tant de nuances du juste & de l’injuste ! on est souvent bien incertain. Quel homme sait précisément ce qui est permis, ou ce qui est défendu ? qui pourra poser sûrement les bornes qui séparent le bien & le mal ? quelle règle me donnerez-vous pour les discerner ?
CU-SU.
Celles de Confutzée mon maître ; vis comme en mourant tu voudrais avoir vécu, traite ton prochain comme tu veux qu’il te traite.
KOU.
Ces maximes, je l’avoue, doivent être le code du genre humain. Mais que m’importera en mourant d’avoir bien vécu ? qu’y gagnerai-je ? cette horloge quand elle sera détruite, sera-t-elle heureuse d’avoir bien sonné les heures ?
CU-SU.
Cette horloge ne sent point, ne pense point, [I-105] elle ne peut avoir des remords, & vous en avez quand vous vous sentez coupable.
KOU.
Mais si après avoir commis plusieurs crimes, je parviens à n’avoir plus de remords ?
CU-SU.
Alors, il faudra vous étouffer ; & soyez sûr que parmi les hommes qui n’aiment pas qu’on les opprime, il s’en trouvera qui vous mettront hors d’état de faire de nouveaux crimes.
KOU.
Ainsi Dieu qui est en eux leur permettra d’être méchans après m’avoir permis de l’être ?
CU-SU.
Dieu vous a donné la raison, n’en abusez ni vous, ni eux ; non-seulement vous serez malheureux dans cette vie, mais qui vous a dit que vous ne le seriez pas dans une autre ?
KOU.
Et qui vous a dit qu’il y a une autre vie ?
CU-SU.
Dans le doute seul vous devez vous conduire comme s’il y en avait une.
KOU.
Mais, si je suis sûr qu’il n’y en a point ?
[I-106]
CU-SU.
Je vous en défie.
TROISIÈME ENTRETIEN.
KOU.
Vous me poussez, Cu-su. Pour que je puisse être récompensé ou puni quand je ne serai plus, il faut qu’il subsiste dans moi quelque chose qui sente, & qui pense après moi. Or, comme avant ma naissance, rien de moi n’avait ni sentiment ni pensée, pourquoi y en aurait-il après ma mort ? que pourrait être cette partie incompréhensible de moi-même ? Le bourdonnement de cette abeille restera-t-il quand l’abeille ne sera plus ? La végétation de cette plante subsiste-t-elle quand la plante est déracinée ? La végétation n’est-elle pas un mot dont on se sert pour signifier la manière inexplicable dont l’Être suprême a voulu que la plante tirât les sucs de la terre ? L’ame est de même un mot inventé pour exprimer faiblement & obscurément les ressorts de notre vie. Tous les animaux se meuvent, & cette puissance de se mouvoir, on l’appelle force active ; mais il n’y a pas un être distinct qui soit cette force. Nous avons des passions, de la mémoire, de la raison ; mais ces passions, cette mémoire, cette raison, ne sont pas sans doute des choses à part, ce ne sont pas des êtres existant dans nous, ce ne sont pas de petites personnes qui aient une existence particulière ; ce sont des mots génériques, inventés pour fixer nos [I-107] idées. L’âme qui signifie notre mémoire, notre raison, nos passions, n’est donc elle-même qu’un mot. Qui fait le mouvement dans la nature ? c’est Dieu. Qui fait végéter toutes les plantes ? c’est Dieu. Qui fait le mouvement dans les animaux ? c’est Dieu. Qui fait la pensée de l’homme ? c’est Dieu.
Si l’ame [[4]] humaine était une petite personne renfermée dans notre corps, qui en dirigeât les mouvemens & les idées, cela ne marquerait-il pas dans l’éternel artisan du monde une impuissance & un artifice indigne de lui ? il n’aurait donc pas été capable de faire des automates qui eussent dans eux-mêmes le don du mouvement & de la pensée ? Vous m’avez appris le grec, vous m’avez fait lire Homère, je trouve Vulcain un divin forgeron quand il fait des trépieds d’or qui vont tous seuls au conseil des dieux : mais ce Vulcain me paraîtrait un misérable charlatan, s’il avait caché dans le corps de ces trépieds quelqu’un de ses garçons qui les fît mouvoir sans qu’on s’en aperçût.
Il y a de froids rêveurs qui ont pris pour une belle imagination l’idée de faire rouler des planètes par des génies qui les poussent sans cesse ; mais Dieu n’a pas été réduit à cette pitoyable ressource : en un mot, pourquoi mettre deux ressorts à un ouvrage lorsqu’un seul suffit ? Vous n’oserez pas nier que Dieu ait le pouvoir d’animer l’être peu connu que nous [I-108] appelons matière, pourquoi donc se servirait-il d’un autre agent pour l’animer ?
Il y a bien plus, qui serait cette ame que vous donnez si libéralement à notre corps ? d’où viendrait-elle ? quand viendrait-elle ? faudrait-il que le créateur de l’univers fût continuellement à l’affût de l’accouplement des hommes & des femmes, qu’il remarquât attentivement le moment où un germe sort du corps d’un homme, & entre dans le corps d’une femme, & qu’alors il envoyât vite une ame dans ce germe ? & si ce germe meurt, que deviendra cette ame ? elle aura donc été créée inutilement, ou elle attendra une autre occasion.
Voilà, je vous l’avouë, une étrange occupation pour le Maître du monde ; & non seulement, il faut qu’il prenne garde continuellement à la copulation de l’espèce humaine, mais il faut qu’il en fasse autant avec tous les animaux, car ils ont tous comme nous de la mémoire, des idées, des passions ; & si une ame est nécessaire pour former ces sentimens, cette mémoire, ces idées, ces passions, il faut que Dieu travaille perpétuellement à forger des ames pour les éléphants, & pour les porcs, pour les hiboux, pour les poissons, & pour les bonzes.
Quelle idée me donneriez-vous de l’architecte de tant de millions de mondes, qui serait obligé de faire continuellement des chevilles invisibles pour perpétuer son ouvrage ?
Voilà une très petite partie des raisons qui [I-109] peuvent me faire douter de l’existence de l’ame.
CU-SU.
Vous raisonnez de bonne foi ; & ce sentiment vertueux, quand même il serait erroné, serait agréable à l’Être suprême. Vous pouvez vous tromper, mais vous ne cherchez pas à vous tromper, & dès lors vous êtes excusable. Mais songez que vous ne m’avez proposé que des doutes, & que ces doutes sont tristes. Admettez des vraisemblances plus consolantes ; il est dur d’être anéanti ; espérez de vivre. Vous savez qu’une pensée n’est point matière, vous savez qu’elle n’a nul rapport avec la matière, pourquoi donc vous serait-il si difficile de croire que Dieu a mis dans vous un principe divin, qui ne pouvant être dissous, ne peut être sujet à la mort ? oseriez-vous dire qu’il est impossible que vous ayez une ame ? non sans doute ; & si cela est possible, n’est-il pas très vraisemblable que vous en avez une ? pourriez-vous rejeter un systême si beau & si nécessaire au genre humain ? & quelques difficultés vous rebuteront-elles ?
KOU.
Je voudrais embrasser ce systême, mais je voudrais qu’il me fût prouvé. Je ne suis pas le maître de croire quand je n’ai pas d’évidence. Je suis toûjours frappé de cette grande idée que Dieu a tout fait, qu’il est partout, qu’il pénètre tout, qu’il donne le mouvement & la vie à tout ; & s’il est dans toutes les [I-110] parties de mon être, comme il est dans toutes les parties de la nature, je ne vois pas quel besoin j’ai d’une ame. Qu’ai-je à faire de ce petit être subalterne, quand je suis animé par Dieu même ? à quoi me servirait cette ame ? Ce n’est pas nous qui nous donnons nos idées, car nous les avons presque toûjours malgré nous ; nous en avons quand nous sommes endormis ; tout se fait en nous sans que nous nous en mêlions. L’ame aurait beau dire au sang & aux esprits animaux, Courez, je vous prie, de cette façon pour me faire plaisir, ils circuleront toûjours de la manière que Dieu leur a prescrite. J’aime mieux être la machine d’un Dieu qui m’est démontré, que d’être la machine d’une ame dont je doute.
CU-SU.
Eh bien, si Dieu même vous anime, ne souillez jamais par des crimes ce Dieu qui est en vous ; & s’il vous a donné une ame, que cette ame ne l’offense jamais. Dans l’un & dans l’autre systême vous avez une volonté ; vous êtes libre ; c’est-à-dire, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez ; servez-vous de ce pouvoir pour servir ce Dieu qui vous l’a donné. Il est bon que vous soyez philosophe, mais il est nécessaire que vous soyez juste. Vous le serez encor plus quand vous croirez avoir une ame immortelle.
Daignez me répondre : n’est-il pas vrai que Dieu est la souveraine justice ?
[I-111]
KOU.
Sans doute ; & s’il était possible qu’il cessât de l’être, (ce qui est un blasphême) je voudrais moi agir avec équité.
CU-SU.
N’est-il pas vrai que votre devoir sera de récompenser les actions vertueuses, & de punir les criminelles quand vous serez sur le trône ? Voudriez-vous que Dieu ne fît pas ce que vous-même êtes tenu de faire ? Vous savez qu’il est, & qu’il sera toûjours dans cette vie des vertus malheureuses, & des crimes impunis ; il est donc nécessaire que le bien & le mal trouvent leur jugement dans une autre vie. C’est cette idée si simple, si naturelle, si générale, qui a établi chez tant de nations la créance de l’immortalité de nos ames, & de la justice divine qui les juge, quand elles ont abandonné leur dépouille mortelle. Y a-t-il un systême plus raisonnable, plus convenable à la Divinité, & plus utile au genre humain ?
KOU.
Pourquoi donc plusieurs nations n’ont-elles point embrassé ce systême ? Vous savez que nous avons dans notre province environ deux cents familles d’anciens Sinous [[5]] qui ont autrefois habité une partie de l’Arabie pétrée ; ni [I-112] elles, ni leurs ancêtres n’ont jamais cru l’ame immortelle : ils ont leurs cinq livres, comme nous avons nos cinq Kings ; j’en ai lu la traduction ; leurs loix nécessairement semblables à celles de tous les autres peuples, leur ordonnent de respecter leurs pères, de ne point voler, de ne point mentir, de n’être ni adultères, ni homicides ; mais ces mêmes loix ne leur parlent ni de récompenses ni de châtiments dans une autre vie.
CU-SU.
Si cette idée n’est pas encor développée chez ce pauvre peuple, elle le sera sans doute un jour. Mais que nous importe une malheureuse petite nation, tandis que les Babyloniens, les Égyptiens, les Indiens, & toutes les nations policées ont reçu ce dogme salutaire ? Si vous étiez malade, rejetteriez-vous un remède approuvé par tous les Chinois, sous prétexte que quelques barbares des montagnes n’auraient pas voulu s’en servir ? Dieu vous a donné la raison, elle vous dit que l’ame doit être immortelle, c’est donc Dieu qui vous le dit lui-même.
[I-113]
KOU.
Mais comment pourrai-je être récompensé, ou puni, quand je ne serai plus moi-même, quand je n’aurai plus rien de ce qui aura constitué ma personne ? Ce n’est que par ma mémoire que je suis toûjours moi. Je perds ma mémoire dans ma dernière maladie ; il faudra donc après ma mort un miracle pour me la rendre, pour me faire rentrer dans mon existence que j’aurai perdue ?
CU-SU.
C’est-à-dire que si un prince avait égorgé sa famille pour régner, s’il avait tyrannisé ses sujets, il en serait quitte pour dire à Dieu, Ce n’est pas moi, j’ai perdu la mémoire, vous vous méprenez, je ne suis plus la même personne ; pensez-vous que Dieu fût bien content de ce sophisme ?
KOU.
Eh bien soit, je me rends ; [[6]] je voulais faire le bien pour moi-même, je le ferai aussi pour [I-114] plaire à l’Être suprême. Je pensais qu’il suffisait que mon ame fût juste dans cette vie, j’espérerai qu’elle sera heureuse dans une autre. Je vois que cette opinion est bonne pour les peuples & pour les princes, mais le culte de Dieu m’embarrasse.
QUATRIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Que trouvez-vous de choquant dans notre Chu-King, ce premier livre canonique, si respecté de tous les empereurs chinois ? Vous labourez un champ de vos mains royales pour donner l’exemple au peuple, & vous en offrez les prémices au Chang-ti, au Tien, à l’Être suprême ; vous lui sacrifiez quatre fois l’année ; vous êtes roi & pontife ; vous promettez à Dieu de faire tout le bien qui sera en votre pouvoir ; y a-t-il là quelque chose qui répugne ?
KOU.
Je suis bien loin d’y trouver à redire ; je sais que Dieu n’a nul besoin de nos sacrifices, ni de nos prières, mais nous avons besoin de lui [I-115] en faire ; son culte n’est pas établi pour lui, mais pour nous. J’aime fort à faire des prières, je veux surtout qu’elles ne soient point ridicules ; car quand j’aurai bien crié que la montagne du Chang-ti est une montagne grasse, & qu’il ne faut point regarder les montagnes grasses, quand j’aurai fait enfuir le soleil, & sécher la lune : ce galimatias sera-t-il agréable à l’Être suprême, utile à mes sujets & à moi-même ?
Je ne peux surtout souffrir la démence des sectes qui nous environnent : d’un côté je vois Laotzé que sa mère conçut par l’union du ciel & de la terre, & dont elle fut grosse quatre-vingts ans. Je n’ai pas plus de foi à sa doctrine de l’anéantissement & du dépouillement universel, qu’aux cheveux blancs avec lesquels il naquit, & à la vache noire sur laquelle il monta pour aller prêcher sa doctrine.
Le dieu Fo ne m’en impose pas davantage, quoiqu’il ait eu pour père un éléphant blanc, & qu’il promette une vie immortelle.
Ce qui me déplaît surtout, c’est que de telles rêveries sont continuellement prêchées par les bonzes qui séduisent le peuple pour le gouverner ; ils se rendent respectables par des mortifications qui effrayent la nature. Les uns se [I-116] privent toute leur vie des alimens les plus salutaires, comme si on ne pouvait plaire à Dieu que par un mauvais régime. Les autres se mettent au cou un carcan, dont quelquefois ils se rendent très dignes ; ils s’enfoncent des clous dans les cuisses, comme si leurs cuisses étaient des planches ; le peuple les suit en foule. Si un Roi donne quelque édit qui leur déplaît, ils vous disent froidement que cet édit ne se trouve pas dans le commentaire du dieu Fo, & qu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. Comment remédier à une maladie populaire si extravagante, & si dangereuse ? Vous savez que la tolérance est le principe du gouvernement de la Chine, & de tous ceux de l’Asie : mais cette indulgence n’est-elle pas bien funeste, quand elle expose un empire à être bouleversé pour des opinions fanatiques ?
CU-SU.
Que le Chang-ti me préserve de vouloir éteindre en vous cet esprit de tolérance, cette vertu si respectable, qui est aux ames ce que la permission de manger est au corps. La loi naturelle permet à chacun de croire ce qu’il veut, comme de se nourrir de ce qu’il veut. Un médecin n’a pas le droit de tuer ses malades parce qu’ils n’auront pas observé la diète qu’il leur a prescrite. Un prince n’a pas le droit de faire pendre ceux de ses sujets qui n’auront pas pensé comme lui ; mais il a le droit d’empêcher les troubles ; & s’il est sage, il lui sera très aisé de déraciner les superstitions. Vous [I-117] savez ce qui arriva à Daon, sixième roi de la Caldée, il y a quelques quatre mille ans ?
KOU.
Non, je n’en sais rien, vous me feriez plaisir de me l’apprendre.
CU-SU.
Les prêtres chaldéens s’étaient avisés d’adorer les brochets de l’Euphrate. Ils prétendaient qu’un fameux brochet nommé Oannès leur avait autrefois appris la théologie, que ce brochet était immortel, qu’il avait trois pieds de long, & un petit croissant sur la queüe. C’était par respect pour cet Oannès, qu’il était défendu de manger du brochet. Il s’éleva une grande dispute entre les théologiens, pour savoir si le brochet Oannès était laité, ou œuvé. Les deux partis s’excommunièrent réciproquement, & on en vint plusieurs fois aux mains. Voici comme le roi Daon s’y prit pour faire cesser ce désordre.
Il commanda un jeûne rigoureux de trois jours aux deux partis ; après quoi il fit venir les partisans du brochet aux œufs, qui assistèrent à son dîner ; il se fit apporter un brochet de trois pieds, auquel on avait mis un petit croissant sur la queüe. Est-ce là votre dieu ? dit-il aux docteurs ; Oui, sire, lui répondirent-ils, car il a un croissant sur la queue. Le roi commanda qu’on ouvrît le brochet, qui avait la plus belle laite du monde. Vous voyez bien, dit-il, que ce n’est pas là votre dieu, puisqu’il est laité ; [I-118] et le brochet fut mangé par le roi & par ses satrapes, au grand contentement des théologiens des œufs, qui voyaient qu’on avait frit le dieu de leurs adversaires.
On envoya chercher aussitôt les docteurs du parti contraire : on leur montra un dieu de trois pieds qui avait des œufs & un croissant sur la queüe ; ils assurèrent que c’était là le dieu Oannès, & qu’il était laité ; il fut frit comme l’autre, & reconnu œuvé. Alors les deux partis étant également sots, & n’ayant pas déjeuné, le bon roi Daon leur dit qu’il n’avait que des brochets à leur donner pour leur dîner : ils en mangèrent goulûment, soit œuvés, soit laités. La guerre civile finit, chacun bénit le bon roi Daon ; & les citoyens depuis ce tems firent servir à leur dîner tant de brochets qu’ils voulurent.
KOU.
J’aime fort le roi Daon, & je promets bien de l’imiter à la première occasion qui s’offrira. J’empêcherai toûjours autant que je le pourrai (sans faire violence à personne) qu’on adore des Fo, & des brochets.
Je sais que dans le Pégu & dans le Tonquin il y a de petits dieux & de petits talapoins qui font descendre la lune dans le décours, & qui prédisent clairement l’avenir ; c’est-à-dire, qui voient clairement ce qui n’est pas, car l’avenir n’est point. J’empêcherai autant que je le pourrai que les talapoins ne viennent chez moi prendre le futur pour le présent & faire descendre la lune.
[I-119]
Quelle pitié qu’il y ait des sectes qui aillent de ville en ville débiter leurs rêveries, comme des charlatans qui vendent leurs drogues ! quelle honte pour l’esprit humain que de petites nations pensent que la vérité n’est que pour elles, & que le vaste empire de la Chine est livré à l’erreur ! L’Être éternel ne serait-il que le Dieu de l’île Formose ou de l’île Borneo ? Abandonnerait-il le reste de l’univers ? Mon cher Cu-su, il est le père de tous les hommes ; il permet à tous de manger du brochet ; le plus digne hommage qu’on puisse lui rendre est d’être vertueux ; un cœur pur est le plus beau de tous ses temples, comme disait le grand empereur Hiao.
CINQUIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Puisque vous aimez la vertu, comment la pratiquerez-vous quand vous serez roi ?
KOU.
En n’étant injuste ni envers mes voisins, ni envers mes peuples.
CU-SU.
Ce n’est pas assez de ne point faire de mal ; vous ferez du bien, vous nourrirez les pauvres en les occupant à des travaux utiles, & non pas en dotant la fainéantise. Vous embellirez les grands chemins, vous creuserez des canaux, vous élèverez des édifices publics, vous [I-120] encouragerez tous les arts, vous récompenserez le mérite en tout genre, vous pardonnerez les fautes involontaires.
KOU.
C’est ce que j’appelle n’être point injuste, ce sont là autant de devoirs.
CU-SU.
Vous pensez en véritable Roi ; mais il y a le Roi & l’homme, la vie publique, & la vie privée. Vous allez bientôt vous marier, combien comptez-vous avoir de femmes ?
KOU.
Mais je crois qu’une douzaine me suffira ; un plus grand nombre pourrait me dérober un tems destiné aux affaires. Je n’aime point ces Rois qui ont des trois cents femmes, & des sept cents concubines, & des milliers d’eunuques pour les servir. Cette manie des eunuques me paraît surtout un trop grand outrage à la nature humaine. Je pardonne tout au plus qu’on chaponne des coqs, ils en sont meilleurs à manger, mais on n’a point encor fait mettre d’eunuques à la broche. À quoi sert leur mutilation ? Le Dalaï-Lama en a cinquante pour chanter dans sa pagode. Je voudrais bien savoir si le Chang-ti se plaît beaucoup à entendre les voix claires de ces cinquante hongres ?
Je trouve encor très ridicule qu’il y ait des bonzes qui ne se marient point ; ils se vantent [I-121] d’être plus sages que les autres Chinois : eh bien, qu’ils fassent donc des enfans sages. Voilà une plaisante manière d’honorer le Chang-ti que de le priver d’adorateurs ! Voilà une singulière façon de servir le genre humain que de donner l’exemple d’anéantir le genre humain ! Le bon petit Lama [[7]] nommé Stelca isant Erepi, voulait dire que tout prêtre devait faire le plus d’enfans qu’il pourrait ; il prêchait d’exemple, & a été fort utile en son tems. Pour moi, je marierai tous les Lamas & bonzes, & Lamesses & bonzesses qui auront de la vocation pour ce saint œuvre ; ils en seront certainement meilleurs citoyens, & je croirai faire en cela un grand bien au royaume de Lou.
CU-SU.
Oh ! le bon prince que nous aurons là ! Vous me faites pleurer de joie. Vous ne vous contenterez pas d’avoir des femmes & des sujets ; car enfin, on ne peut pas passer sa journée à faire des édits & des enfans, vous aurez sans doute des amis.
KOU.
J’en ai déjà, & de bons, qui m’avertissent de mes défauts ; je me donne la liberté de reprendre les leurs ; ils me consolent, & je les console ; l’amitié est le baume de la vie, il vaut mieux que celui du chymiste Érueil, & même [I-122] que les sachets du grand Hanourd. Je suis étonné qu’on n’ait pas fait de l’amitié un précepte de religion ; j’ai envie de l’insérer dans notre rituel.
CU-SU.
Gardez-vous-en bien, l’amitié est assez sacrée d’elle-même, ne la commandez jamais, il faut que le cœur soit libre, & puis, si vous faisiez de l’amitié un précepte, un mystère, un rite, une cérémonie, il y aurait mille bonzes qui en prêchant & en écrivant leurs rêveries, rendraient l’amitié ridicule, il ne faut pas l’exposer à cette profanation.
Mais comment en userez-vous avec vos ennemis ? Confutzée recommande en vingt endroits de les aimer ; cela ne vous paraît-il pas un peu difficile ?
KOU.
Aimer ses ennemis ! Eh mon Dieu, rien n’est si commun.
CU-SU.
Comment l’entendez-vous ?
KOU.
Mais comme il faut, je crois, l’entendre. J’ai fait l’apprentissage de la guerre sous le prince de Décon contre le prince du Vis-Brunk : dès qu’un [[8]] de nos ennemis était blessé & [I-123] tombait entre nos mains, nous avions soin de lui comme s’il eût été notre frère, nous avons souvent donné notre propre lit à nos ennemis blessés & prisonniers, & nous avons couché auprès d’eux sur des peaux de tigres étendues à terre ; nous les avons servis nous-mêmes : que voulez-vous de plus ? que nous les aimions comme on aime sa maîtresse ?
CU-SU.
Je suis très édifié de tout ce que vous me dites, & je voudrais que toutes les nations vous entendissent. Car on m’assure qu’il y a des peuples assez impertinents pour oser dire que nous ne connaissons pas la vraie vertu, que nos bonnes actions ne sont que des péchés splendides, que nous avons besoin des leçons de leurs talapoins pour nous faire de bons principes. Hélas les malheureux ! ce n’est que d’hier qu’ils savent lire & écrire, & ils prétendent enseigner leurs maîtres !
SIXIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Je ne vous répéterai pas tous les lieux communs qu’on débite parmi nous depuis cinq ou six mille ans sur toutes les vertus. Il y en a qui ne sont que pour nous-mêmes, comme la prudence pour conduire nos ames, la tempérance pour gouverner nos corps ; ce sont des préceptes de politique & de santé. Les [I-124] véritables vertus sont celles qui sont utiles à la société, comme la fidélité, la magnanimité, la bienfaisance, la tolérance &c. Grâce au ciel, il n’y a point de vieille qui n’enseigne parmi nous toutes ces vertus à ses petits enfans ; c’est le rudiment de notre jeunesse au village comme à la ville ; mais il y a une grande vertu qui commence à être de peu d’usage, & j’en suis fâché.
KOU.
Quelle est-elle ? nommez-la vite, je tâcherai de la ranimer.
CU-SU.
C’est l’hospitalité, cette vertu si sociale, ce lien sacré des hommes commence à se relâcher depuis que nous avons des cabarets. Cette pernicieuse institution nous est venue, à ce qu’on dit, de certains sauvages d’Occident. Ces misérables apparemment n’ont point de maison pour accueillir les voyageurs. Quel plaisir de recevoir dans la grande ville de Lou, dans la belle place Honchan, dans ma maison Ki, un généreux étranger qui arrive de Samarcande, pour qui je deviens dès ce moment un homme sacré, & qui est obligé par toutes les loix divines & humaines de me recevoir chez lui quand je voyagerai en Tartarie, & d’être mon ami intime !
Les sauvages dont je vous parle ne reçoivent les étrangers que pour de l’argent dans des cabanes dégoûtantes, ils vendent cher cet accueil infâme, & avec cela, j’entends dire que [I-125] ces pauvres gens se croient au-dessus de nous, qu’ils se vantent d’avoir une morale plus pure. Ils prétendent que leurs prédicateurs prêchent mieux que Confutzée, qu’enfin, c’est à eux de nous enseigner la justice, parce qu’ils vendent de mauvais vin sur les grands chemins, que leurs femmes vont comme des folles dans les rues, & qu’elles dansent pendant que les nôtres cultivent des vers à soie.
KOU.
Je trouve l’hospitalité fort bonne, je l’exerce avec plaisir, mais je crains l’abus. Il y a des gens vers le grand Thibet qui sont fort mal logés, qui aiment à courir, & qui voyageraient pour rien d’un bout du monde à l’autre ; & quand vous irez au grand Thibet, jouir chez eux du droit de l’hospitalité, vous ne trouverez ni lit, ni pot-au-feu ; cela peut dégoûter de la politesse.
CU-SU.
L’inconvénient est petit, il est aisé d’y remédier en ne recevant que des personnes bien recommandées. Il n’y a point de vertu qui n’ait ses dangers, & c’est parce qu’elles en ont qu’il est beau de les embrasser.
Que notre Confutzée est sage & saint ! il n’est aucune vertu qu’il n’inspire ; le bonheur des hommes est attaché à chacune de ses sentences : en voici une qui me revient dans la mémoire, c’est la cinquante-troisième.
Reconnais les bienfaits par des bienfaits, & ne te venge jamais des injures.
[I-126]
Quelle maxime, quelle loi les peuples de l’Occident pourraient-ils opposer à une morale si pure ? en combien d’endroits Confutzée recommande-t-il l’humilité ? si on pratiquait cette vertu, il n’y aurait jamais de querelles sur la terre.
KOU.
J’ai lû tout ce que Confutzée & les sages des siècles antérieurs ont écrit sur l’humilité ; mais il me semble qu’ils n’en ont jamais donné une définition assez exacte ; il y a peu d’humilité peut-être à oser les reprendre ; mais j’ai au moins l’humilité d’avouer que je ne les ai pas entendus. Dites-moi ce que vous en pensez ?
CU-SU.
J’obéïrai humblement. Je crois que l’humilité est la modestie de l’ame ; car la modestie extérieure n’est que la civilité. L’humilité ne peut pas consister à se nier à soi-même la supériorité qu’on peut avoir acquise sur un autre. Un bon médecin ne peut se dissimuler qu’il en sait davantage que son malade en délire. Celui qui enseigne l’astronomie doit s’avouer qu’il est plus savant que ses disciples ; il ne peut s’empêcher de le croire, mais il ne doit pas s’en faire accroire. L’humilité n’est pas l’abjection ; elle est le correctif de l’amour-propre, comme la modestie est le correctif de l’orgueil.
KOU.
Eh bien, c’est dans l’exercice de toutes ces [I-127] vertus, & dans le culte d’un Dieu simple & universel, que je veux vivre, loin des chimères des sophistes, & des illusions des faux prophètes. L’amour du prochain sera ma vertu sur le trône, & l’amour de Dieu ma religion. Je mépriserai le dieu Fo, & Laotzée, & Vitsnou qui s’est incarné tant de fois chez les Indiens, & Sammonocodom qui descendit du ciel pour venir joüer au cerf volant chez les Siamois, & les Camis qui arrivèrent de la Lune au Japon.
Malheur à un peuple assez imbécile & assez barbare pour penser qu’il y a un Dieu pour sa seule province : c’est un blasphème. Quoi ? la lumière du soleil éclaire tous les yeux, & la lumière de Dieu n’éclairerait qu’une petite & chétive nation dans un coin de ce globe ! quelle horreur ! & quelle sottise ! La Divinité parle au cœur de tous les hommes, & les liens de la charité doivent les unir d’un bout de l’univers à l’autre.
CU-SU.
Ô sage Kou ! vous avez parlé comme un homme inspiré par le Chang-ti même ; vous serez un digne prince. J’ai été votre docteur, & vous êtes devenu le mien.
[I-128]
CATÉCHISME DU CURÉ.↩
ARISTON.
Eh bien, mon cher Téotime, vous allez donc être curé de campagne ?
TÉOTIME.
Oui ; on me donne une petite paroisse, & je l’aime mieux qu’une grande. Je n’ai qu’une portion limitée d’intelligence & d’activité ; je ne pourrais certainement pas diriger soixante & dix mille ames, attendu que je n’en ai qu’une ; & j’ai toûjours admiré la confiance de ceux qui se sont chargés de ces districts immenses. Je ne me sens pas capable d’une telle administration ; un grand troupeau m’effraye, mais je pourrai faire quelque bien à un petit. J’ai étudié assez de jurisprudence pour empêcher, autant que je le pourrai, mes pauvres paroissiens de se ruiner en procès. Je sais assez de médecine pour leur indiquer les remèdes simples quand ils seront malades. J’ai assez de connaissance de l’agriculture pour leur donner quelquefois des conseils utiles. Le seigneur du lieu & sa femme sont d’honnêtes gens qui ne sont point dévots, & qui m’aideront à faire du bien. Je me flatte que je vivrai assez heureux, & qu’on ne sera pas malheureux avec moi.
ARISTON.
N’êtes-vous pas fâché de n’avoir point de femme ? ce serait une grande consolation ; il [I-129] serait doux après avoir prôné, chanté, confessé, communié, baptisé, enterré, de trouver dans son logis une femme douce, agréable & honnête, qui aurait soin de votre linge & de votre personne, qui vous égaierait dans la santé, qui vous soignerait dans la maladie, qui vous ferait de jolis enfans, dont la bonne éducation serait utile à l’État. Je vous plains vous qui servez les hommes, d’être privé d’une consolation si nécessaire aux hommes.
TÉOTIME.
L’Église Grecque a grand soin d’encourager les curés au mariage ; l’Église anglicane & les protestants ont la même sagesse ; l’Église latine a une sagesse contraire ; il faut m’y soumettre. Peut-être aujourd’hui que l’esprit philosophique a fait tant de progrès, un concile ferait des loix plus favorables à l’humanité que le concile de Trente ; mais en attendant, je dois me conformer aux loix présentes ; il en coûte beaucoup, je le sais, mais tant de gens qui valaient mieux que moi s’y sont soumis, que je ne dois pas murmurer.
ARISTON.
Vous êtes savant, & vous avez une éloquence sage ; comment comptez-vous prêcher devant des gens de campagne ?
TÉOTIME.
Comme je prêcherais devant les Rois ; je parlerai toûjours de morale, & jamais de [I-130] controverse ; Dieu me préserve d’approfondir la grace concomitante, la grace efficace, à laquelle on résiste, la suffisante qui ne suffit pas ; d’examiner si les anges qui mangèrent avec Abraham & avec Loth avaient un corps, ou s’ils firent semblant de manger ; il y a mille choses que mon auditoire n’entendrait pas, ni moi non plus. Je tâcherai de faire des gens de bien, & de l’être, mais je ne ferai point de théologiens, & je le serai le moins que je pourrai.
ARISTON.
Ô le bon curé ! Je veux acheter une maison de campagne dans votre paroisse. Dites-moi, je vous prie, comment vous en userez dans la confession ?
TÉOTIME.
La confession est une chose excellente, un frein aux crimes, inventé dans l’antiquité la plus reculée ; on se confessait dans la célébration de tous les anciens mystères ; nous avons imité & sanctifié cette sage pratique ; elle est très bonne pour engager les cœurs ulcérés de haine à pardonner, & pour faire rendre par les petits voleurs ce qu’ils peuvent avoir dérobé à leur prochain. Elle a quelques inconvénients. Il y a beaucoup de confesseurs indiscrets, surtout parmi les moines, qui apprennent quelquefois plus de sottises aux filles que tous les garçons d’un village ne pourraient leur en faire. Point de détails dans la confession ; ce n’est point un interrogatoire juridique, c’est l’aveu [I-131] de ses fautes qu’un pécheur fait à l’Être suprême entre les mains d’un autre pécheur qui va s’accuser à son tour. Cet aveu salutaire n’est point fait pour contenter la curiosité d’un homme.
ARISTON.
Et des excommunications, en userez-vous ?
TÉOTIME.
Non ; il y a des rituels où l’on excommunie les sauterelles, les sorciers & les comédiens. Je n’interdirai point l’entrée de l’église aux sauterelles, attendu qu’elles n’y vont jamais. Je n’excommunierai point les sorciers, parce qu’il n’y a point de sorciers : & à l’égard des comédiens, comme ils sont pensionnés par le roi, & autorisés par le magistrat, je me garderai bien de les diffamer. Je vous avouerai même comme à mon ami, que j’ai du gout pour la comédie, quand elle ne choque point les mœurs. J’aime passionnément le Misanthrope, Athalie & d’autres pièces, qui me paraissent des écoles de vertu & de bienséance. Le seigneur de mon village fait jouer dans son château quelques-unes de ces pièces, par de jeunes personnes qui ont du talent : ces représentations inspirent la vertu par l’attrait du plaisir ; elles forment le goût, elles apprennent à bien parler & à bien prononcer. Je ne vois rien là que de très innocent, & même de très utile ; je compte bien assister à ces spectacles pour mon instruction, mais dans une loge grillée, pour ne point scandaliser les faibles.
[I-132]
ARISTON.
Plus vous me découvrez vos sentimens, & plus j’ai envie de devenir votre paroissien. Il y a un point bien important qui m’embarrasse. Comment ferez-vous pour empêcher les paysans de s’enivrer les jours de fêtes ? c’est là leur grande manière de les célébrer. Vous voyez les uns accablés d’un poison liquide, la tête penchée vers les genoux, les mains pendantes, ne voyant point, n’entendant rien, réduits à un état fort au-dessous de celui des brutes, reconduits chez eux en chancelant par leurs femmes éplorées, incapables de travail le lendemain, souvent malades & abrutis pour le reste de leur vie. Vous en voyez d’autres devenus furieux par le vin, exciter des querelles sanglantes, frapper & être frappés, & quelquefois finir par le meurtre ces scènes affreuses, qui sont la honte de l’espèce humaine ; il le faut avouer, l’État perd plus de sujets par les fêtes que par les batailles ; comment pourrez-vous diminuer dans votre paroisse un abus si exécrable ?
TÉOTIME.
Mon parti est pris ; je leur permettrai, je les presserai même de cultiver leurs champs les jours de fêtes après le service divin que je ferai de très bonne heure. C’est l’oisiveté de la férie qui les conduit au cabaret. Les jours ouvrables ne sont point les jours de la débauche & du meurtre. Le travail modéré contribue à la santé du corps & à celle de l’ame : de plus, [I-133] ce travail est nécessaire à l’État. Supposons cinq millions d’hommes qui font par jour pour dix sous d’ouvrage l’un portant l’autre, & ce compte est bien modéré ; vous rendez ces cinq millions d’hommes inutiles trente jours de l’année. C’est donc trente fois cinq millions de pièces de dix sous que l’État perd en main d’œuvre. Or certainement, Dieu n’a jamais ordonné, ni cette perte, ni l’ivrognerie.
ARISTON.
Ainsi vous concilierez la prière & le travail ; Dieu ordonne l’un & l’autre. Vous servirez Dieu & le prochain ; mais dans les disputes ecclésiastiques, quel parti prendrez-vous ?
TÉOTIME.
Aucun. On ne dispute jamais sur la vertu, parce qu’elle vient de Dieu : on se querelle sur des opinions qui viennent des hommes.
ARISTON.
Oh le bon curé ! le bon curé !
[I-134]
CATÉCHISME DU JAPONOIS.↩
L’INDIEN.
Est-il vrai qu’autrefois les Japonois ne savaient pas faire la cuisine, qu’ils avaient soumis leur royaume au grand Lama, que ce grand Lama décidait souverainement de leur boire & de leur manger, qu’il envoyait chez vous de tems en tems un petit Lama, lequel venait recueillir les tributs, & qu’il vous donnait en échange un signe de protection, fait avec les deux premiers doigts & le pouce ?
LE JAPONOIS.
Hélas ! rien n’est plus vrai. Figurez-vous même que toutes les places de Canusi [[9]] qui sont les grands cuisiniers de notre île, étaient données par le Lama, & n’étaient pas données pour l’amour de Dieu. De plus, chaque maison de nos séculiers payait une once d’argent par an à ce grand cuisinier du Thibet. Il ne nous accordait pour tout dédommagement que des petits plats d’assez mauvais goût qu’on appelle des restes. Et quand il lui prenait quelque fantaisie nouvelle, comme de faire la guerre aux peuples du Tangut, il levait chez nous de nouveaux subsides. Notre nation se plaignit souvent, mais sans aucun fruit ; & même chaque plainte finissait par payer un peu [I-135] davantage. Enfin l’amour qui fait tout pour le mieux, nous délivra de cette servitude. Un de nos empereurs se brouilla avec le grand Lama pour une femme : mais il faut avoüer que ceux qui nous servirent le plus dans cette affaire furent nos Canusi, autrement Pauxcospie ; [[10]] c’est à eux que nous avons l’obligation d’avoir secoué le joug, & voici comment.
Le grand Lama avait une plaisante manie ; il croyait avoir toûjours raison ; notre Daïri & nos Canusi voulurent avoir du moins raison quelquefois. Le grand Lama trouva cette prétention absurde, nos Canusi n’en démordirent point, & ils rompirent pour jamais avec lui.
L’INDIEN.
Eh bien, depuis ce tems-là vous avez été sans doute heureux & tranquilles ?
LE JAPONOIS.
Point du tout, nous nous sommes persécutés, déchirés, dévorés pendant près de deux siècles. Nos Canusi voulaient en vain avoir raison ; il n’y a que cent ans qu’ils sont raisonnables. Aussi, depuis ce tems-là pouvons-nous hardiment nous regarder comme une des nations les plus heureuses de la terre.
L’INDIEN.
Comment pouvez-vous jouir d’un tel bonheur, s’il est vrai ce qu’on m’a dit que vous [I-136] ayez douze factions de cuisine dans votre empire ? vous devez avoir douze guerres civiles par an.
LE JAPONOIS.
Pourquoi ? s’il y a douze traiteurs dont chacun ait une recette différente, faudra-t-il pour cela se couper la gorge au lieu de dîner ? au contraire, chacun fera bonne chère à sa façon chez le cuisinier qui lui agréera davantage.
L’INDIEN.
Il est vrai qu’on ne doit point disputer des goûts, mais on en dispute, & la querelle s’échauffe.
LE JAPONOIS.
Après qu’on a disputé bien longtems, & qu’on a vu que toutes ces querelles n’apprenaient aux hommes qu’à se nuire, on prend enfin le parti de se tolérer mutuellement, & c’est sans contredit ce qu’il y a de mieux à faire.
L’INDIEN.
Et qui sont, s’il vous plaît, ces traiteurs qui partagent votre nation dans l’art de boire & de manger ?
LE JAPONOIS.
Il y a premièrement les Breuxch, [[11]] qui ne vous donneront jamais de boudin ni de lard ; ils sont attachés à l’ancienne cuisine ; ils aimeraient mieux mourir que de piquer un poulet ; d’ailleurs, grands calculateurs ; & s’il y a une [I-137] once d’argent à partager entre eux & les onze autres cuisiniers, ils en prennent d’abord la moitié pour eux, & le reste est pour ceux qui savent le mieux compter.
L’INDIEN.
Je crois que vous ne soupez guère avec ces gens-là.
LE JAPONOIS.
Non ; il y a ensuite les Pispates, qui certains jours de chaque semaine, & même pendant un tems considérable de l’année, aimeraient cent fois mieux manger pour cent écus de turbots, de truites, de soles, de saumons, d’esturgeons, que de se nourrir d’une blanquette de veau, qui ne reviendrait pas à quatre sous.
Pour nous autres Canusi, nous aimons fort le bœuf, & une certaine pâtisserie qu’on appelle en Japonois du pudding. Au reste, tout le monde convient que nos cuisiniers sont infiniment plus savants que ceux des Pispates. Personne n’a plus approfondi que nous le Garum des Romains, n’a mieux connu les oignons de l’ancienne Égypte, la pâte de sauterelles des premiers Arabes, la chair de cheval des Tartares, & il y a toûjours quelque chose à apprendre dans les livres des Canusi, qu’on appelle communément Pauxcospie.
Je ne vous parlerai point de ceux qui ne mangent qu’à la Terluh, ni de ceux qui tiennent pour le régime de Vincal, ni des Batistanes, ni des autres ; mais les Quekars méritent [I-138] une attention particulière. Ce sont les seuls convives que je n’aie jamais vus s’enivrer & jurer. Ils sont très difficiles à tromper, mais ils ne vous tromperont jamais. Il semble que la loi d’aimer son prochain comme soi-même n’ait été faite que pour ces gens-là ; car en vérité, comment un bon Japonois peut-il se vanter d’aimer son prochain comme lui-même, quand il va pour quelque argent lui tirer une balle de plomb dans la cervelle, ou l’égorger avec un criss large de quatre doigts, le tout en front de bandière ? il s’expose lui-même à être égorgé, & à recevoir des balles de plomb ; ainsi, on peut dire avec bien plus de vérité, qu’il hait son prochain comme lui-même. Les Quekars n’ont jamais eu cette frénésie ; ils disent que les pauvres humains sont des cruches d’argile faites pour durer très peu, & que ce n’est pas la peine qu’elles aillent de gaieté de cœur se briser les unes contre les autres.
Je vous avoüe que si je n’étais pas Canusi, je ne haïrais pas d’être Quekar. Vous m’avoüerez qu’il n’y a pas moyen de se quereller avec des cuisiniers si pacifiques. Il y en a d’autres en très grand nombre qu’on appelle Diestes ; ceux-là donnent à dîner à tout le monde indifféremment, & vous êtes libre chez eux de manger tout ce qui vous plaît, lardé, bardé, sans lard, sans barde, aux œufs, à l’huile ; perdrix, saumon, vin gris, vin rouge, tout cela leur est indifférent, pourvu que vous fassiez quelque prière à Dieu avant ou après le dîner, & même simplement avant le déjeuner, [I-139] et que vous soyez honnêtes gens, ils riront avec vous aux dépens du grand Lama, à qui cela ne fera nul mal, & aux dépens de Terluh & de Vincal, & de Memnon, &c. Il est bon seulement que nos Diestes avoüent que nos Canusi sont très savants en cuisine, & que surtout ils ne parlent jamais de retrancher nos rentes ; alors nous vivrons très paisiblement ensemble.
L’INDIEN.
Mais enfin, il faut qu’il y ait une cuisine dominante, la cuisine du Roi.
LE JAPONOIS.
Je l’avoüe ; mais quand le Roi du Japon a fait bonne chère, il doit être de bonne humeur, il ne doit pas empêcher ses bons sujets de digérer.
L’INDIEN.
Mais si des entêtés veulent manger au nez du Roi des saucisses pour lesquelles le Roi aura de l’aversion, s’ils s’assemblent quatre ou cinq mille armés de grils pour faire cuire leurs saucisses, s’ils insultent ceux qui n’en mangent point ?
LE JAPONOIS.
Alors il faut les punir comme des yvrognes qui troublent le repos des citoyens. Nous avons pourvu à ce danger. Il n’y a que ceux qui mangent à la royale qui soient susceptibles des dignités de l’État. Tous les autres peuvent dîner à leur fantaisie, mais ils sont exclus des charges. Les attroupements sont [I-140] souverainement défendus, & punis sur le champ sans rémission, toutes les querelles à table sont réprimées soigneusement, selon le précepte de notre grand cuisinier Japonois, qui a écrit dans la langue sacrée, Suti raho cus flac, natis in usum lætitiæ sciphis pugnare tracum est… : ce qui veut dire, Le dîner est fait pour une joie recueillie & honnête, & il ne faut pas se jeter les verres à la tête.
Avec ces maximes nous vivons heureusement chez nous ; notre liberté est affermie sous nos Taicosema ; nos richesses augmentent ; nous avons deux cents jonques de ligne, & nous sommes la terreur de nos voisins.
L’INDIEN.
Pourquoi donc le bon versificateur Recina, fils de ce poëte indien Recina, [[12]] si tendre, si exact, si harmonieux, si éloquent, a-t-il dit dans un ouvrage didactique en rimes, intitulé la grace & non les graces,
Le Japon où jadis brilla tant de lumière,
N’est plus qu’un triste amas de folles visions ?
LE JAPONOIS.
Le Recina dont vous me parlez est lui-même un grand visionnaire. Ce pauvre Indien ignore-t-il que nous lui avons enseigné ce que c’est que la lumière ? que si on connait aujourd’hui dans l’Inde la véritable route des planètes, c’est à nous qu’on en est redevable ? que nous [I-141] seuls avons enseigné aux hommes les loix primitives de la nature, & le calcul de l’infini ? que s’il faut descendre à des choses qui sont d’un usage plus commun, les gens de son pays n’ont appris que de nous à faire des jonques, dans les proportions mathématiques ? qu’ils nous doivent jusqu’aux chausses appelées les bas au métier, dont ils couvrent leurs jambes ? Serait-il possible qu’ayant inventé tant de choses admirables ou utiles, nous ne fussions que des fous ? & qu’un homme qui a mis en vers les rêveries des autres fût le seul sage ? Qu’il nous laisse faire notre cuisine, & qu’il fasse, s’il veut, des vers sur des sujets plus poëtiques. [[13]]
L’INDIEN.
Que voulez-vous ? il a les préjugés de son pays, ceux de son parti, & les siens propres.
LE JAPONOIS.
Oh voilà trop de préjugés !
[I-142]
CATÉCHISME DU JARDINIER.↩
ou entretien du Bacha Tuctan, & du Jardinier Karpos
TUCTAN.
Eh bien, mon ami Karpos, tu vends cher tes légumes, mais ils sont bons… de quelle religion es-tu à présent ?
KARPOS.
Ma foi, mon Bacha, j’aurais bien de la peine à vous le dire. Quand notre petite île de Samos appartenait aux Grecs, je me souviens que l’on me faisait dire que l’Agion pneuma n’était produit que du Tou patrou ; on me faisait prier Dieu tout droit sur mes deux jambes, les mains croisées ; on me défendait de manger du lait en carême. Les Vénitiens sont venus, alors mon curé vénitien m’a fait dire qu’Agion pneuma venait du Tou patrou, & du Touyou, m’a permis de manger du lait, & m’a fait prier Dieu à genoux. Les Grecs sont revenus & ont chassé les Vénitiens, alors il a fallu renoncer au Touyou & à la crème. Vous avez enfin chassé les Grecs, & je vous entends crier Allah illa Allach de toutes vos forces ; je ne sais plus trop ce que je suis ; j’aime Dieu de tout mon cœur, & je vends mes légumes fort raisonnablement.
[I-143]
TUCTAN.
Tu as là de très belles figues.
KARPOS.
Mon Bacha, elles sont fort à votre service.
TUCTAN.
On dit que tu as aussi une jolie fille.
KARPOS.
Oui, mon Bacha, mais elle n’est pas à votre service.
TUCTAN.
Pourquoi cela ? misérable !
KARPOS.
C’est que je suis un honnête homme : il m’est permis de vendre mes figues, mais non pas de vendre ma fille.
TUCTAN.
Et par quelle loi ne t’est-il pas permis de vendre ce fruit-là ?
KARPOS.
Par la loi de tous les honnêtes Jardiniers ; l’honneur de ma fille n’est point à moi, il est à elle, ce n’est pas une marchandise.
TUCTAN.
Tu n’es donc pas fidèle à ton Bacha ?
[I-144]
KARPOS.
Très fidèle dans les choses justes, tant que vous serez mon maître.
TUCTAN.
Mais si ton papa Grec faisait une conspiration contre moi, & s’il t’ordonnait de la part du Tou patrou, & du Touyou, d’entrer dans son complot, n’aurais-tu pas la dévotion d’en être ?
KARPOS.
Moi ? point du tout, je m’en donnerais bien de garde.
TUCTAN.
Et pourquoi refuserais-tu d’obéir à ton Papa Grec dans une occasion si belle ?
KARPOS.
C’est que je vous ai fait serment d’obéïssance, & que je sais bien que le Tou patrou n’ordonne point les conspirations.
TUCTAN.
J’en suis bien aise : mais si par malheur tes Grecs reprenaient l’île & me chassaient, me serais-tu fidèle ?
KARPOS.
Eh comment alors pourrais-je vous être fidèle, puisque vous ne seriez plus mon Bacha ?
[I-145]
TUCTAN.
Et le serment que tu m’as fait que deviendrait-il ?
KARPOS.
Il serait comme mes figues, vous n’en tâteriez plus : n’est-il pas vrai, (sauf respect) que si vous étiez mort à l’heure que je vous parle, je ne vous devrais plus rien ?
TUCTAN.
La supposition est incivile, mais la chose est vraie.
KARPOS.
Eh bien, si vous étiez chassé, c’est comme si vous étiez mort, car vous auriez un successeur auquel il faudrait que je fisse un autre serment. Pourriez-vous exiger de moi une fidélité qui ne vous servirait à rien ? c’est comme si ne pouvant manger de mes figues vous vouliez m’empêcher de les vendre à d’autres.
TUCTAN.
Tu es un raisonneur. Tu as donc des principes ?
KARPOS.
Oui à ma façon, ils sont en petit nombre, mais ils me suffisent, & si j’en avais davantage ils m’embarrasseraient.
TUCTAN.
Je serais curieux de savoir tes principes.
[I-146]
KARPOS.
C’est par exemple d’être bon mari, bon père, bon voisin, bon sujet, & bon jardinier ; je ne vais pas au-delà, & j’espère que Dieu me fera miséricorde.
TUCTAN.
Et crois-tu qu’il me fera miséricorde à moi qui suis le gouverneur de ton île ?
KARPOS.
Et comment voulez-vous que je le sache ? est-ce à moi à deviner comment Dieu en use avec les Bachas ? C’est une affaire entre vous & lui, je ne m’en mêle en aucune sorte. Tout ce que j’imagine, c’est que si vous êtes un aussi honnête Bacha que je suis honnête jardinier, Dieu vous traitera fort bien.
TUCTAN.
Par Mahomet ! je suis fort content de cet idolâtre-là. Adieu mon ami, Allah vous ait en sa sainte garde.
KARPOS.
Grand merci. Theos ait pitié de vous ! mon Bacha.
[I-147]
CERTAIN, CERTITUDE.↩
Quel âge a votre ami Christophe ? Vingt-huit ans ; j’ai vu son contrat de mariage, son extrait-baptistaire, je le connais dès son enfance, il a vingt-huit ans, j’en ai la certitude, j’en suis certain.
À peine ai-je entendu la réponse de cet homme si sûr de ce qu’il dit, & de vingt autres qui confirment la même chose, que j’apprends qu’on a antidaté par des raisons secrètes, & par un manège singulier, l’extrait baptistaire de Christophe. Ceux à qui j’avais parlé n’en savent encor rien ; cependant, ils ont toûjours la certitude de ce qui n’est pas.
Si vous aviez demandé à la terre entière avant le tems de Copernic, Le soleil est-il levé ? s’est-il couché aujourd’hui ? tous les hommes vous auraient répondu, Nous en avons une certitude entière ; ils étaient certains, & ils étaient dans l’erreur.
Les sortilèges, les divinations, les obsessions, ont été longtems la chose du monde la plus certaine aux yeux de tous les peuples ; quelle foule innombrable de gens qui ont vu toutes ces belles choses, qui en ont été certains ! aujourd’hui cette certitude est un peu tombée.
Un jeune homme qui commence à étudier la géométrie vient me trouver ; il n’en est encor qu’à la définition des triangles : N’êtes-vous pas certain, lui dis-je, que les trois [I-148] angles d’un triangle sont égaux à deux droits ? il me répond que non seulement il n’en est point certain, mais qu’il n’a pas même d’idée nette de cette proposition ; je la lui démontre, il en devient alors très certain, & il le sera pour toute sa vie.
Voilà une certitude bien différente des autres ; elles n’étaient que des probabilités, & ces probabilités examinées sont devenues des erreurs, mais la certitude mathématique est immuable & éternelle.
J’existe, je pense, je sens de la douleur, tout cela est-il aussi certain qu’une vérité géométrique ? Oui. Pourquoi ? C’est que ces vérités sont prouvées par le même principe qu’une chose ne peut être, & n’être pas en même tems. Je ne peux en même tems exister & n’exister pas, sentir, & ne sentir pas. Un triangle ne peut en même tems avoir cent quatre-vingts degrés, qui sont la somme de deux angles droits, & ne les avoir pas.
La certitude physique de mon existence, de mon sentiment, & la certitude mathématique sont donc de même valeur, quoiqu’elles soient d’un genre différent.
Il n’en est pas de même de la certitude fondée sur les apparences, ou sur les rapports unanimes, que nous font les hommes.
Mais quoi, me dites-vous, n’êtes-vous pas certain que Pékin existe ? n’avez-vous pas chez vous des étoffes de Pékin ? des gens de différens pays, de différentes opinions, & qui ont écrit violemment les uns contre les autres en [I-149] prêchant tous la vérité à Pékin, ne vous ont-ils pas assuré de l’existence de cette ville ? Je réponds qu’il m’est extrêmement probable qu’il y avait alors une ville de Pékin ; mais je ne voudrais pas parier ma vie que cette ville existe ; & je parierai quand on voudra ma vie, que les trois angles d’un triangle sont égaux à deux droits.
On a imprimé dans le Dictionnaire encyclopédique une chose fort plaisante ; on y soutient qu’un homme devrait être aussi sûr, aussi certain que le Maréchal de Saxe est ressuscité, si tout Paris le lui disait, qu’il est sûr que le Maréchal de Saxe a gagné la bataille de Fontenoy, quand tout Paris le lui dit. Voyez, je vous prie, combien ce raisonnement est admirable ; je crois tout Paris quand il me dit une chose moralement possible ; donc je dois croire tout Paris quand il me dit une chose moralement & physiquement impossible.
Apparemment que l’auteur de cet article voulait rire, & que l’autre auteur qui s’extasie à la fin de cet article, & écrit contre lui-même, voulait rire aussi. [[14]]
[I-150]
CHAÎNE DES ÊTRES CRÉÉS.↩
La première fois que je lus Platon, & que je vis cette gradation d’êtres qui s’élèvent depuis le plus léger atôme jusqu’à l’Être suprême, cette échelle me frappa d’admiration ; mais l’ayant regardée attentivement, ce grand fantôme s’évanouït, comme autrefois toutes les apparitions s’enfuyaient le matin au chant du coq.
L’imagination se complaît d’abord à voir le passage imperceptible de la matière brute, à la matière organisée, des plantes aux zoophytes, de ces zoophytes aux animaux, de ceux-ci à l’homme, de l’homme aux génies, de ces génies revêtus d’un petit corps aërien à des substances immatérielles ; & enfin mille ordres différens de ces substances, qui de beautés en perfections s’élèvent jusqu’à Dieu même. Cette hiérarchie plaît beaucoup aux bonnes gens, qui croient voir le Pape & ses Cardinaux suivis des Archevêques, des Évêques ; après quoi viennent les curés, les vicaires, les simples prêtres, les diacres, les sous-diacres, puis paraissent les moines, & la marche est fermée par les capucins.
Mais il y a un peu plus de distance entre Dieu & ses plus parfaites créatures, qu’entre le saint père & le doyen du sacré collège : ce doyen peut devenir pape, mais le plus parfait des génies créés par l’Être suprême, ne peut devenir Dieu ; il y a l’infini entre Dieu & lui.
[I-151]
Cette chaîne, cette gradation prétendue n’existe pas plus dans les végétaux & dans les animaux ; la preuve en est qu’il y a des espèces de plantes & d’animaux qui sont détruites. Nous n’avons plus de murex. Il était défendu de manger du griffon & de l’ixion ; ces deux espèces ont disparu de ce monde, quoi qu’en dise Bochart : où donc est la chaîne ?
Quand même nous n’aurions pas perdu quelques espèces, il est visible qu’on en peut détruire. Les lions, les rhinocéros commencent à devenir fort rares.
Il est très probable qu’il y a eu des races d’hommes qu’on ne retrouve plus ; mais je veux qu’elles aient toutes subsisté, ainsi que les blancs, les nègres, les Caffres à qui la nature a donné un tablier de leur peau, pendant du ventre à la moitié des cuisses ; les Samoyèdes dont les femmes ont un mamelon d’un bel ébène, &c.
N’y a-t-il pas visiblement un vuide entre le singe & l’homme ? n’est-il pas aisé d’imaginer un animal à deux pieds sans plumes, qui serait intelligent sans avoir ni l’usage de la parole, ni notre figure, que nous pourrions apprivoiser, qui répondrait à nos signes & qui nous servirait ? & entre cette nouvelle espèce & celle de l’homme, n’en pourrait-on pas imaginer d’autres ?
Par delà l’homme, vous logez dans le ciel, divin Platon, une file de substances célestes ; nous croyons nous autres à quelques-unes de ces substances, parce que la foi nous l’enseigne. Mais vous, quelle raison avez-vous d’y [I-152] croire ? vous n’avez pas parlé apparemment au génie de Socrate ; & le bonhomme Heres qui ressuscita exprès pour vous apprendre les secrets de l’autre monde, ne vous a rien appris de ces substances.
La prétendue chaîne n’est pas moins interrompue dans l’univers sensible.
Quelle gradation, je vous prie, entre vos planètes ! la Lune est quarante fois plus petite que notre globe. Quand vous avez voyagé de la Lune dans le vuide, vous trouvez Vénus, elle est environ aussi grosse que la Terre. De là vous allez chez Mercure, il tourne dans une ellipse qui est fort différente du cercle que parcourt Vénus ; il est vingt-sept fois plus petit que nous, le Soleil un million de fois plus gros, Mars cinq fois plus petit ; celui-là fait son tour en deux ans, Jupiter son voisin en douze, Saturne en trente ; & encor Saturne, le plus éloigné de tous, n’est pas si gros que Jupiter. Où est la gradation prétendüe ?
Et puis, comment voulez-vous que dans de grands espaces vuides il y ait une chaîne qui lie tout ? s’il y en a une, c’est certainement celle que Newton a découverte ; c’est elle qui fait graviter tous les globes du monde planétaire les uns vers les autres dans ce vide immense.
Ô Platon tant admiré ! vous n’avez conté que des fables, & il est venu dans l’île des Cassidérides, où de votre tems les hommes allaient tout nus, un philosophe qui a enseigné à la terre des vérités aussi grandes que vos imaginations étaient puériles.
[I-153]
CHAÎNE DES ÉVÉNEMENS.↩
Il y a longtems qu’on a prétendu que tous les événements sont enchaînés les uns aux autres, par une fatalité invincible ; c’est le destin qui, dans Homère, est supérieur à Jupiter même. Ce maître des dieux & des hommes, déclare net, qu’il ne peut empêcher Sarpédon son fils de mourir dans le tems marqué. Sarpédon était né dans le moment qu’il fallait qu’il naquît, & ne pouvait pas naître dans un autre ; il ne pouvait mourir ailleurs que devant Troye ; il ne pouvait être enterré ailleurs qu’en Lycie ; son corps devait dans le tems marqué produire des légumes qui devaient se changer dans la substance de quelques Lyciens ; ses héritiers devaient établir un nouvel ordre dans ses États ; ce nouvel ordre devait influer sur les royaumes voisins ; il en résultait un nouvel arrangement de guerre & de paix avec les voisins des voisins de la Lycie : ainsi de proche en proche la destinée de toute la terre a dépendu de la mort de Sarpédon, laquelle dépendait d’un autre événement, lequel était lié par d’autres à l’origine des choses.
Si un seul de ces faits avait été arrangé différemment, il en aurait résulté un autre univers : or il n’était pas possible que l’univers actuel n’existât pas, donc il n’était pas possible à Jupiter de sauver la vie à son fils, tout Jupiter qu’il était.
[I-154]
Ce systême de la nécessité & de la fatalité, a été inventé de nos jours par Leibnitz, à ce qu’il dit, sous le nom de raison suffisante ; il est pourtant fort ancien ; ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il n’y a point d’effet sans cause, & que souvent la plus petite cause produit les plus grands effets.
Mylord Bolingbroke avouë que les petites querelles de Made. Marlborough, & de Made. Masham, lui firent naître l’occasion de faire le traité particulier de la reine Anne avec Louis XIV : ce traité amena la paix d’Utrecht ; cette paix d’Utrecht affermit Philippe V sur le trône d’Espagne. Philippe V prit Naples & la Sicile sur la maison d’Autriche ; le prince Espagnol qui est aujourd’hui roi de Naples, doit évidemment son royaume à Mylady Masham, & il ne l’aurait pas eu, il ne serait peut-être même pas né, si la duchesse de Marlborough avait été plus complaisante envers la reine d’Angleterre ; son existence à Naples dépendait d’une sottise de plus ou de moins à la cour de Londres. Examinez les situations de tous les peuples de l’univers, elles sont ainsi établies sur une suite de faits qui paraissent ne tenir à rien, & qui tiennent à tout. Tout est rouage, poulie, corde, ressort dans cette immense machine.
Il en est de même dans l’ordre physique. Un vent qui souffle du fond de l’Afrique & des mers australes, amène une partie de l’atmosphère africaine, qui retombe en pluie dans les vallées des Alpes ; ces pluies fécondent nos terres ; notre vent du nord à son tour envoie nos [I-155] vapeurs chez les nègres ; nous faisons du bien à la Guinée, & la Guinée nous en fait. La chaîne s’étend d’un bout de l’univers à l’autre.
Mais il me semble qu’on abuse étrangement de la vérité de ce principe. On en conclut qu’il n’y a si petit atôme dont le mouvement n’ait influé dans l’arrangement actuel du monde entier ; qu’il n’y a si petit accident, soit parmi les hommes, soit parmi les animaux, qui ne soit un chaînon essentiel de la grande chaîne du destin.
Entendons-nous : tout effet a évidemment sa cause, à remonter de cause en cause dans l’abîme de l’éternité ; mais toute cause n’a pas son effet, à descendre jusqu’à la fin des siècles. Tous les événements sont produits les uns par les autres, je l’avoue ; si le passé est accouché du présent, le présent accouche du futur ; tout a des pères, mais tout n’a pas toûjours des enfans. Il en est ici précisément comme d’un arbre généalogique ; chaque maison remonte, comme on sait, à Adam, mais dans la famille il y a bien des gens qui sont morts sans laisser de postérité.
Il y a un arbre généalogique des événemens de ce monde. Il est incontestable que les habitans des Gaules & de l’Espagne descendent de Gomer ; & les Russes de Magog son frère cadet : on trouve cette généalogie dans tant de gros livres ! sur ce pied-là, on ne peut nier que nous ne devions à Magog les soixante mille Russes qui sont aujourd’hui en armes devers [I-156] la Poméranie, & les soixante mille Français qui sont vers Francfort ; mais que Magog ait craché à droite ou à gauche, auprès du mont Caucase, & qu’il ait fait deux ronds dans un puits ou trois, qu’il ait dormi sur le côté gauche ou sur le côté droit ; je ne vois pas que cela ait influé beaucoup sur la résolution prise par l’impératrice de Russie Élizabeth, d’envoyer une armée au secours de l’impératrice des Romains Marie-Thérèse. Que mon chien rêve ou ne rêve pas en dormant, je n’aperçois pas le rapport que cette importante affaire peut avoir avec celle du grand Mogol.
Il faut songer que tout n’est pas plein dans la nature, & que tout mouvement ne se communique pas de proche en proche, jusqu’à faire le tour du monde. Jetez dans l’eau un corps de pareille densité, vous calculez aisément qu’au bout de quelque tems le mouvement de ce corps, & celui qu’il a communiqué à l’eau, sont anéantis ; le mouvement se perd & se répare ; donc le mouvement que put produire Magog en crachant dans un puits, ne peut avoir influé sur ce qui se passe aujourd’hui en Russie & en Prusse. Donc, les événements présents ne sont pas les enfans de tous les événements passés ; ils ont leurs lignes directes ; mais mille petites lignes collatérales ne leur servent à rien. Encore une fois, tout être a son père, mais tout être n’a pas des enfans : nous en dirons peut être davantage quand nous parlerons de la destinée.
[I-157]
DE LA CHINE.↩
Nous allons chercher à la Chine de la terre, comme si nous n’en avions point ; des étoffes, comme si nous manquions d’étoffes ; une petite herbe pour infuser dans de l’eau, comme si nous n’avions point de simples dans nos climats. En récompense, nous voulons convertir les Chinois, c’est un zèle très louable, mais il ne faut pas leur contester leur antiquité, & leur dire qu’ils sont des idolâtres. Trouverait-on bon, en vérité, qu’un capucin ayant été bien reçu dans un château des Montmorency, voulût leur persuader qu’ils sont nouveaux nobles, comme les secrétaires du roi, & les accuser d’être idolâtres, parce qu’il aurait trouvé dans ce château deux ou trois statues de connétables, pour lesquelles on aurait un profond respect ?
Le célèbre Wolf, professeur de mathématique dans l’université de Halle, prononça un jour un très bon discours, à la louange de la philosophie chinoise ; il loüa cette ancienne espèce d’hommes, qui diffère de nous par la barbe, par les yeux, par le nez, par les oreilles & par le raisonnement ; il loua, dis-je, les Chinois d’adorer un Dieu suprême, & d’aimer la vertu ; il rendait cette justice aux Empereurs de la Chine, aux Kolao, aux tribunaux, aux lettrés. La justice qu’on rend aux bonzes est d’une espèce différente.
Il faut savoir que ce Wolf attirait à Halle [I-158] un millier d’écoliers de toutes les nations. Il y avait dans la même université un professeur de théologie nommé Lange, qui n’attirait personne ; cet homme au désespoir de geler de froid seul dans son auditoire, voulut, comme de raison, perdre le professeur de mathématiques ; il ne manqua pas, selon la coutume de ses semblables, de l’accuser de ne pas croire en Dieu.
Quelques écrivains d’Europe, qui n’avaient jamais été à la Chine, avaient prétendu que le gouvernement de Pékin était athée. Wolf avait loué les philosophes de Pékin, donc Wolf était athée ; l’envie & la haine ne font jamais de meilleurs syllogismes. Cet argument de Lange, soutenu d’une cabale & d’un protecteur, fut trouvé concluant par le roi du pays, qui envoya un dilemme en forme au mathématicien ; ce dilemme lui donnait le choix de sortir de Halle dans vingt-quatre heures, ou d’être pendu. Et comme Wolf raisonnait fort juste, il ne manqua pas de partir ; sa retraite ôta au Roi deux ou trois cent mille écus par an, que ce philosophe faisait entrer dans le royaume, par l’affluence de ses disciples.
Cet exemple doit faire sentir aux Souverains qu’il ne faut pas toûjours écouter la calomnie, & sacrifier un grand homme à la fureur d’un sot. Revenons à la Chine.
De quoi nous avisons-nous, nous autres au bout de l’Occident, de disputer avec acharnement & avec des torrents d’injures, pour savoir s’il y avait eu quatorze princes, ou [I-159] non, avant Fohi empereur de la Chine, & si ce Fohi vivait trois mille, ou deux mille neuf cents ans avant notre ère vulgaire ? Je voudrais bien que deux Irlandais s’avisassent de se quereller à Dublin pour savoir quel fut au douzième siècle le possesseur des terres que j’occupe aujourd’hui ; n’est-il pas évident qu’ils devraient s’en rapporter à moi qui ai les archives entre mes mains ? Il en est de même à mon gré des premiers empereurs de la Chine ; il faut s’en rapporter aux tribunaux du pays.
Disputez tant qu’il vous plaira sur les quatorze princes qui régnèrent avant Fohi, votre belle dispute n’aboutira qu’à prouver que la Chine était très peuplée alors, & que les loix y régnaient. Maintenant, je vous demande si une nation assemblée, qui a des loix & des princes, ne suppose pas une prodigieuse antiquité ? Songez combien de tems il faut pour qu’un concours singulier de circonstances fasse trouver le fer dans les mines, pour qu’on l’emploie à l’agriculture, pour qu’on invente la navette & tous les autres arts.
Ceux qui font les enfans à coup de plume, ont imaginé un fort plaisant calcul. Le jésuite Pétau, par une belle supputation, donne à la terre 285 ans après le déluge, cent fois plus d’habitans qu’on n’ose lui en supposer à présent. Les Cumberlands & les Whistons ont fait des calculs aussi comiques ; ces bonnes gens n’avaient qu’à consulter les registres de nos colonies en Amérique, ils auraient été bien étonnés, ils auraient appris combien peu le genre [I-160] humain se multiplie, & qu’il diminue très souvent, au lieu d’augmenter.
Laissons donc, nous qui sommes d’hier, nous descendans des Celtes, qui venons de défricher les forêts de nos contrées sauvages, laissons les Chinois & les Indiens jouïr en paix de leur beau climat, & de leur antiquité. Cessons surtout d’appeler idolâtres l’Empereur de la Chine, & le Soubab de Dékan ; il ne faut pas être fanatique du mérite chinois ; la constitution de leur Empire est à la vérité la meilleure qui soit au monde, la seule qui soit toute fondée sur le pouvoir paternel (ce qui n’empêche pas que les mandarins ne donnent force coups de bâtons à leurs enfans) ; la seule dans laquelle un gouverneur de province soit puni, quand en sortant de charge il n’a pas eu les acclamations du peuple ; la seule qui ait institué des prix pour la vertu, tandis que partout ailleurs les loix se bornent à punir le crime ; la seule qui ait fait adopter ses loix à ses vainqueurs, tandis que nous sommes encor sujets aux coutumes des Burgundiens, des Francs & des Goths qui nous ont domptés. Mais on doit avoüer que le petit peuple gouverné par des bonzes, est aussi fripon que le nôtre, qu’on y vend tout fort cher aux étrangers, ainsi que chez nous ; que dans les sciences, les Chinois sont encor au terme où nous étions il y a deux cents ans ; qu’ils ont comme nous mille préjugés ridicules, qu’ils croient aux talismans, à l’astrologie judiciaire, comme nous y avons cru longtems.
[I-161]
Avoüons encor qu’ils ont été étonnés de notre thermomètre, de notre manière de mettre des liqueurs à la glace avec du salpêtre, & de toutes les expériences de Torricelli, & d’Otogueric, tout comme nous le fûmes lorsque nous vîmes ces amusements de physique pour la première fois ; ajoutons que leurs médecins ne guérissent pas plus les maladies mortelles, que les nôtres, & que la nature toute seule guérit à la Chine les petites maladies comme ici ; mais tout cela n’empêche pas que les Chinois il y a quatre mille ans, lorsque nous ne savions pas lire, ne sussent toutes les choses essentiellement utiles dont nous nous vantons aujourd’hui.
La religion des lettrés encor une fois est admirable. Point de superstitions, point de légendes absurdes, point de ces dogmes qui insultent à la raison & à la nature, & auxquels des bonzes donnent mille sens différens, parce qu’ils n’en ont aucun. Le culte le plus simple leur a paru le meilleur depuis plus de quarante siècles. Ils sont ce que nous pensons qu’étaient Seth, Hénoc & Noé ; ils se contentent d’adorer un Dieu avec tous les sages de la terre, tandis qu’en Europe on se partage entre Thomas & Bonaventure, entre Calvin & Luther, entre Jansenius & Molina.
[I-162]
CHRISTIANISME.↩
Recherches historiques sur le christianisme
Plusieurs savants ont marqué leur surprise de ne trouver dans l’historien Joseph aucune trace de Jésus-Christ, car tous les vrais savants conviennent aujourd’hui, que le petit passage où il en est question dans son Histoire, est interpolé [[15]]. Le père de Flavien Joseph avait dû cependant être un des témoins de tous les miracles de Jésus. Joseph était de race sacerdotale, parent de la reine Mariamne, femme d’Hérode ; il entre dans les plus grands détails sur toutes les actions de ce prince ; cependant, il ne dit pas un mot ni de la vie ni de la mort de Jésus, & cet historien qui ne dissimule aucune des cruautés d’Hérode, ne parle point du massacre de tous les enfans, ordonné par lui, en conséquence de la nouvelle à lui parvenüe, qu’il était né un roi des Juifs. Le calendrier Grec compte quatorze mille enfans égorgés dans cette occasion.
C’est de toutes les actions de tous les tyrans [I-163] la plus horrible. Il n’y en a point d’exemple dans l’histoire du monde entier.
Cependant, le meilleur écrivain qu’aient jamais eu les Juifs, le seul estimé des Romains & des Grecs, ne fait nulle mention de cet événement aussi singulier qu’épouvantable. Il ne parle point de la nouvelle étoile qui avait paru en Orient après la naissance du Sauveur ; phénomène éclatant, qui ne devait pas échapper à la connaissance d’un historien aussi éclairé que l’était Joseph. Il garde encor le silence sur les ténèbres qui couvrirent toute la terre, en plein midi, pendant trois heures, à la mort du Sauveur, sur la grande quantité des tombeaux qui s’ouvrirent dans ce moment, & sur la foule des justes qui ressuscitèrent.
Les savants ne cessent de témoigner leur surprise de voir qu’aucun historien Romain n’a parlé de ces prodiges, arrivés sous l’Empire de Tibère, sous les yeux d’un gouverneur Romain, & d’une garnison Romaine, qui devait avoir envoyé à l’Empereur & au Sénat, un détail circonstancié du plus miraculeux événement dont les hommes aient jamais entendu parler. Rome elle-même devait avoir été plongée pendant trois heures dans d’épaisses ténèbres ; ce prodige devait avoir [I-164] été marqué dans les fastes de Rome, & dans ceux de toutes les nations. Dieu n’a pas voulu que ces choses divines aient été écrites par des mains profânes.
Les mêmes savans trouvent encor quelques difficultés dans l’histoire des Évangiles. Ils remarquent que dans St. Matthieu, Jésus-Christ dit aux scribes & aux pharisiens, que tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, doit retomber sur eux, depuis le sang d’Abel le juste, jusqu’à Zacharie, fils de Barac, qu’ils ont tué entre le temple & l’autel.
Il n’y a point, disent-ils, dans l’histoire des Hébreux, de Zacharie tué dans le temple avant la venüe du Messie, ni de son tems : mais on trouve dans l’histoire du siège de Jérusalem par Joseph, un Zacharie fils de Barac, tué au milieu du temple, par la faction des Zélotes. C’est au chap. 19 du livre 4. De là ils soupçonnent que l’Évangile selon St. Matthieu a été écrit après la prise de Jérusalem par Titus. Mais tous les doutes, & toutes les objections de cette espèce, s’évanouïssent, dès qu’on considère la différence infinie qui doit être entre les livres divinement inspirés, & les livres des hommes. Dieu voulut envelopper d’un nuage aussi respectable qu’obscur sa naissance, sa vie & sa mort. Ses voies sont en tout différentes des nôtres.
Les savans se sont aussi fort tourmentés sur la différence des deux généalogies de Jésus-Christ. St. Matthieu donne pour père à Joseph, Jacob ; à Jacob, Matan ; à Matan, Éléazar. St. [I-165] Luc au contraire dit que Joseph était fils d’Héli, Héli de Matat, Matat de Lévi, Lévi de Melchi &c. Ils ne veulent pas concilier les cinquante-six ancêtres que Luc donne à Jésus depuis Abraham, avec les quarante-deux ancêtres différens que Matthieu lui donne depuis le même Abraham. Et ils sont effarouchés que Matthieu en parlant de quarante-deux générations, n’en rapporte pourtant que quarante & une.
Ils forment encor des difficultés sur ce que Jésus n’est point fils de Joseph, mais de Marie. Ils élèvent aussi quelques doutes sur les miracles de notre Sauveur, en citant St. Augustin, St. Hilaire, & d’autres qui ont donné aux récits de ces miracles un sens mystique, un sens allégorique : comme au figuier maudit & séché pour n’avoir pas porté de figues quand ce n’était pas le tems des figues ; aux démons envoyés dans les corps des cochons, dans un pays où l’on ne nourrissait point de cochons ; à l’eau changée en vin sur la fin d’un repas où les convives étaient déjà échauffés. Mais toutes ces critiques des savants sont confondues par la foi, qui n’en devient que plus pure. Le but de cet article est uniquement de suivre le fil historique, & de donner une idée précise des faits sur lesquels personne ne dispute.
Premièrement, Jésus nâquit sous la loi Mosaïque ; il fut circoncis suivant cette loi, il en accomplit tous les préceptes, il en célébra toutes les fêtes, & il ne prêcha que la morale ; il ne révéla point le mystère de son [I-166] incarnation ; il ne dit jamais aux Juifs qu’il était né d’une vierge ; il reçut la bénédiction de Jean dans l’eau du Jourdain, cérémonie à laquelle plusieurs Juifs se soumettaient, mais il ne baptisa jamais personne ; il ne parla point des sept sacremens ; il n’institua point de hiérarchie ecclésiastique de son vivant. Il cacha à ses contemporains qu’il était fils de Dieu, éternellement engendré, consubstantiel à Dieu, & que le Saint-Esprit procédait du Père & du Fils. Il ne dit point que sa personne était composée de deux natures, & de deux volontés ; il voulut que ces grands mystères fussent annoncés aux hommes dans la suite des tems, par ceux qui seraient éclairés des lumières du St. Esprit. Tant qu’il vécut il ne s’écarta en rien de la loi de ses pères ; il ne montra aux hommes qu’un juste agréable à Dieu, persécuté par ses envieux, & condamné à la mort par des magistrats prévenus. Il voulut que sa sainte Église établie par lui fît tout le reste.
Joseph, au chap. XII. de son histoire, parle d’une secte de Juifs rigoristes, nouvellement établie par un nommé Judas Galiléen. Ils méprisent, dit-il, les maux de la terre ; ils triomphent des tourmens par leur constance ; ils préfèrent la mort à la vie lorsque le sujet en est honorable. Ils ont souffert le fer & le feu, & vu briser leurs os, plutôt que de prononcer la moindre parole contre leur législateur, ni manger des viandes défenduës.
Il paraît que ce portrait tombe sur les Judaïtes, & non pas sur les Esséniens. Car voici [I-167] les paroles de Joseph. Judas fut l’auteur d’une nouvelle secte, entièrement différente des trois autres, c’est-à-dire des Saducéens, des Pharisiens & des Esséniens. Il continuë & dit ; Ils sont Juifs de nation ; ils vivent unis entre eux, & regardent la volupté comme un vice ; le sens naturel de cette phrase fait voir que c’est des Judaïtes dont l’auteur parle.
Quoi qu’il en soit, on connut ces Judaïtes avant que les disciples du Christ commençassent à faire un parti considérable dans le monde.
Les Thérapeutes étaient une société différente des Esséniens & des Judaïtes ; ils ressemblaient aux Gymnosophistes des Indes, & aux Brames. Ils ont, dit Philon, un mouvement d’amour céleste, qui les jette dans l’enthousiasme des Bacchantes & des Coribantes, & qui les met dans l’état de la contemplation à laquelle ils aspirent. Cette secte naquit dans Alexandrie qui était toute remplie de Juifs ; & s’étendit beaucoup dans l’Égypte.
Les disciples de Jean-Batiste s’étendirent aussi un peu en Égypte, mais principalement dans la Syrie & dans l’Arabie ; il y en eut aussi dans l’Asie mineure. Il est dit dans les Actes des apôtres (ch. 19) que Paul en rencontra plusieurs à Éphèse ; il leur dit, Avez-vous reçu le St. Esprit ? Ils lui répondirent, Nous n’avons pas seulement ouï dire qu’il y ait un St. Esprit. Il leur dit, Quel batême avez-vous donc reçu ? Ils lui répondirent, Le batême de Jean.
Il y avait dans les premières années qui suivirent la mort de Jésus, sept sociétés ou [I-168] sectes chez les Juifs, les Pharisiens, les Saducéens, les Esséniens, les Judaïtes, les Thérapeutes, les disciples de Jean, & les disciples de Christ, dont Dieu conduisait le petit troupeau dans des sentiers inconnus à la sagesse humaine.
Celui qui contribua le plus à fortifier cette société naissante, fut ce Paul même qui l’avait persécutée avec le plus de cruauté. Il était né à Tarsis en Cilicie, & fut élevé par le fameux docteur Pharisien Gamaliel disciple de Hillel. Les Juifs prétendent qu’il rompit avec Gamaliel, qui refusa de lui donner sa fille en mariage. On voit quelques traces de cette anecdote à la suite des Actes de Ste. Thècle. Ces actes portent qu’il avait le front large, la tête chauve, les sourcils joints, le nez aquilin, la taille courte & grosse, & les jambes torses. Lucien dans son Dialogue de Philopatris en fait un portrait assez semblable. On doute beaucoup qu’il fût citoyen romain, car en ce tems-là on n’accordait ce titre à aucun Juif ; ils avaient été chassés de Rome par Tibère : & Tarsis ne fut colonie romaine que près de cent ans après sous Caracalla, comme le remarque Cellarius dans sa Géographie, livre 3, & Grotius dans ses commentaires sur les actes.
Les fidèles eurent le nom de chrétiens dans Antioche, vers l’année soixante de notre ère vulgaire ; mais ils furent connus dans l’empire romain, comme nous le verrons dans la suite, sous d’autres noms. Ils ne se distinguaient [I-169] auparavant que par le nom de frères, de saints ou de fidèles. Dieu qui était descendu sur la terre pour y être un exemple d’humilité & de pauvreté, donnait ainsi à son Église les plus faibles commencemens, & la dirigeait dans ce même état d’humiliation, dans lequel il avait voulu naître. Tous les premiers fidèles furent des hommes obscurs, ils travaillent tous de leurs mains. L’apôtre Paul témoigne qu’il gagnait sa vie à faire des tentes. St. Pierre ressuscita la couturière Dorcas qui faisait les robes des frères. L’assemblée des fidèles se tenait à Joppé, dans la maison d’un corroyeur nommé Simon, comme on le voit au chap. 9 des Actes des apôtres.
Les fidèles se répandirent secrètement en Grèce, & quelques-uns allèrent de là à Rome, parmi les Juifs à qui les Romains permettaient une synagogue. Ils ne se séparèrent point d’abord des Juifs ; ils gardèrent la circoncision ; & comme on l’a déjà remarqué ailleurs, les quinze premiers évêques de Jérusalem furent tous circoncis.
Lorsque l’apôtre Paul prit avec lui Timothée qui était fils d’un père Gentil, il le circoncit lui-même dans la petite ville de Listre. Mais Tite son autre disciple, ne voulut point se soumettre à la circoncision. Les frères disciples de Jésus furent unis aux Juifs, jusqu’au tems où Paul essuya une persécution à Jérusalem, pour avoir amené des étrangers dans le temple. Il était accusé par les Juifs de vouloir détruire la loi Mosaïque par Jésus-Christ. C’est pour se [I-170] laver de cette accusation que l’apôtre Jaques proposa à l’apôtre Paul de se faire raser la tête, & de s’aller purifier dans le temple avec quatre Juifs qui avaient fait vœu de se raser, Prenez-les avec vous, lui dit Jaques (chap. 21, Actes des apôt.) purifiez-vous avec eux, & que tout le monde sache que ce que l’on dit de vous est faux, & que vous continuez à garder la loi de Moïse. Ainsi donc Paul qui d’abord avait été le persécuteur sanguinaire de la société établie par Jésus, Paul qui depuis voulut gouverner cette société naissante ; Paul chrétien judaïse afin que le monde sache qu’on le calomnie quand on dit qu’il est chrétien. Paul fait ce qui passe aujourd’hui pour un crime abominable, un crime qu’on punit par le feu en Espagne, en Portugal, en Italie ; & il le fait à la persuasion de l’apôtre Jaques ; & il le fait, après avoir reçu le St. Esprit, c’est-à-dire, après avoir été instruit par Dieu même, qu’il faut renoncer à tous ces rites judaïques autrefois institués par Dieu même.
Paul n’en fut pas moins accusé d’impiété & d’hérésie, & son procès criminel dura longtems ; mais on voit évidemment par les accusations mêmes intentées contre lui, qu’il était venu à Jérusalem pour observer les rites judaïques.
Il dit à Festus ces propres paroles (chap. 25 des Actes :) Je n’ai péché ni contre la loi juive, ni contre le temple.
Les apôtres annonçaient Jésus-Christ comme Juif, observateur de la loi juive, envoyé de Dieu pour la faire observer.
[I-171]
La circoncision est utile, dit l’apôtre Paul, (ch. 2. Épît. aux Romains) si vous observez la loi ; mais si vous la violez votre circoncision devient prépuce. Si un incirconcis garde la loi, il sera comme circoncis. Le vrai Juif est celui qui est Juif intérieurement.
Quand cet apôtre parle de Jésus-Christ dans ses épîtres, il ne révèle point le mystère ineffable de sa consubstantialité avec Dieu ; nous sommes délivrés par lui (dit-il, chap. 5, Épît. aux Romains) de la colère de Dieu, le don de Dieu s’est répandu sur nous, par la grace donnée à un seul homme qui est Jésus-Christ… La mort a régné par le péché d’un seul homme, les justes régneront dans la vie par un seul homme qui est Jésus-Christ.
Et au chap. 8, Nous les héritiers de Dieu, & les cohéritiers de Christ. Et au chap. 16. À Dieu, qui est le seul sage, honneur & gloire par Jésus-Christ… Vous êtes à Jésus-Christ, & Jésus-Christ à Dieu. (1e aux Corinthiens, chap. 3)
Et, (1e aux Corinthiens chap. 15, vs. 27) Tout lui est assujetti, en exceptant sans doute Dieu qui lui a assujetti toutes choses.
On a eu quelque peine à expliquer le passage de l’épître aux Philippiens ; Ne faites rien par une vaine gloire ; croyez mutuellement par humilité que les autres vous sont supérieurs, ayez les mêmes sentimens que Christ Jésus, qui étant dans l’empreinte de Dieu n’a point crû sa proye de s’égaler à Dieu. Ce passage paraît très bien approfondi, & mis dans tout son jour, dans une lettre qui nous reste des églises de Vienne & [I-172] de Lyon, écrite l’an 117, & qui est un précieux monument de l’antiquité. On loüe dans cette lettre la modestie de quelques fidèles : Ils n’ont pas voulu, dit la lettre, prendre le grand titre de martyrs, (pour quelques tribulations) à l’exemple de Jésus-Christ, lequel étant empreint de Dieu, n’a pas cru sa proye la qualité d’égal à Dieu. Origène dit aussi dans son Commentaire sur Jean ; La grandeur de Jésus a plus éclaté quand il s’est humilié, que s’il eût fait sa proye d’être égal à Dieu. En effet, l’explication contraire est un contresens visible. Que signifierait, Croyez les autres supérieurs à vous ; imitez Jésus qui n’a pas cru que c’était une proye, une usurpation, de s’égaler à Dieu ? Ce serait visiblement se contredire, ce serait donner un exemple de grandeur pour un exemple de modestie, ce serait pécher contre le sens commun.
La sagesse des apôtres fondait ainsi l’Église naissante. Cette sagesse ne fut point altérée par la dispute qui survint entre les apôtres Pierre, Jaques & Jean d’un côté, & Paul de l’autre. Cette contestation arriva à Antioche. L’apôtre Pierre, autrement Céphas, ou Simon Barjone, mangeait avec les gentils convertis, & n’observait point avec eux les cérémonies de la loi, ni la distinction des viandes ; il mangeait, lui, Barnabé, & d’autres disciples, indifféremment du porc, des chairs étouffées, des animaux qui avaient le pied fendu & qui ne ruminaient pas ; mais plusieurs Juifs chrétiens arrivés, St. Pierre se remit avec eux à l’abstinence des viandes défendues, & aux cérémonies de la loi Mosaïque.
[I-173]
Cette action paraissait très prudente ; il ne voulait pas scandaliser les Juifs chrétiens ses compagnons ; mais St. Paul s’éleva contre lui avec un peu de dureté. Je lui résistai, dit-il, à sa face, parce qu’il était blâmable. (Épître aux Galates chap. 2)
Cette querelle paraît d’autant plus extraordinaire de la part de St. Paul, qu’ayant été d’abord persécuteur, il devait être plus modéré, & que lui-même il était allé sacrifier dans le temple à Jérusalem, qu’il avait circoncis son disciple Timothée, qu’il avait accompli les rites juifs qu’il reprochait alors à Céphas. St. Jérôme prétend que cette querelle entre Paul & Céphas était feinte. Il dit dans sa première homélie, tom. 3, qu’ils firent comme deux avocats qui s’échauffent & se piquent au barreau, pour avoir plus d’autorité sur leurs clients ; il dit que Pierre Céphas, étant destiné à prêcher aux Juifs, & Paul aux Gentils, ils firent semblant de se quereller, Paul pour gagner les Gentils, & Pierre pour gagner les Juifs. Mais St. Augustin n’est point du tout de cet avis. Je suis fâché, dit-il dans l’Épître à Jérôme, qu’un aussi grand homme se rende le patron du mensonge, patronum mendacii.
Au reste, si Pierre était destiné aux Juifs judaïsants, & Paul aux étrangers, il est très probable que Pierre ne vint point à Rome. Les Actes des apôtres ne font aucune mention du voyage de Pierre en Italie.
Quoi qu’il en soit, ce fut vers l’an 60 de notre ère, que les chrétiens commencèrent à se [I-174] séparer de la communion Juive, & c’est ce qui leur attira tant de querelles, & tant de persécutions de la part des synagogues répandues à Rome, en Grèce, dans l’Égypte & dans l’Asie. Ils furent accusés d’impiété, d’athéïsme par leurs frères Juifs, qui les excommuniaient dans leurs synagogues trois fois les jours du sabbat. Mais Dieu les soutint toûjours au milieu des persécutions.
Petit à petit, plusieurs Églises se formèrent, & la séparation devint entière entre les Juifs & les Chrétiens, avant la fin du premier siècle ; cette séparation était ignorée du gouvernement Romain. Le sénat de Rome, ni les empereurs n’entraient point dans ces querelles d’un petit parti que Dieu avait jusque-là conduit dans l’obscurité, & qu’il élevait par des degrés insensibles.
Il faut voir dans quel état était alors la religion de l’Empire Romain. Les mystères & les expiations étaient accrédités dans presque toute la terre. Les Empereurs (il est vrai), les grands & les philosophes, n’avaient nulle foi à ces mystères ; mais le peuple, qui en fait de religion donne la loi aux grands, leur imposait la nécessité de se conformer en apparence à son culte. Il faut pour l’enchaîner paraître porter les mêmes chaînes que lui. Cicéron lui-même fut initié aux mystères d’Éleusine. La connaissance d’un seul Dieu était le principal dogme qu’on annonçait dans ces fêtes mystérieuses & magnifiques. Il faut avouer que les prières & les hymnes qui nous sont restés de [I-175] ces mystères, sont ce que le paganisme a de plus pieux & de plus admirable.
Les Chrétiens qui n’adoraient aussi qu’un seul Dieu, eurent par là plus de facilité de convertir plusieurs Gentils. Quelques philosophes de la secte de Platon devinrent chrétiens. C’est pourquoi les pères de l’Église des trois premiers siècles furent tous platoniciens.
Le zèle inconsidéré de quelques-uns ne nuisit point aux vérités fondamentales. On a reproché à St. Justin l’un des premiers Pères, d’avoir dit dans son commentaire sur Isaïe, que les saints jouïraient dans un règne de mille ans sur la terre, de tous les biens sensuels. On lui a fait un crime d’avoir dit dans son apologie du christianisme, que Dieu ayant fait la terre, en laissa le soin aux anges, lesquels étant devenus amoureux des femmes, leur firent des enfans qui sont les démons.
On a condamné Lactance & d’autres pères, pour avoir supposé des oracles des sibylles. Il prétendait que la sibylle Érytrée avait fait ces quatre vers grecs, dont voici l’explication littérale :
Avec cinq pains & deux poissons
Il nourrira cinq mille hommes au désert ;
Et en ramassant les morceaux qui resteront,
Il en remplira douze paniers.
On reprocha aussi aux premiers chrétiens la supposition de quelques vers acrostiches d’une ancienne sibylle, lesquels commençaient tous [I-176] par les lettres initiales du nom de Jésus-Christ, chacune dans leur ordre. On leur reproche d’avoir forgé des lettres de Jésus-Christ au roi d’Édesse, dans le tems qu’il n’y avait point de Roi à Édesse ; d’avoir forgé des lettres de Marie, des lettres de Sénèque à Paul, des lettres & des actes de Pilate, de faux évangiles, de faux miracles, & mille autres impostures.
Nous avons encor l’histoire ou l’Évangile de la nativité & du mariage de la Vierge Marie, où il est dit qu’on la mena au temple âgée de trois ans, & qu’elle monta les degrés toute seule. Il y est rapporté qu’une colombe descendit du ciel pour avertir que c’était Joseph qui devait épouser Marie. Nous avons le protévangile de Jaques frère de Jésus du premier mariage de Joseph. Il y est dit que quand Marie fut enceinte en l’absence de son mari, & que son mari s’en plaignit, les prêtres firent boire de l’eau de jalousie à l’un & à l’autre, & que tous deux furent déclarés innocens.
Nous avons l’Évangile de l’enfance attribué à St. Thomas. Selon cet Évangile Jésus à l’âge de cinq ans se divertissait avec des enfans de son âge à pétrir de la terre glaise dont il formait de petits oiseaux ; on l’en reprit, & alors il donna la vie aux oiseaux, qui s’envolèrent. Une autre fois un petit garçon l’ayant battu, il le fit mourir sur le champ. Nous avons encor en arabe un autre Évangile de l’enfance qui est plus sérieux.
[I-177]
Nous avons un évangile de Nicodème. Celui-là semble mériter une plus grande attention, parce qu’on y trouve les noms de ceux qui accusèrent Jésus devant Pilate ; c’étaient les principaux de la Synagogue, Anne, Caïphe, Sommas, Datam, Gamaliel, Juda, Nephtalim. Il y a dans cette histoire des choses qui se concilient assez avec les évangiles reçus, & d’autres, qui ne se voient point ailleurs. On y lit que la femme guérie d’un flux de sang s’appelait Véronique. On y voit tout ce que Jésus fit dans les enfers quand il y descendit.
Nous avons ensuite les deux lettres qu’on suppose que Pilate écrivit à Tibère touchant le supplice de Jésus ; mais le mauvais latin dans lequel elles sont écrites découvre assez leur fausseté.
On poussa le faux zèle jusqu’à faire courir plusieurs lettres de Jésus-Christ ; on a conservé la lettre qu’on dit qu’il écrivit à Abgare roi d’Édesse ; mais alors il n’y avait plus de roi d’Édesse.
On fabriqua cinquante évangiles, qui furent ensuite déclarés apocryphes. St. Luc nous apprend lui-même que beaucoup de personnes en avaient composé. On a cru qu’il y en avait un nommé l’Évangile éternel, sur ce qu’il est dit dans l’Apocalypse chap. 14. J’ai vu un ange volant au milieu des cieux, & portant l’Évangile éternel. Les cordeliers abusant de ces paroles au 13e siècle, composèrent un Évangile éternel, par lequel le règne [I-178] du St. Esprit devait être substitué à celui de Jésus-Christ ; mais il ne parut jamais dans les premiers siècles de l’Église aucun livre sous ce titre.
On supposa encor des lettres de la Vierge, écrites à Saint Ignace le martyr, aux habitans de Messine & à d’autres.
Abdias qui succéda immédiatement aux apôtres, fit leur histoire, dans laquelle il mêla des fables si absurdes que ces histoires ont été avec le tems entièrement décréditées, mais elles eurent d’abord un grand cours. C’est Abdias qui rapporte le combat de St. Pierre avec Simon le magicien. Il y avait en effet à Rome un mécanicien fort habile nommé Simon, qui non seulement faisait exécuter des vols sur les théâtres, comme on le fait aujourd’hui, mais qui lui-même renouvela le prodige attribué à Dédale ; il se fit des ailes, il vola, & il tomba comme Icare ; c’est ce que rapportent Pline & Suétone.
Abdias qui était dans l’Asie & qui écrivait en hébreu, prétend que St. Pierre & Simon se rencontrèrent à Rome du tems de Néron. Un jeune homme proche parent de l’empereur mourut ; toute la cour pria Simon de le ressusciter ; St. Pierre de son côté se présenta pour faire cette opération. Simon employa toutes les règles de son art ; il parut réussir, le mort remua la tête. Ce n’est pas assez, cria St. Pierre, il faut que le mort parle, que Simon s’éloigne du lit, & on verra si le [I-179] jeune homme est en vie : Simon s’éloigna, le mort ne remua plus, & Pierre lui rendit la vie d’un seul mot.
Simon alla se plaindre à l’empereur qu’un misérable Galiléen s’avisait de faire de plus grands prodiges que lui. Pierre comparut avec Simon, & ce fut à qui l’emporterait dans son art : Di-moi ce que je pense, cria Simon à Pierre ; Que l’empereur, répondit Pierre, me donne un pain d’orge, & tu verras si je sais ce que tu as dans l’ame. On lui donne un pain. Aussitôt Simon fait paraître deux grands dogues qui veulent le dévorer, Pierre leur jette le pain, & tandis qu’ils le mangent, Eh bien, dit-il, ne savais-je pas ce que tu pensais ? tu voulais me faire dévorer par tes chiens.
Après cette première séance, on proposa à Simon & à Pierre le combat du vol, & ce fut à qui s’élèverait le plus haut dans l’air. Simon commença, St. Pierre fit le signe de la croix, & Simon se cassa les jambes. Ce conte était imité de celui qu’on trouve dans le Sepher toldos jeschut, où il est dit que Jésus lui-même vola, & que Judas qui en voulut faire autant fut précipité.
Néron irrité que Pierre eût cassé les jambes à son favori Simon, fit crucifier Pierre la tête en bas, & c’est de là que s’établit l’opinion du séjour de Pierre à Rome, de son supplice & de son sépulcre.
C’est ce même Abdias qui établit encor la créance que St. Thomas alla prêcher le [I-180] Christianisme aux grandes Indes chez le roi Gondafer, & qu’il y alla en qualité d’architecte.
La quantité de livres de cette espèce écrits dans les premiers siècles du Christianisme est prodigieuse. St. Jérôme & St. Augustin même, prétendent que les lettres de Sénèque & de St. Paul sont très authentiques. Dans la première lettre Sénèque souhaite que son frère Paul se porte bien ; Bene te valere, frater, cupio. Paul ne parle pas tout à fait si bien latin que Sénèque ; J’ai reçu vos lettres hier, dit-il, avec joie : Litteras tuas hilaris accepi, & j’y aurais répondu aussitôt si j’avais eu la présence du jeune homme que je vous aurais envoyé, si praesentiam juvenis habuissem. Au reste, ces lettres qu’on croirait devoir être instructives, ne sont que des compliments.
Tant de mensonges forgés par des Chrétiens mal instruits & faussement zélés, ne portèrent point préjudice à la vérité du Christianisme, ils ne nuisirent point à son établissement ; au contraire, ils font voir que la société chrétienne augmentait tous les jours, & que chaque membre voulait servir à son accroissement.
Les Actes des apôtres ne disent point que les apôtres fussent convenus d’un symbole. Si effectivement ils avaient rédigé le symbole, le Credo, tel que nous l’avons, St. Luc n’aurait pas omis dans son histoire ce fondement essentiel de la religion chrétienne ; la substance du Credo est éparse dans les Évangiles, mais les articles ne furent réunis que longtems après.
Notre symbole, en un mot, est [I-181] incontestablement la créance des apôtres, mais n’est pas une pièce écrite par eux. Rufin prêtre d’Aquilée est le premier qui en parle, & une homélie attribuée à St. Augustin est le premier monument qui suppose la manière dont ce Credo fut fait. Pierre dit dans l’assemblée, Je crois en Dieu, Père tout-puissant ; André dit, & en Jésus-Christ ; Jaques ajoute, qui a été conçu du St. Esprit ; & ainsi du reste.
Cette formule s’appelait symbolos en grec, en latin Collatio. Il est seulement à remarquer que le grec porte, Je crois en Dieu Père tout-puissant, faiseur du ciel & de la terre : Pisteo eis theon patera pantokratora poieten ouranou kai ges ; le latin traduit, faiseur, formateur, par creatorem. Mais depuis au premier concile de Nicée, on mit factorem.
Le Christianisme s’établit d’abord en Grèce. Les Chrétiens y eurent à combattre une nouvelle secte de Juifs devenus philosophes à force de fréquenter les Grecs, c’était celle de la Gnose ou des Gnostiques ; il s’y mêla de nouveaux chrétiens. Toutes ces sectes jouïssaient alors d’une entière liberté de dogmatiser, de conférer & d’écrire ; mais sous Domitien la religion chrétienne commença à donner quelque ombrage au gouvernement.
Mais ce zèle de quelques chrétiens, qui n’était pas selon la science, n’empêcha pas l’Église de faire les progrès que Dieu lui destinait. Les chrétiens célébrèrent d’abord leurs mystères dans des maisons retirées, dans des caves, pendant la nuit ; de là leur vint le titre de [I-182] lucifugaces (selon Minutius Félix). Philon les appelle Gesséens. Leurs noms les plus communs, dans les quatre premiers siècles chez les Gentils, étaient ceux de Galiléens, & de Nazaréens, mais celui de Chrétiens a prévalu sur tous les autres.
Ni la hiérarchie, ni les usages ne furent établis tout d’un coup ; les tems apostoliques furent différens des tems qui les suivirent. St. Paul dans sa Ie aux Corinthiens nous apprend que les frères, soit circoncis, soit incirconcis, étant assemblés, quand plusieurs prophêtes voulaient parler, il fallait qu’il n’y en eût que deux ou trois qui parlassent, & que si quelqu’un pendant ce tems-là avait une révélation, le prophète qui avait pris la parole devait se taire.
C’est sur cet usage de l’Église primitive que se fondent encor aujourd’hui quelques communions chrétiennes, qui tiennent des assemblées sans hiérarchie. Il était permis alors à tout le monde de parler dans l’église excepté aux femmes. Il est vrai que Paul leur défend de parler dans la première aux Corinthiens ; mais il semble aussi les autoriser à prêcher, à prophétiser, dans la même épître au chapitre 11, vs. 5. Toute femme qui prie & prophétise tête nue, souille sa tête ; c’est comme si elle était rasée. Les femmes crurent donc qu’il leur était permis de parler, pourvû qu’elles fussent voilées.
Ce qui est aujourd’hui la Ste. Messe, qui se célèbre au matin, était la Cène qu’on faisait le soir ; ces usages changèrent à mesure que [I-183] l’Église se fortifia. Une société plus étendue exigea plus de règlements, & la prudence des pasteurs se conforma aux tems & aux lieux.
St. Jérôme & Eusèbe rapportent que quand les Églises reçurent une forme, on y distingua peu à peu cinq ordres différens. Les surveillants, Episcopoi, d’où sont venus les Évêques : les anciens de la société, Presbyteroi, les prêtres, les servans, ou diacres ; les Pistoi, croyants, initiés ; c’est-à-dire, les batisés, qui avaient part aux soupers des Agapes, & les Catéchumènes & Énergumènes qui attendaient le batême. Aucun, dans ces cinq ordres, ne portait d’habit différent des autres ; aucun n’était contraint au célibat, témoin le livre de Tertullien dédié à sa femme, témoin l’exemple des apôtres. Aucune représentation, soit en peinture, soit en sculpture, dans leurs assemblées, pendant les trois premiers siècles. Les Chrétiens cachaient soigneusement leurs livres aux Gentils ; ils ne les confiaient qu’aux initiés ; il n’était pas même permis aux catéchumènes de réciter l’oraison dominicale.
Ce qui distinguait le plus les Chrétiens, & ce qui a duré jusqu’à nos derniers tems, était le pouvoir de chasser les diables avec le signe de la croix. Origène dans son traité contre Celse, avouë au nombre 133. qu’Antinoüs divinisé par l’empereur Adrien faisait des miracles en Égypte par la force des charmes & des prestiges ; mais il dit que les diables sortent du corps des possédés à la prononciation du seul nom de Jésus.
[I-184]
Tertullien va plus loin, & du fond de l’Afrique où il était, il dit dans son apologétique, au chap. 23, Si vos dieux ne confessent pas qu’ils sont des diables à la présence d’un vrai chrétien, nous voulons bien que vous répandiez le sang de ce chrétien. Y a-t-il une démonstration plus claire ?
En effet, Jésus-Christ envoya ses apôtres pour chasser les démons. Les Juifs avaient aussi de son tems le don de les chasser ; car lorsque Jésus eut délivré des possédés, & eut envoyé les diables dans les corps d’un troupeau de deux mille cochons, & qu’il eut opéré d’autres guérisons pareilles, les Pharisiens dirent, il chasse les démons par la puissance de Belzébut. Si c’est par Belzébut que je les chasse, répondit Jésus, par qui vos fils les chassent-ils ? Il est incontestable que les Juifs se vantaient de ce pouvoir, ils avaient des exorcistes, & des exorcismes. On invoquait le nom du Dieu de Jacob & d’Abraham. On mettait des herbes consacrées dans le nez des démoniaques (Joseph rapporte une partie de ces cérémonies.) Ce pouvoir sur les diables, que les Juifs ont perdu, fut transmis aux Chrétiens, qui semblent aussi l’avoir perdu depuis quelque tems.
Dans le pouvoir de chasser les démons, était compris celui de détruire les opérations de la magie ; car la magie fut toûjours en vigueur chez toutes les nations. Tous les Pères de l’Église rendent témoignage à la magie. St. Justin avoüe dans son apologétique au livre 3, qu’on évoque souvent les ames des morts, & en tire un argument en faveur de l’immortalité [I-185] de l’ame. Lactance, au liv. 7 de ses institutions divines, dit, que si on osait nier l’existence des ames après la mort, le magicien vous en convaincrait bientôt en les faisant paraître. Irénée, Clément Alexandrin, Tertullien, l’évêque Cyprien, tous affirment la même chose. Il est vrai qu’aujourd’hui tout est changé, & qu’il n’y a pas plus de magiciens que de démoniaques, mais il s’en trouvera quand il plaira à Dieu.
Quand les sociétés chrétiennes devinrent un peu nombreuses, & que plusieurs s’élevèrent contre le culte de l’Empire Romain, les magistrats sévirent contre elles, & les peuples, surtout, les persécutèrent. On ne persécutait point les Juifs qui avaient des privilèges particuliers, & qui se renfermaient dans leurs synagogues ; on leur permettait l’exercice de leur religion, comme on fait encor aujourd’hui à Rome ; on souffrait tous les cultes divers répandus dans l’Empire, quoique le sénat ne les adoptât pas.
Mais les chrétiens se déclarant ennemis de tous ces cultes, & surtout de celui de l’Empire, furent exposés plusieurs fois à ces cruelles épreuves.
Un des premiers, & des plus célèbres martyrs, fut Ignace, évêque d’Antioche, condamné par l’empereur Trajan lui-même, alors en Asie, & envoyé par ses ordres à Rome, pour être exposé aux bêtes, dans un tems où l’on ne massacrait point à Rome les autres Chrétiens. On ne sait point de quoi il était [I-186] accusé auprès de cet empereur, renommé d’ailleurs pour sa clémence ; il fallait que St. Ignace eût de bien violents ennemis. Quoi qu’il en soit, l’histoire de son martyre rapporte qu’on lui trouva le nom de Jésus-Christ gravé sur le cœur, en caractères d’or ; & c’est de là que les chrétiens prirent en quelques endroits le nom de Théophores, qu’Ignace s’était donné à lui-même.
On nous a conservé une lettre de lui, par laquelle il prie les Évêques & les Chrétiens de ne point s’opposer à son martyre ; soit que dès lors les Chrétiens fussent assez puissants pour le délivrer, soit que parmi eux quelques-uns eussent assez de crédit pour obtenir sa grace. Ce qui est encor très remarquable, c’est qu’on souffrit que les Chrétiens de Rome vinssent au-devant de lui quand il fut amené dans cette capitale ; ce qui prouve évidemment qu’on punissait en lui la personne, & non pas la secte.
Les persécutions ne furent pas continuées. Origène dans son livre 3e contre Celse, dit, On peut compter facilement les chrétiens qui sont morts pour leur religion, parce qu’il en est mort peu, & seulement de tems en tems, & par intervalle.
Dieu eut un si grand soin de son Église, que malgré ses ennemis, il fit en sorte qu’elle tînt cinq conciles dans le premier siècle, seize dans le second, & trente dans le troisième ; c’est-à-dire, des assemblées tolérées. Ces assemblées furent quelquefois défendues, quand la fausse [I-187] prudence des magistrats craignit qu’elles ne devinssent tumultueuses. Il nous est resté peu de procès verbaux des Pro-consuls & des Préteurs qui condamnèrent les Chrétiens à mort. Ce serait les seuls actes sur lesquels on pût constater les accusations portées contr’eux, & leurs supplices.
Nous avons un fragment de Denys d’Alexandrie, dans lequel il rapporte l’extrait du greffe d’un pro-consul d’Égypte, sous l’empereur Valérien ; le voici.
« Denys, Fauste, Maxime, Marcel, & Cherémon, ayant été introduits à l’audience, le préfet Émilien leur a dit : Vous avez pu connaître par les entretiens que j’ai eus avec vous, & par tout ce que je vous en ai écrit, combien nos princes ont témoigné de bonté à votre égard ; je veux bien encor vous le redire : ils font dépendre votre conservation & votre salut de vous-mêmes, & votre destinée est entre vos mains : ils ne demandent de vous qu’une seule chose, que la raison exige de toute personne raisonnable, c’est que vous adoriez les dieux protecteurs de leur Empire, & que vous abandonniez cet autre culte si contraire à la nature & au bon sens.
« Denys a répondu : Chacun n’a pas les mêmes dieux, & chacun adore ceux qu’il croit l’être véritablement.
« Le préfet Émilien a repris : Je vois bien que vous êtes des ingrats, qui abusez des bontés que les empereurs ont pour vous. Eh [I-188] bien, vous ne demeurerez pas davantage dans cette ville, & je vous envoie à Cephro dans le fond de la Lybie ; ce sera là le lieu de votre bannissement, selon l’ordre que j’en ai reçu de nos Empereurs : au reste, ne pensez pas y tenir vos assemblées, ni aller faire vos prières dans ces lieux que vous nommez des cimetières, cela vous est absolument défendu, & je ne le permettrai à personne. »
Rien ne porte plus les caractères de vérité, que ce procès-verbal. On voit par là qu’il y avait des tems où les assemblées étaient prohibées. C’est ainsi que parmi nous il est défendu aux Calvinistes de s’assembler dans le Languedoc ; nous avons même quelquefois fait pendre & rouer des ministres, ou prédicants, qui tenaient des assemblées malgré les loix. C’est ainsi qu’en Angleterre & en Irlande, les assemblées sont défendues aux catholiques romains ; & il y a eu des occasions, où les délinquants ont été condamnés à la mort.
Malgré ces défenses portées par les loix Romaines, Dieu inspira à plusieurs Empereurs de l’indulgence pour les Chrétiens. Dioclétien même, qui passe chez les ignorans pour un persécuteur ; Dioclétien dont la première année de règne est encor l’époque de l’ère des martyrs, fut, pendant plus de dix-huit ans, le protecteur déclaré du Christianisme, au point que plusieurs chrétiens eurent des charges principales auprès de sa personne. Il épousa même une chrétienne, il souffrit que dans Nicomédie sa résidence, il y eût une superbe église, élevée [I-189] vis-à-vis son palais. Enfin il épousa une Chrétienne.
Le César Galérius ayant malheureusement été prévenu contre les Chrétiens, dont il croyait avoir à se plaindre, engagea Dioclétien à faire détruire la cathédrale de Nicomédie. Un Chrétien plus zélé que sage, mit en pièces l’édit de l’Empereur, & de là vint cette persécution si fameuse, dans laquelle il y eut plus de deux cents personnes condamnées à la mort, dans toute l’étendüe de l’Empire Romain, sans compter ceux que la fureur du petit peuple, toûjours fanatique, & toûjours barbare, put faire périr, contre les formes juridiques.
Il y eut en divers tems un si grand nombre de martyrs, qu’il faut bien se donner de garde d’ébranler la vérité de l’histoire de ces véritables confesseurs de notre sainte religion, par un mélange dangereux de fables, & de faux martyrs.
Le bénédictin Dom Ruinart, par exemple, homme d’ailleurs aussi instruit qu’estimable & zélé, aurait dû choisir avec plus de discrétion ses actes sincères. Ce n’est pas assez qu’un manuscrit soit tiré de l’abbaye de St. Benoît sur Loire, ou d’un couvent de célestins de Paris, conforme à un manuscrit des feuillans, pour que cet acte soit authentique ; il faut que cet acte soit ancien, écrit par des contemporains, & qu’il porte d’ailleurs tous les caractères de la vérité.
Il aurait pû se passer de rapporter l’avanture du jeune Romanus, arrivée en 303. Ce jeune [I-190] Romain avait obtenu son pardon de Dioclétien dans Antioche. Cependant, il dit que le juge Asclépiade le condamna à être brûlé. Des Juifs présens à ce spectacle, se moquèrent du jeune St. Romanus, & reprochèrent aux Chrétiens que leur Dieu les laissait brûler, lui qui avait délivré Sidrac, Misac, & Abdenago de la fournaise ; qu’aussi-tôt il s’éleva, dans le tems le plus serein, un orage qui éteignit le feu ; qu’alors le juge ordonna qu’on coupât la langue au jeune Romanus ; que le premier médecin de l’empereur se trouvant là, fit officieusement la fonction de bourreau, & lui coupa la langue dans la racine ; qu’aussi-tôt le jeune homme qui était bègue auparavant, parla avec beaucoup de liberté ; que l’empereur fut étonné que l’on parlât si bien sans langue ; que le médecin pour réitérer cette expérience coupa sur-le-champ la langue à un passant, lequel en mourut subitement.
Eusèbe, dont le bénédictin Ruinart a tiré ce conte, devait respecter assez les vrais miracles, opérés dans l’ancien & dans le nouveau testament (desquels personne ne doutera jamais) pour ne pas leur associer des histoires si suspectes, lesquelles pourraient scandaliser les faibles.
Cette dernière persécution ne s’étendit pas dans tout l’empire. Il y avait alors en Angleterre quelque christianisme, qui s’éclipsa bientôt pour reparaître ensuite sous les rois saxons. Les Gaules méridionales & l’Espagne, étaient remplies de Chrétiens. Le césar [I-191] Constance Clore les protégea beaucoup dans toutes ces provinces. Il avait une concubine, qui était chrétienne, c’est la mère de Constantin, connue sous le nom de Ste. Hélène ; car il n’y eut jamais de mariage avéré entre elle & lui, & il la renvoya même dès l’an 292, quand il épousa la fille de Maximien-Hercule ; mais elle avait conservé sur lui beaucoup d’ascendant, & lui avait inspiré une grande affection pour notre sainte religion.
La divine Providence prépara par des voies qui semblent humaines le triomphe de son Église. Constance Clore mourut en 306 à Yorck en Angleterre, dans un tems où les enfans qu’il avait de la fille d’un César étaient en bas âge, & ne pouvaient prétendre à l’Empire. Constantin eut la confiance de se faire élire à Yorck par cinq ou six mille soldats Allemands, Gaulois & Anglais pour la plupart. Il n’y avait pas d’apparence que cette élection faite sans le consentement de Rome, du Sénat, & des armées, pût prévaloir ; mais Dieu lui donna la victoire sur Maxentius élu à Rome, & le délivra enfin de tous ses collègues. On ne peut dissimuler qu’il ne se rendît d’abord indigne des faveurs du ciel, par le meurtre de tous ses proches, de sa femme & de son fils.
On peut douter de ce que Zozime rapporte à ce sujet. Il dit que Constantin agité de remords, après tant de crimes, demanda aux pontifes de l’Empire, s’il y avait quelques expiations pour lui, & qu’ils lui dirent qu’ils n’en [I-192] connaissaient pas. Il est bien vrai qu’il n’y en avait point eu pour Néron, & qu’il n’avait osé assister aux sacrés mystères en Grèce. Cependant, les Tauroboles étaient en usage ; & il est bien difficile de croire qu’un Empereur tout-puissant n’ait pu trouver un prêtre qui voulût lui accorder des sacrifices expiatoires. Peut-être même est-il encor moins croyable que Constantin occupé de la guerre, de son ambition, de ses projets, & environné de flatteurs, ait eu le tems d’avoir des remords. Zozime ajoute qu’un prêtre Égyptien arrivé d’Espagne, qui avait accès à sa porte, lui promit l’expiation de tous ses crimes dans la Religion Chrétienne. On a soupçonné que ce prêtre était Ozius évêque de Cordoue.
Quoi qu’il en soit, Constantin communia avec les Chrétiens, bien qu’il ne fût jamais que catéchumène, & réserva son batême pour le moment de sa mort. Il fit bâtir sa ville de Constantinople, qui devint le centre de l’empire & de la Religion Chrétienne. Alors l’Église prit une forme auguste.
Il est à remarquer que dès l’an 314, avant que Constantin résidât dans sa nouvelle ville, ceux qui avaient persécuté les chrétiens furent punis par eux de leurs cruautés. Les Chrétiens jetèrent la femme de Maximien dans l’Oronte ; ils égorgèrent tous ses parens ; ils massacrèrent dans l’Égypte & dans la Palestine, les magistrats qui s’étaient le plus déclarés contre le christianisme. La veuve & la fille de Dioclétien s’étant cachées à Thessalonique, furent reconnües, [I-193] et leur corps fut jeté dans la mer. Il eût été à souhaiter que les Chrétiens eussent moins écouté l’esprit de vengeance ; mais Dieu qui punit selon sa justice, voulut que les mains des Chrétiens fussent teintes du sang de leurs persécuteurs, sitôt que ces Chrétiens furent en liberté d’agir.
Constantin convoqua, assembla dans Nicée, vis-à-vis de Constantinople, le premier concile œcuménique, auquel présida Ozius. On y décida la grande question qui agitait l’Église, touchant la divinité de Jésus-Christ ; les uns se prévalaient de l’opinion d’Origène, qui dit au chap. 6 contre Celse, Nous présentons nos prières à Dieu par Jésus, qui tient le milieu entre les natures créées, & la nature incréée, qui nous apporte la grace de son père, & présente nos prières au grand Dieu en qualité de notre pontife. Ils s’appuyaient aussi sur plusieurs passages de St. Paul, dont on a rapporté quelques-uns. Ils se fondaient surtout sur ces paroles de Jésus-Christ, Mon père est plus grand que moi ; & ils regardaient Jésus comme le premier né de la création, comme la plus pure émanation de l’Être suprême, mais non pas précisément comme Dieu.
Les autres qui étaient orthodoxes, alléguaient des passages plus conformes à la divinité éternelle de Jésus, comme celui-ci : Mon père & moi, nous sommes la même chose ; paroles que les adversaires interprétaient comme signifiant ; mon père & moi avons le même dessein, la même volonté ; je n’ai point d’autres désirs que ceux de [I-194] mon père. Alexandre, évêque d’Alexandrie, & après lui Athanase, étaient à la tête des orthodoxes, & Eusèbe évêque de Nicomédie avec dix-sept autres évêques, le prêtre Arius, & plusieurs prêtres, étaient dans le parti opposé. La querelle fut d’abord envenimée, parce que St. Alexandre traita ses adversaires d’Antéchrists.
Enfin, après bien des disputes, le St. Esprit décida ainsi dans le concile, par la bouche de 299 évêques, contre dix-huit : Jésus est fils unique de Dieu, engendré du Père, c’est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, consubstantiel au Père ; nous croyons aussi au St. Esprit, &c. Ce fut la formule du Concile. On voit par cet exemple combien les évêques l’emportaient sur les simples prêtres. Deux mille personnes du second ordre étaient de l’avis d’Arius, au rapport de deux patriarches d’Alexandrie qui ont écrit la chronique d’Alexandrie en arabe. Arius fut exilé par Constantin, mais Athanase le fut aussi bientôt après, & Arius fut rappelé à Constantinople ; mais St. Macaire pria Dieu si ardemment de faire mourir Arius, avant que ce prêtre pût entrer dans la cathédrale, que Dieu exauça sa prière. Arius mourut en allant à l’église en 330. L’empereur Constantin finit sa vie en 337. Il mit son testament entre les mains d’un prêtre Arien, & mourut entre les bras du chef des Ariens Eusèbe, évêque de Nicomédie, ne s’étant fait baptiser qu’au lit de mort, & laissant l’Église triomphante, mais divisée.
[I-195]
Les partisans d’Athanase & ceux d’Eusèbe se firent une guerre cruelle ; & ce qu’on appelle l’Arianisme fut longtems établi dans toutes les provinces de l’Empire.
Julien le philosophe, surnommé l’apostat, voulut étouffer ces divisions, & ne put y parvenir.
Le second Concile général fut tenu à Constantinople en 381. On y expliqua ce que le concile de Nicée n’avait pas jugé à propos de dire sur le St. Esprit, & on ajouta à la formule de Nicée, que le St. Esprit est Seigneur vivifiant, qui procède du père, & qu’il est adoré & glorifié avec le père & le fils.
Ce ne fut que vers le neuvième siècle que l’Église latine statua par degrés que le St. Esprit procède du Père & du Fils.
En 431 le 3e concile général tenu à Éphèse décida que Marie était véritablement mère de Dieu, & que Jésus avait deux natures & une personne. Nestorius évêque de Constantinople qui voulait que la St. Vierge fût appelée mère de Christ, fut déclaré Judas par le concile, & les deux natures furent encor confirmées par le concile de Calcédoine.
Je passerai légèrement sur les siècles suivants qui sont assez connus. Malheureusement, il n’y eut aucune de ces disputes qui ne causât des guerres, & l’Église fut toûjours obligée de combattre. Dieu permit encor, pour exercer la patience des fidèles, que les Grecs & les Latins rompissent sans retour au neuvième siècle : il permit encor qu’en Occident il y eût [I-196] 29 schismes sanglants pour la chaire de Rome.
Cependant l’Église Grecque presque tout entière, & toute l’Église d’Afrique devinrent esclaves sous les Arabes, & ensuite sous les Turcs, qui élevèrent la religion Mahométane sur les ruines de la Chrétienne ; l’Église Romaine subsista, mais toûjours souillée de sang par plus de six cents ans de dîscorde, entre l’Empire d’Occident & le sacerdoce. Ces querelles mêmes la rendirent très puissante. Les évêques, les abbés en Allemagne se firent tous princes, & les Papes acquirent peu à peu la domination absolue dans Rome & dans un pays de cent lieues. Ainsi Dieu éprouva son Église par les humiliations, par les troubles, par les crimes, & par la splendeur.
Cette Église Latine perdit au seizième siècle la moitié de l’Allemagne, le Dannemarck, la Suêde, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, la meilleure partie de la Suisse, la Hollande ; elle a gagné plus de terrain en Amérique par les conquêtes des Espagnols, qu’elle n’en a perdu en Europe, mais avec plus de territoire elle a bien moins de sujets.
La Providence divine semblait destiner le Japon, Siam, l’Inde & la Chine, à se ranger sous l’obéissance du Pape, pour le récompenser de l’Asie mineure, de la Syrie, de la Grèce, de l’Égypte, de l’Afrique, de la Russie, & des autres États perdus, dont nous avons parlé. St. François Xavier qui porta le St. Évangile aux Indes orientales, & au Japon quand les Portugais y allèrent chercher des marchandises, [I-197] fit un très grand nombre de miracles, tous attestés par les RR. PP. Jésuites ; quelques-uns disent qu’il ressuscita neuf morts ; mais le R. P. Ribadeneira, dans sa fleur des saints, se borne à dire qu’il n’en ressuscita que quatre ; c’est bien assez. La Providence voulut qu’en moins de cent années il y eût des milliers de catholiques romains dans les îles du Japon. Mais le diable sema son ivraie au milieu du bon grain. Les Chrétiens formèrent une conjuration suivie d’une guerre civile, dans laquelle ils furent tous exterminés en 1638. Alors la nation ferma ses ports à tous les étrangers, excepté aux Hollandais qu’on regardait comme des marchands, & non pas comme des chrétiens, & qui furent d’abord obligés de marcher sur la croix pour obtenir la permission de vendre leurs denrées dans la prison où on les renferme lorsqu’ils abordent à Nangazaki.
La Religion Catholique, Apostolique & Romaine fut proscrite à la Chine dans nos derniers tems, mais d’une manière moins cruelle. Les RR. PP. jésuites n’avaient pas à la vérité ressuscité des morts à la Cour de Pékin, ils s’étaient contentés d’enseigner l’astronomie, de fondre du canon, & d’être mandarins. Leurs malheureuses disputes avec des Dominicains & d’autres, scandalisèrent à tel point le grand Empereur Yontchin, que ce prince qui était la justice & la bonté même, fut assez aveugle pour ne plus permettre qu’on enseignât notre sainte religion, dans laquelle nos missionnaires ne s’accordaient pas. Il les chassa avec une [I-198] bonté paternelle, leur fournissant des subsistances & des voitures jusqu’aux confins de son empire.
Toute l’Asie, toute l’Afrique, la moitié de l’Europe, tout ce qui appartient aux Anglais, aux Hollandais dans l’Amérique, toutes les hordes Américaines non domptées, toutes les terres australes, qui sont une cinquième partie du globe, sont demeurées la proye du démon, pour vérifier cette sainte parole : il y en a beaucoup d’appelés mais peu d’élus ; s’il y a environ seize cents millions d’hommes sur la terre, comme quelques doctes le prétendent, la sainte Église Romaine catholique universelle en possède à peu près soixante millions, ce qui fait plus de la vingt-sixième partie des habitans du monde connu.
LE CIEL DES ANCIENS.↩
Si un ver à soye donnait le nom de Ciel au petit duvet qui entoure sa coque, il raisonnerait aussi bien que firent tous les anciens, en donnant le nom de Ciel à l’atmosphère, qui est, comme dit très-bien M. de Fontenelle dans ses mondes, le duvet de notre coque.
Les vapeurs qui sortent de nos mers & de notre terre, & qui forment les nuages, les météores & les tonnerres, furent pris d’abord pour la demeure des dieux. Les dieux descendent toûjours dans des nuages d’or chez [I-199] Homère ; c’est de là que les peintres les peignent encor aujourd’hui assis sur une nuée ; mais comme il était bien juste que le maître des dieux fût plus à son aise que les autres, on lui donna un aigle pour le porter, parce que l’aigle vole plus haut que les autres oiseaux.
Les anciens Grecs voyant que les maîtres des villes demeuraient dans des citadelles, au haut de quelque montagne, jugèrent que les dieux pouvaient avoir une citadelle aussi, & la placèrent en Thessalie sur le mont Olimpe, dont le sommet est quelquefois caché dans les nuës, de sorte que leur palais était de plain-pied à leur ciel.
Les étoiles & les planètes qui semblent attachées à la voûte bleüe de notre atmosphère, devinrent ensuite les demeures des dieux ; sept d’entr’eux eurent chacun leur planète, les autres logèrent où ils purent ; le conseil général des dieux se tenait dans une grande salle, à laquelle on allait par la voye lactée ; car il fallait bien que les dieux eussent une salle en l’air, puisque les hommes avaient des hôtels-de-ville sur la terre.
Quand les titans, espèce d’animaux entre les dieux & les hommes, déclarèrent une guerre assez juste à ces dieux-là, pour réclamer une partie de leur héritage du côté paternel, étant fils du ciel & de la terre, ils ne mirent que deux ou trois montagnes les unes sur les autres, comptant que c’en était bien assez pour se rendre maîtres du ciel, & du château de l’Olimpe.
[I-200]
Neve foret terris securior arduus aether,
Affectasse ferunt regnum coeleste gigantes,
Altaque congestos struxisse ad sidera montes.
Cette physique d’enfans & de vieilles, était prodigieusement ancienne ; cependant il est très sûr que les Caldéens avaient des idées aussi saines que nous de ce qu’on appelle le Ciel ; ils plaçaient le soleil au centre de notre monde planétaire, à-peu-près à la distance de notre globe que nous avons reconnüe ; ils faisaient tourner la terre, & toutes les planètes autour de cet astre ; c’est ce que nous apprend Aristarque de Samos : c’est le véritable systême du monde que Copernic a renouvelé depuis ; mais les philosophes gardaient le secret pour eux, afin d’être plus respectés des rois & du peuple, ou plutôt pour n’être pas persécutés.
Le langage de l’erreur est si familier aux hommes, que nous appelons encor nos vapeurs, & l’espace de la terre à la lune, du nom de Ciel ; nous disons, monter au ciel, comme nous disons que le soleil tourne, quoiqu’on sache bien qu’il ne tourne pas ; nous sommes probablement le ciel pour les habitans de la lune, & chaque planète place son ciel dans la planète voisine.
Si on avait demandé à Homère dans quel ciel était allée l’ame de Sarpedon, & où était celle d’Hercule, Homère eût été bien embarrassé, il eût répondu par des vers harmonieux.
Quelle sûreté avait-on que l’ame aërienne d’Hercule se fût trouvée plus à son aise dans [I-201] Vénus, dans Saturne, que sur notre globe ? Aurait-elle été dans le soleil ? la place ne paraît pas tenable dans cette fournaise. Enfin, qu’entendaient les anciens par le ciel ? ils n’en savaient rien, ils criaient toûjours le ciel & la terre ; c’est comme si on criait l’infini & un atôme. Il n’y a point, à proprement parler, de ciel, il y a une quantité prodigieuse de globes qui roulent dans l’espace vide, & notre globe roule comme les autres.
Les anciens croyaient qu’aller dans les cieux c’était monter ; mais on ne monte point d’un globe à un autre ; les globes célestes sont tantôt au-dessus de notre horizon, tantôt au-dessous. Ainsi, supposons que Vénus étant venue à Paphos, retournât dans sa planète quand cette planète était couchée, la déesse Vénus ne montait point alors par rapport à notre horizon ; elle descendait, & on devait dire en ce cas descendre au ciel. Mais les anciens n’y entendaient pas tant de finesse ; ils avaient des notions vagues, incertaines, contradictoires sur tout ce qui tenait à la physique. On a fait des volumes immenses pour savoir ce qu’ils pensaient sur bien des questions de cette sorte. Quatre mots auraient suffi, ils ne pensaient pas.
Il faut toûjours en excepter un petit nombre de sages, mais ils sont venus tard ; peu ont expliqué leurs pensées, & quand ils l’ont fait, les charlatans de la terre les ont envoyés au ciel par le plus court chemin.
Un écrivain qu’on nomme, je crois, [I-202] Pluche, a prétendu faire de Moïse un grand physicien ; un autre avait auparavant concilié Moïse avec Descartes, & avait imprimé le Cartesius mozaizans ; selon lui, Moïse avait inventé le premier les tourbillons & la matière subtile ; mais on sait assez que Dieu qui fit de Moïse un grand législateur, un grand prophète, ne voulut point du tout en faire un professeur de physique ; il instruisit les Juifs de leur devoir, & ne leur enseigna pas un mot de philosophie. Calmet qui a beaucoup compilé & qui n’a raisonné jamais, parle du systême des Hébreux ; mais ce peuple grossier était bien loin d’avoir un systême ; il n’avait pas même d’école de géométrie, le nom leur en était inconnu ; leur seule science était le métier de courtier & l’usure.
On trouve dans leurs livres quelques idées louches, incohérentes, & dignes en tout d’un peuple barbare sur la structure du ciel. Leur premier ciel était l’air, le second le firmament, où étaient attachées les étoiles ; ce firmament était solide & de glace, & portait les eaux supérieures, qui s’échappèrent de ce réservoir par des portes, des écluses, des cataractes, au tems du déluge.
Au-dessus de ce firmament ou de ces eaux supérieures, était le troisième ciel ou l’empyrée, où St. Paul fut ravi. Le firmament était une espèce de demi-voûte, qui embrassait la terre. Le soleil ne faisait point le tour d’un globe qu’ils ne connaissaient pas. Quand il était parvenu à l’occident, il revenait à l’orient par un chemin inconnu ; & si on ne le voyait pas, [I-203] c’était comme le dit le Baron de Feneste, parce qu’il revenait de nuit.
Encore les Hébreux avaient-ils pris ces rêveries des autres peuples. La plupart des nations, excepté l’école des Caldéens, regardaient le ciel comme solide ; la terre fixe & immobile, était plus longue d’orient en occident que du midi au nord d’un grand tiers ; de là viennent ces expressions de longitude & de latitude que nous avons adoptées. On voit que dans cette opinion il était impossible qu’il y eût des antipodes. Aussi St. Augustin traite l’idée des antipodes d’absurdité, & Lactance dit expressément, Y a-t-il des gens assez fous pour croire qu’il y ait des hommes dont la tête soit plus basse que les pieds ? &c.
St. Chrysostome s’écrie dans sa quatorzième homélie, Où sont ceux qui prétendent que les cieux sont mobiles, & que leur forme est circulaire ?
Lactance dit encor au Liv. III. de ses institutions, Je pourrais vous prouver par beaucoup d’arguments qu’il est impossible que le ciel entoure la terre.
L’auteur du Spectacle de la nature pourra dire à M. le chevalier tant qu’il voudra, que Lactance & St. Chrysostome étaient de grands philosophes, on lui répondra qu’ils étaient de grands saints, & qu’il n’est point du tout nécessaire pour être un saint, d’être un bon astronome. On croira qu’ils sont au ciel, mais on avouera qu’on ne sait pas dans quelle partie du ciel précisément.
[I-204]
CIRCONCISION.↩
Lors qu’Hérodote raconte ce que lui ont dit les barbares chez lesquels il a voyagé, il raconte des sottises, & c’est ce que font la plûpart de nos voyageurs. Aussi n’exige-t-il pas qu’on le croie, quand il parle de l’avanture de Gigès & de Candaule, d’Arion porté sur un dauphin, & de l’oracle consulté pour savoir ce que faisait Crésus, qui répondit qu’il faisait cuire alors une tortue dans un pot couvert ; & du cheval de Darius qui ayant henni le premier de tous, déclara son maître Roi, & de cent autres fables propres à amuser des enfans & à être compilées par des rhéteurs ; mais quand il parle de ce qu’il a vû, des coutumes des peuples qu’il a examinées, de leurs antiquités, qu’il a consultées, il parle alors à des hommes.
Il semble, dit-il au livre d’Euterpe, que les habitans de la Colchide sont originaires d’Égypte, j’en juge par moi-même plutôt que par ouï-dire ; car j’ai trouvé qu’en Colchide on se souvenait bien plus des anciens Égyptiens qu’on ne se ressouvenait des anciennes coutumes de Colcos en Égypte.
Ces habitans des bords du Pont-Euxin prétendaient être une colonie établie par Sésostris ; pour moi je le conjecturais non-seulement parce qu’ils sont bazanés, & qu’ils ont les cheveux frisés, mais parce que les peuples de Colchide, d’Égypte, & d’Éthiopie, sont les seuls sur la terre qui se sont fait circoncire de tout tems, car les [I-205] Phéniciens et ceux de la Palestine avouent qu’ils ont pris la circoncision des Égyptiens. Les Syriens qui habitent aujourd’hui sur les rivages du Thermodon, & de Pathenie, & les Macrons leurs voisins, avouent qu’il n’y a pas longtems qu’ils se sont conformés à cette coutume d’Égypte ; c’est par là principalement qu’ils sont reconnus pour Égyptiens d’origine.
À l’égard de l’Éthiopie & de l’Égypte, comme cette cérémonie est très ancienne chez ces deux nations, je ne saurais dire qui des deux tient la circoncision de l’autre ; il est toutefois vraisemblable que les Éthiopiens la prirent des Égyptiens ; comme, au contraire, les Phéniciens ont aboli l’usage de circoncire les enfans nouveau-nés, depuis qu’ils ont eu plus de commerce avec les Grecs.
Il est évident, par ce passage d’Hérodote, que plusieurs peuples avaient pris la circoncision de l’Égypte ; mais aucune nation n’a jamais prétendu avoir reçu la circoncision des Juifs. À qui peut-on donc attribuer l’origine de cette coutume, ou à la nation de qui cinq ou six autres confessent la tenir, ou à une autre nation bien moins puissante, moins commerçante, moins guerrière, cachée dans un coin de l’Arabie pétrée, qui n’a jamais communiqué le moindre de ses usages à aucun peuple ?
Les Juifs disent qu’ils ont été reçus autrefois par charité dans l’Égypte ; n’est-il pas bien vraisemblable que le petit peuple a imité un usage du grand peuple, & que les Juifs ont pris quelques coutumes de leurs maîtres ?
Clément d’Alexandrie rapporte que [I-206] Pythagore voyageant chez les Égyptiens, fut obligé de se faire circoncire, pour être admis à leurs mystères ; il fallait donc absolument être circoncis pour être au nombre des prêtres d’Égypte. Ces prêtres existaient lorsque Joseph arriva en Égypte ; le gouvernement était très ancien, & les cérémonies antiques de l’Égypte observées avec la plus scrupuleuse exactitude.
Les Juifs avouent qu’ils demeurèrent pendant deux cent cinq ans en Égypte ; ils disent qu’ils ne se firent point circoncire dans cet espace de tems ; il est donc clair que pendant ces deux cent cinq ans, les Égyptiens n’ont pas reçu la circoncision des Juifs ; l’auraient-ils prise d’eux, après que les Juifs leur eurent volé tous les vases qu’on leur avait prêtés, & se furent enfuis dans le désert avec leur proie, selon leur propre témoignage ? Un maître adoptera-t-il la principale marque de la religion de son esclave voleur & fugitif ? cela n’est pas dans la nature humaine.
Il est dit dans le livre de Josué, que les Juifs furent circoncis dans le désert. Je vous ai délivrés de ce qui faisait votre opprobre chez les Égyptiens. Or, quel pouvait être cet opprobre pour des gens qui se trouvaient entre les peuples de Phénicie, les Arabes, & les Égyptiens, si ce n’est ce qui les rendait méprisables à ces trois nations ? comment leur ôte-t-on cet opprobre ? en leur ôtant un peu de prépuce ? n’est-ce pas là le sens naturel de ce passage ?
La Genèse dit qu’Abraham avait été circoncis auparavant, mais Abraham voyagea en [I-207] Égypte, qui était depuis longtems un royaume florissant, gouverné par un puissant Roi, rien n’empêche que dans ce royaume si ancien, la circoncision ne fût dès longtems en usage avant que la nation Juive fût formée. De plus, la circoncision d’Abraham n’eut point de suite ; sa postérité ne fut circoncise que du tems de Josué.
Or avant Josué, les Israëlites, de leur aveu même, prirent beaucoup de coutumes des Égyptiens ; ils les imitèrent dans plusieurs sacrifices, dans plusieurs cérémonies, comme dans les jeûnes qu’on observait les veilles des fêtes d’Isis, dans les ablutions, dans la coutume de raser la tête des prêtres : l’encens, le candélabre, le sacrifice de la vache rousse, la purification avec de l’hysope, l’abstinence du cochon, l’horreur des ustensiles de cuisine des étrangers, tout atteste que le petit peuple hébreu, malgré son aversion pour la grande nation Égyptienne, avait retenu une infinité d’usages de ses anciens maîtres. Ce bouc Hazazel qu’on envoyait dans le désert, chargé des péchés du peuple, était une imitation visible d’une pratique égyptienne, les rabbins conviennent même que le mot d’Hazazel n’est point hébreu. Rien n’empêche donc que les Hébreux aient imité les Égyptiens dans la circoncision, comme faisaient les Arabes leurs voisins.
Il n’est point extraordinaire que Dieu, qui a sanctifié le baptême si ancien chez les Asiatiques, ait sanctifié aussi la circoncision non moins ancienne chez les Africains. On a déjà [I-208] remarqué qu’il est le maître d’attacher ses graces aux signes qu’il daigne choisir.
Au reste, depuis que sous Josué, le peuple Juif eut été circoncis, il a conservé cet usage jusqu’à nos jours ; les Arabes y ont aussi toûjours été fidèles, mais les Égyptiens, qui dans les premiers tems circoncisaient les garçons & les filles, cessèrent avec le tems de faire aux filles cette opération, & enfin la restreignirent aux prêtres, aux astrologues, & aux prophètes. C’est ce que Clément d’Alexandrie & Origène nous apprennent. En effet, on ne voit point que les Ptolomées aient jamais reçu la circoncision.
Les auteurs Latins, qui traitent les Juifs avec un si profond mépris, qu’ils les appellent, Curtus Appella, par dérision, Credat Judaeus Apella, Curti Judæi, ne donnent point de ces épithètes aux Égyptiens. Tout le peuple d’Égypte est aujourd’hui circoncis, mais par une autre raison, parce que le Mahométisme adopta l’ancienne circoncision de l’Arabie.
C’est cette circoncision arabe qui a passé chez les Éthiopiens, où l’on circoncit encor les garçons & les filles.
Il faut avouer que cette cérémonie de la circoncision paraît d’abord bien étrange ; mais on doit remarquer que de tout tems les prêtres de l’Orient se consacraient à leurs divinités par des marques particulières. On gravait avec un poinçon une feuille de lierre sur les prêtres de Bacchus. Lucien nous dit que les dévots à la déesse Isis s’imprimaient des caractères sur le [I-209] poignet, & sur le cou. Les prêtres de Cibèle se rendaient eunuques.
Il y a grande apparence que les Égyptiens, qui révéraient l’instrument de la génération, & qui en portaient l’image en pompe dans leurs processions, imaginèrent d’offrir à Isis & Osiris, par qui tout s’engendrait sur la terre, une partie légère du membre par qui ces dieux avaient voulu que le genre humain se perpétuât. Les anciennes mœurs orientales sont si prodigieusement différentes des nôtres, que rien ne doit paraître extraordinaire à quiconque a un peu de lecture. Un Parisien est tout surpris quand on lui dit que les Hottentots font couper à leurs enfans mâles un testicule. Les Hottentots sont peut-être surpris que les Parisiens en gardent deux.
CONCILES.↩
Tous les conciles sont infaillibles, sans doute ; car ils sont composés d’hommes.
Il est impossible que jamais les passions, les intrigues, l’esprit de dispute, la haine, la jalousie, le préjugé, l’ignorance règnent dans ces assemblées.
Mais pourquoi, dira-t-on, tant de Conciles ont-ils été opposés les uns aux autres ? C’est pour exercer notre foi ; ils ont tous eu raison chacun dans leur tems.
On ne croit aujourd’hui, chez les [I-210] Catholiques Romains, qu’aux Conciles approuvés dans le Vatican, & on ne croit, chez les Catholiques grecs, qu’à ceux approuvés dans Constantinople. Les Protestants se moquent des uns & des autres, ainsi tout le monde doit être content.
Nous ne parlerons ici que des grands Conciles ; les petits n’en valent pas la peine.
Le premier est celui de Nicée. Il fut assemblé en 325 de l’ère vulgaire, après que Constantin eut écrit & envoyé par Ozius cette belle lettre au Clergé un peu brouillon d’Alexandrie : Vous vous querellez pour un sujet bien mince. Ces subtilités sont indignes de gens raisonnables. Il s’agissait de savoir si Jésus était créé, ou incréé. Cela ne touchait en rien la morale, qui est l’essentiel. Que Jésus ait été dans le tems, ou avant le tems, il n’en faut pas moins être homme de bien. Après beaucoup d’altercations, il fut enfin décidé que le fils était aussi ancien que le Père, & consubstantiel au Père. Cette décision ne s’entend guère ; mais elle n’en est que plus sublime. Dix-sept évêques protestent contre l’arrêt, & une ancienne chronique d’Alexandrie, conservée à Oxford, dit que deux mille prêtres protestèrent aussi ; mais les prélats ne font pas grand cas des simples prêtres, qui sont d’ordinaire pauvres. Quoiqu’il en soit, il ne fut point du tout question de la Trinité dans ce premier concile. La formule porte : Nous croyons Jésus consubstantiel au Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré & non fait ; nous croyons aussi au St. [I-211] Esprit. Le St. Esprit, il faut l’avouer, fut traité bien cavalièrement.
Il est rapporté dans le supplément du Concile de Nicée, que les Pères, étant fort embarrassés pour savoir quels étaient les livres cryphes, ou apocryphes de l’Ancien & du Nouveau Testament, les mirent tous pêle-mêle sur un autel, & les livres à rejeter tombèrent par terre. C’est dommage que cette belle recette soit perdue de nos jours.
Après le premier concile de Nicée, composé de 317 évêques infaillibles, il s’en tint un autre à Rimini, & le nombre des infaillibles fut cette fois de 400, sans compter un gros détachement à Seleucie d’environ 200. Ces six cents évêques après quatre mois de querelles, ôtèrent unanimement à Jésus sa consubstantialité. Elle lui a été rendue depuis, excepté chez les Sociniens, ainsi tout va bien.
Un des grands conciles est celui d’Éphèse en 431 ; l’évêque de Constantinople, Nestorius, grand persécuteur d’hérétiques, fut condamné lui-même, comme hérétique, pour avoir soutenu qu’à la vérité Jésus était bien Dieu, mais que sa mère n’était pas absolument mère de Dieu, mais mère de Jésus. Ce fut St. Cyrille, qui fit condamner St. Nestorius ; mais aussi les partisans de Nestorius firent déposer St. Cyrille dans le même Concile ; ce qui embarrassa fort le St. Esprit.
Remarquez ici, lecteur, bien soigneusement que l’Évangile n’a jamais dit un mot, ni de la consubstantialité du Verbe, ni de l’honneur qu’avait eu Marie d’être mère de Dieu, non [I-212] plus que des autres disputes qui ont fait assembler des Conciles infaillibles.
Eutichès était un moine, qui avait beaucoup crié contre Nestorius, dont l’hérésie n’allait pas à moins qu’à supposer deux personnes en Jésus ; ce qui est épouvantable. Le moine, pour mieux contredire son adversaire, assure que Jésus n’avait qu’une nature. Un Flavien évêque de Constantinople, lui soutint qu’il fallait absolument qu’il y eût deux natures en Jésus. On assemble un Concile nombreux à Éphèse, en 449 ; celui-là se tint à coups de bâtons, comme le petit Concile de Cirthe en 355, & certaine conférence à Carthage. La nature de Flavien fut moulue de coups, & deux natures furent assignées à Jésus. Au Concile de Calcedoine en 451, Jésus fut réduit à une nature.
Je passe des Conciles tenus pour des minuties, & je viens au sixième Concile général de Constantinople, assemblé pour savoir au juste si Jésus n’ayant qu’une nature, avait deux volontés. On sent combien cela est important pour plaire à Dieu.
Ce Concile fut convoqué par Constantin le barbu, comme tous les autres l’avaient été par les Empereurs précédents, les légats de l’Évêque de Rome eurent la gauche. Les Patriarches de Constantinople & d’Antioche eurent la droite. Je ne sais si les Caudataires à Rome, prétendent que la gauche est la place d’honneur. Quoi qu’il en soit, Jésus, de cette affaire-là obtint deux volontés.
[I-213]
La loi Mosaïque avait défendu les images. Les peintres, & les sculpteurs n’avaient pas fait fortune chez les Juifs. On ne voit pas que Jésus ait jamais eu de tableaux, excepté peut-être celui de Marie, peinte par Luc. Mais enfin Jésus-Christ ne recommande nulle part qu’on adore les images. Les Chrétiens les adorèrent pourtant vers la fin du quatrième siècle, quand ils se furent familiarisés avec les beaux-arts. L’abus fut porté si loin au huitième siècle, que Constantin Copronyme assembla à Constantinople un Concile de trois cent vingt évêques, qui anathématisa le culte des images, & qui le traita d’idolâtrie.
L’impératrice Irène, la même, qui depuis fit arracher les yeux à son fils, convoqua le second Concile de Nicée en 787 : l’adoration des images y fut rétablie. On veut aujourd’hui justifier ce Concile, en disant que cette adoration était un culte de dulie, & non pas de latrie.
Mais soit de latrie, soit de dulie, Charlemagne en 794 fit tenir à Francfort un autre Concile, qui traita le second de Nicée d’idolâtrie. Le pape Adrien I. y envoya deux légats, & ne le convoqua pas.
Le premier grand Concile, convoqué par un pape, fut le premier de Latran en 1139 ; il y eut environ mille évêques, mais on n’y fit presque rien, sinon qu’on anathématisa ceux qui disaient que l’Église était trop riche.
Autre Concile de Latran en 1179, tenu par le pape Alexandre III, où les Cardinaux, pour [I-214] la première fois, prirent le pas sur les Évêques ; il ne fut question que de discipline.
Autre grand Concile de Latran en 1215. Le pape Innocent III. y dépouilla le Comte de Toulouse de tous ses biens, en vertu de l’excommunication. C’est le premier Concile, qui ait parlé de transsubstantiation.
En 1245, Concile général de Lyon, ville alors Impériale, dans laquelle le Pape Innocent IV. excommunia l’Empereur Frédéric II. & par conséquent le déposa & lui interdit le feu & l’eau : c’est dans ce Concile qu’on donna aux Cardinaux un chapeau rouge, pour les faire souvenir qu’il faut se baigner dans le sang des partisans de l’Empereur. Ce Concile fut la cause de la destruction de la maison de Suabe, & de trente ans d’anarchie dans l’Italie & dans l’Allemagne.
Concile général à Vienne en Dauphiné en 1311, où l’on abolit l’ordre des Templiers, dont les principaux membres avaient été condamnés au plus horrible supplice, sur les accusations les moins prouvées.
En 1414, le grand Concile de Constance, où l’on se contenta de démettre le pape Jean XXIII. convaincu de mille crimes ; & où on brûla Jean Hus, & Jérôme de Prague, pour avoir été opiniâtres, attendu que l’opiniâtreté est un bien plus grand crime, que le meurtre, le rapt, la simonie, & la sodomie.
En 1430, le grand Concile de Bâle, non reconnu à Rome, parce qu’on y déposa le pape Eugène IV. qui ne se laissa point déposer.
[I-215]
Les Romains comptent pour concile général le cinquième Concile de Latran en 1512, convoqué contre Louïs XII roi de France, par le pape Jules II ; mais ce Pape guerrier étant mort, ce Concile s’en alla en fumée.
Enfin nous avons le grand Concile de Trente, qui n’est pas reçu en France pour la discipline : mais le dogme en est incontestable, puisque le St. Esprit arrivait de Rome à Trente, toutes les semaines dans la malle du courrier, à ce que dit Fra-Paolo Sarpi ; mais Fra-Paolo Sarpi sentait un peu l’hérésie.
CONFESSION.↩
C’est encor un problème si la confession, à ne la considérer qu’en politique, a fait plus de bien que de mal. On se confessait dans les mystères d’Isis, d’Orphée & de Cérès, devant l’Hiérophante & les initiés ; car puisque ces mystères étaient des expiations, il fallait bien avoüer qu’on avait des crimes à expier. Les Chrétiens adoptèrent la confession dans les premiers siècles de l’Église, ainsi qu’ils prirent à peu près les rites de l’antiquité, comme les temples, les autels, l’encens, les cierges, les processions, l’eau lustrale, les habits sacerdotaux, plusieurs formules des mystères ; le sursum corda, l’ite missa est, & tant d’autres. Le scandale de la confession [I-216] publique d’une femme arrivé à Constantinople au quatrième siècle, fit abolir la confession.
La confession secrète qu’un homme fait à un autre homme, ne fut admise dans notre Occident que vers le septième siècle. Les Abbés commencèrent par exiger que leurs moines vinssent deux fois par an leur avouer toutes leurs fautes. Ce furent ces Abbés qui inventèrent cette formule, je t’absous autant que je le peux & que tu en as besoin. Il semble qu’il eût été plus respectueux pour l’Être suprême, & plus juste, de dire, Puisse-t-il pardonner à tes fautes & aux miennes !
Le bien que la confession a fait, est d’avoir quelquefois obtenu des restitutions des petits voleurs. Le mal est d’avoir quelquefois dans les troubles des États forcé les pénitens à être rebelles & sanguinaires en conscience. Les prêtres Guelfes refusaient l’absolution aux Gibelins, & les prêtres Gibelins se gardaient bien d’absoudre les Guelfes. Les assassins des Sforces, des Médicis, des Princes d’Orange, des Rois de France, se préparèrent aux parricides par le sacrement de la confession.
Louis XI., la Brinvilliers se confessaient dès qu’ils avaient commis un grand crime, & se confessaient souvent comme les gourmands prennent médecine, pour avoir plus d’appétit.
Si on pouvait être étonné de quelque chose, on le serait d’une bulle du pape Grégoire XV. émanée de sa Sainteté le 30 août 1622, par laquelle il ordonne de révéler les confessions en certains cas.
[I-217]
La réponse du jésuite Coton à Henri IV. durera plus que l’ordre des Jésuites. Révéleriez-vous la confession d’un homme résolu de m’assassiner ? Non, mais je me mettrais entre vous & lui.
CONVULSIONS.↩
On dansa vers l’an 1724 sur le cimetière de St. Médard ; il s’y fit beaucoup de miracles : en voici un rapporté dans une chanson de Mad. la duchesse du Maine :
Un décrotteur à la royale
Du talon gauche estropié,
Obtint pour grace spéciale
D’être boiteux de l’autre pied.
Les convulsions miraculeuses, comme on sait, continuèrent jusqu’à ce qu’on eût mis une garde au cimetière.
De par le Roi, défense à Dieu
De plus fréquenter en ce lieu.
Les Jésuites, comme on le sait encor, ne pouvant plus faire de tels miracles depuis que leur Xavier avait épuisé les graces de la Compagnie à ressusciter neuf morts de compte fait, s’avisèrent, pour balancer le crédit des Jansénistes, de faire graver une estampe de [I-218] Jésus-Christ habillé en Jésuite. Un plaisant du parti Janséniste, comme on le sait encor, mit au bas de l’estampe :
Admirez l’artifice extrême
De ces moines ingénieux ;
Ils vous ont habillé comme eux,
Mon Dieu, de peur qu’on ne vous aime.
Les Jansénistes pour mieux prouver que jamais Jésus-Christ n’avait pu prendre l’habit de Jésuite, remplirent Paris de convulsions, & attirèrent le monde à leur préau. Le Conseiller au Parlement, Carré de Montgeron, alla présenter au roi un recueil in-4o de tous ces miracles, attestés par mille témoins ; il fut mis, comme de raison, dans un château, où l’on tâcha de rétablir son cerveau par le régime ; mais la vérité l’emporte toûjours sur les persécutions, les miracles se perpétuèrent trente ans de suite, sans discontinuer. On faisait venir chez soi sieur Rose, sœur Illuminée, sœur Promise, sœur Confite ; elles se faisaient fouëtter, sans qu’il y parût le lendemain ; on leur donnait des coups de bûches sur leur estomac bien cuirassé, bien rembourré, sans leur faire de mal ; on les couchait devant un grand feu, le visage frotté de pommade, sans qu’elles brulassent ; enfin, comme tous les arts se perfectionnent, on a fini par leur enfoncer des épées dans les chairs, & par les crucifier. Un fameux théologien même a eu aussi l’avantage d’être mis en croix : tout cela pour convaincre le monde qu’une [I-219] certaine bulle était ridicule, ce qu’on aurait pu prouver sans tant de frais. Cependant, & Jésuites & Jansénistes, se réunirent tous contre l’Esprit des loix, & contre… & contre… & contre… & contre… Et nous osons après cela nous moquer des Lapons, des Samoyèdes & des Nègres !
CORPS.↩
De même que nous ne savons ce que c’est qu’un esprit, nous ignorons ce que c’est qu’un corps : nous voyons quelques propriétés, mais quel est ce sujet en qui ces propriétés résident ? il n’y a que des corps, disaient Démocrite & Épicure ; il n’y a point de corps, disaient les disciples de Zénon d’Élée.
L’Évêque de Cloine, Berklay, est le dernier, qui par cent sophismes captieux a prétendu prouver que les corps n’existent pas ; ils n’ont, dit-il, ni couleurs, ni odeurs, ni chaleur ; ces modalités sont dans vos sensations, & non dans les objets : il pouvait s’épargner la peine de prouver cette vérité, elle était assez connue ; mais de là il passe à l’étenduë, à la solidité qui sont des essences du corps, & il croit prouver qu’il n’y a pas l’étenduë dans une pièce de drap vert, parce que ce drap n’est pas verd en effet ; cette sensation du verd n’est qu’en vous, donc cette sensation de l’étenduë n’est aussi qu’en vous. Et après avoir ainsi [I-220] détruit l’étenduë, il conclut que la solidité qui y est attachée tombe d’elle-même ; & qu’ainsi il n’y a rien au monde que nos idées. De sorte que, selon ce docteur, dix mille hommes tués par dix mille coups de canon, ne sont dans le fond que dix mille appréhensions de notre âme.
Il ne tenait qu’à M. l’Évêque de Cloine de ne point tomber dans l’excès de ce ridicule ; il croit montrer qu’il n’y a point d’étenduë, parce qu’un corps lui a paru avec sa lunette quatre fois plus gros qu’il ne l’était à ses yeux, & quatre fois plus petit à l’aide d’un autre verre. De là il conclut qu’un corps ne pouvant à la fois avoir quatre pieds, seize pieds, & un seul pied d’étendue, cette étenduë n’existe pas ; donc il n’y a rien ; il n’avait qu’à prendre une mesure, & dire, De quelque étenduë qu’un corps me paraisse, il est étendu de tant de ces mesures.
Il lui était bien aisé de voir qu’il n’en est pas de l’étenduë & de la solidité comme des sons, des couleurs, des saveurs, des odeurs, &c. Il est clair que ce sont en nous des sentimens excités par la configuration des parties ; mais l’étenduë n’est point un sentiment. Que ce bois allumé s’éteigne, je n’ai plus chaud ; que cet air ne soit plus frappé, je n’entends plus ; que cette rose se fane, je n’ai plus d’odorat pour elle ; mais ce bois, cet air, cette rose, sont étendus sans moi. Le paradoxe de Berklay ne vaut pas la peine d’être réfuté.
Il est bon de savoir ce qui l’avait entraîné [I-221] dans ce paradoxe. J’eus, il y a longtems, quelques conversations avec lui ; il me dit que l’origine de son opinion venait de ce qu’on ne peut concevoir ce que c’est que ce sujet qui reçoit l’étenduë. Et en effet, il triomphe dans son livre, quand il demande à Hilas ce que c’est que ce sujet, ce substratum, cette substance ; C’est le corps étendu, répond Hilas ; alors l’évêque, sous le nom de Philonoüs, se moque de lui ; & le pauvre Hilas voyant qu’il a dit que l’étenduë est le sujet de l’étenduë, & qu’il a dit une sottise, demeure tout confus & avoüe qu’il n’y comprend rien, qu’il n’y a point de corps, que le monde matériel n’existe pas, qu’il n’y a qu’un monde intellectuel.
Philonoüs devait dire seulement à Hilas, Nous ne savons rien sur le fond de ce sujet, de cette substance étenduë, solide, divisible, mobile, figurée, &c. Je ne la connais pas plus que le sujet pensant, sentant & voulant ; mais ce sujet n’en existe pas moins, puisqu’il a des propriétés essentielles dont il ne peut être dépouillé.
Nous sommes tous comme la plûpart des dames de Paris ; elles font grande chère sans savoir ce qui entre dans les ragoûts ; de même nous jouissons des corps, sans savoir ce qui les compose. De quoi est fait le corps ? de parties, & ces parties se résolvent en d’autres parties. Que sont ces dernières parties ? Toujours des corps ; vous divisez sans cesse, & vous n’avancez jamais.
Enfin, un subtil philosophe remarquant [I-222] qu’un tableau est fait d’ingrédiens, dont aucun n’est un tableau, & une maison de matériaux dont aucun n’est une maison, il imagina (d’une façon un peu différente) que les corps sont bâtis d’une infinité de petits êtres qui ne sont pas corps ; & cela s’appelle des monades. Ce systême ne laisse pas d’avoir son bon ; & s’il était révélé, je le croirais très possible ; tous ces petits êtres seraient des points mathématiques, des espèces d’âmes qui n’attendraient qu’un habit pour se mettre dedans. Ce serait une métempsicose continuelle ; une monade irait tantôt dans une baleine, tantôt dans un arbre, tantôt dans un joueur de gobelets. Ce systême en vaut bien un autre ; je l’aime bien autant que la déclinaison des atomes, les formes substantielles, la grâce versatile, & les vampires de dom Calmet.
CRÉDO.↩
Je récite mon Pater & mon Crédo tous les matins, je ne ressemble point à Broussin dont Réminiac disait :
Broussin, dès l’âge le plus tendre,
Posséda la sauce Robert,
Sans que son précepteur lui pût jamais apprendre
Ni son crédo ni son pater.
Le Symbole ou la collation, vient du mot [I-223] Symbolein, et l’Église Latine adopte ce mot comme elle a tout pris de l’Église Grecque. Les théologiens un peu instruits savent que ce symbole qu’on nomme des apôtres, n’est point du tout des apôtres.
On appelait symbole chez les Grecs, les paroles, les signes auxquels les initiés aux mystères de Cérès, de Cibèle, de Mithra se reconnaissaient [[16]] ; les chrétiens avec le tems eurent leur symbole. S’il avait existé du tems des apôtres, il est à croire que Saint Luc en aurait parlé.
On attribue à St. Augustin une histoire du symbole dans son sermon 115. on lui fait dire dans ce sermon que Pierre avait commencé le symbole en disant, Je crois en Dieu père tout-puissant ; Jean ajouta, créateur du ciel & de la terre ; Jaques ajouta, Je crois en Jésus-Christ son fils unique notre Seigneur ; & ainsi du reste. On a retranché cette fable dans la dernière édition d’Augustin. Je m’en rapporte aux révérends pères Bénédictins, pour savoir au juste s’il fallait retrancher ou non ce petit morceau qui est curieux.
Le fait est que personne n’entendit parler de ce Crédo pendant plus de quatre cents années. Le peuple dit que Paris n’a pas été bâti en un jour, le peuple a souvent raison dans ses proverbes. Les apôtres eurent notre symbole dans le cœur, mais ils ne le mirent point par écrit. On en forma un du tems de St. Irénée, qui ne ressemble point à celui que nous récitons. [I-224] Notre symbole tel qu’il est aujourd’hui est constamment du cinquième siècle. Il est postérieur à celui de Nicée. L’article qui dit que Jésus descendit aux enfers, celui qui parle de la communion des saints, ne se trouvent dans aucun des symboles qui précédèrent le nôtre. Et en effet, ni les Évangiles, ni les Actes des apôtres ne disent que Jésus descendit dans l’enfer. Mais c’était une opinion établie dès le troisième siècle que Jésus était descendu dans l’Hadès, dans le Tartare, mots que nous traduisons par celui d’enfer. L’enfer en ce sens n’est pas le mot hébreu Scheol, qui veut dire le souterrain, la fosse. Et c’est pourquoi St. Athanase nous apprit depuis comment notre Sauveur était descendu dans les enfers. Son humanité, dit-il, ne fut ni tout entière dans le sépulcre, ni tout entière dans l’enfer. Elle fut dans le sépulcre selon la chair, & dans l’enfer selon l’ame.
St. Thomas assure que les saints qui ressuscitèrent à la mort de Jésus-Christ, moururent de nouveau pour ressusciter ensuite avec lui ; c’est le sentiment le plus suivi. Toutes ces opinions sont absolument étrangères à la morale ; il faut être homme de bien soit que les saints soient ressuscités deux fois, soit que Dieu ne les ait ressuscités qu’une. Notre symbole a été fait tard, je l’avoue, mais la vertu est de toute éternité.
S’il est permis de citer des modernes dans une matière si grave, je rapporterai ici le Credo de l’abbé de St. Pierre, tel qu’il est écrit de sa main dans son livre sur la pureté de la [I-225] religion, lequel n’a point été imprimé, & que j’ai copié fidèlement.
« Je crois en un seul Dieu & je l’aime. Je crois qu’il illumine toute ame venant au monde ainsi que le dit Saint Jean. J’entends par là toute ame qui le cherche de bonne foi.
« Je crois en un seul Dieu, parce qu’il ne peut y avoir qu’une seule ame du grand tout ; un seul être vivifiant ; un formateur unique.
« Je crois en Dieu le père puissant, parce qu’il est père commun de la nature, de tous les hommes qui sont également ses enfans. Je crois que celui qui les fait tous naître également, qui arrangea les ressorts de notre vie de la même manière, leur a donné les mêmes principes de morale, aperçue par eux dès qu’ils réfléchissent, n’a mis aucune différence entre ses enfans que celle du crime & de la vertu.
« Je crois que le Chinois juste & bienfaisant est plus précieux devant lui qu’un docteur pointilleux & arrogant.
« Je crois que Dieu étant notre père commun, nous sommes tenus de regarder tous les hommes comme nos frères.
« Je crois que le persécuteur est abominable, & qu’il marche immédiatement après l’empoisonneur & le parricide.
« Je crois que les disputes théologiques sont à la fois la farce la plus ridicule & le fléau le plus affreux de la terre, immédiatement après la guerre, la peste, la famine & la vérole.
« Je crois que les ecclésiastiques doivent être [I-226] payés, & bien payés, comme serviteurs du public, précepteurs de morale, teneurs des registres des enfans & des morts ; mais qu’on ne doit leur donner ni les richesses des fermiers généraux, ni le rang des princes, parce que l’un & l’autre corrompent l’ame, & que rien n’est plus révoltant que de voir des hommes si riches & si fiers, faire prêcher l’humilité, & l’amour de la pauvreté par des gens qui n’ont que cent écus de gages.
« Je crois que tous les prêtres qui desservent une paroisse doivent être mariés, non seulement pour avoir une femme honnête qui prenne soin de leur ménage, mais pour être meilleurs citoyens, donner de bons sujets à l’État, & pour avoir beaucoup d’enfans bien élevés.
« Je crois qu’il faut absolument extirper les moines, que c’est rendre un très grand service à la patrie & à eux-mêmes. Ce sont des hommes que Circé a changés en pourceaux, le sage Ulysse doit leur rendre la forme humaine. »
Paradis aux bienfaisants !
CRITIQUE.↩
Je ne prétends point parler ici de cette critique de scholiastes, qui restitue mal un mot d’un ancien auteur qu’auparavant on entendait [I-227] très bien. Je ne touche point à ces vraies critiques qui ont débrouillé ce qu’on peut de l’histoire & de la philosophie ancienne. J’ai en vüe les critiques qui tiennent à la satyre.
Un amateur des lettres lisait un jour le Tasse avec moi ; il tomba sur cette stance.
Chiama gli habitator dell ombre eterne,
Il rauco suon della tartarea tromba,
Treman le spazioze atre caverne,
E l’aer ceco a quel rumor rimbomba,
Ne stridendo cosi dalle superne
Regioni del cielo il fulgor piomba ;
Ne si scossa giamai trema la terra,
Quando i vapori in sen gravida serra.
Il lut ensuite au hazard plusieurs stances de cette force & de cette harmonie. « Ah ! c’est donc là, s’écria-t-il, ce que votre Boileau appelle du clinquant ? c’est donc ainsi qu’il veut rabaisser un grand homme qui vivait cent ans avant lui, pour mieux élever un autre grand homme qui vivait seize cents ans auparavant ; & qui eût lui-même rendu justice au Tasse ?
Consolez-vous, lui dis-je, prenons les opéras de Quinaut. : nous trouvâmes à l’ouverture du livre, de quoi nous mettre en colère contre la critique ; l’admirable poëme d’Armide se présenta, nous trouvâmes ces mots :
SIDONIE.
La haine est affreuse & barbare,
[I-228]
L’amour contraint les cœurs dont il s’empare,
À souffrir des maux rigoureux.
Si votre sort est en votre puissance,
Faites choix de l’indifférence,
Elle assure un sort plus heureux.
ARMIDE.
Non, non, il ne m’est pas possible
De passer de mon trouble en un état paisible,
Mon cœur ne se peut plus calmer ;
Renaud m’offense trop, il n’est que trop aimable,
C’est pour moi désormais un choix indispensable
De le haïr ou de l’aimer.
Nous lûmes toute la pièce d’Armide, dans laquelle le génie du Tasse reçoit encor de nouveaux charmes par les mains de Quinaut ; Eh bien, dis-je à mon ami, c’est pourtant ce Quinaut que Boileau s’efforça toûjours de faire regarder comme l’écrivain le plus méprisable ; il persuada même à Louis XIV, que cet écrivain gracieux, touchant, pathétique, élégant, n’avait d’autre mérite que celui qu’il empruntait du musicien Lully. Je conçois cela très aisément, me répondit mon ami ; Boileau n’était pas jaloux du musicien, il l’était du poëte. Quel fond devons-nous faire sur le jugement d’un homme, qui pour rimer à un vers qui finissait en aut, dénigrait tantôt Boursaut, tantôt Hainaut, tantôt Quinaut, selon qu’il était bien ou mal avec ces messieurs-là ?
[I-229]
Mais pour ne pas laisser refroidir votre zèle contre l’injustice, mettez seulement la tête à la fenêtre, regardez cette belle façade du Louvre, par laquelle Perraut s’est immortalisé : cet habile homme était frère d’un académicien très savant, avec qui Boileau avait eu quelque dispute ; en voilà assez pour être traité d’architecte ignorant.
Mon ami après avoir un peu rêvé reprit en soupirant : La nature humaine est ainsi faite. Le duc de Sully dans ses mémoires, trouve le cardinal d’Ossat, & le secrétaire de Villeroi, de mauvais ministres ; Louvois faisait ce qu’il pouvait pour ne pas estimer le grand Colbert ; Ils n’imprimaient rien l’un contre l’autre de leur vivant, répondis-je, c’est une sottise qui n’est guère attachée qu’à la littérature, à la chicane, & à la théologie.
Nous avons eu un homme de mérite, c’est Lamotte, qui a fait de très belles stances.
Quelquefois au feu qui la charme
Résiste une jeune beauté,
Et contre elle-même elle s’arme
D’une pénible fermeté.
Hélas cette contrainte extrême
La prive du vice qu’elle aime,
Pour fuir la honte qu’elle hait.
Sa sévérité n’est que faste,
Et l’honneur de passer pour chaste
La résout à l’être en effet.
En vain ce sévère stoïque [I-230]
Sous mille défauts abattu
Se vante d’une ame héroïque
Toute voüée à la vertu ;
Ce n’est point la vertu qu’il aime,
Mais son cœur yvre de lui-même
Voudrait usurper les autels ;
Et par sa sagesse frivole
Il ne veut que parer l’idole
Qu’il offre au culte des mortels.
Les champs de Pharsale & d’Arbelle
Ont vû triompher deux vainqueurs,
L’un & l’autre digne modèle
Que se proposent les grands cœurs.
Mais le succès a fait leur gloire ;
Et si le sceau de la victoire
N’eût consacré ces demi-dieux,
Alexandre aux yeux du vulgaire,
N’aurait été qu’un téméraire,
Et César qu’un séditieux.
Cet auteur, dit-il, était un sage qui prêta plus d’une fois le charme des vers à la philosophie. S’il avait toûjours écrit de pareilles stances, il serait le premier des poëtes lyriques, cependant c’est alors qu’il donnait ces beaux morceaux, que l’un de ses contemporains l’appelait :
Certain oison gibier de basse-cour.
Il dit de Lamotte en un autre endroit :
De ses discours l’ennuïeuse beauté.
[I-231]
Il dit dans un autre :
… Je n’y vois qu’un défaut,
C’est que l’auteur les devait faire en prose.
Ces odes-là sentent bien le Quinaut.
Il le poursuit partout ; il lui reproche partout la sécheresse, & le défaut d’harmonie.
Seriez-vous curieux de voir les odes que fit quelques années après ce même censeur qui jugeait Lamotte en maître, & qui le décriait en ennemi ? Lisez :
Cette influence souveraine
N’est pour lui qu’une illustre chaîne
Qui l’attache au bonheur d’autrui ;
Tous les brillants qui l’embellissent,
Tous les talents qui l’ennoblissent
Sont en lui, mais non pas à lui.Il n’est rien que le tems n’absorbe, ne dévore,
Et les faits qu’on ignore
Sont bien peu différens des faits non avenus.
La bonté qui brille en elle
De ses charmes les plus doux,
Est une image de celle
Qu’elle voit briller en vous.
Et par vous seule enrichie
Sa politesse affranchie
Des moindres obscurités,
Est la lueur réfléchie
De vos sublimes clartés.[I-232]
Ils ont vu par ta bonne foi
De leurs peuples troublés d’effroi
La crainte heureusement déçue,
Et déracinée à jamais
La haine si souvent reçue
En survivance de la paix.Dévoile à ma vüe empressée
Ces Déïtés d’adoption,
Synonymes de la pensée,
Symboles de l’abstraction.N’est-ce pas une fortune,
Quand d’une charge commune
Deux moitiés portent le faix ?
Que la moindre le réclame ;
Et que du bonheur de l’ame,
Le corps seul fasse les frais ?
Il ne fallait pas, dit alors mon judicieux amateur de lettres, il ne falait pas sans doute donner de si détestables ouvrages pour modèles à celui qu’on critiquait avec tant d’amertume ; il eût mieux valu laisser jouïr en paix son adversaire de son mérite, & conserver celui qu’on avait ; mais que voulez-vous ? le genus irritabile vatum, est malade de la même bile qui le tourmentait autrefois. Le public pardonne ces pauvretés aux gens à talent, parce que le public ne songe qu’à s’amuser ; il voit dans une allégorie intitulée Pluton, des juges condamnés à être écorchés, & à s’asseoir aux enfers, sur un [I-233] siège couvert de leur peau, au lieu de fleurs de lys ; le lecteur ne s’embarrasse pas si ces juges le méritent, ou non ; si le complaignant qui les cite devant Pluton a tort ou raison. Il dit ces vers uniquement pour son plaisir ; s’ils lui en donnent, il n’en veut pas davantage ; s’ils lui déplaisent, il laisse là l’allégorie, & ne ferait pas un seul pas pour faire confirmer ou casser la sentence.
Les inimitables tragédies de Racine ont toutes été critiquées, & très mal ; c’est qu’elles l’étaient par des rivaux. Les artistes sont les juges compétents de l’art, il est vrai, mais ces juges compétents sont presque toûjours corrompus.
Un excellent critique serait un artiste qui aurait beaucoup de science & de goût, sans préjugés & sans envie. Cela est difficile à trouver.
[I-233]
DAVID.↩
Si un jeune paysan en cherchant des ânesses trouve un royaume, cela n’arrive pas communément. Si un autre paysan guérit son roi d’un accès de folie en joüant de la harpe, ce cas est encor très rare ; mais que ce petit joueur de harpe devienne Roi parce qu’il a rencontré dans un coin un prêtre de village qui lui jette une bouteille d’huile d’olive sur la tête, la chose est encor plus merveilleuse.
[I-234]
Quand & par qui ces merveilles furent-elles écrites ? Je n’en sais rien ; mais je suis bien sûr que ce n’est ni par un Polybe, ni par un Tacite. Je révère fort le digne Juif, quel qu’il soit, qui écrivit l’histoire véritable du puissant royaume des Hébreux pour l’instruction de l’univers sous la dictée du Dieu de tous les mondes qui inspira ce bon Juif ; mais je suis fâché que mon ami David commence par rassembler une bande de voleurs au nombre de quatre cents, qu’à la tête de cette troupe d’honnêtes gens il s’entende avec Abimélec le grand-prêtre qui l’arme de l’épée de Goliath & qui lui donne les pains consacrés. (premier Rois chap. 21. vs. 13.)
Je suis un peu scandalisé que David l’oint du Seigneur, l’homme selon le cœur de Dieu, révolté contre Saül autre oint du Seigneur, s’en aille avec quatre cents bandits mettre le pays à contribution, aille voler le bonhomme Nabal, qu’immédiatement après Nabal se trouve mort, & que David épouse la veuve sans tarder. (Chap. 25. vs. 10. 11.)
J’ai quelques scrupules sur sa conduite avec le grand roi Akis, possesseur, si je ne me trompe, de cinq ou six villages dans le canton de Geth. David était alors à la tête de six cents bandits, allait faire des courses chez les alliés de son bienfaiteur Akis ; il pillait tout, il tuait tout, vieillards, femmes, enfans à la mamelle. Et pourquoi égorgeait-il les enfans à la mamelle ? C’est, dit le divin auteur Juif, de peur que ces enfans n’en [I-235] portassent la nouvelle au Roi Akis. (Chap. 27. vs. 8. 9. 11.)
Ces bandits se fâchent contre lui, ils veulent le lapider. Que fait ce Mandrin Juif ? Il consulte le Seigneur, & le Seigneur lui répond qu’il faut aller attaquer les Amalécites, que ces bandits y gagneront de bonnes dépouilles, & qu’ils s’enrichiront. (Chap. 30.)
Cependant l’oint du seigneur, Saül, perd une bataille contre les Philistins, & il se fait tuer. Un Juif en apporte la nouvelle à David. David qui n’avait pas apparemment de quoi donner la buona nuncia au courrier, le fait tuer pour sa récompense. (2e. Rois chap. 1. vs. 10.)
Isbozeth succède à son père Saül, David est assez fort pour lui faire la guerre. Enfin Isbozeth est assassiné.
David s’empare de tout le royaume, il surprend la petite ville ou le village de Raba & il fait mourir tous les habitans par des supplices assez extraordinaires, on les scie en deux, on les déchire avec des herses de fer, on les brûle dans des fours à briques. Manière de faire la guerre tout à fait noble & généreuse. (2e. Rois chap. 12.)
Après ces belles expéditions, il y a une famine de trois ans dans le païs ; je le crois bien ; car à la manière dont le bon David faisait la guerre, les terres devaient être mal ensemencées. On consulte le Seigneur, & on lui demande pourquoi il y a famine. La réponse était fort aisée, c’était assurément parce que dans un [I-236] païs, qui à peine produit du bled, quand on a fait cuire les laboureurs dans des fours à briques, & qu’on les a sciés en deux, il reste peu de gens pour cultiver la terre ; mais le Seigneur répond que c’est parce que Saül avait tué autrefois des Gabaonites.
Que fait aussitôt le bon David ? il assemble les Gabaonites ; il leur dit que Saül avait eu grand tort de leur faire la guerre ; que Saül n’était point comme lui selon le cœur de Dieu, qu’il est juste de punir sa race, & il leur donne sept petits-fils de Saül à pendre, lesquels furent pendus, parce qu’il y avait eu famine. (2e. Rois chap. 21.)
C’est un plaisir de voir comment cet imbécille de Dom Calmet justifie & canonise toutes ces actions, qui feraient frémir d’horreur si elles n’étaient incroyables.
Je ne parlerai pas ici de l’assassinat abominable d’Uria, & de l’adultère de Betzabéa ; elle est assez connue ; & les voies de Dieu sont si différentes des voies des hommes, qu’il a permis que Jésus-Christ descendît de cette infâme Betzabéa, tout étant purifié par ce saint mystère.
Je ne demande pas maintenant comment Jurieu a eu l’insolence de persécuter le sage Bayle pour n’avoir pas approuvé toutes les actions du bon roi David, mais je demande comment on a souffert qu’un homme tel que Jurieu molestât un homme tel que Bayle ?
[I-237]
DES DÉLITS LOCAUX.↩
Parcourez toute la terre, vous trouverez que le vol, le meurtre, l’adultère, la calomnie sont regardés comme des délits que la société condamne & réprime ; mais ce qui est approuvé en Angleterre, & condamné en Italie, doit-il être puni en Italie comme un de ces attentats contre l’humanité entière ? c’est là ce que j’appelle délit local. Ce qui n’est criminel que dans l’enceinte de quelques montagnes ou entre deux rivières n’exige-t-il pas des juges plus d’indulgence que ces attentats qui sont en horreur à toutes les contrées ? Le juge ne doit-il pas se dire à lui-même : je n’oserais punir à Raguse ce que je punis à Lorette. Cette réflexion ne doit-elle pas adoucir dans son cœur cette dureté qu’il n’est que trop aisé de contracter dans le long exercice de son emploi ?
On connaît les Kermesses de la Flandre ; elles étaient portées dans le siècle passé jusqu’à une indécence qui pouvait révolter des yeux inaccoutumés à ces spectacles.
Voici comme l’on célébrait la fête de Noël dans quelques villes. D’abord paraissait un jeune homme à moitié nu avec des ailes au dos, il récitait l’ave Maria à une jeune fille qui lui répondait fiat, & l’ange la baisait sur la bouche, ensuite un enfant enfermé dans un grand coq de carton criait en imitant le chant du coq : puer natus est nobis. Un gros bœuf en mugissant disait [I-238] ubi, qu’il prononçait oubi, une brebis bêlait en criant Béthléem. Un âne criait hihanus pour signifier eamus, une longue procession précédée de quatre fous, avec des grelots & des marottes fermait la marche. Il reste encor aujourd’hui des traces de ces dévotions populaires, que chez des peuples plus instruits on prendrait pour profanations. Un Suisse de mauvaise humeur, & peut-être plus ivre que ceux qui jouaient le rôle du bœuf & de l’âne, se prit de parole avec eux dans Louvain, il y eut des coups de donnés, on voulut faire pendre le Suisse qui échappa à peine.
Le même homme eut une violente querelle à la Haye en Hollande, pour avoir pris hautement le parti de Barnevelt contre un Gomariste outré. Il fut mis en prison à Amsterdam, pour avoir dit que les prêtres sont le fléau de l’humanité & la source de tous nos malheurs. Eh quoi, disait-il, si l’on croit que les bonnes œuvres peuvent servir au salut, on est au cachot. Si l’on se moque d’un coq & d’un âne, on risque la corde. Cette avanture, toute burlesque qu’elle est, fait assez voir qu’on peut être répréhensible sur un ou deux points de notre hémisphère, & être absolument innocent dans le reste du monde.
[I-239]
DESTIN.↩
De tous les livres qui sont parvenus jusqu’à nous, le plus ancien est Homère ; c’est là qu’on trouve les mœurs de l’antiquité profane, des héros grossiers, des dieux grossiers, faits à l’image de l’homme. Mais c’est là qu’on trouve aussi les semences de la philosophie, & surtout l’idée du destin qui est maître des dieux, comme les dieux sont les maîtres du monde.
Jupiter veut en vain sauver Hector ; il consulte les destinées ; il pèse dans une balance les destins d’Hector & d’Achille ; il trouve que le Troyen doit absolument être tué par le Grec ; il ne peut s’y opposer ; & dès ce moment Apollon, le génie gardien d’Hector, est obligé de l’abandonner. (Iliade liv. 22.) Ce n’est pas qu’Homère ne prodigue souvent dans son poëme, des idées toutes contraires, suivant le privilège de l’antiquité ; mais enfin, il est le premier chez qui on trouve la notion du destin. Elle était donc très en vogue de son tems.
Les Pharisiens, chez le petit peuple Juif, n’adoptèrent le destin que plusieurs siècles après. Car ces Pharisiens eux-mêmes, qui furent les premiers lettrés d’entre les Juifs, étaient très nouveaux. Ils mêlèrent dans Alexandrie une partie des dogmes des stoïciens, aux anciennes idées juives. St. Jérôme prétend même [I-240] que leur secte n’est pas de beaucoup antérieure à notre ère vulgaire.
Les philosophes n’eurent jamais besoin ni d’Homère, ni des Pharisiens, pour se persuader que tout se fait par des loix immuables, que tout est arrangé, que tout est un effet nécessaire.
Ou le monde subsiste par sa propre nature, par ses loix physiques, ou un Être suprême l’a formé selon ses loix suprêmes ; dans l’un & l’autre cas, ces loix sont immuables ; dans l’un & l’autre cas, tout est nécessaire ; les corps graves tendent vers le centre de la terre, sans pouvoir tendre à se reposer en l’air. Les poiriers ne peuvent jamais porter d’ananas. L’instinct d’un épagneul, ne peut être l’instinct d’une autruche ; tout est arrangé, engrené & limité.
L’homme ne peut avoir qu’un certain nombre de dents, de cheveux & d’idées ; il vient un tems où il perd nécessairement ses dents, ses cheveux & ses idées.
Il est contradictoire que ce qui fut hier n’ait pas été, que ce qui est aujourd’hui ne soit pas ; il est aussi contradictoire que ce qui doit être, puisse ne pas devoir être.
Si tu pouvais déranger la destinée d’une mouche, il n’y aurait nulle raison qui pût t’empêcher de faire le destin de toutes les autres mouches, de tous les autres animaux, de tous les hommes, de toute la nature ; tu te trouverais au bout du compte plus puissant que Dieu.
Des imbécilles disent, Mon médecin a tiré ma tante d’une maladie mortelle, il a fait vivre [I-241] ma tante dix ans de plus qu’elle ne devait vivre ; d’autres qui font les capables disent, L’homme prudent fait lui-même son destin.
Nullum numen abest si sit prudentia, sed nos
Te facimus fortuna Deam coeloque locamus.
Mais souvent le prudent succombe sous sa destinée, loin de la faire ; c’est le destin qui fait les prudens.
De profonds politiques assurent que si on avait assassiné Cromwell, Ludlow, Ireton, & une douzaine d’autres parlementaires, huit jours avant qu’on coupât la tête à Charles Ier, ce roi aurait pu vivre encor & mourir dans son lit ; ils ont raison ; ils peuvent ajouter encor que si toute l’Angleterre avait été engloutie dans la mer, ce monarque n’aurait pas péri sur un échafaud auprès de Whitehall, auprès de la salle blanche : mais les choses étaient arrangées de façon que Charles devait avoir le cou coupé.
Le cardinal d’Ossat était sans doute plus prudent qu’un fou des petites maisons ; mais n’est-il pas évident que les organes du sage d’Ossat étaient autrement faits que ceux de cet écervelé ? de même que les organes d’un renard sont différens de ceux d’une grüe & d’une alouette.
Ton médecin a sauvé ta tante ; mais certainement il n’a pas en cela contredit l’ordre de la nature, il l’a suivi. Il est clair que ta tante ne pouvait pas s’empêcher de naître dans [I-242] une telle ville, qu’elle ne pouvait pas s’empêcher d’avoir dans un tel tems une certaine maladie, que le médecin ne pouvait pas être ailleurs que dans la ville où il était, que ta tante devait l’appeler, qu’il devait lui prescrire les drogues qui l’ont guérie.
Un paysan croit qu’il a grêlé par hazard sur son champ, mais le philosophe sait qu’il n’y a point de hazard, & qu’il était impossible, dans la constitution de ce monde, qu’il ne grêlât pas ce jour-là en cet endroit.
Il y a des gens qui étant effrayés de cette vérité en accordent la moitié, comme des débiteurs qui offrent moitié à leurs créanciers, & demandent répit pour le reste. Il y a, disent-ils, des événements nécessaires, & d’autres qui ne le sont pas ; il serait plaisant qu’une partie de ce monde fût arrangée, & que l’autre ne le fût point ; qu’une partie de ce qui arrive dût arriver, & qu’une autre partie de ce qui arrive ne dût pas arriver. Quand on y regarde de près, on voit que la doctrine contraire à celle du destin est absurde & contraire à l’idée d’une providence éternelle ; mais il y a beaucoup de gens destinés à raisonner mal, d’autres à ne point raisonner du tout, d’autres à persécuter ceux qui raisonnent.
Il y a des gens qui vous disent, Ne croyez pas au fatalisme, car alors tout vous paraissant inévitable vous ne travaillerez à rien, vous croupirez dans l’indifférence, vous n’aimerez ni les richesses ni les honneurs, ni les louanges ; vous ne voudrez rien acquérir, vous vous [I-243] croirez sans mérite comme sans pouvoir ; aucun talent ne sera cultivé, tout périra par l’apathie.
Ne craignez rien, messieurs, nous aurons toûjours des passions & des préjugés, puisque c’est notre destinée d’être soumis aux préjugés & aux passions : nous saurons bien qu’il ne dépend pas plus de nous d’avoir beaucoup de mérite & de grands talents, que d’avoir les cheveux bien plantés & la main belle : nous serons convaincus qu’il ne faut tirer vanité de rien, & cependant nous aurons toûjours de la vanité.
J’ai nécessairement la passion d’écrire ceci, & toi tu as la passion de me condamner ; nous sommes tous deux également sots, également les jouets de la destinée. Ta nature est de faire du mal, la mienne est d’aimer la vérité, & de la publier malgré toi.
Le hibou qui se nourrit de souris dans sa masure, a dit au rossignol, Cesse de chanter sous tes beaux ombrages, viens dans mon trou, afin que je t’y dévore ; & le rossignol a répondu, Je suis né pour chanter ici, & pour me moquer de toi.
Vous me demandez ce que deviendra la liberté ? Je ne vous entends pas. Je ne sais ce que c’est que cette liberté dont vous parlez ; il y a si longtems que vous disputez sur sa nature, qu’assurément vous ne la connaissez pas. Si vous voulez, ou plutôt, si vous pouvez examiner paisiblement avec moi ce que c’est, passez à la lettre L.
[I-244]
DIEU.↩
Sous l’empire d’Arcadius, Logomacos, théologal de Constantinople, alla en Scythie, & s’arrêta au pié du Caucase, dans les fertiles plaines de Zéphirim, sur les frontières de la Colchide. Le bon vieillard Dondindac était dans sa grande salle basse, entre sa grande bergerie & sa vaste grange ; il était à genoux avec sa femme, ses cinq fils & ses cinq filles, ses parents & ses valets, & tous chantaient les louanges de Dieu après un léger repas. Que fais-tu là, idolâtre ? lui dit Logomacos. Je ne suis point idolâtre, dit Dondindac. Il faut bien que tu sois idolâtre, dit Logomacos, puisque tu es Scythe, & que tu n’es pas Grec. Çà, di-moi, que chantais-tu dans ton barbare jargon de Scythie ? Toutes les langues sont égales aux oreilles de Dieu, répondit le Scythe ; nous chantions ses louanges. Voilà qui est bien extraordinaire, reprit le théologal ; une famille scythe qui prie Dieu sans avoir été instruite par nous ! Il engagea bientôt une conversation avec le Scythe Dondindac ; car le théologal savait un peu de scythe, & l’autre un peu de grec. On a retrouvé cette conversation dans un manuscrit conservé dans la bibliothèque de Constantinople.
LOGOMACOS.
Voyons si tu sais ton catéchisme ? Pourquoi pries-tu Dieu ?
[I-245]
DONDINDAC.
C’est qu’il est juste d’adorer l’Être suprême de qui nous tenons tout.
LOGOMACOS.
Pas mal pour un barbare ! Et que lui demandes-tu ?
DONDINDAC.
Je le remercie des biens dont je jouis, & même des maux dans lesquels il m’éprouve ; mais je me garde bien de lui rien demander ; il sait mieux que nous ce qu’il nous faut ; & je craindrais d’ailleurs de demander du beau tems quand mon voisin demanderait de la pluye.
LOGOMACOS.
Ah ! je me doutais bien qu’il allait dire quelque sottise. Reprenons les choses de plus haut : Barbare, qui t’a dit qu’il y a un Dieu ?
DONDINDAC.
La nature entière.
LOGOMACOS.
Cela ne suffit pas. Quelle idée as-tu de Dieu ?
DONDINDAC.
L’idée de mon créateur, de mon maître, qui me récompensera si je fais bien, & qui me punira si je fais mal.
[I-246]
LOGOMACOS.
Bagatelles, pauvretés que cela ! Venons à l’essentiel. Dieu est-il infini secundum quid, ou selon l’essence ?
DONDINDAC.
Je ne vous entends pas.
LOGOMACOS.
Bête brute ! Dieu est-il en un lieu, ou hors de tout lieu, ou en tout lieu ?
DONDINDAC.
Je n’en sais rien… Tout comme il vous plaira.
LOGOMACOS.
Ignorant ! Peut-il faire que ce qui a été n’ait point été, & qu’un bâton n’ait pas deux bouts ? voit-il le futur comme futur ou comme présent ? comment fait-il pour tirer l’être du néant, & pour anéantir l’être ?
DONDINDAC.
Je n’ai jamais examiné ces choses.
LOGOMACOS.
Quel lourdaut ! Allons, il faut s’abaisser, se proportionner. Dis-moi, mon ami, crois-tu que la matière puisse être éternelle ?
DONDINDAC.
Que m’importe qu’elle existe de toute [I-247] éternité ou non ; je n’existe pas moi de toute éternité. Dieu est toûjours mon maître ; il m’a donné la notion de la justice, je dois la suivre ; je ne veux point être philosophe, je veux être homme.
LOGOMACOS.
On a bien de la peine avec ces têtes dures. Allons pié à pié : Qu’est-ce que Dieu ?
DONDINDAC.
Mon souverain, mon juge, mon père.
LOGOMACOS.
Ce n’est pas là ce que je demande. Quelle est sa nature ?
DONDINDAC.
D’être puissant & bon.
LOGOMACOS.
Mais est-il corporel ou spirituel ?
DONDINDAC.
Comment voulez-vous que je le sache ?
LOGOMACOS.
Quoi ! tu ne sais pas ce que c’est qu’un esprit ?
DONDINDAC.
Pas le moindre mot : à quoi cela me servirait-il ? en serais-je plus juste ? serais-je meilleur [I-248] mari, meilleur père, meilleur maître, meilleur citoyen ?
LOGOMACOS.
Il faut absolument t’apprendre ce que c’est qu’un esprit ; écoute, c’est, c’est, c’est… Je te dirai cela une autre fois.
DONDINDAC.
J’ai bien peur que vous me disiez moins ce qu’il est que ce qu’il n’est pas. Permettez-moi de vous faire à mon tour une question. J’ai vu autrefois un de vos temples ; pourquoi peignez-vous Dieu avec une grande barbe ?
LOGOMACOS.
C’est une question très difficile & qui demande des instructions préliminaires.
DONDINDAC.
Avant de recevoir vos instructions, il faut que je vous conte ce qui m’est arrivé un jour. Je venais de faire bâtir un cabinet au bout de mon jardin ; j’entendis une taupe qui raisonnait avec un hanneton : Voilà une belle fabrique, disait la taupe ; il faut que ce soit une taupe bien puissante qui ait fait cet ouvrage. Vous vous moquez, dit le hanneton, c’est un hanneton tout plein de génie qui est l’architecte de ce bâtiment. Depuis ce tems-là, j’ai résolu de ne jamais disputer.
[I-249]
DIVINITÉ DE JÉSUS.↩
Les Sociniens qui sont regardés comme des blasphémateurs ne reconnaissent point la divinité de Jésus-Christ. Ils osent prétendre avec les philosophes de l’antiquité, avec les Juifs, les Mahométans & tant d’autres nations, que l’idée d’un Dieu homme est monstrueuse, que la distance d’un Dieu à l’homme est infinie, & qu’il est impossible que l’Être infini, immense, éternel, ait été contenu dans un corps périssable.
Ils ont la confiance de citer en leur faveur Eusèbe évêque de Césarée, qui, dans son Histoire ecclésiastique, liv. premier, chap. 11., déclare qu’il est absurde que la nature non engendrée, immuable du Dieu tout-puissant, prenne la forme d’un homme. Ils citent les Pères de l’Église Justin & Tertullien qui ont dit la même chose. Justin dans son dialogue avec Triphon, & Tertullien dans son discours contre Praxéas.
Ils citent St. Paul qui n’appelle jamais Jésus-Christ Dieu, & qui l’appelle homme très souvent. Ils poussent l’audace jusqu’au point d’affirmer que les chrétiens passèrent trois siècles entiers à former peu à peu l’apothéose de Jésus, & qu’ils n’élevaient cet étonnant édifice qu’à l’exemple des païens qui avaient divinisé des mortels. D’abord, selon eux, on ne regarda Jésus que comme un homme inspiré de Dieu. [I-250] Ensuite comme une créature plus parfaite que les autres. On lui donna quelque tems après une place au-dessus des anges, comme le dit St. Paul. Chaque jour ajoutait à sa grandeur. Il devint une émanation de Dieu produite dans le tems. Ce ne fut pas assez ; on le fit naître avant le tems même. Enfin on le fit Dieu consubstantiel à Dieu. Crellius, Voquelsius, Natalis Alexander, Hornebeck, ont appuyé tous ces blasphèmes par des arguments qui étonnent les sages, & qui pervertissent les faibles. Ce fut surtout Fauste Socin qui répandit les semences de cette doctrine dans l’Europe, & sur la fin du seizième siècle il s’en est peu fallu qu’il n’établît une nouvelle espèce de christianisme. Il y en avait déjà eu plus de trois cents espèces.
DOGMES.↩
Le 18. février de l’an 1763. de l’ère vulgaire, le soleil entrant dans le signe des Poissons, je fus transporté au ciel, comme le savent tous mes amis. Ce ne fut point la jument Borac de Mahomet qui fut ma monture ; ce ne fut point le char enflammé d’Élie qui fut ma voiture ; je ne fus porté ni sur l’éléphant de Sammonocodom le Siamois, ni sur le cheval de St. George le patron d’Angleterre, ni sur le cochon de St. Antoine : j’avoue avec ingénuité que mon voyage se fit je ne sais comment.
[I-251]
On croira bien que je fus éblouï ; mais ce qu’on ne croira pas, c’est que je vis juger tous les morts ; & qui étaient les juges ? c’étaient, ne vous en déplaise, tous ceux qui ont fait du bien aux hommes, Confucius, Solon, Socrate, Titus, les Antonins, Épictète, tous les grands hommes qui ayant enseigné & pratiqué les vertus que Dieu exige, semblaient seuls être en droit de prononcer ses arrêts.
Je ne dirai point sur quels trônes ils étaient assis, ni combien de millions d’êtres célestes étaient prosternés devant le créateur de tous les globes, ni quelle foule d’habitans de ces globes innombrables comparut devant les juges. Je ne rendrai compte ici que de quelques petites particularités tout à fait intéressantes dont je fus frappé.
Je remarquai que chaque mort qui plaidait sa cause & qui étalait ses beaux sentimens, avait à côté de lui tous les témoins de ses actions. Par exemple, quand le Cardinal de Lorraine se vantait d’avoir fait adopter quelques-unes de ses opinions par le concile de Trente, & que pour prix de son orthodoxie il demandait la vie éternelle, tout aussitôt paraissaient autour de lui vingt courtisanes ou dames de la cour, portant toutes sur le front le nombre de leurs rendez-vous avec le Cardinal. On voyait ceux qui avaient jeté avec lui les fondemens de la Ligue ; tous les complices de ses desseins pervers venaient l’environner.
Vis-à-vis du Cardinal de Lorraine était C....., qui se vantait dans son patois grossier [I-252] d’avoir donné des coups de pied à l’idole papale, après que d’autres l’avaient abattue. J’ai écrit contre la peinture & la sculpture, disait-il ; j’ai fait voir évidemment que les bonnes œuvres ne servent à rien du tout ; & j’ai prouvé qu’il est diabolique de danser le menuet ; chassez vite d’ici le Cardinal de Lorraine, & placez-moi à côté de St. Paul.
Comme il parlait, on vit auprès de lui un bûcher enflammé, un spectre épouvantable portant au cou une fraise espagnole à moitié brûlée, sortait du milieu des flammes avec des cris affreux : Monstre, s’écriait-il, monstre exécrable, tremble, reconnai ce S..... que tu as fait périr par le plus cruel des supplices, parce qu’il avait disputé contre toi sur la manière dont trois personnes peuvent faire une seule substance. Alors tous les juges ordonnèrent que le Cardinal de Lorraine serait précipité dans l’abîme, mais que Calvin serait puni plus rigoureusement.
Je vis une foule prodigieuse de morts qui disaient, J’ai cru, j’ai cru ; mais sur leur front il était écrit, J’ai fait, & ils étaient condamnés.
Le Jésuite le Tellier paraissait fièrement la bulle Unigenitus à la main. Mais à ses côtés s’éleva tout d’un coup un monceau de deux mille lettres de cachet. Un Janséniste y mit le feu, le Tellier fut brûlé jusqu’aux os, & le Janséniste, qui n’avait pas moins cabalé que le Jésuite, eut sa part de la brûlure.
Je voyais arriver à droite & à gauche des [I-253] troupes de faquirs, de talapoins, de bonzes, de moines blancs, noirs & gris, qui s’étaient tous imaginés que pour faire leur cour à l’Être suprême il fallait ou chanter ou se fouetter, ou marcher tout nus. J’entendis une voix terrible qui leur demanda, Quel bien avez-vous fait aux hommes ? À cette voix succéda un morne silence, aucun n’osa répondre, & ils furent tous conduits aux petites maisons de l’univers ; c’est un des plus grands bâtiments qu’on puisse imaginer.
L’un criait, c’est aux métamorphoses de Xaca qu’il faut croire ; l’autre, c’est à celles de Sammonocodom ; Bacchus arrêta le soleil & la lune, disait celui-ci ; les dieux ressuscitèrent Pelops, disait celui-là. Voici la bulle in cæna Domini, disait un nouveau venu, & l’huissier des juges criait, Aux petites maisons, aux petites maisons.
Quand tous ces procès furent vuidés, j’entendis alors promulguer cet arrêt.
De par l’Éternel créateur,
Conservateur, rémunérateur,
Vengeur, pardonneur, &c. &c.
Soit notoire à tous les habitans des cent mille millions de milliards de mondes qu’il nous a plu de former, que nous ne jugerons jamais aucun desdits habitans sur leurs idées creuses, mais uniquement sur leurs actions, car telle est notre justice.
J’avoue que ce fut la première fois que [I-254] j’entendis un tel édit ; tous ceux que j’avais lus sur le petit grain de sable où je suis né, finissaient par ces mots ; car tel est notre plaisir.
[I-254]
ÉGALITÉ.↩
Que doit un chien à un chien, & un cheval à un cheval ? Rien, aucun animal ne dépend de son semblable ; mais l’homme ayant reçu le rayon de la divinité qu’on appelle raison, quel en est le fruit ? c’est d’être esclave dans presque toute la terre.
Si cette terre était ce qu’elle semble devoir être, c’est-à-dire, si l’homme y trouvait partout une subsistance facile & assurée, & un climat convenable à sa nature, il est clair qu’il eût été impossible à un homme d’en asservir un autre. Que ce globe soit couvert de fruits salutaires, que l’air qui doit contribuer à notre vie ne nous donne point les maladies & la mort, que l’homme n’ait besoin d’autre logis & d’autre lit que celui des daims & des chevreuils ; alors les Gengiskan & les Tamerlan n’auront de valets que leurs enfans, qui seront assez honnêtes gens pour les aider dans leur vieillesse.
Dans cet état si naturel dont jouïssent tous les quadrupèdes, les oiseaux & les reptiles, l’homme serait aussi heureux qu’eux, la domination serait alors une chimère, une absurdité à laquelle personne ne penserait ; car pourquoi [I-255] chercher des serviteurs quand vous n’avez besoin d’aucun service ?
S’il passait par l’esprit à quelque individu à tête tyrannique & à bras nerveux d’asservir son voisin moins fort que lui, la chose serait impossible, l’opprimé serait à cent lieües, avant que l’oppresseur eût pris ses mesures.
Tous les hommes seraient donc nécessairement égaux, s’ils étaient sans besoins. La misère attachée à notre espèce subordonne un homme à un autre homme : ce n’est pas l’inégalité qui est un malheur réel, c’est la dépendance. Il importe fort peu que tel homme s’appelle Sa Hautesse, tel autre Sa Sainteté ; mais il est dur de servir l’un ou l’autre.
Une famille nombreuse a cultivé un bon terroir ; deux petites familles voisines ont des champs ingrats & rebelles ; il faut que les deux pauvres familles servent la famille opulente, ou qu’ils l’égorgent, cela va sans difficulté. Une des deux familles indigentes va offrir ses bras à la riche pour avoir du pain ; l’autre va l’attaquer & est battue ; la famille servante est l’origine des domestiques & des manœuvres ; la famille battue est l’origine des esclaves.
Il est impossible dans notre malheureux globe que les hommes vivant en société ne soient pas divisés en deux classes, l’une de riches qui commandent, l’autre de pauvres qui servent ; & ces deux se subdivisent en mille, & ces mille ont encor des nuances différentes.
Tous les pauvres ne sont pas absolument malheureux. La plupart sont nés dans cet état, [I-256] & le travail continuel les empêche de trop sentir leur situation ; mais quand ils la sentent, alors on voit des guerres, comme celle du parti populaire contre le parti du sénat à Rome ; celles des paysans en Allemagne, en Angleterre, en France. Toutes ces guerres finissent tôt ou tard par l’asservissement du peuple, parce que les puissants ont l’argent, & que l’argent est maître de tout dans un État ; je dis dans un État, car il n’en est pas de même de nation à nation. La nation qui se servira le mieux du fer, subjuguera toûjours celle qui aura plus d’or & moins de courage.
Tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse & les plaisirs ; & avec beaucoup de goût pour la paresse : par conséquent tout homme voudrait avoir l’argent & les femmes ou les filles des autres, être leur maître, les assujettir à tous ses caprices, & ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu’avec ces belles dispositions il est aussi impossible que les hommes soient égaux, qu’il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l’un de l’autre.
Le genre humain tel qu’il est, ne peut subsister à moins qu’il n’y ait une infinité d’hommes utiles qui ne possèdent rien du tout. Car certainement un homme à son aise ne quittera pas sa terre pour venir labourer la vôtre ; & si vous avez besoin d’une paire de souliers, ce ne sera pas un maître de requêtes qui vous [I-257] la fera. L’égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle, & en même tems la plus chimérique.
Comme les hommes sont excessifs en tout quand ils le peuvent, on a outré cette inégalité, on a prétendu dans plusieurs pays qu’il n’était pas permis à un citoyen de sortir de la contrée où le hasard l’a fait naître ; le sens de cette loi est visiblement, Ce pays est si mauvais & si mal gouverné que nous défendons à chaque individu d’en sortir, de peur que tout le monde n’en sorte. Faites mieux, donnez à tous vos sujets envie de demeurer chez vous, & aux étrangers d’y venir.
Chaque homme dans le fond de son cœur a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes : il ne s’ensuit pas de là que le cuisinier d’un Cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner ; mais le cuisinier peut dire : Je suis homme comme mon maître ; je suis né comme lui en pleurant ; il mourra comme moi dans les mêmes angoisses & les mêmes cérémonies ; nous faisons tous deux les mêmes fonctions animales ; si les Turcs s’emparent de Rome, & si alors je suis Cardinal & mon maître cuisinier, je le prendrai à mon service. Tout ce discours est raisonnable & juste ; mais en attendant que le grand Turc s’empare de Rome, le cuisinier doit faire son devoir, ou toute société humaine est pervertie.
À l’égard d’un homme qui n’est ni cuisinier d’un Cardinal ni revêtu d’aucune autre charge dans l’État ; à l’égard d’un particulier qui ne [I-258] tient à rien, mais qui est fâché d’être reçu partout avec l’air de la protection ou du mépris, qui voit évidemment que plusieurs Monsignors n’ont ni plus de science, ni plus d’esprit, ni plus de vertu que lui, & qui s’ennuie d’être quelquefois dans leur antichambre, quel parti doit-il prendre ? celui de s’en aller.
ENFER.↩
Dès que les hommes vécurent en société, ils durent s’apercevoir que plusieurs coupables échappaient à la sévérité des loix ; ils punissaient les crimes publics ; il fallut établir un frein pour les crimes secrets ; la religion seule pouvait être ce frein. Les Persans, les Caldéens, les Égyptiens, les Grecs, imaginèrent des punitions après la vie, & de tous les peuples anciens que nous connaissons, les Juifs furent les seuls qui n’admirent que des châtiments temporels. Il est ridicule de croire ou de feindre de croire, sur quelques passages très obscurs, que l’enfer était admis par les anciennes loix des Juifs, par leur Lévitique, par leur Décalogue, quand l’auteur de ces loix ne dit pas un seul mot qui puisse avoir le moindre rapport avec les châtiments de la vie future. On serait en droit de dire au rédacteur du Pentateuque, Vous êtes un homme inconséquent & sans probité, comme sans raison, très indigne du nom de législateur que vous vous [I-259] arrogez. Quoi, vous connaissez un dogme aussi réprimant, aussi nécessaire au peuple que celui de l’enfer, & vous ne l’annoncez pas expressément ? & tandis qu’il est admis chez toutes les nations qui vous environnent, vous vous contentez de laisser deviner ce dogme par quelques commentateurs qui viendront quatre mille ans après vous, & qui donneront la torture à quelques-unes de vos paroles pour y trouver ce que vous n’avez pas dit ? Ou vous êtes un ignorant qui ne savez pas que cette créance était universelle en Égypte, en Caldée, en Perse ; ou vous êtes un homme très mal avisé, si étant instruit de ce dogme vous n’en avez pas fait la base de votre religion.
Les auteurs des loix juives pourraient tout au plus répondre, Nous avoüons que nous sommes excessivement ignorans, que nous avons appris à écrire fort tard, que notre peuple était une horde sauvage & barbare, qui de notre aveu erra près d’un demi-siècle dans des déserts impraticables, qu’elle usurpa enfin un petit pays par les rapines les plus odieuses, & par les cruautés les plus détestables dont jamais l’histoire ait fait mention. Nous n’avions aucun commerce avec les nations policées ; comment voulez-vous que nous pussions (nous les plus terrestres des hommes) inventer un systême tout spirituel ?
Nous ne nous servions du mot qui répond à ame, que pour signifier la vie ; nous ne connumes notre Dieu & ses ministres, ses anges, que comme des êtres corporels : la distinction [I-260] de l’ame & du corps, l’idée d’une vie après la mort, ne peuvent être que le fruit d’une longue méditation, & d’une philosophie très fine. Demandez aux Hottentots, & aux nègres, qui habitent un pays cent fois plus étendu que le nôtre, s’ils connaissent la vie à venir ? Nous avons cru faire assez de persuader à notre peuple, que Dieu punissait les malfaiteurs jusqu’à la quatrième génération, soit par la lèpre, soit par des morts subites, soit par la perte du peu de bien qu’on pouvait posséder.
On répliquerait à cette apologie, Vous avez inventé un systême dont le ridicule saute aux yeux, car le malfaiteur qui se portait bien, & dont la famille prospérait, devait nécessairement se moquer de vous.
L’apologiste de la loi judaïque répondrait alors, Vous vous trompez ; car pour un criminel qui raisonnait juste, il y en avait cent qui ne raisonnaient point du tout. Celui qui ayant commis un crime ne se sentait puni ni dans son corps, ni dans celui de son fils, craignait pour son petit-fils. De plus, s’il n’avait pas aujourd’hui quelque ulcère puant, auquel nous étions très sujets, il en éprouvait dans le cours de quelques années : il y a toûjours des malheurs dans une famille, & nous faisions aisément accroire que ces malheurs étaient envoyés par une main divine, vengeresse des fautes secrettes.
Il serait aisé de répliquer à cette réponse, & de dire, Votre excuse ne vaut rien, car il arrive tous les jours que de très honnêtes gens [I-261] perdent la santé & leurs biens ; & s’il n’y a point de famille à laquelle il ne soit arrivé des malheurs, si ces malheurs sont des châtiments de Dieu, toutes vos familles étaient donc des familles de fripons.
Le prêtre Juif pourrait répliquer encor ; il dirait qu’il y a des malheurs attachés à la nature humaine, & d’autres qui sont envoyés de Dieu expressément. Mais on ferait voir à ce raisonneur combien il est ridicule de penser que la fièvre & la grêle sont tantôt une punition divine, tantôt un effet naturel.
Enfin, les Pharisiens & les Esséniens chez les Juifs, admirent la créance d’un enfer à leur mode : ce dogme avait déjà passé des Grecs aux Romains, & fut adopté par les Chrétiens.
Plusieurs pères de l’Église ne crurent point les peines éternelles ; il leur paraissait absurde de brûler pendant toute l’éternité un pauvre homme pour avoir volé une chèvre. Virgile a beau dire dans son sixième chant de l’Énéïde :
Sedet aeternumque sedebit Infelix Theseus.
Il prétend en vain, que Thésée est assis pour jamais sur une chaise, & que cette posture est son supplice. D’autres croyaient que Thésée est un héros qui n’est point assis en enfer, & qu’il est dans les champs Élisées.
Il n’y a pas longtems qu’un bon honnête ministre huguenot prêcha & écrivit que les damnés auraient un jour leur grace, qu’il fallait une proportion entre le péché & le supplice, & qu’une faute d’un moment ne peut mériter [I-262] un châtiment infini. Les prêtres ses confrères déposèrent ce juge indulgent ; l’un d’eux lui dit, Mon ami, je ne crois pas plus l’enfer éternel que vous ; mais il est bon que votre servante, votre tailleur & même votre procureur le croyent.
ENTOUSIASME.↩
Ce mot grec signifie émotion d’entrailles, agitation intérieure ; les Grecs inventèrent-ils ce mot pour exprimer les secousses qu’on éprouve dans les nerfs, la dilatation & le resserrement des intestins, les violentes contractions du cœur, le cours précipité de ces esprits de feu qui montent des entrailles au cerveau, quand on est vivement affecté ?
Ou bien donna-t-on d’abord le nom d’entousiasme, de trouble des entrailles, aux contorsions de cette pythie qui sur le trépied de Delphes recevait l’esprit d’Apollon par un endroit qui ne semble fait que pour recevoir des corps ?
Qu’entendons-nous par entousiasme ? que de nuances dans nos affections ! approbation, sensibilité, émotion, trouble, saisissement, passion, emportement, démence, fureur, rage. Voilà tous les états par lesquels peut passer cette pauvre ame humaine.
Un géomètre assiste à une tragédie touchante, il remarque seulement qu’elle est bien conduite. Un jeune homme à côté de lui est ému [I-263] et ne remarque rien, une femme pleure, un autre jeune homme est si transporté, que pour son malheur il va faire aussi une tragédie. Il a pris la maladie de l’entousiasme.
Le Centurion ou le Tribun militaire qui ne regardait la guerre que comme un métier dans lequel il y avait une petite fortune à faire, allait au combat tranquillement comme un couvreur monte sur un toit. César pleurait en voyant la statue d’Alexandre.
Ovide ne parlait d’amour qu’avec esprit. Sapho exprimait l’entousiasme de cette passion ; & s’il est vrai qu’elle lui coûta la vie, c’est que l’entousiasme chez elle devint démence. L’esprit de parti dispose merveilleusement à l’entousiasme, il n’est point de faction qui n’ait ses énergumènes.
L’entousiasme est surtout le partage de la dévotion mal entenduë. Le jeune faquir qui voit le bout de son nez en faisant ses prières, s’échauffe par degrés jusqu’à croire que s’il se charge de chaînes pesant cinquante livres, l’Être suprême lui aura beaucoup d’obligation. Il s’endort l’imagination toute pleine de Brama, & il ne manque pas de le voir en songe quelquefois même dans cet état où l’on n’est ni endormi ni éveillé, des étincelles sortent de ses yeux, il voit Brama resplendissant de lumière, il a des extases, & cette maladie devient souvent incurable.
La chose la plus rare est de joindre la raison avec l’entousiasme, la raison consiste à voir toûjours les choses comme elles sont. Celui qui dans l’ivresse voit les objets doubles est alors [I-264] privé de sa raison ; l’entousiasme est précisément comme le vin. Il peut exciter tant de tumulte dans les vaisseaux sanguins, & de si violentes vibrations dans les nerfs, que la raison en est tout à fait détruite. Il peut ne causer que de légères secousses qui ne fassent que donner au cerveau un peu plus d’activité. C’est ce qui arrive dans les grands mouvemens d’éloquence, & surtout dans la poësie sublime. L’entousiasme raisonnable est le partage des grands poëtes.
Cet entousiasme raisonnable est la perfection de leur art, c’est ce qui fit croire autrefois qu’ils étaient inspirés des dieux, & c’est ce qu’on n’a jamais dit des autres artistes.
Comment le raisonnement peut-il gouverner l’entousiasme ? c’est qu’un poëte dessine d’abord l’ordonnance de son tableau. La raison alors tient le crayon, mais veut-il animer ses personnages & leur donner le caractère des passions ? alors l’imagination s’échauffe, l’entousiasme agit. C’est un coursier qui s’emporte dans sa carrière, mais la carrière est régulièrement tracée.
ESPRIT FAUX.↩
Nous avons des aveugles, des borgnes, des bigles, des louches, des vuës longues, des vuës courtes, ou distinctes, ou confuses, ou faibles, ou infatigables. Tout cela est une image assez fidelle de notre entendement. Mais on ne connaît guère de vuë fausse. Il n’y a guère d’hommes qui prenne toûjours un [I-265] coq pour un cheval, ni un pot de chambre pour une maison. Pourquoi rencontre-t-on souvent des esprits assez justes d’ailleurs, qui sont absolument faux sur des choses importantes ? Pourquoi ce même Siamois qui ne se laissera jamais tromper quand il sera question de lui compter trois roupies, croit-il fermement aux métamorphoses de Sammonocodom ? Par quelle étrange bizarrerie des hommes sensés ressemblent-ils à Don Quichote, qui croyait voir des géants où les autres hommes ne voyaient que des moulins à vent ? Encore Don Quichote était plus excusable que le Siamois qui croit que Sammonocodom est venu plusieurs fois sur la terre, & que le Turc qui est persuadé que Mahomet a mis la moitié de la lune dans sa manche. Car Don Quichote frappé de l’idée qu’il doit combattre des géants, peut se figurer qu’un géant doit avoir le corps aussi gros qu’un moulin, & les bras aussi longs que les ailes du moulin : mais de quelle supposition peut partir un homme sensé pour se persuader que la moitié de la lune est entrée dans une manche, & qu’un Sammonocodom est descendu du ciel pour venir jouer au cerf-volant à Siam, couper une forêt, & faire des tours de passe-passe ?
Les plus grands génies peuvent avoir l’esprit faux sur un principe qu’ils ont reçu sans examen. Newton avait l’esprit très faux quand il commentait l’Apocalypse.
Tout ce que certains tyrans des ames désirent, c’est que les hommes qu’ils enseignent, aient l’esprit faux. Un faquir élève un [I-266] enfant qui promet beaucoup ; il emploie cinq ou six années à lui enfoncer dans la tête que le dieu Fo apparut aux hommes en éléphant blanc, & il persuade l’enfant qu’il sera fouetté après sa mort pendant cinq cent mille années, s’il ne croit pas ces métamorphoses. Il ajoute qu’à la fin du monde l’ennemi du dieu Fo viendra combattre contre cette divinité.
L’enfant étudie & devient un prodige ; il argumente sur les leçons de son maître, il trouve que Fo n’a pû se changer qu’en éléphant blanc, parce que c’est le plus beau des animaux. Les rois de Siam & du Pégu, dit-il, se sont fait la guerre pour un éléphant blanc ; certainement si Fo n’avait pas été caché dans cet éléphant, ces rois n’auraient pas été si insensés que de combattre pour la possession d’un simple animal.
L’ennemi de Fo viendra le défier à la fin du monde ; certainement cet ennemi sera un rinocerot, car le rinocerot combat l’éléphant. C’est ainsi que raisonne dans un âge mûr l’élève savant du faquir, & il devient une des lumières des Indes ; plus il a l’esprit subtil, plus il l’a faux, & il forme ensuite des esprits faux comme lui.
On montre à tous ces énergumènes un peu de géométrie, & ils l’apprennent assez facilement ; mais, chose étrange ! Leur esprit n’est pas redressé pour cela ; ils aperçoivent les vérités de la géométrie, mais elle ne leur apprend point à peser les probabilités ; ils ont pris leur pli, ils raisonneront de travers toute leur vie, & j’en suis fâché pour eux.
[I-267]
ÉTATS, GOUVERNEMENS.↩
Quel est le meilleur ?
Je n’ai jusqu’à présent connu personne qui n’ait gouverné quelque État. Je ne parle pas de messieurs les ministres, qui gouvernent en effet, les uns deux ou trois ans, les autres six mois, les autres six semaines ; je parle de tous les autres hommes qui à souper ou dans leur cabinet étalent leur systême de gouvernement, réformant les armées, l’Église, la robe & la finance.
L’Abbé de Bourzeis se mit à gouverner la France vers l’an 1645 sous le nom de Cardinal de Richelieu, & fit ce Testament politique dans lequel il veut enrôler la Noblesse dans la cavalerie pour trois ans, faire payer la taille aux Chambres des comptes & aux Parlemens, priver le Roi du produit de la gabelle ; il assure surtout que pour entrer en campagne avec cinquante mille hommes, il faut par économie en lever cent mille. Il affirme que la Provence seule a beaucoup plus de beaux ports de mer, que l’Espagne & l’Italie ensemble.
L’Abbé de Bourzeis n’avait pas voyagé. Au reste, son ouvrage fourmille d’anacronismes & d’erreurs ; il fait signer le Cardinal de Richelieu d’une manière dont il ne signa jamais, ainsi qu’il le fait parler comme il n’a jamais parlé. Au surplus, il emploie un chapitre entier à dire que la raison doit être la règle d’un État, [I-268] & à tâcher de prouver cette découverte ; cet ouvrage de ténèbres, ce bâtard de l’Abbé de Bourzeis a passé longtems pour le fils légitime du Cardinal de Richelieu, & tous les académiciens, dans leurs discours de réception, ne manquaient pas de louer démesurément ce chef-d’œuvre de politique.
Le Sr. Gratien de Courtils voyant le succès du Testament politique de Richelieu, fit imprimer à la Haye le Testament de Colbert, avec une belle lettre de M. Colbert au Roi. Il est clair que si ce Ministre avait fait un pareil testament, il eût fallu l’interdire ; cependant ce livre a été cité par quelques auteurs. Un autre gredin, dont on ignore le nom, ne manqua pas de donner le Testament de Louvois, plus mauvais encor, s’il se peut, que celui de Colbert ; & un Abbé de Chévremont fit tester aussi Charles Duc de Lorraine. Nous avons eu les Testamens politiques du Cardinal Albéroni, du Maréchal de Belle-Isle, & enfin, celui de Mandrin.
Mr. de Boisguilebert, auteur du détail de la France, imprimé en 1695, donna le projet inexécutable de la dixme royale, sous le nom du Maréchal de Vauban.
Un fou nommé la Jonchère, qui n’avait pas de pain, fit en 1720 un projet de finance en quatre volumes, & quelques sots ont cité cette production, comme un ouvrage de la Jonchère le trésorier général, s’imaginant qu’un trésorier ne peut faire un mauvais livre de finances.
Mais il faut convenir que des hommes très [I-269] sages, très dignes peut-être de gouverner, ont écrit sur l’administration des États, soit en France, soit en Espagne, soit en Angleterre. Leurs livres ont fait beaucoup de bien ; ce n’est pas qu’ils aient corrigé les Ministres qui étaient en place quand ces livres parurent, car un Ministre ne se corrige point, & ne peut se corriger ; il a pris sa croissance, plus d’instructions, plus de conseils, il n’a pas le tems de les écouter, le courant des affaires l’emporte ; mais ces bons livres forment les jeunes gens destinés aux places, ils forment les Princes, & la seconde génération est instruite.
Le fort & le faible de tous les gouvernemens a été examiné de près dans les derniers tems. Dites-moi donc, vous qui avez voyagé, qui avez lu & vu, dans quel État, dans quelle sorte de gouvernement voudriez-vous être né ? Je conçois qu’un grand seigneur terrien en France ne serait pas fâché d’être né en Allemagne ; il serait souverain, au lieu d’être sujet. Un pair de France serait fort aise d’avoir les privilèges de la pairie Anglaise, il serait législateur.
L’homme de robe & le financier se trouveraient mieux en France qu’ailleurs.
Mais quelle patrie choisirait un homme sage, libre, un homme d’une fortune médiocre, & sans préjugés ?
Un membre du conseil de Pondichéri, assez savant, revenait en Europe par terre avec un Brame, plus instruit que les Brames ordinaires. Comment trouvez-vous le gouvernement [I-270] du grand Mogol ? dit le conseiller. Abominable, répondit le Brame : comment voulez-vous qu’un État soit heureusement gouverné par des Tartares ? Nos Rayas, nos Omras, nos Nababs sont fort contents ; mais les citoyens ne le sont guère, & des millions de citoyens sont quelque chose.
Le Conseiller & le Brame traversèrent en raisonnant toute la haute Asie. Je fais une réflexion, dit le Brame, c’est qu’il n’y a pas une république dans toute cette vaste partie du monde. Il y a eu autrefois celle de Tyr, dit le Conseiller, mais elle n’a pas duré longtems ; il y en avait encor une autre vers l’Arabie pétrée, dans un petit coin nommé la Palestine, si on peut honorer du nom de république une horde de voleurs & d’usuriers, tantôt gouvernée par des juges, tantôt par des espèces de Rois, tantôt par des grands pontifes, devenue esclave sept ou huit fois, & enfin chassée du pays qu’elle avait usurpé.
Je conçois, dit le Brame, qu’on ne doit trouver sur la terre que très peu de républiques. Les hommes sont rarement dignes de se gouverner eux-mêmes. Ce bonheur ne doit appartenir qu’à des petits peuples, qui se cachent dans des îles, ou entre des montagnes, comme des lapins qui se dérobent aux animaux carnassiers, mais à la longue ils sont découverts & dévorés.
Quand les deux voyageurs furent arrivés dans l’Asie mineure, le Conseiller dit au Brame, Croiriez-vous bien qu’il y a eu une [I-271] république formée dans un coin de l’Italie, qui a duré plus de cinq cents ans, & qui a possédé cette Asie mineure, l’Asie, l’Afrique, la Grèce, les Gaules, l’Espagne, & l’Italie entière ? Elle se tourna donc bien vite en monarchie, dit le Brame ? Vous l’avez deviné, dit l’autre. Mais cette monarchie est tombée, & nous faisons tous les jours de belles dissertations pour trouver les causes de sa décadence & de sa chute. Vous prenez bien de la peine, dit l’Indien ; cet Empire est tombé parce qu’il existait. Il faut bien que tout tombe ; j’espère bien qu’il en arrivera tout autant à l’Empire du grand Mogol.
À propos, dit l’Européen, croyez-vous qu’il faille plus d’honneur dans un État despotique, & plus de vertu dans une République ? L’Indien s’étant fait expliquer ce qu’on entend par honneur, répondit que l’honneur était plus nécessaire dans une République, & qu’on avait bien plus besoin de vertu dans un État monarchique. Car, dit-il, un homme qui prétend être élu par le peuple, ne le sera pas s’il est déshonoré ; au lieu qu’à la cour il pourra aisément obtenir une charge, selon la maxime d’un grand prince, qu’un courtisan pour réussir doit n’avoir ni honneur, ni humeur. À l’égard de la vertu, il en faut prodigieusement dans une Cour pour oser dire la vérité. L’homme vertueux est bien plus à son aise dans une république, il n’a personne à flatter.
Croyez-vous, dit l’homme d’Europe, que les loix & les religions soient faites pour les [I-272] climats, de même qu’il faut des fourrures à Moscou, & des étoffes de gaze à Dély ? Oui, sans doute, dit le Brame ; toutes les loix qui concernent la physique, sont calculées pour le méridien qu’on habite ; il ne faut qu’une femme à un Allemand, & il en faut trois ou quatre à un Persan.
Les rites de la religion sont de même nature. Comment voudriez-vous, si j’étais chrétien, que je disse la messe dans ma province, où il n’y a ni pain ni vin ? À l’égard des dogmes, c’est autre chose ; le climat n’y fait rien. Votre religion n’a-t-elle pas commencé en Asie, d’où elle a été chassée ; n’existe-t-elle pas vers la mer Baltique, où elle était inconnue ?
Dans quel État, sous quelle domination aimeriez-vous mieux vivre ? dit le Conseiller. Partout ailleurs que chez moi, dit son compagnon ; & j’ai trouvé beaucoup de Siamois, de Tunquinois, de Persans, & de Turcs qui en disaient autant. Mais encor une fois, dit l’Européen, quel État choisiriez-vous ? Le Brame répondit ; Celui où l’on n’obéit qu’aux loix. C’est une vieille réponse, dit le Conseiller. Elle n’en est pas plus mauvaise, dit le Brame. Où est ce pays-là ? dit le Conseiller. Le Brame dit, Il faut le chercher. Voyez l’article GENÈVE
[I-273]
ÉVANGILE.↩
C’est une grande question de savoir quels sont les premiers Évangiles. C’est une vérité constante, quoi qu’en dise Abadie, qu’aucun des premiers pères de l’Église inclusivement jusqu’à Irénée, ne cite aucun passage des quatre Évangiles que nous connaissons. Au contraire les Alloges, les Théodosiens rejetèrent constamment l’Évangile de St. Jean, & ils en parlaient toûjours avec mépris, comme l’avance St. Épiphane dans sa 34e homélie. Nos ennemis remarquent encor que non seulement les plus anciens pères ne citent jamais rien de nos Évangiles ; mais qu’ils rapportent plusieurs passages qui ne se trouvent que dans les Évangiles apocryphes rejetés du Canon.
St. Clément, par exemple, rapporte que notre Seigneur ayant été interrogé sur le tems où son royaume adviendrait, répondit, ce sera quand deux ne feront qu’un, quand le dehors ressemblera au dedans & quand il n’y aura ni mâle ni femelle. Or il faut avouer que ce passage ne se trouve dans aucun de nos Évangiles. Il y a cent exemples qui prouvent cette vérité ; on les peut recueillir dans l’Examen critique de M. Fréret secrétaire perpétuel de l’Académie des belles-lettres de Paris.
Le savant Fabricius s’est donné la peine de rassembler les anciens Évangiles que le tems a conservés, celui de Jacques paraît le [I-274] premier. Il est certain qu’il a encor beaucoup d’autorité dans quelques Églises d’Orient. Il est appelé premier Évangile. Il nous reste la passion & la résurrection, qu’on prétend écrites par Nicodème. Cet Évangile de Nicodème est cité par St. Justin & par Tertullien, c’est là qu’on trouve les noms des accusateurs de notre Sauveur, Annas, Caïphas, Soumas, Dathan, Gamaliel, Judas, Levi, Nephtali ; l’attention de rapporter ces noms, donne une apparence de candeur à l’ouvrage. Nos adversaires ont conclu que puisqu’on supposa tant de faux Évangiles reconnus d’abord pour vrais, on peut aussi avoir supposé ceux qui font aujourd’hui l’objet de notre croyance. Ils insistent beaucoup sur la foi des premiers hérétiques qui moururent pour ces évangiles apocryphes. Il y eut donc des faussaires, des séducteurs & des gens séduits qui moururent pour l’erreur ; ce n’est donc pas une preuve de la vérité de notre religion que des martyrs soient morts pour elle.
Ils ajoutent de plus qu’on ne demanda jamais aux martyrs : Croyez-vous à l’Évangile de Jean, ou à l’Évangile de Jacques ? Les païens ne pouvaient fonder des interrogatoires sur des livres qu’ils ne connaissaient pas : les Magistrats punirent quelques Chrétiens comme perturbateurs du repos public ; mais ils ne les interrogèrent jamais sur nos quatre Évangiles. Ces livres ne furent un peu connus des Romains que sous Trajan, & ils ne furent entre les mains du public que dans les dernières années de Dioclétien. Les Sociniens rigides ne regardent [I-275] donc nos quatre Évangiles que comme des ouvrages clandestins fabriqués environ un siècle après Jésus-Christ, & cachés soigneusement aux Gentils pendant un autre siècle. Ouvrages, disent-ils, grossièrement écrits par des hommes grossiers qui ne s’adressèrent longtems qu’à la populace. Nous ne voulons pas répéter ici leurs autres blasphèmes. Cette secte, quoique assez répandue, est aujourd’hui aussi cachée que l’étaient les premiers Évangiles. Il est d’autant plus difficile de les convertir, qu’ils ne croient que leur raison. Les autres Chrétiens ne combattent contre eux que par la voix sainte de l’Écriture : ainsi il est impossible que les uns & les autres étant toûjours ennemis, puissent jamais se rencontrer.
D’EZÉCHIEL.↩
De quelques passages singuliers de ce prophète, & de quelques usages anciens.
On sait assez aujourd’hui qu’il ne faut pas juger des usages anciens par les modernes : qui voudrait réformer la cour d’Alcinoüs dans l’Odyssée, sur celle du grand Turc, ou de Louis XIV, ne serait pas bien reçu des savants : qui reprendrait Virgile d’avoir représenté le roi Évandre couvert d’une peau d’ours, & accompagné de deux chiens, pour recevoir des ambassadeurs, serait un mauvais critique.
[I-276]
Les mœurs des anciens Égyptiens & Juifs sont encor plus différentes des nôtres, que celles du roi Alcinoüs, de Nausica sa fille, & du bonhomme Évandre. Ézéchiel esclave chez les Caldéens eut une vision près de la petite rivière de Chobar qui se perd dans l’Euphrate.
On ne doit point être étonné qu’il ait vû des animaux à quatre faces, & à quatre aîles, avec des pieds de veau, ni des roues qui marchaient toutes seules, & qui avaient l’esprit de vie ; ces symboles plaisent même à l’imagination ; mais plusieurs critiques se sont révoltés contre l’ordre que le Seigneur lui donna de manger pendant trois cent quatre-vingt-dix jours, du pain d’orge, de froment & de millet couvert d’excréments humains.
Le prophète s’écria, pouah ! pouah ! pouah ! mon ame n’a point été jusqu’ici pollüe ; & le Seigneur lui répondit, Eh bien, je vous donne de la fiente de bœuf au lieu d’excrément d’homme, & vous paîtrirez votre pain avec cette fiente.
Comme il n’est point d’usage de manger de telles confitures sur son pain, la plupart des hommes trouvent ces commandemens indignes de la majesté divine. Cependant il faut avoüer que de la bouse de vache & tous les diamans du grand Mogol sont parfaitement égaux, non seulement aux yeux d’un être divin, mais à ceux d’un vrai philosophe ; & à l’égard des raisons que Dieu pouvait avoir d’ordonner un tel déjeuner au prophète, ce n’est pas à nous de les demander.
[I-277]
Il suffit de faire voir que ces commandements qui nous paraissent étranges, ne le parurent pas aux Juifs. Il est vrai que la Synagogue ne permettait pas du tems de St. Jérôme la lecture d’Ézéchiel avant l’âge de trente ans ; mais c’était parce que dans le chapitre 18. il dit que le fils ne portera plus l’iniquité de son père, & qu’on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verds, & les dents des enfans en sont agacées.
En cela il se trouvait expressément en contradiction avec Moïse qui au chap. 28. des Nombres, assure que les enfans portent l’iniquité des pères, jusqu’à la troisième & quatrième génération.
Ézéchiel au chap. 20. fait dire encor au Seigneur, qu’il a donné aux Juifs des préceptes qui ne sont pas bons. Voilà pourquoi la Synagogue interdisait aux jeunes gens une lecture qui pouvait faire douter de l’irréfragabilité des loix de Moïse.
Les censeurs de nos jours sont encor plus étonnés du chap. 16. d’Ézéchiel ; voici comme ce prophète s’y prend pour faire connaître les crimes de Jérusalem. Il introduit le Seigneur parlant à une fille, & le Seigneur dit à la fille : Lorsque vous naquîtes, on ne vous avait point encor coupé le boyau du nombril, on ne vous avait point salée, vous étiez toute nüe, j’eus pitié de vous ; vous êtes devenüe grande, votre sein s’est formé, votre poil a paru, j’ai passé, je vous ai vue, j’ai connu que c’était le tems des amants ; j’ai couvert votre ignominie ; [I-278] je me suis étendu sur vous avec mon manteau ; vous avez été à moi ; je vous ai lavée, parfumée, bien habillée, bien chaussée ; je vous ai donné une écharpe de coton, des bracelets, un collier ; je vous ai mis une pierrerie au nez, des pendants d’oreilles, & une couronne sur la tête, &c.
Alors, ayant confiance à votre beauté, vous avez forniqué pour votre compte avec tous les passants… Et vous avez bâti un mauvais lieu… & vous vous êtes prostituée jusque dans les places publiques, & vous avez ouvert vos jambes à tous les passans… & vous avez couché avec des Égyptiens… & enfin, vous avez payé des amans, & vous leur avez fait des présents, afin qu’ils couchassent avec vous… ; & en payant au lieu d’être payée, vous avez fait le contraire des autres filles… Le proverbe est, telle mère, telle fille, & c’est ce qu’on dit de vous, &c.
On s’élève encor davantage contre le chapitre 23. Une mère avait deux filles qui ont perdu leur virginité de bonne heure ; la plus grande s’appelait Oholla, & la petite Oliba… Oholla a été folle des jeunes seigneurs, magistrats, cavaliers ; elle a couché avec des Égyptiens dès sa première jeunesse… Oliba sa sœur a bien plus forniqué encor avec des officiers, des magistrats & des cavaliers bien faits ; elle a découvert sa turpitude, elle a multiplié ses fornications, elle a recherché avec emportement les embrassemens de ceux qui ont leur membre comme un âne, & qui répandent leur semence comme des chevaux……
[I-279]
Ces descriptions qui effarouchent tant d’esprits faibles ne signifient pourtant que les iniquités de Jérusalem & de Samarie ; les expressions qui nous paraissent libres ne l’étaient point alors. La même naïveté se montre sans crainte, dans plus d’un endroit de l’Écriture. Il y est souvent parlé d’ouvrir la vulve. Les termes dont elle se sert pour exprimer l’accouplement de Boos avec Ruth, de Juda avec sa belle-fille, ne sont point déshonnêtes en hébreu, & le seraient en notre langue.
On ne se couvre point d’un voile quand on n’a pas honte de sa nudité ; comment dans ces tems-là aurait-on rougi de nommer les génitoires, puisqu’on touchait les génitoires de ceux à qui l’on faisait quelque promesse ; c’était une marque de respect, un symbole de fidélité, comme autrefois parmi nous les seigneurs châtelains mettaient leurs mains entre celles de leurs seigneurs paramonts.
Nous avons traduit les génitoires par cuisse. Éliezer met la main sous la cuisse d’Abraham : Joseph met la main sous la cuisse de Jacob. Cette coutume était fort ancienne en Égypte. Les Égyptiens étaient si éloignés d’attacher de la turpitude à ce que nous n’osons ni découvrir, ni nommer, qu’ils portaient en procession une grande figure du membre viril nommé Phallum, pour remercier les dieux de faire servir ce membre à la propagation du genre humain.
Tout cela prouve assez que nos bienséances ne sont pas les bienséances des autres peuples. [I-280] Dans quel tems y a-t-il eu chez les Romains plus de politesse que du tems du siècle d’Auguste ? Cependant, Horace ne fait nulle difficulté de dire dans une pièce morale,
Nec metuo, nedum futuo, vir rure recurrat.
Auguste se sert de la même expression dans une épigramme contre Fulvie.
Un homme qui prononcerait parmi nous le mot qui répond à futuo, serait regardé comme un crocheteur yvre ; ce mot, & plusieurs autres dont se servent Horace, & d’autres auteurs, nous paraît encor plus indécent que les expressions d’Ézéchiel. Défaisons-nous de tous nos préjugés quand nous lisons d’anciens auteurs, ou que nous voyageons chez des nations éloignées. La nature est la même partout, & les usages partout différens.
Je rencontrai un jour dans Amsterdam un Rabbin tout plein de ce chapitre. Ah ! mon ami, dit-il, que nous vous avons d’obligation ! Vous avez fait connaître toute la sublimité de la loi Mosaïque, le déjeuner d’Ézéchiel, ses belles attitudes sur le côté gauche ; Oholla & Oliba sont choses admirables, ce sont des types, mon frère, des types, qui figurent qu’un jour le peuple juif sera maître de toute la terre ; mais pourquoi en avez-vous omis tant d’autres qui sont à peu près de cette force ? pourquoi n’avez-vous pas représenté le Seigneur disant au sage Osée dès le second verset du premier chapitre. Osée, prends une fille de joie, & fais-lui des fils de fille de joye. Ce [I-281] sont ses propres paroles. Osée prit la demoiselle, il en eut un garçon, & puis une fille, & puis encor un garçon, & c’était un type, & ce type dura trois années. Ce n’est pas tout, dit le Seigneur au 3e chapitre. Va-t’en prendre une femme qui soit non seulement débauchée, mais adultère ; Osée obéit, mais il lui en coûta quinze écus, & un setier & demi d’orge ; car vous savez que dans la terre promise il y avait très peu de froment. Mais savez-vous ce que tout cela signifie ? Non, lui dis-je ; Ni moi non plus, dit le rabbin.
Un grave savant s’approcha & nous dit que c’était des fictions ingénieuses & toutes remplies d’agrément. Ah, monsieur, lui répondit un jeune homme fort instruit, si vous voulez des fictions, croyez-moi, préférez celles d’Homère, de Virgile & d’Ovide, quiconque aime les prophéties d’Ézéchiel mérite de déjeuner avec lui.
[I-281]
FABLES.↩
Les plus anciennes fables ne sont-elles pas visiblement allégoriques ? La première que nous connaissions dans notre manière de supputer les tems, n’est-ce pas celle qui est rapportée dans le neuvième chapitre du livre des Juges ; Il fallut choisir un roi parmi les arbres ; l’olivier ne voulut point abandonner le soin de son [I-282] huile, ni le figuier celui de ses figues, ni la vigne celui de son vin, ni les autres arbres celui de leur fruit ; le chardon qui n’était bon à rien, se fit roi, parce qu’il avait des épines & qu’il pouvait faire du mal.
L’ancienne fable de Vénus, telle qu’elle est rapportée dans Hésiode, n’est-elle pas une allégorie de la nature entière ? Les parties de la génération sont tombées de l’éther sur le rivage de la mer ; Vénus naît de cette écume précieuse ; son premier nom est celui d’amante de la génération : y a-t-il une image plus sensible ? Cette Vénus est la déesse de la beauté ; la beauté cesse d’être aimable, si elle marche sans les graces ; la beauté fait naître l’amour ; l’amour a des traits qui percent les cœurs ; il porte un bandeau qui cache les défauts de ce qu’on aime.
La sagesse est conçue dans le cerveau du maître des dieux sous le nom de Minerve ; l’ame de l’homme est un feu divin que Minerve montre à Prométhée, qui se sert de ce feu divin pour animer l’homme.
Il est impossible de ne pas reconnaître dans ces fables une peinture vivante de la nature entière. La plûpart des autres fables sont ou la corruption des histoires anciennes, ou le caprice de l’imagination. Il en est des anciennes fables comme de nos contes modernes ; il y en a de moraux qui sont charmants, il y en a qui sont insipides.
Les fables des anciens peuples ingénieux ont été grossièrement imitées par des peuples [I-283] grossiers, témoin celles de Bacchus, d’Hercule, de Prométhée, de Pandore & tant d’autres ; elles étaient l’amusement de l’ancien monde. Les Barbares qui en entendirent parler confusément les firent entrer dans leur mythologie sauvage, & ensuite ils osèrent dire, C’est nous qui les avons inventées. Hélas ! pauvres peuples ignorés & ignorans, qui n’avez connu aucun art ni agréable, ni utile, chez qui même le nom de géométrie ne parvint jamais, pouvez-vous dire que vous avez inventé quelque chose ? Vous n’avez su ni trouver des vérités ni mentir habilement.
FANATISME.↩
Le Fanatisme est à la superstition, ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités, & ses imaginations pour des prophéties, est un entousiaste ; celui qui soutient sa folie par le meurtre, est un fanatique. Jean Diaz, retiré à Nuremberg, qui était fermement convaincu que le Pape est l’Antéchrist de l’Apocalypse, & qu’il a le signe de la bête, n’était qu’un enthousiaste ; son frère Barthelemi Diaz qui partit de Rome pour aller assassiner saintement son frère, & qui le tua en effet pour l’amour de Dieu, était un des plus abominables fanatiques que la superstition ait pu jamais former.
[I-284]
Polyeucte qui va au temple dans un jour de solennité renverser & casser les statues & les ornements, est un fanatique moins horrible que Diaz, mais non moins sot. Les assassins du Duc François de Guise, de Guillaume Prince d’Orange, du roi Henri III, & du roi Henri IV, de tant d’autres, étaient des énergumènes malades de la même rage que Diaz.
Le plus détestable exemple de fanatisme, est celui des bourgeois de Paris qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces la nuit de la St. Barthélemi leurs concitoyens qui n’allaient point à la messe.
Il y a des fanatiques de sang-froid ; ce sont les juges qui condamnent à la mort ceux qui n’ont d’autre crime que de ne pas penser comme eux ; & ces juges-là sont d’autant plus coupables, d’autant plus dignes de l’exécration du genre humain, que n’étant pas dans un accès de fureur, comme les Cléments, les Châtels, les Ravaillacs, les Damiens, il semble qu’ils pourraient écouter la raison.
Lorsqu’une fois le fanatisme a gangrené un cerveau, la maladie est presque incurable. J’ai vu des convulsionnaires, qui en parlant des miracles de St. Pâris, s’échauffaient par degrés malgré eux ; leurs yeux s’enflammaient, leurs membres tremblaient, la fureur défigurait leur visage ; & ils auraient tué quiconque les eût contredits.
Il n’y a d’autre remède à cette maladie épidémique que l’esprit philosophique, qui répandu de proche en proche adoucit enfin les mœurs [I-285] des hommes, & qui prévient les accès du mal ; car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir, & attendre que l’air soit purifié. Les loix & la religion ne suffisent pas contre la peste des ames ; la religion loin d’être pour elles un aliment salutaire, se tourne en poison dans les cerveaux infectés. Ces misérables ont sans cesse présent à l’esprit l’exemple d’Aod, qui assassine le Roi Églon ; de Judith, qui coupe la tête d’Holopherne en couchant avec lui ; de Samuel qui hâche en morceaux le roi Agag : ils ne voient pas que ces exemples qui sont respectables dans l’antiquité, sont abominables dans le tems présent ; ils puisent leurs fureurs dans la religion même qui les condamne.
Les loix sont encor très impuissantes contre ces accès de rage ; c’est comme si vous lisiez un arrêt du conseil à un frénétique. Ces gens-là sont persuadés que l’Esprit Saint qui les pénètre, est au-dessus des loix, que leur enthousiasme est la seule loi qu’ils doivent entendre.
Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, & qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?
Ce sont d’ordinaire les fripons qui conduisent les fanatiques, & qui mettent le poignard entre leurs mains ; ils ressemblent à ce vieux de la montagne qui faisait, dit-on, goûter les joyes du paradis à des imbéciles, & qui leur promettait une éternité de ces plaisirs, dont il leur avait donné un avant-goût, à condition qu’ils iraient assassiner tous ceux qu’il leur [I-286] nommerait. Il n’y a eu qu’une seule religion dans le monde qui n’ait pas été souillée par le fanatisme, c’est celle des lettrés de la Chine. Les sectes des philosophes étaient non seulement exemptes de cette peste, mais elles en étaient le remède.
Car l’effet de la philosophie est de rendre l’ame tranquille, & le fanatisme est incompatible avec la tranquillité. Si notre sainte Religion a été si souvent corrompue par cette fureur infernale, c’est à la folie des hommes qu’il faut s’en prendre.
Ainsi du plumage qu’il eut
Icare pervertit l’usage ;
Il le reçut pour son salut,
Il s’en servit pour son dommage.
Bertaud, Évêque de Sées.
FAUSSETÉ DES VERTUS HUMAINES.↩
Quand le duc de la Rochefoucault eut écrit ses pensées sur l’amour-propre, & qu’il eut mis à découvert ce ressort de l’homme, un monsieur Esprit, de l’oratoire, écrivit un livre captieux, intitulé, De la fausseté des vertus humaines. Cet Esprit dit qu’il n’y a point de vertu ; mais par grace il termine chaque chapitre en [I-287] renvoyant à la charité chrétienne. Ainsi selon le Sieur Esprit, ni Caton, ni Aristide, ni Marc-Aurèle, ni Épictète, n’étaient des gens de bien : mais on n’en peut trouver que chez les Chrétiens. Parmi les Chrétiens il n’y a de vertu que chez les Catholiques ; parmi les Catholiques, il fallait encor en excepter les Jésuites, ennemis des oratoriens ; partant la vertu ne se trouvait guère que chez les ennemis des jésuites.
Ce Mr. Esprit commence par dire, que la prudence n’est pas une vertu ; & sa raison est qu’elle est souvent trompée. C’est comme si on disait que César n’était pas un grand capitaine, parce qu’il fut battu à Dirrachium.
Si Mr. Esprit avait été philosophe, il n’aurait pas examiné la prudence comme une vertu, mais comme un talent, comme une qualité utile, heureuse ; car un scélérat peut être très prudent, & j’en ai connu de cette espèce. Ô la rage de prétendre que
Nul n’aura de vertu que nous & nos amis !
Qu’est-ce que la vertu, mon ami ? C’est de faire du bien. Fai-nous-en, & cela suffit. Alors nous te ferons grace du motif. Quoi ! selon toi, il n’y aura nulle différence entre le président de Thou, & Ravaillac ? entre Cicéron & ce Popilius auquel il avait sauvé la vie, & qui lui coupa la tête pour de l’argent ? & tu déclareras Épictète & Porphyre des coquins, pour n’avoir pas suivi nos dogmes ? Une telle insolence révolte. Je n’en dirai pas davantage, car je me mettrais en colère.
[I-288]
FIN. CAUSES FINALES.↩
Il paraît qu’il faut être forcené pour nier que les estomacs soient faits pour digérer, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre.
D’un autre côté il faut avoir un étrange amour des causes finales pour assurer que la pierre a été formée pour bâtir des maisons, & que les vers à soye sont nés à la Chine afin que nous ayons du satin en Europe.
Mais, dit-on, si Dieu a fait visiblement une chose à dessein, il a donc fait toutes choses à dessein. Il est ridicule d’admettre la Providence dans un cas, & de la nier dans les autres. Tout ce qui est fait a été prévu, a été arrangé. Nul arrangement sans objet, nul effet sans cause ; donc tout est également le résultat, le produit d’une cause finale ; donc il est aussi vrai de dire que les nez ont été faits pour porter des lunettes, & les doigts pour être ornés de diamants, qu’il est vrai de dire que les oreilles ont été formées pour entendre les sons, & les yeux pour recevoir la lumière.
Je crois qu’on peut aisément éclaircir cette difficulté, quand les effets sont invariablement les mêmes, en tous lieux & en tout tems ; quand ces effets uniformes sont indépendants des êtres auxquels ils appartiennent, alors il y a visiblement une cause finale.
Tous les animaux ont des yeux, & ils voient ; tous ont des oreilles, & ils entendent ; [I-289] tous une bouche par laquelle ils mangent ; un estomac, ou quelque chose d’approchant, par lequel ils digèrent ; tous un orifice qui expulse les excrémens, tous un instrument de la génération : & ces dons de la nature opèrent en eux sans qu’aucun art s’en mêle. Voilà des causes finales clairement établies, & c’est pervertir notre faculté de penser, que de nier une vérité si universelle.
Mais les pierres en tout lieu & en tout tems, ne composent pas des bâtiments ; tous les nez ne portent pas des lunettes ; tous les doigts n’ont pas une bague ; toutes les jambes ne sont pas couvertes de bas de soye. Un ver à soye n’est donc pas fait pour couvrir mes jambes, comme votre bouche est faite pour manger, & votre derrière pour aller à la garderobe. Il y a donc des effets produits par des causes finales, & des effets en très grand nombre qu’on ne peut appeler de ce nom.
Mais les uns & les autres sont également dans le plan de la providence générale : rien ne se fait sans doute malgré elle, ni même sans elle. Tout ce qui appartient à la nature est uniforme, immuable, est l’ouvrage immédiat du maître ; c’est lui qui a créé les loix par lesquelles la lune entre pour les trois quarts dans la cause du flux & du reflux de l’océan, & le soleil pour son quart : c’est lui qui a donné un mouvement de rotation au soleil, par lequel cet astre envoie en cinq minutes & demie des rayons de lumière dans les yeux des hommes, des crocodiles & des chats.
[I-290]
Mais, si après bien des siècles nous nous sommes avisés d’inventer des ciseaux & des broches, de tondre avec les uns la laine des moutons, & de les faire cuire avec les autres pour les manger, que peut-on en inférer autre chose, sinon, que Dieu nous a faits de façon qu’un jour nous deviendrions nécessairement industrieux & carnassiers ?
Les moutons n’ont pas sans doute été faits absolument pour être cuits & mangés, puisque plusieurs nations s’abstiennent de cette horreur. Les hommes ne sont pas créés essentiellement pour se massacrer, puisque les brames & les quakers ne tuent personne ; mais la pâte dont nous sommes pétris produit souvent des massacres, comme elle produit des calomnies, des vanités, des persécutions & des impertinences. Ce n’est pas que la formation de l’homme soit précisément la cause finale de nos fureurs & de nos sottises ; car une cause finale est universelle & invariable en tout tems & en tout lieu. Mais les horreurs & les absurdités de l’espèce humaine n’en sont pas moins dans l’ordre éternel des choses. Quand nous battons notre bled, le fléau est la cause finale de la séparation du grain ; mais si ce fléau en battant mon grain écrase mille insectes, ce n’est pas par ma volonté déterminée, ce n’est pas non plus par hasard ; c’est que ces insectes se sont trouvés cette fois sous mon fléau, & qu’ils devaient s’y trouver.
C’est une suite de la nature des choses, qu’un homme soit ambitieux, que cet homme [I-291] enrégimente quelquefois d’autres hommes, qu’il soit vainqueur, ou qu’il soit battu ; mais jamais on ne pourra dire, L’homme a été créé de Dieu pour être tué à la guerre.
Les instrumens que nous a donnés la nature ne peuvent être toûjours des causes finales en mouvement qui aient leur effet immanquable. Les yeux donnés pour voir ne sont pas toûjours ouverts ; chaque sens a ses tems de repos. Il y a même des sens dont on ne fait jamais d’usage. Par exemple, une malheureuse imbécile enfermée dans un cloître à quatorze ans, ferme pour jamais chez elle la porte dont devait sortir une génération nouvelle ; mais la cause finale n’en subsiste pas moins, elle agira dès qu’elle sera libre.
FOI.↩
Un jour le Prince Pic de la Mirandole rencontra le Pape Alexandre VI. chez la courtisane Émilia pendant que Lucrèce fille du St. Père était en couche & qu’on ne savait dans Rome si l’enfant était du Pape ou de son fils le Duc de Valentinois, ou du mari de Lucrèce Alphonse d’Arragon, qui passait pour impuissant. La conversation fut d’abord fort enjouée. Le Cardinal Bembo en rapporte une partie. Petit Pic, dit le Pape, qui crois-tu le père de mon petit-fils ? je crois que c’est votre gendre, répondit Pic. Eh comment peux-tu croire [I-292] cette sottise ? Je la crois par la foi. Mais ne sais-tu pas bien qu’un impuissant ne fait point d’enfans ? la foi consiste, repartit Pic, à croire les choses parce qu’elles sont impossibles ; & de plus l’honneur de votre maison exige que le fils de Lucrèce ne passe point pour être le fruit d’un inceste. Vous me faites croire des mystères plus incompréhensibles. Ne faut-il pas que je sois convaincu qu’un serpent a parlé, que depuis ce tems tous les hommes furent damnés, que l’ânesse de Balaam parla aussi fort éloquemment, & que les murs de Jérico tombèrent au son des trompettes ! Pic enfila tout de suite une kyrielle de toutes les choses admirables qu’il croyait. Alexandre tomba sur son sofa à force de rire. Je crois tout cela comme vous, disait-il, car je sens bien que je ne peux être sauvé que par la foi & que je ne le serai pas par mes œuvres. Ah ! St. Père, dit Pic, vous n’avez besoin ni d’œuvres ni de foi ; cela est bon pour de pauvres profanes comme nous, mais vous qui êtes Vice-Dieu, vous pouvez croire & faire tout ce qu’il vous plaira, vous avez les clefs du ciel ; & sans doute St. Pierre ne vous fermera pas la porte au nez. Mais pour moi, je vous avoue, que j’aurais besoin d’une puissante protection, si n’étant qu’un pauvre prince j’avais couché avec ma fille, & si je m’étais servi du stylet & de la Cantarella aussi souvent que votre sainteté. Alexandre VI. entendait raillerie. Parlons sérieusement, dit-il, au Prince de la Mirandole. Dites-moi quel mérite on peut avoir à dire à Dieu qu’on est [I-293] persuadé de choses dont en effet on ne peut être persuadé ? quel plaisir cela peut-il faire à Dieu ? entre nous, dire qu’on croit ce qu’il est impossible de croire, c’est mentir.
Pic de la Mirandole fit un grand signe de croix. Eh Dieu paternel, s’écria-t-il, que Votre Sainteté me pardonne, vous n’êtes pas Chrétien. Non, sur ma foi, dit le Pape. Je m’en doutais, dit Pic de la Mirandole.
(par un descendant de Rabelais.)
FOY.↩
Qu’est-ce que la Foy ? Est-ce de croire ce qui paraît évident ? Non ; il m’est évident qu’il y a un Être nécessaire, éternel, suprême, intelligent. Ce n’est pas là de la foy, c’est de la raison. Je n’ai aucun mérite à penser que cet Être éternel, infini, qui est la vertu, la bonté même, veut que je sois bon & vertueux. La foy consiste à croire non ce qui semble vrai, mais ce qui semble faux à notre entendement. Les Asiatiques ne peuvent croire que par la foy le voyage de Mahomet dans les sept planètes, les incarnations du dieu Fo, de Vitsnou, de Xaca, de Brama, de Sammonocodom, &c. &c. &c. Ils soumettent leur entendement, ils tremblent d’examiner, ils ne veulent être ni empalés, ni brûlés ; ils disent, je crois.
Il y a la foy sur les choses étonnantes, & la [I-294] foy sur les choses contradictoires & impossibles.
Vitsnou s’est incarné cinq cents fois, cela est fort étonnant ; mais enfin, cela n’est pas physiquement impossible. Car si Vitsnou a une ame, il peut avoir mis son ame dans cinq cents corps pour se réjoüir. L’Indien, à la vérité, n’a pas une foy bien vive, il n’est pas intimement persuadé de ces métamorphoses ; mais enfin, il dira à son bonze, J’ai la foy ; vous voulez que Vitsnou ait passé par cinq cents incarnations, cela vous vaut cinq cents roupies de rente ; à la bonne heure ; vous irez crier contre moi, vous me dénoncerez, vous ruinerez mon commerce si je n’ai pas la foy ; eh bien, j’ai la foy, & voilà de plus dix roupies que je vous donne. L’Indien peut jurer à ce bonze qu’il croit, sans faire un faux serment ; car après tout il ne lui est pas démontré que Vitsnou n’est pas venu cinq cents fois dans les Indes.
Mais si le bonze exige de lui qu’il croye une chose contradictoire, impossible, que deux & deux font cinq, que le même corps peut être en mille endroits différens, qu’être & n’être pas c’est précisément la même chose, alors, si l’Indien dit qu’il a la foy, il a menti ; & s’il jure qu’il croit, il fait un parjure. Il dit donc au bonze, Mon révérend père, je ne peux vous assurer que je crois ces absurdités-là, quand elles vous vaudraient dix mille roupies de rente au lieu de cinq cents.
Mon fils, répond le bonze, donnez vingt roupies, & Dieu vous fera la grace de croire tout ce que vous ne croyez point.
[I-295]
Comment voulez-vous, répond l’Indien, que Dieu opère sur moi ce qu’il ne peut opérer sur lui-même ? Il est impossible que Dieu fasse ou croye les contradictoires ; autrement il ne serait plus Dieu. Je veux bien vous dire, pour vous faire plaisir, que je crois ce qui est obscur ; mais je ne peux vous dire que je crois l’impossible. Dieu veut que nous soyons vertueux, & non pas que nous soyons absurdes. Je vous ai donné dix roupies, en voilà encor vingt, croyez à trente roupies, soyez homme de bien si vous pouvez, & ne me rompez plus la tête.
FOLIE.↩
Il n’est pas question de renouveler le livre d’Érasme, qui ne serait aujourd’hui qu’un lieu commun assez insipide.
Nous appelons folie cette maladie des organes du cerveau qui empêche un homme nécessairement de penser & d’agir comme les autres ; ne pouvant gérer son bien, on l’interdit ; ne pouvant avoir des idées convenables à la société, on l’en exclut ; s’il est dangereux, on l’enferme ; s’il est furieux, on le lie.
Ce qu’il est important d’observer, c’est que cet homme n’est point privé d’idées ; il en a comme tous les autres hommes pendant la veille, & souvent quand il dort. On peut demander comment son ame spirituelle, immortelle, logée [I-296] dans son cerveau, recevant toutes les idées par les sens très nettes & très distinctes, n’en porte cependant jamais un jugement sain ? Elle voit les objets comme l’ame d’Aristote & de Platon, de Loke & de Newton les voyaient ; elle entend les mêmes sons, elle a le même sens du toucher ; comment donc recevant les perceptions que les plus sages éprouvent, en fait-elle un assemblage extravagant sans pouvoir s’en dispenser ? Si cette substance simple & éternelle a pour ses actions les mêmes instrumens qu’ont les ames des cerveaux les plus sages, elle doit raisonner comme eux. Qui peut l’en empêcher ? Je conçois bien à toute force que si mon fou voit du rouge, & les sages du bleu ; si quand les sages entendent de la musique, mon fou entend le braiment d’un âne ; si quand ils sont au sermon, mon fou croit être à la comédie ; si quand ils entendent oui, il entend non ; alors son ame doit penser au rebours des autres. Mais mon fou a les mêmes perceptions qu’eux ; il n’y a nulle raison apparente pour laquelle son ame ayant reçu par ses sens tous ses outils, ne peut en faire d’usage. Elle est pure, dit-on, elle n’est sujette par elle-même à aucune infirmité ; la voilà pourvue de tous les secours nécessaires : quelque chose qui se passe dans son corps, rien ne peut changer son essence : cependant on la mène dans son étui aux petites misons.
Cette réflexion peut faire soupçonner que la faculté de penser donnée de Dieu à l’homme, est sujette au dérangement comme les autres sens. Un fou est un malade dont le cerveau [I-297] pâtit, comme le gouteux est un malade qui souffre aux pieds & aux mains ; il pensait par le cerveau, comme il marchait avec les pieds, sans rien connaître ni de son pouvoir incompréhensible de marcher, ni de son pouvoir non moins incompréhensible de penser. On a la goutte au cerveau comme aux pieds. Enfin après mille raisonnements, il n’y a peut-être que la foi seule qui puisse nous convaincre qu’une substance simple & immatérielle puisse être malade.
Les doctes ou les docteurs diront au fou ; Mon ami, quoique tu ayes perdu le sens commun, ton ame est aussi spirituelle, aussi pure, aussi immortelle que la nôtre ; mais notre ame est bien logée, & la tienne l’est mal ; les fenêtres de la maison sont bouchées pour elle ; l’air lui manque, elle étouffe. Le fou, dans ses bons moments, leur répondrait, Mes amis, vous supposez à votre ordinaire ce qui est en question, mes fenêtres sont aussi bien ouvertes que les vôtres, puisque je vois les mêmes objets, & que j’entends les mêmes paroles : il faut donc nécessairement que mon ame fasse un mauvais usage de ses sens, ou que mon ame ne soit elle-même qu’un sens vicié, une qualité dépravée. En un mot, ou mon ame est folie par elle-même, ou je n’ai point d’âme.
Un des docteurs pourra répondre : Mon confrère, Dieu a créé peut-être des ames folles, comme il a créé des ames sages. Le fou répliquera ; Si je croyais ce que vous me dites, je serais encor plus fou que je ne le suis. De grace, vous qui en savez tant, dites-moi pourquoi je suis fou ?
[I-298]
Si les docteurs ont encor un peu de sens, ils lui répondront, Je n’en sais rien. Ils ne comprendront pas pourquoi une cervelle a des idées incohérentes ; ils ne comprendront pas mieux pourquoi une autre cervelle a des idées régulières & suivies. Ils se croiront sages, & ils seront aussi fous que lui.
FRAUDE.↩
S’il faut user de fraudes pieuses avec le peuple ?
Le Faquir Bambabef rencontra un jour un des disciples de Confutsée, que nous nommons Confucius, & ce disciple s’appelait Ouang ; & Bambabef soutenait que le peuple a besoin d’être trompé, & Ouang prétendait qu’il ne faut jamais tromper personne ; & voici le précis de leur dispute.
BAMBABEF.
Il faut imiter l’Être suprême, qui ne nous montre pas les choses telles qu’elles sont ; il nous fait voir le soleil sous un diamètre de deux ou trois pieds, quoique cet astre soit un million de fois plus gros que la terre ; il nous fait voir la lune & les étoiles attachées sur un même fond bleu, tandis qu’elles sont à des distances différentes. Il veut qu’une tour carrée nous paraisse ronde de loin ; il veut que le feu nous paraisse chaud, quoiqu’il ne soit ni [I-299] chaud ni froid ; enfin il nous environne d’erreurs convenables à notre nature.
OUANG.
Ce que vous nommez erreur n’en est point une. Le soleil tel qu’il est placé à des millions de millions de lis [[17]] au-delà de notre globe, n’est pas celui que nous voyons. Nous n’apercevons réellement, & nous ne pouvons apercevoir que le soleil qui se peint dans notre rétine, sous un angle déterminé. Nos yeux ne nous ont point été donnés pour connaître les grosseurs & les distances, il faut d’autres secours & d’autres opérations pour les connaître.
Bambabef parut fort étonné de ce propos. Ouang qui était très-patient lui expliqua la théorie de l’optique ; & Bambabef qui avait de la conception, se rendit aux démonstrations du disciple de Confutsée ; puis il reprit la dispute en ces termes.
BAMBABEF.
Si Dieu ne nous trompe pas par le ministère de nos sens, comme je le croyais, avouez au moins que les médecins trompent toûjours les enfans pour leur bien ; ils leur disent qu’ils leur donnent du sucre, & en effet ils leur donnent de la rhubarbe. Je peux donc moi, faquir, tromper le peuple qui est aussi ignorant que les enfans.
OUANG.
J’ai deux fils, je ne les ai jamais trompés ; [I-300] je leur ai dit quand ils ont été malades, voilà une médecine très amère, il faut avoir le courage de la prendre ; elle vous nuirait si elle était douce ; je n’ai jamais souffert que leurs gouvernantes & leurs précepteurs leur fissent peur des esprits, des revenans, des lutins, des sorciers ; par-là j’en ai fait de jeunes citoyens courageux & sages.
BAMBABEF.
Le peuple n’est pas né si heureusement que votre famille.
OUANG.
Tous les hommes se ressemblent ; ils sont nés avec les mêmes dispositions. Ce sont les faquirs qui corrompent la nature des hommes.
BAMBABEF.
Nous leur enseignons des erreurs, je l’avoue, mais c’est pour leur bien. Nous leur faisons accroire que s’ils n’achètent pas de nos clous bénis, s’ils n’expient pas leurs péchés en nous donnant de l’argent, ils deviendront dans une autre vie, chevaux de poste, chiens, ou lézards. Cela les intimide, & ils deviennent gens de bien.
OUANG.
Ne voyez-vous pas que vous pervertissez ces pauvres gens ? Il y en a parmi eux bien plus qu’on ne pense, qui raisonnent, qui se moquent de vos miracles, de vos superstitions, qui voient fort bien qu’ils ne seront changés [I-301] ni en lézards ni en chevaux de poste. Qu’arrive-t-il ? Ils ont assez de bon sens pour voir que vous leur prêchez une religion impertinente, & ils n’en ont pas assez pour s’élever vers une religion pure, & dégagée de superstition, telle que la nôtre. Leurs passions leur font croire qu’il n’y a point de religion, parce que la seule qu’on leur enseigne est ridicule ; vous devenez coupables de tous les vices dans lesquels ils se plongent.
BAMBABEF.
Point du tout, car nous ne leur enseignons qu’une bonne morale.
OUANG.
Vous vous feriez lapider par le peuple, si vous enseigniez une morale impure. Les hommes sont faits de façon, qu’ils veulent bien commettre le mal, mais ils ne veulent pas qu’on le leur prêche. Il faudrait seulement ne point mêler une morale sage avec des fables absurdes, parce que vous affaiblissez par vos impostures, dont vous pourriez vous passer, cette morale que vous êtes forcés d’enseigner.
BAMBABEF.
Quoi ! vous croyez qu’on peut enseigner la vérité au peuple sans la soutenir par des fables.
OUANG.
Je le crois fermement. Nos lettrés sont de la même pâte que nos tailleurs, nos tisserands, & [I-302] nos laboureurs. Ils adorent un Dieu créateur, rémunérateur, & vengeur. Ils ne souillent leur culte, ni par des systêmes absurdes, ni par des cérémonies extravagantes, & il y a bien moins de crimes parmi les lettrés que parmi le peuple. Pourquoi ne pas daigner instruire nos ouvriers comme nous instruisons nos lettrés ?
BAMBABEF.
Vous feriez une grande sottise ; c’est comme si vous vouliez qu’ils eussent la même politesse, qu’ils fussent jurisconsultes ; cela n’est ni possible ni convenable. Il faut du pain blanc pour les maîtres, & du pain bis pour les domestiques.
OUANG.
J’avoue que tous les hommes ne doivent pas avoir la même science ; mais il y a des choses nécessaires à tous. Il est nécessaire que chacun soit juste ; & la plus sûre manière d’inspirer la justice à tous les hommes, c’est de leur inspirer la religion sans superstition.
BAMBABEF.
C’est un beau projet ; mais il est impraticable. Pensez-vous qu’il suffise aux hommes de croire un Dieu qui punit & qui rêcompense ? Vous m’avez dit qu’il arrive souvent que les plus déliés d’entre le peuple se révoltent contre mes fables ; ils se révolteront de même contre votre vérité ; ils diront : Qui m’assurera que Dieu punit & récompense ? où en est la [I-303] preuve ? Quelle mission avez-vous ? Quel miracle avez-vous fait pour que je vous croie ? Ils se moqueront de vous bien plus que de moi.
OUANG.
Voilà où est votre erreur. Vous vous imaginez qu’on secouera le joug d’une idée honnête, vraisemblable, utile à tout le monde, d’une idée dont la raison humaine est d’accord, parce qu’on rejette des choses malhonnêtes, absurdes, inutiles, dangereuses, qui font frémir le bon sens ?
Le peuple est très disposé à croire ses magistrats : quand ses magistrats ne leur proposent qu’une créance raisonnable, ils l’embrassent volontiers. On n’a point besoin de prodiges pour croire un Dieu juste, qui lit dans le cœur de l’homme ; cette idée est trop naturelle pour être combattue. Il n’est pas nécessaire de dire précisément comment Dieu punira & récompensera ; il suffit qu’on croie à sa justice. Je vous assure que j’ai vu des villes entières qui n’avaient presque point d’autres dogmes, & que ce sont celles où j’ai vu le plus de vertu.
BAMBABEF.
Prenez garde ; vous trouverez dans ces villes des philosophes qui vous nieront & les peines & les récompenses.
OUANG.
Vous m’avouerez que ces philosophes nieront bien plus fortement vos inventions ; ainsi [I-304] vous ne gagnez rien par-là. Quand il y aurait des philosophes qui ne conviendraient pas de mes principes, ils n’en seraient pas moins gens de bien ; ils n’en cultiveraient pas moins la vertu, qui doit être embrassée par amour, & non par crainte. Mais, de plus, je vous soutiens qu’aucun philosophe ne serait jamais assuré que la Providence ne réserve pas des peines aux méchans & des récompenses aux bons ; car s’ils me demandent qui m’a dit que Dieu punit ? je leur demanderai qui leur a dit que Dieu ne punit pas ? Enfin, je vous soutiens que les philosophes m’aideront, loin de me contredire. Voulez-vous être philosophe ?
BAMBABEF.
Volontiers ; mais ne le dites pas aux faquirs.
[I-304]
GENÈSE.↩
Nous ne préviendrons point ici ce que nous disons de Moïse à son article ; nous suivrons quelques principaux traits de la Genèse, l’un après l’autre.
Au commencement Dieu créa le ciel & la terre.
C’est ainsi qu’on a traduit ; mais la traduction n’est pas exacte. Il n’y a point d’homme un peu instruit qui ne sache que le texte porte, Au commencement les dieux firent, ou les dieux fit, le ciel & la terre. Cette leçon d’ailleurs est [I-305] conforme à l’ancienne idée des Phéniciens, qui avaient imaginé que Dieu employa des Dieux inférieurs pour débrouiller le chaos, le Chaut Ereb. Les Phéniciens étaient depuis longtems un peuple puissant qui avait sa théogonie avant que les Hébreux se fussent emparés de quelques villages vers son pays. Il est bien naturel de penser que quand les Hébreux eurent enfin un petit établissement vers la Phénicie, ils commencèrent à apprendre la langue, surtout lorsqu’ils y furent esclaves. Alors, ceux qui se mêlèrent d’écrire copièrent quelque chose de l’ancienne théologie de leurs maîtres ; c’est la marche de l’esprit humain.
Dans le tems où l’on place Moïse, les philosophes phéniciens en savaient probablement assez pour regarder la terre comme un point, en comparaison de la multitude infinie de globes que Dieu a placés dans l’immensité de l’espace qu’on nomme le Ciel. Mais cette idée si ancienne & si fausse, que le ciel a été fait pour la terre, a presque toûjours prévalu chez le peuple ignorant. C’est à peu près comme si on disait que Dieu créa toutes les montagnes & un grain de sable, & qu’on s’imaginât que ces montagnes ont été faites pour ce grain de sable. Il n’est guère possible que les Phéniciens si bons navigateurs n’eussent pas de bons astronomes : mais les vieux préjugés prévalaient, & ces vieux préjugés furent la seule science des Juifs.
La terre était tohu bohu & vuide ; les ténèbres [I-306] étaient sur la face de l’abîme, & l’esprit de Dieu était porté sur les eaux.
Tohu bohu signifie précisément chaos, désordre ; c’est un de ces mots imitatifs qu’on trouve dans toutes les langues, comme sens dessus dessous, tintamarre, trictrac. La terre n’était point encor formée telle qu’elle est ; la matière existait, mais la puissance divine ne l’avait point encor arrangée. L’esprit de Dieu signifie le souffle, le vent qui agitait les eaux. Cette idée est exprimée dans les fragments de l’auteur phénicien Sanchoniaton. Les Phéniciens croyaient comme tous les autres peuples la matière éternelle. Il n’y a pas un seul auteur dans l’antiquité qui ait jamais dit qu’on eût tiré quelque chose du néant. On ne trouve même dans toute la Bible aucun passage où il soit dit que la matière ait été faite de rien.
Les hommes furent toûjours partagés sur la question de l’éternité du monde, mais jamais sur l’éternité de la matière.
Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti.
Voilà l’opinion de toute l’antiquité.
Dieu dit, Que la lumière soit faite, & la lumière fut faite ; & il vit que la lumière était bonne ; & il divisa la lumière des ténèbres, & il appela la lumière jour, & les ténèbres nuit ; & le soir & le matin furent un jour. Et Dieu dit aussi, Que le firmament soit fait au milieu des eaux, & qu’il sépare les eaux des eaux ; & Dieu fit le firmament ; & il divisa les eaux au-dessus du firmament des eaux au-dessous du firmament, & Dieu appela [I-307] le firmament ciel ; & le soir & le matin fit le second jour &c. & il vit que cela était bon.
Commençons par examiner si l’évêque d’Avranche Huet, & le Clerc, n’ont pas évidemment raison contre ceux qui prétendent trouver ici un tour d’éloquence sublime.
Cette éloquence n’est affectée dans aucune histoire écrite par les Juifs. Le style est ici de la plus grande simplicité, comme dans le reste de l’ouvrage. Si un orateur pour faire connaître la puissance de Dieu employait seulement cette expression, Il dit, Que la lumière soit, & la lumière fut, ce serait alors du sublime. Tel est ce passage d’un psaume, Dixit, & facta sunt. C’est un trait qui étant unique en cet endroit, & placé pour faire une grande image, frappe l’esprit & l’enlève. Mais ici, c’est le narré le plus simple. L’auteur Juif ne parle pas de la lumière autrement que des autres objets de la création ; il dit également à chaque article, & Dieu vit que cela était bon. Tout est sublime dans la création sans doute ; mais celle de la lumière ne l’est pas plus que celle de l’herbe des champs ; le sublime est ce qui s’élève au-dessus du reste, & le même tour règne partout dans ce chapitre.
C’était encor une opinion fort ancienne, que la lumière ne venait pas du soleil. On la voyait répandue dans l’air avant le lever & après le coucher de cet astre ; on s’imaginait que le soleil ne servait qu’à la pousser plus fortement : aussi l’auteur de la Genèse se conforme-t-il à cette erreur populaire, & par un singulier [I-308] renversement de l’ordre des choses, il ne fait créer le soleil & la lune que quatre jours après la lumière. On ne peut concevoir comment il y a un matin & un soir avant qu’il y ait un soleil. Il y a là une confusion qu’il est impossible de débrouiller. L’auteur inspiré se conformait aux préjugés vagues & grossiers de la nation. Dieu ne prétendait pas enseigner la philosophie aux Juifs. Il pouvait élever leur esprit jusqu’à la vérité, mais il aimait mieux descendre jusqu’à eux.
La séparation de la lumière & des ténèbres n’est pas d’une meilleure physique ; il semble que la nuit & le jour fussent mêlés ensemble comme des grains d’espèces différentes que l’on sépare les uns des autres. On sait assez que les ténèbres ne sont autre chose que la privation de la lumière, & qu’il n’y a de lumière en effet qu’autant que nos yeux reçoivent cette sensation ; mais on était alors bien loin de connaître ces vérités.
L’idée d’un firmament est encor de la plus haute antiquité. On s’imaginait que les cieux étaient très solides, parce qu’on y voyait toûjours les mêmes phénomènes. Les cieux roulaient sur nos têtes ; ils étaient donc d’une matière fort dure. Le moyen de supputer combien les exhalaisons de la terre & des mers pouvaient fournir d’eau aux nuages ? Il n’y avait point de Halley qui pût faire ce calcul. Il y avait donc des réservoirs d’eau dans le ciel. Ces réservoirs ne pouvaient être portés que sur une bonne voûte ; on voyait à travers cette voûte, [I-309] elle était donc de crystal. Pour que les eaux supérieures tombassent de cette voûte sur la terre, il était nécessaire qu’il y eût des portes, des écluses, des cataractes qui s’ouvrissent & se fermassent. Telle était l’astronomie juive ; & puisqu’on écrivait pour des Juifs, il fallait bien adopter leurs idées.
Dieu fit deux grands luminaires, l’un pour présider au jour, l’autre à la nuit ; il fit aussi les étoiles.
Toujours la même ignorance de la nature. Les Juifs ne savaient pas que la lune n’éclaire que par une lumière réfléchie. L’auteur parle ici des étoiles comme d’une bagatelle, quoiqu’elles soient autant de soleils dont chacun a des mondes roulant autour de lui. L’esprit saint se proportionnait à l’esprit du tems.
Dieu dit aussi, Faisons l’homme à notre image, & qu’il préside aux poissons, &c.
Qu’entendaient les Juifs par Faisons l’homme à notre image ? ce que toute l’antiquité entendait.
Finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.
On ne fait des images que des corps. Nulle nation n’imagina un Dieu sans corps, & il est impossible de se le représenter autrement. On peut bien dire, Dieu n’est rien de ce que nous connaissons, mais on ne peut avoir aucune idée de ce qu’il est. Les Juifs crurent Dieu constamment corporel, comme tous les autres peuples. Tous les premiers Pères de l’Église crurent aussi Dieu corporel, jusqu’à ce qu’ils eussent embrassé les idées de Platon.
[I-310]
Il les créa mâle & femelle.
Si Dieu, ou les Dieux secondaires, créèrent l’homme mâle & femelle à leur ressemblance, il semble en ce cas que les Juifs croyaient Dieu, & les Dieux mâles & femelles. On ne sait d’ailleurs si l’auteur veut dire que l’homme avait d’abord les deux sexes, ou s’il entend que Dieu fit Adam & Ève le même jour : le sens le plus naturel est que Dieu forma Adam & Ève en même tems, mais ce sens contredirait absolument la formation de la femme faite d’une côte de l’homme longtems après les sept jours.
Et il se reposa le septième jour.
Les Phéniciens, les Caldéens, les Indiens, disaient que Dieu avait fait le monde en six tems, que l’ancien Zoroastre appelle les six Gahambars si célèbres chez les Perses.
Il est incontestable que tous ces peuples avaient une théologie avant que la horde Juive habitât les déserts d’Oreb & de Sinaï, avant qu’elle pût avoir des écrivains. Il est donc de la plus grande vraisemblance que l’histoire des six jours est imitée de celle des six tems.
Du lieu de volupté sortait un fleuve qui arrosait le jardin, & de là se partageait en quatre fleuves ; l’un s’appelle Phison, qui tourne dans le pays d’Évilath où vient l’or… Le second s’appelle Gehon, qui entoure l’Éthiopie… Le troisième est le Tigre, & le quatrième l’Euphrate.
Suivant cette version le paradis terrestre contenait près du tiers de l’Asie & de l’Afrique. L’Euphrate & le Tigre ont leur source à plus [I-311] de soixante grandes lieuës l’un de l’autre, dans des montagnes horribles qui ne ressemblent guère à un jardin. Le fleuve qui borde l’Éthiopie, & qui ne peut être que le Nil ou le Niger, commence à plus de sept cents lieues des sources du Tigre & de l’Euphrate ; & si le Phison est le Phase, il est assez étonnant de mettre au même endroit la source d’un fleuve de Scythie & celle d’un fleuve d’Afrique.
Au reste, le jardin d’Éden est visiblement pris des jardins d’Éden à Saana dans l’Arabie heureuse, fameuse dans toute l’antiquité. Les Hébreux, peuple très récent, étaient une horde arabe. Ils se faisaient honneur de ce qu’il y avait de plus beau dans le meilleur canton de l’Arabie. Ils ont toûjours employé pour eux les anciennes traditions des grandes nations au milieu desquelles ils étaient enclavés.
Le Seigneur prit donc l’homme, & le mit dans le jardin de volupté, afin qu’il le cultivât.
C’est fort bien fait de cultiver son jardin, mais il est difficile qu’Adam cultivât un jardin de sept à huit cents lieues de long, apparemment qu’on lui donna des aides.
Ne mangez point du fruit de la science du bien & du mal.
Il est difficile de concevoir qu’il y ait eu un arbre qui enseignât le bien & le mal, comme il y a des poiriers & des abricotiers. D’ailleurs, pourquoi Dieu ne veut-il pas que l’homme connaisse le bien & le mal ? Le contraire n’était-il pas beaucoup plus digne de Dieu, & beaucoup plus nécessaire à l’homme ? Il semble à notre [I-312] pauvre raison que Dieu devait ordonner de manger beaucoup de ce fruit ; mais il faut soumettre sa raison.
Dès que vous en aurez mangé vous mourrez.
Cependant Adam en mangea & n’en mourut point. Plusieurs Pères ont regardé tout cela comme une allégorie. En effet, on pourrait dire que les autres animaux ne savent pas qu’ils mourront, mais que l’homme le sait par sa raison. Cette raison est l’arbre de la science qui lui fait prévoir sa fin. Cette explication serait peut-être la plus raisonnable.
Le Seigneur dit aussi, Il n’est pas bon que l’homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui.
On s’attend que le Seigneur va lui donner une femme : point du tout ; le Seigneur lui amène tous les animaux.
Et le nom qu’Adam donna à chacun des animaux est son véritable nom.
Ce qu’on peut entendre par le véritable nom d’un animal serait un nom qui désignerait toutes les propriétés de son espèce, ou du moins les principales ; mais il n’en est ainsi dans aucune langue. Il y a dans chacune quelques mots imitatifs, comme coq en Celte, qui désigne un peu le cri du coq. Loupous en latin, &c. Mais ces mots imitatifs sont en très petit nombre. De plus, si Adam eût ainsi connu toutes les propriétés des animaux, ou il avait déjà mangé du fruit de la science, ou Dieu n’avait pas besoin de lui interdire ce fruit.
Observez que c’est ici la première fois [I-313] qu’Adam est nommé dans la Genèse. Le premier homme, chez les anciens brachmanes, prodigieusement antérieurs aux Juifs, s’appelait Adimo, l’enfant de la terre, & sa femme Procriti, la vie ; c’est ce que dit le Védam, qui est peut-être le plus ancien livre du monde. Adam & Ève signifiaient ces mêmes choses dans la langue Phénicienne.
Lorsque Adam était endormi, Dieu prit une de ses côtes, & mit de la chair à la place, & de la côte qu’il avait tirée d’Adam il bâtit une femme, & il amena la femme à Adam.
Le Seigneur (un chapitre auparavant) avait déjà créé le mâle & la femelle ; pourquoi donc ôter une côte à l’homme pour en faire une femme qui existait déjà ? On répond que l’auteur annonce dans un endroit ce qu’il explique dans l’autre.
Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre, &c. il dit à la femme, &c.
Il n’est fait dans tout cet article aucune mention du Diable, tout y est physique. Le serpent était regardé, non seulement comme le plus rusé des animaux par toutes les nations orientales, mais encor comme immortel. Les Caldéens avaient une fable d’une querelle entre Dieu & le serpent ; & cette fable avait été conservée par Pherécide. Origène la cite dans son livre 6. contre Celse. On portait un serpent dans les fêtes de Bacchus. Les Égyptiens attachaient une espèce de divinité au serpent, au rapport d’Eusèbe dans sa préparation Évangélique livre premier chap. X. Dans l’Arabie & dans les [I-314] Indes, à la Chine même, le serpent était regardé comme le symbole de la vie ; & de là vint que les Empereurs de la Chine, antérieurs à Moïse, portèrent toûjours l’image d’un serpent sur leur poitrine.
Ève n’est point étonnée que le serpent lui parle. Les animaux ont parlé dans toutes les anciennes histoires, & c’est pourquoi lorsque Pilpay & Lockman firent parler les animaux, personne n’en fut surpris.
Toute cette avanture est si physique & si dépouillée de toute allégorie, qu’on y rend raison pourquoi le serpent rempe depuis ce tems-là sur son ventre, pourquoi nous cherchons toûjours à l’écraser, & pourquoi il cherche toûjours à nous mordre ; précisément comme on rendait raison dans les anciennes métamorphoses pourquoi le corbeau qui était blanc autrefois est noir aujourd’hui, pourquoi le hibou ne sort de son trou que de nuit, pourquoi le loup aime le carnage, &c.
Je multiplierai vos misères & vos grossesses, vous enfanterez dans la douleur, vous serez sous la puissance de l’homme, & il vous dominera.
On ne conçoit guère que la multiplication des grossesses soit une punition ; c’était au contraire une très grande bénédiction, & surtout chez les Juifs. Les douleurs de l’enfantement ne sont considérables que dans les femmes délicates ; celles qui sont accoutumées au travail accouchent très aisément, surtout dans les climats chauds. Il y a quelquefois des bêtes qui souffrent beaucoup dans leur gésine ; il y en a [I-315] même qui en meurent. Et quant à la supériorité de l’homme sur la femme, c’est une chose entièrement naturelle, c’est l’effet de la force du corps & même de celle de l’esprit. Les hommes en général ont des organes plus capables d’une attention suivie que les femmes, & sont plus propres aux travaux de la tête & du bras. Mais quand une femme a le poignet & l’esprit plus fort que son mari, elle en est partout la maîtresse ; c’est alors le mari qui est soumis à la femme.
Le Seigneur leur fit des tuniques de peau.
Ce passage prouve bien que les Juifs croyaient Dieu corporel, puisqu’ils lui font exercer le métier de tailleur. Un rabbin nommé Élieser a écrit que Dieu couvrit Adam & Ève de la peau même du serpent qui les avait tentés, & Origène prétend que cette tunique de peau était une nouvelle chair, un nouveau corps, que Dieu fit à l’homme.
Et le Seigneur dit, Voilà Adam qui est devenu comme l’un de nous.
Il faut renoncer au sens commun pour ne pas convenir que les Juifs admirent d’abord plusieurs Dieux. Il est plus difficile de savoir ce qu’ils entendent par ce mot Dieu, Éloïm. Quelques commentateurs ont prétendu que ce mot, l’un de nous, signifie la Trinité ; mais il n’est pas assurément question de la Trinité dans la Bible. La Trinité n’est pas un composé de plusieurs Dieux, c’est le même Dieu triple, & jamais les Juifs n’entendirent parler d’un Dieu en trois personnes. Par ces mots, semblable à nous, [I-316] il est très vraisemblable que les Juifs entendaient les anges Éloïm, & qu’ainsi ce livre ne fut écrit que quand ils adoptèrent la créance de ces Dieux inférieurs.
Le Seigneur le mit hors du jardin de volupté, afin qu’il cultivât la terre.
Mais le Seigneur l’avait mis dans le jardin de volupté afin qu’il cultivât ce jardin. Si Adam de jardinier devint laboureur, il faut avouer qu’en cela son état n’empira pas beaucoup. Un bon laboureur vaut bien un bon jardinier.
Toute cette histoire en général se rapporte à l’idée qu’eurent tous les hommes, & qu’ils ont encor, que les premiers tems valaient mieux que les nouveaux. On a toûjours plaint le présent, & vanté le passé. Les hommes surchargés de travaux ont placé le bonheur dans l’oisiveté, ne songeant pas que le pire des états est celui d’un homme qui n’a rien à faire. On se vit souvent malheureux, & on se forgea l’idée d’un tems où tout le monde avait été heureux : c’est à peu près comme si on disait, il fut un tems où il ne périssait aucun arbre, où nulle bête n’était ni malade, ni faible, ni dévorée par une autre. De là l’idée du siècle d’or, de l’œuf percé par Arimane, du serpent qui déroba à l’âne la recette de la vie heureuse & immortelle que l’homme avait mise sur son bât, de là ce combat de Typhon contre Osiris, d’Ophionée contre les dieux, & cette fameuse boëte de Pandore, & tous ces vieux contes dont quelques-uns sont amusants, & dont aucun n’est instructif.
[I-317]
Et il mit devant le jardin de volupté un chérubin avec un glaive tournoyant & enflammé pour garder l’entrée de l’arbre de vie.
Le mot kerub signifie bœuf. Un bœuf armé d’un sabre enflammé fait une étrange figure à une porte ; mais les Juifs représentèrent depuis des anges en forme de bœufs & d’éperviers, quoiqu’il leur fût défendu de faire aucune figure : ils prirent visiblement ces bœufs & ces éperviers, des Égyptiens, dont ils imitèrent tant de choses. Les Égyptiens vénérèrent d’abord le bœuf comme le symbole de l’agriculture, & l’épervier comme celui des vents, mais ils ne firent jamais un portier d’un bœuf.
Les dieux Éloïm voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour épouses celles qu’ils choisirent.
Cette imagination fut encor celle de tous les peuples ; il n’y a aucune nation, excepté la Chine, où quelque Dieu ne soit venu faire des enfans à des filles. Ces Dieux corporels descendaient souvent sur la terre pour visiter leurs domaines ; ils voyaient nos filles, ils prenaient pour eux les plus jolies : les enfans nés du commerce de ces Dieux & des mortelles devaient être supérieurs aux autres hommes ; aussi la Genèse ne manque pas de dire que ces Dieux qui couchèrent avec nos filles produisirent des géants.
Et je ferai venir sur la terre les eaux du Déluge.
(Voyez l’article Inondation.) Je remarquerai seulement ici que Saint Augustin, dans sa Cité de Dieu, no 8. dit : Maximum illud [I-318] diluvium græca nec latina novit historia : ni l’histoire grecque ni la latine ne connaissent ce grand déluge. En effet on n’a jamais connu que ceux de Deucalion & d’Ogigès en Grèce, regardés comme universels dans les fables recueillies par Ovide, mais totalement ignorés dans l’Asie orientale.
Dieu dit à Noé, Je vais faire alliance avec vous & avec votre semence après vous, & avec tous les animaux.
Dieu faire alliance avec les bêtes ! quelle alliance ! mais s’il s’allie avec l’homme, pourquoi pas avec la bête ? elle a du sentiment, & il y a quelque chose d’aussi divin dans le sentiment que dans la pensée la plus métaphysique. D’ailleurs, les animaux sentent mieux que la plupart des hommes ne pensent. C’est apparemment en vertu de ce pacte que François d’Assise, fondateur de l’ordre séraphique, disait aux cigales & aux lièvres, Chantez, ma sœur la cigale, broutez, mon frère le levraut. Mais quelles ont été les conditions du traité ? que tous les animaux se dévoreraient les uns les autres, qu’ils se nourriraient de notre sang & nous du leur, qu’après les avoir mangés nous nous exterminerions avec rage, & qu’il ne nous manquerait plus que de manger nos semblables égorgés par nos mains. S’il y avait eu un tel pacte, il aurait été fait avec le Diable. Probablement tout ce passage ne veut dire autre chose sinon que Dieu est également le maître absolu de tout ce qui respire.
[I-319]
Et je mettrai mon arc dans les nuées, & il sera un signe de mon pacte, &c.
Remarquez que l’auteur ne dit pas, j’ai mis mon arc dans les nuées, il dit, je mettrai. Cela suppose évidemment que l’opinion commune était que l’arc-en-ciel n’avait pas toûjours existé. C’est un phénomène causé par la pluie, & on le donne ici comme quelque chose de surnaturel qui avertit que la terre ne sera plus inondée. Il est étrange de choisir le signe de la pluie pour assurer qu’on ne sera pas noyé ; mais aussi on peut répondre que dans le danger de l’inondation on est rassuré par l’arc-en-ciel.
Et sur le soir les deux anges arrivèrent à Sodome, &c.
Toute l’histoire des deux anges que les Sodomites voulurent violer, est peut-être la plus extraordinaire que l’antiquité ait inventée. Mais il faut considérer que presque toute l’Asie croyait qu’il y avait des démons incubes & succubes, que de plus ces deux anges étaient des créatures plus parfaites que les hommes, & qu’ils devaient être plus beaux, & allumer plus de désirs chez un peuple corrompu, que des hommes ordinaires.
Pour Loth qui propose ses deux filles aux Sodomites à la place des deux anges, & la femme de Loth changée en statue de sel, & tout le reste de cette histoire, qu’en peut-on dire ? L’ancienne fable arabique de Cinira & de Mirra a quelque rapport à l’inceste de Loth & de ses filles : & l’avanture de Philemon & de Baucis n’est pas sans ressemblance avec les deux anges [I-320] qui apparurent à Loth & à sa femme. Pour la statue de sel, nous ne savons pas à quoi elle ressemble ; est-ce à l’histoire d’Orphée & d’Euridice ?
Il s’est trouvé quelques savants qui ont prétendu qu’on devait retrancher des livres canoniques toutes ces choses incroyables qui scandalisent les faibles ; mais on a dit que ces savants étaient des cœurs corrompus, des hommes à brûler, & qu’il est impossible d’être honnête homme si on ne croit pas que les Sodomites voulurent violer deux anges. C’est ainsi que raisonne une espèce de monstre qui veut dominer sur les esprits.
Quelques célèbres Pères de l’Église ont eu la prudence de tourner toutes ces histoires en allégories, à l’exemple des Juifs, & surtout de Philon. Des Papes plus prudens encor voulurent empêcher qu’on ne traduisît ces livres en langue vulgaire, de peur qu’on ne mît les hommes à portée de juger ce qu’on leur proposait d’adorer.
On doit certainement en conclure que ceux qui entendent parfaitement ce livre doivent tolérer ceux qui ne l’entendent pas ; car si ceux-ci n’y entendent rien, ce n’est pas leur faute ; mais ceux qui n’y comprennent rien, doivent tolérer aussi ceux qui comprennent tout.
[I-321]
GLOIRE.↩
Ben-al-bétif, ce digne chef des derviches leur disait un jour : Mes frères, il est très bon que vous vous serviez souvent de cette sacrée formule de notre Koran, Au nom de Dieu très miséricordieux ; car Dieu use de miséricorde, & vous apprenez à la faire en répétant souvent les mots qui recommandent une vertu, sans laquelle il resterait peu d’hommes sur la terre. Mais, mes frères, gardez-vous bien d’imiter ces téméraires qui se vantent à tout propos de travailler à la gloire de Dieu. Si un jeune imbécile soutient une thèse sur les catégories, thèse à laquelle préside un ignorant en fourrure, il ne manque pas d’écrire en gros caractères à la tête de sa thèse ; Ek Allah abron doxa : Ad majorem Dei gloriam. Un bon musulman a-t-il fait blanchir son sallon, il grave cette sottise sur sa porte ; un Saka porte de l’eau pour la plus grande gloire de Dieu. C’est un usage impie qui est pieusement mis en usage. Que diriez-vous d’un petit Chiaoux, qui en vuidant la chaise percée de notre Sultan, s’écrierait, À la plus grande gloire de notre invincible Monarque ? Il y a certainement plus loin du Sultan à Dieu, que du Sultan au petit Chiaoux.
Qu’avez-vous de commun, misérables vers de terre appelés hommes avec la gloire de l’Être infini ? Peut-il aimer la gloire ? Peut-il en [I-322] recevoir de vous ? Peut-il en gouter ? Jusqu’à quand, animaux à deux pieds sans plumes, ferez-vous Dieu à votre image ? Quoi ! parce que vous êtes vains, parce que vous aimez la gloire, vous voulez que Dieu l’aime aussi ! S’il y avait plusieurs Dieux, chacun d’eux peut-être voudrait obtenir les suffrages de ses semblables. Ce serait là la gloire d’un Dieu. Si l’on peut comparer la grandeur infinie avec la bassesse extrême, ce Dieu serait comme le Roi Alexandre ou Scander, qui ne voulait entrer en lice qu’avec des Rois : Mais vous, pauvres gens, quelle gloire pouvez-vous donner à Dieu ? Cessez de profaner son nom sacré. Un Empereur nommé Octave Auguste, défendit qu’on le louât dans les écoles de Rome, de peur que son nom ne fût avili. Mais vous ne pouvez ni avilir l’Être suprême, ni l’honorer. Anéantissez-vous, adorez & taisez-vous.
Ainsi parlait Ben-al-bétif, & les derviches s’écrièrent, Gloire à Dieu ! Ben-al-bétif a bien parlé.
GRACE.↩
Sacrés consulteurs de Rome moderne, illustres & infaillibles théologiens, personne n’a plus de respect que moi pour vos divines décisions ; mais si Paul Émile, Scipion, Caton, Cicéron, César, Titus, Trajan, Marc-Aurèle, revenaient dans cette Rome qu’ils mirent [I-323] autrefois en quelque crédit, vous m’avouerez qu’ils seraient un peu étonnés de vos décisions sur la grace. Que diraient-ils, s’ils entendaient parler de la grace de santé selon St. Thomas, & de la grace médicinale selon Cajetan ; de la grace extérieure, & intérieure, de la gratuite, de la sanctifiante, de l’actuelle, de l’habituelle, de la coopérante, de l’efficace qui quelquefois est sans effet, de la suffisante qui quelquefois ne suffit pas, de la versatile, & de la congrue ? en bonne foi, y comprendraient-ils plus que vous & moi ?
Quel besoin auraient ces pauvres gens, de vos sublimes instructions ? Il me semble que je les entends dire ;
Mes Révérends Pères, vous êtes de terribles génies : nous pensions sottement que l’Être éternel ne se conduit jamais par des loix particulières comme les vils humains, mais par ses loix générales, éternelles comme lui. Personne n’a jamais imaginé parmi nous, que Dieu fût semblable à un maître insensé qui donne un pécule à un esclave, & refuse la nourriture à l’autre ; qui ordonne à un manchot de pétrir de la farine, à un muet de lui faire la lecture, à un cu-de jatte d’être son courrier.
Tout est grace de la part de Dieu ; il a fait au globe que nous habitons la grace de le former ; aux arbres, la grace de les faire croître ; aux animaux celle de les nourrir ; mais dira-t-on que si un loup trouve dans son chemin un agneau pour son souper, & qu’un autre loup meure de faim, Dieu a fait à ce premier loup une [I-324] grace particulière ? S’est-il occupé par une grace prévenante à faire croître un chêne, préférablement à un autre chêne à qui la sève a manqué ? Si dans toute la nature, tous les êtres sont soumis aux loix générales, comment une seule espèce d’animaux n’y serait-elle pas soumise ?
Pourquoi le maître absolu de tout, aurait-il été plus occupé à diriger l’intérieur d’un seul homme, qu’à conduire le reste de la nature entière ? Par quelle bizarrerie changerait-il quelque chose dans le cœur d’un Courlandais ou d’un Biscayen, pendant qu’il ne change rien aux loix qu’il a imposées à tous les astres ?
Quelle pitié de supposer qu’il fait, défait, refait continuellement des sentimens dans nous ! & quelle audace de nous croire exceptés de tous les êtres ! Encore n’est-ce que pour ceux qui se confessent, que tous ces changements sont imaginés. Un Savoyard, un Bergamasque aura le lundi la grace de faire dire une messe pour douze sous ; le mardi il ira au cabaret, & la grace lui manquera ; le mercredi il aura une grace coopérante qui le conduira à confesse ; mais il n’aura point la grace efficace de la contrition parfaite ; le jeudi ce sera une grace suffisante qui ne lui suffira point, comme on l’a déjà dit. Dieu travaillera continuellement dans la tête de ce Bergamasque, tantôt avec force, tantôt faiblement, & le reste de la terre ne lui sera de rien ! il ne daignera pas se mêler de l’intérieur des Indiens & des Chinois ! S’il vous reste un grain de raison, mes Révérends Pères, ne trouvez-vous pas ce systême prodigieusement ridicule ?
[I-325]
Malheureux, voyez ce chêne qui porte sa tête aux nuës, & ce roseau qui rempe à ses piés ; vous ne dites pas que la grace efficace a été donnée au chêne, & a manqué au roseau. Levez les yeux au ciel, voyez l’éternel Démiurgos créant des millions de mondes qui gravitent tous les uns vers les autres, par des loix générales & éternelles. Voyez la même lumière se réfléchir du soleil à Saturne, & de Saturne à nous ; & dans cet accord de tant d’astres emportés par un cours rapide, dans cette obéissance générale de toute la nature, osez croire, si vous pouvez, que Dieu s’occupe de donner une grace versatile à sœur Thérèse & une grace concomitante à sœur Agnès !
Atome, à qui un sot atome a dit que l’Éternel a des loix particulières pour quelques atomes de ton voisinage, qu’il donne sa grace à celui-là, & la refuse à celui-ci ; que tel qui n’avait pas la grace hier, l’aura demain ; ne répète pas cette sottise. Dieu a fait l’univers, & ne va point créer des vents nouveaux pour remuer quelques brins de paille dans un coin de cet univers. Les théologiens sont comme les combattants chez Homère, qui croyaient que les dieux s’armaient tantôt contre eux, tantôt en leur faveur. Si Homère n’était pas considéré comme poëte, il le serait comme blasphémateur.
C’est Marc-Aurèle qui parle, ce n’est pas moi ; car Dieu qui vous inspire, me fait la grace de croire tout ce que vous dites, tout ce que vous avez dit, & tout ce que vous direz.
[I-326]
GUERRE.↩
La famine, la peste & la guerre sont les trois ingrédiens les plus fameux de ce bas monde. On peut ranger dans la classe de la famine toutes les mauvaises nourritures où la disette nous force d’avoir recours pour abréger notre vie dans l’espérance de la soutenir.
On comprend dans la peste, toutes les maladies contagieuses, qui sont au nombre de deux ou trois mille. Ces deux présents nous viennent de la Providence ; mais la guerre qui réunit tous ces dons, nous vient de l’imagination de trois ou quatre cents personnes, répandues sur la surface de ce globe, sous le nom de princes ou de ministres ; & c’est peut-être pour cette raison que dans plusieurs dédicaces on les appelle les images vivantes de la Divinité.
Le plus déterminé des flatteurs conviendra sans peine, que la guerre traîne toûjours à sa suite la peste & la famine, pour peu qu’il ait vû les hôpitaux des armées d’Allemagne, & qu’il ait passé dans quelques villages où il se sera fait quelque grand exploit de guerre.
C’est sans doute un très bel art que celui qui désole les campagnes, détruit les habitations, & fait périr année commune quarante mille hommes sur cent mille. Cette invention fut d’abord cultivée par des nations assemblées pour leur bien commun ; par exemple, la diète des Grecs déclara à la diète de la Phrygie & des peuples [I-327] voisins, qu’elle allait partir sur un millier de barques de pêcheurs, pour aller les exterminer si elle pouvait.
Le peuple Romain assemblé jugeait qu’il était de son intérêt d’aller se battre avant la moisson, contre le peuple de Veïes, ou contre les Volsques : Et quelques années après, tous les Romains étant en colère contre tous les Carthaginois, se battirent longtems sur mer & sur terre. Il n’en est pas de même aujourd’hui.
Un généalogiste prouve à un Prince qu’il descend en droite ligne d’un Comte, dont les parents avaient fait un pacte de famille il y a trois ou quatre cents ans avec une maison dont la mémoire même ne subsiste plus. Cette maison avait des prétentions éloignées sur une province dont le dernier possesseur est mort d’apoplexie. Le Prince & son conseil concluent sans difficulté que cette province qui est à quelques centaines de lieües de lui, a beau protester qu’elle ne le connaît pas, qu’elle n’a nulle envie d’être gouvernée par lui ; que pour donner des loix aux gens, il faut au moins avoir leur consentement : ces discours ne parviennent pas seulement aux oreilles du Prince, dont le droit est incontestable. Il trouve incontinent un grand nombre d’hommes qui n’ont rien à perdre ; il les habille d’un gros drap bleu à cent dix sous l’aune, borde leurs chapeaux avec du gros fil blanc, les fait tourner à droite & à gauche, & marche à la gloire.
Les autres Princes qui entendent parler de cette équipée, y prennent part chacun selon son [I-328] pouvoir, et couvrent une petite étendue de pays de plus de meurtriers mercenaires, que Gengis-Kan, Tamerlan, Bajazet n’en traînèrent à leur suite.
Des peuples assez éloignés entendent dire qu’on va se battre, & qu’il y a cinq ou six sous par jour à gagner pour eux, s’ils veulent être de la partie ; ils se divisent aussitôt en deux bandes comme des moissonneurs, & vont vendre leurs services à quiconque veut les employer.
Ces multitudes s’acharnent les unes contre les autres, non-seulement sans avoir aucun intérêt au procès, mais sans savoir même de quoi il s’agit.
Il se trouve à la fois cinq ou six puissances belligérantes, tantôt trois contre trois, tantôt deux contre quatre, tantôt une contre cinq, se détestant toutes également les unes les autres, s’unissant & s’attaquant tour à tour ; toutes d’accord en un seul point, celui de faire tout le mal possible.
Le merveilleux de cette entreprise infernale, c’est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses drapeaux & invoque Dieu solennellement, avant d’aller exterminer son prochain. Si un chef n’a eu que le bonheur de faire égorger deux ou trois mille hommes, il n’en remercie point Dieu ; mais lorsqu’il y en a eu environ dix mille d’exterminés par le feu & par le fer, & que pour comble de grace quelque ville a été détruite de fond en comble, alors on chante à quatre parties une chanson assez longue, composée dans [I-329] une langue inconnue à tous ceux qui ont combattu, & de plus toute farcie de barbarismes. La même chanson sert pour les mariages & pour les naissances, ainsi que pour les meurtres ; ce qui n’est pas pardonnable, surtout dans la nation la plus renommée pour les chansons nouvelles.
La Religion naturelle a mille fois empêché des citoyens de commettre des crimes. Une ame bien née n’en a pas la volonté, une ame tendre s’en effraie. Elle se représente un Dieu juste & vengeur ; mais la Religion artificielle encourage à toutes les cruautés qu’on exerce de compagnie, conjurations, séditions, brigandages, embuscades, surprises de villes, pillages, meurtres. Chacun marche gaiement au crime sous la bannière de son saint.
On paye partout un certain nombre de harangueurs pour célébrer ces journées meurtrières ; les uns sont vêtus d’un long justaucorps noir, chargé d’un manteau écourté ; les autres ont une chemise par dessus une robe ; quelques-uns portent deux pendants d’étoffe bigarrée, par-dessus leur chemise. Tous parlent longtems ; ils citent ce qui s’est fait jadis en Palestine, à propos d’un combat en Vétéravie.
Le reste de l’année ces gens-là déclament contre les vices. Ils prouvent en trois points & par antithèses que les dames qui étendent légèrement un peu de carmin sur leurs joues fraîches, seront l’objet éternel des vengeances éternelles de l’Éternel ; que Polyeucte & [I-330] Athalie sont les ouvrages du Démon ; qu’un homme qui fait servir sur sa table pour deux cents écus de marée un jour de carême, fait immanquablement son salut ; & qu’un pauvre homme qui mange pour deux sous & demi de mouton va pour jamais à tous les Diables.
De cinq ou six mille déclamations de cette espèce, il y en a trois ou quatre tout au plus, composées par un Gaulois nommé Massillon, qu’un honnête homme peut lire sans dégoût ; mais dans tous ces discours, à peine en trouverez-vous deux où l’orateur ose dire quelques mots contre ce fléau & ce crime de la guerre, qui contient tous les fléaux & tous les crimes. Les malheureux harangueurs parlent sans cesse contre l’amour qui est la seule consolation du genre humain, & la seule manière de le réparer ; ils ne disent rien des efforts abominables que nous faisons pour le détruire.
Vous avez fait un bien mauvais sermon sur l’impureté, ô Bourdalouë ! mais aucun sur ces meurtres variés en tant de façons, sur ces rapines, sur ces brigandages, sur cette rage universelle qui désole le monde. Tous les vices réunis de tous les âges & de tous les lieux n’égaleront jamais les maux que produit une seule campagne.
Misérables médecins des ames, vous criez pendant cinq quarts-d’heure sur quelques piqûres d’épingles, & vous ne dites rien sur la maladie qui nous déchire en mille morceaux ! Philosophes moralistes, brûlez tous vos livres. Tant que le caprice de quelques hommes fera [I-331] loyalement égorger des milliers de nos frères, la partie du genre humain consacrée à l’héroïsme sera ce qu’il y a de plus affreux dans la nature entière. Que deviennent & que m’importent l’humanité, la bienfaisance, la modestie, la tempérance, la douceur, la sagesse, la piété, tandis qu’une demi-livre de plomb tirée de six cents pas me fracasse le corps, & que je meurs à vingt ans dans des tourments inexprimables, au milieu de cinq ou six mille mourants, tandis que mes yeux qui s’ouvrent pour la dernière fois voient la ville où je suis né détruite par le fer & par la flamme, & que les derniers sons qu’entendent mes oreilles sont les cris des femmes & des enfans expirant sous des ruines, le tout pour les prétendus intérêts d’un homme que nous ne connaissons pas ?
Ce qu’il y a de pis, c’est que la guerre est un fléau inévitable. Si l’on y prend garde, tous les hommes ont adoré le Dieu Mars. Sabaoth chez les Juifs signifie le dieu des armes : mais Minerve chez Homère appelle Mars un Dieu furieux, insensé, infernal.
[I-331]
HISTOIRE DES ROIS JUIFS
ET PARALIPOMÈNES.↩
Tous les peuples ont écrit leur histoire dès qu’ils ont pu écrire. Les Juifs ont aussi écrit la leur. Avant qu’ils eussent des rois, ils [I-332] vivaient sous une théocratie ; ils étaient censés gouvernés par Dieu même.
Quand les Juifs voulurent avoir un roi comme les autres peuples leurs voisins, le prophète Samuel très intéressé à n’avoir point de Roi, leur déclara de la part de Dieu, que c’était Dieu lui-même qu’ils rejetaient ; ainsi la Théocratie finit chez les Juifs, lorsque la Monarchie commença.
On pourrait donc dire, sans blasphémer, que l’histoire des Rois Juifs a été écrite comme celle des autres peuples, & que Dieu n’a pas pris la peine de dicter lui-même l’histoire d’un peuple qu’il ne gouvernait plus.
On n’avance cette opinion qu’avec la plus extrême défiance. Ce qui pourrait la confirmer, c’est que les Paralipomènes contredisent très souvent le livre des Rois dans la chronologie & dans les faits, comme nos historiens profanes se contredisent quelquefois. De plus, si Dieu a toûjours écrit l’histoire des Juifs, il faut donc croire qu’il l’écrit encor ; car les Juifs sont toûjours son peuple chéri. Ils doivent se convertir un jour, & il paraît qu’alors ils seront aussi en droit de regarder l’histoire de leur dispersion comme sacrée, qu’ils sont en droit de dire que Dieu écrivit l’histoire de leurs Rois.
On peut encor faire une réflexion ; c’est que Dieu ayant été leur seul Roi très longtems, & ensuite ayant été leur historien, nous devons avoir pour tous les Juifs le respect le plus profond. Il n’y a point de fripier Juif qui ne soit infiniment au-dessus de César & d’Alexandre. [I-333] Comment ne se pas prosterner devant un fripier qui vous prouve que son histoire a été écrite par la Divinité même, tandis que les histoires Grecques & Romaines ne nous ont été transmises que par des profanes ?
Si le stile de l’Histoire des Rois & des Paralipomènes est divin, il se peut encor que les actions racontées dans ces histoires ne soient pas divines. David assassine Urie. Isboseth, & Miphiboseth sont assassinés. Absalon assassine Ammon, Joab assassine Absalon, Salomon assassine Adonias son frère, Baza assassine Nadab, Zimri assassine Ela, Hamri assassine Zimri, Achab assassine Naboth ; Jéhu assassine Achab, & Joram ; les habitans de Jérusalem assassinent Amasias fils de Joas. Sélom fils de Jabès assassine Zacharias fils de Jéroboam. Manahaim assassine Sélom fils de Jabès. Phacée fils de Roméli assassine Phaceia fils de Manahaim. Ozée fils d’Ela assassine Phacée fils de Roméli. On passe sous silence beaucoup d’autres menus assassinats. Il faut avouer que si le St. Esprit a écrit cette histoire, il n’a pas choisi un sujet fort édifiant.
[I-333]
IDÉE.↩
Qu’est-ce qu’une idée ?
C’est une image qui se peint dans mon cerveau.
Toutes vos pensées sont donc des images ?
Assurément ; car les idées les plus abstraites [I-334] ne sont que les filles de tous les objets que j’ai aperçus. Je ne prononce le mot d’être en général que parce que j’ai connu des êtres particuliers. Je ne prononce le nom d’infini, que parce que j’ai vû des bornes, & que je recule ces bornes dans mon entendement autant que je le puis ; je n’ai d’idées que parce que j’ai des images dans la tête.
Et quel est le peintre qui fait ce tableau ?
Ce n’est pas moi, je ne suis pas assez bon dessinateur : c’est celui qui m’a fait, qui fait mes idées.
Vous seriez donc de l’avis de Mallebranche, qui disait que nous voyons tout en Dieu ?
Je suis bien sûr au moins que si nous ne voyons pas les choses en Dieu même, nous les voyons par son action toute-puissante.
Et comment cette action se fait-elle ?
Je vous ai dit cent fois dans nos entretiens que je n’en savais pas un mot, & que Dieu n’a dit son secret à personne. J’ignore ce qui fait battre mon cœur, courir mon sang dans mes veines : j’ignore le principe de tous mes mouvemens ; & vous voulez que je vous dise comment je sens, & comment je pense ? cela n’est pas juste.
Mais vous savez au moins si votre faculté d’avoir des idées est jointe à l’étendue ?
Pas un mot. Il est bien vrai que Tatien dans son discours aux Grecs, dit que l’ame est composée manifestement d’un corps. Irénée dans son chapitre 62. du second livre, dit, que le Seigneur a enseigné que nos ames gardent la figure [I-335] de notre corps pour en conserver la mémoire. Tertullien assure dans son second livre de l’ame, qu’elle est un corps. Arnobe, Lactance, Hilaire, Grégoire de Nice, Ambroise n’ont point une autre opinion. On prétend que d’autres Pères de l’Église assurent que l’ame est sans aucune étendue, & qu’en cela ils sont de l’avis de Platon, ce qui est très douteux. Pour moi je n’ose être d’aucun avis ; je ne vois qu’incompréhensibilité dans l’un & dans l’autre systême ; & après y avoir rêvé toute ma vie, je suis aussi avancé que le premier jour.
Ce n’était donc pas la peine d’y penser ?
Il est vrai ; celui qui jouït, en sait plus que celui qui réfléchit, ou du moins il sait mieux, il est plus heureux ; mais que voulez-vous ? il n’a pas dépendu de moi, ni de recevoir ni de rejeter dans ma cervelle toutes les idées qui sont venues y combattre les unes contre les autres, & qui ont pris mes cellules médullaires pour leur champ de bataille.
Quand elles se sont bien battuës, je n’ai recueilli de leurs dépouilles que l’incertitude.
Il est bien triste d’avoir tant d’idées, & de ne savoir pas au juste la nature des idées.
Je l’avoue, mais il est bien plus triste, & beaucoup plus sot de croire savoir ce qu’on ne sait pas.
[I-336]
IDOLE, IDOLÂTRE, IDOLÂTRIE.↩
Idole, vient du grec Eidos, figure, Eidolos, représentation d’une figure, Latreuein, servir, révérer, adorer. Ce mot adorer est latin, & a beaucoup d’acceptions différentes : il signifie porter la main à la bouche en parlant avec respect : se courber, se mettre à genoux, saluer, & enfin communément, rendre un culte suprême.
Il est utile de remarquer ici que le dictionnaire de Trévoux commence cet article par dire que tous les payens étaient idolâtres, & que les Indiens sont encor des peuples idolâtres. Premièrement, on n’appela personne payen avant Théodose le jeune ; ce nom fut donné alors aux habitans des bourgs d’Italie, Pagorum incolæ, Pagani, qui conservèrent leur ancienne religion. Secondement, l’Indoustan est mahométan, & les Mahométans sont les implacables ennemis des images & de l’idolâtrie. Troisièmement, on ne doit point appeler idolâtres beaucoup de peuples de l’Inde qui sont de l’ancienne religion des Parsis, ni certaines castes qui n’ont point d’idole.
EXAMEN
S’il y a jamais eu un gouvernement idolâtre ?
Il paraît que jamais il n’y a eu aucun peuple [I-337] sur la terre qui ait pris ce nom d’idolâtre. Ce mot est une injure, un terme outrageant, tel que celui de Gavache que les Espagnols donnaient autrefois aux Français, & celui de Maranes que les Français donnaient aux Espagnols. Si on avait demandé au sénat de Rome, à l’aréopage d’Athènes, à la cour des rois de Perse, Êtes-vous idolâtres ? ils auraient à peine entendu cette question. Nul n’aurait répondu, Nous adorons des images, des idoles. On ne trouve ce mot, Idolâtre, Idolâtrie, ni dans Homère, ni dans Hésiode, ni dans Hérodote, ni dans aucun auteur de la religion des Gentils. Il n’y a jamais eu aucun édit, aucune loi qui ordonnât qu’on adorât des idoles, qu’on les servît en Dieux, qu’on les regardât comme des Dieux.
Quand les capitaines Romains & Carthaginois faisaient un traité, ils attestaient tous leurs Dieux. C’est en leur présence, disaient-ils, que nous jurons la paix. Or les statues de tous ces Dieux, dont le dénombrement était très long, n’étaient pas dans la tente des généraux ; ils regardaient les Dieux comme présens aux actions des hommes, comme témoins, comme juges, & ce n’est pas assurément le simulacre qui constituait la divinité.
De quel œil voyaient-ils donc les statues de leurs fausses divinités dans les temples ? Du même œil, s’il est permis de s’exprimer ainsi, que nous voyons les images des objets de notre vénération. L’erreur n’était pas d’adorer un morceau de bois ou de marbre, mais [I-338] d’adorer une fausse divinité représentée par ce bois & ce marbre. La différence entre eux & nous n’est pas qu’ils eussent des images & que nous n’en ayons point ; la différence est que leurs images figuraient des êtres fantastiques dans une religion fausse, & que les nôtres figurent des êtres réels dans une religion véritable. Les Grecs avaient la statue d’Hercule, & nous celle de St. Christophe : ils avaient Esculape & sa chèvre, & nous St. Roch & son chien ; Jupiter armé du tonnerre, & nous St. Antoine de Padoue, & St. Jacques de Compostelle.
Quand le consul Pline adresse les prières aux Dieux immortels, dans l’exorde du panégyrique de Trajan, ce n’est pas à des images qu’il les adresse ; ces images n’étaient pas immortelles.
Ni les derniers tems du paganisme, ni les plus reculés, n’offrent pas un seul fait qui puisse faire conclure qu’on adorât une idole. Homère ne parle que des Dieux qui habitent le haut Olimpe. Le Palladium, quoique tombé du ciel, n’était qu’un gage sacré de la protection de Pallas ; c’était elle qu’on vénérait dans le Palladium.
Mais les Romains & les Grecs se mettaient à genoux devant des statues, leur donnaient des couronnes, de l’encens, des fleurs, les promenaient en triomphe dans les places publiques. Nous avons sanctifié ces coutumes, & nous ne sommes point idolâtres.
Les femmes en tems de sécheresse portaient les statues des dieux, après avoir jeûné. [I-339] Elles marchaient pié nus ; les cheveux épars, & aussi-tôt il pleuvait à seaux, comme dit Pétrone, & statim urceatim pluebat. N’avons-nous pas consacré cet usage illégitime chez les Gentils, & légitime sans doute parmi nous ? Dans combien de villes ne porte-t-on pas nuds piés des charognes pour obtenir les bénédictions du ciel par leur intercession ? Si un Turc, un lettré Chinois était témoin de ces cérémonies, il pourrait par ignorance nous accuser d’abord de mettre notre confiance dans les simulacres que nous promenons ainsi en procession, mais il suffirait d’un mot pour le détromper.
On est surpris du nombre prodigieux de déclamations débitées dans tous les tems contre l’idolâtrie des Romains, & des Grecs ; & ensuite on est plus surpris encor quand on voit qu’ils n’étaient pas idolâtres.
Il y a des temples plus privilégiés que les autres. La grande Diane d’Éphèse avait plus de réputation qu’une Diane de village. Il se faisait plus de miracles dans le temple d’Esculape à Épidaure, que dans un autre de ses temples. La statue de Jupiter Olimpien attirait plus d’offrandes que celle de Jupiter Paphlagonien. Mais puisqu’il faut toûjours opposer ici les coutumes d’une religion vraie, à celles d’une religion fausse, n’avons-nous pas eu depuis plusieurs siècles plus de dévotion à certains autels qu’à d’autres ? Ne portons-nous pas plus d’offrandes à Notre-Dame de Lorette, qu’à Notre-Dame des Neiges ? C’est à nous à [I-340] voir si on doit saisir ce prétexte pour nous accuser d’idolâtrie ?
On n’avait imaginé qu’une seule Diane, un seul Apollon, un seul Esculape ; non pas autant d’Apollons, de Dianes & d’Esculapes qu’ils avaient de temples & de statues. Il est donc prouvé, autant qu’un point d’histoire peut l’être, que les anciens ne croyaient pas qu’une statue fût une divinité, que le culte ne pouvait être rapporté à cette statue, à cette idole, & que par conséquent les anciens n’étaient point idolâtres.
Une populace grossière & superstitieuse qui ne raisonnait point, qui ne savait ni douter, ni nier, ni croire, qui courait aux temples par oisiveté, & parce que les petits y sont égaux aux grands, qui portait son offrande par coutume, qui parlait continuellement de miracles sans en avoir examiné aucun, & qui n’était guère au-dessus des victimes qu’elle amenait ; cette populace, dis-je, pouvait bien, à la vue de la grande Diane, & de Jupiter tonnant, être frappée d’une horreur religieuse, & adorer sans le savoir, la statue même ; c’est ce qui est arrivé quelquefois dans nos temples à nos paysans grossiers, & on n’a pas manqué de les instruire que c’est aux bienheureux, aux immortels reçus dans le ciel, qu’ils doivent demander leur intercession, & non à des figures de bois & de pierre, & qu’ils ne doivent adorer que Dieu seul.
Les Grecs & les Romains augmentèrent le nombre de leurs dieux par des apothéoses ; [I-341] les Grecs divinisaient les conquérants, comme Bacchus, Hercule, Persée. Rome dressa des autels à ses empereurs. Nos apothéoses sont d’un genre différent. Nous avons des Saints au lieu de leurs demi-Dieux, de leurs Dieux secondaires ; mais nous n’avons égard ni au rang, ni aux conquêtes. Nous avons élevé des temples à des hommes simplement vertueux, qui seraient la plupart ignorés sur la terre, s’ils n’étaient placés dans le ciel. Les apothéoses des anciens sont faites par la flatterie, les nôtres par le respect pour la vertu. Mais ces anciennes apothéoses sont encor une preuve convaincante que les Grecs & les Romains n’étaient point proprement idolâtres. Il est clair qu’ils n’admettaient pas plus une vertu divine dans la statue d’Auguste & de Claudius, que dans leurs médailles.
Cicéron dans ses ouvrages philosophiques ne laisse pas soupçonner seulement qu’on puisse se méprendre aux statues des Dieux & les confondre avec les Dieux mêmes. Ses interlocuteurs foudroient la religion établie, mais aucun d’eux n’imagine d’accuser les Romains de prendre du marbre & de l’airain pour des divinités. Lucrèce ne reproche cette sottise à personne, lui qui reproche tout aux superstitieux. Donc, encor une fois, cette opinion n’existait pas, on n’en avait aucune idée. Il n’y avait point d’idolâtre.
Horace fait parler une statue de Priape ; il lui fait dire, J’étais autrefois un tronc de figuier ; un charpentier ne sachant s’il ferait de moi un dieu ou un banc, se détermina enfin à me faire [I-342] dieu, &c. Que conclure de cette plaisanterie ? Priape était de ces petites divinités subalternes, abandonnées aux railleurs ; & cette plaisanterie même est la preuve la plus forte que cette figure de Priape qu’on mettait dans les potagers pour effrayer les oiseaux, n’était pas fort révérée.
Dacier en se livrant à l’esprit commentateur n’a pas manqué d’observer que Baruch avait prédit cette avanture, en disant, Ils ne seront que ce que voudront les ouvriers ; mais il pouvait observer aussi qu’on en peut dire autant de toutes les statues.
On peut d’un bloc de marbre tirer tout aussi bien une cuvette qu’une figure d’Alexandre, ou de Jupiter, ou de quelque autre chose plus respectable. La matière dont étaient formés les chérubins du Saint des Saints aurait pû servir également aux fonctions les plus viles. Un trône, un autel en sont-ils moins révérés, parce que l’ouvrier en pouvait faire une table de cuisine ?
Dacier au lieu de conclure que les Romains adoraient la statue de Priape, & que Baruch l’avait prédit, devait donc conclure que les Romains s’en moquaient. Consultez tous les auteurs qui parlent des statues de leurs dieux, vous n’en trouverez aucun qui parle d’idolâtrie ; ils disent expressément le contraire. Vous voyez dans Martial :
Qui finxit sacros auro vel marmore vultus,
Non facit ille deos.
[I-343]
Dans Ovide :
Colitur pro Jove forma Jovis.
Dans Stace :
Nulla autem effigies, nulli commissa metallo
Forma dei mentes habitare ac numina gaudet.
Dans Lucain :
Estne dei sedes, nisi terra & pontus & aër ?
On ferait un volume de tous les passages qui déposent que des images n’étaient que des images.
Il n’y a que le cas où les statues rendaient des oracles, qui ait pu faire penser que ces statues avaient en elles quelque chose de divin. Mais certainement l’opinion régnante était que les dieux avaient choisi certains autels, certains simulacres pour y venir résider quelquefois, pour y donner audience aux hommes, pour leur répondre. On ne voit dans Homère & dans les chœurs des tragédies Grecques, que des prières à Apollon qui rend ses oracles sur les montagnes, en tel temple, en telle ville ; il n’y a pas dans toute l’antiquité la moindre trace d’une prière adressée à une statue.
Ceux qui professaient la magie, qui la croyaient une science, ou qui feignaient de le croire, prétendaient avoir le secret de faire descendre les dieux dans les statues, non pas les grands dieux, mais les dieux secondaires, les génies. C’est ce que Mercure Trismégiste appelait [I-344] faire des Dieux ; & c’est ce que St. Augustin réfute dans sa Cité de Dieu. Mais cela même montre évidemment que les simulacres n’avaient rien en eux de divin, puisqu’il fallait qu’un magicien les animât. Et il me semble qu’il arrivait bien rarement qu’un magicien fût assez habile pour donner une ame à une statue pour la faire parler.
En un mot, les images des Dieux n’étaient point des Dieux, Jupiter, & non pas son image, lançait le tonnerre ; ce n’était pas la statue de Neptune qui soulevait les mers, ni celle d’Apollon qui donnait la lumière. Les Grecs & les Romains étaient des Gentils, des Polythéïstes, & n’étaient point des idolâtres.
Si les Perses, les Sabéens, les Égyptiens, les Tartares, les Turcs ont été idolâtres ? Et de quelle antiquité est l’origine des simulacres appelés idoles. Histoire de leur culte.
C’est une grande erreur d’appeler idolâtres les peuples qui rendirent un culte au soleil & aux étoiles. Ces nations n’eurent longtems ni simulacres ni temples. Si elles se trompèrent, c’est en rendant aux astres ce qu’elles devaient au Créateur des astres : Encor le dogme de Zoroastre ou Zerdust, recueilli dans le Sadder, enseigne-t-il un Être suprême, vengeur & rémunérateur ; & cela est bien loin de l’idolâtrie. Le gouvernement de la Chine n’a jamais eu aucune idole ; il a toûjours conservé le culte simple du maître du ciel Kingtien. [I-345] Gengis-Kan chez les Tartares n’était point idolâtre, & n’avait aucun simulacre. Les Musulmans qui remplissent la Grèce, l’Asie mineure, la Syrie, la Perse, l’Inde & l’Afrique, appellent les Chrétiens idolâtres, giaours, parce qu’ils croient que les chrétiens rendent un culte aux images. Ils brisèrent plusieurs statues qu’ils trouvèrent à Constantinople dans St. Sophie, & dans l’église des Sts. Apôtres, & dans d’autres qu’ils convertirent en mosquées. L’apparence les trompa comme elle trompe toûjours les hommes, & leur fit croire que des temples dédiés à des saints qui avaient été hommes autrefois, des images de ces saints révérées à genoux, des miracles opérés dans ces temples, étaient des preuves invincibles de l’idolâtrie la plus complète. Cependant il n’en est rien. Les Chrétiens n’adorent en effet qu’un seul Dieu, & ne révèrent dans les bienheureux que la vertu même de Dieu qui agit dans ses saints. Les Iconoclastes & les Protestants ont fait le même reproche d’idolâtrie à l’Église, & on leur a fait la même réponse.
Comme les hommes ont eu très rarement des idées précises, & ont encor moins exprimé leurs idées par des mots précis, & sans équivoque, nous appelames du nom d’Idolâtres les gentils, & surtout les Polythéistes. On a écrit des volumes immenses, on a débité des sentimens divers sur l’origine de ce culte rendu à Dieu, ou à plusieurs Dieux sous des figures sensibles : cette multitude de livres & d’opinions ne prouve que l’ignorance.
[I-346]
On ne sait pas qui inventa les habits & les chaussures, & on veut savoir qui le premier inventa les idoles ? Qu’importe un passage de Sanchoniaton qui vivait avant la guerre de Troye ? que nous apprend-il, quand il dit que le chaos, l’esprit, c’est-à-dire le souffle, amoureux de ses principes, en tira le limon, qu’il rendit l’air lumineux, que le vent Colp & sa femme Baü engendrèrent Éon, qu’Éon engendra Genos ? que Cronos leur descendant avait deux yeux par derrière comme par devant, qu’il devint Dieu, & qu’il donna l’Égypte à son fils Taut ? Voilà un des plus respectables monumens de l’antiquité.
Orphée antérieur à Sanchoniaton, ne nous en apprendra pas davantage, dans sa Théogonie, que Damascius nous a conservée. Il représente le principe du monde sous la figure d’un dragon à deux têtes, l’une de taureau, l’autre de lion, un visage au milieu, qu’il appelle visage dieu, & des aîles dorées aux épaules.
Mais vous pouvez de ces idées bizarres tirer deux grandes vérités, l’une que les images sensibles & les hiéroglyphes sont de l’antiquité la plus haute ; l’autre que tous les anciens philosophes ont reconnu un premier principe.
Quant au Polythéisme, le bon sens vous dira que dès qu’il y a eu des hommes, c’est-à-dire des animaux faibles, capables de raison & de folie, sujets à tous les accidents, à la maladie & à la mort, ces hommes ont senti leur faiblesse & leur dépendance : ils ont reconnu aisément qu’il est quelque chose de plus [I-347] puissant qu’eux. Ils ont senti une force dans la terre qui fournit leurs alimens ; une dans l’air qui souvent les détruit ; une dans le feu qui consume, & dans l’eau qui submerge. Quoi de plus naturel dans des hommes ignorans que d’imaginer des êtres qui présidaient à ces élémens ? Quoi de plus naturel que de révérer la force invisible qui faisait luire aux yeux le soleil & les étoiles ? Et dès qu’on voulut se former une idée de ces puissances supérieures à l’homme, quoi de plus naturel encor que de les figurer d’une manière sensible ? Pouvait-on même s’y prendre autrement ? La religion juive qui précéda la nôtre, & qui fut donnée par Dieu même, était toute remplie de ces images sous lesquelles Dieu est représenté. Il daigne parler dans un buisson le langage humain ; il paraît sur une montagne. Les esprits célestes qu’il envoie viennent tous avec une forme humaine ; enfin le sanctuaire est rempli de chérubins, qui sont des corps d’hommes avec des aîles & des têtes d’animaux ; c’est ce qui a donné lieu à l’erreur de Plutarque, de Tacite, d’Appien, & de tant d’autres, de reprocher aux Juifs d’adorer une tête d’âne. Dieu malgré sa défense de peindre, & de sculpter aucune figure, a donc daigné se proportionner à la faiblesse humaine, qui demandait qu’on parlât aux sens par des images.
Isaïe dans le chap. VI. voit le Seigneur assis sur un trône, & le bas de sa robe qui remplit le temple. Le Seigneur étend sa main, & touche la bouche de Jérémie, au chap. I. de ce [I-348] prophète. Ézéchiel au chap. III. voit un trône de saphir, & Dieu lui paraît comme un homme assis sur ce trône. Ces images n’altèrent point la pureté de la religion juive, qui jamais n’employa les tableaux, les statues, les idoles, pour représenter Dieu aux yeux du peuple.
Les lettrés Chinois, les Parsis, les anciens Égyptiens n’eurent point d’idoles ; mais bientôt Isis & Osiris furent figurés ; bientôt Bel à Babilone fut un gros colosse. Brama fut un monstre bizarre dans la presqu’île de l’Inde. Les Grecs surtout multiplièrent les noms des dieux, les statues & les temples ; mais en attribuant toûjours la suprême puissance à leur Zeus nommé par les Latins Jupiter ; maître des dieux & des hommes. Les Romains imitèrent les Grecs. Ces peuples placèrent toûjours tous les dieux dans le ciel, sans savoir ce qu’ils entendaient par le ciel & par leur Olimpe : il n’y avait pas d’apparence que ces êtres supérieurs habitassent dans les nuées, qui ne sont que de l’eau. On en avait placé d’abord sept dans les sept planètes, parmi lesquelles on comptait le soleil ; mais depuis, la demeure de tous les Dieux fut l’étendue du ciel.
Les Romains eurent leurs douze grands Dieux ; six mâles & six femelles, qu’ils nommèrent Dii majorum gentium. Jupiter, Neptune, Apollon, Vulcain, Mars, Mercure ; Junon, Vesta, Minerve, Cérès, Vénus, Diane. Pluton fut alors oublié ; Vesta prit sa place.
[I-349]
Ensuite venaient les dieux minorum gentium, les dieux indigètes, les héros, comme Bacchus, Hercule, Esculape ; les Dieux infernaux, Pluton, Proserpine ; ceux de la mer, comme Thétis, Amphitrite, les Néréïdes, Glaucus ; puis les Driades, les Naïades ; les Dieux des jardins, ceux des bergers ; il y en avait pour chaque profession, pour chaque action de la vie, pour les enfans, pour les filles nubiles, pour les mariées, pour les accouchées ; on eut le dieu Pet. On divinisa enfin les empereurs. Ni ces empereurs, ni le dieu Pet, ni la déesse Pertunda, ni Priape, ni Rumilia la déesse des tetons, ni Stercutius le dieu de la garderobe, ne furent à la vérité regardés comme les maîtres du ciel & de la terre. Les empereurs eurent quelquefois des temples, les petits Dieux Pénates n’en eurent point, mais tous eurent leur figure, leur idole.
C’étaient de petits magots dont on ornait son cabinet. C’étaient les amusemens des vieilles femmes & des enfans, qui n’étaient autorisés par aucun culte public. On laissait agir à son gré la superstition de chaque particulier. On retrouve encor ces petites idoles dans les ruines des anciennes villes.
Si personne ne sait quand les hommes commencèrent à se faire des idoles, on sait qu’elles sont de l’antiquité la plus haute. Tharé père d’Abraham en faisait à Ur en Caldée. Rachel déroba & emporta les idoles de son beau-père Laban. On ne peut remonter plus haut.
Mais quelle notion précise avaient les [I-350] anciennes nations de tous ces simulacres ? Quelle vertu, quelle puissance leur attribuait-on ? croyait-on que les Dieux descendaient du ciel pour venir se cacher dans ces statues ? ou qu’ils leur communiquaient une partie de l’esprit divin, ou qu’ils ne leur communiquaient rien du tout ? c’est encor sur quoi on a très inutilement écrit ; il est clair que chaque homme en jugeait selon le degré de sa raison, ou de sa crédulité, ou de son fanatisme. Il est évident que les prêtres attachaient le plus de divinité qu’ils pouvaient à leurs statues, pour s’attirer plus d’offrandes. On sait que les philosophes réprouvaient ces superstitions, que les guerriers s’en moquaient, que les Magistrats les toléraient, & que le peuple toûjours absurde ne savait ce qu’il faisait. C’est en peu de mots l’histoire de toutes les nations à qui Dieu ne s’est pas fait connaître.
On peut se faire la même idée du culte que toute l’Égypte rendit à un bœuf, & que plusieurs villes rendirent à un chien, à un singe, à un chat, à des oignons. Il y a grande apparence que ce furent d’abord des emblèmes. Ensuite un certain bœuf Apis, un certain chien, nommé Anubis, furent adorés ; on mangea toûjours du bœuf & des oignons ; mais il est difficile de savoir ce que pensaient les vieilles femmes d’Égypte, des oignons sacrés & des bœufs.
Les idoles parlaient assez souvent. On faisait commémoration à Rome le jour de la fête de Cibèle, des belles paroles que la statue avait [I-351] prononcées, lorsqu’on en fit la translation du palais du roi Attale.
Ipsa pati volui, ne sit mora, mitte volentem :
Dignus Roma locus, quò deus omnis eat.
« J’ai voulu qu’on m’enlevât, emmenez-moi vite ; Rome est digne que tout dieu s’y établisse. »
La statue de la Fortune avait parlé ; les Scipions, les Cicérons, les Césars, à la vérité, n’en croyaient rien ; mais la vieille à qui Encolpe donna un écu pour acheter des oyes & des dieux, pouvait fort bien le croire.
Les idoles rendaient aussi des oracles, & les prêtres cachés dans le creux des statues parlaient au nom de la divinité.
Comment au milieu de tant de Dieux & de tant de théogonies différentes, & de cultes particuliers, n’y eut-il jamais de guerre de religion chez les peuples nommés idolâtres ? Cette paix fut un bien qui nâquit d’un mal, de l’erreur même. Car chaque nation reconnaissant plusieurs dieux inférieurs, trouva bon que ses voisins eussent aussi les leurs. Si vous exceptez Cambyse à qui on reproche d’avoir tué le bœuf Apis, on ne voit dans l’histoire profane aucun conquérant qui ait maltraité les dieux d’un peuple vaincu. Les Gentils n’avaient aucune religion exclusive, & les prêtres ne songèrent qu’à multiplier les offrandes & les sacrifices.
Les premières offrandes furent des fruits. [I-352] Bientôt après il falut des animaux pour la table des prêtres ; ils les égorgeaient eux-mêmes ; ils devinrent bouchers & cruels ; enfin ils introduisirent l’usage horrible de sacrifier des victimes humaines ; & surtout des enfans & de jeunes filles. Jamais les Chinois, ni les Parsis, ni les Indiens ne furent coupables de ces abominations. Mais à Hiéropolis en Égypte, au rapport de Porphyre, on immola des hommes.
Dans la Tauride on sacrifiait des étrangers. Heureusement les prêtres de la Tauride ne devaient pas avoir beaucoup de pratiques. Les premiers Grecs, les Cypriots, les Phéniciens, les Tyriens, les Carthaginois, eurent cette superstition abominable. Les Romains eux-mêmes tombèrent dans ce crime de religion ; & Plutarque rapporte qu’ils immolèrent deux Grecs & deux Gaulois, pour expier les galanteries de trois Vestales. Procope, contemporain du roi des Francs Théodebert, dit que les Francs immolèrent des hommes quand ils entrèrent en Italie avec ce prince. Les Gaulois, les Germains faisaient communément de ces affreux sacrifices. On ne peut guère lire l’histoire sans concevoir de l’horreur pour le genre humain.
Il est vrai que chez les Juifs Jephté sacrifia sa fille, & que Saül fut prêt d’immoler son fils. Il est vrai que ceux qui étaient voués au Seigneur par anathème ne pouvaient être rachetés ainsi qu’on rachetait les bêtes, & qu’il fallait qu’ils périssent. Samuël prêtre Juif [I-353] hacha en morceaux avec un saint couperet le Roi Agag prisonnier de guerre à qui Saül avait pardonné, & Saül fut réprouvé pour avoir observé le droit des gens avec ce Roi ; mais Dieu maître des hommes, peut leur ôter la vie quand il veut, comme il le veut, & par qui il veut ; & ce n’est pas aux hommes à se mettre à la place du maître de la vie & de la mort, & à usurper les droits de l’Être suprême.
Pour consoler le genre humain de cet horrible tableau, de ces pieux sacrilèges, il est important de savoir que chez presque toutes les nations nommées idolâtres, il y avait la théologie sacrée & l’erreur populaire, le culte secret & les cérémonies publiques, la religion des sages & celle du vulgaire. On n’enseignait qu’un seul Dieu aux initiés dans les mystères : il n’y a qu’à jeter les yeux sur l’hymne attribué à l’ancien Orphée, qu’on chantait dans les mystères de Cérès Éleusine, si célèbre en Europe & en Asie :
« Contemple la nature divine, illumine ton esprit, gouverne ton cœur, marche dans la voie de la justice, que le Dieu du ciel & de la terre soit toûjours présent à tes yeux ; il est unique, il existe seul par lui-même, tous les êtres tiennent de lui leur existence : il les soutient tous ; il n’a jamais été vu des mortels, & il voit toutes choses. »
Qu’on lise encor ce passage du philosophe Maxime de Madaure, dans sa Lettre à St. Augustin :
« Quel homme est assez grossier, assez [I-354] stupide pour douter qu’il soit un Dieu suprême éternel, infini, qui n’a rien engendré de semblable à lui-même, & qui est le père commun de toutes choses ? »
Il y a mille témoignages que les sages abhorraient non seulement l’idolâtrie, mais encor le polythéisme.
Épictète, ce modèle de résignation & de patience, cet homme si grand dans une condition si basse, ne parle jamais que d’un seul Dieu. Voici une de ses maximes :
« Dieu m’a créé, Dieu est au-dedans de moi, je le porte partout. Pourrais-je le souiller par des pensées obscènes, par des actions injustes, par d’infâmes désirs ? Mon devoir est de remercier Dieu de tout, de le louer de tout, & de ne cesser de le bénir, qu’en cessant de vivre. »
Toutes les idées d’Épictète roulent sur ce principe.
Marc-Aurèle, aussi grand peut-être sur le trône de l’empire romain, qu’Épictète dans l’esclavage, parle souvent, à la vérité, des dieux, soit pour se conformer au langage reçu, soit pour exprimer des êtres mitoyens entre l’Être suprême & les hommes ; mais en combien d’endroits ne fait-il pas voir qu’il ne reconnaît qu’un Dieu éternel, infini ?
« Notre âme, dit-il, est une émanation de la divinité. Mes enfans, mon corps, mes esprits me viennent de Dieu. »
Les Stoïciens, les Platoniciens, admettaient une nature divine & universelle : les Épicuriens la niaient. Les Pontifes ne parlaient que d’un [I-355] seul Dieu dans les mystères. Où étaient donc les idolâtres ?
Au reste c’est une des grandes erreurs du Dictionnaire de Moréri de dire que du tems de Théodose le jeune, il ne resta plus d’idolâtres que dans les pays reculés de l’Asie & de l’Afrique. Il y avait dans l’Italie beaucoup de peuples encor Gentils, même au septième siècle. Le nord de l’Allemagne depuis le Vézer, n’était pas chrétien du tems de Charlemagne. La Pologne & tout le septentrion restèrent longtems après lui dans ce qu’on appelle idolâtrie. La moitié de l’Afrique, tous les royaumes au-delà du Gange, le Japon, la populace de la Chine, cent hordes de Tartares ont conservé leur ancien culte. Il n’y a plus en Europe que quelques Lapons, quelques Samoyèdes, quelques Tartares, qui aient persévéré dans la religion de leurs ancêtres.
Finissons par remarquer que dans les tems qu’on appelle parmi nous le moyen âge, nous appelions le pays des Mahométans la Paganie. Nous traitions d’idolâtres, d’adorateurs d’images, un peuple qui a les images en horreur. Avouons encor une fois, que les Turcs sont plus excusables de nous croire idolâtres, quand ils voient nos autels chargés d’images & de statues.
[I-357]
INONDATION.↩
Y a-t-il eu un tems où le globe ait été entièrement inondé ? cela est physiquement impossible. Il se peut que successivement la mer ait couvert tous les terrains l’un après l’autre ; & cela ne peut être arrivé que par une gradation lente, dans une multitude prodigieuse de siècles. La mer en cinq cents années de tems, s’est retirée d’Aiguemortes, de Fréjus, de Ravenne qui étaient de grands ports, & a laissé environ deux lieux de terrain à sec. Par cette progression il est évident qu’il lui faudrait deux millions deux cent cinquante mille ans pour faire le tour de notre globe. Ce qui est très remarquable, c’est que cette période approche fort de celle qu’il faut à l’axe de la terre pour se relever & pour coïncider avec l’équateur ; mouvement très vraisemblable, qu’on commence depuis cinquante ans à soupçonner, & qui ne peut s’effectuer que dans l’espace de deux millions & plus de trois cents mille années.
[I-358]
Les lits, les couches de coquilles qu’on a découverts à quelques lieuës de la mer, sont une preuve incontestable qu’elle a déposé peu à peu ces productions maritimes sur des terrains qui étaient autrefois les rivages de l’Océan ; mais que l’eau ait couvert entièrement tout le globe à la fois, c’est une chimère absurde en physique, démontrée impossible par les loix de la gravitation, par les loix des fluides, par l’insuffisance de la quantité d’eau. Ce n’est pas qu’on prétende donner la moindre atteinte à la grande vérité du déluge universel rapporté dans le Pentateuque ; au contraire, c’est un miracle, donc il le faut croire ; c’est un miracle, donc il n’a pu être exécuté par les loix physiques.
Tout est miracle dans l’histoire du déluge. Miracle que quarante jours de pluye aient inondé les quatre parties du monde, & que l’eau se soit élevée de quinze coudées au-dessus de toutes les plus hautes montagnes ; miracle qu’il y ait eu des cataractes, des portes, des ouvertures dans le ciel ; miracle que tous les animaux se soient rendus dans l’arche de toutes les parties du monde ; miracle que Noé ait trouvé de quoi les nourrir pendant dix mois ; miracle que tous les animaux aient tenu dans l’arche avec leurs provisions ; miracle que la plupart n’y soient pas morts ; miracle qu’ils aient trouvé de quoi se nourrir en sortant de l’arche ; miracle encor, mais d’une autre espèce, qu’un nommé Palletier ait cru expliquer comment tous les animaux ont pu tenir & se nourrir naturellement dans l’arche de Noé.
[I-359]
Or l’histoire du déluge étant la chose la plus miraculeuse dont on ait jamais entendu parler, il serait insensé de l’expliquer ; ce sont de ces mystères qu’on croit par la foi, & la foi consiste à croire ce que la raison ne croit pas, ce qui est encor un autre miracle.
Ainsi l’histoire du déluge universel est comme celle de la tour de Babel, de l’ânesse de Balaam, de la chute de Jérico au son des trompettes, des eaux changées en sang, du passage de la mer Rouge, & de tous les prodiges que Dieu daigna faire en faveur des élus de son peuple. Ce sont des profondeurs que l’esprit humain ne peut sonder.
INQUISITION.↩
L’Inquisition est, comme on sait, une invention admirable & tout à fait chrétienne, pour rendre le Pape & les moines plus puissants & pour rendre tout un royaume hypocrite.
On regarde d’ordinaire St. Dominique comme le premier à qui l’on doit cette sainte institution. En effet nous avons encor une patente donnée par ce grand saint, laquelle est conçue en ces propres mots : Moi, frère Dominique, je réconcilie à l’Église le nommé Roger porteur des présentes, à condition qu’il se fera fouetter par un prêtre trois dimanches consécutifs depuis l’entrée de la ville jusqu’à la porte de l’église, qu’il fera maigre toute sa vie, qu’il jeûnera [I-360] trois carêmes dans l’année, qu’il ne boira jamais de vin, qu’il portera le san-benito avec des croix, qu’il récitera le bréviaire tous les jours, dix pater dans la journée & vingt à l’heure de minuit, qu’il gardera désormais la continence & qu’il se présentera tous les mois au curé de sa paroisse, &c. Tout cela sous peine d’être traité comme hérétique, parjure & impénitent.
Quoique Dominique soit le véritable fondateur de l’Inquisition, cependant Louis de Paramo l’un des plus respectables écrivains & des plus brillantes lumières du St. Office, rapporte au titre second de son second livre, que Dieu fut le premier instituteur du St. Office, & qu’il exerça le pouvoir des frères prêcheurs contre Adam. D’abord Adam est cité au tribunal, Adam, ubi es ? & en effet, ajoute-t-il, le défaut de citation aurait rendu la procédure de Dieu nulle.
Les habits de peau que Dieu fit à Adam & à Ève furent le modèle du san-benito que le St. Office fait porter aux hérétiques. Il est vrai que par cet argument on prouve que Dieu fut le premier tailleur ; mais il n’est pas moins évident qu’il fut le premier inquisiteur.
Adam fut privé de tous les biens immeubles qu’il possédait dans le paradis terrestre, c’est de là que le St. Office confisque les biens de tous ceux qu’il a condamnés.
Louis de Paramo remarque que les habitans de Sodome furent brûlés comme hérétiques, parce que la sodomie est une hérésie formelle. De là il passe à l’histoire des Juifs ; il y trouve partout le St. Office.
[I-361]
Jésus-Christ est le premier inquisiteur de la nouvelle loi, les Papes furent inquisiteurs de droit divin, & enfin ils communiquèrent leur puissance à St. Dominique.
Il fait ensuite le dénombrement de tous ceux que l’inquisition a mis à mort, & il en trouve beaucoup au delà de cent mille.
Son livre fut imprimé en 1589 à Madrid avec l’approbation des Docteurs, les éloges de l’Évêque & le privilège du Roi. Nous ne concevons pas aujourd’hui des horreurs si extravagantes à la fois & si abominables ; mais alors rien ne paraissait plus naturel & plus édifiant. Tous les hommes ressemblent à Louis de Paramo quand ils sont fanatiques.
Ce Paramo était un homme simple, très exact dans les dates, n’omettant aucun fait intéressant, & supputant avec scrupule le nombre des victimes humaines que le St. Office a immolées dans tous les pays.
Il raconte avec la plus grande naïveté l’établissement de l’inquisition en Portugal, & il est parfaitement d’accord avec quatre autres historiens qui ont tous parlé comme lui. Voici ce qu’ils rapportent unanimement.
Il y avait longtems que le Pape Boniface IX, au commencement du quinzième siècle, avait délégué des frères prêcheurs qui allaient en Portugal de ville en ville brûler les hérétiques, les Musulmans & les Juifs ; mais ils étaient ambulants, & les Rois mêmes se plaignirent quelquefois de leurs vexations. Le pape Clément VII. voulut leur donner un [I-362] établissement fixe en Portugal comme ils en avaient en Arragon & en Castille. Il y eut des difficultés entre la Cour de Rome & celle de Lisbonne, les esprits s’aigrirent, l’Inquisition en souffrait & n’était point établie parfaitement.
En 1539 il parut à Lisbonne un Légat du Pape, qui était venu, disait-il, pour établir la Ste. Inquisition sur des fondements inébranlables. Il apporte au Roi Jean III. des lettres du Pape Paul III. Il avait d’autres lettres de Rome pour les principaux Officiers de la Cour ; ses patentes de Légat étaient dûment scellées & signées ; il montra les pouvoirs les plus amples de créer un grand Inquisiteur & tous les juges du St. Office. C’était un fourbe nommé Savedra qui savait contrefaire toutes les écritures, fabriquer & appliquer de faux sceaux & de faux cachets. Il avait appris ce métier à Rome & s’y était perfectionné à Séville dont il arrivait avec deux autres fripons. Son train était magnifique, il était composé de plus de cent vingt domestiques. Pour subvenir à cette énorme dépense, lui & ses deux confidents empruntèrent à Séville des sommes immenses au nom de la chambre apostolique de Rome ; tout était concerté avec l’artifice le plus éblouissant.
Le Roi de Portugal fut étonné d’abord que le Pape lui envoyât un légat a latere sans l’en avoir prévenu. Le légat répondit fièrement que dans une chose aussi pressante que l’établissement fixe de l’inquisition, Sa Sainteté ne pouvait souffrir les délais, & que le Roi était [I-363] assez honoré que le premier courrier qui lui en apportait la nouvelle fût un Légat du St. Père. Le roi n’osa répliquer. Le Légat dès le jour même établit un grand inquisiteur, envoya partout recueillir des décimes, & avant que la Cour pût avoir des réponses de Rome, il avait déjà fait brûler deux cents personnes & recueilli plus de deux cent mille écus.
Cependant le Marquis de Villanova, seigneur espagnol de qui le Légat avait emprunté à Séville une somme très considérable sur de faux billets, jugea à propos de se payer par ses mains, au lieu d’aller se compromettre avec le fourbe à Lisbonne. Le Légat faisait alors sa tournée sur les frontières de l’Espagne. Il y marche avec cinquante hommes armés, l’enlève & le conduit à Madrid.
La friponnerie fut bientôt découverte à Lisbonne, le conseil de Madrid condamna le légat Savedra au fouët & à dix ans de galères ; mais ce qu’il y eut d’admirable, c’est que le pape Paul IV. confirma depuis tout ce qu’avait établi ce fripon ; il rectifia par la plénitude de sa puissance divine toutes les petites irrégularités des procédures, & rendit sacré ce qui avait été purement humain.
Qu’importe de quel bras Dieu daigne se servir ?
Voilà comme l’Inquisition devint sédentaire à Lisbonne, & tout le royaume admira la Providence.
Au reste on connaît assez toutes les procédures de ce tribunal, on sait combien elles sont [I-364] opposées à la fausse équité & à l’aveugle raison de tous les autres tribunaux de l’univers. On est emprisonné sur la simple dénonciation des personnes les plus infâmes, un fils peut dénoncer son père, une femme son mari ; on n’est jamais confronté avec ses accusateurs, les biens sont confisqués au profit des juges ; c’est ainsi du moins que l’Inquisition s’est conduite jusqu’à nos jours ; il y a là quelque chose de divin : car il est incompréhensible que les hommes aient souffert ce joug patiemment.
Enfin le Comte d’Aranda a été béni de l’Europe entière en rognant les griffes & en limant les dents du monstre ; mais il respire encor.
[I-356]
Jephté.↩
ou des sacrifices de sang humain
Il est évident par le texte du livre des Juges que Jephté promit de sacrifier la première personne qui sortirait de sa maison pour venir le féliciter de sa victoire contre les Ammonites. Sa fille unique vint au-devant de lui ; il déchira ses vêtemens, & il l’immola après lui avoir permis d’aller pleurer sur les montagnes le malheur de mourir vierge. Les filles juives célébrèrent longtems cette avanture, en pleurant la fille de Jephté pendant quatre jours. (Voyez chap. 12. des Juges.)
En quelque temps que cette histoire ait été écrite, qu’elle soit imitée de l’histoire Grecque, d’Agamemnon & d’Idoménée, ou qu’elle en soit le modèle, qu’elle soit antérieure ou postérieure à de pareilles histoires assyriennes, ce n’est pas ce que j’examine ; je m’en tiens au texte : Jephté voua sa fille en holocauste, & accomplit son vœu.
Il était expressément ordonné par la loi juive, d’immoler les hommes voués au Seigneur. Tout homme voué ne sera point racheté, mais sera mis à mort sans rémission. La Vulgate traduit, Non redimetur, sed morte morietur. Lévitique, chap. 27. verset 29.
C’est en vertu de cette loi que Samuël coupa en morceaux le roi Agag, à qui (comme nous [I-357] l’avons déjà dit) Saül avait pardonné ; & c’est même pour avoir épargné Agag, que Saül fut réprouvé du Seigneur, & perdit son royaume.
Voilà donc les sacrifices de sang humain clairement établis ; il n’y a aucun point d’histoire mieux constaté. On ne peut juger d’une nation que par ses archives, & par ce qu’elle rapporte d’elle-même.
[I-364]
JOB.↩
Bonjour, mon ami Job, tu es un des plus anciens originaux dont les livres fassent mention ; tu n’étais point Juif : on sait que le livre qui porte ton nom est plus ancien que le Pentateuque. Si les Hébreux qui l’ont traduit de l’arabe, se sont servis du mot Jéhova pour signifier Dieu, ils empruntèrent ce mot des Phéniciens & des Égyptiens, comme les vrais savants n’en doutent pas. Le mot de Satan n’était point hébreu, il était caldéen, on le sait assez.
Tu demeurais sur les confins de la Caldée. Des commentateurs dignes de leur profession, prétendent que tu croyais à la résurrection, [I-365] parce qu’étant couché sur ton fumier, tu as dit dans ton 19e. chapitre, que tu t’en releverais quelque jour. Un malade qui espère sa guérison, n’espère pas pour cela la résurrection ; mais je veux te parler d’autres choses.
Avouë que tu étais un grand bavard, mais tes amis l’étaient davantage. On dit que tu possédais sept mille moutons, trois mille chameaux, mille bœufs & cinq cents ânesses. Je veux faire ton compte.
| Sept mille moutons, à trois livres dix sous piéce, font vingt-deux mille cinq cents livres tournois, pose | 22500 liv. | |
| J’évalue les trois mille chameaux, à cinquante écus piéce, | 450000 liv.-:- | |
| Mille bœufs ne peuvent être estimés l’un portant l’autre moins de | 80000 liv.-:- | |
| Et cinq cents ânesses, à vingt francs l’ânesse, | 10000 liv.-:- | |
| Le tout se monte à | 562500 liv.-:- |
Sans compter tes meubles, bagues & joyaux.
J’ai été beaucoup plus riche que toi, & quoique j’aye perdu une grande partie de mon bien, & que je sois malade comme toi, je n’ai point murmuré contre Dieu, comme tes amis semblent te le reprocher quelquefois.
Je ne suis point du tout content de Satan, qui pour t’induire au péché & pour te faire oublier Dieu, demande la permission de t’ôter [I-366] ton bien & de te donner la gale. C’est dans cet état que les hommes ont toûjours recours à la Divinité. Ce sont les gens heureux qui l’oublient. Satan ne connaissait pas assez le monde ; il s’est formé depuis ; & quand il veut s’assurer de quelqu’un, il en fait un fermier-général, ou quelque chose de mieux, s’il est possible. C’est ce que notre ami Pope nous a clairement montré dans l’histoire du chevalier Balaam.
Ta femme était une impertinente, mais tes prétendus amis Éliphas natif de Théman en Arabie, Baldad de Suez, & Sophar de Nahamath étaient bien plus insupportables qu’elle. Ils t’exhortent à la patience d’une manière à impatienter le plus doux des hommes. Ils te font de longs sermons plus ennuyeux que ceux que prêche le fourbe V.....e à Amsterdam, & le &c.
Il est vrai que tu ne sais ce que tu dis quand tu t’écries, mon Dieu ! Suis-je une mer ou une baleine pour avoir été enfermé par vous comme dans une prison ? mais tes amis n’en savent pas davantage quand ils te répondent, que le jonc ne peut reverdir sans humidité, & que l’herbe des prés ne peut croître sans eau. Rien n’est moins consolant que cet axiome.
Sophar de Nahamath te reproche d’être un babillard, mais aucun de ces bons amis ne te prête un écu. Je ne t’aurais pas traité ainsi. Rien n’est plus commun que gens qui conseillent, rien de plus rare que ceux qui secourent. C’est bien la peine d’avoir trois amis pour n’en pas recevoir une goutte de bouillon quand [I-367] on est malade. Je m’imagine que quand Dieu t’eut rendu tes richesses & ta santé, ces éloquents personnages n’osèrent pas se présenter devant toi ; aussi, les amis de Job ont passé en proverbe.
Dieu fut très mécontent d’eux, & leur dit tout net au chap. 42. qu’ils sont ennuyeux & imprudens ; & il les condamne à une amende de sept taureaux & de sept béliers pour avoir dit des sottises. Je les aurais condamnés pour n’avoir point secouru leur ami.
Je te prie de me dire s’il est vrai que tu vécus cent quarante ans après cette avanture. J’aime à voir que les honnêtes gens vivent longtems ; mais il faut que les hommes d’aujourd’hui soient de grands fripons tant leur vie est courte.
(Par un malade aux eaux d’Aix-la-Chapelle.)
[I-194]
Au reste le livre de Job est un des plus précieux de toute l’antiquité. Il est évident que ce livre est d’un Arabe qui vivait avant le tems où nous plaçons Moïse. Il est dit qu’Éliphaz l’un des interlocuteurs est de Théman ; c’est une ancienne ville d’Arabie. Baldad était de Sué autre ville d’Arabie ; Sophar était de Naamath, contrée d’Arabie encor plus orientale.
Mais ce qui est bien plus remarquable, & ce qui démontre que cette fable ne peut être d’un Juif, c’est qu’il y est parlé des trois constellations que nous nommons aujourd’hui l’Ourse, l’Orion & les Hiades. Les Hébreux n’ont jamais eu la moindre connaissance de l’astronomie, ils n’avaient pas même de mot pour exprimer cette science ; tout ce qui regarde les arts de l’esprit leur était inconnu jusqu’au terme de géométrie.
Les Arabes au contraire habitant sous des tentes, étant continuellement à portée d’observer les astres, furent peut-être les premiers qui réglèrent leurs années par l’inspection du ciel.
Une observation plus importante, c’est qu’il n’est parlé que d’un seul Dieu dans ce livre. C’est une erreur absurde d’avoir imaginé que les Juifs fussent les seuls qui reconnussent un [I-195] Dieu unique ; c’était la doctrine de presque tout l’Orient, & les Juifs en cela ne furent que des plagiaires comme ils le furent en tout.
Dieu dans le 38e chapitre parle lui-même à Job du milieu d’un tourbillon, & c’est ce qui a été imité depuis dans la Genèse. On ne peut trop répéter que les livres Juifs sont très nouveaux. L’ignorance & le fanatisme crient que le Pentateuque est le plus ancien livre du monde. Il est évident que ceux de Sanchoniaton, ceux de Thaut antérieurs de huit cents ans à ceux de Sanchoniaton ; ceux du premier Zerdust, le Shasta, le Védam des Indiens que nous avons encor, les cinq Kings des Chinois, enfin le livre de Job, sont d’une antiquité beaucoup plus reculée qu’aucun livre Juif. Il est démontré que ce petit peuple ne put avoir des annales que lorsqu’il eut un gouvernement stable ; qu’il n’eut ce gouvernement que sous ses Rois ; que son jargon ne se forma qu’avec le temps d’un mélange de phénicien & d’arabe. Il y a des preuves incontestables que les Phéniciens cultivaient les lettres très longtems avant eux. Leur profession fut le brigandage & le courtage ; ils ne furent écrivains que par hasard. On a perdu les livres des Égyptiens & des Phéniciens ; les Chinois, les Brames, les Guèbres, les Juifs ont conservé les leurs. Tous ces monumens sont curieux ; mais ce ne sont que des monumens de l’imagination humaine dans lesquels on ne peut apprendre une seule vérité, soit physique, soit historique. Il n’y a point aujourd’hui de petit [I-196] livre de physique, qui ne soit plus utile que tous les livres de l’antiquité.
Le bon Calmet ou Dom Calmet (car les bénédictins veulent qu’on leur donne du Dom) ce naïf compilateur de tant de rêveries & d’imbécillités, cet homme que sa simplicité a rendu si utile à quiconque veut rire des sottises antiques, rapporte fidèlement les opinions de ceux qui ont voulu deviner la maladie dont Job fut attaqué, comme si Job eût été un personnage réel. Il ne balance point à dire que Job avait la vérole, & il entasse passage sur passage à son ordinaire pour prouver ce qui n’est pas. Il n’avait pas lu l’histoire de la vérole par Astruc : car Astruc n’étant ni un Père de l’Église ni un docteur de Salamanque, mais un médecin très savant, le bonhomme Calmet ne savait pas seulement qu’il existât ; les moines compilateurs sont de pauvres gens.
[I-367]
JOSEPH.↩
L’histoire de Joseph, à ne la considérer que comme un objet de curiosité & de littérature, est un des plus précieux monumens de l’antiquité, qui soient parvenus jusqu’à nous. Elle paraît être le modèle de tous les écrivains orientaux ; elle est plus attendrissante que l’Odyssée d’Homère ; car un héros qui pardonne, est plus touchant que celui qui se venge.
Nous regardons les Arabes comme les premiers auteurs de ces fictions ingénieuses qui [I-368] ont passé dans toutes les langues ; mais je ne vois chez eux aucune avanture comparable à celle de Joseph. Presque tout en est merveilleux, & la fin peut faire répandre des larmes d’attendrissement. C’est un jeune homme de seize ans dont ses frères sont jaloux ; il est vendu par eux à une caravane de marchands Ismaëlites, conduit en Égypte, & acheté par un eunuque du roi. Cet eunuque avait une femme, ce qui n’est point du tout étonnant ; le Kislar-Aga eunuque parfait, à qui on a tout coupé, a aujourd’hui un sérail à Constantinople : on lui a laissé ses yeux & ses mains, & la nature n’a point perdu ses droits dans son cœur. Les autres eunuques, à qui on n’a coupé que les deux accompagnements de l’organe de la génération, emploient encor souvent cet organe ; & Putiphar à qui Joseph fut vendu, pouvait très bien être du nombre de ces eunuques.
La femme de Putiphar devient amoureuse du jeune Joseph, qui fidèle à son maître & à son bienfaiteur, rejette les empressements de cette femme. Elle en est irritée, & accuse Joseph d’avoir voulu la séduire. C’est l’histoire d’Hippolite & de Phèdre, de Bellérophon & de Stenobée, d’Hebrus & de Damasippe, de Tanis & de Péribée, de Mirtil & d’Hipodamie, de Pélée & de Demenette.
Il est difficile de savoir quelle est l’originale de toutes ces histoires ; mais chez les anciens auteurs arabes, il y a un trait touchant l’avanture de Joseph & de la femme de Putiphar, qui est fort ingénieux. L’auteur suppose que [I-369] Putiphar incertain entre sa femme & Joseph, ne regarda pas la tunique de Joseph que sa femme avait déchirée comme une preuve de l’attentat du jeune homme. Il y avait un enfant au berceau dans la chambre de la femme ; Joseph disait qu’elle lui avait déchiré & ôté sa tunique en présence de l’enfant ; Putiphar consulta l’enfant dont l’esprit était fort avancé pour son âge ; l’enfant dit à Putiphar, regardez si la tunique est déchirée par devant ou par derrière ; si elle l’est par devant, c’est une preuve que Joseph a voulu prendre par force votre femme qui se défendait ; si elle l’est par derrière, c’est une preuve que votre femme courait après lui. Putiphar, grace au génie de cet enfant, reconnut l’innocence de son esclave. C’est ainsi que cette avanture est rapportée dans l’Alcoran d’après l’ancien auteur Arabe. Il ne s’embarrasse point de nous instruire à qui appartenait l’enfant qui jugea avec tant d’esprit. Si c’était un fils de la Putiphar, Joseph n’était pas le premier à qui cette femme en avait voulu.
Quoi qu’il en soit, Joseph, selon la Genèse, est mis en prison, & il s’y trouve en compagnie de l’échanson & du panetier du Roi d’Égypte. Ces deux prisonniers d’État rêvent tous deux pendant la nuit ; Joseph explique leurs songes, il leur prédit que dans trois jours l’échanson rentrera en grace, & que le panetier sera pendu, ce qui ne manqua pas d’arriver.
Deux ans après le roi d’Égypte rêve aussi ; [I-370] son échanson lui dit qu’il y a un jeune Juif en prison, qui est le premier homme du monde pour l’intelligence des rêves ; le roi fait venir le jeune homme, qui lui prédit sept années d’abondance, & sept années de stérilité.
Interrompons un peu ici le fil de l’histoire, pour voir de quelle prodigieuse antiquité est l’interprétation des songes. Jacob avait vu en songe l’échelle mystérieuse au haut de laquelle était Dieu lui-même : il apprit en songe une méthode de multiplier les troupeaux ; méthode qui n’a jamais réussi qu’à lui. Joseph lui-même avait appris par un songe qu’il dominerait un jour sur ses frères. Abimélec, longtems auparavant, avait été averti en songe que Sara était femme d’Abraham. (Voyez l’article Songe.)
Revenons à Joseph. Dès qu’il eut expliqué le songe de Pharaon, il fut sur le champ premier ministre. On doute qu’aujourd’hui on trouvât un Roi, même en Asie, qui donnât une telle charge pour un rêve expliqué. Pharaon fit épouser à Joseph une fille de Putiphar. Il est dit, que ce Putiphar était grand-prêtre d’Héliopolis ; ce n’était donc pas l’eunuque son premier maître ; ou si c’était lui, il avait encor certainement un autre titre que celui de grand-prêtre, & sa femme avait été mère plus d’une fois.
Cependant, la famine arriva, comme Joseph l’avait prédit, & Joseph pour mériter les bonnes graces de son roi, força tout le peuple à vendre ses terres à Pharaon, & toute la nation [I-371] fit esclave pour avoir du bled. C’est-là apparemment l’origine du pouvoir despotique. Il faut avouer que jamais Roi n’avait fait un meilleur marché ; mais aussi le peuple ne devait guère bénir le premier ministre.
Enfin, le père & les frères de Joseph eurent aussi besoin de bled, car la famine désolait alors toute la terre. Ce n’est pas la peine de raconter ici comment Joseph reçut ses frères, comment il leur pardonna & les enrichit. On trouve dans cette histoire tout ce qui constitue un poëme épique intéressant ; exposition, nœud, reconnaissance, péripétie, & merveilleux. Rien n’est plus marqué au coin du génie oriental.
Ce que le bon homme Jacob père de Joseph répondit à Pharaon, doit bien frapper ceux qui savent lire. Quel âge avez-vous ? lui dit le roi. J’ai cent trente ans, dit le vieillard, & je n’ai pas eu encor un jour heureux dans ce court pèlerinage.
JUDÉE.↩
Je n’ai pas été en Judée, Dieu merci, & je n’irai jamais. J’ai vu des gens de toute nation qui en sont revenus. Ils m’ont tous dit que la situation de Jérusalem est horrible ; que tout le pays d’alentour est pierreux ; que les montagnes sont pelées ; que le fameux fleuve du Jourdain n’a pas plus de quarante-cinq pieds de largeur, que le seul bon canton de ce pays [I-372] est Jérico. Enfin ils parlent tous comme parlait St. Jérôme qui demeura si longtems dans Bethléem, & qui peint cette contrée comme le rebut de la nature. Il dit qu’en été il n’y a pas seulement d’eau à boire. Ce pays cependant devait paraître aux Juifs un lieu de délices en comparaison des déserts dont ils étaient originaires. Des misérables qui auraient quitté les Landes pour habiter quelques montagnes du Lampourdan vanteraient leur nouveau séjour, & s’ils espéraient pénétrer jusque dans les belles parties du Languedoc, ce serait là pour eux la terre promise.
Voilà précisément l’histoire des Juifs. Jérico, Jérusalem sont Toulouse & Montpellier, & le désert de Sinaï est le pays entre Bordeaux & Bayonne.
Mais si le Dieu qui conduisait les Juifs, voulait leur donner une bonne terre, si ces malheureux avaient en effet habité l’Égypte, que ne les laissait-il en Égypte ? à cela on ne répond que par des phrases théologiques.
La Judée, dit-on, était la terre promise. Dieu dit à Abraham ; Je vous donnerai tout ce pays depuis le fleuve d’Égypte jusqu’à l’Euphrate. (Genèse chap. 15.)
Hélas mes amis ! vous n’avez jamais eu ces rivages fertiles de l’Euphrate & du Nil. On s’est moqué de vous. Les maîtres du Nil & de l’Euphrate ont été tour à tour vos maîtres. Vous avez été presque toûjours esclaves. Promettre & tenir sont deux, mes pauvres Juifs. Vous avez un vieux rabbin qui en lisant vos [I-373] sages prophéties qui vous annoncent une terre de miel & de lait, s’écria qu’on vous avait promis plus de beurre que de pain. Savez-vous bien que si le grand Turc m’offrait aujourd’hui la seigneurie de Jérusalem, je n’en voudrais pas ?
Frédéric second en voyant ce détestable pays, dit publiquement que Moïse était bien malavisé d’y mener sa compagnie de lépreux ; que n’allait-il à Naples, disait Frédéric. Adieu, mes chers Juifs ; je suis fâché que terre promise soit terre perdue.
(par le baron de Broukans.)
JULIEN LE PHILOSOPHE
EMPEREUR ROMAIN.↩
On rend quelquefois justice bien tard. Deux ou trois auteurs ou mercenaires, ou fanatiques parlent du barbare & de l’efféminé Constantin comme d’un Dieu, & traitent de scélérat le juste, le sage, le grand Julien. Tous les auteurs copistes des premiers, répètent la flatterie & la calomnie ; elles deviennent presque un article de foi. Enfin, le tems de la saine critique arrive ; & au bout de quatorze cents ans des hommes éclairés revoient le procès que l’ignorance avait jugé. On voit dans Constantin un heureux ambitieux qui se moque de Dieu & des hommes. Il a l’insolence de feindre que Dieu lui a envoyé dans les airs une [I-374] enseigne qui lui assure la victoire. Il se baigne dans le sang de tous ses parents, & il s’endort dans la mollesse ; mais il était chrétien, on le canonisa.
Julien est sobre, chaste, désintéressé, valeureux, clément, mais il n’était pas chrétien, on l’a regardé longtems comme un monstre.
Aujourd’hui, après avoir comparé les faits, les monumens, les écrits de Julien & ceux de ses ennemis, on est forcé de reconnaître que s’il n’aimait pas le christianisme, il fut excusable de haïr une secte souillée du sang de toute sa famille ; qu’ayant été persécuté, emprisonné, exilé, menacé de mort par les Galiléens sous le règne du barbare Constance, il ne les persécuta jamais ; qu’au contraire, il pardonna à dix soldats chrétiens qui avaient conspiré contre sa vie. On lit ses lettres, & on admire. Les Galiléens, dit-il, ont souffert sous mon prédécesseur l’exil & les prisons ; on a massacré réciproquement ceux qui s’appellent tour à tour hérétiques. J’ai rappelé leurs exilés, élargi leurs prisonniers ; j’ai rendu leurs biens aux proscrits ; je les ai forcés de vivre en paix. Mais telle est la fureur inquiète des Galiléens qu’ils se plaignent de ne pouvoir plus se dévorer les uns les autres. Quelle lettre ! quelle sentence portée par la philosophie contre le fanatisme persécuteur !
Enfin en discutant les faits on a été obligé de convenir que Julien avait toutes les qualités de Trajan, hors le goût si longtems pardonné aux Grecs & aux Romains ; toutes les vertus de Caton, mais non pas son [I-375] opiniâtreté et sa mauvaise humeur ; tout ce qu’on admira dans Jules César, & aucun de ses vices ; il eut la continence de Scipion. Enfin il fut en tout égal à Marc-Aurèle le premier des hommes.
On ose plus répéter aujourd’hui après le calomniateur Théodoret, qu’il immola une femme dans le temple de Carres pour se rendre les Dieux propices. On ne redit plus qu’en mourant il jeta de sa main quelques gouttes de son sang au ciel, en disant à Jésus-Christ : Tu as vaincu Galiléen, comme s’il eût combattu contre Jésus en faisant la guerre aux Perses ; comme si ce philosophe qui mourut avec tant de résignation, avait reconnu Jésus ; comme s’il eût cru que Jésus était en l’air, & que l’air était le ciel ! ces inepties de gens qu’on appelle pères de l’Église, ne se répètent plus aujourd’hui.
On est enfin réduit à lui donner des ridicules, comme faisaient les citoyens frivoles d’Antioche. On lui reproche sa barbe mal peignée & la manière dont il marchait. Mais, monsieur l’Abbé de La Bléterie, vous ne l’avez pas vu marcher, & vous avez lu ses lettres & ses loix, monumens de ses vertus. Qu’importe qu’il eût la barbe sale & la démarche précipitée, pourvu que son cœur fût magnanime & que tous ses pas tendissent à la vertu.
Il reste aujourd’hui un fait important à examiner. On reprocha à Julien d’avoir voulu faire mentir la prophétie de Jésus-Christ en rebâtissant le temple de Jérusalem. On dit qu’il [I-376] sortit de terre des feux qui empêchèrent l’ouvrage. On dit que c’est un miracle, & que ce miracle ne convertit ni Julien, ni Alipius intendant de cette entreprise, ni personne de sa cour, & là-dessus l’Abbé de La Bléterie s’exprime ainsi :
« Lui & les philosophes de sa cour mirent sans doute en œuvre ce qu’ils savaient de physique pour dérober à la Divinité un prodige si éclatant. La nature fut toûjours la ressource des incrédules, mais elle sert la religion si à propos qu’ils devraient au moins la soupçonner de collusion. »
Premièrement, il n’est pas vrai qu’il soit dit dans l’Évangile que jamais le temple juif ne serait rebâti. L’Évangile de Matthieu, écrit visiblement après la ruine de Jérusalem par Titus, prophétise, il est vrai, qu’il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple de l’Iduméen Hérode, mais aucun Évangéliste ne dit qu’il ne sera jamais rebâti.
Secondement, qu’importe à la Divinité qu’il y ait un temple juif, ou un magasin, ou une mosquée au même endroit où les Juifs tuaient des bœufs & des vaches ?
Troisièmement, on ne sait pas si c’est de l’enceinte des murs de la ville, ou de l’enceinte du temple que partirent ces prétendus feux qui, selon quelques-uns, brûlaient les ouvriers. Mais on ne voit pas pourquoi Jésus aurait brûlé les ouvriers de l’Empereur Julien, & qu’il ne brûla point ceux du Calife Omar qui longtems après bâtit une mosquée sur les ruines du temple ; ni ceux du grand Saladin qui [I-377] rétablit cette même mosquée. Jésus avait-il tant de prédilection pour les mosquées des Musulmans ?
Quatrièmement, Jésus ayant prédit qu’il ne resterait pas pierre sur pierre dans Jérusalem, n’avait pas empêché de la rebâtir.
Cinquièmement, Jésus a prédit plusieurs choses dont Dieu n’a pas permis l’accomplissement ; il a prédit la fin du monde & son avènement dans les nuées avec une grande puissance & une grande majesté, à la fin de la génération qui vivait alors. Cependant, le monde dure encor, & durera vraisemblablement assez longtems. (Luc. I. chap. 2.)
Sixièmement, si Julien avait écrit ce miracle, je dirais qu’on l’a trompé par un faux rapport ridicule ; je croirais que les Chrétiens ses ennemis mirent tout en œuvre pour s’opposer à son entreprise, qu’ils tuèrent les ouvriers, & firent accroire que ces ouvriers étaient morts par miracle. Mais Julien n’en dit mot. La guerre contre les Perses l’occupait alors. Il différa pour un tems l’édification du temple, & il mourut avant de pouvoir commencer cet édifice.
Septièmement, ce prodige est rapporté dans Ammien Marcellin qui était payen. Il est très possible que ce soit une interpolation des chrétiens ; on leur en a reproché tant d’autres qui ont été avérées.
Mais il n’est pas moins vraisemblable que dans un tems où on ne parlait que de prodiges & de contes de sorciers, Ammien Marcellin ait [I-378] rapporté cette fable sur la foi de quelque esprit crédule. Depuis Tite-Live jusqu’à de Thou inclusivement, toutes les histoires sont infectées de prodiges.
Huitièmement, si Jésus faisait des miracles, serait-ce pour empêcher qu’on ne rebâtît un temple où lui-même sacrifia, & où il fut circoncis, ne ferait-il pas des miracles pour rendre chrétiennes tant de nations qui se moquent du Christianisme, ou plutôt, pour rendre plus doux & plus humains ses Chrétiens qui depuis Arius & Athanase jusqu’aux Roland & aux Cavalier des Cévennes ont versé des torrents de sang, & se sont conduits en cannibales ?
De là je conclus que la nature n’est point en collusion avec le Christianisme, comme le dit La Bléterie ; mais que La Bléterie est en collusion avec des contes de vieilles, comme dit Julien, Quibus cum stolidis aniculis negotium erat.
La Bléterie, après avoir rendu justice à quelques vertus de Julien, finit pourtant l’histoire de ce grand homme, en disant que sa mort fut un effet de la vengeance divine. Si cela est, tous les héros morts jeunes depuis Alexandre jusqu’à Gustave-Adolphe, ont donc été punis de Dieu. Julien mourut de la plus belle des morts en poursuivant ses ennemis après plusieurs victoires. Jovien qui lui succéda régna bien moins longtems que lui, & régna avec honte. Je ne vois point la vengeance divine, & je ne vois plus dans La Bléterie qu’un déclamateur de mauvaise foi ; mais où sont les hommes qui osent dire la vérité ?
[I-379]
Le Stoïcien Libanius fut un de ces hommes rares ; il célébra le brave & clément Julien devant Théodose le meurtrier des Thessaloniciens ; mais Le Beau & La Bléterie tremblent de le louer devant des habitués de paroisse.
(Tiré de Mr. Boulanger.)
DU JUSTE DE L’INJUSTE.↩
Qui nous a donné le sentiment du juste & de l’injuste ? Dieu, qui nous a donné un cerveau & un cœur. Mais quand votre raison vous apprend-elle qu’il y a vice & vertu ? quand elle nous apprend que deux & deux font quatre. Il n’y a point de connaissance innée, par la raison qu’il n’y a point d’arbre qui porte des feuilles & des fruits en sortant de la terre. Rien n’est ce qu’on appelle inné, c’est-à-dire, né développé : mais, répétons-le encor, Dieu nous fait naître avec des organes qui à mesure qu’ils croissent nous font sentir tout ce que notre espèce doit sentir pour la conservation de cette espèce.
Comment ce mystère continuel s’opère-t-il ? dites-le-moi, jaunes habitans des îles de la Sonde, noirs Africains, imberbes Canadiens, & vous Platons, Cicérons, Épictètes. Vous sentez tous également qu’il est mieux de donner le superflu de votre pain, de votre ris ou de votre manioc au pauvre qui vous le demande humblement, que de le tuer ou de lui crever [I-380] les deux yeux. Il est évident à toute la terre qu’un bienfait est plus honnête qu’un outrage, que la douceur est préférable à l’emportement.
Il ne s’agit donc plus que de nous servir de notre raison pour discerner les nuances de l’honnête & du déshonnête. Le bien & le mal sont souvent voisins ; nos passions les confondent : qui nous éclairera ? nous-mêmes quand nous sommes tranquilles. Quiconque a écrit sur nos devoirs a bien écrit dans tous les pays du monde, parce qu’il n’a écrit qu’avec sa raison. Ils ont tous dit la même chose : Socrate & Épicure, Confutzée & Cicéron, Marc-Antonin & Amurath second ont eu la même morale.
Redisons tous les jours à tous les hommes, La morale est une, elle vient de Dieu ; les dogmes sont différens, ils viennent de nous.
Jésus n’enseigna aucun dogme métaphysique, il n’écrivit point de cahiers théologiques ; il ne dit point, Je suis consubstantiel, j’ai deux volontés & deux natures avec une seule personne ; il laissa aux cordeliers & aux jacobins qui devaient venir douze cents ans après lui, le soin d’argumenter pour savoir si sa mère a été conçue dans le péché originel ; il n’a jamais dit que le mariage est le signe visible d’une chose invisible ; il n’a pas dit un mot de la grace concomitante ; il n’a institué ni moines ni inquisiteurs ; il n’a rien ordonné de ce que nous voyons aujourd’hui.
Dieu avait donné la connaissance du juste & [I-381] de l’injuste dans tous les tems qui précédèrent le Christianisme. Dieu n’a point changé & ne peut changer : le fond de notre âme, nos principes de raison & de morale seront éternellement les mêmes. De quoi servent à la vertu des distinctions théologiques, des dogmes fondés sur ces distinctions, des persécutions fondées sur ces dogmes ? La nature effrayée & soulevée avec horreur contre toutes ces inventions barbares, crie à tous les hommes, Soyez justes, & non des sophistes persécuteurs.
Vous lisez dans le Sadder, qui est l’abrégé des loix de Zoroastre, cette sage maxime. Quand il est incertain si une action qu’on te propose est juste ou injuste, abstiens-toi. Qui jamais a donné une règle plus admirable ? quel législateur à mieux parlé ? Ce n’est pas là le systême des opinions probables inventé par des gens qui s’appelaient la Société de Jésus.
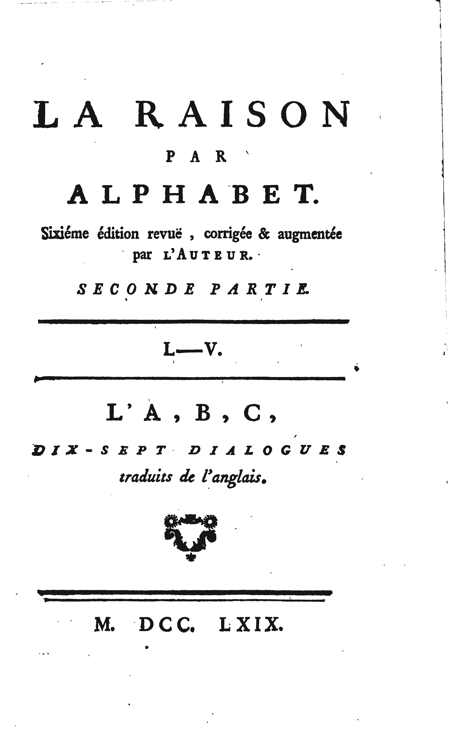
[II-1]
LA RAISON PAR ALPHABET.
LETTRES,
GENS DE LETTRES OU LETTRÉS.↩
Dans nos tems barbares, lorsque les Francs, les Germains, les Bretons, les Lombards, les Mosarabes espagnols, ne savaient ni lire ni écrire, on institua des écoles, des universités, composées presque toutes d’ecclésiastiques, qui ne sachant que leur jargon enseignèrent ce jargon à ceux qui voulurent l’apprendre ; les académies, ne sont venues que longtems après ; elles ont méprisé les sottises des [II-2] écoles, mais elles n’ont pas toûjours osé s’élever contre elles, parce qu’il y a des sottises qu’on respecte, attendu qu’elles tiennent à des choses respectables.
Les gens de lettres qui ont rendu le plus de service au petit nombre d’êtres pensants répandus dans le monde, sont les lettrés isolés, les vrais savants renfermés dans leur cabinet, qui n’ont ni argumenté sur les bancs des universités, ni dit les choses à moitié dans les académies ; & ceux-là ont presque tous été persécutés. Notre misérable espèce est tellement faite que ceux qui marchent dans le chemin battu jettent toûjours des pierres à ceux qui enseignent un chemin nouveau.
Montesquieu dit que les Scythes crevaient les yeux à leurs esclaves, afin qu’ils fussent moins distraits en battant leur beurre ; c’est ainsi que l’Inquisition en use, & presque tout le monde est aveugle dans les pays où ce monstre règne. On a deux yeux depuis plus de cent ans en Angleterre ; les Français commencent à ouvrir un œil ; mais quelquefois il se trouve des hommes en place qui ne veulent pas même permettre qu’on soit borgne.
Ces pauvres gens en place sont comme le docteur Balouard de la comédie italienne, qui ne veut être servi que par le balourd arlequin, & qui craint d’avoir un valet trop pénétrant.
Faites des odes à la louange de monseigneur Superbus fadus, des madrigaux pour sa maîtresse, dédiez à son portier un livre de géographie, vous serez bien reçu ; éclairez les hommes, vous serez écrasé.
[II-3]
Descartes est obligé de quitter sa patrie, Gassendi est calomnié, Arnauld traîne ses jours dans l’exil ; tout philosophe est traité comme les prophètes chez les Juifs.
Qui croirait que dans le dix-huitième siècle un philosophe ait été traîné devant les tribunaux séculiers & traité d’impie par les tribunaux d’argumens, pour avoir dit que les hommes ne pourraient exercer les arts s’ils n’avaient pas de mains ? Je ne désespère pas qu’on ne condamne bientôt aux galères le premier qui aura l’insolence de dire qu’un homme ne penserait pas s’il était sans tête ; car, lui dira un bachelier, l’ame est un esprit pur, la tête n’est que de la matière ; Dieu peut placer l’ame dans le talon, aussi bien que dans le cerveau ; partant, je vous dénonce comme un impie.
Le plus grand malheur d’un homme de lettres n’est peut-être pas d’être l’objet de la jalousie de ses confrères, la victime de la cabale, le mépris des puissants du monde, c’est d’être jugé par des sots. Les sots vont loin quelquefois, surtout quand le fanatisme se joint à l’ineptie, & à l’ineptie l’esprit de vengeance. Le grand malheur encor d’un homme de lettres est ordinairement de ne tenir à rien. Un bourgeois achète un petit office, & le voilà soutenu par ses confrères. Si on lui fait une injustice, il trouve aussitôt des défenseurs. L’homme de lettres est sans secours ; il ressemble aux poissons volans ; s’il s’élève un peu, les oiseaux le dévorent ; s’il plonge, les poissons le mangent.
Tout homme public paye tribut à la malignité, mais il est payé en deniers & en honneurs. [II-4] L’homme de lettres paye le même tribut sans rien recevoir, il est descendu pour son plaisir dans l’arène, il s’est lui-même condamné aux bêtes.
DE LA LIBERTÉ.↩
A. — Voilà une batterie de canons qui tire à nos oreilles, avez-vous la liberté de l’entendre ou de ne l’entendre pas ?
B. — Sans doute, je ne peux pas m’empêcher de l’entendre.
A. — Voulez-vous que ce canon emporte votre tête, & celles de votre femme & de votre fille qui se promènent avec vous ?
B. — Quelle proposition me faites-vous là ? je ne peux pas tant que je suis de sens rassis vouloir chose pareille, cela m’est impossible.
A. — Bon, vous entendez nécessairement ce canon, & vous voulez nécessairement ne pas mourir vous & votre famille d’un coup de canon à la promenade, vous n’avez ni le pouvoir de ne pas entendre, ni le pouvoir de vouloir rester ici ?
[II-5]
[[18]] B. — Cela est clair.
A. — Vous avez en conséquence fait une trentaine de pas pour être à l’abri du canon, vous avez eu le pouvoir de marcher avec moi ce peu de pas ?
B. — Cela est encor très clair.
A. — Et si vous aviez été paralytique, vous n’auriez pu éviter d’être exposé à cette batterie, vous n’auriez pas eu le pouvoir d’être où vous êtes, vous auriez nécessairement entendu & reçu un coup de canon, & vous seriez mort nécessairement ?
B. — Rien n’est plus véritable.
A. — En quoi consiste donc votre liberté, si ce n’est dans le pouvoir que votre individu a exercé de faire ce que votre volonté exigeait d’une nécessité absolue ?
B. — Vous m’embarrassez ; la liberté n’est donc autre chose que le pouvoir de faire ce que je veux.
A. — Réfléchissez-y, & voyez si la liberté peut être entendue autrement ?
B. — En ce cas mon chien de chasse est aussi libre que moi ; il a nécessairement la volonté de courir quand il voit un lièvre, & le pouvoir de courir s’il n’a pas mal aux jambes. Je n’ai [II-6] donc rien au-dessus de mon chien, vous me réduisez à l’état des bêtes ?
A. — Voilà les pauvres sophismes des pauvres sophistes qui vous ont instruit. Vous voilà bien malade d’être libre comme votre chien ! Eh ne ressemblez-vous pas à votre chien en mille choses ? la faim, la soif, la veille, le dormir, les cinq sens ne vous sont-ils pas communs avec lui ? voudriez-vous avoir l’odorat autrement que par le nez ? pourquoi voulez-vous avoir la liberté autrement que lui ?
B. — Mais j’ai une ame qui raisonne beaucoup, & mon chien ne raisonne guère. Il n’a presque que des idées simples, & moi j’ai mille idées métaphysiques.
A. — Eh bien, vous êtes mille fois plus libre que lui, c’est-à-dire, vous avez mille fois plus de pouvoir de penser que lui, mais vous n’êtes pas libre autrement que lui.
B. — Quoi ? je ne suis pas libre de vouloir ce que je veux ?
A. — Qu’entendez-vous par là ?
B. — J’entends ce que tout le monde entend. Ne dit-on pas tous les jours, les volontés sont libres ?
A. — Un proverbe n’est pas une raison ; expliquez-vous mieux ?
B. — J’entends que je suis libre de vouloir comme il me plaira.
A. — Avec votre permission, cela n’a pas de sens ; ne voyez-vous pas qu’il est ridicule de dire, je veux vouloir. Vous voulez nécessairement en conséquence des idées qui se sont [II-7] présentées à vous. Voulez-vous vous marier, oui ou non ?
B. — Mais si je vous disais que je ne veux ni l’un ni l’autre ?
A. — Vous répondriez comme celui qui disait, les uns croyent le cardinal Mazarin mort, les autres le croyent vivant, & moi je ne crois ni l’un ni l’autre.
B. — Eh bien, je veux me marier.
A. — Ah ! c’est répondre cela. Pourquoi voulez-vous vous marier ?
B. — Parce que je suis amoureux d’une jeune fille, belle, douce, bien élevée, assez riche, qui chante très bien, dont les parents sont de très honnêtes gens, & que je me flatte d’être aimé d’elle, & fort bien venu de sa famille.
A. — Voilà une raison. Vous voyez que vous ne pouvez vouloir sans raison. Je vous déclare que vous êtes libre de vous marier, c’est-à-dire, que vous avez le pouvoir de signer le contract.
B. — Comment ! je ne peux vouloir sans raison ? Eh que deviendra cet autre proverbe, sit pro ratione voluntas ; ma volonté est ma raison, je veux parce que je veux ?
A. — Cela est absurde, mon cher ami ; il y aurait en vous un effet sans cause.
B. — Quoi ! lorsque je joue à pair ou non, j’ai une raison de choisir pair plutôt qu’impair ?
A. — Oui, sans doute.
B. — Et quelle est cette raison, s’il vous plaît ?
A. — C’est que l’idée d’impair s’est présentée à votre esprit plutôt que l’idée opposée. Il [II-8] serait plaisant qu’il y eût des cas où vous voulez parce qu’il y a une cause de vouloir, & qu’il y eût quelques cas où vous voulussiez sans cause. Quand vous voulez vous marier, vous en sentez la raison dominante évidemment ; vous ne la sentez pas quand vous jouez à pair ou non ; & cependant il faut bien qu’il y en ait une.
B. — Mais encor une fois, je ne suis donc pas libre ?
A. — Votre volonté n’est pas libre, mais vos actions le sont ; vous êtes libre de faire quand vous avez le pouvoir de faire.
B. — Mais tous les livres que j’ai lûs sur la liberté d’indifférence…
A. — Sont des sottises ; il n’y a point de liberté d’indifférence ; c’est un mot destitué de sens, inventé par des gens qui n’en avaient guères.
LIBERTÉ DE PENSER.↩
Vers l’an 1707, tems où les Anglais gagnèrent la bataille de Sarragosse, protégèrent le Portugal, & donnèrent pour quelque tems un Roi à l’Espagne, Mylord Boldmind Officier Général qui avait été blessé, était aux eaux de Barège. Il y rencontra le comte Médroso, qui étant tombé de cheval derrière le bagage, à une lieuë & demie du champ de bataille, venait prendre les eaux aussi. Il était familier de l’Inquisition, Mylord Boldmind n’était familier que dans [II-9] la conversation ; un jour après boire il eut avec Médroso cet entretien.
BOLDMIND.
Vous êtes donc sergent des Dominicains ? vous faites-là un vilain métier.
MÉDROSO.
Il est vrai ; mais j’ai mieux aimé être leur valet que leur victime, & j’ai préféré le malheur de brûler mon prochain à celui d’être cuit moi-même.
BOLDMIND.
Quelle horrible alternative ! vous étiez cent fois plus heureux sous le joug des Maures qui vous laissaient croupir librement dans toutes vos superstitions, & qui tout vainqueurs qu’ils étaient ne s’arrogeaient pas le droit inouï de tenir les ames dans les fers.
MÉDROSO.
Que voulez-vous ! il ne nous est permis ni d’écrire, ni de parler, ni même de penser. Si nous parlons, il est aisé d’interpréter nos paroles, encor plus nos écrits. Enfin, comme on ne peut nous condamner dans un Auto-da-fé pour nos pensées secrettes, on nous menace d’être brûlés éternellement par l’ordre de Dieu même, si nous ne pensons pas comme les Jacobins. Ils ont persuadé au gouvernement que si nous avions le sens commun, tout l’État serait en combustion, & que la nation deviendrait la plus malheureuse de la terre.
[II-10]
BOLDMIND.
Trouvez-vous que nous soyons si malheureux nous autres Anglais qui couvrons les mers de vaisseaux, & qui venons gagner pour vous des batailles au bout de l’Europe ? Voyez-vous que les Hollandais qui vous ont ravi presque toutes vos découvertes dans l’Inde, & qui aujourd’hui sont au rang de vos protecteurs, soient maudits de Dieu pour avoir donné une entière liberté à la presse, & pour faire le commerce des pensées des hommes ? L’empire Romain en a-t-il été moins puissant parce que Cicéron a écrit avec liberté ?
MÉDROSO.
Quel est ce Cicéron ? je n’ai jamais entendu parler de cet homme-là ; il ne s’agit pas ici de Cicéron, il s’agit de notre St. Père le Pape, & de St. Antoine de Padouë, & j’ai toûjours ouï dire que la Religion Romaine est perdue si les hommes se mettent à penser.
BOLDMIND.
Ce n’est pas à vous à le croire, car vous êtes sûrs que votre religion est divine, & que les portes d’enfer ne peuvent prévaloir contre elle : si cela est, rien ne pourra jamais la détruire.
MÉDROSO.
Non ; mais on peut la réduire à peu de chose, & c’est pour avoir pensé que la Suède, le Dannemarck, toute votre île, la moitié de [II-11] l’Allemagne gémissent dans le malheur épouvantable de n’être plus sujets du Pape, on dit même que si les hommes continuent à suivre leurs fausses lumières, ils s’en tiendront bientôt à l’adoration simple de Dieu & à la vertu ; si les portes de l’enfer prévalent jamais jusque-là, que deviendra le saint Office ?
BOLDMIND.
Si les premiers Chrétiens n’avaient pas eu la liberté de penser, n’est-il pas vrai qu’il n’y eût point eu de Christianisme ?
MÉDROSO.
Que voulez-vous dire ? Je ne vous entends point.
BOLDMIND.
Je le crois bien, je veux dire que si Tibère & les premiers Empereurs avaient eu des Jacobins, qui eussent empêché les premiers Chrétiens d’avoir des plumes & de l’encre, s’il n’avait pas été longtems permis dans l’Empire Romain de penser librement il eût été impossible que les Chrétiens établissent leurs dogmes ; si donc le Christianisme ne s’est formé que par la liberté de penser, par quelle contradiction, par quelle injustice voudrait-il anéantir aujourd’hui cette liberté sur laquelle seule il est fondé ?
Quand on vous propose quelque affaire d’intérêt n’examinez-vous pas longtems avant de conclure ? quel plus grand intérêt y a-t-il au monde que celui de notre bonheur ou de notre malheur éternel ? il y a cent religions sur la [II-12] terre qui toutes vous damnent si vous croyez à vos dogmes, qu’elles appellent absurdes & impies ; examinez donc ces dogmes.
MÉDROSO.
Comment puis-je les examiner ? je ne suis pas Jacobin.
BOLDMIND.
Vous êtes homme, & cela suffit.
MÉDROSO.
Hélas ! vous êtes bien plus homme que moi.
BOLDMIND.
Il ne tient qu’à vous d’apprendre à penser ; vous êtes né avec de l’esprit ; vous êtes un oiseau dans la cage de l’Inquisition, le saint Office vous a rogné les ailes, mais elles peuvent revenir. Celui qui ne sait pas la géométrie peut l’apprendre ; tout homme peut s’instruire ; il est honteux de mettre son ame entre les mains de ceux à qui vous ne confieriez pas votre argent : osez penser par vous-même.
MÉDROSO.
On dit que si tout le monde pensait par soi-même ce serait une étrange confusion.
BOLDMIND.
C’est tout le contraire, quand on assiste à un spectacle, chacun en dit librement son avis, & [II-13] la paix n’est point troublée ; mais si quelque protecteur insolent d’un mauvais poëte voulait forcer tous les gens de goût à trouver bon ce qui leur paraît mauvais, alors les sifflets se feraient entendre & les deux partis pourraient se jeter des pommes à la tête comme il arriva une fois à Londres. Ce sont ces tyrans des esprits, qui ont causé une partie des malheurs du monde ; nous ne sommes heureux en Angleterre que depuis que chacun jouït librement du droit de dire son avis.
MÉDROSO.
Nous sommes aussi fort tranquilles à Lisbonne où personne ne peut dire le sien.
BOLDMIND.
Vous êtes tranquilles, mais vous n’êtes pas heureux ; c’est la tranquillité des galériens qui rament en cadence & en silence.
MÉDROSO.
Vous croyez donc que mon ame est aux galères ?
BOLDMIND.
Oui, & je voudrais la délivrer.
MÉDROSO.
Mais si je me trouve bien aux galères ?
BOLDMIND.
En ce cas vous méritez d’y être.
[II-14]
DES LOIX.↩
Première Section.
Les moutons vivent en société fort doucement, leur caractère passe pour très débonnaire, parce que nous ne voyons pas la prodigieuse quantité d’animaux qu’ils dévorent. Il est à croire même qu’ils les mangent innocemment & sans le savoir, comme lorsque nous mangeons d’un fromage de Sassenage. La république des moutons est l’image fidèle de l’âge d’or.
Un poulailler est visiblement l’État monarchique le plus parfait. Il n’y a point de Roi comparable à un coq. S’il marche fièrement au milieu de son peuple, ce n’est point par vanité. Si l’ennemi approche, il ne donne point d’ordre à ses sujets d’aller se faire tuer pour lui en vertu de sa certaine science & pleine puissance : il y va lui-même, range ses poules derrière lui & combat jusqu’à la mort. S’il est vainqueur, c’est lui qui chante le Te-Deum. Dans la vie civile, il n’y a rien de si galant, de si honnête, de si désintéressé. Il a toutes les vertus. A-t-il dans son bec royal un grain de bled, un vermisseau, il le donne à la première de ses sujettes qui se présente. Enfin Salomon dans son sérail n’approchait pas d’un coq de basse-cour.
S’il est vrai que les abeilles soient gouvernées [II-15] par une Reine à qui tous ses sujets font l’amour, c’est un gouvernement plus parfait encor.
Les fourmis passent pour une excellente démocratie. Elle est au-dessus de tous les autres États ; puisque tout le monde y est égal, & que chaque particulier y travaille pour le bonheur de tous.
La république des castors est encor supérieure à celle des fourmis, du moins si nous en jugeons par leurs ouvrages de maçonnerie.
Les singes ressemblent plutôt à des bâteleurs qu’à un peuple policé, & ils ne paraissent pas être réunis sous des loix fixes & fondamentales, comme les espèces précédentes.
Nous ressemblons plus aux singes qu’à aucun autre animal par le don de l’imitation, par la légèreté de nos idées, & par notre inconstance qui ne nous a jamais permis d’avoir des loix uniformes & durables.
Quand la nature forma notre espèce, & nous donna quelques instincts, l’amour-propre pour notre conservation, la bienveillance pour la conservation des autres, l’amour qui est commun avec toutes les espèces, & le don inexplicable de combiner plus d’idées que tous les animaux ensemble ; après nous avoir ainsi donné notre lot, elle nous dit : Faites comme vous pourrez.
Il n’y a aucun bon code dans aucun pays. La raison en est évidente, les loix ont été faites à mesure selon les tems, les lieux, les besoins, &c.
Quand les besoins ont changé, les loix qui sont demeurées sont devenues ridicules. Ainsi [II-16] la loi qui défendait de manger du porc & de boire du vin, était très raisonnable en Arabie, où le porc & le vin sont pernicieux ; elle est absurde à Constantinople.
La loi qui donne tout le fief à l’aîné, est fort bonne dans un tems d’anarchie & de pillage. Alors l’aîné est le capitaine du château que des brigands assailliront tôt ou tard ; les cadets seront ses premiers officiers, les laboureurs ses soldats. Tout ce qui est à craindre, c’est que le cadet n’assassine ou n’empoisonne le Seigneur Salien son aîné, pour devenir à son tour le maître de la masure ; mais ces cas sont rares, parce que la nature a tellement combiné nos instincts & nos passions, que nous avons plus d’horreur d’assassiner notre frère aîné que nous n’avons d’envie d’avoir sa place. Or cette loi convenable à des possesseurs de donjons du tems de Chilperic, est détestable quand il s’agit de partager des rentes dans une ville.
À la honte des hommes, on sait que les loix du jeu sont les seules qui soient partout justes, claires, inviolables & exécutées. Pourquoi l’Indien qui a donné les règles du jeu d’échecs, est-il obéi de bon gré dans toute la terre, & que les décrétales des Papes, par exemple, sont aujourd’hui un objet d’horreur & de mépris ? c’est que l’inventeur des échecs combina tout avec justesse pour la satisfaction des joueurs, & que les Papes dans leurs décrétales, n’eurent en vuë que leur seul avantage. L’Indien voulut exercer également l’esprit des hommes & leur donner du plaisir ; les Papes ont voulu [II-17] abrutir l’esprit des hommes. Aussi le fond du jeu des échecs a subsisté le même depuis cinq mille ans, il est commun à tous les habitans de la terre ; & les décrétales ne sont reconnues qu’à Spolette, à Orviette, à Lorette, où le plus mince jurisconsulte les déteste & les méprise en secret.
DES LOIX.↩
Seconde Section
Du tems de Vespasien & de Tite, pendant que les Romains éventraient les Juifs, un Israélite fort riche qui ne voulait point être éventré, s’enfuit avec tout l’or qu’il avait gagné à son métier d’usurier, & emmena vers Eziongaber toute sa famille, qui consistait en sa vieille femme, un fils & une fille ; il avait dans son train, deux eunuques, dont l’un servait de cuisinier, l’autre était laboureur & vigneron. Un bon Essénien qui savait par cœur le Pentateuque lui servait d’aumônier : tout cela s’embarqua dans le port d’Eziongaber, traversa la mer qu’on nomme Rouge, & qui ne l’est point, & entra dans le golphe Persique, pour aller chercher la terre d’Ophir, sans savoir où elle était. Vous croyez bien qu’il survint une horrible tempête, qui poussa la famille hébraïque vers les côtes des Indes ; le vaisseau fit naufrage à une des îles Maldives, [II-18] nommée aujourd’hui Padrabranca, laquelle était alors déserte.
Le vieux richard & la vieille se noyèrent ; le fils, la fille, les deux eunuques & l’aumônier se sauvèrent ; on tira comme on put quelques provisions du vaisseau, on bâtit des petites cabanes dans l’île, & on y vécut assez commodément. Vous savez que l’île de Padrabranca est à cinq degrés de la ligne, & qu’on y trouve les plus gros cocos & les meilleurs ananas du monde ; il était fort doux d’y vivre dans le tems qu’on égorgeait ailleurs le reste de la nation chérie ; mais l’Essénien pleurait en considérant que peut-être il ne restait plus qu’eux de Juifs sur la terre, & que la semence d’Abraham allait finir.
Il ne tient qu’à vous de la ressusciter, dit le jeune Juif, épousez ma sœur. Je le voudrais bien, dit l’aumônier, mais la loi s’y oppose. Je suis Essénien, j’ai fait vœu de ne me jamais marier, la loi porte qu’on doit accomplir son vœu ; la race juive finira si elle veut, mais certainement je n’épouserai point votre sœur, toute jolie qu’elle est.
Mes deux eunuques ne peuvent pas lui faire d’enfans, reprit le Juif ; je lui en ferai donc s’il vous plaît, & ce sera vous qui bénirez le mariage.
J’aimerais mieux cent fois être éventré par les soldats romains, dit l’aumônier, que de servir à vous faire commettre un inceste ; si c’était votre sœur de père, encor passe, la loi le permet ; mais elle est votre sœur de mère, cela est abominable.
[II-19]
Je conçois bien, répondit le jeune homme, que ce serait un crime à Jérusalem, où je trouverais d’autres filles ; mais dans l’île de Padrabranca, où je ne vois que des cocos, des ananas & des huitres, je crois que la chose est très permise. Le Juif épousa donc sa sœur, & en eut une fille malgré les protestations de l’Essénien ; ce fut l’unique fruit d’un mariage que l’un croyait très légitime, & l’autre abominable.
Au bout de quatorze ans, la mère mourut ; le père dit à l’aumônier, Vous êtes-vous enfin défait de vos anciens préjugés ? voulez-vous épouser ma fille ? Dieu m’en préserve, dit l’Essénien. Oh bien je l’épouserai donc moi, dit le père, il en sera ce qui pourra, mais je ne veux pas que la semence d’Abraham soit réduite à rien. L’Essénien épouvanté de cet horrible propos ne voulut plus demeurer avec un homme qui manquait à la loi, & s’enfuit. Le nouveau marié avait beau lui crier, Demeurez, mon ami, j’observe la loi naturelle, je sers la patrie, n’abandonnez pas vos amis ; l’autre le laissait crier, ayant toûjours la loi dans la tête, & s’enfuit à la nage dans l’île voisine.
C’était la grande île d’Attole, très peuplée, & très civilisée ; dès qu’il aborda, on le fit esclave. Il apprit à balbutier la langue d’Attole ; il se plaignit très amèrement de la façon inhospitalière dont on l’avait reçu ; on lui dit que c’était la loi, & que depuis que l’île avait été sur le point d’être surprise par les habitans de celle d’Ada, on avait sagement réglé que tous [II-20] les étrangers qui aborderaient dans Attole, seraient mis en servitude. Ce ne peut être une loi, dit l’Essénien, car elle n’est pas dans le Pentateuque ; on lui répondit qu’elle était dans le digeste du pays, & il demeura esclave : il avait heureusement un très bon maître fort riche, qui le traita bien, & auquel il s’attacha beaucoup.
Des assassins vinrent un jour pour tuer le maître, & pour voler ses trésors ; ils demandèrent aux esclaves s’il était à la maison, & s’il avait beaucoup d’argent ? Nous vous jurons, dirent les esclaves, qu’il n’a point d’argent, & qu’il n’est point à la maison ; mais l’Essénien dit, La loi ne permet pas de mentir, je vous jure qu’il est à la maison, & qu’il a beaucoup d’argent ; ainsi le maître fut volé & tué ; les esclaves accusèrent l’Essénien devant les juges, d’avoir trahi son patron ; l’Essénien dit qu’il ne voulait mentir, & qu’il ne mentirait pour rien au monde, & il fut pendu.
On me contait cette histoire, & bien d’autres semblables dans le dernier voyage que je fis des Indes en France. Quand je fus arrivé, j’allai à Versailles pour quelques affaires, je vis passer une belle femme, suivie de plusieurs belles femmes. Quelle est cette belle femme, dis-je à mon Avocat en Parlement, qui était venu avec moi, car j’avais un Procès en Parlement à Paris, pour mes habits qu’on m’avait faits aux Indes, & je voulais toûjours avoir mon Avocat à mes côtés ? C’est la fille du Roi, dit-il, elle est charmante & bienfaisante, c’est bien [II-21] dommage que dans aucun cas elle ne puisse jamais être Reine de France. Quoi, lui dis-je, si on avait le malheur de perdre tous ses parents, & les Princes du sang, (ce qu’à Dieu ne plaise) elle ne pourrait hériter du Royaume de son père ? Non, dit l’Avocat, la loi Salique s’y oppose formellement. Et qui a fait cette loi Salique ? dis-je à l’Avocat. Je n’en sais rien, dit-il, mais on prétend que chez un ancien peuple nommé les Saliens, qui ne savaient ni lire ni écrire, il y avait une loi écrite qui disait qu’en terre Salique fille n’héritait pas d’un aleu, & cette loi a été adoptée en terre non Salique. Et moi, lui dis-je, je la casse ; vous m’avez assuré que cette Princesse est charmante & bienfaisante, donc elle aurait un droit incontestable à la couronne, si le malheur arrivait qu’il ne restât qu’elle du sang royal ; ma mère a hérité de son père, & je veux que cette Princesse hérite du sien.
Le lendemain mon Procès fut jugé en une chambre du Parlement, & je perdis tout d’une voix ; mon Avocat me dit que je l’aurais gagné tout d’une voix en une autre chambre. Voilà qui est bien comique, lui dis-je ; ainsi donc chaque Chambre chaque loi. Oui, dit-il, il y a vingt-cinq commentaires sur la coutume de Paris ; c’est-à-dire, on a prouvé vingt-cinq fois que la coutume de Paris est équivoque ; & s’il y avait vingt-cinq chambres de juges, il y aurait vingt-cinq jurisprudences différentes. Nous avons, continua-t-il, à quinze lieues de Paris une Province nommée Normandie, où vous [II-22] auriez été tout autrement jugé qu’ici. Cela me donna envie de voir la Normandie. J’y allai avec un de mes frères : nous rencontrames à la première auberge un jeune homme qui se désespérait ; je lui demandai quelle était sa disgrace ? il me répondit que c’était d’avoir un frère aîné. Où est donc le grand malheur d’avoir un frère ? lui dis-je ; mon frère est mon aîné, & nous vivons très bien ensemble. Hélas, monsieur, me dit-il, la loi donne tout ici aux aînés, & ne laisse rien aux cadets. Vous avez raison, lui dis-je, d’être fâché ; chez nous on partage également, & quelquefois les frères ne s’en aiment pas mieux.
Ces petites avantures me firent faire de belles & profondes réflexions sur les loix, & je vis qu’il en est d’elles comme de nos vêtements ; il m’a fallu porter un doliman à Constantinople, & un juste-au-corps à Paris.
Si toutes les loix humaines sont de convention, disais-je, il n’y a qu’à bien faire ses marchés. Les bourgeois de Déli & d’Agra disent qu’ils ont fait un très mauvais marché avec Tamerlan : les bourgeois de Londres se félicitent d’avoir fait un très bon marché avec le Roi Guillaume d’Orange. Un citoyen de Londres me disait un jour, C’est la nécessité qui fait les loix, & la force les fait observer. Je lui demandai si la force ne faisait pas aussi quelquefois des loix, & si Guillaume le bâtard & le conquérant ne leur avait pas donné des ordres sans faire de marché avec eux. Oui, dit-il, nous étions des bœufs alors, Guillaume nous [II-23] mit un joug, & nous fit marcher à coups d’aiguillons ; nous avons depuis été changés en hommes, mais les cornes nous sont restées, & nous en frappons quiconque veut nous faire labourer pour lui, & non pas pour nous.
Plein de toutes ces réflexions, je me complaisais à penser qu’il y a une loi naturelle indépendante de toutes les conventions humaines : le fruit de mon travail doit être à moi ; je dois honorer mon père & ma mère ; je n’ai nul droit sur la vie de mon prochain, & mon prochain n’en a point sur la mienne, &c. Mais quand je songeai que depuis Cordolaomor jusqu’à Mentzel, Colonel de Houzards, chacun tue loyalement & pille son prochain avec une patente dans sa poche, je fus très affligé.
On me dit que parmi les voleurs il y avait des loix, & qu’il y en avait aussi à la guerre. Je demandai ce que c’était que ces loix de la guerre ? C’est, me dit-on, de pendre un brave Officier qui aura tenu dans un mauvais poste sans canon contre une armée royale ; c’est de faire pendre un prisonnier, si on a pendu un des vôtres ; c’est de mettre à feu & à sang les villages qui n’auront pas apporté toute leur subsistance au jour marqué, selon les ordres du gracieux souverain du voisinage. Bon, dis-je, voilà l’Esprit des loix.
Après avoir été bien instruit, je découvris qu’il y a de sages loix par lesquelles un berger est condamné à neuf ans de galères pour avoir donné un peu de sel étranger à ses moutons. Mon voisin a été ruiné par un procès pour deux [II-24] chênes qui lui appartenaient qu’il avait fait couper dans son bois, parce qu’il n’avait pu observer une formalité qu’il n’avait pu connaître ; sa femme est morte dans la misère, & son fils traîne une vie plus malheureuse. J’avoue que ces loix sont justes, quoique leur exécution soit un peu dure ; mais je sais mauvais gré aux loix qui autorisent cent mille hommes à aller loyalement égorger cent mille voisins. Il m’a paru que la plûpart des hommes ont reçu de la nature assez de sens commun pour faire des loix ; mais que tout le monde n’a pas assez de justice pour faire de bonnes loix.
Assemblez d’un bout de la terre à l’autre les simples & tranquilles agriculteurs : ils conviendront tous aisément, qu’il doit être permis de vendre à ses voisins l’excédent de son bled, & que la loi contraire est inhumaine & absurde ; que les monnaies représentatives des denrées ne doivent pas plus être altérées que les fruits de la terre ; qu’un père de famille doit être le maître chez soi ; que la religion doit rassembler les hommes pour les unir, & non pour en faire des fanatiques & des persécuteurs ; que ceux qui travaillent, ne doivent pas se priver du fruit de leurs travaux pour en doter la superstition & l’oisiveté ; ils feront en une heure trente loix de cette espèce, toutes utiles au genre humain.
Mais que Tamerlan arrive & subjugue l’Inde ; alors vous ne verrez plus que des loix arbitraires. L’une accablera une province pour enrichir un publicain de Tamerlan ; l’autre fera un crime de [II-25] léze-Majesté d’avoir mal parlé de la maîtresse du premier valet de chambre d’un Raya ; une troisième ravira la moitié de la récolte de l’agriculteur, & lui contestera le reste ; il y aura enfin des loix par lesquelles un appariteur Tartare viendra saisir vos enfans au berceau, fera du plus robuste un soldat, & du plus faible un eunuque, & laissera le père & la mère sans secours & sans consolation.
Or lequel vaut le mieux d’être le chien de Tamerlan ou son sujet ? Il est clair que la condition de son chien est fort supérieure.
LOIX CIVILES
ET ECCLÉSIASTIQUES.↩
On a trouvé dans les papiers d’un jurisconsulte ces notes, qui méritent peut-être un peu d’examen.
Que jamais aucune loi ecclésiastique n’ait de force, que lorsqu’elle aura la sanction expresse du gouvernement. C’est par ce moyen qu’Athènes & Rome n’eurent jamais de querelles religieuses.
Ces querelles sont le partage des nations barbares, ou devenues barbares.
Que le Magistrat seul puisse permettre ou prohiber le travail les jours de fête, parce qu’il n’appartient pas à des prêtres de défendre à des hommes de cultiver leurs champs.
[II-26]
Que tout ce qui concerne les mariages dépende uniquement du Magistrat, & que les prêtres s’en tiennent à l’auguste fonction de les bénir.
Que le prêt à l’intérêt soit purement un objet de la loi civile, parce qu’elle seule préside au commerce.
Que tous les Ecclésiastiques soient soumis en tous les cas au gouvernement, parce qu’ils sont sujets de l’État.
Que jamais on n’ait le ridicule honteux de payer à un prêtre étranger la première année du revenu d’une terre, que des citoyens ont donnée à un prêtre concitoyen.
Qu’aucun prêtre ne puisse jamais ôter à un citoyen la moindre prérogative, sous prétexte que ce citoyen est pécheur, parce que le prêtre pécheur doit prier pour les pécheurs, & non les juger.
Que les Magistrats, les laboureurs & les prêtres, payent également les charges de l’État, parce que tous appartiennent également à l’État.
Qu’il n’y ait qu’un poids, une mesure, une coutume.
Que les supplices des criminels soient utiles. Un homme pendu n’est bon à rien, & un homme condamné aux ouvrages publics sert encor la patrie, & est une leçon vivante.
Que toute loi soit claire, uniforme & précise. L’interpréter, c’est presque toûjours la corrompre.
Que rien ne soit infâme que le vice.
[II-27]
Que les impôts ne soient jamais que proportionnels.
Que la loi ne soit jamais en contradiction avec l’usage. Car si l’usage est bon, la loi ne vaut rien [[19]].
LUXE.↩
On a déclamé contre le luxe depuis deux mille ans, en vers & en prose, & on l’a toûjours aimé.
Que n’a-t-on pas dit des premiers Romains, quand ces brigands ravagèrent & pillèrent les moissons ; quand pour augmenter leur pauvre village, ils détruisirent les pauvres villages des Volsques, & des Samnites ? c’étaient des hommes désintéressés & vertueux ; ils n’avaient pu encor voler ni or, ni argent, ni pierreries, parce qu’il n’y en avait point dans les bourgs qu’ils saccagèrent. Leurs bois ni leurs marais ne produisaient ni perdrix, ni faisans, & on loue leur tempérance.
Quand de proche en proche ils eurent tout pillé, tout volé du fond du golfe Adriatique à l’Euphrate, & qu’ils eurent assez d’esprit pour jouïr du fruit de leurs rapines pendant sept à huit cents ans ; quand ils cultivèrent tous les arts, qu’ils goutèrent tous les plaisirs, & qu’ils les firent même goûter aux vaincus, ils cessèrent alors, dit-on, d’être sages & gens de bien.
Toutes ces déclamations se réduisent à [II-28] prouver qu’un voleur ne doit jamais ni manger le dîner qu’il a pris, ni porter l’habit qu’il a dérobé, ni se parer de la bague qu’il a volée. Il fallait, dit-on, jeter tout cela dans la rivière, pour vivre en honnêtes gens ; dites plutôt qu’il ne fallait pas voler. Condamnez les brigands quand ils pillent ; mais ne les traitez pas d’insensés quand ils jouïssent. [[20]] De bonne foi, lorsqu’un grand nombre de marins Anglais se sont enrichis à la prise de Pondichéri, & de la Havane, ont-ils eu tort d’avoir ensuite du plaisir à Londres, pour prix de la peine qu’ils avaient eue au fond de l’Asie & de l’Amérique ?
Les déclamateurs voudraient-ils qu’on enfouît les richesses qu’on aurait amassées par le sort des armes, par l’agriculture, par le commerce & par l’industrie ? Ils citent Lacédémone ; que ne citent-ils aussi la république de Saint Marin ? Quel bien Sparte fit-elle à la Grèce ? eut-elle jamais des Démosthènes, des Sophocle, des Appelles & des Fidias ? Le luxe d’Athènes a fait de grands hommes en tout genre ; Sparte a eu quelques capitaines, & encor en moins grand nombre que les autres villes. Mais à la bonne heure qu’une aussi petite république que Lacédémone conserve sa pauvreté. On arrive à la mort aussi bien en manquant de [II-29] tout, qu’en jouïssant de ce qui peut rendre la vie agréable. Le sauvage du Canada subsiste & atteint la vieillesse, comme le citoyen d’Angleterre qui a cinquante mille guinées de revenu. Mais qui comparera jamais le pays des Iroquois à l’Angleterre ?
Que la république de Raguse & le Canton de Zug fassent des loix somptuaires, ils ont raison, il faut que le pauvre ne dépense point au-delà de ses forces ; mais j’ai lu quelque part :
Sachez surtout que le luxe enrichit
Un grand État, s’il en perd un petit.
Si par luxe vous entendez l’excès, on sait que l’excès est pernicieux en tout genre, dans l’abstinence comme dans la gourmandise, dans l’économie comme dans la libéralité. Je ne sais comment il est arrivé que dans mes villages où la terre est ingrate, les impôts lourds, la défense d’exporter le bled qu’on a semé intolérable, il n’y a guère pourtant de colon qui n’ait un bon habit de drap, & qui ne soit bien chaussé & bien nourri. Si ce colon laboure avec son bel habit, avec du linge blanc, les cheveux frisés & poudrés, voilà certainement le plus grand luxe, & le plus impertinent ; mais qu’un bourgeois de Paris ou de Londres paraisse au spectacle vêtu comme ce paysan, voilà la lésine la plus grossière & la plus ridicule.
Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
Quos ultrà citraque nequit consistere rectum.
[II-30]
Lorsqu’on inventa les ciseaux, qui ne sont certainement pas de l’antiquité la plus haute, que ne dit-on pas contre les premiers qui se rognèrent les ongles, & qui coupèrent une partie des cheveux qui leur tombaient sur le nez ? On les traita sans doute de petits-maîtres & de prodigues, qui achetaient chèrement un instrument de la vanité, pour gâter l’ouvrage du Créateur. Quel péché énorme d’accourcir la corne que Dieu fait naître au bout de nos doigts ! C’était un outrage à la Divinité. Ce fut bien pis quand on inventa les chemises & les chaussons. On sait avec quelle fureur les vieux Conseillers qui n’en avaient jamais porté, crièrent contre les jeunes Magistrats qui donnèrent dans ce luxe funeste.
[II-30]
MAÎTRE.↩
Comment un homme a-t-il pu devenir le maître d’un autre homme, & par quelle espèce de magie incompréhensible a-t-il pu devenir le maître de plusieurs autres hommes ? On a écrit sur ce phénomène un grand nombre de bons volumes ; mais je donne la préférence à une fable indienne parce qu’elle est courte, & que les fables ont tout dit.
Adimo, le père de tous les Indiens, eut deux fils & deux filles de sa femme Procriti. L’aîné était un géant vigoureux, le cadet était un petit bossu, les deux filles étaient jolies. Dès que [II-31] le géant sentit sa force, il coucha avec ses deux sœurs, & se fit servir par le petit bossu. De ses deux sœurs, l’une fut sa cuisinière, l’autre sa jardinière. Quand le géant voulait dormir il commençait par enchaîner à un arbre son petit frère le bossu, & lorsque celui-ci s’enfuyait, il le rattrapait en quatre enjambées, & lui donnait vingt coups de nerf de bœufs.
Le bossu devint soumis, & le meilleur sujet du monde. Le géant satisfait de le voir remplir ses devoirs de sujet, lui permit de coucher avec une de ses sœurs dont il était dégoûté. Les enfans qui vinrent de ce mariage ne furent pas tout à fait bossus ; mais ils eurent la taille assez contrefaite. Ils furent élevés dans la crainte de Dieu & du géant. Ils reçurent une excellente éducation ; on leur apprit que leur grand-oncle était géant de droit divin, qu’il pouvait faire de toute sa famille ce qui lui plaisait ; que s’il avait quelque jolie nièce, ou arrière-nièce, c’était pour lui seul sans difficulté, & que personne ne pouvait coucher avec elle que quand il n’en voudrait plus.
Le géant étant mort, son fils qui n’était pas à beaucoup près si fort ni si grand que lui, crut cependant être géant comme son père de droit divin. Il prétendit faire travailler pour lui tous les hommes, & coucher avec toutes les filles. La famille se ligua contre lui, il fut assommé, & on se mit en république.
Les Siamois au contraire prétendaient que la famille avait commencé par être républicaine, & que le géant n’était venu qu’après un grand [II-32] nombre d’années & de dissensions ; mais tous les auteurs de Benarès & de Siam conviennent que les hommes vécurent une infinité de siècles avant d’avoir l’esprit de faire des loix ; & ils le prouvent par une raison sans réplique, c’est qu’aujourd’hui même où tout le monde se pique d’avoir de l’esprit, on n’a pas trouvé encor le moyen de faire une vingtaine de loix passablement bonnes.
C’est encor, par exemple, une question insoluble dans l’Inde, si les Républiques ont été établies avant ou après les Monarchies, si la confusion a dû paraître aux hommes plus horrible que le despotisme. J’ignore ce qui est arrivé dans l’ordre des tems ; mais dans celui de la nature il faut convenir que les hommes naissant tous égaux, la violence & l’habileté, ont fait les premiers maîtres ; les loix ont fait les derniers.
MARTIRE.↩
On nous berne de martires à faire pouffer de rire. On nous peint les Titus, les Trajans, les Marc-Aurèles, ces modèles de vertu, comme des monstres de cruauté. Fleuri Abbé du Loc-Dieu a déshonoré son histoire ecclésiastique par des contes qu’une vieille femme de bon sens ne ferait pas à des petits enfans.
Peut-on répéter sérieusement que les [II-33] Romains condamnèrent sept vierges de soixante & dix ans chacune à passer par les mains de tous les jeunes gens de la ville d’Ancire, eux qui punissaient de mort les Vestales pour la moindre galanterie ?
C’est apparemment pour faire plaisir aux cabaretiers qu’on a imaginé qu’un cabaretier Chrétien nommé Théodote, pria Dieu de faire mourir ces sept vierges plutôt que de les exposer à perdre le plus vieux des pucelages. Dieu exauça le cabaretier pudibond, & le proconsul fit noyer dans un lac les sept demoiselles. Dès qu’elles furent noyées, elles vinrent se plaindre à Théodote du tour qu’il leur avait joué, & le supplièrent instamment d’empêcher qu’elles ne fussent mangées des poissons. Théodote prend avec lui trois buveurs de sa taverne, marche au lac avec eux, précédé d’un flambeau céleste, & d’un cavalier céleste, repêche les sept vieilles, les enterre, & finit par être pendu.
Dioclétien rencontre un petit garçon nommé St. Romain, qui était bègue ; il veut le faire brûler parce qu’il était Chrétien ; trois Juifs se trouvent là & se mettent à rire de ce que Jésus-Christ laisse brûler un petit garçon qui lui appartient ; ils crient que leur Religion vaut bien mieux que la Chrétienne, puisque Dieu a délivré Sidrac, Mizac & Abdénago de la fournaise ardente. Aussitôt les flammes qui entouraient le jeune Romain, sans lui faire mal, se séparent, & vont brûler les trois Juifs.
L’empereur tout étonné dit qu’il ne veut rien avoir à démêler avec Dieu ; mais un juge [II-34] de village moins scrupuleux condamne le petit bègue à avoir la langue coupée. Le premier Médecin de l’Empereur est assez honnête pour faire l’opération lui-même ; dès qu’il a coupé la langue au petit Romain, cet enfant se met à jaser avec une volubilité qui ravit toute l’assemblée en admiration.
On trouve cent contes de cette espèce dans les martirologes. On a cru rendre les anciens Romains odieux, & on s’est rendu ridicule. Voulez-vous de bonnes barbaries bien avérées, de bons massacres bien constatés, des ruisseaux de sang qui aient coulé en effet, des pères, des mères, des maris, des femmes, des enfans à la mamelle réellement égorgés & entassés les uns sur les autres ? Monstres persécuteurs, ne cherchez ces vérités que dans vos annales : vous les trouverez dans les croisades contre les Albigeois, dans les massacres de Mérindol & de Cabrière, dans l’épouvantable journée de la St. Barthélemi, dans les massacres de l’Irlande, dans les vallées des Vaudois. Il vous sied bien, barbares que vous êtes, d’imputer aux meilleurs des Empereurs des cruautés extravagantes, vous qui avez inondé l’Europe de sang, & qui l’avez couverte de corps expirants, pour prouver que le même corps peut être en mille endroits à la fois, & que le Pape peut vendre des indulgences ! Cessez de calomnier les Romains vos législateurs, & demandez pardon à Dieu des abominations de vos pères.
Ce n’est pas le supplice, dites-vous, qui fait [II-35] le martyre, c’est la cause. Eh bien, je vous accorde que vos victimes ne doivent point être appelées du nom de martir, qui signifie témoin ; mais quel nom donnerons-nous à vos bourreaux ? Les Phalaris & les Busiris ont été les plus doux des hommes en comparaison de vous : votre Inquisition qui subsiste encor, ne fait-elle pas frémir la raison, la nature, la Religion ? Grand Dieu ! Si on allait mettre en cendres ce tribunal infernal, déplairait-on à vos regards vengeurs ?
MATIÈRE.↩
Les sages à qui on demande ce que c’est que l’ame, répondent qu’ils n’en savent rien. Si on leur demande ce que c’est que la matière, ils font la même réponse. Il est vrai que des professeurs, & surtout des écoliers, savent parfaitement tout cela ; & quand ils ont répété que la matière est étendue & divisible, ils croient avoir tout dit ; mais quand ils sont priés de dire ce que c’est que cette chose étendue, ils se trouvent embarrassés. Cela est composé de parties, disent-ils ; & ces parties de quoi sont-elles composées ? Les élémens de ces parties sont-ils divisibles ? Alors ou ils sont muets, ou ils parlent beaucoup, ce qui est également suspect. Cet être presque inconnu qu’on nomme matière, est-il éternel ? Toute l’antiquité l’a cru. A-t-il par lui-même la force active ? [II-36] Plusieurs philosophes l’ont pensé. Ceux qui le nient sont-ils en droit de le nier ? Vous ne concevez pas que la matière puisse avoir rien par elle-même. Mais comment pouvez-vous assurer qu’elle n’a pas par elle-même les propriétés qui lui sont nécessaires ? Vous ignorez quelle est sa nature, & vous lui refusez des modes qui sont pourtant dans sa nature ; car enfin, dès qu’elle est, il faut bien qu’elle soit d’une certaine façon, qu’elle soit figurée ; & dès qu’elle est nécessairement figurée, est-il impossible qu’il n’y ait d’autres modes attachées à sa configuration ? La matière existe, vous ne la connaissez que par vos sensations. Hélas ! de quoi servent toutes les subtilités de l’esprit depuis qu’on raisonne ? La géométrie nous a appris bien des vérités, la métaphysique bien peu. Nous pesons la matière, nous la mesurons, nous la décomposons & au-delà de ces opérations grossières, si nous voulons faire un pas, nous trouvons dans nous l’impuissance, & devant nous un abîme.
Pardonnez de grace à l’univers entier qui s’est trompé en croyant la matière existante par elle-même. Pouvait-il faire autrement ? comment imaginer que ce qui est sans succession n’a pas toûjours été ? S’il n’était pas nécessaire que la matière existât, pourquoi existe-t-elle ? Et s’il fallait qu’elle fût, pourquoi n’aurait-elle pas été toûjours ? Nul axiome n’a jamais été plus universellement reçu que celui-ci : Rien ne se fait de rien. En effet le contraire est incompréhensible. Le chaos a chez tous les peuples précédé [II-37] l’arrangement qu’une main divine a fait du monde entier. L’éternité de la matière n’a nui chez aucun peuple au culte de la Divinité. La Religion ne fut jamais effarouchée qu’un Dieu éternel fût reconnu comme le maître d’une matière éternelle. Nous sommes assez heureux pour savoir aujourd’hui par la foi, que Dieu tira la matière du néant ; mais aucune nation n’avait été instruite de ce dogme ; les Juifs même l’ignorèrent. Le premier verset de la Genèse dit que les dieux Éloïm, non pas Éloï, firent le ciel & la terre ; il ne dit pas que le ciel & la terre furent créés de rien.
Philon qui est venu dans le seul tems où les Juifs aient eu quelque érudition, dit dans son chapitre de la création :
« Dieu étant bon par sa nature n’a point porté envie à la substance, à la matière, qui par elle-même n’avait rien de bon, qui n’a de sa nature, qu’inertie, confusion, désordre. Il daigna la rendre bonne de mauvaise qu’elle était. »
L’idée du chaos débrouillé par un Dieu se trouve dans toutes les anciennes théogonies, Hésiode répétait ce que pensait l’Orient, quand il disait dans sa théogonie : « Le chaos est ce qui a existé le premier. » Ovide était l’interprète de tout l’empire romain, quand il disait :
Sic ubi dispositam quisquis fuit ille deorum
Congeriem secuit…
La matière était donc regardée entre les mains de Dieu, comme l’argile sous la rouë [II-38] du potier, s’il est permis de se servir de ces faibles images pour en exprimer la divine puissance.
La matière étant éternelle devait avoir des propriétés éternelles, comme la configuration, la force d’inertie, le mouvement & la divisibilité. Mais cette divisibilité n’est que la suite du mouvement ; car sans mouvement rien ne se divise, ne se sépare, ni ne s’arrange. On regardait donc le mouvement comme essentiel à la matière. Le chaos avait été un mouvement confus ; & l’arrangement de l’univers un mouvement régulier imprimé à tous les corps par le maître du monde. Mais comment la matière aurait-elle le mouvement par elle-même ? Comme elle a, selon tous les anciens, l’étenduë & l’impénétrabilité.
Mais on ne la peut concevoir sans étendue, & on peut la concevoir sans mouvement ? À cela on répondait ; Il est impossible que la matière ne soit pas perméable ; or étant perméable, il faut bien que quelque chose passe continuellement dans ses pores ; à quoi bon des passages si rien n’y passe ?
De réplique en réplique on ne finirait jamais ; le systême de la matière éternelle a de très grandes difficultés comme tous les systêmes. Celui de la matière formée de rien n’est pas moins incompréhensible. Il faut l’admettre & ne pas se flatter d’en rendre raison ; la philosophie ne rend point raison de tout. Que de choses incompréhensibles n’est-on pas obligé d’admettre, même en géométrie ! Conçoit-on deux lignes [II-39] qui s’approcheront toûjours, & qui ne se rencontreront jamais ?
Les géomètres à la vérité nous diront ; Les propriétés des asymptotes vous sont démontrées ; vous ne pouvez vous empêcher de les admettre ; mais la création ne l’est pas, pourquoi l’admettez-vous ? Quelle difficulté trouvez-vous à croire comme toute l’antiquité la matière éternelle ? D’un autre côté le théologien vous pressera & vous dira, Si vous croyez la matière éternelle, vous reconnaissez donc deux principes, Dieu & la matière, vous tombez dans l’erreur de Zoroastre, de Manés.
On ne répondra rien aux géomètres, parce que ces gens-là ne connaissent que leurs lignes, leurs surfaces & leurs solides ; mais on pourra dire au théologien : En quoi suis-je Manichéen ? voilà des pierres qu’un architecte n’a point faites ; il en a élevé un bâtiment immense ; je n’admets point deux architectes ; les pierres brutes ont obéi au pouvoir & au génie.
Heureusement quelque systême qu’on embrasse, aucun ne nuit à la morale ; car qu’importe que la matière soit faite ou arrangée ? Dieu est également notre maître absolu. Nous devons être également vertueux sur un chaos débrouillé, ou sur un chaos créé de rien, presque aucune de ces questions métaphysiques n’influe sur la conduite de la vie ; il en est des disputes comme des vains discours qu’on tient à table ; chacun oublie après dîner ce qu’il a dit, & va où son intérêt & son goût l’appellent.
[II-40]
MÉCHANT.↩
On nous crie que la nature humaine est essentiellement perverse, que l’homme est né enfant du Diable, & méchant. Rien n’est plus mal avisé. Car, mon ami, toi qui me prêches que tout le monde est né pervers, tu m’avertis donc que tu es né tel, qu’il faut que je me défie de toi comme d’un renard ou d’un crocodile. Oh point ! me dis-tu, je suis régénéré, je ne suis ni hérétique ni infidèle, on peut se fier à moi ; mais le reste du genre humain qui est ou hérétique, ou ce que tu appelles infidèle, ne sera donc qu’un assemblage de monstres, & toutes les fois que tu parleras à un Luthérien, ou un Turc, tu dois être sûr qu’ils te voleront, & qu’ils t’assassineront, car ils sont enfans du Diable ; ils sont nés méchans ; l’un n’est point régénéré, & l’autre est dégénéré. Il serait bien plus raisonnable, bien plus beau de dire aux hommes, Vous êtes tous nés bons, voyez combien il serait affreux de corrompre la pureté de votre être. Il eût fallu en user avec le genre humain comme on en use avec tous les hommes en particulier. Un chanoine mène-t-il une vie scandaleuse ? on lui dit, est-il possible que vous déshonoriez la dignité de chanoine ? On fait souvenir un homme de robe qu’il a l’honneur d’être Conseiller du Roi, & qu’il doit l’exemple. On dit à un soldat pour l’encourager, Songe que tu es du régiment de Champagne. On [II-41] devrait dire à chaque individu, Souviens-toi de ta dignité d’homme.
Et en effet, malgré qu’on en ait, on en revient toûjours là ; car que veut dire ce mot si fréquemment employé chez toutes les nations, rentrez en vous-mêmes ? si vous étiez né enfant du Diable, si votre origine était criminelle, si votre sang était formé d’une liqueur infernale, ce mot rentrez en vous-même, signifierait, Consultez, suivez votre nature diabolique, soyez imposteur, voleur, assassin, c’est la loi de votre père.
L’homme n’est point né méchant, il le devient, comme il devient malade. Des médecins se présentent & lui disent, Vous êtes né malade ; il est bien sûr que ces médecins, quelque chose qu’ils disent & qu’ils fassent, ne le guériront pas si sa maladie est inhérente à sa nature ; & ces raisonneurs sont très malades eux-mêmes.
Assemblez tous les enfans de l’univers, vous ne verrez en eux que l’innocence, la douceur & la crainte ; s’ils étaient nés méchans, malfaisans, cruels, ils en montreraient quelque signe, comme les petits serpens cherchent à mordre, & les petits tigres à déchirer. Mais la nature n’ayant pas donné à l’homme plus d’armes offensives qu’aux pigeons & aux lapins, elle ne leur a pu donner un instinct qui les porte à détruire.
L’homme n’est donc pas né mauvais, pourquoi plusieurs sont-ils donc infectés de cette peste de la méchanceté ? c’est que ceux qui sont [II-42] à leur tête étant pris de la maladie, la communiquent au reste des hommes, comme une femme attaquée du mal que Christophe Colomb rapporta d’Amérique, répand ce venin d’un bout de l’Europe à l’autre. Le premier ambitieux a corrompu la terre.
Vous m’allez dire que ce premier monstre a déployé le germe d’orgueil, de rapine, de fraude, de cruauté qui est dans tous les hommes. J’avoue qu’en général la plupart de nos frères peuvent acquérir ces qualités ; mais tout le monde a-t-il la fièvre putride, la pierre & la gravelle parce que tout le monde y est exposé ?
Il y a des nations entières qui ne sont point méchantes ; les Philadelphiens, les Banians n’ont jamais tué personne. Les Chinois, les peuples du Tonquin, de Lao, de Siam, du Japon même, depuis plus de cent ans ne connaissent point la guerre. À peine voit-on en dix ans un de ces grands crimes qui étonnent la nature humaine, dans les villes de Rome, de Venise, de Paris, de Londres, d’Amsterdam, villes où pourtant la cupidité, mère de tous les crimes, est extrême.
Si les hommes étaient essentiellement méchans, s’ils naissaient tous soumis à un être aussi malfaisant que malheureux, qui pour se venger de son supplice leur inspirerait toutes ses fureurs, on verrait tous les matins les maris assassinés par leurs femmes, & les pères par leurs enfans, comme on voit à l’aube du jour des poules étranglées par une fouïne qui est venue sucer leur sang.
[II-43]
S’il y a un milliard d’hommes sur la terre, c’est beaucoup ; cela donne environ cinq cents millions de femmes qui cousent, qui filent, qui nourrissent leurs petits, qui tiennent la maison ou la cabane propre, & qui médisent un peu de leurs voisines. Je ne vois pas quel grand mal ces pauvres innocentes font sur la terre. Sur ce nombre d’habitans du globe, il y a deux cents millions d’enfans au moins, qui certainement ne tuent ni ne pillent, & environ autant de vieillards ou de malades qui n’en ont pas le pouvoir. Restera tout au plus cent millions de jeunes gens robustes & capables du crime. De ces cent millions il y en a quatre-vingt-dix continuellement occupés à forcer la terre par un travail prodigieux à leur fournir la nourriture & le vêtement ; ceux-là n’ont guère le tems de mal faire.
Dans les dix millions restants seront compris les gens oisifs & de bonne compagnie, qui veulent jouïr doucement, les hommes à talents occupés de leurs professions, les magistrats, les prêtres, visiblement intéressés à mener une vie pure, au moins en apparence. Il ne restera donc de vrais méchants que quelques politiques, soit séculiers, soit réguliers qui veulent toûjours troubler le monde, & quelques milliers de vagabonds qui louent leurs services à ces politiques. Or il n’y a jamais à la fois un million de ces bêtes féroces employées ; & dans ce nombre je compte les voleurs de grands chemins. Vous avez donc, tout au plus, sur la terre dans les tems les plus orageux, un homme sur mille, [II-44] qu’on peut appeler méchant, encor ne l’est-il pas toûjours.
Il y a donc infiniment moins de mal sur la terre qu’on ne dit, & qu’on ne croit. Il y en a encor trop, sans doute ; on voit des malheurs & des crimes horribles ; mais le plaisir de se plaindre & d’exagérer est si grand, qu’à la moindre égratignure vous criez que la terre regorge de sang. Avez-vous été trompé ? tous les hommes sont des parjures. Un esprit mélancolique qui a souffert une injustice voit l’univers couvert de damnés, comme un jeune voluptueux soupant avec sa dame au sortir de l’opéra, n’imagine pas qu’il y ait des infortunés.
MESSIE.↩
Messiah ou Meshiah, en hébreu ; Christus, ou Célomenos, en grec ; Unctus en latin, Oint.
Nous voyons dans l’Ancien Testament que le nom de Messie fut souvent donné à des Princes idolâtres ou infidèles. Il est dit [[21]] que Dieu envoya un Prophête pour oindre Jéhu Roi d’Israël ; il annonça l’onction sacrée à Hazaël Roi de Damas & de Syrie, ces deux Princes étant les Messies du Très-haut, pour punir la maison d’Achab.
Au 16e d’Ésaïe le nom de Messie est [II-45] expressément donné à Cyrus.
« Ainsi a dit l’Éternel à Cyrus son oint, son Messie, duquel j’ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, &c. »
Ézéchiel au 28e chapitre de ses révélations donne le nom de Messie au roi de Tyr, qu’il appelle aussi Chérubin.
« Fils de l’homme, dit l’Éternel au Prophête, prononce à haute voix une complainte sur le Roi de Tyr, & lui dis ; Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel. Tu étais le sceau de la ressemblance de Dieu, plein de sagesse & parfait en beauté ; tu as été le jardin d’Héden du Seigneur, (ou suivant d’autres versions, tu étais toutes les délices du Seigneur.) Tes vêtements étaient de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolithe, d’onyx, de béryl, de saphir, d’escarboucle, d’émeraude, & d’or ; ce que savaient faire tes tambours & tes flûtes a été chez toi ; ils ont été tous prêts au jour que tu fus créé ; tu as été un Chérubin, un Messie. »
Ce nom de Messiah, Christ, se donnait aux Rois, aux Prophètes, & aux grands-prêtres des Hébreux. Nous lisons dans le I. des Rois xij. 3, « Le Seigneur & son Messie sont témoins », c’est-à-dire, « le Seigneur & le Roi qu’il a établi ». Et ailleurs : « Ne touchez point mes oints, & ne faites aucun mal à mes Prophêtes. » David animé de l’esprit de Dieu, donne dans plus d’un endroit à Saül son beau-père réprouvé qui le persécutait, le nom & la qualité d’oint, de Messie du Seigneur.
« Dieu [II-46] me garde, dit-il fréquemment, de porter ma main sur l’oint du Seigneur, sur le Messie de Dieu ! »
Hérode étant oint fut appelé Messie par les Hérodiens, qui composèrent quelque tems une petite secte.
Si le nom de Messie, d’oint de l’Éternel a été donné à des Rois idolâtres, à des réprouvés, il a été très souvent employé dans nos anciens oracles pour désigner l’oint véritable du Seigneur, ce Messie par excellence, le Christ, fils de Dieu, enfin Dieu lui-même.
Si l’on rapproche tous les divers oracles qu’on applique pour l’ordinaire au Messie, il en peut résulter quelques difficultés apparentes dont les Juifs se sont prévalus pour justifier, s’ils le pouvaient, leur obstination. Plusieurs grands théologiens leur accordent, que dans l’état d’oppression sous lequel gémissait le peuple Juif, & après toutes les promesses que l’Éternel lui avait faites si souvent, il pouvait soupirer après la venue d’un Messie vainqueur & libérateur, & qu’ainsi il est en quelque sorte excusable de n’avoir pas d’abord reconnu ce libérateur dans la personne de Jésus, d’autant plus qu’il n’y a pas un seul passage dans l’Ancien Testament où il soit dit, Croyez au Messie.
Il était dans le plan de la sagesse éternelle, que les idées spirituelles du vrai Messie fussent inconnues à la multitude aveugle ; elles le furent au point que les docteurs Juifs se sont avisés de nier que les passages que nous alléguons doivent s’entendre du Messie ; plusieurs disent que [II-47] le Messie est déjà venu en la personne d’Ézéchias ; c’était le sentiment du fameux Hillel. D’autres en grand nombre prétendent que la croyance de la venue d’un Messie n’est point un article fondamental de foi, & que ce dogme n’étant ni dans le Décalogue, ni dans le Lévitique, il n’est qu’une espérance consolante.
Plusieurs rabbins vous disent qu’ils ne doutent pas, que suivant les anciens oracles le Messie ne soit venu dans les tems marqués ; mais qu’il ne vieillit point, qu’il reste caché sur cette terre, & qu’il attend pour se manifester qu’Israël ait célébré comme il faut le sabbat.
Le fameux Rabbin Salomon Jarchy ou Raschy, qui vivait au commencement du douzième siècle, dit dans ses Talmudiques, que les anciens Hébreux ont cru que le Messie était né le jour de la dernière destruction de Jérusalem par les armées romaines ; c’est, comme on dit, appeler le médecin après la mort.
Le Rabbin Kimchy qui vivait aussi au douzième siècle, annonçait que le Messie dont il croyait la venue très prochaine, chasserait de la Judée les Chrétiens qui la possédaient pour lors ; il est vrai que les Chrétiens perdirent la terre sainte ; mais ce fut Saladin qui les vainquit : pour peu que ce conquérant eût protégé les Juifs, & se fût déclaré pour eux, il est vraisemblable que dans leur enthousiasme ils en auraient fait leur Messie.
Les auteurs sacrés, & notre Seigneur Jésus lui-même, comparent souvent le règne du Messie & l’éternelle béatitude à des jours de noces, à [II-48] des festins ; mais les talmudistes ont étrangement abusé de ces paraboles ; selon eux le Messie donnera à son peuple rassemblé dans la terre de Canaan, un repas dont le vin sera celui qu’Adam lui-même fit dans le Paradis terrestre, & qui se conserve dans de vastes celliers, creusés par les anges au centre de la terre.
On servira pour entrée le fameux poisson, appelé le grand Léviathan, qui avale tout d’un coup un poisson moins grand que lui, lequel ne laisse pas d’avoir trois cents lieuës de long ; toute la masse des eaux est portée sur Léviathan. Dieu au commencement en créa un mâle & un autre femelle ; mais de peur qu’ils ne renversassent la terre, & qu’ils ne remplissent l’univers de leurs semblables, Dieu tua la femelle, & la sala pour le festin du Messie.
Les Rabbins ajoutent qu’on tuera pour ce repas le taureau Béhémoth, qui est si gros qu’il mange chaque jour le foin de mille montagnes : la femelle de ce taureau fut tuée au commencement du monde, afin qu’une espèce si prodigieuse ne se multipliât pas, ce qui n’aurait pu que nuire aux autres créatures ; mais ils assurent que l’Éternel ne la sala pas, parce que la vache salée n’est pas si bonne que la léviathane. Les Juifs ajoutent encor si bien foi à toutes ces rêveries rabbiniques, que souvent ils jurent sur leur part du bœuf Béhémoth.
Après des idées si grossières sur la venue du Messie, & sur son règne, faut-il s’étonner, si les Juifs tant anciens que modernes, & plusieurs même des premiers Chrétiens, malheureusement [II-49] imbus de toutes ces rêveries, n’ont pu s’élever à l’idée de la nature divine de l’oint du Seigneur, & n’ont pas attribué la qualité de Dieu au Messie ? Voyez comme les Juifs s’expriment là-dessus dans l’ouvrage intitulé Judæi Lusitani quæstiones ad Christianos [[22]].
« Reconnaître, disent-ils, un homme-Dieu, c’est s’abuser soi-même, c’est se forger un monstre, un centaure, le bizarre composé de deux natures qui ne sauraient s’allier. »
Ils ajoutent que les Prophêtes n’enseignent point que le Messie soit homme-Dieu, qu’ils distinguent expressément entre Dieu & David, qu’ils déclarent le premier maître & le second serviteur, &c.
On sait assez que les Juifs esclaves de la lettre n’ont jamais pénétré comme nous le sens des Écritures.
Lorsque le Sauveur parut, les préjugés juifs s’élevèrent contre lui. Jésus-Christ lui-même, pour ne pas révolter leurs esprits aveugles, paraît extrêmement réservé sur l’article de sa divinité : « Il voulait, dit Saint Chrysostome, accoutumer insensiblement ses auditeurs à croire un mystère si fort élevé au-dessus de la raison. » S’il prend l’autorité d’un Dieu en pardonnant les péchés, cette action soulève tous ceux qui en sont les témoins ; ses miracles les plus évidents ne peuvent convaincre de sa divinité, ceux mêmes en faveur desquels ils les opère. Lorsque devant le tribunal du souverain sacrificateur, il avoue avec un modeste détour qu’il est le fils [II-50] de Dieu, le grand-prêtre déchire sa robe & crie au blasphème. Avant l’envoi du St. Esprit, les apôtres ne soupçonnent pas même la divinité de leur maître ; il les interroge sur ce que le peuple pense de lui ; ils répondent, que les uns le prennent pour Élie, les autres pour Jérémie, ou pour quelque autre prophète. St. Pierre a besoin d’une révélation particulière pour connaître que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant.
Les Juifs révoltés contre la divinité de Jésus-Christ ont eu recours à toutes sortes de voies pour détruire ce grand mystère ; ils détournent le sens de leurs propres oracles, ou ne les appliquent pas au Messie ; ils prétendent que le nom de Dieu, Éloï, n’est pas particulier à la Divinité, & qu’il se donne même par les auteurs sacrés aux juges, aux magistrats, en général à ceux qui sont élevés en autorité ; ils citent en effet un très grand nombre de passages des saintes Écritures, qui justifient cette observation, mais qui ne donnent aucune atteinte aux termes exprès des anciens oracles qui regardent le Messie.
Enfin ils prétendent que si le Sauveur, & après lui les Évangélistes, les Apôtres & les premiers Chrétiens, appellent Jésus le fils de Dieu, ce terme auguste ne signifiait dans les tems évangéliques, autre chose que l’opposé de fils de Bélial, c’est-à-dire, homme de bien, serviteur de Dieu ; par opposition à un méchant, un homme qui ne craint point Dieu.
Si les Juifs ont contesté à Jésus-Christ la [II-51] qualité de Messie & sa divinité, ils n’ont rien négligé aussi pour le rendre méprisable, pour jetter sur sa naissance, sa vie & sa mort, tout le ridicule & tout l’opprobre qu’a pû imaginer leur criminel acharnement.
De tous les ouvrages qu’a produits l’aveuglement des Juifs, il n’en est point de plus odieux & de plus extravagant que le livre ancien intitulé Sepher Toldos Jeschut, tiré de la poussière par Mr. Vagenseil dans le second tome de son ouvrage intitulé Tela ignea, &c.
C’est dans ce Sepher Toldos Jeschut, qu’on lit une histoire monstrueuse de la vie de notre Sauveur forgée avec toute la passion & la mauvaise foi possibles. Ainsi, par exemple, ils ont osé écrire qu’un nommé Panther ou Pandera habitant de Bethléem, était devenu amoureux d’une jeune femme mariée à Jokanam. Il eut de ce commerce impur un fils qui fut nommé Jesua ou Jesu. Le père de cet enfant fut obligé de s’enfuir, & se retira à Babilone. Quant au jeune Jesu, on l’envoya aux écoles ; mais, ajoute l’auteur, il eut l’insolence de lever la tête, & de se découvrir devant les sacrificateurs, au lieu de paraître devant eux la tête baissée, & le visage couvert, comme c’était la coutume ; hardiesse qui fut vivement tancée ; ce qui donna lieu d’examiner sa naissance, qui fut trouvée impure, & l’exposa bientôt à l’ignominie.
Ce détestable livre Sepher Toldos Jeschut était connu dès le second siècle ; Celse le cita avec confiance, & Origène le réfute au chapitre neuvième.
[II-52]
Il y a un autre livre intitulé aussi Toledos Jeschut, publié l’an 1705 par Mr. Huldric, qui suit de plus près l’Évangile de l’enfance, mais qui commet à tout moment les anachronismes les plus grossiers ; il fait naître & mourir Jésus-Christ sous le règne d’Hérode le grand ; il veut que ce soit à ce prince qu’ont été faites les plaintes sur l’adultère de Panther & de Marie mère de Jésus.
L’auteur qui prend le nom de Jonathan, qui se dit contemporain de Jésus-Christ & demeurant à Jérusalem, avance qu’Hérode consulta sur le fait de Jésus-Christ les sénateurs d’une ville dans la terre de Césarée : nous ne suivrons pas un auteur aussi absurde dans toutes ses contradictions.
Cependant c’est à la faveur de toutes ces calomnies que les Juifs s’entretiennent dans leur haine implacable contre les Chrétiens, & contre l’Évangile ; ils n’ont rien négligé pour altérer la chronologie du Vieux Testament, & pour répandre des doutes & des difficultés sur le tems de la venue de notre Sauveur.
Ahmed-ben-Cassum-al-Andacousy Maure de Grenade qui vivait sur la fin du seizième siècle, cite un ancien manuscrit arabe qui fut trouvé avec seize lames de plomb, gravées en caractères arabes, dans une grotte, près de Grenade. Don Pedro y Quinones archevêque de Grenade en a rendu lui-même témoignage ; ces lames de plomb, qu’on appelle de Grenade, ont été depuis portées à Rome, où après un examen de plusieurs années, elles ont enfin été [II-53] condamnées comme apocryphes sous le pontificat d’Alexandre VII ; elles ne renferment que des histoires fabuleuses touchant la vie de Marie & de son fils.
Le nom de Messie accompagné de l’épithète de faux se donne encor à ces imposteurs qui dans divers tems ont cherché à abuser la nation juive. Il y eut de ces faux-Messies avant même la venue du véritable oint de Dieu. Le sage Gamaliel parle [[23]] d’un nommé Theudas, dont l’histoire se lit dans les Antiquités Judaïques de Joseph, liv. 20. chap. 2. Il se vantait de passer le Jourdain à pié sec ; il attira beaucoup de gens à sa suite ; mais les Romains étant tombés sur sa petite troupe la dissipèrent, coupèrent la tête au malheureux chef, & l’exposèrent dans Jérusalem.
Gamaliel parle aussi de Judas le Galiléen, qui est sans doute le même dont Joseph fait mention dans le 12e chap. du second livre de la guerre des Juifs. Il dit que ce faux prophète avait ramassé près de trente mille hommes ; mais l’hyperbole est le caractère de l’historien Juif.
Dès les tems apostoliques l’on vit Simon surnommé le magicien [[24]], qui avait su séduire les habitans de Samarie, au point qu’ils le considéraient comme la vertu de Dieu.
Dans le siècle suivant l’an 178 & 179 de l’ère chrétienne, sous l’empire d’Adrien, parut [II-54] le faux-Messie Barchochebas, à la tête d’une armée. L’Empereur envoya contre lui Julius Severus, qui après plusieurs rencontres enferma les révoltés dans la ville de Bither ; elle soutint un siège opiniâtre & fut emportée, Barchochebas y fut pris & mis à mort. Adrien crut ne pouvoir mieux prévenir les continuelles révoltes des Juifs qu’en leur défendant par un édit d’aller à Jérusalem ; il établit même des gardes aux portes de cette ville, pour en défendre l’entrée aux restes du peuple d’Israël.
On lit dans Socrate, historien ecclésiastique, [[25]], que l’an 434 il parut dans l’île de Candie un faux-Messie qui s’appelait Moïse. Il se disait l’ancien libérateur des Hébreux ressuscité pour les délivrer encor.
Un siècle après, en 530, il y eut dans la Palestine un faux-Messie nommé Julien ; il s’annonçait comme un grand conquérant, qui à la tête de sa nation détruirait par les armes tout le peuple chrétien ; séduits par ses promesses, les Juifs armés massacrèrent plusieurs Chrétiens. L’empereur Justinien envoya des troupes contre lui ; on livra bataille au faux-Christ, il fut pris & condamné au dernier supplice.
Au commencement du 8e siècle, Serenus Juif Espagnol, se porta pour Messie, prêcha, eut des disciples, & mourut comme eux dans la misère.
Il s’éleva plusieurs faux-Messies dans le douzième siècle. Il en parut un en France sous [II-55] Louïs le jeune ; il fut pendu lui & ses adhérens, sans qu’on ait jamais su les noms ni du maître ni des disciples.
Le treizième siècle fut fertile en faux-Messies ; on en compte sept ou huit qui parurent en Arabie, en Perse, dans l’Espagne, en Moravie : l’un d’eux qui se nommait David el Ré passe pour avoir été un très grand magicien ; il séduisit les Juifs, & se vit à la tête d’un parti considérable ; mais ce Messie fut assassiné.
Jaque Zieglerne de Moravie, qui vivait au milieu du 16e siècle, annonçait la prochaine manifestation du Messie ; né, à ce qu’il assurait, depuis quatorze ans, il l’avait vu, disait-il, à Strasbourg, & il gardait avec soin une épée & un sceptre pour les lui mettre en main dès qu’il serait en âge d’enseigner.
L’an 1624 un autre Zieglerne confirma la prédiction du premier.
L’an 1666 Sabathai Sévi né dans Alep, se dit le Messie prédit par les Zieglernes. Il débuta par prêcher sur les grands chemins, & au milieu des campagnes ; les Turcs se moquaient de lui, pendant que ses disciples l’admiraient. Il paraît qu’il ne mit pas d’abord dans ses intérêts le gros de la nation Juive, puisque les chefs de la synagogue de Smyrne, portèrent contre lui une sentence de mort ; mais il en fut quitte pour la peur & le bannissement.
Il contracta trois mariages, & l’on prétend qu’il n’en consomma point, disant que cela était au-dessous de lui. Il s’associa un nommé Nathan-Lévi : celui-ci fit le personnage du [II-56] prophête Élie, qui devait précéder le Messie. Ils se rendirent à Jérusalem, & Nathan y annonça Sabathai Sévi comme le libérateur des nations. La populace juive se déclara pour eux ; mais ceux qui avaient quelque chose à perdre les anathématisèrent.
Sévi pour fuir l’orage se retira à Constantinople, & de là à Smyrne ; Nathan-Lévi lui envoya quatre ambassadeurs qui le reconnurent & le saluèrent publiquement en qualité de Messie ; cette ambassade en imposa au peuple, & même à quelques docteurs qui déclarèrent Sabathai Sévi Messie & roi des Hébreux. Mais la synagogue de Smyrne condamna son Roi à être empalé.
Sabathai se mit sous la protection du Cadi de Smyrne, & eut bientôt pour lui tout le peuple Juif ; il fit dresser deux trônes, un pour lui, & l’autre pour son épouse favorite ; il prit le nom de Roi des Rois, & donna à Joseph Sévi son frère celui de Roi de Juda. Il promit aux Juifs la conquête de l’Empire Ottoman assurée. Il poussa même l’insolence jusqu’à faire ôter de la liturgie juive le nom de l’Empereur, & à y faire substituer le sien.
On le fit mettre en prison aux Dardanelles ; les Juifs publièrent qu’on n’épargnait sa vie, que parce que les Turcs savaient bien qu’il était immortel. Le Gouverneur des Dardanelles s’enrichit des présents que les Juifs lui prodiguèrent pour visiter leur Roi, leur Messie prisonnier, qui dans les fers conservait toute sa dignité, & se faisait baiser les pieds.
[II-57]
Cependant le sultan qui tenait sa cour à Andrinople, voulut faire finir cette comédie ; il fit venir Sévi & lui dit que s’il était Messie, il devait être invulnérable ; Sévi en convint. Le Grand-Seigneur le fit placer pour but aux flèches de ses icoglans ; le Messie avoua qu’il n’était point invulnérable, & protesta que Dieu ne l’envoyait que pour rendre témoignage à la sainte religion musulmane. Fustigé par les ministres de la loi, il se fit Mahométan, & il vécut & mourut également méprisé des Juifs & des Musulmans ; ce qui a si fort décrédité la profession de faux-Messie, que Sévi est le dernier qui ait paru.
MÉTAMORPHOSE,
MÉTEMPSICOSE.↩
N’est-il pas bien naturel que toutes les métamorphoses dont la terre est couverte, aient fait imaginer dans l’Orient où on a imaginé tout, que nos âmes passaient d’un corps à un autre ; un point presque imperceptible devient un ver, ce ver devient papillon ; un gland se transforme en chêne, un œuf en oiseau ; l’eau devient nuage & tonnerre ; le bois se change en feu & en cendre ; tout paraît enfin métamorphosé dans la nature. On attribua bientôt aux âmes qu’on regardait comme des figures légères, ce qu’on voyait sensiblement dans des [II-58] corps plus grossiers. L’idée de la métempsicose est peut-être le plus ancien dogme de l’univers connu, & il règne encor dans une grande partie de l’Inde & de la Chine.
Il est encor très naturel que toutes les métamorphoses dont nous sommes les témoins, aient produit ces anciennes fables qu’Ovide a recueillies dans son admirable ouvrage. Les Juifs même ont eu aussi leurs métamorphoses. Si Niobé fut changée en marbre, Hedith femme de Loth fut changée en statue de sel. Si Euridice resta dans les enfers pour avoir regardé derrière elle, c’est aussi pour la même indiscrétion que cette femme de Loth fut privée de la nature humaine. Le bourg qu’habitaient Baucis & Philémon en Phrygie est changé en un lac, la même chose arrive à Sodome. Les filles d’Anius changeaient l’eau en huile, nous avons dans l’Écriture une métamorphose à peu près semblable, mais plus vraie & plus sacrée. Cadmus fut changé en serpent ; la verge d’Aaron devint serpent aussi.
Les dieux se changeaient très souvent en hommes, les Juifs n’ont jamais vu les anges que sous la forme humaine : les anges mangèrent chez Abraham. Paul dans son Épître aux Corinthiens dit que l’ange de Sathan lui a donné des soufflets : Angelos Sathana me colaphisei.
[II-59]
MIRACLES.↩
Un miracle selon l’énergie du mot est une chose admirable. En ce cas tout est miracle. L’ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d’un million de soleils, l’activité de la lumière, la vie des animaux, sont des miracles perpétuels.
Selon les idées reçues nous appelons miracle la violation de ces loix divines & éternelles. Qu’il y ait une éclipse de soleil pendant la pleine lune, qu’un mort fasse à pied deux lieuës de chemin en portant sa tête entre ses bras, nous appelons cela un miracle.
Plusieurs physiciens soutiennent qu’en ce sens il n’y a point de miracles, & voici leurs argumens.
Un miracle est la violation des loix mathématiques, divines, immuables, éternelles. Par ce seul exposé, un miracle est une contradiction dans les termes. Une loi ne peut être à la fois immuable & violée ; mais une loi, leur dit-on, étant établie par Dieu même, ne peut-elle être suspendue par son auteur ? Ils ont la hardiesse de répondre que non, & qu’il est impossible que l’Être infiniment sage ait fait des loix pour les violer. Il ne pouvait, disent-ils, déranger sa machine que pour la faire mieux aller ; or il est clair qu’étant Dieu il a fait cette immense machine aussi bonne qu’il l’a pû ; s’il [II-60] a vu qu’il y aurait quelque imperfection résultante de la nature de la matière, il y a pourvu dès le commencement, ainsi il n’y changera jamais rien.
De plus Dieu ne peut rien faire sans raison ; or quelle raison le porterait à défigurer pour quelque tems son propre ouvrage ?
C’est en faveur des hommes, leur dit-on. C’est donc au moins en faveur de tous les hommes, répondent-ils ; car il est impossible de concevoir que la nature divine travaille pour quelques hommes en particulier, & non pas pour tout le genre humain ; encor même le genre humain est bien peu de chose ; il est beaucoup moindre qu’une petite fourmilière en comparaison de tous les êtres qui remplissent l’immensité. Or n’est-ce pas la plus absurde des folies d’imaginer que l’Être infini intervertisse en faveur de trois ou quatre centaines de fourmis, sur ce petit amas de fange, le jeu éternel de ces ressorts immenses qui font mouvoir tout l’univers.
Mais supposons que Dieu ait voulu distinguer un petit nombre d’hommes par des faveurs particulières, faudra-t-il qu’il change ce qu’il a établi pour tous les tems & pour tous les lieux ? Il n’a certes aucun besoin de ce changement, de cette inconstance, pour favoriser ses créatures ; ses faveurs sont dans ses loix mêmes. Il a tout prévu, tout arrangé pour elles, toutes obéissent irrévocablement à la force qu’il a imprimée pour jamais dans la nature.
Pourquoi Dieu ferait-il un miracle ? Pour [II-61] venir à bout d’un certain dessein sur quelques êtres vivans ! Il dirait donc, Je n’ai pu parvenir, par la fabrique de l’univers, par mes décrets divins, par mes loix éternelles, à remplir un certain dessein : je vais changer mes éternelles idées, mes loix immuables, pour tâcher d’exécuter ce que je n’ai pu faire par elles. Ce serait un aveu de sa faiblesse, & non de sa puissance. Ce serait, ce semble, dans lui la plus inconcevable contradiction. Ainsi donc, oser supposer à Dieu des miracles, c’est réellement l’insulter (si des hommes peuvent insulter Dieu.) C’est lui dire, Vous êtes un être faible & inconséquent. Il est donc absurde de croire des miracles, c’est déshonorer en quelque sorte la Divinité.
On presse ces philosophes : on leur dit, Vous avez beau exalter l’immutabilité de l’Être suprême, l’éternité de ses loix, la régularité de ses mondes infinis : notre petit tas de boue a été tout couvert de miracles ; les histoires sont aussi remplies de prodiges que d’événements naturels. Les filles du grand prêtre Anius changeaient tout ce qu’elles voulaient en bled, en vin, ou en huile ; Athalide fille de Mercure ressuscita plusieurs fois ; Esculape ressuscita Hipolite ; Hercule arracha Alceste à la mort ; Herès revint au monde après avoir passé quinze jours dans les enfers. Romulus & Rémus naquirent d’un dieu & d’une vestale ; le Palladium tomba du ciel dans la ville de Troye ; la chevelure de Bérénice devint un assemblage d’étoiles ; la cabane de Baucis & de Philémon fut [II-62] changée en un superbe temple ; la tête d’Orphée rendait des oracles après sa mort ; les murailles de Thèbes se construisirent d’elles-mêmes au son de la flûte, en présence des Grecs ; les guérisons faites dans le temple d’Esculape, étaient innombrables ; & nous avons encor des monumens chargés du nom des témoins oculaires des miracles d’Esculape.
Nommez-moi un peuple, chez lequel il ne se soit pas opéré des prodiges incroyables, surtout dans des tems où l’on savait à peine lire & écrire.
Les philosophes ne répondent à ces objections qu’en riant & en levant les épaules ; mais les philosophes chrétiens disent ; Nous croyons aux miracles opérés dans notre sainte religion ; nous les croyons par la foi, & non par notre raison que nous nous gardons bien d’écouter ; car lorsque la foi parle, on sait assez que la raison ne doit pas dire un seul mot ; nous avons une croyance ferme & entière dans les miracles de Jésus-Christ, & des apôtres ; mais permettez-nous de douter un peu de plusieurs autres ; souffrez, par exemple, que nous suspendions notre jugement sur ce que rapporte un homme simple auquel on a donné le nom de grand. Il assure qu’un petit moine était si fort accoutumé à faire des miracles, que le prieur lui défendit enfin d’exercer son talent. Le petit moine obéït ; mais ayant vu un pauvre couvreur qui tombait du haut d’un toit, il balança entre le désir de lui sauver la vie, & la sainte obédience. Il ordonna seulement au couvreur [II-63] de rester en l’air jusqu’à nouvel ordre, & courut vîte conter à son prieur l’état des choses. Le Prieur lui donna l’absolution du péché qu’il avait commis en commençant un miracle sans permission, & lui permit de l’achever, pourvu qu’il s’en tînt là, & qu’il n’y revînt plus. On accorde aux philosophes qu’il faut un peu se défier de cette histoire.
Mais comment oseriez-vous nier, leur dit-on, que St. Gervais & St. Protais aient apparu en songe à St. Ambroise, qu’ils lui aient enseigné l’endroit où étaient leurs reliques ? que St. Ambroise les ait déterrées, & qu’elles aient guéri un aveugle ? St. Augustin était alors à Milan ; c’est lui qui rapporte ce miracle immenso populo teste, dit-il dans sa Cité de Dieu livre 22. Voilà un miracle des mieux constatés. Les philosophes disent qu’ils n’en croient rien, que Gervais & Protais n’apparaissent à personne, qu’il importe fort peu au genre humain qu’on sache où sont les restes de leurs carcasses ; qu’ils n’ont pas plus de foi à cet aveugle, qu’à celui de Vespasien ; que c’est un miracle inutile ; que Dieu ne fait rien d’inutile ; & ils se tiennent fermes dans leurs principes. Mon respect pour St. Gervais & St. Protais ne me permet pas d’être de l’avis de ces philosophes ; je rends compte seulement de leur incrédulité. Ils font grand cas du passage de Lucien qui se trouve dans la mort de Peregrinus. « Quand un joueur de gobelets adroit se fait chrétien, il est sûr de faire fortune. » Mais comme Lucien est [II-64] un auteur profane, il ne doit avoir aucune autorité parmi nous.
Ces philosophes ne peuvent se résoudre à croire les miracles opérés dans le second siècle ; des témoins oculaires ont beau écrire que l’Évêque de Smyrne St. Polycarpe, ayant été condamné à être brûlé & étant jeté dans les flammes, ils entendirent une voix du ciel qui criait, Courage, Polycarpe, sois fort, montre-toi homme ; qu’alors les flammes du bûcher s’écartèrent de son corps, & formèrent un pavillon de feu au-dessus de sa tête, & que du milieu du bûcher il sortit une colombe ; enfin on fut obligé de trancher la tête de Polycarpe. À quoi bon ce miracle ? disent les incrédules ; pourquoi les flammes ont-elles perdu leur nature, & pourquoi la hache de l’exécuteur n’a-t-elle pas perdu la sienne ? D’où vient que tant de martyrs sont sortis sains & saufs de l’huile bouillante, & n’ont pu résister au tranchant du glaive ? On répond que c’est la volonté de Dieu. Mais les philosophes voudraient avoir vu tout cela de leurs yeux avant de le croire.
Ceux qui fortifient leurs raisonnements par la science vous diront que les Pères de l’Église ont avoué souvent eux-mêmes qu’il ne se faisait plus de miracles de leur tems. St. Chrysostome dit expressément :
« Les dons extraordinaires de l’esprit étaient donnés même aux indignes, parce qu’alors l’Église avait besoin de miracles ; mais aujourd’hui ils ne sont pas même donnés aux dignes, parce que l’Église n’en a plus de besoin. »
Ensuite il avoue qu’il n’y [II-65] a plus personne qui ressuscite les morts, ni même qui guérisse les malades.
St. Augustin lui-même, malgré le miracle de Gervais & de Protais, dit dans sa Cité de Dieu :
« Pourquoi ces miracles qui se faisaient autrefois ne se font-ils plus aujourd’hui ? » Et il en donne la même raison : « Cur, inquiunt, nunc illa miracula quæ prædicatis facta esse, non fiunt ? Possem quidem dicere, necessaria priùs fuisse, quàm crederet mundus, ad hoc ut crederet mundus. »
On objecte aux philosophes que St. Augustin, malgré cet aveu, parle pourtant d’un vieux savetier d’Hippone, qui ayant perdu son habit alla prier à la chapelle des vingt martyrs, qu’en retournant il trouva un poisson dans le corps duquel il y avait un anneau d’or, & que le cuisinier qui fit cuire le poisson, dit au savetier, Voilà ce que les vingt martyrs vous donnent.
À cela les philosophes répondent qu’il n’y a rien dans cette histoire qui contredise les loix de la nature, que la physique n’est point du tout blessée qu’un poisson ait avalé un anneau d’or, & qu’un cuisinier ait donné cet anneau à un savetier, qu’il n’y a là aucun miracle.
Si on fait souvenir ces philosophes que selon St. Jérôme, dans sa vie de l’ermite Paul, cet ermite eut plusieurs conversations avec des satyres, & avec des faunes, qu’un corbeau lui apporta tous les jours pendant trente ans la moitié d’un pain pour son dîner, & un pain tout entier le jour que St. Antoine vint le voir ; [II-66] ils pourront répondre encor, que tout cela n’est pas absolument contre la physique ; que des satyres & des faunes peuvent avoir existé, & qu’en tout cas si ce conte est une puérilité, cela n’a rien de commun avec les vrais miracles du Sauveur & de ses Apôtres. Plusieurs bons chrétiens ont combattu l’histoire de St. Simeon Stilite, écrite par Théodoret ; beaucoup de miracles qui passent pour authentiques dans l’Église Grecque, ont été révoqués en doute par plusieurs Latins ; de même que des miracles Latins ont été suspects à l’Église Grecque ; les Protestans sont venus ensuite, qui ont fort maltraité les miracles de l’une & l’autre Église.
Un savant jésuite [[26]] qui a prêché longtems dans les Indes, se plaint de ce que ni ses confrères, ni lui, n’ont jamais pu faire de miracle. Xavier se lamente dans plusieurs de ses lettres de n’avoir point le don des langues ; il dit qu’il n’est chez les Japonois que comme une statue muette ; cependant les Jésuites ont écrit qu’il avait ressuscité huit morts, c’est beaucoup ; mais il faut aussi considérer qu’il les ressuscitait à six mille lieuës d’ici. Il s’est trouvé depuis des gens qui ont prétendu que l’abolissement des Jésuites en France, est un beaucoup plus grand miracle que ceux de Xavier & d’Ignace.
Quoi qu’il en soit, tous les Chrétiens conviennent que les miracles de Jésus-Christ & des Apôtres sont d’une vérité incontestable ; mais [II-67] qu’on peut douter à toute force, de quelques miracles faits dans nos derniers tems, & qui n’ont pas eu une autenticité certaine.
On souhaiterait, par exemple, pour qu’un miracle fût bien constaté, qu’il fût fait en présence de l’Académie des Sciences de Paris, ou de la Société Royale de Londres, & de la Faculté de médecine, assistées d’un détachement du régiment des Gardes, pour contenir la foule du peuple, qui pourrait par son indiscrétion empêcher l’opération du miracle.
On demandait un jour à un philosophe, ce qu’il dirait, s’il voyait le soleil s’arrêter, c’est-à-dire, si le mouvement de la terre autour de cet astre cessait ; si tous les morts ressuscitaient, & si toutes les montagnes allaient se jeter de compagnie dans la mer, le tout pour prouver quelque vérité importante, comme par exemple, la grace versatile ? Ce que je dirais, répondit le philosophe, je me ferais Manichéen ; je dirais qu’il y a un principe qui défait ce que l’autre a fait.
MORALE.↩
Je viens de lire ces mots dans une déclamation en quatorze volumes, intitulée Histoire du bas Empire.
Les Chrétiens avaient une morale ; mais les Payens n’en avaient point.
Ah Mr. le Beau auteur de ces quatorze [II-68] volumes où avez-vous pris cette sottise ? eh qu’est-ce donc que la morale de Socrate, de Zaleucus, de Curondas, de Cicéron, d’Épictète, de Marc-Antonin ?
Il n’y a qu’une morale, M. le Beau, comme il n’y a qu’une géométrie. Mais, me dira-t-on, la plus grande partie des hommes ignore la géométrie. Oui ; mais dès qu’on s’y applique un peu, tout le monde est d’accord. Les agriculteurs, les manœuvres, les artistes n’ont point fait de cours de morale ; ils n’ont lu ni de finibus, de Cicéron, ni les Éthiques d’Aristote ; mais sitôt qu’ils réfléchissent, ils sont sans le savoir les disciples de Cicéron ; le teinturier Indien, le berger Tartare, & le matelot d’Angleterre connaissent le juste & l’injuste. Confucius n’a point inventé un systême de morale, comme on bâtit un systême de physique. Il l’a trouvé dans le cœur de tous les hommes.
Cette morale était dans le cœur du préteur Festus quand les Juifs le pressèrent de faire mourir Paul qui avait amené des étrangers dans [II-69] leur temple. Sachez, leur dit-il, que jamais les Romains ne condamnent personne sans l’entendre.
Si les Juifs manquaient de morale ou manquaient à la morale, les Romains la connaissaient & lui rendaient gloire.
La morale n’est point dans la superstition, elle n’est point dans les cérémonies, elle n’a rien de commun avec les dogmes. On ne peut trop répéter que tous les dogmes sont différens, & que la morale est la même chez tous les hommes qui font usage de leur raison. La morale vient donc de Dieu comme la lumière. Nos superstitions ne sont que ténèbres. Lecteur, réfléchissez. Étendez cette vérité ; tirez vos conséquences.
MOYSE.↩
En vain plusieurs savants ont cru que le Pentateuque ne peut avoir été écrit par Moïse [[27]] Ils disent que par l’Écriture même il [II-70] est avéré que le premier exemplaire connu fut trouvé du tems du Roi Josias, & que cet unique exemplaire fut apporté au Roi par le secrétaire Saphan. Or entre Moïse & cette avanture du secrétaire Saphan, il y a 1167 années par le comput hébraïque. Car Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent l’an du monde 2213, & le secrétaire Saphan publia le livre de la loi l’an du monde 3380. Ce livre trouvé sous Josias fut inconnu jusqu’au retour de la captivité de Babilone, & il est dit que ce fut Esdras, inspiré de Dieu, qui mit en lumière toutes les saintes Écritures.
Mais que ce soit Esdras ou un autre, qui ait rédigé ce livre, cela est absolument indifférent dès que le livre est inspiré. Il n’est point dit dans le Pentateuque que Moïse en soit l’auteur ; il serait donc permis de l’attribuer à un autre homme, à qui l’Esprit divin l’aura dicté. Si l’Église n’avait pas d’ailleurs décidé que le livre est de Moïse.
Quelques contradicteurs ajoutent qu’aucun prophète n’a cité les livres du Pentateuque, qu’il n’en est question ni dans les Psaumes, ni dans les livres attribués à Salomon, ni dans Jérémie, ni dans Isaïe, ni enfin dans aucun [II-71] livre canonique des Juifs. Les mots qui répondent à ceux de Genèse, Exode, Nombres, Lévitique, Deutéronome, ne se trouvent dans aucun autre écrit, reconnu par eux pour authentique.
D’autres plus hardis ont fait les questions suivantes.
1o En quelle langue Moïse aurait-il écrit dans un désert sauvage ? Ce ne pouvait être qu’en égyptien. Car par ce livre même on voit que Moïse & tout son peuple était né en Égypte. Il est probable qu’ils ne parlaient pas d’autre langue. Les Égyptiens ne se servaient pas encor du papiros ; on gravait des hiéroglyphes sur le marbre ou sur le bois. Il est même dit que les tables des commandements furent gravées sur la pierre. Il aurait donc fallu graver cinq volumes sur des pierres polies, ce qui demandait des efforts & un tems prodigieux.
2o Est-il vraisemblable que dans un désert, où le peuple juif n’avait ni cordonnier, ni tailleur, & où le Dieu de l’univers était obligé de faire un miracle continuel pour conserver les vieux habits & les vieux souliers des Juifs, il se soit trouvé des hommes assez habiles pour graver les cinq livres du Pentateuque sur le [II-72] marbre ou sur le bois ? On dira qu’on trouva bien des ouvriers qui firent un veau d’or en une nuit, & qui réduisirent ensuite l’or en poudre, opération impossible à la chymie ordinaire non encor inventée ; qui construisirent le tabernacle, qui l’ornèrent de trente-quatre colonnes d’airain avec des chapiteaux d’argent, qui ourdirent & qui brodèrent des voiles de lin, d’hyacinthe, de pourpre, & d’écarlate ; mais cela même fortifie l’opinion des contradicteurs. Ils répondent qu’il n’est pas possible que dans un désert où l’on manquait de tout, on ait fait des ouvrages si recherchés ; qu’il aurait fallu commencer par faire des souliers & des tuniques ; que ceux qui manquent du nécessaire, ne donnent point dans le luxe ; & que c’est une contradiction évidente de dire qu’il y ait eu des fondeurs, des graveurs, des brodeurs, quand on n’avait ni habits, ni pain.
3o Si Moïse avait écrit le premier chapitre de la Genèse, aurait-il été défendu à tous les jeunes gens de lire ce premier chapitre ? Aurait-on porté si peu de respect au législateur ? Si c’était Moïse qui eût dit que Dieu punit l’iniquité des pères jusqu’à la quatrième génération, Ézéchiel aurait-il osé dire le contraire ?
4o Si Moïse avait écrit le Lévitique, aurait-il pu se contredire dans le Deutéronome ? Le Lévitique défend d’épouser la femme de son frère, le Deutéronome l’ordonne.
5o Moïse aurait-il parlé dans son livre de villes qui n’existaient pas de son tems ? aurait-il dit que des villes qui étaient pour [II-73] lui à l’orient du Jourdain, étaient à l’occident ?
6o Aurait-il assigné quarante-huit villes aux Lévites dans un pays où il n’y a jamais eu dix villes, & dans un désert où il a toûjours erré sans avoir une maison ?
7o Aurait-il prescrit des règles pour les Rois Juifs, tandis que non seulement il n’y avait point de Rois chez ce peuple, mais qu’ils étaient en horreur, & qu’il n’était pas probable qu’il y en eût jamais ? Quoi ! Moïse aurait donné des préceptes pour la conduite des Rois, qui ne vinrent qu’environ cinq cents années après lui, & il n’aurait rien dit pour les juges & les pontifes qui lui succédèrent ? Cette réflexion ne conduit-elle pas à croire que le Pentateuque a été composé du tems des Rois, & que les cérémonies instituées par Moïse n’avaient été qu’une tradition ?
8o Se pourrait-il faire qu’il eût dit aux Juifs, Je vous ai fait sortir au nombre de six cent mille combattants de la terre d’Égypte, sous la protection de votre Dieu ? Les Juifs ne lui auraient-ils pas répondu, Il faut que vous ayez été bien timide pour ne nous pas mener contre le Pharaon d’Égypte ; il ne pouvait pas nous opposer une armée de deux cent mille hommes. Jamais l’Égypte n’a eu tant de soldats sur pied ; nous l’aurions vaincu sans peine, nous serions les maîtres de son pays ? Quoi ! le Dieu qui vous parle a égorgé pour nous faire plaisir tous les premiers-nés d’Égypte, & s’il y a dans ce pays-là trois cent mille familles, cela fait trois cent mille hommes morts en une [II-74] nuit pour nous venger ; & vous n’avez pas secondé votre Dieu ? & vous ne nous avez pas donné ce pays fertile que rien ne pouvait défendre ? vous nous avez fait sortir de l’Égypte en larrons & en lâches, pour nous faire périr dans des déserts, entre les précipices & les montagnes ? Vous pouviez nous conduire au moins par le droit chemin dans cette terre de Canaan sur laquelle nous n’avons nul droit, & que vous nous avez promise, & dans laquelle nous n’avons pû encor entrer ?
Il était naturel que de la terre de Gessen nous marchassions vers Tyr & Sidon le long de la Méditerranée ; mais vous nous faites passer l’isthme de Suez presque tout entier ; vous nous faites rentrer en Égypte, remonter jusque par delà Memphis, & nous nous trouvons à Béel Sephon, au bord de la mer Rouge, tournant le dos à la terre de Canaan, ayant marché quatre-vingts lieues dans cette Égypte que nous voulions éviter, & enfin près de périr entre la mer & l’armée de Pharaon !
Si vous aviez voulu nous livrer à nos ennemis, auriez-vous pris une autre route & d’autres mesures ? Dieu nous a sauvés par un miracle, dites-vous ; la mer s’est ouverte pour nous laisser passer ; mais après une telle faveur fallait-il nous faire mourir de faim & de fatigue dans les déserts horribles d’Éthan, de Cadés-Barné, de Mara, d’Élim, d’Oreb & de Sinaï ? Tous nos pères ont péri dans ces solitudes affreuses, & vous nous venez dire au bout de [II-75] quarante ans que Dieu a eu un soin particulier de nos pères !
Voilà ce que ces Juifs murmurateurs, ces enfans injustes des Juifs vagabonds, morts dans les déserts, auraient pu dire à Moïse, s’il leur avait lu l’Exode & la Genèse. Et que n’auraient-ils pas dû dire & faire à l’article du veau d’or ? Quoi ! vous osez nous conter que votre frère fit un veau pour nos pères, quand vous étiez avec Dieu sur la montagne ; vous qui tantôt nous dites que vous avez parlé à Dieu face à face & tantôt que vous n’avez pu le voir que par derrière ! Mais enfin, vous étiez avec ce Dieu, & votre frère jette en fonte un veau d’or en un seul jour, & nous le donne pour l’adorer ; & au lieu de punir votre indigne frère, vous le faites notre pontife, & vous ordonnez à vos lévites d’égorger vingt-trois mille hommes de votre peuple ; nos pères l’auraient-ils souffert ? se seraient-ils laissé assommer comme des victimes par des prêtres sanguinaires ? Vous nous dites que non content de cette boucherie incroyable, vous avez fait encor massacrer vingt-quatre mille de vos pauvres suivants, parce que l’un d’eux avait couché avec une Madianite ; tandis que vous-même avez épousé une Madianite ; & vous ajoutez que vous êtes le plus doux de tous les hommes. Encore quelques actions de cette douceur, & il ne serait plus resté personne.
Non, si vous aviez été capable d’une telle cruauté, si vous aviez pu l’exercer, vous seriez le plus barbare de tous les hommes, & [II-76] tous les supplices ne suffiraient pas pour expier un si étrange crime.
Ce sont là, à peu près, les objections que font les savants à ceux qui pensent que Moïse est l’auteur du Pentateuque. Mais on leur répond que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes ; que Dieu a éprouvé, conduit & abandonné son peuple par une sagesse qui nous est inconnue ; que les Juifs eux-mêmes depuis plus de deux mille ans ont cru que Moïse est l’auteur de ces livres ; que l’Église qui a succédé à la Synagogue, & qui est infaillible comme elle, a décidé ce point de controverse, & que les savants doivent se taire, quand l’Église parle.
[II-76]
NÉCESSAIRE.↩
OSMIN.
Ne dites-vous pas que tout est nécessaire ?
SÉLIM.
Si tout n’était pas nécessaire, il s’ensuivrait que Dieu aurait fait des choses inutiles.
OSMIN.
C’est-à-dire, qu’il était nécessaire à la nature divine qu’elle fît tout ce qu’elle a fait ?
SÉLIM.
Je le crois, ou du moins je le soupçonne, il [II-77] y a des gens qui pensent autrement ; je ne les entends point, peut-être ont-ils raison. Je crains la dispute sur cette matière.
OSMIN.
C’est aussi d’un autre nécessaire que je veux vous parler.
SÉLIM.
Quoi donc ? de ce qui est nécessaire à un honnête homme pour vivre ? du malheur où l’on est réduit quand on manque du nécessaire ?
OSMIN.
Non, car ce qui est nécessaire à l’un ne l’est pas toûjours à l’autre ; il est nécessaire à un Indien d’avoir du riz, à un Anglais d’avoir de la viande, il faut une fourrure à un Russe, & une étoffe de gaze à un Africain, tel homme croit que douze chevaux de carrosse lui sont nécessaires, tel autre se borne à une paire de souliers, tel autre marche gaiement pieds nus, je veux vous parler de ce qui est nécessaire à tous les hommes.
SÉLIM.
Il me semble que Dieu a donné tout ce qu’il fallait à cette espèce ; des yeux pour voir, des pieds pour marcher, une bouche pour manger, un œsophage pour avaler, un estomac pour digérer, une cervelle pour raisonner, des organes pour produire leurs semblables.
OSMIN.
Comment donc arrive-t-il que des hommes [II-78] naissent privés d’une partie de ces choses nécessaires ?
SÉLIM.
C’est que les loix générales de la nature ont amené des accidents qui ont fait naître des monstres ; mais en général l’homme est pourvu de tout ce qu’il lui faut pour vivre en société.
OSMIN.
Y a-t-il des notions communes à tous les hommes qui servent à les faire vivre en société ?
SÉLIM.
Oui, j’ai voyagé avec Paul Lucas, & partout où j’ai passé j’ai vû qu’on respectait son père & sa mère, qu’on se croyait obligé de tenir sa promesse, qu’on avait de la pitié pour les innocens opprimés, qu’on détestait la persécution, qu’on regardait la liberté de penser comme un droit de la nature ; & les ennemis de cette société comme les ennemis du genre humain ; ceux qui pensent différemment m’ont paru des créatures mal organisées, des monstres comme ceux qui sont nés sans yeux, & sans mains.
OSMIN.
Ces choses nécessaires, le sont-elles en tout tems & en tous lieux ?
SÉLIM.
Oui, sans cela elles ne seraient pas nécessaires à l’espèce humaine.
[II-79]
OSMIN.
Ainsi une créance qui est nouvelle n’était pas nécessaire à cette espèce. Les hommes pouvaient très bien vivre en société & remplir leurs devoirs envers Dieu avant de croire que Mahomet avait eu de fréquents entretiens avec l’ange Gabriel.
SÉLIM.
Rien n’est plus évident, il serait ridicule de penser qu’on n’eût pû remplir ses devoirs d’homme avant que Mahomet fût venu au monde, il n’était point du tout nécessaire à l’espèce humaine de croire à l’Alcoran ; le monde allait avant Mahomet tout comme il va aujourd’hui. Si le Mahométisme avait été nécessaire au monde, il aurait existé dès le commencement du monde, il aurait existé en tous lieux ; Dieu qui nous a donné à tous deux yeux pour voir son soleil, nous aurait donné à tous une intelligence pour voir la vérité de la religion musulmane. Cette secte n’est donc que comme les loix positives qui changent selon les tems & selon les lieux, comme les modes, comme les opinions des physiciens qui se succèdent les unes aux autres.
La secte musulmane ne pouvait donc être essentiellement nécessaire à l’homme.
OSMIN.
Mais puisqu’elle existe, Dieu l’a permise ?
SÉLIM.
Oui, comme il permet que le monde soit [II-80] rempli de sottises, d’erreurs & de calamités. Ce n’est pas à dire que les hommes soient tous essentiellement faits pour être sots & malheureux, il permet que quelques hommes soient mangés par les serpens ; mais on ne peut pas dire, Dieu a fait l’homme pour être mangé par des serpens.
OSMIN.
Qu’entendez-vous en disant Dieu permet ? rien peut-il arriver sans ses ordres ? permettre, vouloir, & faire n’est-ce pas pour lui la même chose ?
SÉLIM.
Il permet le crime, mais il ne le fait pas.
OSMIN.
Faire un crime, c’est agir contre la justice divine, c’est désobéïr à Dieu. Or Dieu ne peut désobéïr à lui-même, il ne peut commettre de crime, mais il a fait l’homme de façon que l’homme en commet beaucoup, d’où vient cela ?
SÉLIM.
Il y a des gens qui le savent, mais ce n’est pas moi, tout ce que je sais bien, c’est que l’Alcoran est ridicule ; quoique de tems en tems il y ait d’assez bonnes choses, certainement l’Alcoran n’était point nécessaire à l’homme, je m’en tiens là, je vois clairement ce qui est faux & je connais très peu ce qui est vrai.
[II-81]
OSMIN.
Je croyais que vous m’instruiriez, & vous ne m’apprenez rien.
SÉLIM.
N’est-ce pas beaucoup de connaître les gens qui vous trompent, & les erreurs grossières & dangereuses qu’ils vous débitent ?
OSMIN.
J’aurais à me plaindre d’un médecin qui me ferait une exposition des plantes nuisibles, & qui ne m’en montrerait pas une salutaire.
SÉLIM.
Je ne suis point médecin, & vous n’êtes point malade, mais il me semble que je vous donnerais une fort bonne recette si je vous disais, défiez-vous de toutes les inventions des charlatans ; adorez Dieu ; soyez honnête homme, & croyez que deux & deux font quatre.
[81]
ORGUEIL.↩
Cicéron dans une de ses lettres dit familièrement à son ami, Mandez-moi à qui vous voulez que je fasse donner les Gaules. Dans une autre il se plaint d’être fatigué des lettres de je ne sais quels Princes qui le remercient d’avoir fait ériger leurs provinces en royaumes, & il ajoute qu’il ne sait seulement pas où ces royaumes sont situés.
[82]
Il se peut que Cicéron, qui d’ailleurs avait souvent vu le peuple Romain, ce peuple Roi, lui applaudir & lui obéïr, & qui était remercié par des Rois qu’il ne connaissait pas, ait eu quelques mouvements d’orgueil & de vanité.
Quoique ce sentiment ne soit point du tout convenable à un aussi chétif animal que l’homme, cependant on pourrait le pardonner à un Cicéron, à un César, à un Scipion : mais que dans le fond d’une de nos provinces à demi barbares, un homme qui aura acheté une petite charge, & fait imprimer des vers médiocres, s’avise d’être orgueilleux, il y a là de quoi rire longtems.
[II-82]
PAPISME
(sur le)
DIALOGUE.↩
Le PAPISTE & le TRÉSORIER.
LE PAPISTE.
Monseigneur a dans sa principauté des Luthériens, des Calvinistes, des Quakers, des Anabaptistes, & même des Juifs, & vous voudriez encor qu’il admît des Unitaires.
LE TRÉSORIER.
Si ces Unitaires vous apportent de l’industrie [II-83] & de l’argent, quel mal nous feront-ils ? vous n’en serez que mieux payé de vos gages.
LE PAPISTE.
J’avoue que la soustraction de mes gages me serait plus douloureuse que l’admission de ces messieurs ; mais enfin ils ne croient pas que J. C. soit fils de Dieu.
LE TRÉSORIER.
Que vous importe, pourvu qu’il vous soit permis de le croire, & que vous soyez bien nourri, bien vêtu, bien logé ? Les Juifs sont bien loin de croire qu’il soit fils de Dieu ; & cependant vous êtes fort aise de trouver ici des Juifs, sur qui vous placez votre argent à 6 pour 100. St. Paul lui-même n’a jamais parlé de la divinité de Jésus Christ ; il l’appelle franchement un homme : « la mort, dit-il, a régné par le péché d’un seul homme, les justes régneront par un seul homme qui est Jésus… vous êtes à Jésus & Jésus est à Dieu… Epist. ad Rom… » Tous vos premiers Pères de l’Église ont pensé comme St. Paul ; il est évident que pendant 300 ans, Jésus s’est contenté de son humanité ; figurez-vous que vous êtes un chrétien des trois premiers siècles.
LE PAPISTE.
Mais, monsieur, ils ne croient point à l’éternité des peines.
LE TRÉSORIER.
Ni moi non plus ; soyez damné à jamais [II-84] si vous voulez ; pour moi je ne compte point du tout l’être.
LE PAPISTE.
Ah ! monsieur, il est bien dur de ne pouvoir damner à son plaisir tous les hérétiques de ce monde ; mais la rage qu’ont les Unitaires de rendre un jour les ames heureuses, n’est pas ma seule peine. Vous savez que ces monstres-là ne croient pas plus à la résurrection des corps, que les Saducéens ; ils disent que nous sommes tous Anthropophages ; que les particules qui composaient votre grand-père & votre bisaïeul, ayant été nécessairement dispersées dans l’atmosphère, sont devenues carottes & asperges, & qu’il est impossible que vous n’ayez mangé quelques petits morceaux de vos ancêtres.
LE TRÉSORIER.
Soit ; mes petits-enfans en feront autant de moi, ce ne sera qu’un rendu ; il en arrivera autant aux Papistes. Ce n’est pas une raison pour qu’on vous chasse des États de Monseigneur, ce n’est pas une raison non plus pour qu’il en chasse les Unitaires. Ressuscitez, comme vous pourrez ; il m’importe fort peu que les unitaires ressuscitent ou non, pourvu qu’ils nous soient utiles pendant leur vie.
LE PAPISTE.
Et que direz-vous, monsieur, du péché originel, qu’ils nient effrontément ? N’êtes-vous pas tout scandalisé quand ils assurent que le [II-85] Pentateuque n’en dit pas un mot ; que l’Évêque d’Hyppone, St. Augustin, est le premier qui ait enseigné positivement ce dogme, quoiqu’il soit évidemment indiqué par Saint Paul ?
LE TRÉSORIER.
Ma foi si le Pentateuque n’en a pas parlé, ce n’est pas ma faute ; pourquoi n’ajoutiez-vous pas un petit mot du péché originel dans l’ancien Testament, comme vous y avez, dit-on, ajouté tant d’autres choses ? Je n’entends rien à ces subtilités. Mon métier est de vous payer régulièrement vos gages, quand j’ai de l’argent…
PATRIE.↩
Une patrie est un composé de plusieurs familles ; & comme on soutient communément sa famille par amour-propre, lorsqu’on n’a pas un intérêt contraire, on soutient par le même amour-propre sa ville ou son village qu’on appelle sa patrie.
Plus cette patrie devient grande, moins on l’aime ; car l’amour partagé s’affaiblit. Il est impossible d’aimer tendrement une famille trop nombreuse qu’on connaît à peine.
Celui qui brûle de l’ambition d’être Édile, Tribun, Préteur, Consul, Dictateur, crie qu’il aime sa patrie, & il n’aime que lui-même. Chacun veut être sûr de pouvoir coucher chez soi, sans qu’un autre homme s’arroge le pouvoir de [II-86] l’envoyer coucher ailleurs. Chacun veut être sûr de sa fortune & de sa vie. Tous formant ainsi les mêmes souhaits, il se trouve que l’intérêt particulier devient l’intérêt général : on fait des vœux pour la république, quand on n’en fait que pour soi-même.
Il est impossible qu’il y ait sur la terre un État qui ne se soit gouverné d’abord en république ; c’est la marche naturelle de la nature humaine. Quelques familles s’assemblent d’abord contre les ours & contre les loups : celle qui a des grains en fournit en échange à celle qui n’a que du bois.
Quand nous avons découvert l’Amérique, nous avons trouvé toutes les peuplades divisées en républiques ; il n’y avait que deux royaumes dans toute cette partie du monde. De mille nations nous n’en trouvâmes que deux subjuguées.
Il en était ainsi de l’ancien monde ; tout était république en Europe, avant les roitelets d’Étrurie & de Rome. On voit encor aujourd’hui des républiques en Afrique. Tripoli, Tunis, Alger, vers notre septentrion, sont des républiques de brigands. Les Hottentots vers le midi, vivent encor comme on dit qu’on vivait dans les premiers âges du monde ; libres, égaux entre eux, sans maîtres, sans sujets, sans argent, & presque sans besoins. La chair de leurs moutons les nourrit, leur peau les habille, les huttes de bois & de terre sont leurs retraites : ils sont les plus puants de tous les hommes, mais ils ne le sentent pas ; ils vivent & ils meurent plus doucement que nous.
[II-87]
Il reste dans notre Europe huit Républiques sans Monarques, Venise, la Hollande, la Suisse, Gênes, Luques, Raguse, Genève & St. Marin. On peut regarder la Pologne, la Suède, l’Angleterre, comme des républiques sous un Roi, mais la Pologne est la seule qui en prenne le nom.
Or, maintenant, lequel vaut le mieux que votre patrie soit un État monarchique, ou un État républicain ? il y a quatre mille ans qu’on agite cette question. Demandez la solution aux riches, ils aiment tous mieux l’aristocratie : interrogez le peuple, il veut la démocratie ; il n’y a que les Rois qui préfèrent la royauté. Comment donc est-il possible que presque toute la terre soit gouvernée par des Monarques ? demandez-le aux rats qui proposèrent de pendre une sonnette au cou du chat. Mais en vérité, la véritable raison est, comme on l’a dit, que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes.
Il est triste que souvent pour être bon patriote on soit l’ennemi du reste des hommes. L’ancien Caton, ce bon citoyen, disait toûjours en opinant au sénat, Tel est mon avis, & qu’on ruine Carthage. Être bon patriote, c’est souhaiter que sa ville s’enrichisse par le commerce, & soit puissante par les armes. Il est clair qu’un pays ne peut gagner sans qu’un autre perde, & qu’il ne peut vaincre sans faire des malheureux.
Telle est donc la condition humaine, que souhaiter la grandeur de son pays c’est souhaiter [II-88] du mal à ses voisins. Celui qui voudrait que sa patrie ne fût jamais ni plus grande, ni plus petite, ni plus riche, ni plus pauvre, serait le citoyen de l’univers.
PAUL.↩
Questions sur Paul
Paul était-il citoyen Romain comme il s’en vante ? S’il était de Tarsis en Cilicie, Tarsis ne fut colonie romaine que cent ans après lui ; tous les antiquaires en sont d’accord. S’il était de la petite ville ou bourgade de Giscale, comme St. Jérôme l’a cru, cette ville était dans la Galilée ; & certainement les Galiléens n’étaient pas citoyens Romains.
Est-il vrai que Paul n’entra dans la société naissante des Chrétiens qui étaient alors demi-Juifs, que parce que Gamaliel dont il avait été le disciple lui refusa sa fille en mariage ? Il me semble que cette accusation ne se trouve que dans les actes des Apôtres reçus par les Ébionites, actes rapportés & réfutés par l’évêque Épiphane dans son 30. chap.
Est-il vrai que Ste. Thècle vint trouver St. Paul déguisée en homme ? & les actes de Ste. Thècle sont-ils recevables ? Tertullien dans son livre du baptême chap. 17. tient que cette histoire fut écrite par un prêtre attaché à Paul. Jérôme, Cyprien en réfutant la fable du lion [II-89] baptisé par Ste. Thècle, affirment la vérité de ces actes. C’est là que se trouve un portrait de St. Paul qui est assez singulier ; il était gros, court, large d’épaules ; ses sourcils noirs se joignaient sur son nez aquilin, ses jambes étaient crochues, sa tête chauve, & il était rempli de la grace du Seigneur.
C’est à peu près ainsi qu’il est dépeint dans le Philopatris de Lucien : à la grace du Seigneur près, dont Lucien n’avait malheureusement aucune connaissance.
Peut-on excuser Paul d’avoir repris Pierre qui judaïsait, quand lui-même alla judaïser huit jours dans le temple de Jérusalem ?
Lorsque Paul fut traduit devant le gouverneur de Judée par les Juifs pour avoir introduit des étrangers dans le temple, fit-il bien de dire à ce gouverneur, que c’était pour la résurrection des morts qu’on lui faisait son procès, tandis qu’il ne s’agissait point de la résurrection des morts ? Actes chap. 24.
Paul fit-il bien de circoncire son disciple Timothée, après avoir écrit aux Galates, Si vous vous faites circoncire, Jésus ne vous servira de rien ?
Fit-il bien d’écrire aux Corinthiens (ch. 9) n’avons-nous pas le droit de vivre à vos dépens & de mener avec nous une femme, &c. ? Fit-il bien d’écrire aux Corinthiens dans sa 2e épître ; Je ne pardonnerai à aucun de ceux qui ont péché, ni aux autres ? Que penserait-on aujourd’hui d’un homme qui prétendrait vivre à nos dépens lui & sa femme, nous juger, nous punir, & confondre le coupable & l’innocent ?
[II-90]
Qu’entend-on par le ravissement de Paul au troisième ciel ? qu’est-ce qu’un troisième ciel ?
Quel est enfin le plus vraisemblable (humainement parlant) ou que Paul se soit fait chrétien pour avoir été renversé de son cheval par une grande lumière en plein midi, & qu’une voix céleste lui ait crié, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ou bien que Paul ait été irrité contre les Pharisiens, soit pour le refus de Gamaliel de lui donner sa fille, soit par quelque autre cause ?
Dans toute autre histoire le refus de Gamaliel ne semblerait-il pas plus naturel qu’une voix céleste, si d’ailleurs nous n’étions pas obligés de croire ce miracle ?
Je ne fais aucune de ces questions que pour m’instruire ; & j’exige de quiconque voudra m’instruire qu’il parle raisonnablement.
PÉCHÉ ORIGINEL.↩
C’est ici le prétendu triomphe des Sociniens, ou Unitaires. Ils appellent ce fondement de la Religion Chrétienne le péché originel. C’est outrager Dieu, disent-ils ; c’est l’accuser de la barbarie la plus absurde que d’oser dire qu’il forma toutes les générations des hommes pour les tourmenter par des supplices éternels, sous prétexte que leur premier père mangea d’un fruit dans un jardin. Cette sacrilège imputation est d’autant plus inexcusable [II-91] chez les Chrétiens qu’il n’y a pas un seul mot touchant cette invention du péché originel, ni dans le Pentateuque, ni dans les Prophètes, ni dans les Évangiles, soit apocryphes, soit canoniques, ni dans aucun des écrivains qu’on appelle les premiers pères de l’Église.
Il n’est pas même conté dans la Genèse que Dieu ait condamné Adam à la mort pour avoir avalé une pomme. Il lui dit bien, tu mourras très certainement le jour que tu en mangeras. Mais cette même Genèse fait vivre Adam neuf cent trente ans après ce déjeuner criminel. Les animaux, les plantes, qui n’avaient point mangé de ce fruit moururent dans le tems prescrit par la nature. L’homme est né pour mourir ainsi que tout le reste.
Enfin, la punition d’Adam n’entrait en aucune manière dans la loi juive. Adam n’était pas plus Juif que Persan ou Caldéen. Les premiers chapitres de la Genèse (en quelque tems qu’ils fussent composés) furent regardés par tous les savants Juifs comme une allégorie, & même comme une fable très dangereuse, puisqu’il fut défendu de la lire avant l’âge de vingt-cinq ans.
En un mot, les Juifs ne connurent pas plus le péché originel que les cérémonies chinoises ; & quoique les théologiens trouvent tout ce qu’ils veulent dans l’Écriture ou totidem verbis, ou totidem litteris, on peut assurer qu’un théologien raisonnable n’y trouvera jamais ce mystère surprenant.
Avouons que St. Augustin accrédita le [II-92] premier cette étrange idée, digne de la tête chaude & romanesque d’un Africain débauché & repentant, Manichéen & Chrétien, indulgent & persécuteur, qui passa sa vie à se contredire lui-même.
Quelle horreur, s’écrient les Unitaires rigides, que de calomnier l’auteur de la nature jusqu’à lui imputer des miracles continuels pour damner à jamais des hommes qu’il fait naître pour si peu de tems ! ou il a créé les ames de toute éternité ; & dans ce systême étant infiniment plus anciennes que le péché d’Adam, elles n’ont aucun rapport avec lui ; ou ces ames sont formées à chaque moment qu’un homme couche avec une femme, & en ce cas, Dieu est continuellement à l’affût de tous les rendez-vous de l’univers pour créer des esprits qu’il rendra éternellement malheureux ; ou Dieu est lui-même l’ame de tous les hommes, & dans ce systême il se damne lui-même. Quelle est la plus horrible & la plus folle de ces trois suppositions ? Il n’y en a pas une quatrième ; car l’opinion que Dieu attend six semaines pour créer une ame damnée dans un fœtus, revient à celle qui la fait créer au moment de la copulation. Qu’importe six semaines de plus ou de moins ?
J’ai rapporté le sentiment des Unitaires : & les hommes sont parvenus à un tel point de superstition que j’ai tremblé en le rapportant.
(Cet article est de feu Mr. Boulanger.)
[II-93]
PERSÉCUTION.↩
Ce n’est pas Dioclétien que j’appellerai persécuteur, car il fut dix-huit ans entiers le protecteur des Chrétiens ; & si dans les derniers tems de son Empire il ne les sauva pas des ressentimens de Galérius, il ne fut en cela qu’un Prince séduit & entraîné par la cabale au-delà de son caractère, comme tant d’autres.
Je donnerai encor moins le nom de persécuteurs aux Trajans, aux Antonins, je croirais prononcer un blasphème.
Quel est le persécuteur ? c’est celui dont l’orgueil blessé, & le fanatisme en fureur irritent le Prince, ou les Magistrats contre des hommes innocens, qui n’ont d’autre crime que de n’être pas de son avis. Impudent, tu adores un Dieu, tu prêches la vertu, & tu la pratiques ; tu as servi les hommes, & tu les as consolés ; tu as établi l’orpheline, tu as secouru le pauvre, tu as changé les déserts où quelques esclaves traînaient une vie misérable, en campagnes fertiles peuplées de familles heureuses ; mais j’ai découvert que tu me méprises, & que tu n’as jamais lu mon livre de controverse : tu sais que je suis un fripon, que j’ai contrefait l’écriture de G***, que j’ai volé des **** ; tu pourrais bien le dire, il faut que je te prévienne ; j’irai donc chez le confesseur du premier Ministre ou chez le Podestat. [II-94] Je leur remontrerai en penchant le cou, & en tordant la bouche, que tu as une opinion erronée sur les cellules où furent renfermés les Septante ; que tu parlas même il y a dix ans d’une manière peu respectueuse du chien de Tobie, lequel tu soutenais être un barbet, tandis que je prouvais que c’était un lévrier. Je te dénoncerai comme l’ennemi de Dieu & des hommes. Tel est le langage du persécuteur ; & si ces paroles ne sortent pas précisément de sa bouche, elles sont gravées dans son cœur avec le burin du fanatisme trempé dans le fiel de l’envie.
C’est ainsi que le jésuite le Tellier osa persécuter le Cardinal de Noailles, & que Jurieu persécuta Bayle.
Lorsqu’on commença à persécuter les Protestans en France, ce ne fut ni François I, ni Henri II, ni François II, qui épièrent ces infortunés, qui s’armèrent contre eux d’une fureur réfléchie, & qui les livrèrent aux flammes pour exercer sur eux leurs vengeances. François I était trop occupé avec la duchesse d’Étampes, Henri II avec sa vieille Diane, & François II était trop enfant. Par qui la persécution commença-t-elle ? Par des prêtres jaloux qui armèrent les préjugés des Magistrats, & la politique des Ministres.
Si les Rois n’avaient pas été trompés, s’ils avaient prévu que la persécution produirait cinquante ans de guerres civiles, & que la moitié de la nation serait exterminée mutuellement par l’autre, ils auraient éteint dans leurs [II-95] larmes les premiers bûchers qu’ils laissèrent allumer.
Ô Dieu de miséricorde, si quelque homme peut ressembler à cet être malfaisant qu’on nous peint occupé sans cesse à détruire tes ouvrages, n’est-ce pas le persécuteur ?
PHILOSOPHE.↩
Philosophe, amateur de la sagesse, c’est-à-dire, de la vérité. Tous les philosophes ont eu ce double caractère, il n’en est aucun dans l’antiquité qui n’ait donné des exemples de vertu aux hommes, & des leçons de vérités morales. Ils ont pu se tromper tous sur la physique, mais elle est si peu nécessaire à la conduite de la vie, que les philosophes n’avaient pas besoin d’elle. Il a fallu des siècles pour connaître une partie des loix de la nature. Un jour suffit à un sage pour connaître les devoirs de l’homme.
Le philosophe n’est point entousiaste, il ne s’érige point en prophête, il ne se dit point inspiré des Dieux ; ainsi je ne mettrai au rang des philosophes, ni l’ancien Zoroastre, ni Hermès, ni l’ancien Orphée, ni aucun de ces législateurs dont se vantaient les nations de la Caldée, de la Perse, de la Syrie, de l’Égypte, & de la Grèce. Ceux qui se dirent enfans des dieux étaient les pères de l’imposture, & s’ils se servirent du mensonge pour enseigner des [II-96] vérités, ils étaient indignes de les enseigner ; ils n’étaient pas philosophes : ils étaient tout au plus de très prudens menteurs.
Par quelle fatalité honteuse peut-être pour les peuples occidentaux, faut-il aller au bout de l’Orient pour trouver un sage simple, sans faste, sans imposture, qui enseignait aux hommes à vivre heureux six cents ans avant notre ère vulgaire, dans un tems où tout le Septentrion ignorait l’usage des lettres, & où les Grecs commençaient à peine à se distinguer par la sagesse ? ce sage est Confucius, qui étant législateur ne voulut jamais tromper les hommes. Quelle plus belle règle de conduite a-t-on jamais donnée depuis lui dans la terre entière ?
« Réglez un État comme vous réglez une famille ; on ne peut bien gouverner sa famille qu’en lui donnant l’exemple.
« La vertu doit être commune au laboureur & au Monarque.
« Occupe-toi du soin de prévenir les crimes pour diminuer le soin de les punir.
« Sous les bons rois Yao & Xu les Chinois furent bons ; sous les mauvais rois Kie & Chu ils furent méchants.
« Fais à autrui comme à toi-même.
« Aime les hommes en général, mais chéris les gens de bien. Oublie les injures & jamais les bienfaits.
« J’ai vû des hommes incapables de sciences, je n’en ai jamais vû incapables de vertus. »
Avouons qu’il n’est point de législateur qui ait [II-97] annoncé des vérités plus utiles au genre humain.
Une foule de philosophes Grecs enseigna depuis une morale aussi pure. S’ils s’étaient bornés à leurs vains systêmes de physique, on ne prononcerait aujourd’hui leur nom que pour se moquer d’eux. Si on les respecte encor, c’est qu’ils furent justes, & qu’ils apprirent aux hommes à l’être.
On ne peut lire certains endroits de Platon, & surtout l’admirable exorde des loix de Zaleucus, sans éprouver dans son cœur l’amour des actions honnêtes & généreuses. Les Romains ont leur Cicéron, qui seul vaut peut-être tous les philosophes de la Grèce. Après lui viennent des hommes encor plus respectables, mais qu’on désespère presque d’imiter, c’est Épictète dans l’esclavage, ce sont les Antonins & les Juliens sur le trône.
Quel est le citoyen parmi nous qui se priverait, comme Julien, Antonin, & Marc-Aurèle, de toutes les délicatesses de notre vie molle & efféminée ? qui dormirait comme eux sur la dure ? qui voudrait s’imposer leur frugalité ? qui marcherait comme eux à pied & tête nus à la tête des armées, exposé tantôt à l’ardeur du soleil, tantôt aux frimas ? qui commanderait comme eux à toutes ses passions ? Il y a parmi nous des dévots ; mais où sont les sages ? où sont les ames inébranlables, justes & tolérantes ?
Il y a eu des philosophes de cabinet en France, & tous, excepté Montagne, ont été persécutés. C’est, ce me semble, le dernier degré [II-98] de la malignité de notre nature, de vouloir opprimer ces mêmes philosophes qui la veulent corriger.
Je conçois bien que des fanatiques d’une secte égorgent les entousiastes d’une autre secte, que les Franciscains haïssent les Dominicains, & qu’un mauvais artiste cabale pour perdre celui qui le surpasse ; mais que le sage Charron ait été menacé de perdre la vie, que le savant & généreux Ramus ait été assassiné, que Descartes ait été obligé de fuir en Hollande pour se soustraire à la rage des ignorans, que Gassendi ait été forcé plusieurs fois de se retirer à Digne, loin des calomnies de Paris, c’est là l’opprobre éternel d’une nation.
Un des philosophes les plus persécutés fut l’immortel Bayle, l’honneur de la nature humaine. On me dira que le nom de Jurieu son calomniateur & son persécuteur est devenu exécrable, je l’avoue ; celui du Jésuite le Tellier l’est devenu aussi ; mais de grands hommes qu’il opprimait en ont-ils moins fini leurs jours dans l’exil & dans la disette ?
Un des prétextes dont on se servit pour accabler Bayle, & pour le réduire à la pauvreté, fut son article de David dans son utile dictionnaire. On lui reprochait de n’avoir point donné de louanges à des actions qui en elles-mêmes sont injustes, sanguinaires, atroces, ou contraires à la bonne foi, ou qui font rougir la pudeur.
Bayle, à la vérité, ne loua point David pour avoir ramassé, selon les livres hébreux, six [II-99] cents vagabonds perdus de dettes & de crimes, pour avoir pillé ses compatriotes à la tête de ces bandits, pour être venu dans le dessein d’égorger Nabal & toute sa famille, parce qu’il n’avait pas voulu payer les contributions, pour avoir été vendre ses services au Roi Achis ennemi de sa nation, pour avoir trahi ce Roi Achis son bienfaiteur, pour avoir saccagé les villages alliés de ce Roi Achis, pour avoir massacré dans ces villages jusqu’aux enfans à la mamelle, de peur qu’il ne se trouvât un jour une personne qui pût faire connaître ses déprédations, comme si un enfant à la mamelle aurait pu révéler son crime ; pour avoir fait périr tous les habitans de quelques autres villages sous des scies, sous des herses de fer, sous des cognées de fer, & dans des fours à brique ; pour avoir ravi le trône à Isboseth fils de Saül, par une perfidie ; pour avoir dépouillé & fait périr Miphiboseth petit-fils de Saül & fils de son ami, de son protecteur Jonathas ; pour avoir livré aux Gabaonites deux autres enfans de Saül, & cinq de ses petits-enfans qui moururent à la potence.
Je ne parle pas de la prodigieuse incontinence de David, de ses concubines, de son adultère avec Betzabée & du meurtre d’Urie.
Quoi donc, les ennemis de Bayle auraient-ils voulu que Bayle eût fait l’éloge de toutes ces cruautés & de tous ces crimes ? faudrait-il qu’il eût dit, Princes de la terre, imitez l’homme selon le cœur de Dieu, massacrez sans pitié les alliés de votre bienfaiteur, égorgez, ou faites [II-100] égorger toute la famille de votre roi, couchez avec toutes les femmes quand vous faites répandre le sang des hommes, & vous serez un modèle de vertu quand on dira que vous avez fait des psaumes.
Bayle n’avait-il pas grande raison de dire que si David fut selon le cœur de Dieu, ce fut par sa pénitence, & non par ses forfaits ? Bayle ne rendait-il pas service au genre humain en disant que Dieu qui a sans doute dicté toute l’histoire juive, n’a pas canonisé tous les crimes rapportés dans cette histoire ?
Cependant, Bayle fut persécuté, & par qui ? par des hommes persécutés ailleurs, par des fugitifs qu’on aurait livrés aux flammes dans leur patrie ; & ces fugitifs étaient combattus par d’autres fugitifs appelés Jansénistes, chassés de leur pays par les Jésuites, qui ont enfin été chassés à leur tour.
Ainsi tous les persécuteurs se sont déclaré une guerre mortelle, tandis que le philosophe opprimé par eux tous s’est contenté de les plaindre.
On ne sait pas assez que Fontenelle, en 1713, fut sur le point de perdre ses pensions, sa place & sa liberté, pour avoir rédigé en France vingt ans auparavant, le traité des oracles du savant Van Dale, dont il avait retranché avec précaution tout ce qui pouvait alarmer le fanatisme. Un Jésuite avait écrit contre Fontenelle, il n’avait pas daigné répondre ; & c’en fut assez pour que le Jésuite le Tellier confesseur de Louis XIV, accusât auprès du roi Fontenelle d’athéisme.
[II-101]
Sans Mr. d’Argenson, il arrivait que le digne fils d’un faussaire, procureur de Vire, & reconnu faussaire lui-même, proscrivait la vieillesse du neveu de Corneille.
Il est si aisé de séduire son pénitent, que nous devons bénir Dieu que ce le Tellier n’ait pas fait plus de mal. Il y a deux gîtes dans le monde, où l’on ne peut tenir contre la séduction & la calomnie ; ce sont le lit & le confessionnal.
Nous avons toûjours vû les philosophes persécutés par des fanatiques. Mais est-il possible que les gens de lettres s’en mêlent aussi ? & qu’eux-mêmes ils aiguisent souvent contre leurs frères les armes dont on les perce tous l’un après l’autre ?
Malheureux gens de lettres, est-ce à vous d’être délateurs ? Voyez si jamais chez les Romains il y eut des Garasses, des Chaumeix, des Hayet, qui accusassent les Lucrèces, les Possidonius, les Varrons & les Plines.
Être hypocrite ? quelle bassesse ! mais être hypocrite & méchant, quelle horreur ! il n’y eut jamais d’hypocrites dans l’ancienne Rome, qui nous comptait pour une petite partie de ses sujets. Il y avait des fourbes, je l’avoue, mais non des hypocrites de religion, qui sont l’espèce la plus lâche & la plus cruelle de toutes. Pourquoi n’en voit-on point en Angleterre, & d’où vient y en a-t-il encor en France ? Philosophes, il vous sera aisé de résoudre ce problème.
[II-102]
PIERRE,↩
En italien, Piero, ou Pietro ; en espagnol Pedro ; en latin Petrus ; en grec Petros ; en hébreu Cepha.
Pourquoi les successeurs de Pierre ont-ils eu tant de pouvoir en Occident, & aucun en Orient ? C’est demander pourquoi les évêques de Vurtzbourg & de Saltzbourg se sont attribués les droits régaliens dans des tems d’anarchie, tandis que les Évêques Grecs sont toûjours restés sujets. Le tems, l’occasion, l’ambition des uns, & la faiblesse des autres, ont fait & feront tout dans ce monde.
À cette anarchie l’opinion s’est jointe, & l’opinion est la reine des hommes. Ce n’est pas qu’en effet ils aient une opinion bien déterminée ; mais des mots leur en tiennent lieu.
Il est rapporté dans l’Évangile que Jésus dit à Pierre : « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. » Les partisans de l’Évêque de Rome soutinrent vers le onzième siècle, que qui donne le plus, donne le moins ; que les cieux entouraient la terre ; & que Pierre ayant les clefs du contenant, il avait aussi les clefs du contenu. Si on entend par les cieux toutes les étoiles & toutes les planètes, il est évident, selon Tomasius, que les clefs données à Simon Barjone surnommé Pierre, étaient un passe-partout. Si on entend par les cieux les nuées, [II-103] l’atmosphère, l’éther, l’espace dans lequel roulent les planètes, il n’y a guère de serruriers, selon Mursius, qui puissent faire une clef pour ces portes-là.
Les clefs en Palestine étaient une cheville de bois qu’on liait avec une courroie ; Jésus dit à Barjone : « Ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans le ciel. » Les théologiens du Pape en ont conclu, que les Papes avaient reçu le droit de lier & de délier les peuples du serment de fidélité fait à leurs Rois, & de disposer à leur gré de tous les royaumes. C’est conclure magnifiquement. Les Communes dans les États Généraux de France en 1302, disent dans leur requête au Roi, que
« Boniface VIII était un B***** qui croyait que Dieu liait & emprisonnait au ciel, ce que Boniface liait sur terre ».
Un fameux Luthérien d’Allemagne, (c’était je pense Mélancton) avait beaucoup de peine à digérer que Jésus eût dit à Simon Barjone, Cepha ou Cephas : « Tu es Pierre, & sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, mon Église. » Il ne pouvait concevoir que Dieu eût employé un pareil jeu de mots, une pointe si extraordinaire, & que la puissance du Pape fût fondée sur un quolibet.
Pierre a passé pour avoir été Évêque de Rome ; mais on sait assez qu’en ce tems-là, & longtems après, il n’y eut aucun évêché particulier. La société chrétienne ne prit une forme que vers la fin du second siècle.
Il se peut que Pierre eût fait le voyage de [II-104] Rome ; il se peut même qu’il fût mis en croix la tête en bas, quoique ce ne fût pas l’usage ; mais on n’a aucune preuve de tout cela. Nous avons une lettre sous son nom, dans laquelle il dit qu’il est à Babilone : des Canonistes judicieux ont prétendu que par Babilone on devait entendre Rome. Ainsi supposé qu’il eût daté de Rome, on aurait pu conclure que la lettre avait été écrite à Babilone. On a tiré longtems de pareilles conséquences, & c’est ainsi que le monde a été gouverné.
Il y avait un saint homme à qui on avait fait payer bien chèrement un bénéfice à Rome, ce qui s’appelle une simonie ; on lui demandait, s’il croyait que Simon Pierre eût été au pays ? il répondit, Je ne vois pas que Pierre y ait été, mais je suis sûr de Simon.
Quant à la personne de Pierre, il faut avouer que Paul n’est pas le seul qui ait été scandalisé de sa conduite ; on lui a souvent résisté en face, à lui & à ses successeurs. Ce Paul lui reprochait aigrement de manger des viandes défendues, c’est-à-dire, du porc, du boudin, du lièvre, des anguilles, de l’ixion, & du griffon. Pierre se défendait en disant, qu’il avait vu le ciel ouvert vers la sixième heure, & une grande nappe qui descendait des quatre coins du ciel, laquelle était toute remplie d’anguilles, de quadrupèdes & d’oiseaux ; & que la voix d’un ange avait crié : « Tuez & mangez. » C’est apparemment cette même voix qui a crié à tant de pontifes : « Tuez tout, & mangez la substance du peuple », dit Voloston.
[II-105]
Casaubon ne pouvait approuver la manière dont Pierre traita le bon homme Anania & Saphira sa femme. De quel droit, disait Casaubon, un Juif esclave des Romains ordonnait-il, ou souffrait-il que tous ceux qui croiraient en Jésus vendissent leurs héritages & en apportassent le prix à ses pieds ? Si quelque Anabaptiste à Londres faisait apporter à ses pieds tout l’argent de ses frères, ne serait-il pas arrêté comme un séducteur séditieux, comme un larron qu’on ne manquerait pas d’envoyer à Tyburn ? N’est-il pas horrible de faire mourir Anania, parce qu’ayant vendu son fonds & en ayant donné l’argent à Pierre, il avait retenu pour lui & pour sa femme quelques écus pour subvenir à leurs nécessités sans le dire ? À peine Anania est-il mort, que sa femme arrive. Pierre au lieu de l’avertir charitablement qu’il vient de faire mourir son mari d’apoplexie, pour avoir gardé quelques oboles, & de lui dire de bien prendre garde à elle, la fait tomber dans le piège. Il lui demande si son mari a donné tout son argent aux saints. La bonne femme répond, oui, & elle meurt sur-le-champ. Cela est dur.
Corringius demande, pourquoi Pierre qui tuait ainsi ceux qui lui avaient fait l’aumône, n’allait pas tuer plutôt tous les docteurs qui avaient fait mourir Jésus-Christ, & qui le firent fouetter lui-même plus d’une fois ? Ô Pierre ! vous faites mourir deux chrétiens qui vous ont fait l’aumône, & vous laissez vivre ceux qui ont crucifié votre Dieu !
[II-106]
Apparemment que Corringius n’était pas en pays d’inquisition, quand il faisait ces questions hardies. Érasme, à propos de Pierre, remarquait une chose fort singulière ; c’est que le chef de la Religion Chrétienne commença son apostolat par renier Jésus-Christ ; & que le premier pontife des Juifs avait commencé son ministère par faire un veau d’or, & par l’adorer.
Quoi qu’il en soit, Pierre nous est dépeint comme un pauvre qui catéchisait des pauvres. Il ressemble à ces fondateurs d’ordres, qui vivaient dans l’indigence, & dont les successeurs sont devenus grands seigneurs.
Le Pape successeur de Pierre a tantôt gagné, tantôt perdu ; mais il lui reste encor environ cinquante millions d’hommes sur la terre, soumis en plusieurs points à ses loix, outre ses sujets immédiats.
Se donner un maître à trois ou quatre cents lieuës de chez soi ; attendre pour penser que cet homme ait paru penser ; n’oser juger en dernier ressort un procès entre quelques-uns de ses concitoyens, que par des commissaires nommés par cet étranger ; n’oser se mettre en possession des champs & des vignes qu’on a obtenus de son propre Roi, sans payer une somme considérable à ce maître étranger ; violer les loix de son pays qui défendent d’épouser sa nièce, & l’épouser légitimement en donnant à ce maître étranger une somme encor plus considérable ; n’oser cultiver son champ le jour que cet étranger veut qu’on célèbre la mémoire d’un [II-107] inconnu qu’il a mis dans le ciel de son autorité privée ; c’est là en partie ce que c’est que d’admettre un Pape ; ce sont là les libertés de l’Église Gallicane.
Il y a quelques autres peuples qui portent plus loin leur soumission. Nous avons vu de nos jours un souverain demander au Pape la permission de faire juger par son tribunal royal des moines accusés de parricide, ne pouvoir obtenir cette permission, & n’oser les juger !
On sait assez qu’autrefois les droits des Papes allaient plus loin ; ils étaient fort au-dessus des Dieux de l’antiquité ; car ces Dieux passaient seulement pour disposer des Empires, & les Papes en disposaient en effet.
Sturbinus dit qu’on peut pardonner à ceux qui doutent de la divinité & de l’infaillibilité du Pape, quand on fait réflexion.
Que quarante schismes ont profané la chaire de St. Pierre, & que vingt-sept l’ont ensanglantée ;
Qu’Étienne VII, fils d’un prêtre, déterra le corps de Formose son prédécesseur, & fit trancher la tête à ce cadavre ;
Que Sergius III convaincu d’assassinats, eut un fils de Marozie, lequel hérita de la papauté ;
Que Jean X, amant de Théodora, fut étranglé dans son lit ;
Que Jean XI, fils de Sergius III, ne fut connu que par sa crapule ;
Que Jean XII fut assassiné chez sa maîtresse ;
Que Benoît IX acheta & revendit le Pontificat ;
[II-108]
Que Grégoire VII fut l’auteur de cinq cents ans de guerres civiles soutenues par ses successeurs ;
Qu’enfin parmi tant de Papes, ambitieux, sanguinaires & débauchés, il y a eu un Alexandre VI, dont le nom n’est prononcé qu’avec la même horreur que ceux des Néron & des Caligula.
C’est une preuve, dit-on, de la divinité de leur caractère, qu’elle ait subsisté avec tant de crimes ; mais si les Califes avaient eu une conduite encor plus affreuse, ils auraient donc été encor plus divins. C’est ainsi que raisonne Dermius ; mais les Jésuites lui ont répondu.
PRÉJUGÉS.↩
Le préjugé est une opinion sans jugement. Ainsi dans toute la terre, on inspire aux enfans toutes les opinions qu’on veut, avant qu’ils puissent juger.
Il y a des préjugés universels, nécessaires, & qui sont la vertu même. Par tous pays on apprend aux enfans à reconnaître un Dieu rémunérateur & vengeur ; à respecter, à aimer leur père & leur mère ; à regarder le larcin comme un crime, le mensonge intéressé comme un vice, avant qu’ils puissent deviner ce que c’est qu’un vice & une vertu.
Il y a donc de très bons préjugés : ce sont ceux que le jugement ratifie quand on raisonne.
[II-109]
Sentiment n’est pas simple préjugé ; c’est quelque chose de bien plus fort. Une mère n’aime pas son fils, parce qu’on lui dit qu’il le faut aimer ; elle le chérit heureusement malgré elle. Ce n’est point par préjugé que vous courez au secours d’un enfant inconnu prêt à tomber dans un précipice, ou à être dévoré par une bête.
Mais c’est par préjugé que vous respecterez un homme revêtu de certains habits, marchant gravement, parlant de même. Vos parents vous ont dit que vous deviez vous incliner devant cet homme, vous le respectez avant de savoir s’il mérite vos respects : vous croissez en âge & en connaissances ; vous vous apercevez que cet homme est un charlatan pétri d’orgueil, d’intérêt, & d’artifice ; vous méprisez ce que vous révériez, & le préjugé cède au jugement. Vous avez cru par préjugé les fables dont on a bercé votre enfance ; on vous a dit, que les Titans firent la guerre aux Dieux, & que Vénus fut amoureuse d’Adonis ; vous prenez à douze ans ces fables pour des vérités ; vous les regardez à vingt ans comme des allégories ingénieuses.
Examinons en peu de mots les différentes sortes de préjugés, afin de mettre de l’ordre dans nos affaires. Nous serons peut-être comme ceux qui du tems du systême de Lass s’aperçurent qu’ils avaient calculé des richesses imaginaires.
Préjugés de sens
N’est-ce pas une chose plaisante que nos [II-110] yeux nous trompent toûjours, lors même que nous voyons très bien, & qu’au contraire nos oreilles ne nous trompent pas ? Que votre oreille bien conformée entende, vous êtes belle, je vous aime : il est bien sûr qu’on ne vous a pas dit, je vous hais, vous êtes laide ; mais vous voyez un miroir uni, il est démontré que vous vous trompez, c’est une surface très raboteuse. Vous voyez le soleil d’environ deux pieds de diamètre, il est démontré qu’il est un million de fois plus gros que la terre.
Il semble que Dieu ait mis la vérité dans vos oreilles, & l’erreur dans vos yeux ; mais étudiez l’optique, & vous verrez que Dieu ne vous a pas trompé, & qu’il est impossible que les objets vous paraissent autrement que vous les voyez dans l’état présent des choses.
Préjugés physiques
Le soleil se lève, la lune aussi, la terre est immobile ; ce sont là des préjugés physiques naturels. Mais que les écrevisses soient bonnes pour le sang, parce qu’étant cuites elles sont rouges comme lui ; que les anguilles guérissent la paralysie, parce qu’elles frétillent ; que la lune influe sur nos maladies, parce qu’un jour on observa qu’un malade avait eu un redoublement de fièvre pendant le décours de la lune : ces idées & mille autres ont été des erreurs d’anciens charlatans qui jugèrent sans raisonner, & qui étant trompés trompèrent les autres.
[II-111]
Préjugés historiques
La plûpart des histoires ont été crues sans examen, & cette créance est un préjugé. Fabius Pictor raconte que plusieurs siècles avant lui, une vestale de la ville d’Albe allant puiser de l’eau dans sa cruche, fut violée, qu’elle accoucha de Romulus & de Remus, qu’ils furent nourris par une louve, &c. Le peuple romain crut cette fable ; il n’examina point si dans ce tems-là il y avait des vestales dans le Latium, s’il était vraisemblable que la fille d’un Roi sortît de son couvent avec sa cruche, s’il était probable qu’une louve allaitât deux enfans au lieu de les manger. Le préjugé s’établit.
Un moine écrit que Clovis étant dans un grand danger à la bataille de Tolbiac, fit vœu de se faire chrétien s’il en réchappait ; mais est-il naturel qu’on s’adresse à un Dieu étranger dans une telle occasion ? n’est-ce pas alors que la religion dans laquelle on est né agit le plus puissamment ? Quel est le chrétien qui dans une bataille contre les Turcs ne s’adressera pas plutôt à la Sainte Vierge qu’à Mahomet ? On ajoute qu’un pigeon apporta la sainte ampoule dans son bec pour oindre Clovis, & qu’un ange apporta l’oriflamme pour le conduire ; le préjugé crut toutes les historiettes de ce genre. Ceux qui connaissent la nature humaine savent bien que l’usurpateur Clovis, & l’usurpateur Rolon ou Rol, se firent chrétiens pour gouverner plus sûrement des chrétiens, comme les [II-112] usurpateurs turcs se firent musulmans pour gouverner plus sûrement les musulmans.
Préjugés religieux
Si votre nourrice vous a dit que Cérès préside aux bled, ou que Visnou & Xaca se sont fait hommes plusieurs fois, ou que Sammonocodom est venu couper une forêt, ou qu’Odin vous attend dans sa salle vers le Jutland, ou que Mahomet ou quelque autre a fait un voyage dans le ciel, enfin si votre précepteur vient ensuite enfoncer dans votre cervelle ce que votre nourrice y a gravé, vous en tenez pour votre vie. Votre jugement veut-il s’élever contre ces préjugés ? vos voisins & surtout vos voisines crient à l’impie, & vous effrayent ; votre Derviche craignant de voir diminuer son revenu, vous accuse auprès du Cadi, & ce Cadi vous fait empaler s’il le peut, parce qu’il veut commander à des sots, & qu’il croit que les sots obéissent mieux que les autres ; & cela durera jusqu’à ce que vos voisins & le Derviche & le Cadi commencent à comprendre que la sottise n’est bonne à rien, & que la persécution est abominable.
PRÊTRE.↩
Les prêtres sont dans un État à peu près ce que sont les précepteurs dans les maisons des citoyens, faits pour enseigner, prier, [II-113] donner l’exemple ; ils ne peuvent avoir aucune autorité sur les maîtres de la maison, à moins qu’on ne prouve que celui qui donne des gages doit obéir à celui qui les reçoit.
De toutes les Religions celle qui exclut le plus positivement les prêtres de toute autorité civile, c’est sans contredit celle de Jésus : Rendez à César ce qui est à César. — Il n’y aura parmi vous ni premier ni dernier. — Mon royaume n’est point de ce monde.
Les querelles de l’Empire & du Sacerdoce qui ont ensanglanté l’Europe pendant plus de six siècles, n’ont donc été de la part des prêtres que des rébellions contre Dieu & les hommes, & un péché continuel contre le St. Esprit.
Depuis Calcas qui assassina la fille d’Agamemnon jusqu’à Grégoire XIII & Sixte V, deux Évêques de Rome qui voulurent priver le grand Henri IV du royaume de France, la puissance sacerdotale a été fatale au monde.
Prière n’est pas domination, exhortation n’est pas despotisme. Un bon prêtre doit être le médecin des ames. Si Hippocrate avait ordonné à ses malades de prendre de l’hellébore sous peine d’être pendus, Hippocrate aurait été plus fou & plus barbare que Phalaris, & il aurait eu peu de pratiques. Quand un prêtre dit, Adorez Dieu, soyez juste, indulgent, compatissant, c’est alors un très bon médecin ; quand il dit, Croyez-moi, ou vous serez brûlé, c’est un assassin.
Le Magistrat doit soutenir & contenir le prêtre, comme le père de famille doit donner de [II-114] la considération au précepteur de ses enfans & empêcher qu’il n’en abuse. L’accord du sacerdoce & de l’Empire est le systême le plus monstrueux ; car dès qu’on cherche cet accord, on suppose nécessairement la division ; il faut dire, la protection donnée par l’empire au sacerdoce.
Mais dans les pays où le Sacerdoce a obtenu l’Empire, comme dans Salem, où Melchisédec était prêtre & Roi, comme dans le Japon où le Daïri a été si longtems Empereur, comment faut-il faire ? Je réponds que les successeurs de Melchisédec & des Daïri ont été dépossédés.
Les Turcs sont sages en ce point. Ils font à la vérité le voyage de la Mecque, mais ils ne permettent pas au Shérif de la Mecque d’excommunier le Sultan. Ils ne vont point acheter à la Mecque la permission de ne pas observer le Ramadan, & celle d’épouser leurs cousines ou leurs nièces ; ils ne sont point jugés par des Imans que le Shérif délègue ; ils ne payent point la première année de leur revenu au Shérif. Que de choses à dire sur tout cela ! Lecteur, c’est à vous de les dire vous-même.
PROPHÊTES.↩
Le prophète Jurieu fut sifflé, les prophètes des Cévennes furent pendus ou roués ; les prophètes qui vinrent du Languedoc & du Dauphiné à Londres furent mis au pilori ; les prophètes anabaptistes furent condamnés à divers [II-115] supplices ; le prophète Savonarola fut cuit à Florence ; le prophête Jean-Batiseur ou Batiste eut le cou coupé.
On prétend que Zacharie fut assassiné ; mais heureusement cela n’est pas prouvé. Le prophète Jeddo ou Addo qui fut envoyé à Béthel à condition qu’il ne mangerait ni ne boirait, ayant malheureusement mangé un morceau de pain, fut mangé à son tour par un lion, & on trouva ses os sur le grand chemin entre ce lion & son âne. Jonas fut avalé par un poisson ; il est vrai qu’il ne resta dans son ventre que trois jours & trois nuits ; mais c’est toûjours passer soixante & douze heures fort mal à son aise.
Habacuc fut transporté en l’air par les cheveux à Babilone. Ce n’est pas un grand malheur à la vérité ; mais c’est une voiture fort incommode. On doit beaucoup souffrir quand on est suspendu par les cheveux l’espace de trois cents milles. J’aurais mieux aimé une paire d’ailes, la jument Borack ou l’Hyppogriphe.
Michée, fils de Jemilla, ayant vû le Seigneur assis sur son trône avec l’armée du ciel à droite & à gauche, & le Seigneur ayant demandé quelqu’un pour aller tromper le roi Achab, le diable s’étant présenté au Seigneur, & s’étant chargé de la commission, Michée rendit compte de la part du Seigneur au roi Achab de cette avanture céleste. Il est vrai que pour récompense il ne reçut qu’un énorme soufflet de la main du prophète Sédékia ; il est vrai qu’il ne fut mis dans un cachot que pour quelques jours ; mais enfin il est désagréable pour un [II-116] homme inspiré d’être souffleté & fourré dans un cul de basse-fosse.
On croit que le Roi Amasias fit arracher les dents au prophète Amos pour l’empêcher de parler. Ce n’est pas qu’on ne puisse absolument parler sans dents ; on a vu de vieilles édentées très bavardes ; mais il faut prononcer distinctement une prophétie, & un prophète édenté n’est pas écouté avec le respect qu’on lui doit.
Baruch essuya bien des persécutions. Ézéchiel fut lapidé par les compagnons de son esclavage. On ne sait si Jérémie fut lapidé, ou s’il fut scié en deux.
Pour Isaïe, il passe pour constant qu’il fut scié par ordre de Manassé Roitelet de Juda.
Il faut convenir que c’est un méchant métier que celui de prophête. Pour un seul qui comme Élie va se promener de planètes en planètes dans un beau carrosse de lumière, traîné par quatre chevaux blancs, il y en a cent qui vont à pied, & qui sont obligés d’aller demander leur dîner de porte en porte. Ils ressemblent assez à Homère qui fut obligé, dit-on, de mendier dans les sept villes qui se disputèrent depuis l’honneur de l’avoir vu naître. Ses commentateurs lui ont attribué une infinité d’allégories, auxquelles il n’avait jamais pensé. On a fait souvent le même honneur aux prophêtes. Je ne disconviens pas qu’ils n’ayent été très instruits de l’avenir. Il n’y a qu’à donner à son ame un certain degré d’exaltation, comme l’a très bien imaginé le brave philosophe ou fou de nos jours qui voulait percer un trou [II-117] jusqu’aux aux Antipodes & enduire les malades de poix résine. Les Juifs exaltèrent si bien leur ame qu’ils virent très clairement toutes les choses futures ; mais il est difficile de deviner au juste si par Jérusalem les prophètes entendent toûjours la vie éternelle, si Babilone signifie Londres ou Paris ; si quand ils parlent d’un grand dîner on doit l’expliquer par un jeûne ; si du vin rouge signifie du sang, si un manteau rouge signifie la foi, & un manteau blanc la charité. L’intelligence des prophètes est l’effort de l’esprit humain, c’est pourquoi je n’en dirai pas davantage.
[II-117]
RELIGION.↩
Première question.
L’Évêque de Vorcester, Warburton, auteur d’un des plus savants ouvrages qu’on ait jamais fait, s’exprime ainsi page 8. Tome premier.
« Une religion, une société qui n’est pas fondée sur la créance d’une autre vie, doit être soutenue par une Providence extraordinaire. Le Judaïsme n’est pas fondé sur la créance d’une autre vie ; donc, le Judaïsme a été soutenu par une Providence extraordinaire. »
Plusieurs théologiens se sont élevés contre lui, & comme on rétorque tous les arguments, on a rétorqué le sien, on lui a dit :
[II-118]
« Toute religion qui n’est pas fondée sur le dogme de l’immortalité de l’ame, & sur les peines & les récompenses éternelles, est nécessairement fausse ; or le Judaïsme ne connut point ces dogmes, donc le Judaïsme, loin d’être soutenu par la providence, était par vos principes une Religion fausse & barbare qui attaquait la providence. »
Cet Évêque eut quelques autres adversaires qui lui soutinrent que l’immortalité de l’ame était connue chez les Juifs, dans le tems même de Moïse ; mais il leur prouva très évidemment, que ni le Décalogue, ni le Lévitique, ni le Deutéronome, n’avaient dit un seul mot de cette créance, & qu’il est ridicule de vouloir tordre & corrompre quelques passages des autres livres, pour en tirer une vérité qui n’est point annoncée dans le livre de la loi.
Mr. l’Évêque ayant fait quatre volumes pour démontrer que la loi Judaïque ne proposait ni peines, ni récompenses après la mort, n’a jamais pu répondre à ses adversaires d’une manière bien satisfaisante. Ils lui disaient :
« Ou Moïse connaissait ce dogme, & alors il a trompé les Juifs en ne le manifestant pas ; ou il l’ignorait ; & en ce cas il n’en savait pas assez pour fonder une bonne Religion. En effet si la Religion avait été bonne, pourquoi l’aurait-on abolie ? Une Religion vraie doit être pour tous les tems & pour tous les lieux, elle doit être comme la lumière du soleil, qui éclaire tous les peuples & toutes les générations. »
[II-119]
Ce prélat, tout éclairé qu’il est, a eu beaucoup de peine à se tirer de toutes ces difficultés ; mais quel systême en est exempt ?
Seconde question.
Un autre savant beaucoup plus philosophe, qui est un des plus profonds métaphysiciens de nos jours, donne de fortes raisons pour prouver que le polythéisme a été la première Religion des hommes, & qu’on a commencé à croire plusieurs Dieux, avant que la raison fût assez éclairée pour ne reconnaître qu’un seul Être suprême.
J’ose croire, au contraire, qu’on a commencé d’abord par reconnaître un seul Dieu, & qu’ensuite la faiblesse humaine en a adopté plusieurs, & voici comme je conçois la chose.
Il est indubitable qu’il y eut des bourgades avant qu’on eût bâti de grandes villes, & que tous les hommes ont été divisés en petites républiques, avant qu’ils fussent réunis dans de grands Empires. Il est bien naturel qu’une bourgade effrayée du tonnerre, affligée de la perte de ses moissons, maltraitée par la bourgade voisine, sentant tous les jours sa faiblesse, sentant partout un pouvoir invisible, ait bientôt dit, Il y a quelque être au-dessus de nous qui nous fait du bien & du mal.
Il me paraît impossible qu’elle ait dit : Il y a deux pouvoirs, car pourquoi plusieurs ? On commence en tout genre par le simple, ensuite vient le composé, & souvent enfin on revient au [II-120] simple par des lumières supérieures. Telle est la marche de l’esprit humain.
Quel est cet être qu’on aura d’abord invoqué ? Sera-ce le soleil ? sera-ce la lune ? je ne le crois pas. Examinons ce qui se passe dans les enfans ; ils sont à peu près ce que sont les hommes ignorans. Ils ne sont frappés ni de la beauté, ni de l’utilité de l’astre qui anime la nature, ni des secours que la lune nous prête, ni des variations régulières de son cours ; ils n’y pensent pas ; ils y sont trop accoutumés. On n’adore, on n’invoque, on ne veut apaiser que ce qu’on craint ; tous les enfans voient le ciel avec indifférence ; mais, que le tonnerre gronde, ils tremblent ; ils vont se cacher. Les premiers hommes en ont sans doute agi de même. Il ne peut y avoir que des espèces de philosophes qui aient remarqué le cours des astres, les aient fait admirer, & les aient fait adorer ; mais des cultivateurs simples & sans aucune lumière, n’en savaient pas assez pour embrasser une erreur si noble.
Un village se sera donc borné à dire ; Il y a une puissance qui tonne, qui grêle sur nous, qui fait mourir nos enfans, apaisons-la ; mais comment l’apaiser ? Nous voyons que nous avons calmé par de petits présents la colère des gens irrités, faisons donc de petits présents à cette puissance. Il faut bien aussi lui donner un nom. Le premier qui s’offre est celui de Chef, de Maître, de Seigneur ; cette puissance est donc appelée Monseigneur. C’est probablement la raison pour laquelle les premiers [II-121] Égyptiens appelèrent leur dieu Knef, les Syriens Adoni, les peuples voisins Baal, ou Bel, ou Melch, ou Moloc, les Scythes Papée ; tous mots qui signifient Seigneur, Maître.
C’est ainsi qu’on trouva presque toute l’Amérique partagée en une multitude de petites peuplades, qui toutes avaient leur Dieu protecteur. Les Mexicains même, ni les Péruviens qui étaient de grandes nations, n’avaient qu’un seul Dieu. L’une adorait Mango Kapak, l’autre le Dieu de la guerre. Les Mexicains donnaient à leur Dieu guerrier le nom de Viliputsi, comme les Hébreux avaient appelé leur Seigneur Sabaoth.
Ce n’est point par une raison supérieure & cultivée que tous les peuples ont ainsi commencé à reconnaître une seule divinité ; s’ils avaient été philosophes, ils auraient adoré le Dieu de toute la nature, & non pas le Dieu d’un village ; ils auraient examiné ces rapports infinis de tous les êtres, qui prouvent un Être créateur & conservateur ; mais ils n’examinèrent rien, ils sentirent. C’est là le progrès de notre faible entendement ; chaque bourgade sentait sa faiblesse, & le besoin qu’elle avait d’un fort protecteur. Elle imaginait cet être tutélaire & terrible résidant dans la forêt voisine, ou sur la montagne, ou dans une nuée. Elle n’en imaginait qu’un seul, parce que la bourgade n’avait qu’un chef à la guerre. Elle l’imaginait corporel, parce qu’il était impossible de se le représenter autrement. Elle ne pouvait croire que la bourgade voisine n’eût pas aussi [II-122] son Dieu. Voilà pourquoi Jephté dit aux habitans de Moab ; vous possédez légitimement ce que votre Dieu Chamos vous a fait conquérir, vous devez nous laisser jouïr de ce que notre dieu nous a donné par ses victoires.
Ce discours tenu par un étranger à d’autres étrangers est très remarquable. Les Juifs & les Moabites avaient dépossédé les naturels du pays, l’un & l’autre n’avaient d’autre droit que celui de la force ; & l’un dit à l’autre, Ton Dieu t’a protégé dans ton usurpation, souffre que mon Dieu me protège dans la mienne.
Jérémie & Amos demandent l’un & l’autre ; quelle raison a eu le Dieu Melchom de s’emparer du pays de Gad ? Il paraît évident par ces passages, que l’antiquité attribuait à chaque pays un Dieu protecteur. On trouve encor des traces de cette théologie dans Homère.
Il est bien naturel que l’imagination des hommes s’étant échauffée, & leur esprit ayant acquis des connaissances confuses, ils aient bientôt multiplié leurs Dieux, & assigné des protecteurs aux élémens, aux mers, aux forêts, aux fontaines, aux campagnes. Plus ils auront examiné les astres, plus ils auront été frappés d’admiration. Le moyen de ne pas adorer le soleil, quand on adore la divinité d’un ruisseau ? Dès que le premier pas est fait, la terre est bientôt couverte de Dieux, & on descend enfin des astres aux chats & aux oignons.
Cependant, il faut bien que la raison se perfectionne ; le tems forme enfin des philosophes qui voient que ni les oignons ni les [II-123] chats, ni même les astres, n’ont arrangé l’ordre de la nature. Tous ces philosophes, Babiloniens, Persans, Égyptiens, Scythes, Grecs & Romains admettent un Dieu suprême, rémunérateur & vengeur.
Ils ne le disent pas d’abord aux peuples ; car quiconque eût mal parlé des oignons & des chats devant des vieilles & des prêtres, eût été lapidé. Quiconque eût reproché à certains Égyptiens de manger leurs dieux, eût été mangé lui-même, comme en effet Juvenal rapporte qu’un Égyptien fut tué & mangé tout cru dans une dispute de controverse.
Mais que fit-on ? Orphée & d’autres établissent des mystères que les initiés jurent par des serments exécrables de ne point révéler, & le principal de ces mystères, est l’adoration d’un seul Dieu. Cette grande vérité pénètre dans la moitié de la terre ; le nombre des initiés devient immense ; il est vrai que l’ancienne Religion subsiste toûjours ; mais comme elle n’est point contraire au dogme de l’unité de Dieu, on la laisse subsister. Et pourquoi l’abolirait-on ? Les Romains reconnaissent le Deus optimus maximus ; les Grecs ont leur Zeus, leur Dieu suprême. Toutes les autres divinités ne sont que des êtres intermédiaires ; on place des héros & des Empereurs au rang des Dieux, c’est-à-dire des bienheureux. Mais il est sûr que Claude, Octave, Tibère & Caligula ne sont pas regardés comme les créateurs du ciel & de la terre.
En un mot il paraît prouvé que du tems [II-124] d’Auguste, tous ceux qui avaient une religion, reconnaissaient un Dieu supérieur, éternel, & plusieurs ordres de Dieux secondaires, dont le culte fut appelé depuis Idolâtrie.
Les loix des Juifs n’avaient jamais favorisé l’idolâtrie ; car quoiqu’ils admissent des malachim, des anges, des êtres célestes d’un ordre inférieur, leur loi n’ordonnait point que ces divinités secondaires eussent un culte chez eux. Ils adoraient les anges, il est vrai, c’est-à-dire, ils se prosternaient quand ils en voyaient ; mais comme cela n’arrivait pas souvent, il n’y avait ni de cérémonial, ni de culte légal établi pour eux. Les chérubins de l’arche ne recevaient point d’hommages. Il est constant que les Juifs, du moins depuis Alexandre, adoraient ouvertement un seul Dieu, comme la foule innombrable d’initiés l’adoraient secrettement dans leurs mystères.
Troisième question.
Ce fut dans ce tems où le culte d’un Dieu suprême était universellement établi chez tous les sages en Asie, en Europe, & en Afrique, que la Religion Chrétienne prit naissance.
Le Platonisme aida beaucoup à l’intelligence de ses dogmes. Le Logos qui chez Platon signifiait la sagesse, la raison de l’Être suprême, devint chez nous le Verbe, & une seconde personne de Dieu. Une métaphysique profonde & au-dessus de l’intelligence humaine, fut un sanctuaire inaccessible, dans lequel la religion fut enveloppée.
[II-125]
On ne répétera point ici, comment Marie fut déclarée dans la suite mère de Dieu, comment on établit la consubstantialité du Père & du Verbe, & la procession du Pneuma, organe divin du divin Logos, deux natures & deux volontés résultantes de l’hypostase, & enfin la manducation supérieure, l’ame nourrie ainsi que le corps, des membres & du sang de l’homme, Dieu adoré & mangé sous la forme du pain, présent aux yeux, sensible au goût, & cependant anéanti. Tous les mystères ont été sublimes.
On commença dès le second siècle, par chasser les démons au nom de Jésus ; auparavant on les chassait au nom de Jehovah, ou Yhaho, car St. Matthieu rapporte, que les ennemis de Jésus ayant dit qu’il chassait les démons au nom du prince des démons, il leur répondit, Si c’est par Belzebuth que je chasse les démons, par qui vos enfans les chassent-ils ?
On ne sait point en quel tems les Juifs reconnurent pour prince des démons Belzebuth, qui était un Dieu étranger ; mais on sait, (et c’est Joseph qui nous l’apprend) qu’il y avait à Jérusalem des exorcistes préposés pour chasser les démons des corps des possédés, c’est-à-dire, des hommes attaqués de maladies singulières, qu’on attribuait alors dans une grande partie de la terre à des génies malfaisants.
On chassait donc ces démons avec la véritable prononciation de Jehovah aujourd’hui perdue, & avec d’autres cérémonies aujourd’hui oubliées.
[II-126]
Cet exorcisme par Jehovah ou par les autres noms de Dieu était encor en usage dans les premiers siècles de l’Église. Origène en disputant contre Celse, lui dit, no 262.
« Si en invoquant Dieu, ou en jurant par lui on le nomme le Dieu d’Abraham, d’Isaac & de Jacob, on fera certaines choses par ces noms, dont la nature & la force sont telles, que les démons se soumettent à ceux qui les prononcent ; mais si on le nomme d’un autre nom, comme Dieu de la mer bruïante, supplantateur, ces noms seront sans vertu. Le nom d’Israël traduit en grec ne pourra rien opérer, mais prononcez-le en hébreu, avec les autres mots requis, vous opérerez la conjuration. »
Le même Origène au nombre 19. dit ces paroles remarquables.
« Il y a des noms qui ont naturellement de la vertu, tels que sont ceux dont se servent les sages parmi les Égyptiens, les mages en Perse, les Bracmanes dans l’Inde. Ce qu’on nomme magie n’est pas un art vain & chimérique, ainsi que le prétendent les Stoïciens & les Épicuriens : ni le nom de Sabaoth, ni celui d’Adonaï, n’ont pas été faits pour des êtres créés ; mais ils appartiennent à une théologie mystérieuse qui se rapporte au Créateur ; de là vient la vertu de ces noms quand on les arrange & qu’on les prononce selon les règles, &c. »
Origène en parlant ainsi ne donne point son sentiment particulier, il ne fait que rapporter [II-127] l’opinion universelle. Toutes les Religions alors connues admettaient une espèce de magie ; & on distinguait la magie céleste, & la magie infernale ; la nécromancie & la théurgie ; tout était prodige, divination, oracle. Les Perses ne niaient point les miracles des Égyptiens, ni les Égyptiens ceux des Perses. Dieu permettait que les premiers chrétiens fussent persuadés des oracles attribués aux Sibylles, & leur laissait encor quelques erreurs peu importantes, qui ne corrompaient point le fond de la religion.
Une chose encor fort remarquable, c’est que les chrétiens des deux premiers siècles avaient de l’horreur pour les temples, les autels & les simulacres. C’est ce qu’Origène avoue no 347. Tout changea depuis avec la discipline, quand l’Église reçut une forme constante.
Quatrième question.
Lorsqu’une fois une religion est établie légalement dans un État, les tribunaux sont tous occupés à empêcher qu’on ne renouvelle la plupart des choses qu’on faisait dans cette religion avant qu’elle fût publiquement reçue. Les fondateurs s’assemblaient en secret malgré les magistrats ; on ne permet que les assemblées publiques sous les yeux de la loi, & toutes associations qui se dérobent à la loi sont défendues. L’ancienne maxime était qu’il vaut mieux obéïr à Dieu qu’aux hommes ; la maxime opposée est reçue, que c’est obéir à Dieu que de suivre les [II-128] loix de l’État. On n’entendait parler que d’obsessions & de possessions ; le Diable était alors déchaîné sur la terre : le Diable ne sort plus aujourd’hui de sa demeure ; les prodiges, les prédictions étaient alors nécessaires ; on ne les admet plus. Un homme qui prédirait des calamités dans les places publiques serait mis aux petites maisons. Les fondateurs recevaient secrettement l’argent des fidèles ; un homme qui recueillerait de l’argent pour en disposer sans y être autorisé par la loi, serait repris de justice. Ainsi, on ne se sert plus d’aucun des échafauds qui ont servi à bâtir l’édifice.
Cinquième question.
Après notre sainte Religion, qui sans doute est la seule bonne, quelle serait la moins mauvaise ?
Ne serait-ce pas la plus simple ? Ne serait-ce pas celle qui enseignerait beaucoup de morale & très peu de dogmes ? celle qui tendrait à rendre les hommes justes, sans les rendre absurdes ? celle qui n’ordonnerait point de croire des choses impossibles, contradictoires, injurieuses à la Divinité, & pernicieuses au genre humain, & qui n’oserait point menacer des peines éternelles quiconque aurait le sens commun ? Ne serait-ce point celle qui ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux, & qui n’inonderait pas la terre de sang pour des sophismes inintelligibles ? celle dans laquelle une équivoque, un jeu de mots & deux ou trois [II-129] chartes supposées, ne feraient pas un Souverain & un Dieu, d’un prêtre souvent incestueux, homicide & empoisonneur ? celle qui ne soumettrait pas les Rois à ce prêtre ? celle qui n’enseignerait que l’adoration d’un Dieu, la justice, la tolérance & l’humanité ?
Sixième question.
On a dit que la religion des Gentils était absurde en plusieurs points, contradictoire, pernicieuse ; mais ne lui a-t-on pas imputé plus de mal qu’elle n’en a fait, & plus de sottises qu’elle n’en a prêchées ?
Car de voir Jupiter taureau,
Serpent, cigne, ou quelque autre chose,
Je ne trouve point cela beau,
Et ne m’étonne pas, si parfois on en cause.
Prologue d’Amphitrion.
Sans doute cela est fort impertinent ; mais qu’on me montre dans toute l’antiquité un temple dédié à Léda couchant avec un cigne ou avec un taureau ? Y a-t-il eu un sermon prêché dans Athènes ou dans Rome pour encourager les filles à faire des enfans avec les cignes de leur basse-cour ? Les fables recueillies & ornées par Ovide sont-elles la religion ? ne ressemblent-elles pas à notre légende dorée, à notre fleur des saints ? Si quelque brame ou quelque derviche venait nous objecter l’histoire de Ste. [II-130] Marie Égyptienne, laquelle n’ayant pas de quoi payer les matelots qui l’avaient conduite en Égypte, donna à chacun d’eux ce que l’on appelle des faveurs, en guise de monnaie, nous dirions au brame, Mon révérend père, vous vous trompez, notre religion n’est pas la légende dorée.
Nous reprochons aux anciens leurs oracles, leurs prodiges : s’ils revenaient au monde & qu’on pût compter les miracles de Notre-Dame de Lorette, & ceux de Notre-Dame d’Éphèse, en faveur de qui des deux serait la balance du compte ?
Les sacrifices humains ont été établis chez presque tous les peuples, mais très rarement mis en usage. Nous n’avons que la fille de Jephté, & le roi Agag d’immolés chez les Juifs ; car Isaac & Jonathas ne le furent pas. L’histoire d’Iphigénie n’est pas bien avérée chez les Grecs. Les sacrifices humains sont très rares chez les anciens Romains ; en un mot, la religion payenne a fait répandre très peu de sang, & la nôtre en a couvert la terre. La nôtre est sans doute la seule bonne, la seule vraie ; mais nous avons fait tant de mal par son moyen, que quand nous parlons des autres, nous devons être modestes.
Septième question.
Si un homme veut persuader sa religion à des étrangers, ou à ses compatriotes, ne doit-il pas s’y prendre avec la plus insinuante douceur, [II-131] & la modération la plus engageante ? S’il commence par dire que ce qu’il annonce est démontré, il trouvera une foule d’incrédules ; s’il ose leur dire, qu’ils ne rejettent sa doctrine, qu’autant qu’elle condamne leurs passions, que leur cœur a corrompu leur esprit, qu’ils n’ont qu’une raison fausse & orgueilleuse ; il les révolte, il les anime contre lui, il ruine lui-même ce qu’il veut établir.
Si la religion qu’il annonce est vraie, l’emportement & l’insolence la rendront-ils plus vraie ? Vous mettez-vous en colère, quand vous dites qu’il faut être doux, patient, bienfaisant, juste, remplir tous les devoirs de la société ? Non, car tout le monde est de votre avis ; pourquoi donc dites-vous des injures à votre frère, quand vous lui prêchez une métaphysique mystérieuse ? C’est que son sens irrite votre amour-propre. Vous avez l’orgueil d’exiger que votre frère soumette son intelligence à la vôtre : l’orgueil humilié produit la colère ; elle n’a point d’autre source. Un homme blessé de vingt coups de fusil dans une bataille, ne se met point en colère ; mais un docteur blessé du refus d’un suffrage devient furieux & implacable.
Huitième question.
Ne faut-il pas soigneusement distinguer la religion de l’État & la religion théologique ? Celle de l’État exige que les imans tiennent des registres des circoncis, les curés ou pasteurs des registres des batisés, qu’il y ait des [II-132] mosquées, des églises, des temples, des jours consacrés à l’adoration & au repos, des rites établis par la loi ; que les ministres de ces rites ayent de la considération sans pouvoir ; qu’ils enseignent les bonnes mœurs au peuple, & que les ministres de la loi veillent sur les mœurs des ministres des temples. Cette religion de l’État ne peut en aucun tems causer aucun trouble.
Il n’en est pas ainsi de la religion théologique ; celle-ci est la source de toutes les sottises, & de tous les troubles imaginables ; c’est la mère du fanatisme & de la discorde civile, c’est l’ennemie du genre humain. Un bonze prétend que Fo est un Dieu, qu’il a été prédit par des faquirs, qu’il est né d’un éléphant blanc, que chaque bonze peut faire un Fo avec des grimaces. Un Talapoin dit que Fo était un saint homme, dont les bonzes ont corrompu la doctrine, & que c’est Sammonocodom qui est le vrai Dieu. Après cent argumens & cent démentis, les deux factions conviennent de s’en rapporter au Dalay-Lama qui demeure à trois cents lieuës de là, qui est immortel & même infaillible. Les deux factions lui envoient une députation solennelle. Le Dalay-Lama commence, selon son divin usage, par leur distribuer sa chaise percée.
Les deux sectes rivales la reçoivent d’abord avec un respect égal, la font sécher au soleil, & l’enchâssent dans de petits chapelets qu’ils baisent dévotement. Mais dès que le Dalay-Lama & son conseil ont prononcé au nom de [II-133] Fo, voilà le parti condamné qui jette les chapelets au nez du vice-Dieu, & qui lui veut donner cent coups d’étrivières. L’autre parti défend son Lama dont il a reçu de bonnes terres ; tous deux se battent longtems ; & quand ils sont las de s’exterminer, de s’assassiner, de s’empoisonner réciproquement, ils se disent encor de grosses injures ; & le Dalay-Lama en rit, & il distribue encor sa chaise percée à quiconque veut bien recevoir les déjections du bon père Lama.
RÉSURRECTION.↩
On conte que les Égyptiens n’avaient bâti leurs pyramides que pour en faire des tombeaux, & que leurs corps embaumés par dedans & par dehors, attendaient que leurs ames vinssent les ranimer au bout de mille ans. Mais si leurs corps devaient ressusciter, pourquoi la première opération des parfumeurs était-elle de leur percer le crâne avec un crochet, & d’en tirer la cervelle ? L’idée de ressusciter sans cervelle, fait soupçonner (si on peut user de ce mot) que les Égyptiens n’en avaient guère de leur vivant : mais il faut considérer que la plupart des anciens croyaient que l’ame est dans la poitrine. Et pourquoi l’ame est-elle dans la poitrine plutôt qu’ailleurs ? C’est qu’en effet dans tous nos sentimens un peu violents, on éprouve vers la région du cœur, une [II-134] dilatation ou un resserrement, qui a fait penser que c’était là le logement de l’ame. Cette ame était quelque chose d’aérien, c’était une figure légère qui se promenait où elle pouvait, jusqu’à ce qu’elle eût retrouvé son corps.
La croyance de la résurrection est beaucoup plus ancienne que les tems historiques. Athalide fils de Mercure pouvait mourir & ressusciter à son gré ; Esculape rendit la vie à Hippolite ; Hercule à Alceste. Pelops ayant été haché en morceaux par son père, fut ressuscité par les dieux. Platon raconte qu’Hères ressuscita pour quinze jours seulement.
Les Pharisiens, chez les Juifs, n’adoptèrent le dogme de la résurrection que très longtems après Platon.
Il y a dans les Actes des apôtres un fait bien singulier, & bien digne d’attention. St. Jaques, & plusieurs de ses compagnons conseillent à St. Paul d’aller dans le temple de Jérusalem, observer toutes les cérémonies de l’ancienne loi, tout chrétien qu’il était, afin que tous sachent, disent-ils, que tout ce qu’on dit de vous est faux, & que vous continuez de garder la loi de Moïse. C’est dire bien clairement, Allez mentir, allez vous parjurer, allez renier publiquement la religion que vous enseignez.
St. Paul alla donc pendant sept jours dans le temple, mais le septième il fut reconnu. On l’accusa d’y être venu avec des étrangers, & de l’avoir profané. Voici comment il se tira d’affaire.
Or Paul sachant qu’une partie de ceux qui étaient [II-135] là, étaient saducéens, & l’autre Pharisiens, il s’écria dans l’assemblée : Mes frères, je suis Pharisien & fils de Pharisien ; c’est à cause de l’espérance d’une autre vie, & de la résurrection des morts que l’on veut me condamner [[28]]. Il n’avait point du tout été question de la résurrection des morts dans toute cette affaire ; Paul ne le disait que pour animer les Pharisiens & les Saducéens les uns contre les autres.
V. 7. Paul ayant parlé de la sorte, il s’émut une dissension entre les pharisiens & les saducéens ; & l’assemblée fut divisée.
V. 8. Car les Saducéens disent qu’il n’y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, au lieu que les pharisiens reconnaissent & l’un & l’autre, &c.
On a prétendu que Job, qui est très ancien, connaissait le dogme de la résurrection. On cite ces paroles : Je sais que mon rédempteur est vivant, & qu’un jour sa rédemption s’élèvera sur moi, ou que je me relèverai de la poussière, que ma peau reviendra, que je verrai encor Dieu dans ma chair.
Mais plusieurs commentateurs entendent par ces paroles, que Job espère qu’il relèvera bientôt de maladie, & qu’il ne demeurera pas toûjours couché sur la terre, comme il l’était. La suite prouve assez que cette explication est la véritable ; car il s’écrie le moment d’après à ses faux & durs amis ; Pourquoi donc dites-vous, Persécutons-le, ou bien, parce que vous direz, parce que nous l’avons persécuté. Cela ne veut-il pas dire [II-136] évidemment, Vous vous repentirez de m’avoir offensé, quand vous me reverrez dans mon premier état de santé & d’opulence ? Un malade qui dit, Je me lèverai, ne dit pas, Je ressusciterai. Donner des sens forcés à des passages clairs, c’est le sûr moyen de ne jamais s’entendre, ou plutôt d’être regardés comme des gens de mauvaise foi par les honnêtes gens.
St. Jérôme ne place la naissance de la secte des Pharisiens que très peu de tems avant Jésus-Christ. Le rabbin Hillel passe pour le fondateur de la secte Pharisienne ; & cet Hillel était contemporain de Gamaliel le maître de St. Paul.
Plusieurs de ces Pharisiens croyaient que ces Juifs seuls ressusciteraient, & que le reste des hommes n’en valait pas la peine. D’autres ont soutenu qu’on ne ressusciterait que dans la Palestine, & que les corps de ceux qui auront été enterrés ailleurs, seront secrettement transportés auprès de Jérusalem pour s’y rejoindre à leur âme. Mais St. Paul écrivant aux habitans de Thessalonique, leur dit, que le second avènement de Jésus-Christ est pour eux & pour lui, qu’ils en seront témoins.
V. 16. Car aussi-tôt que le signal aura été donné par l’archange, & par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, & ceux qui seront morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers.
V. 17. Puis nous autres qui sommes vivans, & qui serons demeurés jusqu’alors, nous serons emportés avec eux dans les nuées pour aller au [II-137] devant du Seigneur au milieu de l’air, & ainsi nous vivrons pour jamais avec le Seigneur. [[29]]
Ce passage important ne prouve-t-il pas évidemment que les premiers chrétiens comptaient voir la fin du monde, comme en effet elle est prédite dans St. Luc, pour le tems même que St. Luc vivait ? S’ils ne virent point cette fin du monde, si personne ne ressuscita pour lors, ce qui est différé n’est pas perdu.
St. Augustin croit que les enfans, & même les enfans morts nés, ressusciteront dans l’âge de la maturité. Les Origènes, les Jérômes, les Athanases, les Basiles, n’ont pas crû que les femmes dussent ressusciter avec leur sexe.
Enfin, on a toûjours disputé sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes, & sur ce que nous serons.
RÉSURRECTION.↩
Section Seconde.
Le père Mallebranche prouve la résurrection par les chenilles qui deviennent papillons. Cette preuve, comme on voit, est aussi légère que les ailes des insectes dont il l’emprunte. Des penseurs qui calculent, font des objections arithmétiques contre cette vérité si bien prouvée. Ils disent que les hommes & les autres animaux sont réellement nourris & reçoivent [II-138] leur croissance de la substance de leurs prédécesseurs. Le corps d’un homme réduit en poussière, répandu dans l’air & retombant sur la surface de la terre devient légume, ou froment. Ainsi Caïn mangea une partie d’Adam ; Énoch se nourrit de Caïn, Irad d’Énoch, Maviael de Srad, Mathusalem de Maviael, & il se trouve qu’il n’y a aucun de nous qui n’ait avalé une petite portion de notre premier père. C’est pourquoi on a dit que nous étions tous anthropophages. Rien n’est plus sensible après une bataille ; non seulement nous tuons nos frères ; mais au bout de deux ou trois ans, nous les avons tous mangés quand on a fait les moissons sur le champ de bataille ; nous serons aussi mangés sans difficulté à notre tour. Or, quand il faudra ressusciter, comment rendrons-nous à chacun le corps qui lui appartenait sans perdre du nôtre ?
Voilà ce que disent ceux qui se défient de la résurrection, mais les ressusciteurs leur ont répondu très pertinemment.
Un rabbin nommé Samaï démontre la résurrection par ce passage de l’Exode, J’ai apparu à Abraham, à Isaac & à Jacob ; & je leur ai promis avec serment de leur donner la terre de Canaan. Or, Dieu, malgré son serment, dit ce grand rabbin, ne leur donna point cette terre ; donc ils ressusciteront pour en jouïr, afin que le serment soit accompli.
Le profond philosophe Dom Calmet trouve dans les Vampires une preuve bien plus concluante. Il a vu de ces Vampires qui sortaient [II-139] des cimetières pour aller sucer le sang des gens endormis ; il est clair qu’ils ne pouvaient sucer le sang des vivans s’ils étaient encor morts ; donc ils étaient ressuscités ; cela est péremptoire.
Une chose encor certaine, c’est que tous les morts, au jour du jugement, marcheront sous la terre comme des taupes, à ce que dit le Talmud, pour aller comparaître dans la vallée de Josaphat qui est entre la ville de Jérusalem & le mont des Oliviers. On sera fort pressé dans cette vallée, mais il n’y a qu’à réduire les corps proportionnellement comme les diables de Milton dans la salle du Pandémonium.
Cette résurrection se fera au son de la trompette, à ce que dit St. Paul. Il faudra nécessairement qu’il y ait plusieurs trompettes, car le tonnerre lui-même ne s’entend guère plus de trois ou quatre lieues à la ronde. On demande combien il y aura de trompettes, les théologiens n’ont pas encor fait ce calcul ; mais ils le feront.
Les Juifs disent que la Reine Cléopatre, qui sans doute croyait la résurrection comme toutes les Dames de ce tems-là, demanda à un Pharisien si on ressusciterait tout nu. Le docteur lui répondit qu’on serait très bien habillé, par la raison que le bled qu’on sème étant mort en terre, ressuscite en épi avec une robe & des barbes. Ce rabbin était un théologien excellent. Il raisonnait comme Dom Calmet.
[II-140]
SALOMON.↩
Le nom de Salomon a toûjours été révéré dans l’Orient. Les ouvrages qu’on croit de lui, les annales des Juifs, les fables des Arabes ont porté sa renommée jusqu’aux Indes. Son règne est la grande époque des Hébreux.
Il était le troisième Roi de la Palestine. Le premier livre des Rois dit que sa mère Betzabée obtint de David qu’il fît couronner Salomon son fils au lieu de son aîné Adonias. Il n’est pas surprenant qu’une femme complice de la mort de son premier mari, ait eu assez d’artifice pour faire donner l’héritage au fruit de son adultère, & pour faire déshériter le fils légitime, qui de plus était l’aîné.
C’est une chose très remarquable que le prophète Nathan qui était venu reprocher à David son adultère, le meurtre d’Urie, le mariage qui suivit ce meurtre, fût le même qui depuis seconda Betzabée pour mettre sur le trône Salomon né de ce mariage sanguinaire & infâme. Cette conduite, à ne raisonner que selon la chair, prouverait que ce prophète Nathan avait, selon les tems, deux poids & deux mesures. Le livre même ne dit pas que Nathan reçût une mission particulière de Dieu, pour faire déshériter Adonias. S’il en eut une, il faut la respecter. Mais nous ne pouvons admettre que ce que nous trouvons écrit.
Adonias, exclu du trône par Salomon, lui [II-141] demanda pour toute grace, qu’il lui permît d’épouser Abisag, cette jeune fille qu’on avait donnée à David pour le réchauffer dans sa vieillesse.
L’Écriture ne dit point si Salomon disputait à Adonias la concubine de son père ; mais elle dit que Salomon, sur cette seule demande, le fit assassiner. Apparemment que Dieu, qui lui donna l’esprit de sagesse, lui refusa alors celui de justice & d’humanité, comme il lui refusa depuis le don de la continence.
Il est dit dans le même livre des Rois, qu’il était maître d’un grand royaume, qui s’étendait de l’Euphrate à la mer Rouge & à la Méditerranée ; mais malheureusement il est dit en même tems que le Roi d’Égypte avait conquis le pays de Gazer dans le Canaan, & qu’il donna pour dot la ville de Gazer à sa fille, qu’on prétend que Salomon épousa ; il est dit qu’il y avait un Roi à Damas. Les royaumes de Sidon & de Tyr florissaient. Entouré d’États puissants, il manifesta sans doute sa sagesse, en demeurant en paix avec eux tous. L’abondance extrême qui enrichit son pays ne pouvait être que le fruit de cette sagesse profonde, puisque du tems de Saül il n’y avait pas un ouvrier en fer dans son pays, & qu’on ne trouva que deux épées quand il fallut que Saül fît la guerre aux Philistins, auxquels les Juifs étaient soumis.
Saül, qui ne possédait d’abord dans ses États que deux épées, eut bientôt une armée de trois cent trente mille hommes. Jamais le [II-142] Sultan des Turcs n’a eu de si nombreuses armées ; il y avait là de quoi conquérir la terre. Ces contradictions semblent exclure tout raisonnement : mais ceux qui veulent raisonner trouvent difficile que David qui succède à Saül vaincu par les Philistins, ait pû pendant son administration fonder un vaste empire.
Les richesses qu’il laissa à Salomon sont encor plus incroyables : il lui donna comptant cent trois mille talents d’or, & un million treize mille talents d’argent. Le talent d’or des Hébreux vaut environ six mille livres sterling ; le talent d’argent environ cinq cents livres sterling. La somme totale du legs en argent comptant, sans les pierreries & les autres effets, & sans le revenu ordinaire proportionné sans doute à ce trésor, montait à un milliard cent dix-neuf millions cinq cent mille livres sterling, ou à cinq milliards cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions d’écus d’Allemagne, ou à vingt-cinq milliards six cent quarante-huit millions de France : il n’y avait pas alors autant d’espèces circulantes dans le monde entier.
On ne voit pas après cela pourquoi Salomon se tourmentait tant à envoyer ses flottes au pays d’Ophir pour rapporter de l’or. On devine encor moins comment ce puissant Monarque n’avait pas dans ses vastes États un seul homme qui sût couper du bois dans la forêt du Liban. Il fut obligé de prier Hiram roi de Tyr de lui prêter des fendeurs de bois & des ouvriers pour le mettre en ouvre. Il faut avouer que [II-143] ces contradictions exercent le génie des commentateurs.
On servait par jour pour le dîner & le souper de sa maison cinquante bœufs & cent moutons, & de la volaille & du gibier à proportion ; ce qui peut aller par jour à soixante mille livres pesant de viande. Cela fait une bonne maison. On ajoute qu’il avait quarante mille écuries & autant de remises pour ses chariots de guerre, mais seulement douze mille écuries pour sa cavalerie. Voilà bien des chariots pour un pays de montagnes, & c’était un grand appareil pour un Roi dont le prédécesseur n’avait eu qu’une mule à son couronnement, & pour un terrain qui ne nourrit que des ânes.
On n’a pas voulu qu’un Prince qui avait tant de chariots se bornât à un petit nombre de femmes ; on lui en donne sept cents, qui portaient le nom de Reines ; & ce qui est étrange, c’est qu’il n’avait que trois cents concubines, contre la coutume des Rois, qui ont d’ordinaire plus de maîtresses que de femmes. Il entretenait quatre cent douze mille chevaux, sans doute pour aller se promener avec elles le long du lac de Genézareth, ou vers celui de Sodome, ou vers le torrent de Cédron, qui serait un des endroits les plus délicieux de la terre, si ce torrent n’était pas à sec neuf mois de l’année, & si le terrain n’était pas un peu pierreux.
Quant au temple qu’il fit bâtir, & que les Juifs ont cru le plus bel ouvrage de [II-144] l’Univers, si les Bramantes, les Michel Anges & les Palladio avaient vû ce bâtiment, ils ne l’auraient pas admiré ; c’était une espèce de petite forteresse quarrée, qui renfermait une cour, & dans cette cour un édifice de quarante coudées de long, & un autre de vingt ; & il est dit seulement que ce second édifice, qui était proprement le temple, l’oracle, le saint des saints, avait vingt coudées de large comme de long, & vingt de haut. Il n’y a point d’architecte en Europe, qui ne regardât un tel bâtiment comme un monument de barbares.
Les livres attribués à Salomon, ont duré plus que son temple. C’est peut-être une des grandes preuves de la force des préjugés & de la faiblesse de l’esprit humain.
Le nom seul de l’auteur a rendu ces livres respectables : on les a crus bons parce qu’on les a crus d’un Roi, & que ce Roi passait pour le plus sage des hommes.
Le premier ouvrage qu’on lui attribue, est celui des Proverbes. C’est un recueil de maximes triviales, basses, incohérentes, sans goût, sans choix & sans dessein. Peut-on se persuader qu’un Roi éclairé ait composé un recueil de sentences dans lesquelles on n’en trouve pas une seule qui regarde la manière de gouverner ; la politique, les mœurs des courtisans, les usages de la cour ?
On y voit des chapitres entiers où il n’est parlé que de gueuses, qui vont inviter les passants dans les ruës à coucher avec elles.
[II-145]
Qu’on prenne au hasard quelques-uns de ces proverbes.
Il y a trois choses insatiables, & une quatrième qui ne dit jamais, c’est assez ; le sépulcre, la matrice, la terre, qui n’est jamais rassasiée d’eau ; & le feu, qui est la quatrième, ne dit jamais, c’est assez.
Il y a trois choses difficiles, & j’ignore entièrement la quatrième. La voye d’un aigle dans l’air, la voye d’un serpent sur la pierre, la voye d’un vaisseau sur la mer, & la voye d’un homme dans une femme.
Il y a quatre choses qui sont les plus petites de la terre, & qui sont plus sages que les sages ; les fourmis, petit peuple qui se prépare une nourriture pendant la moisson ; le lièvre, peuple faible qui couche sur des pierres ; la sauterelle, qui n’ayant pas de Rois, voyage par troupes ; le lézard, qui travaille de ses mains & qui demeure dans les palais des Rois.
Est-ce à un grand roi, au plus sage des mortels qu’on ose imputer des niaiseries si basses & si absurdes ? Ceux qui le font auteur de ces plates puérilités, & qui croient les admirer, ne sont pas assurément les plus sages des hommes.
Les Proverbes ont été attribués à Isaïe, à Elzia, à Sobna, à Éliacin, à Joaké, & à plusieurs autres. Mais qui que ce soit qui ait compilé ce recueil de sentences orientales, il n’y a pas d’apparence que ce soit un Roi qui s’en soit donné la peine. Aurait-il dit, que la terreur du Roi est comme le rugissement du lion ? [II-146] C’est ainsi que parle un sujet ou un esclave, que la colère de son maître fait trembler. Salomon aurait-il tant parlé de la femme impudique ? Aurait-il dit, ne regardez point le vin quand il paraît clair, & que sa couleur brille dans le verre ?
Je doute fort qu’on ait eu des verres à boire du tems de Salomon ; c’est une invention fort récente ; toute l’antiquité buvait dans des tasses de bois ou de métal ; & ce seul passage indique que cette rhapsodie juive fut composée dans Alexandrie, ainsi que tant d’autres livres juifs. [[30]]
L’Ecclésiaste, que l’on met sur le compte de Salomon, est d’un ordre & d’un goût tout différent. Celui qui parle dans cet ouvrage est un homme détrompé des illusions de la grandeur, lassé de plaisirs, & dégoûté de la science. C’est un philosophe Épicurien, qui répète à chaque page que le juste & l’impie sont sujets aux mêmes accidens, que l’homme n’a rien de plus que la bête, qu’il vaut mieux n’être pas né que d’exister, qu’il n’y a point d’autre vie, & qu’il n’y a rien de bon & de raisonnable que de jouïr en paix du fruit de ses travaux avec la femme qu’on aime.
Tout l’ouvrage est d’un matérialiste qui est à la fois sensuel & dégoûté. Il semble seulement [II-147] qu’on ait mis au dernier verset un mot édifiant sur Dieu, pour diminuer le scandale qu’un tel livre devait causer.
Les critiques auront de la peine à se persuader que ce livre soit de Salomon. Il n’est pas naturel qu’il ait dit : malheur à la terre qui a un Roi enfant. Les Juifs n’avaient point eu encor de tels Rois.
Il n’est pas naturel qu’il ait dit, j’observe le visage du Roi. Il est bien plus vraisemblable que l’auteur a voulu faire parler Salomon, & que par cette aliénation d’esprit dont tous les ouvrages des Juifs sont remplis, il a oublié souvent dans le corps du livre que c’était un Roi qu’il faisait parler.
Ce qui est toûjours surprenant, c’est que l’on ait consacré cet ouvrage impie parmi les livres canoniques. S’il fallait établir aujourd’hui le canon de la Bible, on n’y mettrait certainement pas l’Ecclésiaste ; mais il fut inséré dans un tems où les livres étaient très rares, où ils étaient plus admirés que lus. Tout ce qu’on peut faire aujourd’hui, c’est de pallier autant qu’il est possible l’Épicuréisme qui règne dans cet ouvrage. On a fait pour l’Ecclésiaste comme pour tant d’autres choses qui révoltent bien autrement. Elles furent établies dans des tems d’ignorance ; & on est forcé, à la honte de la raison, de les soutenir dans des tems éclairés, & d’en déguiser ou l’absurdité ou l’horreur par des allégories.
Le Cantique des Cantiques est encor attribué à Salomon, parce que le nom de roi s’y [II-148] trouve en deux ou trois endroits, parce qu’on fait dire à l’amante, qu’elle est belle comme les peaux de Salomon, parce que l’amante dit qu’elle est noire, & qu’on a cru que Salomon désignait par là sa femme Égyptienne.
Ces trois raisons sont également ridicules :
1.o Quand l’amante, en parlant à son amant, dit : le Roi m’a menée dans ses celliers, elle parle visiblement d’un autre que de son amant : donc le Roi n’est pas cet amant : c’est le Roi du festin, c’est le paranimphe, c’est le maître de la maison qu’elle entend : & cette Juive est si loin d’être la maîtresse d’un Roi, que dans tout le cours de l’ouvrage c’est une bergère, une fille des champs qui va chercher son amant à la campagne & dans les ruës de la ville, & qui est arrêtée aux portes par les gardes qui lui volent sa robe.
2.o Je suis belle comme les peaux de Salomon, est l’expression d’une villageoise qui dirait, Je suis belle comme les tapisseries du Roi : & c’est précisément parce que le nom de Salomon se trouve dans cet ouvrage qu’il ne saurait être de lui. Quel monarque ferait une comparaison si ridicule ? Voyez, dit l’amante au 3e chapitre, voyez le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l’a couronné au jour de son mariage. Qui ne reconnaît à ces expressions la comparaison ordinaire que font les filles du peuple en parlant de leurs amans ? Elles disent : il est beau comme un prince, il a un air de Roi, &c.
3.o Il est vrai que cette bergère qu’on fait parler dans ce Cantique amoureux, dit qu’elle [II-149] est hâlée du soleil, qu’elle est brune. Or si c’était là la fille du Roi d’Égypte, elle n’était point si hâlée. Les filles de qualité en Égypte sont blanches. Cléopatre l’était ; & en un mot ce personnage ne peut être à la fois une fille de village & une Reine.
Il se peut qu’un monarque, qui avait mille femmes ait dit à l’une d’elles, qu’elle me baise d’un baiser de sa bouche, car vos tétons sont meilleurs que le vin ; un Roi & un berger, quand il s’agit de baiser sur la bouche, peuvent s’exprimer de la même manière. Il est vrai qu’il est assez étrange qu’on ait prétendu que c’était la fille qui parlait en cet endroit, & qui faisait l’éloge des tétons de son amant.
Je ne nierai pas encor qu’un Roi galant ait fait dire à sa maîtresse, Mon bien-aimé est comme un bouquet de myrrhe, il demeurera entre mes tétons. Je n’entends pas trop ce que c’est qu’un bouquet de myrrhe ; mais enfin quand la bien-aimée avise son bien-aimé, de lui passer la main gauche sur le cou, & de l’embrasser de la main droite, je l’entends fort bien.
On pourrait demander quelques explications à l’auteur du Cantique, quand il dit ; Votre nombril est comme une coupe dans laquelle il y a toûjours quelque chose à boire ; votre ventre est comme un boisseau de froment, vos tétons sont comme deux faons de chevreuil, & votre nez est comme la tour du Mont Liban.
J’avoue que les églogues de Virgile sont [II-150] d’un autre stile ; mais chacun a le sien, & un Juif n’est pas obligé d’écrire comme Virgile.
C’est apparemment encor un beau tour d’éloquence orientale, que de dire, Notre sœur est encor petite, elle n’a point de tétons ; que ferons-nous de notre sœur ? Si c’est un mur, bâtissons dessus ; si c’est une porte, fermons-la.
À la bonne heure que Salomon le plus sage des hommes ait parlé ainsi dans ses goguettes. Mais plusieurs Rabbins ont soutenu que non-seulement cette petite églogue voluptueuse n’était pas du Roi Salomon, mais qu’elle n’était pas autentique. Théodore de Mopsueste était de ce sentiment, & le célèbre Grotius appelle le Cantique des Cantiques un ouvrage libertin, Flagitiosus ; cependant il est consacré, & on le regarde comme une allégorie perpétuelle du mariage de Jésus-Christ avec son Église. Il faut avouer que l’allégorie est un peu forte, & qu’on ne voit pas ce que l’Église pourrait entendre quand l’auteur dit que sa petite sœur n’a point de tétons.
Après tout, ce Cantique est un morceau précieux de l’antiquité. C’est le seul livre d’amour qui nous soit resté des Hébreux. Il est vrai que c’est une rapsodie inepte, mais il y a beaucoup de volupté. Il n’y est question que de baiser sur la bouche, de tétons qui valent mieux que du vin, de jouës qui sont de la couleur des tourterelles. Il y est souvent parlé de jouïssance. C’est une églogue juive. Le style est comme celui de tous les [II-151] ouvrages d’éloquence des Hébreux, sans liaison, sans suite, plein de répétitions, confus, ridiculement métaphorique ; mais il y a des endroits qui respirent la naïveté & l’amour.
Le Livre de la Sagesse est dans un goût plus sérieux ; mais il n’est pas plus de Salomon que le Cantique des Cantiques. On l’attribue communément à Jésus fils de Sirac, d’autres à Philon de Biblos ; mais quel que soit l’auteur, il paraît que de son tems on n’avait point encor le Pentateuque, car il dit au chap. 10. qu’Abraham voulut immoler Isaac du tems du déluge ; & dans un autre endroit, il parle du patriarche Joseph comme d’un Roi d’Égypte.
Pour l’Ecclésiaste, dont nous avons déjà parlé, Grotius prétend qu’il fut écrit sous Zorobabel. Nous avons vû avec quelle liberté l’auteur de l’Ecclésiaste s’exprime ; on sait qu’il dit que les hommes n’ont rien de plus que les bêtes ; qu’il vaut mieux n’être pas né que d’exister ; qu’il n’y a point d’autre vie, qu’il n’y a rien de bon que de se réjouïr dans ses œuvres avec celle qu’on aime.
Il se pourrait faire que Salomon eût tenu de tels discours à quelques-unes de ses femmes ; on prétend que ce sont des objections qu’il se fait ; mais ces maximes qui ont l’air un peu libertin, ne ressemblent point du tout à des objections ; & c’est se moquer du monde, d’entendre dans un auteur le contraire de ce qu’il dit.
[II-152]
Au reste, plusieurs Pères ont prétendu que Salomon avait fait pénitence ; ainsi on peut lui pardonner.
Il y a grande apparence que Salomon était riche & savant, pour son tems & pour son peuple. L’exagération, compagne inséparable de la grossièreté, lui attribua des richesses qu’il n’avait pu posséder, & des livres qu’il n’avait pu faire. Le respect pour l’antiquité a depuis consacré ces erreurs.
Mais que ces livres aient été écrits par un Juif, que nous importe ? Notre Religion Chrétienne est fondée sur la Juive, mais non pas sur tous les livres que les Juifs ont faits. 1894.Pourquoi le Cantique des Cantiques sera-t-il plus sacré pour nous que les fables du Talmud ? C’est, dit-on, que nous l’avons compris dans le canon des Hébreux : & qu’est-ce que ce canon ? C’est un recueil d’ouvrages autentiques. Eh bien un ouvrage pour être autentique est-il divin ? Une histoire des Roitelets de Juda & de Sichem, par exemple, est-elle autre chose qu’une histoire ? Voilà un étrange préjugé. Nous avons les Juifs en horreur, & nous voulons que tout ce qui a été écrit par eux & recueilli par nous, porte l’empreinte de la Divinité. Il n’y a jamais eu de contradiction si palpable.
[II-153]
SECTE.↩
Toute secte, en quelque genre que ce puisse être est le ralliement du doute & de l’erreur. Scotistes, Thomistes, Réaux, Nominaux, Papistes, Calvinistes, Molinistes, Jansénistes, ne sont que des noms de guerre.
Il n’y a point de secte en géométrie ; on ne dit point un Euclidien, un Archimédien.
Quand la vérité est évidente, il est impossible qu’il s’élève des partis & des factions. Jamais on n’a disputé s’il fait jour à midi.
La partie de l’astronomie qui détermine le cours des astres & le retour des éclipses, étant une fois connue il n’y a plus de dispute chez les astronomes.
On ne dit point en Angleterre, Je suis Newtonien, je suis Lockien, Halleyen ; pourquoi ? parce que quiconque a lû, ne peut refuser son consentement aux vérités enseignées par ces trois grands hommes. Plus Newton est révéré, moins on s’intitule Newtonien ; ce mot supposerait qu’il y a des anti-Newtoniens en Angleterre. Nous avons peut-être encor quelques Cartésiens en France ; c’est uniquement parce que le systême de Descartes est un tissu d’imaginations erronées, & ridicules.
Il en est de même dans le petit nombre de vérités de fait qui sont bien constatées. Les actes de la Tour de Londres ayant été autentiquement recueillis par Rymer, il n’y a point [II-154] de Rymériens, parce que personne ne s’avise de combattre ce recueil. On n’y trouve ni contradictions, ni absurdités, ni prodiges, rien qui révolte la raison, rien, par conséquent, que des sectaires s’efforcent de soutenir ou de renverser par des raisonnements absurdes. Tout le monde convient donc que les actes de Rymer sont dignes de foi.
Vous êtes mahométan, donc il y a des gens qui ne le sont pas, donc vous pourriez bien avoir tort.
Quelle serait la Religion véritable, si le Christianisme n’existait pas ? c’est celle dans laquelle il n’y a point de sectes ; celle dans laquelle tous les esprits s’accordent nécessairement.
Or, dans quel dogme tous les esprits se sont-ils accordés ? Dans l’adoration d’un Dieu & dans la probité. Tous les philosophes de la terre qui ont eu une religion, dirent dans tous les tems, Il y a un Dieu, & il faut être juste. Voilà donc la religion universelle établie dans tous les tems & chez tous les hommes.
Le point dans lequel ils s’accordent tous est donc vrai, & les systêmes par lesquels ils diffèrent, sont donc faux.
Ma secte est la meilleure, me dit un brame ; mais, mon ami, si ta secte est bonne, elle est nécessaire ; car si elle n’était pas absolument nécessaire, tu m’avoueras qu’elle serait inutile ; si elle est absolument nécessaire, elle l’est à tous les hommes ; comment donc se peut-il faire que tous les hommes n’ayent pas ce qui leur est absolument nécessaire ? Comment se peut-il que [II-155] le reste de la terre se moque de toi & de ton Brama ?
Lorsque Zoroastre, Hermès, Orphée, Minos, & tous les grands-hommes disent, Adorons Dieu, & soyons justes, personne ne rit ; mais toute la terre siffle celui qui prétend qu’on ne peut plaire à Dieu, qu’en tenant à sa mort une queuë de vache, & celui qui veut qu’on se fasse couper un bout de prépuce, & celui qui consacre des crocodiles & des oignons, & celui qui attache le salut éternel à des os de morts qu’on porte sous sa chemise, ou à une indulgence plénière qu’on achète à Rome pour deux sous & demi.
D’où vient ce concours universel de risée & de sifflets d’un bout de l’univers à l’autre ? Il faut bien que les choses dont tout le monde se moque, ne soient pas d’une vérité bien évidente. Que dirions-nous d’un secrétaire de Séjan, qui dédia à Pétrone un livre d’un stile ampoulé, intitulé, La Vérité des oracles sibyllins prouvée par les faits ?
Ce secrétaire vous prouve d’abord qu’il était nécessaire que Dieu envoyât sur la terre plusieurs sibylles l’une après l’autre ; car il n’avait pas d’autres moyens d’instruire les hommes. Il est démontré que Dieu parlait à ces sibylles : car le mot de sibylle signifie conseil de Dieu. Elles devaient vivre longtems ; car c’est bien le moins que des personnes à qui Dieu parle, aient ce privilège. Elles furent au nombre de douze, car ce nombre est sacré. Elles avaient certainement prédit tous les événements du [II-156] monde, car Tarquin le superbe acheta trois de leurs livres cent écus d’une vieille. Quel incrédule, ajoute le secrétaire, osera nier tous ces faits évidents qui se sont passés dans un coin à la face de toute la terre ? Qui pourra nier l’accomplissement de leurs prophéties ? Virgile lui-même n’a-t-il pas cité les prédictions des sibylles ? Si nous n’avons pas les premiers exemplaires des livres sibyllins, écrits dans un tems où l’on ne savait ni lire ni écrire, n’en avons-nous pas des copies authentiques ? Il faut que l’impiété se taise devant ces preuves. Ainsi parlait Houtevillus à Séjan. Il espérait avoir une place d’augure qui lui vaudrait cinquante mille livres de rente, & il n’eut rien.
Ce que ma secte enseigne est obscur, je l’avoue, dit un fanatique : & c’est en vertu de cette obscurité qu’il faut la croire ; car elle dit elle-même qu’elle est pleine d’obscurités. Ma secte est extravagante, donc elle est divine ; car comment ce qui paraît si fou aurait-il été embrassé par tant de peuples s’il n’y avait pas du divin ? C’est précisément comme l’Alcoran que les Sonnites disent avoir un visage d’ange & un visage de bête ; ne soyez pas scandalisés du mufle de la bête, & révérez la face de l’ange. Ainsi parle cet insensé ; mais un fanatique d’une autre secte répond à ce fanatique, C’est toi qui es la bête, & c’est moi qui suis l’ange.
Or, qui jugera ce procès ? Qui décidera entre ces deux énergumènes ? L’homme raisonnable, impartial, savant d’une science qui n’est [II-157] pas celle des mots ; l’homme dégagé des préjugés & amateur de la vérité & de la justice ; l’homme enfin qui n’est pas bête, & qui ne croit point être ange.
SENS COMMUN.↩
Il y a quelquefois dans les expressions vulgaires une image de ce qui se passe au fond du cœur de tous les hommes. Sensus Communis, signifiait chez les Romains non seulement sens commun, mais humanité, sensibilité. Comme nous ne valons pas les Romains, ce mot ne dit chez nous que la moitié de ce qu’il disait chez eux. Il ne signifie que le bon sens, raison grossière, raison commencée, première notion des choses ordinaires, état mitoyen entre la stupidité & l’esprit. Cet homme n’a pas le sens commun, est une grosse injure. Cet homme a le sens commun, est une injure aussi ; cela veut dire qu’il n’est pas tout-à-fait stupide, & qu’il manque de ce qu’on appelle esprit. Mais d’où vient cette expression sens commun, si ce n’est des sens ? Les hommes quand ils inventèrent ce mot faisaient l’aveu que rien n’entrait dans l’ame que par les sens, autrement, auraient-ils employé le mot de sens pour signifier le raisonnement commun ?
On dit quelquefois, le sens commun est fort rare ; que signifie cette phrase ? que dans plusieurs hommes la raison commencée est arrêtée dans [II-158] ses progrès par quelques préjugés, que tel homme qui juge très sainement dans une affaire se trompera toûjours grossièrement dans une autre. Cet Arabe qui sera d’ailleurs un bon calculateur, un savant chymiste, un astronome exact, croira cependant que Mahomet a mis la moitié de la lune dans sa manche.
Pourquoi ira-t-il au-delà du sens commun dans les trois sciences dont je parle, & sera-t-il au-dessous du sens commun quand il s’agira de cette moitié de lune ? C’est que dans les premiers cas il a vû avec ses yeux, il a perfectionné son intelligence, & dans le second il a vû par les yeux d’autrui, il a fermé les siens, il a perverti le sens commun qui est en lui.
Comment cet étrange renversement d’esprit peut-il s’opérer ? Comment les idées qui marchent d’un pas si régulier & si ferme dans la cervelle sur un grand nombre d’objets, peuvent-elles clocher si misérablement sur un autre mille fois plus palpable, & plus aisé à comprendre ? cet homme a toûjours en lui les mêmes principes d’intelligence, il faut donc qu’il y ait un organe vicié, comme il arrive quelquefois que le gourmet le plus fin peut avoir le goût dépravé sur une espèce particulière de nourriture.
Comment l’organe de cet Arabe qui voit la moitié de la lune dans la manche de Mahomet est-il vicié ? C’est par la peur. On lui a dit que s’il ne croyait pas à cette manche, son ame immédiatement après sa mort, en passant sur le pont aigu tomberait pour jamais dans l’abîme ; [II-159] on lui a dit bien pis, si jamais vous doutez de cette manche, un derviche vous traitera d’impie, un autre vous prouvera que vous êtes un insensé, qui ayant tous les motifs possibles de crédibilité n’avez pas voulu soumettre votre raison superbe à l’évidence. Une troisième vous déférera au petit divan d’une petite province, & vous serez légalement empalé.
Tout cela donne une terreur panique au bon Arabe, à sa femme, à sa sœur, à toute la petite famille. Ils ont du bon sens sur tout le reste, mais sur cet article leur imagination est blessée, comme celle de Pascal, qui voyait continuellement un précipice auprès de son fauteuil. Mais notre Arabe croit-il en effet à la manche de Mahomet ? non, il fait des efforts pour croire ; il dit cela est impossible, mais cela est vrai ; je crois ce que je ne crois pas. Il se forme dans sa tête sur cette manche, un chaos d’idées qu’il craint de débrouiller ; & c’est véritablement n’avoir pas le sens commun.
SENSATION.↩
Les huîtres ont, dit-on, deux sens, les taupes quatre, les autres animaux comme les hommes cinq ; quelques personnes en admettent un sixième ; mais il est évident que la sensation voluptueuse, dont ils veulent parler, se réduit au sentiment du tact, & que cinq sens sont notre partage. Il nous est impossible d’en imaginer par delà, & d’en désirer.
[II-160]
Il se peut que dans d’autres globes on ait des sens dont nous n’avons pas d’idée : il se peut que le nombre des sens augmente de globe en globe, & que l’être qui a des sens innombrables & parfaits soit le terme de tous les êtres.
Mais nous autres avec nos cinq organes quel est notre pouvoir ? Nous sentons toûjours malgré nous, & jamais parce que nous le voulons ; il nous est impossible de ne pas avoir la sensation que notre nature nous destine, quand l’objet nous frappe. Le sentiment est dans nous ; mais il ne peut en dépendre. Nous le recevons, & comment le recevons-nous ? On sait assez qu’il n’y a aucun rapport entre l’air battu, & des paroles qu’on me chante, & l’impression que ces paroles font dans mon cerveau.
Nous sommes étonnés de la pensée ; mais le sentiment est tout aussi merveilleux. Un pouvoir divin éclate dans la sensation du dernier des insectes comme dans le cerveau de Newton. Cependant, que mille animaux meurent sous vos yeux, vous n’êtes point inquiets de ce que deviendra leur faculté de sentir, quoique cette faculté soit l’ouvrage de l’Être des êtres ; vous les regardez comme des machines de la nature nées pour périr & pour faire place à d’autres.
Pourquoi & comment leur sensation subsisterait-elle, quand ils n’existent plus ? Quel besoin l’auteur de tout ce qui est, aurait-il de conserver des propriétés dont le sujet est détruit ? Il vaudrait autant dire que le pouvoir de la plante nommée sensitive, de retirer ses feuilles vers [II-161] ses branches, subsiste encor quand la plante n’est plus. Vous allez sans doute demander, comment la sensation des animaux périssant avec eux, la pensée de l’homme ne périra pas ? je ne peux répondre à cette question, je n’en sais pas assez pour la résoudre. L’auteur éternel de la sensation & de la pensée sait seul comment il la donne, & comment il la conserve.
Toute l’antiquité a maintenu, que rien n’est dans notre entendement qui n’ait été dans nos sens. Descartes dans ses romans prétendit que nous avions des idées métaphysiques avant de connaître le téton de notre nourrice ; une faculté de Théologie proscrivit ce dogme, non parce que c’était une erreur, mais parce que c’était une nouveauté : ensuite elle adopta cette erreur parce qu’elle était détruite par Locke philosophe anglais, & qu’il fallait bien qu’un Anglais eût tort. Enfin après avoir changé si souvent d’avis, elle est revenue à proscrire cette ancienne vérité, que les sens sont les portes de l’entendement ; elle a fait comme les gouvernements obérés, qui tantôt donnent cours à certains billets, & tantôt les décrient ; mais depuis longtems personne ne veut des billets de cette faculté.
Toutes les facultés du monde n’empêcheront jamais les philosophes de voir que nous commençons par sentir, & que notre mémoire n’est qu’une sensation continuée. Un homme qui naîtrait privé de ses cinq sens, serait privé de toute idée, s’il pouvait vivre. Les notions métaphysiques ne viennent que par les [II-162] sens ; car comment mesurer un cercle ou un triangle, si on n’a pas vu ou touché un cercle & un triangle ? comment se faire une idée imparfaite de l’infini, qu’en reculant des bornes ? & comment retrancher des bornes, sans en avoir vu ou senti ?
La sensation enveloppe toutes nos facultés, dit un grand philosophe (page 128. Tome II. traité des sensations.)
Que conclure de tout cela ? Vous qui lisez & qui pensez, concluez.
Les Grecs avaient inventé la faculté Psyché pour les sensations, & la faculté nous pour les pensées. Nous ignorons malheureusement ce que c’est que ces deux facultés ; nous les avons, mais leur origine ne nous est pas plus connue qu’à l’huitre, à l’ortie de mer, au polype, aux vermisseaux & aux plantes. Par quelle mécanique inconcevable le sentiment est-il dans tout mon corps, & la pensée dans ma seule tête ? Si on vous coupe la tête, il n’y a pas d’apparence que vous puissiez alors résoudre un problème de géométrie : cependant votre glande pinéale, votre corps calleux, dans lesquels vous logez votre âme, subsistent longtems sans altération, votre tête coupée est si pleine d’esprits animaux, que souvent elle bondit après avoir été séparée de son tronc : il semble qu’elle devrait avoir dans ce moment des idées très vives, & ressembler à la tête d’Orphée qui faisait encor de la musique, & qui chantait Euridice quand on la jetait dans les eaux de l’Èbre.
[II-163]
Si vous ne pensez pas, quand vous n’avez plus de tête, d’où vient que votre cœur est sensible quand il est arraché ?
Vous sentez, dites-vous, parce que tous les nerfs ont leur origine dans le cerveau ; & cependant si on vous a trépané, & si on vous brûle le cerveau, vous ne sentez rien. Les gens qui savent les raisons de tout cela sont bien habiles.
SONGES.↩
Somnia quae ludum animos volitantibus umbris,
Non delubra deum nec ab athere numina mittunt,
Sed sua quisque facit.
Mais comment tous les sens étant morts dans le sommeil, y en a-t-il un interne qui est vivant ? comment vos yeux ne voyant plus, vos oreilles n’entendant rien, voyez-vous cependant & entendez-vous dans vos rêves ? Le chien est à la chasse en songe, il aboie, il suit sa proie, il est à la curée. Le poëte fait des vers en dormant. Le mathématicien voit des figures ; le métaphysicien raisonne bien ou mal : on en a des exemples frappans.
Sont-ce les seuls organes de la machine qui agissent ? est-ce l’ame pure, qui soustraite à l’empire des sens jouït de ses droits en liberté ?
Si les organes seuls produisent les rêves de [II-164] la nuit, pourquoi ne produiront-ils pas seuls les idées du jour ? Si l’ame pure, tranquille dans le repos des sens, agissant par elle-même, est l’unique cause, le sujet unique de toutes les idées que vous avez en dormant, pourquoi toutes ces idées sont-elles presque toûjours irrégulières, déraisonnables, incohérentes ? Quoi, c’est dans le tems où cette ame est le moins troublée, qu’il y a plus de trouble dans toutes ses imaginations ! elle est en liberté, & elle est folle ! si elle était née avec des idées métaphysiques, comme l’ont dit tant d’écrivains qui rêvaient les yeux ouverts, ses idées pures & lumineuses de l’être, de l’infini, de tous les premiers principes, devraient se réveiller en elle avec la plus grande énergie quand son corps est endormi : on ne serait jamais bon philosophe qu’en songe.
Quelque systême que vous embrassiez, quelques vains efforts que vous fassiez pour vous prouver que la mémoire remue votre cerveau, & que votre cerveau remue votre âme, il faut que vous conveniez que toutes vos idées vous viennent dans le sommeil sans vous, & malgré vous : votre volonté n’y a aucune part. Il est donc certain que vous pouvez penser sept ou huit heures de suite, sans avoir la moindre envie de penser, & sans même être sûr que vous pensez. Pesez cela, & tâchez de deviner ce que c’est que le composé de l’animal.
Les songes ont toûjours été un grand objet de superstition ; rien n’était plus naturel. Un homme vivement touché de la maladie de sa [II-165] maîtresse, songe qu’il la voit mourante ; elle meurt le lendemain, donc les dieux lui ont prédit sa mort.
Un Général d’armée rêve qu’il gagne une bataille, il la gagne en effet, les dieux l’ont averti qu’il serait vainqueur.
On ne tient compte que des rêves qui ont été accomplis, on oublie les autres. Les songes font une grande partie de l’histoire ancienne, aussi-bien que les oracles.
La Vulgate traduit ainsi la fin du verset 26. du chap. 19. du Lévitique : Vous n’observerez point les songes. Mais le mot songe n’est point dans l’hébreu : & il serait assez étrange qu’on réprouvât l’observation des songes dans le même livre où il est dit que Joseph devint le bienfaiteur de l’Égypte & de sa famille, pour avoir expliqué trois songes.
L’explication des rêves était une chose si commune qu’on ne se bornait pas à cette intelligence ; il fallait encor deviner quelquefois ce qu’un autre homme avait rêvé. Nabucodonosor ayant oublié un songe qu’il avait fait, ordonna à ses mages de le deviner, & les menaça de mort s’ils n’en venaient pas à bout ; mais le juif Daniel qui était de l’école des mages, leur sauva la vie en devinant quel était le songe du roi, & en l’interprétant. Cette histoire & beaucoup d’autres, pourraient servir à prouver que la loi des Juifs ne défendait pas l’onéiromancie, c’est-à-dire, la science des songes.
[II-166]
SUPERSTITION.↩
Chapitre tiré de Cicéron, de Sénèque & de Plutarque.
Presque tout ce qui va au-delà de l’adoration d’un Être suprême, & de la soumission du cœur à ses ordres éternels, est superstition. C’en est une très dangereuse que le pardon des crimes attaché à certaines cérémonies.
Et nigras mactant pecudes, & manibu divis
Inferias mittunt.
O faciles nimium qui tristia crimina caedis
Fluminea tolli posse putatis aqua !
Vous pensez que Dieu oubliera votre homicide, si vous vous baignez dans un fleuve, si vous immolez une brebis noire, & si on prononce sur vous des paroles. Un second homicide vous sera donc pardonné au même prix, & ainsi un troisième, & cent meurtres ne vous coûteront que cent brebis noires & cent ablutions ! Faites mieux, misérables humains, point de meurtre & point de brebis noires.
Quelle infâme idée d’imaginer qu’un prêtre d’Isis & de Cibèle en jouant des cymbales & des castagnettes vous réconciliera avec la Divinité ! Et qu’est-il donc ce prêtre de Cibèle, cet eunuque errant qui vit de vos faiblesses, pour [II-167] s’établir médiateur entre le Ciel & vous ? Quelles patentes a-t-il reçues de Dieu ? Il reçoit de l’argent de vous pour marmotter des paroles, & vous pensez que l’Être des êtres ratifie les paroles de ce charlatan ?
Il y a des superstitions innocentes : vous dansez les jours de fête en l’honneur de Diane ou de Pomone ; ou de quelqu’un de ces dieux secondaires dont votre calendrier est rempli : à la bonne heure. La danse est très agréable, elle est utile au corps, elle réjouit l’ame ; elle ne fait de mal à personne ; mais n’allez pas croire que Pomone & Vertumne vous sachent beaucoup de gré d’avoir sauté en leur honneur, & qu’ils vous punissent d’y avoir manqué. Il n’y a d’autre Pomone ni d’autre Vertumne, que la bêche & le hoyau du jardinier. Ne soyez pas assez imbéciles pour croire que votre jardin sera grêlé si vous avez manqué de danser la pirrique ou la cordace.
Il y a peut-être une superstition pardonnable & même encourageante à la vertu ; c’est celle de placer parmi les dieux les grands hommes qui ont été les bienfaiteurs du genre humain. Il serait mieux sans doute, de s’en tenir à les regarder simplement comme des hommes vénérables ; & surtout de tâcher de les imiter. Vénérez sans culte, un Solon, un Thales, un Pythagore, mais n’adorez pas un Hercule pour avoir nettoyé les écuries d’Augias, & pour avoir couché avec cinquante filles dans une nuit.
Gardez-vous surtout d’établir un culte pour des gredins qui n’ont eu d’autre mérite que [II-168] l’ignorance, l’entousiasme, & la crasse, qui se sont fait un devoir & une gloire de l’oisiveté & de la gueuserie ; ceux qui au moins ont été inutiles pendant leur vie, méritent-ils l’apothéose après leur mort ?
Remarquez que les tems les plus superstitieux ont toûjours été ceux des plus horribles crimes.
SUPERSTITION.↩
Section seconde
Le superstitieux est au fripon ce que l’esclave est au tyran. Il y a plus encor ; le superstitieux est gouverné par le fanatique, & le devient. La superstition née dans le Paganisme, adoptée par le Judaïsme, infecta l’Église chrétienne dès les premiers tems. Tous les Pères de l’Église sans exception crurent au pouvoir de la magie. L’Église condamna toûjours la magie, mais elle y crut toûjours : elle n’excommunia point les sorciers comme des fous qui étaient trompés, mais comme des hommes qui étaient réellement en commerce avec les diables.
Aujourd’hui la moitié de l’Europe croit que l’autre a été longtems & est encor superstitieuse. Les Protestants regardent les reliques, les indulgences, les macérations, les prières pour les morts, l’eau bénite, & presque tous les rites de l’Église romaine, comme une démence [II-169] superstitieuse. La superstition, selon eux, consiste à prendre des pratiques inutiles pour des pratiques nécessaires. Parmi les Catholiques Romains il y en a de plus éclairés que leurs ancêtres, qui ont renoncé à beaucoup de ces usages autrefois sacrés ; & ils se défendent sur les autres qu’ils ont conservés, en disant, ils sont indifférens, & ce qui n’est qu’indifférent ne peut être un mal.
Il est difficile de remarquer les bornes de la superstition. Un Français voyageant en Italie trouve presque tout superstitieux, & ne se trompe guère. L’Archevêque de Cantorbéri prétend que l’Archevêque de Paris est superstitieux ; les Presbitériens font le même reproche à monsieur de Cantorbéri, & sont à leur tour traités de superstitieux par les Quakers, qui sont les plus superstitieux de tous aux yeux des autres Chrétiens.
Personne ne convient donc chez les sociétés chrétiennes de ce que c’est que la superstition. La secte qui semble le moins attaquée de cette maladie de l’esprit est celle qui a le moins de rites. Mais si avec peu de cérémonies elle est fortement attachée à une croyance absurde, cette créance absurde équivaut, elle seule, à toutes les pratiques superstitieuses observées depuis Simon le magicien jusqu’au curé Gauffrédi.
Il est donc évident que c’est le fond de la religion d’une secte, qui passe pour superstition chez une autre secte.
Les Musulmans accusent toutes les sociétés [II-170] chrétiennes, & en sont accusés. Qui jugera ce grand procès ? Sera-ce la raison ? Mais chaque secte prétend avoir la raison de son côté. Ce sera donc la force qui jugera, en attendant que la raison pénètre dans un assez grand nombre de têtes pour désarmer la force.
Par exemple, il a été un tems dans l’Europe chrétienne où il n’était pas permis à de nouveaux époux de jouir des droits du mariage sans avoir acheté ce droit de l’Évêque & du Curé.
Quiconque dans son testament ne laissait pas une partie de son bien à l’Église était excommunié & privé de la sépulture. Cela s’appelait mourir déconfès, c’est-à-dire, ne confessant pas la Religion Chrétienne. Et quand un chrétien mourait intestat, l’Église relevait le mort de cette excommunication, en faisant un testament pour lui, en stipulant, & en se faisant payer le legs pieux que le défunt aurait dû faire.
C’est pourquoi le pape Grégoire IX, & St. Louïs ordonnèrent après le concile de Narbonne tenu en 1235, que tout testament auquel on n’aurait pas appelé un prêtre serait nul, & le Pape décerna que le testateur & le notaire seraient excommuniés.
La taxe des péchés fut encor, s’il est possible, plus scandaleuse. C’était la force qui soutenait toutes ces loix auxquelles se soumettait la superstition des peuples ; & ce n’est qu’avec le tems que la raison fit abolir ces honteuses vexations, dans le tems qu’elle en laissait subsister tant d’autres.
[II-171]
Jusqu’à quel point la politique permet-elle qu’on ruine la superstition ? Cette question est très épineuse ; c’est demander jusqu’à quel point on doit faire la ponction à un hydropique, qui peut mourir dans l’opération. Cela dépend de la prudence du médecin.
Peut-il exister un peuple, libre de tous préjugés superstitieux ? C’est demander, Peut-il exister un peuple de philosophes ? On dit qu’il n’y a nulle superstition dans la Magistrature de la Chine. Il est vraisemblable qu’il n’en restera aucune dans la Magistrature de quelques villes d’Europe.
Alors ces Magistrats empêcheront que la superstition du peuple ne soit dangereuse. L’exemple de ces Magistrats n’éclairera pas la canaille, mais les principaux bourgeois la contiendront. Il n’y a peut-être pas un seul tumulte, un seul attentat religieux, où les bourgeois n’aient autrefois trempé, parce que ces bourgeois alors étaient canaille ; mais la raison & le tems les auront changés. Leurs mœurs adoucies adouciront celles de la plus vile, & de la plus féroce populace : c’est de quoi nous avons des exemples frappants dans plus d’un pays. En un mot, moins de superstitions moins de fanatisme, & moins de fanatisme moins de malheurs.
[II-172]
THÉISTE.↩
Le Théïste est un homme fermement persuadé de l’existence d’un Être suprême aussi bon que puissant, qui a formé tous les êtres étendus, végétans, sentans, & réfléchissans ; qui perpétue leur espèce, qui punit sans cruauté les crimes, & récompense avec bonté les actions vertueuses.
Le Théïste ne sait pas comment Dieu punit, comment il favorise, comment il pardonne, car il n’est pas assez téméraire pour se flatter de connaître comment Dieu agit, mais il sait que Dieu agit & qu’il est juste. Les difficultés contre la providence ne l’ébranlent point dans sa foi, parce qu’elles ne sont que des grandes difficultés & non pas des preuves ; il est soumis à cette providence, quoiqu’il n’en aperçoive que quelques effets & quelques dehors, & jugeant des choses qu’il ne voit pas par les choses qu’il voit, il pense que cette providence s’étend dans tous les lieux & dans tous les siècles.
Réuni dans ce principe avec le reste de l’univers, il n’embrasse aucune des sectes, qui toutes se contredisent ; sa religion est la plus ancienne & la plus étendue ; car l’adoration simple d’un Dieu a précédé tous les systêmes du monde. Il parle une langue que tous les peuples entendent, pendant qu’ils ne s’entendent pas entre eux. Il a des frères depuis Pékin [II-173] jusqu’à la Cayenne, & il compte tous les sages pour ses frères. Il croit que la Religion ne consiste ni dans des opinions d’une métaphysique inintelligible, ni dans de vains appareils, mais dans l’adoration & dans la justice. Faire le bien, voilà son culte ; être soumis à Dieu, voilà sa doctrine. Le Mahométan lui crie, Prends garde à toi si tu ne fais pas le pèlerinage de la Mecque. Malheur à toi, lui dit un Récollet, si tu ne fais pas un voyage à Notre-Dame de Lorette. Il rit de Lorette & de la Mecque, mais il secourt l’indigent, & il défend l’opprimé.
THÉOLOGIEN.↩
J’ai connu un vrai Théologien ; il possédait les langues de l’Orient, & était instruit des anciens rites des nations autant qu’on peut l’être. Les Bracmanes, les Caldéens, les Ignicoles, les Sabéens, les Syriens, les Égyptiens lui étaient aussi connus que les Juifs ; les diverses leçons de la Bible lui étaient familières ; il avait pendant trente années essayé de concilier les Évangiles, & tâché d’accorder ensemble les Pères. Il chercha dans quel tems précisément on rédigea le symbole attribué aux Apôtres, & celui qu’on met sous le nom d’Athanase ; comment on institua les sacremens les uns après les autres, quelle fut la différence entre la Synaxe & la Messe, comment l’Église [II-174] Chrétienne fut divisée depuis sa naissance en différens partis, et comment la société dominante traita toutes les autres d’hérétiques. Il sonda les profondeurs de la politique qui se mêla toûjours de ces querelles, et il distingua entre la politique et la sagesse, entre l’orgueil qui veut subjuguer les esprits et le désir de s’éclairer soi-même, entre le zèle et le fanatisme.
La difficulté d’arranger dans sa tête tant de choses, dont la nature est d’être confondues, & de jeter un peu de lumière sur tant de nuages, le rebuta souvent ; mais comme ces recherches étaient le devoir de son état, il s’y consacra malgré ses dégouts. Il parvint enfin à des connaissances ignorées de la plûpart de ses confrères. Plus il fut véritablement savant, plus il se défia de tout ce qu’il savait. Tandis qu’il vécut, il fut indulgent, et à sa mort il avoua qu’il avait consumé inutilement sa vie.
TIRANNIE.↩
On appelle tyran le Souverain qui ne connaît de loix que son caprice, qui prend le bien de ses sujets, & qui ensuite les enrôle pour aller prendre celui de ses voisins. Il n’y a point de ces tyrans-là en Europe.
On distingue la tyrannie d’un seul, & celle de plusieurs. Cette tyrannie de plusieurs serait celle d’un corps qui envahirait les droits [II-175] des autres corps, & qui exercerait le despotisme à la faveur des loix corrompues par lui. Il n’y a pas non plus de cette espèce de tyrans en Europe.
Sous quelle tyrannie aimeriez-vous mieux vivre ? Sous aucune ; mais s’il fallait choisir, je détesterais moins la tyrannie d’un seul que celle de plusieurs. Un despote a toûjours quelques bons moments ; une assemblée de despotes n’en a jamais. Si un tyran me fait une injustice, je peux le désarmer par sa maîtresse, par son confesseur, ou par son page ; mais une compagnie de graves tyrans est inaccessible à toutes les séductions. Quand elle n’est pas injuste, elle est au moins dure, & jamais elle ne répand de graces.
Si je n’ai qu’un despote, j’en suis quitte pour me ranger contre un mur, lorsque je le vois passer, ou pour me prosterner, ou pour frapper la terre de mon front selon la coutume du pays ; mais s’il y a une compagnie de cent despotes, je suis exposé à répéter cette cérémonie cent fois par jour, ce qui est très ennuyeux à la longue quand on n’a pas les jarrets souples. Si j’ai une métairie dans le voisinage de l’un de nos Seigneurs, je suis écrasé ; si je plaide contre un parent des parents d’un de nos Seigneurs, je suis ruiné. Comment faire ? J’ai peur que dans ce monde on ne soit réduit à être enclume ou marteau ; heureux qui échappe à cette alternative !
[II-176]
TOLÉRANCE.↩
Qu’est-ce que la tolérance ? c’est l’apanage de l’humanité. Nous sommes tous paitris de faiblesses, & d’erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c’est la première loi de la nature.
Qu’à la bourse d’Amsterdam, de Londres, ou de Surate, ou de Bassora, le Guèbre, le Banian, le Juif, le Mahométan, le Déïcole Chinois, le Bramin, le Chrétien Grec, le Chrétien Romain, le Chrétien Protestant, le Chrétien Quaker, trafiquent ensemble, ils ne lèveront pas le poignard les uns sur les autres pour gagner des ames à leur Religion. Pourquoi donc nous sommes-nous égorgés presque sans interruption depuis le premier Concile de Nicée ?
Constantin commença par donner un édit qui permettait toutes les religions ; il finit par persécuter. Avant lui on ne s’éleva contre les Chrétiens que parce qu’ils commençaient à faire un parti dans l’État. Les Romains permettaient tous les cultes, jusqu’à celui des Juifs, jusqu’à celui des Égyptiens, pour lesquels ils avaient tant de mépris. Pourquoi Rome tolérait-elle ces cultes ? C’est que ni les Égyptiens, ni même les Juifs ne cherchaient à exterminer l’ancienne religion de l’Empire, ne couraient point la terre & les mers pour faire des prosélytes ; ils ne songeaient qu’à gagner de l’argent ; mais il [II-177] est incontestable que les Chrétiens voulaient que leur religion fût la dominante. Les Juifs ne voulaient pas que la statue de Jupiter fût à Jérusalem ; mais les Chrétiens ne voulaient pas qu’elle fût au Capitole. St. Thomas a la bonne foi d’avouer, que si les Chrétiens ne détrônèrent pas les Empereurs, c’est qu’ils ne le pouvaient pas. Leur opinion était que toute la terre doit être chrétienne. Ils étaient donc nécessairement ennemis de toute la terre, jusqu’à ce qu’elle fût convertie.
Ils étaient entre eux ennemis les uns des autres sur tous les points de leur controverse. Faut-il d’abord regarder Jésus-Christ comme Dieu ? ceux qui le nient sont anathématisés sous le nom d’Ébionites qui anathématisent les adorateurs de Jésus.
Quelques-uns d’entre eux veulent-ils que tous les biens soient communs, comme on prétend qu’ils l’étaient du tems des Apôtres ? Leurs adversaires les appellent Nicolaïtes, & les accusent des crimes les plus infâmes. D’autres prétendent-ils à une dévotion mystique ? on les appelle Gnostiques, & on s’élève contre eux avec fureur. Marcion dispute-t-il sur la Trinité ? On le traite d’idolâtre.
Tertullien, Praxéas, Origène, Novat, Novatien, Sabellius, Donat sont tous persécutés par leurs frères avant Constantin : & à peine Constantin a-t-il fait régner la Religion Chrétienne, que les Athanasiens & les Eusébiens se déchirent, & depuis ce tems l’Église Chrétienne est inondée de sang jusqu’à nos jours.
[II-178]
Le peuple Juif était, je l’avouë, un peuple bien barbare. Il égorgeait sans pitié tous les habitans d’un malheureux petit pays sur lequel il n’avait pas plus de droit qu’il n’en a sur Paris & sur Londres. Cependant quand Naaman est guéri de sa lèpre pour s’être plongé sept fois dans le Jourdain, quand pour témoigner sa gratitude à Élisée qui lui a enseigné ce secret, il lui dit qu’il adorera le Dieu des Juifs par reconnaissance, il se réserve la liberté d’adorer aussi le Dieu de son Roi. Il en demande permission à Élisée, & le prophète n’hésite pas à la lui donner. Les Juifs adoraient leur Dieu ; mais ils n’étaient jamais étonnés que chaque peuple eût le sien. Ils trouvaient bon que Chamos eût donné un certain district aux Moabites, pourvu que leur Dieu leur en donnât aussi un. Jacob n’hésita pas à épouser les filles d’un idolâtre. Laban avait son Dieu, comme Jacob avait le sien. Voilà des exemples de tolérance chez le peuple le plus intolérant & le plus cruel de toute l’antiquité ; nous l’avons imité dans ses fureurs absurdes, & non dans son indulgence.
Il est clair que tout particulier qui persécute un homme, son frère, parce qu’il n’est pas de son opinion, est un monstre. Cela ne souffre pas de difficulté. Mais le Gouvernement ! mais les Magistrats ! mais les Princes ! comment en useront-ils envers ceux qui ont un autre culte que le leur ? Si ce sont des étrangers puissants, il est certain qu’un Prince fera alliance avec eux. François I très Chrétien s’unira avec les [II-179] Musulmans contre Charles-Quint très Catholique. François I donnera de l’argent aux Luthériens d’Allemagne, pour les soutenir dans leur révolte contre l’Empereur ; mais il commencera, selon l’usage, par faire brûler les Luthériens chez lui. Il les paye en Saxe par politique ; il les brûle par politique à Paris. Mais qu’arrivera-t-il ? Les persécutions font des prosélytes. Bientôt la France sera pleine de nouveaux Protestans. D’abord ils se laisseront pendre, & puis ils pendront à leur tour. Il y aura des guerres civiles. Puis viendra la St. Barthélemi, & ce coin du monde sera pire que tout ce que les anciens & les modernes ont jamais dit de l’enfer.
Insensés ! qui n’avez jamais pu rendre un culte pur au Dieu qui vous a faits ! Malheureux que l’exemple des Noachides, des Lettrés Chinois, des Parsis & de tous les sages n’ont jamais pu conduire ! Monstres, qui avez besoin de superstitions comme le gésier des corbeaux a besoin de charognes. On vous l’a déjà dit & on n’a autre chose à vous dire ; si vous avez deux religions chez vous, elles se couperont la gorge ; si vous en avez trente, elles vivront en paix. Voyez le Grand Turc, il gouverne des Guèbres, des Banians, des Chrétiens Grecs, des Nestoriens, des Romains. Le premier qui veut exciter du tumulte est empalé, & tout le monde est tranquille.
[II-180]
TOLÉRANCE.↩
Section seconde
De toutes les Religions, la Chrétienne est sans doute celle qui doit inspirer le plus de tolérance, quoique jusqu’ici les Chrétiens aient été les plus intolérans de tous les hommes.
Jésus ayant daigné naître dans la pauvreté & dans la bassesse, ainsi que ses frères, ne daigna jamais pratiquer l’art d’écrire. Les Juifs avaient une loi écrite avec le plus grand détail, & nous n’avons pas une seule ligne de la main de Jésus. Les Apôtres se divisèrent sur plusieurs points. St. Pierre & St. Barnabé mangeaient des viandes défendues avec les nouveaux Chrétiens étrangers, & s’en abstenaient avec les Chrétiens Juifs. St. Paul leur reprochait cette conduite, & ce même St. Paul pharisien, disciple du pharisien Gamaliel, ce même St. Paul qui avait persécuté les Chrétiens avec fureur, & qui ayant rompu avec Gamaliel se fit chrétien lui-même, alla pourtant ensuite sacrifier dans le temple de Jérusalem, dans le tems de son apostolat. Il observa publiquement pendant huit jours toutes les cérémonies de la loi Judaïque à laquelle il avait renoncé, il y ajouta même des dévotions, des purifications qui étaient de surabondance, il judaïsa entièrement. Le plus grand Apôtre des Chrétiens fit pendant huit jours [II-181] les mêmes choses pour lesquelles on condamne les hommes au bûcher chez une grande partie des peuples chrétiens.
Theudas, Judas, s’étaient dits Messies avant Jésus. Dosithée, Simon, Ménandre, se dirent Messies après Jésus. Il y eut dès le premier siècle de l’Église, & avant même que le nom de Chrétien fût connu, une vingtaine de sectes dans la Judée.
Les Gnostiques contemplatifs, les Dosithéens, les Cérinthiens, existaient avant que les disciples de Jésus eussent pris le nom de Chrétien. Il y eut bientôt trente Évangiles, dont chacun appartenait à une société différente ; & dès la fin du premier siècle on peut compter trente sectes de chrétiens dans l’Asie mineure, dans la Syrie, dans Alexandrie, & même dans Rome.
Toutes ces sectes méprisées du gouvernement Romain, & cachées dans leur obscurité, se persécutaient cependant les unes les autres dans les souterrains où elles rampaient ; c’est-à-dire, elles se disaient des injures. C’est tout ce qu’elles pouvaient faire dans leur abjection. Elles n’étaient presque toutes composées que de gens de la lie du peuple.
Lorsque enfin quelques Chrétiens eurent embrassé les dogmes de Platon, & mêlé un peu de philosophie à leur Religion qu’ils séparèrent de la Juive, ils devinrent insensiblement plus considérables, mais toûjours divisés en plusieurs sectes, sans que jamais il y ait eu un seul tems où l’Église Chrétienne ait été réunie. Elle a [II-182] pris sa naissance au milieu des divisions des Juifs, des Samaritains, des Pharisiens, des Saducéens, des Esséniens, des Judaïtes, des Disciples de Jean, des Thérapeutes. Elle a été divisée dans son berceau, elle l’a été dans les persécutions mêmes qu’elle essuya quelquefois sous les premiers Empereurs. Souvent le martyr était regardé comme un apostat par ses frères, & le Chrétien Carpocratien expirait sous le glaive des bourreaux Romains excommunié par le Chrétien Ébionite, lequel Ébionite était anathématisé par le Sabellier.
Cette horrible discorde qui dure depuis tant de siècles est une leçon bien frappante que nous devons mutuellement nous pardonner nos erreurs, la discorde est le grand mal du genre humain, & la tolérance en est le seul remède.
Il n’y a personne qui ne convienne de cette vérité, soit qu’il médite de sang-froid dans son cabinet, soit qu’il examine paisiblement la vérité avec ses amis. Pourquoi donc les mêmes hommes qui admettent en particulier l’indulgence, la bienfaisance, la justice, s’élèvent-ils en public avec tant de fureur contre ces vertus ? pourquoi ? c’est que leur intérêt est leur Dieu, c’est qu’ils sacrifient tout à ce monstre qu’ils adorent.
Je possède une dignité & une puissance que l’ignorance & la crédulité ont fondée ; je marche sur les têtes des hommes prosternés à mes pieds : s’ils se relèvent & me regardent en face, je suis perdu, il faut donc les tenir attachés à la terre avec des chaînes de fer.
Ainsi ont raisonné des hommes que des siècles [II-183] de fanatisme ont rendus puissans. Ils ont d’autres puissans sous eux, & ceux-ci en ont d’autres encor, qui tous s’enrichissent des dépouilles du pauvre, s’engraissent de son sang, & rient de son imbécillité. Ils détestent tous la tolérance comme des partisans enrichis aux dépens du public craignent de rendre leurs comptes, & comme des tyrans redoutent le mot de liberté. Pour comble, enfin, ils soudoient des fanatiques qui crient à haute voix, Respectez les absurdités de mon maître, tremblez, payez, & taisez-vous.
C’est ainsi qu’on en usa longtems dans une grande partie de la terre ; mais aujourd’hui que tant de sectes se balancent par leur pouvoir, quel parti prendre avec elles ? toute secte, comme on sait, est un titre d’erreur, il n’y a point de secte de géomètres, d’algébristes, d’arithméticiens, parce que toutes les propositions de géométrie, d’algèbre, d’arithmétique sont vraies. Dans toutes les autres sciences on peut se tromper. Quel théologien Thomiste ou Scotiste oserait dire sérieusement qu’il est sûr de son fait ?
S’il est une secte qui rappelle les tems des premiers Chrétiens, c’est sans contredit celle des Quakers. Rien ne ressemble plus aux Apôtres. Les Apôtres recevaient l’esprit, & les Quakers reçoivent l’esprit. Les Apôtres & les Disciples parlaient trois ou quatre à la fois dans l’assemblée au troisième étage, les quakers en font autant au rez-de-chaussée. Il était permis, selon St. Paul, aux femmes de prêcher, [II-184] & selon le même St. Paul il leur était défendu. Les Quakresses prêchent en vertu de la première permission.
Les Apôtres & les Disciples juraient par oui & par non, les Quakers ne jurent pas autrement.
Point de dignité, point de parure différente parmi les Disciples & les Apôtres. Les Quakers ont des manches sans boutons, & sont tous vêtus de la même manière.
Jésus-Christ ne batisa aucun de ses Apôtres, les Quakers ne sont point baptisés.
Il serait aisé de pousser plus loin le parallèle ; il serait encor plus aisé de faire voir combien la Religion Chrétienne d’aujourd’hui diffère de la Religion que Jésus a pratiquée. Jésus était Juif, & nous ne sommes point Juifs. Jésus s’abstenait de porc parce qu’il est immonde, & du lapin parce qu’il rumine & qu’il n’a point le pied fendu ; nous mangeons hardiment du porc parce qu’il n’est point pour nous immonde, & nous mangeons du lapin qui a le pied fendu, & qui ne rumine pas.
Jésus était circoncis, & nous gardons notre prépuce. Jésus mangeait l’agneau Pascal avec des laitues, il célébrait la fête des Tabernacles ; & nous n’en faisons rien. Il observait le Sabbat, & nous l’avons changé ; il sacrifiait ; & nous ne sacrifions point.
Jésus cacha toûjours le mystère de son incarnation & de sa dignité, il ne dit point qu’il était égal à Dieu. St. Paul dit expressément dans son épître aux Hébreux que Dieu a créé [II-185] Jésus inférieur aux Anges, & malgré toutes les paroles de St. Paul Jésus a été reconnu Dieu au concile de Nicée.
Jésus n’a donné au Pape ni la Marche d’Ancône, ni le Duché de Spolette, & cependant le Pape les possède de droit divin.
Jésus n’a point fait un sacrement du mariage ni du diaconat, & chez nous le diaconat & le mariage sont des sacremens.
Si l’on veut bien y faire attention, la Religion Catholique Apostolique & Romaine, est dans toutes ses cérémonies & dans tous ses dogmes, l’opposé de la Religion de Jésus.
Mais quoi ! faudra-t-il que nous judaïsions tous parce que Jésus a judaïsé toute sa vie ?
S’il était permis de raisonner conséquemment en fait de Religion, il est clair que nous devrions tous nous faire Juifs, puisque Jésus-Christ notre Sauveur est né Juif, a vécu Juif, est mort Juif, & qu’il a dit expressément qu’il accomplissait, qu’il remplissait la Religion Juive. Mais il est plus clair encor que nous devons nous tolérer mutuellement parce que nous sommes tous faibles, inconséquents, sujets à la mutabilité, à l’erreur : un roseau couché par le vent dans la fange dira-t-il au roseau voisin couché dans un sens contraire, rampe à ma façon, misérable, ou je présenterai requête pour qu’on t’arrache & qu’on te brûle ?
[II-186]
TORTURE.↩
Quoiqu’il y ait peu d’articles de jurisprudence dans ces honnêtes réflexions alphabétiques, il faut pourtant dire un mot de la Torture, autrement nommée Question. C’est une étrange manière de questionner les hommes. Ce ne sont pourtant pas de simples curieux qui l’ont inventée ; toutes les apparences sont que cette partie de notre législation, doit sa première origine à un voleur de grand chemin. La plupart de ces messieurs sont encor dans l’usage de serrer les pouces, de brûler les pieds & de questionner par d’autres tourments ceux qui refusent de leur dire où ils ont mis leur argent.
Les conquérans ayant succédé à ces voleurs trouvèrent l’invention fort utile à leurs intérêts, ils la mirent en usage quand ils soupçonnèrent qu’on avait contre eux quelques mauvais desseins, comme, par exemple, celui d’être libre ; c’était un crime de lèze-majesté divine & humaine. Il fallait connaître les complices, & pour y parvenir on faisait souffrir mille morts à ceux qu’on soupçonnait, parce que selon la jurisprudence de ces premiers héros, quiconque était soupçonné d’avoir eu seulement contre eux quelque pensée peu respectueuse était digne de mort. Dès qu’on a mérité ainsi la mort il importe peu qu’on y ajoute des tourments épouvantables de plusieurs jours, & même de plusieurs semaines ; cela même tient je ne sais quoi de la divinité. [II-187] La Providence nous met quelquefois à la torture en y employant la pierre, la gravelle, la goutte, le scorbut, la lèpre, la vérole grande ou petite, le déchirement d’entrailles, les convulsions des nerfs & autres exécuteurs des vengeances de la Providence.
Or, comme les premiers despotes furent de l’aveu de tous leurs courtisans des images de la Divinité, ils l’imitèrent tant qu’ils purent.
Ce qui est très singulier, c’est qu’il n’est jamais parlé de question, de torture dans les livres juifs. C’est bien dommage qu’une nation si douce, si honnête, si compatissante, n’ait pas connu cette façon de savoir la vérité. La raison en est, à mon avis, qu’ils n’en avaient pas besoin, Dieu la leur faisait toûjours connaître comme à son peuple chéri. Tantôt on jouait la vérité aux trois dés, & le coupable qu’on soupçonnait avait toûjours rafle de six. Tantôt on allait au grand-Prêtre, qui consultait Dieu sur le champ par l’urim & le tummim. Tantôt on s’adressait au Voyant, au Prophète, & vous croyez bien que le Voyant & le Prophète découvrait tout aussi bien les choses les plus cachées que l’Urim & le Tummim du grand-Prêtre. Le peuple de Dieu n’était pas réduit comme nous à interroger, à conjecturer ; ainsi la torture ne put être chez lui en usage. Ce fut la seule chose qui manquât aux mœurs du peuple saint. Les Romains n’infligèrent la torture qu’aux esclaves, mais les esclaves n’étaient pas comptés pour des hommes. Il n’y a pas d’apparence non plus, qu’un Conseiller de la Tournelle regarde comme un de ses semblables [II-188] un homme qu’on lui amène hâve, pâle, défait, les yeux mornes, la barbe longue & sale, couvert de la vermine dont il a été rongé dans un cachot. Il se donne le plaisir de l’appliquer à la grande & à la petite torture en présence d’un chirurgien qui lui tâte le pouls, jusqu’à ce qu’il soit en danger de mort, après quoi on recommence ; & comme dit très bien la comédie des plaideurs, cela fait toûjours passer une heure ou deux.
Le grave Magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit de faire ces expériences sur son prochain, va conter à dîner à sa femme ce qui s’est passé le matin. La première fois Madame en a été révoltée, à la seconde elle y a pris goût, parce qu’après tout les femmes sont curieuses : & ensuite la première chose qu’elle lui dit lorsqu’il rentre en robe chez lui, Mon petit cœur, n’avez-vous fait donner aujourd’hui la question à personne ?
Les Français qui passent, je ne sais pourquoi, pour un peuple fort humain, s’étonnent que les Anglais qui ont eu l’inhumanité de nous prendre tout le Canada, aient renoncé au plaisir de donner la question.
Lorsque le Chevalier de la Barre, petit-fils d’un Lieutenant-Général des armées, jeune homme de beaucoup d’esprit & d’une grande espérance, mais ayant toute l’étourderie d’une jeunesse effrénée, fut convaincu d’avoir chanté des chansons impies, & même d’avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les Juges d’Abbeville, gens comparables [II-189] aux Sénateurs Romains, ordonnèrent non seulement qu’on lui arrachât la langue, qu’on lui coupât la main & qu’on brûlât son corps à petit feu, mais ils l’appliquèrent encor à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chanté, & combien de processions il avait vû passer le chapeau sur la tête.
Ce n’est pas dans le treizième ou dans le quatorzième siècle que cette avanture est arrivée, c’est dans le dix-huitième. Les nations étrangères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par les filles d’opéra qui ont les mœurs fort douces, par nos danseurs d’opéra qui ont de la grace, par Mademoiselle Clairon qui déclame des vers à ravir. Elles ne savent pas qu’il n’y a point au fond de nation plus cruelle que la Française.
Les Russes passaient pour des barbares en 1700, nous ne sommes qu’en 1769 ; une impératrice vient de donner à ce vaste État des loix qui auraient fait honneur à Minos, à Numa & à Solon, s’ils avaient eu assez d’esprit pour les inventer. La plus remarquable est la tolérance universelle, la seconde est l’abolition de la torture. La justice & l’humanité ont conduit sa plume ; elle a tout réformé. Malheur à une nation qui étant depuis longtems civilisée est encor conduite par d’anciens usages atroces ! Pourquoi changerions-nous notre jurisprudence ? dit-elle ; l’Europe se sert de nos cuisiniers, de nos tailleurs, de nos perruquiers, donc nos loix sont bonnes.
[II-190]
TRANSUBSTANTATION.↩
Les Protestants, et surtout les philosophes Protestans, regardent la Transubstantiation comme le dernier terme de l’impudence des moines, & de l’imbécillité des laïques. Ils ne gardent aucune mesure sur cette croyance qu’ils appellent monstrueuse ; ils ne pensent pas même qu’il y ait un seul homme de bon sens, qui, après y avoir réfléchi, ait pu l’embrasser sérieusement. Elle est, disent-ils, si absurde, si contraire à toutes les loix de la physique, si contradictoire, que Dieu même ne pourrait pas faire cette opération ; parce que c’est en effet anéantir Dieu que de supposer qu’il fait les contradictoires. Non-seulement un Dieu dans un pain ; mais un Dieu à la place du pain ; cent mille miettes de pain, devenues en un instant autant de Dieux ; cette foule innombrable de Dieux, ne faisant qu’un seul Dieu ; de la blancheur, sans un corps blanc, de la rondeur, sans un corps rond ; du vin, changé en sang, & qui a le goût du vin ; du pain, qui est changé en chair & en fibres, & qui a le goût du pain ; tout cela inspire tant d’horreur & de mépris aux ennemis de la religion catholique, apostolique & romaine, que cet excès d’horreur & de mépris, s’est quelquefois changé en fureur.
Leur horreur augmente, quand on leur dit qu’on voit tous les jours dans les pays [II-191] catholiques, des prêtres, des moines qui, sortant d’un lit incestueux, & n’ayant pas encor lavé leurs mains souillées d’impuretés, vont faire des Dieux par centaines ; mangent & boivent leur Dieu ; chient & pissent leur Dieu. Mais quand ils réfléchissent que cette superstition, cent fois plus absurde & plus sacrilège que toutes celles des Égyptiens, a valu à un prêtre italien quinze à vingt millions de rente, & la domination d’un pays de cent milles d’étendue en long & en large, ils voudraient tous aller, à main armée, chasser ce prêtre qui s’est emparé du palais des Césars. Je ne sais si je serai du voyage ; car j’aime la paix ; mais quand ils seront établis à Rome, j’irai sûrement leur rendre visite.
(Par Mr. Guillaume, ministre protestant.)
[II-191]
VERTU.↩
Qu’est-ce que vertu ? Bienfaisance envers le prochain. Puis-je appeler vertu autre chose que ce qui me fait du bien ? Je suis indigent, tu es libéral. Je suis en danger, tu me secours. On me trompe, tu me dis la vérité. On me néglige, tu me consoles. Je suis ignorant, tu m’instruis. Je t’appellerai sans difficulté vertueux. Mais que deviendront les vertus cardinales & théologales ? Quelques-unes resteront dans les écoles.
Que m’importe que tu sois tempérant ? c’est [II-192] un précepte de santé que tu observes ; tu t’en porteras mieux, & je t’en félicite. Tu as la foi & l’espérance, je t’en félicite encor davantage ; elles te procureront la vie éternelle. Tes vertus théologales sont des dons célestes ; tes cardinales sont d’excellentes qualités qui servent à te conduire : mais elles ne sont point vertus par rapport à ton prochain. Le prudent se fait du bien, le vertueux en fait aux hommes. St. Paul a eu raison de te dire que la charité l’emporte sur la foi, sur l’espérance.
Mais quoi, n’admettra-t-on de vertus que celles qui sont utiles au prochain ! Eh comment puis-je en admettre ? Nous vivons en société ; il n’y a donc de véritablement bon pour nous que ce qui fait le bien de la société. Un solitaire sera sobre, pieux ; il sera revêtu d’un cilice ; eh bien, il sera saint ; mais je ne l’appellerai vertueux que quand il aura fait quelque acte de vertu dont les autres hommes auront profité. Tant qu’il est seul, il n’est ni bienfaisant ni malfaisant ; il n’est rien pour nous. Si St. Bruno a mis la paix dans les familles, s’il a secouru l’indigence, il a été vertueux ; s’il a jeûné, prié dans la solitude, il a été un saint. La vertu entre les hommes est un commerce de bienfaits ; celui qui n’a nulle part à ce commerce ne doit point être compté. Si ce saint était dans le monde, il y ferait du bien sans doute ; mais tant qu’il n’y sera pas, le monde aura raison de ne lui pas donner le nom de vertueux ; il sera bon pour lui, & non pour nous.
[II-193]
Mais, me dites-vous, si un solitaire est gourmand, yvrogne, livré à une débauche secrète avec lui-même, il est donc vertueux s’il a les qualités contraires. C’est de quoi je ne peux convenir ; c’est un très vilain homme s’il a les défauts dont vous parlez : mais il n’est point vicieux, méchant, punissable par rapport à la société à qui ses infamies ne font aucun mal. Il est à présumer que s’il rentre dans la société il y fera du mal, qu’il y sera très vicieux ; & il est même bien plus probable que ce sera un méchant homme, qu’il n’est sûr que l’autre solitaire tempérant & chaste, sera un homme de bien ; car dans la société les défauts augmentent, & les bonnes qualités diminuent.
On fait une objection bien plus forte ; Néron, le Pape Alexandre six, & d’autres monstres de cette espèce, ont répandu des bienfaits ; je réponds hardiment qu’ils furent vertueux ce jour-là.
Quelques théologiens disent que le divin Empereur Antonin n’était pas vertueux, que c’était un Stoïcien entêté, qui non content de commander aux hommes voulait encor être estimé d’eux, qu’il rapportait à lui-même le bien qu’il faisait au genre humain, qu’il fut toute sa vie juste, laborieux, bienfaisant par vanité, & qu’il ne fit que tromper les hommes par ses vertus, je m’écrie alors, Mon Dieu, donnez-nous souvent de pareils fripons !
[II-194]
Addition à la fin de l'article JOB, après ces mots, tant leur vie est courte. I. Part. pag. 367.↩
AU reste le livre de Job est un des plus précieux de toute l'antiquité. Il est évident que ce livre est d'un Arabe qui vivait avant le tems ou nous plaçons Moïfe. Il est dit qu'Eliphaz l'un des interlocuteurs est de Théman , c'est une ancienne ville d'Arabie. Baldad était de Sué autre ville d'Arabie ; Sophar était de Naamath , contrée d'Arabie encor plus orientale.
Mais ce qui est bien plus remarquable , & ce qui démontre que cette fable ne peut être d'un Juif , c'est qu'il y est parlé des trois constellations que nous nommons aujourd'hui l'Ourse , l'Orion & les Hiades. Les Hébreux n'ont jamais eu la moindre connaissance de l'astronomie , ils n'avaient pas même de mot pour exprimer cette science ; tout ce qui regarde les arts de l'esprit leur était inconnu jusqu'au terme de géométrie.
Les Arabes an contraire habitant fous des tentes , étant continuellement à portée' d'observer les astres , furent peut-être les premiers qui réglèrent leurs années par l'inspection du ciel.
Une observation plus importante , c'est qu'iln'est parlé que d'un seul Dieu dans ce livre.C'est une erreur absurde d'avoir imaginé queles Juifs fussent les seuls qui reconnussent un [195] Dieu unique ; c'était la doctrine de presque tout l'Orient , & les Juifs en cela ne furent que des plagiaires come ils le furent en tout.
Dieu dans le 38e chapitre parle lui-même à Job du milieu d'un tourbillon , & c'est ce qui a été imité depuis dans la Genèse. On ne peut trop répéter que les livres Juifs font très nouveaux. L'ignorance & le fanatisme crient que le Pentateuque est le plus ancien livre du monde. Il est évident que ceux de Sanchoniaton ; ceux de Thaut antérieurs de huit cent ans à ceux de Sanchoniaton ; ceux du premier Zerdust , le Shasta , le Védam des Indiens que nous avons encor , les cinq Kings des Chinois, enfin le livre de Job , font d'une antiquité beaucoup plus reculée qu'aucun livre Juif. Il est démontré que ce petit peuple ne put avoir des annales que lorsqu'il eut un gouvernement stable ; qu'il n'eut ce gouvernement que sous ses Rois ; que son jargon ne se forma qu'avec le tems d'un mélange de phénicien & d'arabe. Il y a des preuves incontestables que les Phéniciens cultivaient les lettres très long-tems avant eux. Leur profession fut le brigandage & le courtage ; ils ne furent écrivainsque par hazard. On a perdu les livres des Egyptiens & des Phéniciens ; les Chinois , les Brames , les Guèbres , les Juifs ont conservé les leurs. Tous ces monumens sont curieux ; mais ce ne font que des monumens de l'imagination humaine dans lesquels on ne peut apprendre une seule vérité , soit physique, soit historique. Il n'y a point aujourd'hui de petit [195] livre de physique , qui ne soit plus utile que tous les livres de l'antiquité.
Le bon Calmet ou Dom Calmet ( car les bénédictins veulent qu'on leur donne du Dom ) ce naïf compilateur de tant de rêveries & d'imbécillités , cet homme que sa simplicité a rendit si utile à quiconque veut rire des sottises antiques , rapporte fidèlement les opinions de ceux qui ont voulu deviner la maladie dont Job fut attaqué, comme si Job eût été un personnage réel. Il ne balance point à dire que Job avait la vérole , & il entasse passage sur passage à son ordinaire pour prouver ce qui n'est pas. Il n'avait pas lu l'histoire de la vérole par Astruc : car Astruc n'étant ni un père de l'Eglise ni un docteur de Salamanque , mais un médecin très savant , le bon homme Calmet ne savait pas seulement qu'il existât; les moines compilateurs sont de pauvres gens.
Notes↩
[1] On devrait condamner messieurs les … à présenter tous les ans à la police un enfant de leur façon ; l’abbé des Fontaines fut sur le point d’être cuit en place de Grêve ; des protecteurs le sauvèrent. Il fallait une victime, on cuisit des Chaufours à sa place : cela est trop fort ; est modus in rebus : on doit proportionner les peines aux délits : qu’auraient dit César, Alcibiade, le roi de Bythinie Nicomède, le roi de France Henri III, & tant d’autres rois ? Quand on brûla des Chaufours, on se fonda sur les Établissements de saint Louis, mis en français au quinzième siècle. Si aucun est soupçonné de …… doit être mené à l’évêque ; & se, il en étoit prouvé, l’en le doit ardoir, & tuit li mueble sont au baron. &c. Mais St Louis ne dit pas ce qu’il faut faire au baron, si le baron est soupçonné de …… St Louis entend les hérétiques, qu’on n’appelait point alors d’un autre nom. Un équivoque fit brûler à Paris des Chaufours gentilhomme lorrain. Despréaux eut bien raison de faire une satire contre l’équivoque, elle a causé bien plus de mal qu’on ne croit.
[2] Commentarium rerum Gallicarum, L. 28.
[3] Voyez l’article du Ciel.
[4] Voyez l’article Ame.
[5] Ce sont les Juifs des dix tribus, qui dans leur dispersion, pénétrèrent jusqu’à la Chine ; ils y sont appelés Sinous.
[8] Eh bien ! tristes ennemis de la raison & de la vérité, direz-vous encor que cet ouvrage enseigne la mortalité de l’ame ? Ce morceau a été imprimé dans toutes les éditions. De quel front osez-vous donc le calomnier ? Hélas, si vos ames conservent leur caractère pendant l’éternité, elles seront éternellement des ames bien sottes & bien injustes. Non, les auteurs de cet ouvrage raisonnable & utile ne vous disent point que l’ame meurt avec le corps ; ils vous disent seulement que vous êtes des ignorans. N’en rougissez pas ; tous les sages ont avoué leur ignorance, aucun d’eux n’a été assez impertinent pour connaître la nature de l’ame. Gassendi en résumant tout ce qu’a dit l’antiquité, vous parle ainsi. Vous savez que vous pensez, mais vous ignorez quelle espèce de substance vous êtes, vous qui pensez. Vous ressemblez à un aveugle qui sentant la chaleur du soleil, croirait avoir une idée distincte de cet astre. Lisez le reste de cette admirable lettre à Descartes, lisez Locke ; relisez cet ouvrage-ci attentivement, & vous verrez qu’il est impossible que nous ayons la moindre notion de la nature de l’ame, par la raison qu’il est impossible que la créature connaisse les secrets ressorts du Créateur ; vous verrez que sans connaître le principe de nos pensées, il faut tâcher de penser avec justesse, & avec justice, qu’il faut être tout ce quevous n’êtes pas, modeste, doux, bienfaisant, indulgent ; ressembler à Cu-su et à Kou, et non pas à Thomas d’Aquin ou à Scot, dont les ames étaient fort ténébreuses, ou à Calvin ou à Luther, dont les ames étaient bien dures et bien emportées. Tâchez que vos ames tiennent un peu de la nôtre ; alors vous vous moquerez prodigieusement de vous-mêmes.
[7] Stelca isant Erepi, signifie en chinois, l’abbé Castel de Saint Pierre.
[8] C’est une chose remarquable, qu’en retournant Décon & Vis-Brunk, qui sont des noms chinois, on retrouve Condé & Brunswik, tant les grands hommes sont célèbres dans toute la terre.
[9] Les Canusi sont les anciens prêtres du Japon.
[10] Pauxcospie, anagramme d’épiscopaux.
[11] On voit assez que les Breuxch sont les Hébreux, et sic de cæteris.
[12] Racine, probablement, Louis Racine, fils de l’admirable Racine.
[13] N. B. Cet Indien Recina, sur la fois des rêveurs de son pays, a cru qu’on ne pouvait faire de bonnes sausses que quand Brama par une volonté toute particulière enseignait lui-même la sausse à ses favoris, qu’il y avait un nombre infini de cuisiniers auxquels il était impossible de faire un ragoût avec la ferme volonté d’y réussir, & que Brama leur en ôtait les moyens par pure malice. On ne croit pas au Japon une pareille impertinence, & on y tient pour une vérité incontestable cette sentence Japonoise.
God never acts by partial will, but by general Laws.
[14] Voyez l’article Certitude, Dictionnaire encyclopédique.
[15] Les chrétiens, par une de ces fraudes qu’on appelle pieuses, falsifièrent grossièrement un passage de Joseph. Ils supposent à ce Juif si entêté de sa religion, quatre lignes ridiculement interpolées, & au bout de ce passage ils ajoutent, Il était le Christ. Quoi ! si Joseph avait entendu parler de tant d’événements qui étonnent la nature, Joseph n’en aurait dit que la valeur de quatre lignes dans l’histoire de son pays !Quoi ! ce Juif obstiné aurait dit, Jésus était le Christ. Eh ! si tu l’avais cru Christ, tu aurais donc été chrétien. Quelle absurdité de faire parler Joseph en chrétien ! comment se trouve-t-il encor des théologiens assez imbéciles ou assez insolents pour essayer de justifier cette imposture des premiers chrétiens reconnus pour fabricateurs d’impostures cent fois plus fortes !
[16] Arnobe liv. 5. Simbola quæ rogata sacrorum &c. Voyez aussi Clément d’Alexandrie dans son sermon protreptique, ou cohortatio ad gentes.
[17] Un lis est de 124 pas.
[18] Un pauvre d’esprit dans un petit écrit honnête, poli,& surtout bien raisonné, objecte que si le prince ordonne à B. de rester exposé au canon, il y restera. Oui, sans doute, s’il a plus de courage, ou plutôt plus de crainte de la honte que d’amour de la vie, comme il arrive très souvent. Premièrement il s’agit ici d’un cas tout différent. Secondement, quand l’instinct de la crainte de la honte l’emporte sur l’instinct de la conservation de soi-même, l’homme est autant nécessité à demeurer exposé au canon, qu’il est nécessité à fuir quand il n’est pas honteux de fuir. Le pauvre d’esprit était nécessité à faire des objections ridicules, & à dire des injures ; & les philosophes se sentent nécessités à se moquer un peu de lui, & à lui pardonner.
[19] Voyez le poëme de la Loi naturelle.
[20] Le pauvre d’esprit que nous avons déjà cité, ayant lû ce passage dans une mauvaise édition où il y avait un point après ce mot bonne foi, crut que l’auteur voulait dire que les voleurs jouissaient de bonne foi. Nous savons bien que ce pauvre d’esprit est méchant, mais de bonne foi il ne peut être dangereux.
[21] iv. Reg. viii. 12. 13. 14.
[22] Quæst. 1. 2. 4. 23. &c.
[23] Act. Apost., c. v. 34. 35. 36.
[24] Act. Apost. c. 8. 9.
[25] Socr. Hist. eccl. l. 2. chap. 38.
[26] Ospiniam, page 230.
[27] Est-il bien vrai qu’il y ait eu un Moïse ? Si un homme qui commandait à la nature entière eût existé chez les Égyptiens, de si prodigieux événements n’auraient-ils pas fait la partie principale de l’histoire d’Égypte ? Sanchoniaton, Manéton, Megastène, Hérodote n’en auraient-ils pas parlé ? Joseph l’historien a recueilli tous les témoignages possibles en faveur des Juifs ; il n’ose dire qu’aucun des auteurs qu’il cite, ait dit un seul mot des miracles de Moïse. Quoi ! le Nil aura été changé en sang ; un ange aura égorgé tous les premiers-nés dans l’Égypte ; la mer se sera ouverte, ses eaux auront été suspendues à droite & à gauche, & nul auteur n’en aura parlé ! & les nations auront oublié ces prodiges, & il n’y aura aucun petit peuple d’esclaves barbares qui nous aura conté ces histoires des milliers d’années après l’événement ?
Quel est donc ce Moïse inconnu à la terre entière jusqu’au tems où un Ptolomée eut, dit-on, la curiosité de faire traduire en grec les écrits des Juifs ? Il y avait un grand nombre de siècles que les fables orientales attribuaient à Bacchus tout ce que les Juifs ont dit de Moïse. Bacchus avait passé la mer Rouge à pied sec, Bacchus avait changé les eaux en sang, Bacchus avait journellement opéré des miracles avec sa verge ;tous ces faits étaient chantés dans les orgies de Bacchus avant qu’on eût le moindre commerce avec les Juifs, avant qu’on sût seulement si ce pauvre peuple avait des livres. N’est-il pas de la plus extrême vraisemblance que ce peuple si nouveau, si longtems errant, si tard connu, établi si tard en Palestine, prît avec la langue phénicienne les fables phéniciennes,sur lesquelles il enchérit encor ainsi que font tous les imitateurs grossiers ? Un peuple si pauvre, si ignorant, si étranger dans tous les arts, pouvait-il faire autre chose que de copier ses voisins ? Ne sait-on pas que jusqu’au nom d’Adonaï, d’Idaho, d’Éloï, ou Éloa, qui signifia Dieu chez la nation juive, tout était phénicien ?
[28] Actes des Apôtres, chapitre 23. vs. 6. 7. 8.
[29] I Épît. aux Thess. ch. 4.
[30] Un pédant a cru trouver une erreur dans ce passage : il a prétendu qu’on a mal traduit par le mot de verre le gobelet qui était, dit-il, de bois ou de métal ; mais comment le vin aurait-il brillé dans un gobelet de métal ou de bois ? & puis qu’importe !
L’A, B, C,
OU
DIALOGUES ENTRE A, B, C;
TRADUIT DE L’ANGLAIS DE M. HUET [1]
[311]
PREMIER ENTRETIEN.
SUR HOBBES, GROTIUS, ET MONTESQUIEU.↩
A.
Eh bien! vous avez lu Grotius, Hobbes et Montesquieu. Que pensez-vous de ces trois hommes célèbres ?
B.
Grotius m’a souvent ennuyé ; mais il est très-savant : il semble aimer la raison et la vertu ; mais la raison et la vertu touchent [312] peu quand elles ennuient ; il me parait de plus qu'il est quelquefois un fort mauvais raisonneur, Montesquieu a beaucoup d'imagination sur un sujet qui semblait n'exiger que du jugement : il se trompe trop souvent sur les faits ; mais je crois qu'il se trompe aussi quelquefois quand il raisonne, Hobbes est bien dur, ainsi que son style, mais j'ai peur que sa dureté ne tienne souvent à la vérité. En un mot, Grotius est un franc pédant, Hobbes un triste philosophe, et Montesquieu un bel esprit humain.
C.
Je suis assez de cet avis, La vie est trop courte, et on a trop de choses à faire pour apprendre de Grotius [2]que, selon Tertullien, « la cruauté, la fraude et l'injustice, sont les compagnes de la guerre » ; que « Carnéade défendait le faux comme le vrai » ; qu'Horace a dit dans une satire : « La nature ne peut discerner le juste de l'injuste [3]; » que, selon Plutarque, « les enfants ont de [313] la compassion » ; que Chrysippe a dit : « L'origine du droit est dans Jupiter ; » que si on en croit Florentin, « la nature a mis entre les hommes une espèce de parenté » ; que Carnéade a dit que « l'utilité est la mère de la justice ».
J'avoue que Grotius me fait grand plaisir quand il dit, dès son premier chapitre du premier livre, que « la loi des Juifs n'obligeait point les étrangers ». Je pense avec lui qu'Alexandre et Aristote ne sont point damnés pour avoir gardé leur prépuce, et pour n'avoir pas employé le jour du sabbat à ne rien faire. De braves théologiens se sont élevés contre lui avec leur absurdité ordinaire; mais moi qui, Dieu merci, ne suis point théologien, je trouve Grotius un très-bon homme.
J'avoue qu'il ne sait ce qu'il dit quand il prétend que les Juifs avaient enseigné la circoncision aux autres peuples. Il est assez reconnu aujourd'hui que la petite horde judaïque avait pris toutes ses ridicules coutumes des peuples puissants dont elle était environnée; mais que fait la circoncision au « droit de la guerre et de la paix [4] » ?
A.
Vous avez raison ; les compilations de Grotius ne méritaient pas le tribut d'estime que l'ignorance leur a payé. Citer les pensées [314] des vieux auteurs qui ont dit le pour et le contre, ce n'est pas penser. C'est ainsi qu'il se trompe très-grossièrement dans son livre de la Vérité du christianisme, en copiant les auteurs chrétiens qui ont dit que les Juifs, leurs prédécesseurs, avaient enseigné le monde ; tandis que la petite nation juive n'avait elle-même jamais eu cette prétention insolente ; tandis que, renfermée dans les rochers de la Palestine et dans son ignorance, elle n'avait pas seulement reconnu l'immortalité de l'âme, que tous ses voisins admettaient.
C'est ainsi qu'il prouve le christianisme par Hystaspe et par les sibylles, et l'aventure de la baleine qui avala Jonas par un passage de Lycophron. Le pédantisme et la justesse de l'esprit sont incompatibles.
Montesquieu n'est pas pédant; que pensez-vous de son Esprit des lois [5] ?
Il m'a fait un grand plaisir, parce qu'il y a beaucoup de plaisanteries, beaucoup de choses vraies, hardies et fortes, et des chapitres entiers dignes des Lettres persanes : le chapitre xxvii du livre XIX est un portrait de votre Angleterre, dessiné dans le goût de Paul Véronôse ; j'y vois des couleurs brillantes, de la facilité de pinceau, et quelques défauts de costume. Celui de l'Inquisition [6], et celui des esclaves nègres [7]sont fort au-dessus de Callot. Partout il combat le despotisme, rend les gens de finance odieux, les courtisans méprisables, les moines ridicules : ainsi tout ce qui n'est ni moine, ni financier, ni employé dans le ministère, ni aspirant à l'être, a été charmé, et surtout en France.
Je suis fâché que ce livre soit un labyrinthe sans fil, et qu'il n'y ait aucune méthode. Je suis encore plus étonné qu'un homme qui écrit sur les lois dise dans sa préface « qu'on ne trouvera point de saillies dans son ouvrage [8] » ; et il est encore plus étrange que son livre soit un recueil de saillies. C'est Michel Montaigne législateur : aussi était-il du pays de Michel Montaigne.
Je ne puis m'empêcher de rire en parcourant plus de cent chapitres qui ne contiennent pas douze lignes, et plusieurs qui [315] n'en contiennent que deux[9].Il semble que l'auteur ait toujours voulu jouer avec son lecteur dans la matière la plus grave.
On ne croit pas lire un ouvrage sérieux lorsque, après avoir cité les lois grecques et romaines, il parle de celles de Bantam, de Cochin, de Tunquin, d'Achem, de Bornéo, de Jacatra, de Formose, comme s'il avait des mémoires fidèles du gouvernement de tous ces pays. Il mêle trop souvent le faux avec le vrai, en physique, en morale, en histoire : il vous dit [10], d'après Puffendorf, que, du temps du roi Charles IX, il y avait vingt millions d'hommes en France. Puffendorf va même jusqu'à vingt-neuf millions : il parlait fort au hasard. On n'avait jamais fait en France de dénombrement ; on était trop ignorant alors pour soupçonner seulement qu'on pût deviner le nombre des habitants par celui des naissances et des morts. La France n'avait point en ce temps la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Boussillon, l'Artois, le Cambrésis, la moitié de la Flandre ; et aujourd'hui qu'elle possède toutes ces provinces, il est prouvé qu'elle ne contient qu'environ vingt millions d'âmes tout au plus, par le dénombrement des feux assez exactement donné en 1751 [11].
Le même auteur assure [12], sur la foi de Chardin, qu'il n'y a que le petit fleuve Cyrus qui soit navigable en Perse. Chardin n'a point fait cette bévue. Il dit au chapitre i, volume II [13], « qu'il n'y a point de fleuve qui porte bateau dans le cœur du royaume »; mais sans compter l'Euphrate, le Tigre, et l'Indus, toutes les provinces frontières sont arrosées de fleuves qui contribuent à la facilité du commerce et à la fertilité de la terre ; le Zinderud traverse Ispahan; l'Agi se joint au Kur, etc. Et puis, quel rapport l'Esprit des lois peut-il avoir avec les fleuves de la Perse ?
Les raisons qu'il apporte de l'établissement des grands empires en Asie, et de la multitude des petites puissances en Europe, semblent aussi fausses que ce qu'il dit des rivières de la Perse [14]. « En Europe, dit-il, les grands empires n'ont jamais pu subsister; » la puissance romaine y a pourtant subsisté plus de cinq cents ans : et « la cause, continue-t-il, de la durée de ces grands empires, [316] c'est qu'il y a de grandes plaines ». Il n'a pas songé que la Perse est entrecoupée de montagnes; il ne s'est pas souvenu du Caucase, du Taurus, de l'Ararat, de l'Immaüs, du Saron, dont les branches couvrent l'Asie. Il ne faut ni donner des raisons des choses qui n'existent point, ni en donner de fausses des choses qui existent.
Sa prétendue influence des climats [15] sur la religion est prise de Chardin, et n'en est pas plus vraie; la religion mahométane, née dans le terrain aride et brûlant de la Mecque, fleurit aujourd'hui dans les belles contrées de l'Asie Mineure, de la Syrie, de l'Egypte, de la Thrace, de la Mysie, de l'Afrique septentrionale, de la Servie, de la Bosnie, de la Dalmatie, de l'Épire, de la Grèce; elle a régné en Espagne, et il s'en est fallu bien peu qu'elle ne soit allée jusqu'à Rome. La religion chrétienne est née dans le terrain pierreux de Jérusalem, et dans un pays de lépreux, où le cochon est un aliment presque mortel, et défendu par la loi. Jésus ne mangea jamais de cochon, et on en mange chez les chrétiens : leur religion domine aujourd'hui dans des pays fangeux où l'on ne se nourrit que de cochons, comme dans la Vestphalie. On ne finirait pas si on voulait examiner les erreurs de ce genre qui fourmillent dans ce livre.
Ce qui est encore révoltant pour un lecteur un peu instruit, c'est que presque partout les citations sont fausses ; il prend presque toujours son imagination pour sa mémoire.
Il prétend que, dans le Testament attribué au cardinal de Richelieu, il est dit [16] que, « si dans le peuple il se trouve quelque malheureux honnête homme, il ne faut point s'en servir: tant il est vrai que la vertu n'est pas le ressort du gouvernement monarchique ».
Le misérable Testament faussement attribué au cardinal de Richelieu dit précisément tout le contraire. Voici ses paroles, au chapitre iv [17] : « On peut dire hardiment que de deux personnes dont le mérite est égal, celle qui est la plus aisée en ses affaires est préférable à l'autre, étant certain qu'il faut qu'un pauvre magistrat ait l'âme d'une trempe bien forte si elle ne se laisse quelquefois amollir par la considération de ses intérêts. Aussi l'expérience nous apprend que les riches sont moins sujets à concussion que les autres, et que la pauvreté contraint un officier à être fort soigneux du revenu du sac. »
[317]
Montesquieu, il faut l'avouer, ne cite pas mieux les auteurs grecs que les français. Il leur fait souvent dire le contraire de ce qu'ils ont dit.
Il avance, en parlant de la condition des femmes dans les divers gouvernements, ou plutôt en promettant d'en parler, que chez les Grecs [18] « l'amour n'avait qu'une forme que l'on n'ose dire ». Il n'hésite pas à prendre Plutarque même pour son garant : il fait dire à Plutarque que « les femmes n'ont aucune part au véritable amour ». Il ne fait pas réflexion que Plutarque fait parler plusieurs interlocuteurs : il y a un Protogène [19] qui déclame contre les femmes, mais Daphneus prend leur parti; Plutarque décide pour Daphneus ; il fait un très-bel éloge de l'amour céleste et de l'amour conjugal; il finit par rapporter plusieurs exemples de la fidélité et du courage des femmes. C'est même dans ce dialogue qu'on trouve l'histoire de Gamma , et celle d'Éponine, femme de Sabinus, dont les vertus ont servi de sujet à des pièces de théâtre [20].
Enfin il est clair que Montesquieu, dans l'Esprit des lois, a calomnié l'esprit de la Grèce, en prenant une objection que Plutarque réfute pour une loi que Plutarque recommande.[21]
« Des cadis ont soutenu que le Grand Seigneur n'était point obligé de tenir sa parole ou son serment, lorsqu'il bornait par là son autorité. »
Ricaut, cité en cet endroit, dit seulement, page 18 de l'édition d'Amsterdam, de 1671 :
« Il y a même de ces gens-là qui soutiennent que le Grand Seigneur peut se dispenser des promesses qu'il a faites avec serment, quand, pour les accomplir, il faut donner des bornes à son autorité. »
Ce discours est bien vague. Le sultan des Turcs ne peut promettre qu'à ses sujets ou aux puissances voisines. Si ce sont des promesses à ses sujets, il n'y a point de serment ; si ce sont des traités de paix, il faut qu'il les tienne comme les autres princes, ou qu'il fasse la guerre. L'Alcoran ne dit en aucun endroit qu'on peut violer son serment, et il dit en cent endroits qu'il faut le garder. Il se peut que, pour entreprendre une guerre injuste, comme elles le sont presque toutes, le Grand Turc assemble un conseil de conscience, comme ont fait plusieurs princes chrétiens, [318] afin de faire le mal en conscience ; il se peut que quelques docteurs musulmans aient imité les docteurs catholiques, qui ont dit qu'il ne faut garder la foi ni aux infidèles ni aux hérétiques; mais il reste à savoir si cette jurisprudence est celle des Turcs.
L'auteur de l' Esprit des lois donne cette prétendue décision des cadis comme un preuve du despotisme du sultan ; il semble que ce serait au contraire une preuve qu'il est soumis aux lois, puisqu'il serait obligé de consulter des docteurs pour se mettre au-dessus des lois. Nous sommes voisins des Turcs, et nous ne les connaissons pas [22]. Le comte de Marsigli, qui a vécu si longtemps au milieu d'eux, dit qu'aucun auteur n'a donné une véritable connaissance ni de leur empire, ni de leurs lois. Nous n'avons eu même aucune traduction tolérable de l'Alcoran, avant celle que nous a donnée l'Anglais Sale [23] en 1734. Presque tout ce qu'on a dit de leur religion et de leur jurisprudence est faux, et les conclusions que l'on en tire tous les jours contre eux sont trop peu fondées. On ne doit, dans l'examen des lois, citer que des lois reconnues.
« [24] Tout bas commerce était infâme chez les Grecs. » Je ne sais pas ce que Montesquieu entend par bas commerce; mais je sais que, dans Athènes, tous les citoyens commerçaient, que Platon vendit de l'huile, et que le père du démagogue Démosthène était marchand de fer. La plupart des ouvriers étaient des étrangers ou des esclaves : il nous est important de remarquer que le négoce n'était point incompatible avec les dignités dans les républiques de la Grèce, excepté chez les Spartiates, qui n'avaient aucun commerce.
« J'ai ouï plusieurs fois déplorer, dit-il [25], l'aveuglement du conseil de François I er, qui rebuta Christophe Colomb qui lui proposait les Indes. » Vous remarquerez que François Ier n'était pas né lorsque Colomb découvrit les îles de l'Amérique.
Puisqu'il s'agit ici de commerce, observons que l'auteur condamne une ordonnance du conseil d'Espagne qui défend d'employer l'or et l'argent en dorure [26] « Un décret pareil, dit-il, serait semblable à celui que feraient les états de Hollande s'ils défendaient la consommation de la cannelle. » Il ne songe pas que les Espagnols, n'ayant point de manufactures, auraient acheté les [319] galons et les étoffes de l'étranger, et que les Hollandais ne pouvaient acheter de la cannelle. Ce qui était très-raisonnable en Espagne eût été très-ridicule en Hollande.
Si un roi donnait sa voix dans les jugements criminels,[27]
« il perdrait le plus bel attribut de sa souveraineté, qui est celui de faire grâce. Il serait insensé qu'il fît et défît ses jugements. Il ne voudrait pas être en contradiction avec lui-même. Outre que cela confondrait toutes les idées, on ne saurait si un homme serait absous ou s'il recevrait sa grâce ».
Tout cela est évidemment erroné. Qui empêcherait le souverain de faire grâce après avoir été lui-même au nombre des juges ? Comment est-on en contradiction avec soi-même, en jugeant selon la loi, et en pardonnant selon sa clémence? En quoi les idées seraient-elles confondues ? Comment pourrait-on ignorer que le roi lui a publiquement fait grâce après la condamnation ?
Dans le procès fait au duc d'Alençon [28], pair de France, en 1458, le parlement, consulté par le roi pour savoir s'il avait le droit d'assister au jugement du procès d'un pair de France, répondit qu'il avait trouvé par ses registres que non-seulement les rois de France avaient ce droit, mais qu'il était nécessaire qu'ils y assistassent en qualité de premiers pairs.
Cet usage s'est conservé en Angleterre. Les rois d'Angleterre délèguent à leur place, dans ces occasions, un grand steward qui les représente. L'empereur peut assister au jugement d'un prince de l'empire. Il est beaucoup mieux sans doute qu'un souverain n'assiste point aux jugements criminels : les hommes sont trop faibles et trop lâches ; l'haleine seule du prince ferait trop pencher la balance.
« Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie. » [29]
Le contraire est d'une vérité reconnue. Ils ont fait de la chambre des communes une puissance intermédiaire qui balance celle des pairs. Ils n'ont fait que saper la puissance ecclésiastique, qui doit être une société priante, édifiante, exhortante, et non pas puissante.
« Il ne suffit pas qu'il y ait, dans une monarchie, des rangs intermédiaires ; il faut encore un dépôt de lois... L'ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le [320] gouvernement civil, exigent qu'il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient ensevelies. » [30]
Cependant le dépôt des lois de l'empire est à la diète de Ratisbonne entre les mains des princes : ce dépôt est en Angleterre dans la chambre haute ; en Suède, dans le sénat composé de nobles; et, en dernier lieu, l'impératrice Catherine II, dans son nouveau code, le meilleur de tous les codes, remet ce dépôt au sénat composé des grands de l'empire.
Ne faut-il pas distinguer entre les lois politiques et les lois de la justice distributive? Les lois politiques ne doivent-elles pas avoir pour gardiens les principaux membres de l'État? Les lois du tien et du mien, l'ordonnance criminelle [31], n'ont besoin que d'être bien faites et d'être imprimées; le dépôt en doit être chez les libraires. Les juges doivent s'y conformer; et quand elles sont mauvaises, comme il arrive fort souvent, alors ils doivent faire des remontrances à la puissance suprême pour les faire changer.
Le même auteur prétend qu'au [32] Tunquin tous les magistrats et les principaux officiers militaires sont eunuques, et que chez les lamas [33] la loi permet aux femmes d'avoir plusieurs maris. Quand ces fables seraient vraies, qu'en résulterait-il? Nos magistrats voudraient-ils être eunuques, et n'être qu'en quatrièmes ou en cinquièmes auprès de mesdames les conseillères ?
Pourquoi perdre son temps à se tromper sur les prétendues flottes de Salomon envoyées d'Asiongaber en Afrique [34] , et sur les chimériques voyages depuis la mer Rouge jusqu'à celle de Rayonne, et sur les richesses encore plus chimériques de Sofala? Quel rapport entre toutes ces digressions erronées et l'Esprit des lois ?
Je m'attendais à voir comment les Décrétales changèrent toute la jurisprudence de l'ancien code romain; par quelles lois Charlemagne gouverna son empire, et par quelle anarchie le gouvernement féodal le bouleversa; par quel art et par quelle audace Grégoire VII et ses successeurs écrasèrent les lois des royaumes et des grands fiefs sous l'anneau du pêcheur; par quelles secousses on est parvenu à détruire la législation papale; j'espérais voir l'origine des bailliages qui rendirent la justice presque partout depuis les Othon, et celle des tribunaux appelés i ou audience, ou banc du roi, ou échiquier; je désirais de connaître l'histoire des lois sous lesquelles nos pères et leurs enfants ont [321] vécu, les motifs qui les ont établies, négligées, détruites, renouvelées : je n'ai malheureusement rencontré souvent que de l'esprit, des railleries, des imaginations et des erreurs.
Par quelle raison les Gaulois, asservis et dépouillés par les Romains, continuèrent-ils à vivre sous les lois romaines quand ils furent de nouveau subjugués et dépouillés par une horde de Francs? Quels furent bien précisément les lois et les usages de ces nouveaux brigands?
Quels droits s'arrogèrent les évêques gaulois quand les Francs furent les maîtres? N'eurent-ils pas quelquefois part à l'administration publique avant que le rebelle Pépin leur donnât place dans le parlement de la nation ?
Y eut-il des fiefs héréditaires avant Charlemagne? Une foule de questions pareilles se présentent à l'esprit. Montesquieu n'en résout aucune.
Quel fut ce tribunal abominable institué par Charlemagne en Vestphalie, tribunal de sang appelé le conseil veimique [35], tribunal plus horrible encore que l'Inquisition, tribunal composé de juges inconnus, qui jugeait à mort sur le simple rapport de ses espions, et qui avait pour bourreau le plus jeune des conseillers de ce petit sénat d'assassins? Quoi! Montesquieu me parle des lois de Bantam, et il ne connaît pas les lois de Charlemagne, et il le prend pour un bon législateur!
Je cherchais[36] un guide dans un chemin difficile : j'ai trouvé un compagnon de voyage qui n'était guère mieux instruit que moi; j'ai trouvé l'esprit de l'auteur, qui en a beaucoup, et rarement l'esprit des lois; il sautille plus qu'il ne marche; il brille plus qu'il n'éclaire; il satirise quelquefois plus qu'il ne juge; et il fait souhaiter qu'un si beau génie eût toujours plus cherché à instruire qu'à surprendre.
Ce livre très défectueux est plein de choses admirables dont on a fait de détestables copies. Enfin des fanatiques l'ont insulté par les endroits mêmes qui méritent les remerciements du genre humain.
Malgré ses défauts, cet ouvrage doit être toujours cher aux hommes, parce que l'auteur a dit sincèrement ce qu'il pense, au lieu que la plupart des écrivains de son pays, à commencer par [322] le grand Bossuet, ont dit très-souvent ce qu'ils ne pensaient pas. Il a partout fait souvenir les hommes qu'ils sont libres; il présente à la nature humaine ses titres qu'elle a perdus dans la plus grande partie de la terre; il combat la superstition, il inspire la morale.
Je vous avouerai encore combien je suis affligé qu'un livre qui pouvait être si utile soit fondé sur une distinction chimérique. La vertu, dit-il, est le principe des républiques [37], l'honneur l'est des monarchies [38] On n'a jamais assurément formé des républiques par vertu. L'intérêt public s'est opposé à la domination d'un seul ; l'esprit de propriété, l'ambition de chaque particulier, ont été un frein à l'ambition et à l'esprit de rapine. L'orgueil de chaque citoyen a veillé sur l'orgueil de son voisin. Personne n'a voulu être l'esclave de la fantaisie d'un autre. Voilà ce qui établit une république, et ce qui la conserve. Il est ridicule d'imaginer qu'il faille plus de vertu à un Grison qu'à un Espagnol[39].
[323]
Que l'honneur soit le principe des seules monarchies, ce n'est pas une idée moins chimérique ; et il le fait bien voir lui-même sans y penser. « La nature de l'honneur, dit-il au chapitre VII du livre III, est de demander des préférences et des distinctions. Il est donc, par la chose [même, placé dans le gouvernement monarchique. »
Certainement, par la chose même, on demandait, dans la république romaine, la préture, le consulat, l'ovation, le triomphe ; ce sont là des préférences, des distinctions qui valent bien les titres qu'on achète souvent dans les monarchies, et dont le tarif est fixé. Il y a un autre fondement de son livre qui ne me paraît pas porter moins à faux : c'est la division des gouvernements en républicain, en monarchique, et en despotique [40].
Il a plu à nos auteurs (je ne sais trop pourquoi) d'appeler despotes les souverains de l'Asie et de l'Afrique ; on entendait autrefois par un despote un petit prince d'Europe, vassal du Turc, et vassal amovible, une espèce d'esclave couronné gouvernant d'autres esclaves. Ce mot despote, dans son origine, avait signifié, chez les Grecs, maître de maison, pire de famille. Nous donnons aujourd'hui libéralement ce titre à l'empereur de Maroc, au Grand Turc, au pape, à l'empereur de la Chine. Montesquieu, au commencement du second livre (chap. i), définit ainsi le gouvernement despotique : « Un seul homme, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices, »
Or il est très-faux qu'un tel gouvernement existe, et il me paraît très-faux qu'il puisse exister. L'Alcoran et les commentaires approuvés sont les lois des musulmans : tous les monarques de cette religion jurent sur l'Alcoran d'observer ces lois. [324] Les anciens corps de milice et les gens de loi ont des privilèges immenses; et quand les sultans ont voulu violer ces privilèges, ils ont tous été étranglés, ou du moins solennellement déposés.
Je n'ai jamais été à la Chine, mais j'ai vu plus de vingt personnes qui ont fait ce voyage, et je crois avoir lu tous les auteurs qui ont parlé de ce pays; je sais, beaucoup plus certainement que Rollin ne savait l'histoire ancienne; je sais, dis-je, parle rapport unanime de nos missionnaires de sectes différentes, que la Chine est gouvernée par les lois, et non par une seule volonté arbitraire ; je sais qu'il y a dans Pékin six tribunaux suprêmes auxquels ressortissent quarante-quatre autres tribunaux; je sais que les remontrances faites à l'empereur par ces six tribunaux suprêmes ont force de loi ; je sais qu'on n'exécute pas à mort un portefaix, un charbonnier, aux extrémités de l'empire, sans avoir envoyé son procès au tribunal suprême de Pékin, qui en rend compte à l'empereur. Est-ce là un gouvernement arbitraire et tyrannique ? L'empereur y est plus révéré que le pape ne l'est à Rome ; mais, pour être respecté, faut-il régner sans le frein des lois ? Une preuve que ce sont les lois qui règnent à la Chine, c'est que le pays est plus peuplé que l'Europe entière ; nous avons porté à la Chine notre sainte religion, et nous n'y avons pas réussi. Nous aurions pu prendre ses lois en échange, mais nous ne savons peut-être pas faire un tel commerce [41].
Il est bien sûr que l'évêque de Rome est plus despotique que l'empereur de la Chine, car il est infaillible, et l'empereur chinois ne l'est pas : cependant cet évêque est encore assujetti à des lois.
[325]
Le despotisme n'est que l'abus de la monarchie, une corruption d'un beau gouvernement. J'aimerais autant mettre les voleurs de grand chemin au rang des corps de l'État que de placer les tyrans au rang des rois.
A.
Vous ne me parlez pas de la vénalité des emplois de judicature [42], de ce beau trafic des lois que les Français seuls connaissent dans le monde entier. Il faut que ces gens-là soient les plus grands commerçants de l'univers, puisqu'ils vendent et achètent jusqu'au droit de juger les hommes. Comment diable! si j'avais l'honneur d'être né Picard ou Champenois, et d'être le fils d'un traitant ou d'un fournisseur de vivres, je pourrais, moyennant douze ou quinze mille écus, devenir, moi septième, le maître absolu de la vie et de la fortune de mes concitoyens! On m'appellerait monsieur [43] dans le protocole de mes collègues, et j'appellerais les plaideurs par leur nom tout court, fussent-ils des Châtillon et des Montmorency, et je serais tuteur des rois[44] pour mon argent! C'est un excellent marché. J'aurais de plus le plaisir de faire brûler tous les livres qui me déplairaient par celui que Jean-Jacques Rousseau veut faire beau-père du dauphin. C'est un grand droit [45].
B.
Il est vrai que Montesquieu a la faiblesse de dire que la vénalité des charges est bonne dans les États monarchiques [46] . Que voulez-vous ? il était président à mortier en province [47]. Je n'ai jamais vude mortier, mais je m'imagine que c'est un superbe ornement. Il est bien difficile à l'esprit le plus philosophique de ne pas payer son tribut à l'amour-propre. Si un épicier parlait de législation, il voudrait que tout le monde achetât de la cannelle et de la muscade,
A.
Tout cela n'empêche pas qu'il n'y ait des morceaux excellents dans l'Esprit des lois. J'aime les gens qui pensent et qui me font penser. En quel rang mettez-vous ce livre?
[326]
B.
Dans le rang des ouvrages de génie qui font désirer la perfection. Il me paraît un édifice mal fondé, et construit irrégulièrement, dans lequel il y a beaucoup de Idéaux appartements vernis et dorés.
A.
Je passerais volontiers quelques heures dans ces appartements, mais je ne puis demeurer un moment dans ceux de Grotius : ils sont trop mal tournés, et les meubles trop à l'antique ; mais vous, comment trouvez-vous la maison que Hobbes a bâtie en Angleterre?
B.
Elle a tout à fait l'air d'une prison, car il n'y loge guère que des criminels et des esclaves. Il dit que l'homme est né ennemi de l'homme, que le fondement de la société est l'assemblage de tous contre tous ; il prétend que l'autorité seule fait les lois, que la vérité [48] ne s'en mêle pas ; il ne distingue point la royauté de la tyrannie. Chez lui la force fait tout : il y a bien quelque chose de vrai dans quelques-unes de ces idées ; mais ses erreurs m'ont si fort révolté que je ne voudrais ni être citoyen de sa ville quand je lis son De Cive, ni être mangé par sa grosse bête de Léviathan.
C.
Vous me paraissez, messieurs, fort peu contents des livres que vous avez lus ; cependant vous en avez fait votre profit.
A.
Oui, nous prenons ce qui nous paraît bon depuis Aristote jusqu'à Locke, et nous nous moquons du reste.
C.
Je voudrais bien savoir quel est le résultat de toutes vos lectures et de vos réflexions.
A.
Très-peu de chose.
B.
N'importe ; essayons de nous rendre compte de ce peu que nous savons, sans verbiage, sans pédantisme, sans un sot asservissement aux tyrans des esprits et au vulgaire tyrannisé ; enfin avec toute la bonne foi de la raison.
[327]
DEUXIÈME ENTRETIEN.
SUR L’ÂME [49].↩
B.
Commençons. Il est bon, avant de s’assurer de ce qui est juste, honnête, convenable entre les âmes humaines, de savoir d’où elles viennent, et où elles vont : on veut connaître à fond les gens à qui on a à faire.
C.
C’est bien dit, quoique cela n’importe guère. Quels que soient l’origine et le destin de l'âme, l’essentiel est qu’elle soit juste ; mais j’aime toujours à traiter cette matière, qui plaisait tant à Cicéron. Qu’en pensez-vous, monsieur A? L’âme est-elle immortelle?
A.
Mais, monsieur C, la question est un peu brusque. Il me semble que, pour savoir par soi-même si l’âme est immortelle, il faut d’abord être bien certain qu’elle existe : et c’est de quoi je n’ai aucune connaissance, sinon par la foi, qui tranche toutes les difficultés. Lucrèce disait, il y a dix-huit cents ans :
Ignoratur enim quae sit natura animaï;
(LUCR., I, 113.)
on ignore la nature de l’âme. Il pouvait dire : On ignore son existence. J’ai lu deux ou trois cents dissertations sur ce grand objet : elles ne m’ont jamais rien appris. Me voilà avec vous comme saint Augustin avec saint Jérôme, Augustin lui dit tout net qu’il ne sait rien de ce qui concerne l’âme. Cicéron, meilleur philosophe qu’Augustin, avait dit souvent la même chose avant lui, et beaucoup plus élégamment. Nos jeunes bacheliers en savent davantage, sans doute; mais moi, je n’en sais rien, et à l’âge de quatre-vingts ans [50] je me trouve aussi avancé que le premier jour.
C.
C’est que vous radotez. N’êtes-vous pas certain que les bêtes ont la vie, que les plantes ont la végétation, que l’air a sa [328] fluidité, que les vents ont leurs cours? Doutez-vous que tous ayez une vieille âme qui dirige votre vieux corps ?
A.
C'est précisément parce que je ne sais rien de tout ce que vous m'alléguez que j'ignore absolument si j'ai une âme, quand je ne consulte que ma faible raison. Je vois bien que l'air est agité, mais je ne vois point d'être réel dans l'air qu'on appelle cours du voit. Une rose végète, mais il n'y a point un petit individu secret dans la rose qui soit la végétation : cela serait aussi absurde en philosophie que de dire que l'odeur est dans la rose. On a prononcé pourtant cette absurdité pendant des siècles. La physique ignorante de toute l'antiquité disait : L'odeur part des fleurs pour aller à mon nez, les couleurs partent des objets pour venir à mes yeux ; on faisait une espèce d'existence à part de l'odeur, de la saveur, de la vue, de l'ouïe ; on allait jusqu'à croire que la vie était quelque chose qui faisait l'animal vivant. Le malheur de toute l'antiquité fut de transformer ainsi des paroles en êtres réels : on prétendait qu'une idée était un être ; il fallait consulter les idées, les archétypes qui subsistaient je ne sais où. Platon donna cours à ce jargon, qu'on appela philosophie. Aristote réduisit cette chimère en méthode : de là ces entités, ces quiddités, ces eccéités, et toutes les barbaries de l'école.
Quelques sages s'aperçurent que tous ces êtres imaginaires ne sont que des mots inventés pour soulager notre entendement; que la vie de l'animal n'est autre chose que l'animal vivant ; que ses idées sont l'animal pensant, que la végétation d'une plante n'est rien que la plante végétante ; que le mouvement d'une boule n'est que la boule changeant de place ; qu'en un mot tout être métaphysique n'est qu'une de nos conceptions. Il a fallu deux mille ans pour que ces sages eussent raison.
C.
Mais s'ils ont raison, si tous ces êtres métaphysiques ne sont que des paroles, votre âme, qui passe pour un être métaphysique , n'est donc rien ? Nous n'avons donc réellement point d'âme ?
A.
Je ne dis pas cela ; je dis que je n'en sais rien du tout par moi-même. Je crois seulement que Dieu nous accorde cinq sens et la pensée, et il se pourrait bien faire que nous fussions dans [329] Dieu, comme disent Aratus et saint Paul [51], et que nous vissions les choses en Dieu, comme dit Malebranche [52].
C.
A ce compte, j'aurais donc des pensées sans avoir une âme : cela serait fort plaisant,
A.
Pas si plaisant. Ne convenez-vous pas que les animaux ont du sentiment?
B.
Assurément, et c'est renoncer au sens commun que de n'en pas convenir.
A.
Croyez-vous qu'il y ait un petit être inconnu logé chez eux, que vous nommez sensibilité, mémoire, appétit, ou que vous appelez du nom vague et inexplicable âme?
B.
Non, sans doute; aucun de nous n'en croit rien. Les bêtes sentent parce que c'est leur nature, parce que cette nature leur a donné tous les organes du sentiment, parce que l'auteur, le principe de toute la nature l'a déterminé ainsi pour jamais.
A.
Eh bien ! cet éternel principe a tellement arrangé les choses que, quand j'aurai une tête bien constituée, quand mon cervelet ne sera ni trop humide ni trop sec, j'aurai des pensées, et je l'en remercie de tout mon cœur.
C.
Mais comment avez-vous des pensées dans la tête?
A.
Je n'en sais rien, encore une fois. Un philosophe [53] a été persécuté pour avoir dit, il y a quarante ans [54], dans un temps où l'on n'osait encore penser dans sa patrie : « La difficulté n'est pas de savoir seulement si la matière peut penser, mais de savoir comment un être, quel qu'il soit, peut avoir la pensée. » Je suis de l'avis de ce philosophe, et je vous dirai, en bravant les sots [330] persécuteurs, que j’ignore absolument tous les premiers principes des choses.
B.
Vous êtes un grand ignorant, et nous aussi.
A.
D’accord.
B.
Pourquoi donc raisonnons-nous? Comment saurons-nous ce qui est juste ou injuste, si nous ne savons pas seulement ce que c’est qu’une âme ?
A.
Il y a bien de la différence : nous ne connaissons rien du principe de la pensée, mais nous connaissons très-bien notre intérêt. Il nous est sensible que notre intérêt est que nous soyons justes envers les autres, et que les autres le soient envers nous, afin que tous puissent être sur ce tas de boue le moins malheureux que faire se pourra pendant le peu de temps qui nous est donné par l’Être des êtres pour végéter, sentir et penser.
TROISIÈME ENTRETIEN.
SI L’HOMME EST NÉ MÉCHANT ET ENFANT DU DIABLE.↩
B.
Vous êtes Anglais, monsieur A; vous nous direz bien franchement votre opinion sur le juste et l’injuste, sur le gouvernement, sur la religion, la guerre, la paix, les lois, etc., etc., etc., etc.
A.
De tout mon cœur; ce que je trouve de plus juste, c’est liberté et propriété. Je suis fort aise de contribuera donner à mon roi un million sterling par an pour sa maison, pourvu que je jouisse de mon bien dans la mienne. Je veux que chacun ait sa prérogative : je ne connais de lois que celles qui me protègent, et je trouve notre gouvernement le meilleur de la terre, parce que chacun y sait ce qu’il a, ce qu’il doit, et ce qu’il peut. Tout est soumis à la loi, à commencer par la royauté et par la religion.
C.
Vous n’admettez donc pas le droit divin dans la société?
[331]
A.
Tout est de droit divin si vous voulez, parce que Dieu a fait les hommes, et qu'il n'arrive rien sans sa volonté divine et sans l'enchaînement des lois éternelles, éternellement exécutées; l'archevêque de Cantorbéry, par exemple, n'est pas plus archevêque de droit divin que je ne suis né membre du parlement. Quand il plaira à Dieu de descendre sur la terre pour donner un bénéfice de douze mille guinées de revenu à un prêtre, je dirai alors que son bénéfice est de droit divin; mais jusque-là je croirai son droit très-humain.
B.
Ainsi tout est convention chez les hommes ; c'est Hobbes tout pur.
A.
Hobbes n'a été en cela que l'écho de tous les gens sensés. Tout est convention ou force.
C.
Il n'y a donc point de loi naturelle?
A.
Il y en a une sans doute, c'est l'intérêt et la raison.
B.
L'homme est donc né en effet dans un état de guerre, puisque notre intérêt combat presque toujours l'intérêt de nos voisins, et que nous faisons servir notre raison à soutenir cet intérêt qui nous anime?
A.
Si l'état naturel de l'homme était la guerre, tous les hommes s'égorgeraient : il y a longtemps que nous ne serions plus ( Dieu merci). Il nous serait arrivé ce qui arriva aux hommes nés des dents du serpent Cadmus : ils se battirent, et il n'en resta pas un. L'homme étant né pour tuer son voisin, et pour en être tué, accomplirait nécessairement sa destinée, comme les vautours accomplissent la leur en mangeant mes pigeons, et les fouines en suçant le sang de mes poules. On a vu des peuples qui n'ont jamais fait la guerre : on le dit des brachmanes, on le dit de plusieurs peuplades des îles de l'Amérique, que les chrétiens exterminèrent, ne pouvant les convertir. Les primitifs, que nous nommons quakers[55], commencent à composer, dans la Pensylvanie, [332] une nation considérable, et ils ont toute guerre en horreur. Les Lapons, les Samoyèdes, n'ont jamais tué personne en front de bandière. La guerre n'est donc pas l'essence du genre humain.
B.
Il faut pourtant que l'envie de nuire, le plaisir d'exterminer son prochain pour un léger intérêt, la plus horrible méchanceté et la plus noire perfidie, soient le caractère distinctif de notre espèce, au moins depuis le péché originel: car les doux théologiens assurent que, dès ce moment-là, le diable s'empara de toute notre race. Or le diable est notre maître, comme vous savez, et un très-méchant maître : donc tous les hommes lui ressemblent.
A.
Que le diable soit dans le corps des théologiens, je vous le passe; mais assurément il n'est pas dans le mien. Si l'espèce humaine était sous le gouvernement immédiat du diable, comme on le dit, il est clair que tous les maris assommeraient leurs femmes, que les fils tueraient leurs pères, que les mères mangeraient leurs enfants, et que la première chose que ferait un enfant, dès qu'il aurait des dents, serait de mordre sa mère, en cas que sa mère ne l'eût pas encore mis à la broche. Or, comme rien de tout cela n'arrive, il est démontré qu'on se moque de nous quand on nous dit que nous sommes sous la puissance du diable : c'est le plus sot blasphème qu'on ait jamais prononcé.
C.
En y faisant attention, j'avoue que le genre humain n'est pas tout à fait si méchant que certaines gens le crient dans l'espérance de le gouverner. Ils ressemblent à ces chirurgiens qui supposent que toutes les dames de la cour sont attaquées de cette maladie honteuse qui produit beaucoup d'argent à ceux qui la traitent. Il y a des maladies, sans doute; mais tout l'univers n'est pas entre les mains de la Faculté. Il y a de grands crimes ; mais ils sont rares. Aucun pape, depuis plus de deux cents ans, n'a ressemblé au pape Alexandre VI; aucun roi de l'Europe n'a bien imité le Christiern II de Danemark et le Louis XI de France. On n'a vu qu'un seul archevêque de Paris aller au parlement avec un poignard dans sa poché [56]. La Saint-Barthélémy est bien [333] horrible, quoi qu'en dise l'abbé de Caveyrac[57] mais enfin, quand on voit tout Paris occupé de la musique de Rameau, ou de Zaïre, ou de l'Opéra-Comique, ou des tableaux exposés au Salon, ou de Ramponeau, ou du singe de Nicolet, on oublie que la moitié de la nation égorgea l'autre pour des arguments théologiques, il y aura bientôt deux cents ans tout juste[58]. Les supplices abominables des Jeanne Grey, des Marie Stuart, des Charles Ier , ne se renouvellent pas chez vous tous les jours.
Ces horreurs épidémiques sont comme ces grandes pestes qui ravagent quelquefois la terre; après quoi on laboure, on sème, on recueille, on boit, on danse, on fait l'amour sur les cendres des morts qu'on foule aux pieds; et, comme l'a dit un homme qui a passé sa vie à sentir, à raisonner, et à plaisanter [59] « si tout n'est pas bien, tout est passable ».
Il y a telle province, comme la Touraine, par exemple, où l'on n'a pas commis un grand crime depuis cent cinquante années. Venise a vu plus de quatre siècles s'écouler sans la moindre sédition dans son enceinte, sans une seule assemblée tumultueuse : il y a mille villages en Europe où il ne s'est pas commis un meurtre depuis que la mode de s'égorger pour la religion est un peu passée : les agriculteurs n'ont pas le temps de se dérober à leurs travaux; leurs femmes et leurs filles les aident, elles cousent, elles filent, elles pétrissent, elles enfournent ( non pas comme l'archevêque La Casa [60]); toutes ces bonnes gens sont trop occupés pour songer à mal. Après un travail agréable pour eux, parce qu'il leur est nécessaire, ils font un léger repas que l'appétit assaisonne, et cèdent au besoin de dormir pour recommencer le lendemain. Je ne crains pour eux que les jours de fêtes, si ridiculement consacrés à psalmodier, d'une voix rauque et discordante, du latin qu'ils n'entendent point, et à perdre leur raison dans un cabaret, ce qu'ils n'entendent que trop. Encore une fois, si tout n'est pas bien, tout est passable.
B.
Par quelle rage a-t-on donc pu imaginer qu'il existe un lutin doué d'une gueule béante, de quatre griffes de lion et d'une [334] queue de serpent ; qu’il est accompagné d’un milliard de farfadetsbâtis comme lui, tous descendus du ciel, tous enfermés dans une fournaise souterraine; que Jésus-Christ descendit dans cette fournaise pour enchaîner tous ces animaux; que, depuis ce temps-là,ils sortent tous les jours de leur cachot, qu’ils nous tentent, qu’ilsentrent dans notre corps et dans notre âme ; qu’ils sont nos souverains absolus, et qu’ils nous inspirent tonte leur perversité diabolique ? De quelle source a pu venir une opinion aussi extravagante, un conte aussi absurde?
A.
De l’ignorance des médecins.
B.
Je ne m’y attendais pas.
A.
Vous deviez pourtant vous y attendre. Vous savez assez qu’avant Hippocrate, et même depuis lui, les médecins n’entendaient rien aux maladies. D’où venaient l’épilepsie, le haut-mal, par exemple? Des dieux malfaisants, des mauvais génies; aussi l’appelait-on le mal sacre. Les écrouelles étaient dans le même cas. Ces maux étaient l’effet d’un miracle ; il fallait un miracle pour en guérir : on faisait des pèlerinages; on se faisait toucher par les prêtres : cette superstition a fait le tour du monde; elle est encore en vogue parmi la canaille. Dans un voyage à Paris je vis des épileptiques, dans la Sainte-Chapelle et à Saint-Maur, pousser des hurlements et faire des contorsions la nuit du jeudi saint au vendredi; et notre ex-roi Jacques II [61] , comme personne sacrée, s’imaginait guérir les écrouelles envoyées par le malin. Toute maladie inconnue était donc autrefois une possession du mauvais génie. Le mélancolique Oreste passa pour être possédé de Mégère, et on l’envoya voler une statue pour obtenir sa guérison. Les Grecs, qui étaient un peuple très-nouveau, tenaient cette superstition des Égyptiens; les prêtres et les prêtresses d’Isis allaient par le monde disant la bonne aventure, et délivraient pour de l’argent les sots qui étaient sous l’empire de Typhon. Ils faisaient leurs exorcismes avec des tambours de basque et des castagnettes. Le misérable peuple juif, nouvellement établi dans ses rochers entre la Phénicie, l’Égypte, et la Syrie, prit toutes les superstitions de ses voisins, et, dans l’excès de sa brutale ignorance, il y [335] ajouta des superstitions nouvelles. Lorsque cette petite horde fut esclave à Babylone, elle y apprit les noms du diable, de Satan, Asmodée, Mammon, Belzébuth, tous serviteurs du mauvais principe Arimane; et ce fut alors que les Juifs attribuèrent aux diables les maladies et les morts subites. Leurs livres saints, qu'ils composèrent depuis, quand ils eurent l'alphabet chaldéen, parlent quelquefois des diables.
Vous voyez que, quand l'ange Raphaël descend exprès de l'empyrée pour faire payer une somme d'argent par le Juif Gabel au Juif Tobie, il mène le petit Tobie chez Raguel, dont la fille avait déjà épousé sept maris à qui le diable Asmodée avait tordu le cou. La doctrine du diable prit une grande faveur chez les Juifs ; ils admirent une quantité prodigieuse de diables dans un enfer dont les lois du Pentateuque n'avaient jamais dit un seul mot : presque tous leurs malades furent possédés du diable. Ils eurent, au lieu de médecins, des exorcistes en titre d'office qui chassaient les esprits malins avec la racine nommée barath [62], des prières, et des contorsions.
Les méchants passèrent pour possédés encore plus que les malades. Les débauchés, les pervers, sont toujours appelés enfants de Bélial dans les écrits juifs.
Les chrétiens, qui ne furent pendant cent ans que des demi-juifs, adoptèrent les possessions du démon, et se vantèrent de chasser le diable. Ce fou de Tertullien pousse la manie jusqu'à dire que tout chrétien contraint, avec le signe de la croix, Junon, Minerve, Gérés, Diane, à confesser qu'elles sont des diablesses, La légende rapporte qu'un âne chassait les diables de Senlis en traçant une croix sur le sable avec son sabot par le commandement de saint Rieule,
Peu à peu l'opinion s'établit que tous les hommes naissent endiablés et damnés : étrange idée sans doute, idée exécrable, outrage affreux à la Divinité, d'imaginer qu'elle formecontinuellement des êtres sensibles et raisonnables uniquement pour être tourmentés à jamais par d'autres êtres éternellement plongés eux-mêmes dans les supplices. Si le bourreau qui, en un jour, arracha le cœur, dans Carlisle [63], à dix-huit partisans du prince Charles-Édouard, avait été chargé d'établir un dogme, voilà celui qu'il aurait choisi ; encore aurait-il fallu qu'il eût été ivre de brandevin, [336] car eût-il eu à la fois l'âme d'un bourreau et d'un théologien, il n'aurait jamais pu inventer de sang-froid un système où tant de milliers d'enfants à la mamelle sont livrés à des bourreaux éternels.
B.
J'ai peur que le diable ne vous reproche d'être un mauvais fils qui renie son père. Vos discours bretons paraîtront aux bons catholiques romains une preuve que le diable vous possède, et que vous ne voulez pas en convenir; mais je serais curieux de savoir comment cette idée, qu'un être infiniment bon fait tous les jours des millions d'hommes pour les damner, a pu entrer dans les cervelles.
A.
Par une équivoque, comme la puissance papistique est fondée sur un jeu de mots : « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'établirai mon Église. » (Matth., chapitre xvi, v. 18.)
Voici l'équivoque qui damne tous les petits enfants. Dieu défend à Eve et à son mari de manger le fruit de l'arbre de la science, qu'il avait planté dans son jardin; il leur dit (Genèse, chapitre ii, v. 17) : «Le jour que vous en mangerez, vous mourrez de mort. » Ils en mangèrent, et n'en moururent point. Au contraire, Adam vécut encore neuf cent trente ans. Il faut donc entendre une autre mort : c'est la mort de l'âme, la damnation. Mais il n'est point dit qu'Adam soit damné : ce sont donc ses enfants qui le seront; et comment cela? c'est que Dieu condamne le serpent, qui avait séduit Eve, à marcher sur le ventre (car auparavant vous voyez bien qu'il marchait sur ses pieds) ; et la race d'Adam est condamnée à être mordue au talon par le serpent. Or le serpent, c'est visiblement le diable ; et le talon qu'il mord, c'est notre âme. « L'homme écrasera la tête des serpents tant qu'il pourra » (Genèse, chapitre III, v. 15); il est clair qu'il faut entendre par là le Messie, qui a triomphé du diable.
Mais comment a-t-il écrasé la tête du vieux serpent, en lui livrant tous les enfants qui ne sont pas baptisés? C'est là le mystère. Et comment les enfants sont-ils damnés parce que leur premier père et leur première mère avaient mangé du fruit de leur jardin? C'est encore là le mystère.
C.
Je vous arrête là. N'est-ce pas pour Caïn que nous sommes damnés, et non pas pour Adam? Car nous avons la mine de descendre de Caïn, si je ne me trompe, attendu qu'Abel mourut [337] sans être marié; et il me paraît qu'il est plus raisonnable d'être damné pour un fratricide que pour une pomme.
A.
Ce ne peut être pour Caïn, car il est dit[64] que Dieu le protégea, et lui mit un signe, de peur qu'on ne le battît ou qu'on ne le tuât; il est dit même [65] qu'il fonda une ville dans le temps qu'il était encore presque seul sur la terre avec son père et sa mère, sa sœur, dont il fit sa femme, et avec un fils nommé Enoch. J'ai vu même un des plus ennuyeux livres, intitulé la Science du gouvernement [66], par un sénéchal de Forcalquier nommé Réal, qui fait dériver les lois de la ville bâtie par notre père Caïn.
Mais, quoi qu'il en soit, il est indubitable que les Juifs n'avaient jamais entendu parler du péché originel, ni de la damnation éternelle des petits enfants morts sans être circoncis. Les Saducéens, qui ne croyaient pas l'immortalité de l'âme, et les Pharisiens, qui croyaient la métempsycose, ne pouvaient pas admettre la damnation éternelle, quelque pente qu'aient les fanatiques à croire les contradictoires.
Jésus fut circoncis à huit jours, et baptisé étant adulte, selon la coutume de plusieurs Juifs, qui regardaient le baptême comme une purification des souillures de l'âme: c'était un ancien usage des peuples de l'Indus et du Gange, à qui les brachmanes avaient fait accroire que l'eau lave les péchés comme les vêtements. Jésus, en un mot, circoncis et baptisé, ne parle dans aucun Évangile du péché originel. Aucun apôtre ne dit que les petits enfants non baptisés seront brûlés à tout jamais pour la pomme d'Adam. Aucun des premiers Pères de l'Église n'avança cette cruelle chimère; et vous savez d'ailleurs qu'Adam, Eve, Abel, et Caïn, n'ont jamais été connus que du petit peuple juif.
B.
Qui a donc dit cela nettement le premier?
A.
C'est l'Africain Augustin, homme d'ailleurs respectable, mais qui tord quelques passages de saint Paul pour en inférer, dans ses lettres à Évode et à Jérôme, que Dieu précipite du sein de leurs mères, dans les enfers, les enfants qui périssent dans leurs premiers jours. Lisez surtout le second livre de la revue de ses [338] ouvrages, chapitre xlv. « La foi catholique enseigne que tous leshommes naissent si coupables que les enfants mêmes sont certainement damnés quand ils meurent sans avoir été régénérésen Jésus. »
Il est vrai que la nature, soulevée dans le cœur de ce rhéteur, le force à frémir de cette sentence barbare : cependant il la prononce; il ne se rétracte point, lui qui changea si souvent d’opinion. L’Église fait valoir ce système terrible pour rendre son baptême plus nécessaire. Les communions réformées détestent aujourd’hui ce système. La plupart des théologiens n’osent plus l’admettre ; cependant ils continuent à reconnaître que nos enfants appartiennent à l’enfer. Cela est si vrai que le prêtre, en baptisant ces petites créatures, leur demande si elles renoncent au diable ; et le parrain, qui répond pour elles, est assez bon pour dire oui.
C.
Je suis content de tout ce que vous avez dit ; je pense que la nature de l’homme n’est pas tout à fait diabolique. Mais pourquoi dit-on que l’homme est toujours porté au mal?
A.
Il est porté à son bien-être, lequel n’est un mal que quand il opprime ses frères. Dieu lui a donné l’amour-propre, qui lui est utile ; la bienveillance, qui est utile à son prochain ; la colère, qui est dangereuse, la compassion, qui la désarme; la sympathie avec plusieurs de ses compagnons, l’antipathie envers d’autres. Beaucoup de besoins et beaucoup d’industrie, l’instinct, la raison, et les passions, voilà l’homme. Quand vous serez des dieux, essayez de faire un homme sur un meilleur modèle.
QUATRIÈME ENTRETIEN.
DE LA LOI NATURELLE, ET DE LA CURIOSITÉ [67].↩
B.
Nous sommes bien convaincus qite l’homme n’est point un être absolument détestable ; mais venons au fait : qu’appelez-vous juste et injuste?
A.
Ce qui paraît tel à l’univers entier.
[339]
C.
L'univers est composé de bien des têtes. On dit qu'à Lacédémone on applaudissait aux larcins, pour lesquels on condamnait aux mines dans Athènes.
A.
Abus de mots. Il ne pouvait se commettre de larcin à Sparte, lorsque tout y était en commun. Ce que vous appelez vol était la punition de l'avarice.
B.
Il était défendu d'épouser sa sœur à Rome. Il était permis chez les Égyptiens, les Athéniens, et même chez les Juifs, d'épouser sa sœur de père : car, malgré le Lévitique, la jeune Thamar dit à son frère Amnon : Mon frère, ne me faites point de sottises ; mais demandez-moi en mariage à mon père ; il ne vous refusera pas[68].
A.
Lois de convention que tout cela, usages arbitraires, modes qui passent. L'essentiel demeure toujours. Montrez-moi un pays où il soit honnête de me ravir le fruit de mon travail, de violer sa promesse, de mentir pour nuire, de calomnier, d'assassiner, d'empoisonner, d'être ingrat envers son bienfaiteur, de battre son père et sa mère quand ils vous présentent à manger.
B.
Voici ce que j'ai lu dans une déclamation qui a été connue en son temps; j'ai transcrit ce morceau, qui me paraît singulier.
«Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres ; que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux, ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne [69] ! »
C.
Il faut que ce soit quelque voleur de grand chemin, bel esprit, qui ait écrit cette impertinence.
[340]
A.
Je soupçonne seulement que c'est un gueux fort paresseux : car, au lieu d'aller gâter le terrain d'un voisin sage et industrieux, il n'avait qu'à l'imiter [70] ; et chaque père de famille ayant suivi cet exemple, voilà bientôt un très-joli village de formé. L'auteur de ce passage me paraît un animal bien insociable.
B.
Vous croyez donc qu'en outrageant et en volant le bonhomme qui a entouré d'une haie vive son jardin et son poulailler il a manqué aux premiers devoirs de la loi naturelle ?
A.
Oui, oui, encore une fois; il y a une loi naturelle, et elle ne consiste ni à faire le mal d'autrui, ni à s'en réjouir.
C.
Il y a des gens pourtant qui disent que rien n'est plus naturel que de faire du mal. Beaucoup d'enfants s'amusent à plumer leurs moineaux ; et il n'y a guère d'hommes faits qui ne courent avec un secret plaisir sur le rivage de la mer pour jouir du spectacle d'un vaisseau battu par les vents, qui s'entr'ouvre et qui s'engloutit par degrés dans les flots, tandis que les passagers lèvent les mains au ciel, et tombent dans l'abîme de l'eau avec leurs femmes qui tiennent leurs enfants dans leurs bras. Lucrèce en donne la raison (lib. II, v. 4) :
. . . Quibus ipse malis careas quia cernere suave est.
On voit avec plaisir les maux qu'on ne sent pas.
A.
Lucrèce ne sait ce qu'il dit ; et il y est fort sujet, malgré ses belles descriptions [71]. On court à un tel spectacle par curiosité. La curiosité est un sentiment naturel à l'homme; mais il n'y a [341] pas un des spectateurs qui ne fît les derniers efforts, s'il le pouvait, pour sauver ceux qui se noient.
[72] Quand les petits garçons et les petites filles déplument leurs moineaux, c'est purement par esprit de curiosité, comme lorsqu'elles mettent en pièces les jupes de leurs poupées. C'est cette passion seule qui conduit tant de monde aux exécutions publiques. « Étrange empressement de voir des misérables ! » a dit l'auteur d'une tragédie [73].
Je me souviens qu'étant à Paris lorsqu'on fit souffrir à Damiens une mort des plus recherchées et des plus affreuses qu'on puisse imaginer, toutes les fenêtres qui donnaient sur la place furent louées chèrement par les dames ; aucune d'elles assurément ne faisait la réflexion consolante qu'on ne la tenaillerait point aux mamelles, qu'on ne verserait point du plomb fondu et de la poix-résine bouillante dans ses plaies, et que quatre chevaux ne tireraient point ses membres disloqués et sanglants. Un des bourreaux jugea plus sainement que Lucrèce, car, lorsqu'un des académiciens de Paris [74] voulut entrer dans l'enceinte pour examiner la chose de plus près, et qu'il fut repoussé par les archers : « Laissez entrer monsieur, dit-il, c'est un amateur; » c'est-à-dire: C'est un curieux ; ce n'est pas par méchanceté qu'il vient ici, ce n'est pas par un retour sur soi-même, pour goûter le plaisir de n'être pas écartelé : c'est uniquement par curiosité, comme on va voir une expérience de physique.
B.
Soit; je conçois que l'homme n'aime et ne fait le mal que pour son avantage; mais tant de gens sont portés à se procurer leur avantage par le malheur d'autrui; la vengeance est une passion si violente, il y en a des exemples si funestes; l'ambition, plus fatale encore, a inondé la terre de tant de sang que, lorsque je m'en retrace l'horrible tableau, je suis tenté de me rétracter, et d'avouer que l'homme est très-diabolique. J'ai beau avoir dans mon cœur la notion du juste et de l'injuste; un Attila, que saint Léon courtise; un Phocas, que saint Grégoire flatte avec la plus lâche bassesse; un Alexandre VI, souillé de tant d'incestes, de tant d'homicides, de tant d'empoisonnements, avec lequel le faible Louis XII, qu'on appelle bon, fait la plus indigne et la plus [342] étroite alliance; un Cromwell, dont le cardinal Mazarin recherchela protection, et pour qui il chasse de France les héritiers de Charles Ie, cousins germains de Louis XIV, etc., etc., etc.; cent exemples pareils dérangent mes idées, et je ne sais plus où j’en suis.
A.
Eh hien! les orages empêchent-ils que nous ne jouissions aujourd’hui d’un beau soleil? Le tremblement qui a détruit la moitié de la ville de Lisbonne [75] empêche-t-il que tous n’ayez fait très-commodément le voyage de Madrid à Rome sur la terre affermie? Si Attila fut un brigand, et le cardinal Mazarin un fripon, n’y at-il pas des princes et des ministres honnêtes gens? Et l’idée delà justice ne subsiste-t-elle pas toujours? C’est sur elle que sont fondées toutes les lois; les Grecs les appelaient Filles du ciel; cela ne veut dire que filles de la nature.
C.
N’importe, je suis prêt de me rétracter aussi: car je vois qu’on n’a fait des lois que parce que les hommes sont méchants. Si les chevaux étaient toujours dociles, on ne leur aurait jamais mis de frein. Mais, sans perdre notre temps à fouiller dans la nature de l’homme et à comparer les prétendus sauvages aux prétendus civilisés, voyons quel est le mors qui convient le mieux à notre bouche.
A.
Je vous avertis que je ne saurais souffrir qu’on me bride sans me consulter, que je veux me brider moi-même, et donner ma voix pour savoir au moins qui me montera sur le dos.
C.
Nous sommes à peu près de la même écurie.
CINQUIÈME ENTRETIEN.
DES MANIÈRES DE PERDRE ET DE GARDER SA LIBERTÉ, ET DE LA THÉOCRATIE.↩
[B.]
Monsieur A, vous me paraissez un Anglais très-profond; comment imaginez-vous que se soient établis tous ces gouvernements dont on a peine à retenir les noms : monarchique, despotique, [343] tyrannique, oligarchique, aristocratique, démocratique, anarchique, théocratique, diabolique, et les autres qui sont mêlés de tous les précédents?
C.
Oui; chacun fait son roman, parce que nous n'avons point d'histoire véritable. Dites-nous, monsieur A, quel est votre roman ?
A.
Puisque vous le voulez, je m'en vais donc perdre mon temps à vous parler, et vous le vôtre à m'écouter.
J'imagine d'abord que deux petites peuplades voisines, composées chacune d'environ une centaine de familles, sont séparées par un ruisseau, et cultivent un assez bon terrain: car, si elles se sont fixées en cet endroit, c'est que la terre y est fertile.
Comme chaque individu a reçu également de la nature deux bras, deux jambes et une tête, il me paraît impossible que les habitants de ce petit canton n'aient pas d'abord été tous égaux. Et, comme ces deux peuplades sont séparées par un ruisseau, il me paraît encore impossible qu'elles n'aient pas été ennemies, car il y aura eu nécessairement quelque différence dans leur manière de prononcer les mêmes mots. Les habitants du midi du ruisseau se seront sûrement moqués de ceux qui sont au nord, et cela ne se pardonne point. Il y aura eu une grande émulation entre les deux villages; quelque fille, quelque femme aura été enlevée. Les jeunes gens se seront battus à coups de poings, de gaules et de pierres, à plusieurs reprises. Les choses étant égales jusque-là de part et d'autre, celui qui passe pour le plus fort et le plus habile du village du nord dit à ses compagnons : Si vous voulez me suivre et faire ce que je vous dirai, je vous rendrai les maîtres du village du midi. Il parle avec tant d'assurance qu'il obtient leurs suffrages. Il leur fait prendre de meilleures armes que n'en a la peuplade opposée. Vous ne vous êtes battus jusqu'à présent qu'en plein jour, leur dit-il; il faut attaquer vos ennemis pendant qu'ils dorment. Cette idée paraît d'un grand génie à la fourmilière du septentrion; elle attaque la fourmilière méridionale dans la nuit, tue quelques habitants dormeurs, en estropie plusieurs (comme firent noblement Ulysse et Rhésus[76]), enlève les filles et le reste du bétail; après quoi, la bourgade victorieuse se querelle nécessairement pour le partage des dépouilles. [344] Il est naturel qu'ils s'en rapportent au chef qu'ils ont choisi pour cette expédition héroïque. Le voilà donc établi capitaine et juge. L'invention de surprendre, de voler et de tuer ses voisins, a imprimé la terreur dans le midi, et le respect dans le nord.
Ce nouveau chef passe dans le pays pour un grand homme; on s'accoutume à lui obéir, et lui encore plus à commander. Je crois que ce pourrait bien être là l'origine de la monarchie.
C.
Il est vrai que le grand art de surprendre, tuer et voler, est un héroïsme de la plus haute antiquité. Je ne trouve point de stratagème de guerre, dans Frontin, comparable à celui des enfants de Jacob, qui venaient en effet du nord, et qui surprirent, tuèrent et volèrent les Sichemites, qui demeuraient au midi. C'est un rare exemple de saine politique et de sublime valeur. Car le fils du roi de Sichem étant éperdument amoureux de Dina, fille du patriarche Jacob, laquelle, ayant six ans tout au plus, était déjà nubile, et les deux amants ayant couché ensemble, les enfants de Jacjb proposèrent au roi de Sichem, au prince son fils, et à tous les Sichemites, de se faire circoncire pour ne faire ensemble qu'un seul peuple; et sitôt que les Sichemites, s'étant coupé le prépuce, se furent mis au lit, deux patriarches, Siméon et Lévi, surprirent eux seuls tous les Sichemites [77], et les tuèrent, et les dix autres patriarches les volèrent. Cela ne cadre pas pourtant avec votre système : car c'étaient les surpris, les tués et les volés, qui avaient un roi, et les assassins et les voleurs n'en avaient pas encore.
A.
Apparemment que les Sichemites avaient fait autrefois quelque belle action pareille, et qu'à la longue leur chef était devenu monarque. Je conçois qu'il y eut des voleurs qui eurent des chefs, et d'autres voleurs qui n'en eurent point. Les Arabes du désert, par exemple, furent presque toujours des voleurs républicains; mais les Persans, les Mèdes, furent des voleurs monarchiques. Sans discuter avec vous les prépuces de Sichem et les voleries des Arabes, j'ai dans la tête que la guerre offensive a fait les premiers rois, et que la guerre défensive a fait les premières républiques.
Un chef de brigands tel que Déjocès [78] (s'il a existé), ou Cosrou [345] nommé Cyriis, ou Romulus, assassin de son frère, ou Clovis, autre assassin, Genseric, Attila, se font rois : les peuples qui demeurent dans des cavernes, dans des îles, dans des marais, dans des gorges de montagnes, dans des rochers, conservent leur liberté, comme les Suisses, les Grisons, les Vénitiens, les Génois. Ou vit autrefois les Tyriens, les Carthaginois et les Rhodiens, conserver la leur tant qu'on ne put aborder chez eux par mer. Les Grecs furent longtemps libres dans un pays hérissé de montagnes; les Romains dans leurs sept collines reprirent leur liberté dès qu'ils le purent, et l'ôtèrent ensuite à plusieurs peuples en les surprenant, en les tuant, et en les volant, comme nous l'avons déjà dit[79]. Et enfin la terre appartint partout au plus fort et au plus habile.
A mesure que les esprits se sont raffinés, on a traité les gouvernements comme les étoffes dans lesquelles on a varié les fonds, les dessins et les couleurs. Ainsi la monarchie d'Espagne est aussi différente de celle d'Angleterre que le climat. Celle de Pologne ne ressemble en rien à celle d'Angleterre. La république de Venise est le contraire de celle de Hollande.
C.
Tout cela est palpable; mais, parmi tant de formes de gouvernement, est-il bien vrai qu'il y ait jamais eu une théocratie?
A.
Cela est si vrai que la théocratie est encore partout, et que du Japon à Rome on vous montre des lois émanées de Dieu même.
B.
Mais ces lois sont toutes différentes, toutes se combattent. La raison humaine peut très-bien ne pas comprendre que Dieu soit descendu sur la terre pour ordonner le pour et le contre, pour commander aux Égyptiens et aux Juifs de ne jamais manger de cochon après s'être coupé le prépuce, et pour nous laisser à nous des prépuces et du porc frais. Il n'a pu défendre l'anguille et le lièvre en Palestine, en permettant le lièvre en Angleterre, et en ordonnant l'anguille aux papistes les jours maigres. J'avoue que je tremble d'examiner; je crains de trouver là des contradictions.
A.
Bon lies médecins n'ordonnent-ils pas des remèdes contraires dans les mêmes maladies? L'un vous ordonne le bain froid, l'autre le bain chaud; celui-ci vous saigne, celui-là vous purge, [346] cet autre tous tue; un nouveau venu [80] empoisonne votre fils, et devient l'oracle de votre petit-fils.
C.
Cela est curieux. J'aurais bien voulu voir, en exceptant Moïse et les autres véritablement inspirés, le premier impudent qui osa faire parler Dieu.
A.
Je pense qu'il était un composé de fanatisme et de fourberie. La fraude seule ne suffirait pas : elle fascine, et le fanatisme subjugue. Il est vraisemblable, comme dit un de mes amis [81]que ce métier commença par les rêves. Un homme d'une imagination allumée voit en songe son père et sa mère mourir; ils sont tous deux vieux et malades, ils meurent : le rêve est accompli; le voilà persuadé qu'un dieu lui a parlé en songe. Pour peu qu'il soit audacieux et fripon (deux choses très-communes), il se met à prédire au nom de ce dieu. Il voit que, dans une guerre, ses compatriotes sont six contre un : il leur prédit la victoire, à condition qu'il aura la dîme du butin.
Le métier est bon ; mon charlatan forme des élèves qui ont tous le même intérêt que lui. Leur autorité augmente par leur nombre. Dieu leur révèle que les meilleurs morceaux des moutons et des bœufs, les volailles les plus grasses, la mère-goutte du vin, leur appartiennent.
The priests eat roast-beef, and the people stare [82].
Le roi du pays fait d'abord un marché avec eux pour être mieux obéi par le peuple; mais bientôt le monarque est la dupe du marché : les charlatans se servent du pouvoir que le monarque leur a laissé prendre sur la canaille, pour l'asservir lui-même. Le monarque regimbe, le prêtre le dépossède au nom de Dieu. Samuel détrône Saûl, Grégoire VII détrône l'empereur Henri IV, et le prive de la sépulture. Ce système diabolico-théocratique dure jusqu'à ce qu'il se trouve des princes assez bien élevés, et qui aient assez d'esprit et de courage pour rogner les ongles aux Samuel et aux Grégoire. Telle est, ce me semble, l'histoire du genre humain.
[347]
B.
Il n’est pas besoin d’avoir lu pour juger que les choses ont dû se passer ainsi. Il n’y a qu’à voir la populace imbécile d’une ville de province dans laquelle il y a deux couvents de moines, quelques magistrats éclairés, et un commandant qui a du bon sens. Le peuple est toujours prêt à s’attrouper autour des cordeliers et des capucins. Le commandant veut les contenir. Le magistrat, fâché contre le commandant, rend un arrêt qui ménage un peu l’insolence des moines et la crédulité du peuple, L’évêque est encore plus fâché que le magistrat se soit mêlé d’une affaire divine; et les moines restent puissants jusqu’à ce qu’une révolution les abolisse.
Humani generis mores tibi nosse volenti
Sufficit una domus.Juvenal, sat. XIII, v. 150.
SIXIÈME ENTRETIEN.
DES TROIS GOUVERNEMENTS, ET DE MILLE ERREURS ANCIENNES.↩
B.
Allons au fait. Je vous avouerai que je m’accommoderais assez d’un gouvernement démocratique. Je trouve que ce philosophe[83] avait tort, qui disait à un partisan d’un gouvernement populaire: «Commence par l’essayer dans ta maison, tu t’en repentiras bien vite. » Avec sa permission, une maison et une ville sont deux choses fort différentes. Ma maison est à moi ; mes enfants sont à moi ; mes domestiques, quand je les paye, sont à moi ; mais de quel droit mes concitoyens m’appartiendraient-ils? Tous ceux qui ont des possessions dans le même territoire ont droit également au maintien de l’ordre dans ce territoire. J’aime à voir des hommes libres faire eux-mêmes les lois sous lesquelles ils vivent, comme ils ont fait leurs habitations. C’est un plaisir pour moi que mon maçon, mon charpentier, mon forgeron, qui m’ont aidé à bâtir mon logement, mon voisin l’agriculteur, et mon ami le manufacturier, s’élèvent tous au-dessus de leur métier, et connaissent mieux l’intérêt public que le plus insolent chiaoux de Turquie. Aucun laboureur, aucun artisan, dans une démocratie, n’a la [348] vexation et le mépris à redouter ; aucun n'est dans le cas de ce chapelier qui présentait sa requête à un duc et pair pour être payé de ses fournitures : « Est-ce que vous n'avez rien reçu, mon ami, sur votre partie ? — Je vous demande pardon, monseigneur ; j'ai reçu un soufflet de monseigneur votre intendant. »
Il est bien doux de n'être point exposé à être traîné dans un cachot pour n'avoir pu payer à un homme qu'on ne connaît pas un impôt dont on ignore la valeur et la cause, et jusqu'à l'existence.
Être libre, n'avoir que des égaux, est la vraie vie, la vie naturelle de l'homme ; toute autre est un indigne artifice, une mauvaise comédie, où l'un joue le personnage de maître, l'autre d'esclave, celui-là de parasite, et cet autre d'entremetteur. Vous m'avouerez que les hommes ne peuvent être descendus de l'état naturel que par lâcheté et par bêtise.
Cela est clair : personne ne peut avoir perdu sa liberté que pour n'avoir pas su la défendre. Il y a eu deux manières de la perdre: c'est quand les sots ont été trompés par des fripons, ou quand les faibles ont été subjugués par les forts. On parle de je ne sais quels vaincus à qui je ne sais quels vainqueurs firent crever un œil[84] ; il y a des peuples à qui on a crevé les deux yeux comme aux vieilles rosses à qui l'on fait tourner la meule. Je veux garder mes yeux; je m'imagine qu'on en crève un dans l'État aristocratique, et deux dans l'État monarchique.
A.
Vous parlez comme un citoyen de la Nord-Hollande, et je vous le pardonne.
C.
Pour moi, je n'aime que l'aristocratie; le peuple n'est pas digne de gouverner. Je ne saurais souffrir que mon perruquier soit législateur ; j'aimerais mieux ne porter jamais de perruque. Il n'y a que ceux qui ont reçu une très-bonne éducation qui soient faits pour conduire ceux qui n'en ont reçu aucune. Le gouvernement de Venise est le meilleur : cette aristocratie est le plus ancien État de l'Europe. Je mets après lui le gouvernement de l'Allemagne. Faites-moi noble vénitien ou comte de l'empire, je vous déclare que je ne peux vivre joyeusement que dans l'une ou dans l'autre de ces deux conditions.
[349]
A.
Vous êtes un seigneur riche, monsieur C, et j'approuve fort votre façon de penser. Je vois que vous seriez pour le gouvernement des Turcs si vous étiez empereur de Constantinople. Pour moi, quoique je ne sois que membre du parlement de la Grande-Bretagne, je regarde ma constitution comme la meilleure de toutes ; et je citerai pour mon garant un témoignage qui n'est pas récusable : c'est celui d'un Français qui, dans un poëme[85] consacré aux vérités et non aux vaines fictions, parle ainsi de notre gouvernement :
Aux murs de Westminster on voit paraître ensemble
Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble,
Les députés du peuple, et les grands, et le roi,
Divisés d'intérêt, réunis par la loi;
Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,
Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible.
C.
Dangereux à lui-même! Vous avez donc de très-grands abus chez vous?
A.
Sans doute, comme il en fut chez les Romains, chez les Athéniens, et comme il y en aura toujours chez les hommes. Le comble de la perfection humaine est d'être puissant et heureux avec des abus énormes; et c'est à quoi nous sommes parvenus. Il est dangereux de trop manger ; mais je veux que ma table soit bien garnie.
B.
Voulez-vous que nous ayons le plaisir d'examiner à fond tous les gouvernements de la terre, depuis l'empereur chinois Hiao, et depuis la horde hébraïque, jusqu'aux dernières dissensions de Raguse [86] et de Genève?
A.
Dieu m'en préserve! je n'ai que faire de fouiller dans les archives des étrangers pour régler mes comptes. Assez de gens, qui n'ont pu gouverner une servante et un valet, se sont mêlés de régir l'univers avec leur plume. Ne voudriez-vous pas que nous perdissions notre temps à lire ensemble le livre de Bossuet, évêque [350] que de Meaux, intitulé la Politique de l’Écriture sainte? Plaisantepolitique que celle d’un malheureux peuple qui fut sanguinairesans être guerrier, usurier sans être commerçant, brigand sanspouvoir conserver ses rapines, presque toujours esclave et presque toujours révolté, vendu au marché par Titus et par Adriencomme on vend l’animal que ces Juifs appelaient immonde [87] , etqui était plus utile qu’eux. J’abandonne au déclamateur Bossuet la politique des roitelets de Juda et de Samarie, qui ne connurentque l’assassinat, à commencer par leur David, lequel, ayant faitle métier de brigand pour être roi, assassina Urie dès qu’il fut lemaître ; et ce sage Salomon, qui commença par assassiner Adoniasson propre frère au pied de l’autel. Je suis las de cet absurde pédantisme qui consacre l’histoire d’un tel peuple à l'instructionde la jeunesse.
Je ne suis pas moins las de tous les livres dans lesquels on répète les fables d’Hérodote et de ses semblables sur les anciennes monarchies de l’Asie et sur les républiques qui ont disparu.
Qu’ils nous redisent qu’une Didon, sœur prétendue de Pygmalion (qui ne sont point des noms phéniciens), s’enfuit de Phénicie pour acheter en Afrique autant de terrain qu’en pourrait contenir un cuir de bœuf, et que, le coupant en lanières, elle entoura de ces lanières un territoire immense où elle fonda Carthage ; que ces historiens romanciers parlent après tant d’autres, et que tant d’autres nous parlent après eux des oracles d’Apollon accomplis, et de l’anneau de Gygès, et des oreilles de Smerdis, et du cheval de Darius qui fit son maître roi de Perse : qu’on s’étende sur les lois de Charondas, qu’on nous répète que la petite ville de Sybaris mit trois cent mille hommes en campagne contre la petite ville de Crotone, qui ne put armer que cent mille hommes : il faut mettre toutes ces histoires avec la louve de Romulus et de Rémus, le cheval de Troie, et la baleine [88] de Jonas.
Laissons donc là toute la prétendue histoire ancienne, et, à l’égard de la moderne, que chacun cherche à s’instruire par les fautes de son pays et par celles de ses voisins : la leçon sera longue ; mais aussi voyons toutes les belles institutions par lesquelles les nations modernes se signalent : cette leçon sera longue encore.
[351]
B.
Et que nous apprendra-t-elle?
A.
Que plus les lois de convention se rapprochent de la loi naturelle, et plus la vie est supportable[89]
C.
Voyons donc.
SEPTIÈME ENTRETIEN.
QUE L’EUROPE MODERNE VAUT MIEUX QUE L’EUROPE ANCIENNE.↩
C.
Seriez-vous assez hardi pour me soutenir que vous autres Anglais vous valez mieux que les Athéniens et les Romains ; que vos combats de coqs ou de gladiateurs, dans une enceinte de planches pourries, l’emportent sur le Colisée? Les savetiers et les bouffons qui jouent leurs rôles dans vos tragédies sont-ils supérieurs aux héros de Sophocle? Vos orateurs font-ils oublier Cicéron et Démosthène ? Et enfin Londres est-elle mieux policée que l’ancienne Rome?
A.
Non ; mais Londres vaut dix mille fois mieux qu’elle ne valait alors, et il en est de même du reste de l’Europe.
B.
Ah! exceptez-en, je vous prie, la Grèce, qui obéit au Grand Turc, et la malheureuse partie de l’Italie qui obéit au pape.
A.
Je les excepte aussi; mais songez que Paris, qui n’est que d’un dixième moins grand que Londres, n’était alors qu’une petite cité barbare. Amsterdam n’était qu’un marais, Madrid un désert, et de la rive droite du Rhin jusqu’au golfe de Bothnie tout était sauvage; les habitants de ces climats vivaient, comme les Tartares ont toujours vécu, dans l’ignorance, dans la disette, dans la barbarie.
[352]
Comptez-vous pour peu de chose qu'il y ait aujourd'hui des philosophes sur le trône, à Berlin [90], en Suède[91], en Pologne[92] en Russie [93], et que les découvertes de notre grand Newton soient devenues le catéchisme de la noblesse de Moscou et de Pétersbourg?
C.
Vous m'avouerez qu'il n'en est pas de même sur les bords du Danube [94] et du Mançanarès ; la lumière est venue du Nord [95] car vous êtes gens du Nord par rapport à moi, qui suis né sous le quarante-cinquième degré ; mais toutes ces nouveautés font-elles qu'on soit plus heureux dans ces pays qu'on ne l'était quand César descendit dans votre île, où il vous trouva à moitié nus ?
A.
Je le crois fermement ; de bonnes maisons, de bons vêtements, de la bonne chère, avec de bonnes lois et de la liberté, valent mieux que la disette, l'anarchie et l'esclavage. Ceux qui sont mécontents de Londres n'ont qu'à s'en aller aux Orcades : ils y vivront comme nous vivions à Londres du temps de César; ils mangeront du pain d'avoine, et s'égorgeront à coups de couteau pour un poisson séché au soleil et pour une cabane de paille. La vie sauvage a ses charmes ; ceux qui la prêchent n'ont qu'à donner l'exemple.
B.
Mais au moins ils vivraient sous la loi naturelle. La pure nature n'a jamais connu ni débats de parlement, ni prérogatives de la couronne, ni compagnie des Indes, ni impôts de trois schellings par livre sur son champ et sur son pré, et d'un schelling par fenêtre. Vous pourriez bien avoir corrompu la nature ; elle n'est point altérée dans les îles Orcades et chez les Topinambous.
A.
Et si je vous disais que ce sont les sauvages qui corrompent la nature, et que c'est nous qui la suivons ?
[353]
C.
Vous m’étonnez ; quoi ! c’est suivre la nature que de sacrer un archevêque de Cantorbéry ? d’appeler un Allemand transplanté chez vous [96] Votre Majesté ? de ne pouvoir épouser qu’une seule femme, et de payer plus du quart de votre revenu tous les ans ? sans compter bien d’autres transgressions contre la nature dont je ne parle pas.
A.
Je vais pourtant vous le prouver, ou je me trompe fort. N’est-il pas vrai que l’instinct et le jugement, ces deux fils aînés de la nature, nous enseignent à chercher en tout notre bien-être, et à procurer celui des autres, quand leur bien-être fait le nôtre évidemment ? N’est-il pas vrai que si deux vieux cardinaux se rencontraient à jeun et mourants de faim sous un prunier, ils s’aideraient tous deux machinalement à monter sur l’arbre pour cueillir des prunes, et que deux petits coquins de la Forêt-Noire ou des Chicachas en feraient autant ?
B.
Eh bien ! qu’en voulez-vous conclure ?
A.
Ce que ces deux cardinaux et les deux margajats en concluront, que dans tous les cas pareils il faut s’entr’aider. Ceux qui fourniront le plus de secours à la société seront donc ceux qui suivront la nature de plus près. Ceux qui inventeront les arts (ce qui est un grand don de Dieu), ceux qui proposeront des lois (ce qui est infiniment plus aisé), seront donc ceux qui auront le mieux obéi à la loi naturelle : donc, plus les arts seront cultivés et les propriétés assurées, plus la loi naturelle aura été en effet observée. Donc, lorsque nous convenons de payer trois schellings en commun par livre sterling, pour jouir plus sûrement de dix-sept autres schellings ; quand nous convenons de choisir un Allemand pour être, sous le nom de roi, le conservateur de notre liberté, l’arbitre entre les lords et les communes, le chef de la république ; quand nous n’épousons qu’une seule femme par économie, et pour avoir la paix dans la maison ; quand nous tolérons (parce que nous sommes riches) qu’un archevêque de Cantorbéry ait douze mille pièces de revenu pour soulager les pauvres, pour prêcher la vertu s’il sait prêcher, pour entretenir la paix [354] dans le clergé, etc., etc., nous faisons plus que de perfectionner la loi naturelle, nous allons au delà du but; mais le sauvage isolé et brut (s’il y a de tels animaux sur la terre, ce dont je doute fort), que fait-il, du matin au soir, que de pervertir la loi naturelle en étant inutile à lui-même et à tous les hommes ?
Une abeille qui ne ferait ni miel ni cire, une hirondelle qui ne ferait pas son nid, une poule qui ne pondrait jamais, corrompraient leur loi naturelle, qui est leur instinct : les hommes insociables corrompent l’instinct de la nature humaine.
C.
Ainsi l’homme, déguisé sous la laine des moutons ou sous l’excrément des vers à soie, inventant la poudre à canon pour se détruire, et allant chercher la vérole à deux mille lieues de chez lui, c’est là l’homme naturel, et le Brasilien tout nu est l’homme artificiel ?
A.
Non ; mais le Brasilien est un animal qui n’a pas encore atteint le complément de son espèce. C’est un oiseau qui n’a ses plumes que fort tard, une chenille enfermée dans sa fève, qui ne sera en papillon que dans quelques siècles. Il aura peut-être un jour des Newton et des Locke, et alors il aura rempli toute l’étendue de la carrière humaine, supposé que les organes du Brasilien soient assez forts et assez souples pour arriver à ce terme : car tout dépend des organes. Mais que m’importent après tout le caractère d’un Brasilien et les sentiments d’un Topinambou ? Je ne suis ni l’un ni l’autre, je veux être heureux chez moi à ma façon. Il faut examiner l’état où l’on est, et non l’état où l’on ne peut être.
HUITIÈME ENTRETIEN.
DES SERFS DE CORPS.↩
B.
Il me paraît que l’Europe est aujourd’hui comme une grande foire. On y trouve tout ce qu’on croit nécessaire à la vie ; il y a des corps de garde pour veiller à la sûreté des magasins ; des fripons qui gagnent aux trois dés l’argent que perdent les dupes; des fainéants qui demandent l’aumône, et des marionnettes dans le préau [97] .
[355]
A.
Tout cela est de convention, comme vous voyez; et ces conventions de la Foire sont fondées sur les besoins de l'homme, sur sa nature, sur le développement de son intelligence, sur la cause première qui pousse le ressort des causes secondes. Je suis persuadé qu'il en est ainsi dans une république de fourmis : nous les voyons toujours agir sans bien démêler ce qu'elles font; elles ont l'air de courir au hasard, elles jugent peut-être ainsi de nous; elles tiennent leur foire comme nous la nôtre. Pour moi, je ne suis pas absolument mécontent de ma boutique.
C.
Parmi les conventions qui me déplaisent de cette grande foire du monde, il y en a deux surtout qui me mettent en colère : c'est qu'on y vende des esclaves, et qu'il y ait des charlatans dont on paye l'orviétan beaucoup trop cher. Montesquieu m'a fort réjoui dans son chapitre des nègres [98]. Il est bien comique; il triomphe en s'égayant sur notre injustice.
A.
Nous n'avons pas, à la vérité, le droit naturel d'aller garrotter un citoyen d'Angola pour le mener travailler à coups de nerf de bœuf à nos sucreries de la Barbade, comme nous avons le droit naturel de mener à la chasse le chien que nous avons nourri; mais nous avons le droit de convention. Pourquoi ce nègre se vend-il? ou pourquoi se laisse-t-il vendre? je l'ai acheté, il m'appartient; quel tort lui fais-je? Il travaille comme un cheval, je le nourris mal, je rhabille de même, il est battu quand il désobéit; y a-t-il là de quoi tant s'étonner? Traitons-nous mieux nos soldats ? n'ont-ils pas perdu absolument leur liberté comme ce nègre ? la seule différence entre le nègre et le guerrier, c'est que le guerrier coûte bien moins. Un beau nègre revient à présent à cinq cents écus au moins, et un beau soldat en coûte à peine cinquante. Ni l'un ni l'autre ne peut quitter le lieu où il est confiné; l'un et l'autre sont battus pour la moindre faute. Le salaire est à peu près le même; et le nègre a sur le soldat l'avantage de ne point risquer sa vie, et de la passer avec sa négresse et ses négrillons.
B.
Quoi! vous croyez donc qu'un homme peut vendre sa liberté, qui n'a point de prix?
[356]
A.
Tout a son tarif : tant pis pour lui s'il me vend à bon marché quelque chose de si précieux. Dites qu'il est un imbécile; mais ne dites pas que je suis un coquine [99].
C.
Il me semble que Grotius [100], livre II, chapitre v, approuve fort l'esclavage; il trouve même la condition d'un esclave beaucoup plus avantageuse que celle d'un homme de journée, qui n'est pas toujours sûr d'avoir du pain.
B.
Mais Montesquieu regarde la servitude comme une espèce de péché contre nature [101]. Voilà un Hollandais citoyen libre qui veut des esclaves, et un Français qui n'en veut point; il ne croit pas même au droit de la guerre.
A.
Et quel autre droit peut-il donc y avoir dans la guerre que celui du plus fort? Je suppose que je me trouve en Amérique engagé dans une action contre des Espagnols. Un Espagnol m'a blessé, je suis prêt à le tuer; il me dit : Brave Anglais, ne me tue pas, et je te servirai. J'accepte la proposition, je lui fais ce plaisir, je le nourris d'ail et d'ognons; il me lit les soirs Don Quichotte à mon coucher : quel mal y a-t-il à cela, s'il vous plaît? Si je me [357] rends à un Espagnol aux mêmes conditions, quel reproche ai-je à lui faire? Il n'y a dans un marché que ce qu'on y met, comme dit l'empereur Justinien [102].
Montesquieu n'avoue-t-il pas lui-même qu'il y a des peuples d'Europe chez lesquels il est fort commun de se vendre, comme par exemple les Russes?
B.
Il est vrai qu'il le dit [103] , et qu'il cite le capitaine Jean Perry dans l'État présent de la Russie [104]; mais il cite à son ordinaire. Jean Perry dit précisément le contraire [105]. Voici ses propres mots:
« Le czar a ordonné que personne ne se dirait à l'avenir son esclave, son golup, mais seulement raah, qui signifie sujet. Il est vrai que ce peuple n'en tire aucun avantage réel, car il est encore aujourd'hui esclave. »
En effet, tous les cultivateurs, tous les habitants des terres appartenantes aux boyards ou aux prêtres sont esclaves. Si l'impératrice de Russie commence à créer des hommes libres, elle rendra par là son nom immortel.
Au reste, à la honte de l'humanité, les agriculteurs, les artisans, les bourgeois qui ne sont pas citoyens des grandes villes, sont encore esclaves, serfs de glèbe, en Pologne, en Bohême, en Hongrie, en plusieurs provinces de l'Allemagne, dans la moitié de la Franche-Comté [106] dans le quart de la Bourgogne; et ce qu'il y a de contradictoire, c'est qu'ils sont esclaves des prêtres. Il y a tel évêque qui n'a guère que des serfs de glèbe de mainmorte dans son territoire : telle est l'humanité, telle est la charité chrétienne. Quant aux esclaves faits pendant la guerre, on ne voit [358] chez les religieux chevaliers de Malte que des esclaves de Turquie ou des côtes d’Afrique enchaînés aux rames de leurs galères chrétiennes.
A.
Par ma foi, si des évêques et des religieux ont des esclaves, je veux en avoir aussi.
B.
Il serait mieux que personne n’en eût.
C.
La chose arrivera infailliblement quand la paix perpétuelle [107] de l’abbé de Saint-Pierre sera signée par le Grand Turc et par toutes les puissances, et qu’on aura bâti la ville d’arbitrage auprès du trou qu’on voulait percer jusqu’au centre de la terre [108], pour savoir bien précisément comment il faut se conduire sur sa surface.
NEUVIÈME ENTRETIEN.
DES ESPRITS SERFS.↩
B.
Si vous admettez l’esclavage du corps, vous ne permettez pas du moins l’esclavage des esprits?
A.
Entendons-nous, s’il vous plaît. Je n’admets point l’esclavage du corps parmi les principes de la société. Je dis seulement qu’il vaut mieux, pour un vaincu, être esclave que d’être tué, en cas qu’il aime plus la vie que la liberté.
Je dis que le nègre qui se vend est un fou, et que le père nègre qui vend son négrillon est un barbare, mais que je suis un homme fort sensé d’acheter ce nègre et de le faire travailler à ma sucrerie. Mon intérêt est qu’il se porte bien, afin qu’il travaille. Je serai humain envers lui, et je n’exige pas de lui plus de reconnaissance que de mon cheval, à qui je suis obligé de donner de l’avoine si je veux qu’il me serve [109]. Je suis avec mon cheval [359] à peu près comme Dieu avec l'homme. Si Dieu a fait l'homme pour vivre quelques minutes dans l'écurie de la terre, il fallait bien qu'il lui procurât de la nourriture : car il serait absurde qu'il lui eût fait présent de la faim et d'un estomac, et qu'il eût oublié de le nourrir.
C.
Et si votre esclave vous est inutile?
A.
Je lui donnerai sa liberté, sans contredit, dût-il s'aller faire moine.
B.
Mais l'esclavage de l'esprit, comment le trouvez-vous ?
A.
Qu'appelez-vous esclavage de l'esprit ?
B.
J'entends cet usage où l'on est de plier l'esprit de nos enfants, comme les femmes caraïbes pétrissent la tête des leurs; d'apprendre d'abord à leur bouche à balbutier des sottises dont nous nous moquons nous-mêmes; de leur faire croire ces sottises dès qu'ils peuvent commencer à croire; de prendre ainsi tous les soins possibles pour rendre une nation idiote, pusillanime et barbare; d'instituer enfin des lois qui empêchent les hommes d'écrire, de parler, et même de penser, comme Arnolphe veut, dans la comédie, qu'il n'y ait dans sa maison d'écritoire que pour lui [110], et faire d'Agnès une imbécile, afin de jouir d'elle.
A.
S'il y avait de pareilles lois en Angleterre, ou je ferais une belle conspiration pour les abolir, ou je fuirais pour jamais do mon île après y avoir mis le feu.
[360]
C.
Cependant il est bon que tout le monde ne dise pas ce qu’il pense. On ne doit insulter ni par écrit, ni dans ses discours, les puissances et les lois à l’abri desquelles on jouit de sa fortune, de sa liberté, et de toutes les douceurs de la vie.
A.
Non, sans doute, et il faut punir le séditieux téméraire; mais, parce que les hommes peuvent abuser de l'écriture, faut-il leur en interdire l’usage ? J’aimerais autant qu’on tous rendît muet pour vous empêcher de faire de mauvais arguments. On vole dans les rues, faut-il pour cela défendre d’y marcher? On dit des sottises et des injures, faut-il défendre de parler? Chacun peut écrire chez nous ce qu’il pense, à ses risques et à ses périls; c’est la seule manière de parler à sa nation. Si elle trouve que vous avez parlé ridiculement, elle vous siffle; si séditieusement, elle vous punit; si sagement et noblement, elle vous aime et vous récompense. La liberté de parler aux hommes avec la plume est établie en Angleterre comme en Pologne; elle l’est dans les Provinces-Unies ; elle l’est enfin dans la Suède, qui nous imite; elle doit l’être dans la Suisse, sans quoi la Suisse n’est pas digne d’être libre. Point de liberté chez les hommes sans celle d’expliquer sa pensée.
C.
Et si vous étiez né dans Rome moderne ?
A.
J’aurais dressé un autel à Cicéron et à Tacite, gens de Rome l’ancienne ; je serais monté sur cet autel, et, le chapeau de Brutus sur la tête et son poignard à la main, j’aurais rappelé le peuple aux droits naturels qu’il a perdus ; j’aurais rétabli le tribunat, comme lit Nicolas Rienzi [111].
C.
Et vous auriez fini comme lui.
A.
Peut-être : mais je ne puis vous exprimer l’horreur que m’inspira l’esclavage des Romains dans mon dernier voyage ; je frémissais en voyant des récollets au Capitole [112] . Quatre de mes compatriotes ont frété un vaisseau pour aller dessiner les inutiles [361] ruines de Palmyre et de Balbec [113] ; j'ai été tenté cent fois d'en armer une douzaine à mes frais pour aller changer en ruines les repaires des inquisiteurs dans les pays où l'homme est asservi par ces monstres. Mon héros est l'amiral Blake. Envoyé par Cromwell pour signer un traité avec Jean de Bragance, roi de Portugal, ce prince s'excusa de conclure parce que le grand-inquisiteur ne voulait pas souffrir qu'on traitât avec des hérétiques. « Laissez-moi faire, lui dit Blake, il viendra signer le traité sur mon hord. » Le palais de ce moine était sur le Tage, vis-à-vis notre flotte. L'amiral lui lâche une bordée à boulets rouges ; l'inquisiteur vient lui demander pardon, et signe le traité à genoux. L'amiral ne fit en cela que la moitié de ce qu'il devait faire ; il aurait dû défendre à tous les inquisiteurs de tyranniser les âmes et de brûler les corps, comme les Persans, et ensuite les Grecs et les Romains, défendirent aux Africains de sacrifier des victimes humaines.
B.
Vous parlez toujours en véritable Anglais.
A.
En homme, et comme tous les hommes parleraient s'ils osaient. Voulez-vous que je vous dise quel est le plus grand défaut du genre humain ?
C.
Vous me ferez plaisir ; j'aime à connaître mon espèce.
A.
Ce défaut est d'être sot et poltron.
C.
Cependant toutes les nations montrent du courage à la guerre.
A.
Oui, comme les chevaux, qui tremblent au premier son du tambour, et qui avancent fièrement quand ils sont disciplinés par cent coups de tambour et cent coups de fouet.
[362]
DIXIÈME ENTRETIEN.
SUR LA RELIGION.↩
C.
Puisque vous croyez que le partage du brave homme est d’expliquer librement ses pensées, vous voulez donc qu'on puisse tout imprimer sur le gouvernement et sur la religion ?
A.
Qui garde le silence sur ces deux objets, qui n’ose regarder fixement ces deux pôles de la vie humaine n’est qu’un lâche. Si nous n’avions pas su écrire, nous aurions été opprimés par Jacques II et par son chancelier Jeffreys ; et milord de Kenterbury nous ferait donner le fouet à la porte de sa cathédrale. Notre plume fut la première arme contre la tyrannie, et notre épée la seconde.
C.
Quoi ! écrire contre la religion de son pays !
B.
Eh ! vous n’y pensez pas, monsieur C ; si les premiers chrétiens n’avaient pas eu la liberté d’écrire contre la religion de l’empire romain, ils n’auraient jamais établi la leur; ils firent l’évangile de Marie, celui de Jacques, celui de l’enfance, celui des Hébreux, de Barnabe, de Luc, de Jean, de Matthieu, de Marc: ils en écrivirent cinquante-quatre [114]. Ils firent les lettres de Jésus à un roitelet d’Édesse, celles de Pilate à Tibère, de Paul à Sénèque, et les prophéties des sibylles en acrostiches, et le symbole des douze apôtres, et le testament des douze patriarches [115], et le livre d’Enoch, et cinq ou six apocalypses, et de fausses constitutions apostoliques, etc., etc. Que n’écrivirent-ils point? Pourquoi voulez-vous nous ôter la liberté qu’ils ont eue?
C.
Dieu me préserve de proscrire cette liberté précieuse ! Mais j’y veux du ménagement, comme dans la conversation des honnêtes gens ; chacun y dit son avis, mais personne n’insulte la compagnie.
[363]
A.
Je ne demande pas aussi qu'on insulte la société, mais qu'on l'éclaire. Si la religion du pays est divine (car c'est de quoi chaque nation se pique), cent mille volumes lancés contre elle ne lui feront pas plus de mal que cent mille pelotes de neige n'ébranleront des murailles d'airain. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle [116], comme vous savez : comment des caractères noirs tracés sur du papier blanc pourraient-ils la détruire?
Mais si des fanatiques, ou des fripons, ou des gens qui possèdent ces deux qualités à la fois, viennent à corrompre une religion pure et simple; si par hasard des mages et des bonzes ajoutent des cérémonies ridicules à des lois sacrées, des mystères impertinents à la morale divine des Zoroastre et des Confutzée, le genre humain ne doit-il pas des grâces à ceux qui nettoieraient le temple de Dieu des ordures que ces malheureux y auront amassées ?
B.
Vous me paraissez bien savant: quels sont donc ces préceptes de Zoroastre et de Confutzée?
A.
Confutzée ne dit point : « Ne fais pas aux hommes ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. »
Il dit: « Fais ce que tu veux qu'on te fasse; oublie les injures, et ne te souviens que des bienfaits. » Il fait un devoir de l'amitié et de l'humanité.
Je ne citerai qu'une seule loi de Zoroastre, qui comprend ce que la morale a de plus épuré, et qui est justement le contraire du fameux probabilisme des jésuites : « Quand tu seras en doute si une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi de la faire [117] .»
Nul moraliste, nul philosophe, nul législateur n'a jamais rien dit ni pu dire qui l'emporte sur cette maxime. Si, après cela, des docteurs persans ou chinois ont ajouté à l'adoration d'un Dieu et à la doctrine de la vertu des chimères fantastiques, des apparitions, des visions, des prédictions, des prodiges, des possessions, des scapulaires; s'ils ont voulu qu'on ne mangeât que de certains aliments en l'honneur de Zoroastre et de Confutzée ; s'ils ont prétendu être instruits de tous les secrets de la famille de ces deux grands hommes; s'ils ont disputé trois cents ans pour [364] savoir comment Confutzée avait été fait ou engendré; s'ils ont institué des pratiques superstitieuses qui faisaient passer dans leurs poches l'argent des âmes dévotes; s'ils ont établi leur grandeur temporelle sur la sottise de ces âmes peu spirituelles; si enfin ils ont armé des fanatiques pour soutenir leurs inventions par le fer et par les flammes, il est indubitable qu'il a fallu réprimer ces imposteurs. Quiconque a écrit en faveur de la religion naturelle et divine, contre les détestables abus de la religion sophistique, a été le bienfaiteur de sa patrie.
C.
Souvent ces bienfaiteurs ont été mal récompensés. Ils ont été cuits ou empoisonnés, ou ils sont morts en l'air, et toute réforme a produit des guerres.
A.
C'était la faute de la législation. Il n'y a plus de guerres religieuses depuis que les gouvernements ont été assez sages pour réprimer la théologie.
B.
Je voudrais, pour l'honneur de la raison, qu'on l'abolît au lieu de la réprimer : il est trop honteux d'avoir fait une science de cette folie. Je connais bien à quoi sert un curé qui tient registre des naissances et des morts [118], qui ramasse des aumônes pour les pauvres, qui console les malades, qui met la paix dans les familles; mais à quoi sont bons les théologiens? Qu'en reviendra-t-il à la société, quand on aura bien su qu'un ange est infini, secundum quid, que Scipion et Caton sont damnés pour n'avoir pas été chrétiens, et qu'il y a une différence essentielle entre catègorématique et syncatégorématique ?
N'admirez-vous pas un Thomas d'Aquin qui décide que « les parties irascibles et concupiscibles ne sont pas parties de l'appétit intellectuel » ? Il examine au long si les cérémonies de la loi sont avant la loi. Mille pages sont employées à ces belles questions, et cinq cent mille hommes les étudient.
Les théologiens ont longtemps recherché si Dieu peut être citrouille ou scarabée ; si, quand on a reçu l'eucharistie, on la rend à la garde-robe.
Ces extravagances ont occupé des têtes qui avaient de la barbe [365] dans des pays qui ont produit de grands hommes. C'est sur quoi un écrivain [119], ami de la raison, a dit plusieurs fois que notre grand mal est de ne pas savoir encore à quel point nous sommes au-dessous des Hottentots sur certaines matières.
Nous avons été plus loin que les Grecs et les Romains dans plusieurs arts, et nous sommes des brutes en cette partie ; semblables à ces animaux du Nil dont une partie était vivifiée, tandis que l'autre n'était encore que de la fange [120].
Qui le croirait? Un fou, après avoir répété toutes les bêtises scolastiques pendant deux ans, reçoit ses grelots et sa marotte en cérémonie; il se pavane, il décide; et c'est cette école de Bedlam qui mène aux honneurs et aux richesses. Thomas et Bonaventure ont des autels, et ceux qui ont inventé la charrue, la navette, le rabot, et la scie, sont inconnus.
A.
Il faut absolument qu'on détruise la théologie, comme on a détruit l'astrologie judiciaire, la magie, la baguette divinatoire, la cabale, et la chambre étoilée[121]
C.
Détruisons ces chenilles tant que nous pourrons dans nos jardins, et n'y laissons que les rossignols ; conservons l'utile et l'agréable : c'est là tout l'homme ; mais pour tout ce qui est dégoûtant et venimeux, je consens qu'on l'extermine.
A.
Une bonne religion honnête, mort de ma vie! bien établie par acte de parlement, bien dépendante du souverain, voilà ce qu'il nous faut, et tolérons toutes les autres[122]. Nous ne sommes heureux que depuis que nous sommes libres et tolérants.
[366]
C.
Je lisais l'autre jour un poëme français sur la Grâce[123], poëme didactique et un peu soporatif, attendu qu'il est monotone. L'auteur, en parlant de l'Angleterre, à qui la grâce de Dieu est refusée (quoique votre monarque se dise roi par la grâce de Dieu tout comme un autre), l'auteur, dis-je, s'exprime ainsi en vers assez plats :
Cette île, de chrétiens féconde pépinière,
L'Angleterre, où jadis brilla tant de lumière,
Recevant aujourd'hui toutes religions,
N'est plus qu'un triste amas de folles visions...
Oui, nous sommes, Seigneur, tes peuples les plus chers,
Tu fais luire sur nous tes rayons les plus clairs.
Vérité toujours puire, ô doctrine éternelle !
La France est aujourd'hui ton royaume fidèle.(Chant IV, V. 129-146.)
A.
Voilà un plaisant original avec sa pépinière et ses rayons clairs ! Un Français croit toujours qu'il doit donner le ton aux autres nations ; il semble qu'il s'agisse d'un menuet ou d'une mode nouvelle. Il nous plaint d'être libres ! En quoi, s'il vous plaît, la France est-elle le royaume fidèle de la doctrine éternelle? Est-ce dans le temps qu'une bulle ridicule [124] , fabriquée à Paris dans un collège de jésuites, et scellée à Rome par un collège de cardinaux, a divisé toute la France et fait plus de prisonniers et d'exilés qu'elle n'avait de soldats ? le royaume fidèle!
Que l'Église anglicane réponde, si elle veut, à ces rimeurs de l'Église gallicane ; pour moi, je suis sûr que personne ne regrettera parmi nous ce temps jadis où brilla tant de lumière. Était-ce quand les papes envoyaient chez nous des légats donner nos bénéfices à des Italiens, et imposer des décimes sur nos biens pour payer leurs filles de joie? Était-ce quand nos trois royaumes fourmillaient de moines et de miracles ? Ce plat poète est un bien mauvais citoyen. Il devait souhaiter plutôt à sa patrie assez de rayons clairs pour qu'elle aperçût ce qu'elle gagnerait à nous imiter ; ces rayons font voir qu'il ne faut pas que les gallicans envoient vingt mille livres sterling à Rome toutes les années, et que les anglicans, qui payaient autrefois le denier de saint Pierre, étaient plongés alors dans la plus stupide barbarie.
[367]
B.
C'est très-bien dit; la religion ne consiste point du tout à faire passer son argent à Rome. C'est une vérité reconnue non-seulement de ceux qui ont brisé ce joug, mais encore de ceux qui le portent.
A.
Il faut absolument épurer la religion ; l'Europe entière le crie. On commença ce grand ouvrage il y a près de deux cent cinquante années; mais les hommes ne s'éclairent que par degrés. Qui aurait cru alors qu'on analyserait les rayons du soleil, qu'on électriserait avec le tonnerre, et qu'on découvrirait la gravitation universelle, loi qui préside à l'univers ? Il est temps que des hommes si éclairés ne soient pas esclaves des aveugles. Je ris quand je vois une académie des sciences obligée de se conformer à la décision d'une congrégation du saint-office,
La théologie n'a jamais servi qu'à renverser les cervelles, et quelquefois les États. Elle seule fait les athées, car le grand nombre de petits théologiens, qui est assez sensé pour voir le ridicule de cette étude chimérique, n'en sait pas assez pour lui substituer une saine philosophie. La théologie, disent-ils, est, selon la signification du mot, la science de Dieu : or les polissons qui ont profané cette science ont donné de Dieu des idées absurdes; et de là ils concluent que la Divinité est une chimère, parce que la théologie est chimérique. C'est précisément dire qu'il ne faut prendre ni quinquina pour la fièvre, ni faire diète dans la pléthore, ni être saigné dans l'apoplexie, parce qu'il y a de mauvais médecins ; c'est nier la connaissance du cours des astres, parce qu'il y a eu des astrologues ; c'est nier les effets évidents de la chimie, parce que des chimistes charlatans ont prétendu faire de l'or. Les gens du monde, encore plus ignorants que ces petits théologiens, disent : Voilà des bacheliers et des licenciés qui ne croient pas en Dieu ; pourquoi y croirions-nous ?
Mes amis, une fausse science fait les athées : une vraie science prosterne l'homme devant la Divinité; elle rend juste et sage celui que la théologie a rendu inique et insensé.
Voilà à peu près ce que j'ai lu dans ce petit livre [125] nouveau, et j'en ai fait ma profession de foi.
B.
En vérité, c'est celle de tous les honnêtes gens.
[368]
ONZIÈME ENTRETIEN.
DU DROIT DE LA GUERRE[126].↩
B.
Nous avons traité des matières qui nous regardent tous de fort près ; et les hommes sont bien insensés d’aimer mieux aller à la chasse ou jouer au piquet que de s’instruire sur des objets si importants. Notre premier dessein était d’approfondir le droit de la guerre et de la paix ; nous n’en avons pas encore parlé.
A.
Qu’entendez-vous par le droit de la guerre ?
B.
Vous m’embarrassez ; mais enfin de Groot ou Grotius en a fait un ample traité, dans lequel il cite plus de deux cents auteurs grecs ou latins, et même des auteurs juifs.
A.
Croyez-vous que le prince Eugène et le duc de Marlborough l’eussent étudié, quand ils vinrent chasser les Français de cent lieues de pays? Le droit de la paix, je le connais assez, c’est de tenir sa parole, et de laisser tous les hommes jouir des droits de la nature; mais, pour le droit de la guerre, je ne sais ce que c’est. Le code du meurtre me semble une étrange imagination. J’espère que bientôt on nous donnera la jurisprudence des voleurs de grand chemin.
C.
Comment accorderons-nous donc cette horreur si ancienne, si universelle de la guerre, avec les idées du juste et de l’injuste, avec cette bienveillance pour nos semblables que nous prétendons être née avec nous, avec le ![]() le beau, et l’honnête?
le beau, et l’honnête?
B.
N’allons pas si vite. Ce crime qui consiste à commettre un si grand nombre de crimes en front de bandière n’est pas si universel [369] que vous le dites. Nous avons déjà remarqué [127]que les brames et les primitifs nommés quakers n'ont jamais été coupables de cette abomination. Les nations qui sont au delà du Gange versent très-rarement le sang; et je n'ai point lu que la république de San-Marino ait jamais fait la guerre, quoiqu'elle ait à peu près autant de terrain qu'en avait Romulus. Les peuples de l'Indus et de l'Hydaspe furent bien surpris de voir les premiers voleurs armés qui vinrent s'emparer de leur beau pays. Plusieurs peuples de l'Amérique n'avaient jamais entendu parler de ce péché horrible, quand les Espagnols vinrent les attaquer l'Évangile à la main.
Il n'est point dit que les Chananéens eussent jamais fait la guerre à personne, lorsqu'une horde de Juifs parut tout d'un coup, mit les bourgades en cendres, égorgea les femmes sur les corps de leurs maris, et les enfants sur le ventre de leurs mères. Comment expliquerons-nous cette fureur dans nos principes?
A.
Comme les méchants rendent raison de la peste, des deux véroles, et de la rage. Ce sont des maladies attachées à la constitution de nos organes. On n'est pas toujours attaqué de la rage et de la peste; il suffit souvent qu'un ministre d'État enragé ait mordu un autre ministre pour que la rage se communique dans trois mois à quatre ou cinq cent mille hommes.
C.
Mais, quand on a ces maladies, il y a quelques remèdes. En connaissez-vous pour la guerre?
A.
Je n'en connais que deux, dont la tragédie s'est emparée : la crainte et la pitié. La crainte nous oblige souvent à faire la paix; et la pitié, que la nature a mise dans nos cœurs comme un contre-poison contre l'héroïsme carnassier, fait qu'on ne traite pas toujours les vaincus à toute rigueur. Notre intérêt même est d'user envers eux de miséricorde, afin qu'ils servent sans trop de répugnance leurs nouveaux maîtres : je sais bien qu'il y a eu des brutaux qui ont fait sentir rudement le poids de leurs chaînes aux nations subjuguées. A cela je n'ai autre chose à répondre que ce vers d'une tragédie intitulée Spartacus [128], composée par un Français qui pense profondément :
La loi de l'univers, c'est : Malheur au vaincu.
[370]
J'ai dompté un cheval : si je suis sage, je le nourris bien, je le caresse, et je le monte; si je suis un fou furieux, je l'égorge.
C.
Cela n'est pas consolant, car enfin nous avons presque tous été subjugués. Vous autres Anglais, vous l'avez été par les Romains, par les Saxons et les Danois, et ensuite par un bâtard de Normandie. Le berceau de notre religion est entre les mains des Turcs. Une poignée de Francs a soumis la Gaule, Les Tyriens, les Carthaginois, les Romains, les Goths, les Arabes, ont tour à tour subjugué l'Espagne. Enfin, de la Chine à Cadix, presque tout l'univers a toujours appartenu au plus fort. Je ne connais aucun conquérant qui soit venu l'épée dans une main et un code dans l'autre; ils n'ont fait des lois qu'après la victoire, c'est-à-dire après la rapine; et ces lois, ils les ont faites précisément pour soutenir leur tyrannie. Que diriez-vous si quelque bâtard de Normandie venait s'emparer de votre Angleterre pour venir vous donner ses lois?
A.
Je ne dirais rien; je tâcherais de le tuer à sa descente dans ma patrie. S'il me tuait, je n'aurais rien à répliquer; s'il me subjuguait, je n'aurais que deux partis à prendre, celui de me tuer moi-même, ou celui de le bien servir.
B.
Voilà de tristes alternatives. Quoi! point de loi de la guerre? point de droit des gens?
A.
J'en suis fâché; mais il n'y en a point d'autre que de se tenir continuellement sur ses gardes. Tous les rois, tous les ministres, pensent comme nous; et c'est pourquoi douze cent mille mercenaires en Europe font aujourd'hui la parade tous les jours en temps de paix.
Qu'un prince licencie ses troupes, qu'il laisse tomber ses fortifications en ruines, et qu'il passe son temps à lire Grotius, vous verrez si, dans un an ou deux, il n'aura pas perdu son royaume.
C.
Ce sera une grande injustice.
A.
D'accord.
B.
Et point de remède à cela ?
[371]
Aucun, sinon de se mettre en état d'être aussi injuste que ses voisins. Alors l'ambition est contenue par l'ambition; alors les chiens d'égale force montrent les dents, et ne se déchirent que quand ils ont à disputer une proie.
C.
Mais les Romains, les Romains, ces grands législateurs ?
A.
Ils faisaient des lois, vous dis-je, comme les Algériens assujettissent leurs esclaves à la règle; mais, quand ils combattaient pour réduire les nations en esclavage, leur loi était leur épée. Voyez le grand César, le mari de tant de femmes, et la femme de tant d'hommes; il fait mettre en croix deux mille citoyens du pays de Vannes, afin que le reste apprenne à être plus souple; ensuite, quand toute la nation est bien apprivoisée, viennent les lois et les beaux règlements; on bâtit des cirques, des amphithéâtres, on élève des aqueducs, on construit des bains publics, et les peuples subjugués dansent avec leurs chaînes.
B.
On dit pourtant que, dans la guerre, il y a des lois qu'on observe: par exemple, on fait une trêve de quelques jours pour enterrer ses morts ; on stipule qu'on ne se battra pas dans un certain endroit; on accorde une capitulation à une ville assiégée, on lui permet de racheter ses cloches ; on n'éventre point les femmes grosses quand on prend possession d'une place qui s'est rendue ; vous faites des politesses à un officier blessé qui est tombé entre vos mains ; et, s'il meurt, vous le faites enterrer.
A.
Ne voyez-vous pas que ce sont là les lois de la paix, les lois de la nature, les lois primitives, qu'on exécute réciproquement ? La guerre ne les a pas dictées; elles se font entendre malgré la guerre; et sans cela les trois quarts du globe ne seraient qu'un désert couvert d'ossements.
Si deux plaideurs acharnés, et près d'être ruinés par leurs procureurs, font entre eux un accord qui leur laisse à chacun un peu de pain, appellerez-vous cet accord une loi du barreau ? Si une horde de théologiens, allant faire brûler en cérémonie quelques raisonneurs qu'ils appellent hérétiques, apprend que le lendemain le parti hérétique les fera brûler à son tour; s'ils font [372] grâce pour qu’on la leur fasse, direz-vous que c’est la une loi théologique ? Vous avouerez qu’ils out écouté la nature et l’intérêt, malgré la théologie. Il en est de même dans la guerre : le mal qu’elle ne fait pas, c’est le besoin et l’intérêt qui l’arrêtent. La guerre, vous dis-je, est une maladie affreuse qui saisit les nations l'une après l’autre, et que la nature guérit à la longue.
C.
Quoi ! vous n’admettez point de guerre juste ?
A.
Je n’en ai jamais connu de cette espèce ; cela me paraît contradictoire et impossible.
B.
Quoi ! lorsque le pape Alexandre VI et son infâme fils Borgia pillaient la Romagne, égorgeaient, empoisonnaient tous les seigneurs de ce pays, en leur accordant des indulgences, il n’était pas permis de s’armer contre ces monstres ?
A.
Ne voyez-vous pas que c’étaient ces monstres qui faisaient la guerre? Ceux qui se défendaient la soutenaient. Il n’y a certainement dans ce monde que des guerres offensives; la défensive n’est autre chose que la résistance à des voleurs armés.
C.
Vous vous moquez de nous. Deux princes se disputent un héritage, leur droit est litigieux, leurs raisons sont également plausibles; il faut bien que la guerre en décide : alors cette guerre est juste des deux côtés.
A.
C’est vous qui vous moquez. Il est impossible physiquement que l'un des deux n’ait pas tort, et il est absurde et barbare que des nations périssent parce que l’un de ces deux princes a mal raisonné. Qu’ils se battent en champ clos s’ils veulent; mais qu’un peuple entier soit immolé à leurs intérêts, voilà où est l’horreur. Par exemple, l’archiduc Charles dispute le trône d’Espagne au duc d’Anjou [129] et, avant que le procès soit jugé, il en coûte la vie à plus de quatre cent mille hommes ; je vous demande si la chose est juste.
[373]
B.
J'avoue que non. Il fallait trouver quelque autre biais pour accommoder le différend.
C.
Il était tout trouvé ; il fallait s'en rapporter à la nation sur laquelle on voulait régner. La nation espagnole disait : Nous voulons le duc d'Anjou ; le roi son grand-père l'a nommé héritier par son testament ; nous y avons souscrit ; nous l'avons reconnu pour notre roi ; nous l'avons supplié de quitter la France pour venir gouverner. Quiconque veut s'opposer à la loi des vivants et des morts est visiblement injuste.
B.
Fort bien. Mais si la nation se partage ?
A.
Alors, comme je vous le disais, la nation et ceux qui entrent dans la querelle sont malades de la rage. Ses horribles symptômes durent douze ans, jusqu'à ce que les enragés, épuisés, n'en pouvant plus, soient forcés de s'accorder. Le hasard, le mélange de bons et de mauvais succès, les intrigues, la lassitude, ont éteint cet incendie, que d'autres hasards, d'autres intrigues, la cupidité, la jalousie, l'espérance, avaient allumé. La guerre est comme le mont Vésuve ; ses éruptions engloutissent des villes, et ses embrasements s'arrêtent. Il y a des temps où les bêtes féroces, descendues des montagnes, dévorent une partie de vos travaux, ensuite elles se retirent dans leurs cavernes.
C.
Quelle funeste condition que celle des hommes !
A.
Celle des perdrix est pire : les renards, les oiseaux de proie, les dévorent; les chasseurs les tuent, les cuisiniers les rôtissent; et cependant il y en a toujours. La nature conserve les espèces, et se soucie très-peu des individus.
B.
Vous êtes dur, et la morale ne s'accommode pas de ces maximes.
A.
Ce n'est pas moi qui suis dur, c'est la destinée. Vos moralistes font très-bien de crier toujours:
« Misérables mortels, soyez justes et bienfaisants; cultivez la terre, et ne l'ensanglantez pas. [374] Princes, n'allez pas dévaster l'héritage d'autrui, de peur qu'on ne voustue dans le vôtre. Restez chez vous, pauvres gentillâtres ; rétablissez votre masure ; tirez de vos fonds le double de ce que vous en tiriez ; entourez vos champs de haies vives ; plantez des mûriers ; que vos sœurs vous fassent des bas de soie ; améliorez vos vignes ; et si des peuples voisins veulent venir boire votre vin malgré vous, défendez-vous avec courage : mais n'allez pas vendre votre sang à des princes qui ne vous connaissent pas, qui ne jetteront jamais sur vous un coup d'oeil, et qui vous traitent comme des chiens de chasse qu'on mène contre le sanglier, et qu'on laisse ensuite mourir dans un chenil. »
Ces discours feront peut-être impression sur trois ou quatre têtes bien organisées, tandis que cent mille autres ne les entendront seulement pas, et brigueront l'honneur d'être lieutenants de houssards.
Pour les autres moralistes à gages que l'on nomme prédicateurs, ils n'ont jamais seulement osé prêcher contre la guerre. Ils déclament contre les appétits sensuels après avoir pris leur chocolat. Ils anathématisent l'amour, et, au sortir de la chaire où ils ont crié, gesticulé, et sué, ils se font essuyer par leurs dévotes. Ils s'époumonent à prouver des mystères dont ils n'ont pas la plus légère idée : mais ils se gardent bien de décrier la guerre, qui réunit tout ce que la perfidie a de plus lâche dans les manifestes, tout ce que l'infâme friponnerie a de plus bas dans les fournitures des armées, tout ce que le brigandage a d'affreux dans le pillage, le viol, le larcin, l'homicide, la dévastation, la destruction. Au contraire, ces bons prêtres bénissent en cérémonie les étendards du meurtre: et leurs confrères chantent, pour de l'argent, des chansons juives, quand la terre a été inondée de sang,
B.
Je ne me souviens point en effet d'avoir lu dans le prolixe et argumentant Bourdaloue, le premier qui ait mis les apparences de la raison dans ses sermons ; je ne me souviens point, dis-je, d'avoir lu une seule page contre la guerre.
L'élégant et doux Massillon [130] en bénissant les drapeaux du régiment de Catinat, fait, à la vérité, quelques vœux pour la paix; mais il permet l'ambition. « Ce désir, dit-il, de voir vos services récompensés, s'il est modéré... s'il ne vous porte pas à vous frayer des routes d'iniquité pour parvenir à vos fins... n'a [375] rien dont la morale chrétienne puisse être blessée. » Enfin ilprie Dieu d’envoyer l’ange exterminateur au-devant du régimentde Catinat. « O mon Dieu! faites-le précéder toujours de la victoire et de la mort ; répandez sur ses ennemis des esprits deterreur et de vertige. » J’ignore si la victoire peut précéder unrégiment, et si Dieu répand des esprits de vertige; mais je saisque les prédicateurs autrichiens en disaient autant aux cuirassiers de l’empereur, et que l’ange exterminateur ne savait auquel entendre.
A.
Les prédicateurs juifs allèrent encore plus loin. On voit avec édification les prières humaines dont leurs psaumes sont remplis. Il n’est question que de mettre l’épée divine sur sa cuisse, d’éventrer les femmes, d’écraser les enfants à la mamelle contre la muraille. L’ange exterminateur ne fut pas heureux dans ses campagnes, il devint l’ange exterminé ; et les Juifs, pour prix de leurs psaumes, furent toujours vaincus et esclaves.
De quelque côté que vous vous tourniez, vous verrez que les prêtres ont toujours prêché le carnage, depuis un Aaron, qu’on prétend avoir été pontife d’une horde d’Arabes, jusqu’au prédicant Jurieu, prophète d’Amsterdam. Les négociants de cette ville, aussi sensés que ce pauvre garçon était fou, le laissaient dire, et vendaient leur girofle et leur cannelle.
C.
Eh bien ! n’allons point à la guerre, ne nous faisons point tuer au hasard pour de l’argent. Contentons-nous de nous bien défendre contre les voleurs appelés conquérants.
DOUZIÈME ENTRETIEN.
DU CODE DE LA PERFIDIE.↩
B.
Et du droit de la perfidie, qu’en dirons-nous?
A.
Comment, par saint George! je n’avais jamais entendu parler de ce droit-là. Dans quel catéchisme avez-vous lu ce devoir du chrétien?
B.
Je le trouve partout. La première chose que fait Moïse avec son saint peuple, n’est-ce pas d’emprunter par une perfidie les [376] meubles des Égyptiens [131], pour s'en aller, dit-il, sacrifier dans le désert? Cette perfidie n'est, à la vérité, accompagnée que d'un larcin ; celles qui sont jointes au meurtre sont bien plus admirables. Les perfidies d'Aod [132], de Judith [133] sont très-renommées. Celles du patriarche Jacob envers son beau-père et son frère ne sont que des tours de maître Gonin, puisqu'il n'assassina ni son frère ni son beau-père. Mais vive la perfidie de David [134], qui, s'étant associé quatre cents coquins perdus de dettes et de débauche, et ayant fait alliance avec un certain roitelet nommé Achis [135] allait égorger les hommes, les femmes, les petits enfants des villages qui étaient sous la sauvegarde de ce roitelet, et lui faisait croire qu'il n'avait égorgé que les hommes, les femmes et les petits garçons appartenant au roitelet Saül ! Vive surtout sa perfidie envers le bon homme Uriah [136]! Vive celle du sage Salomon, inspiré de Dieu, qui fit massacrer son frère Adonias, après avoir juré de lui conserver la vie [137]!
Nous avons encore des perfidies très-renommées de Clovis, premier roi chrétien des Francs, qui pourraient beaucoup servir à perfectionner la morale. J'estime surtout sa conduite envers les assassins d'un Regnomer, roi du Mans (supposé qu'il y ait jamais eu un royaume du Mans). Il fit marché avec de braves assassins pour tuer ce roi par derrière, et les paya en fausse monnaie; mais comme ils murmuraient de n'avoir pas leur compte, il les fit assassiner pour rattraper sa monnaie de billon.
Presque toutes nos histoires sont remplies de pareilles perfidies commises par des princes qui tous ont bâti des églises et fondé des monastères.
Or l'exemples de ces braves gens doit certainement servir de leçon au genre humain : car où en chercherait-il, si ce n'est dans les oints du Seigneur?
A.
Il m'importe fort peu que Clovis et ses pareils aient été oints; mais je vous avoue que je souhaiterais, pour l'édification du genre humain, qu'on jetât dans le feu toute l'histoire civile et ecclésiastique. Je n'y vois guère que les annales des crimes [138] ; et soit que ces monstres aient été oints ou ne l'aient pas été, il ne résulte de leur histoire que l'exemple de la scélératesse.
[377]
Je me souviens d'avoir lu autrefois l'Histoire du grand schisme d'Occident [139]. Je voyais une douzaine de papes tous également perfides, tous méritant également d'être pendus à Tyburn. Et puisque la papauté a subsisté au milieu d'un débordement si long et si vaste de tous les crimes, puisque les archives de ces horreurs n'ont corrigé personne, je conclus que l'histoire n'est bonne à rien.
C.
Oui, je conçois que le roman vaudrait mieux: on y est maître du moins de feindre des exemples de vertu ; mais Homère n'a jamais imaginé une seule action vertueuse et honnête dans tout son roman monotone de l'Iliade. J'aimerais beaucoup mieux le roman de Télémaque, s'il n'était pas tout en digressions et en déclamations. Mais puisque vous m'y faites songer, voici un morceau du Télémaque, concernant la perfidie, sur lequel je voudrais avoir votre avis.
Dans une des digressions de ce roman, au livre XX, Adraste, roi des Dauniens, ravit la femme d'un nommé Dioscore. Ce Dioscore se réfugie chez les princes grecs, et, n'écoutant que sa vengeance, il leur offre de tuer le ravisseur leur ennemi. Télémaque, inspiré par Minerve, leur persuade de ne point écouter Dioscore, et de le renvoyer pieds et poings liés au roi Adraste. Comment trouvez-vous cette décision du vertueux Télémaque ?
A.
Abominable. Ce n'était pas apparemment Minerve, c'était Tisiphone qui l'inspirait. Comment! renvoyer ce pauvre homme, afin qu'on le fasse mourir dans les tourments, et qu' Adraste ressemble en tout à David, qui jouissait de la femme en faisant mourir le mari ! L'onctueux auteur du Télémaque n'y pensait pas. Ce n'est point là l'action d'un cœur généreux, c'est celle d'un méchant et d'un traître. Je n'aurais point accepté la proposition de Dioscore, mais je n'aurais pas livré cet infortuné à son ennemi. Dioscore était fort vindicatif, à ce que je vois, mais Télémaque était un perfide.
B.
Et la perfidie dans les traités, l'admettez-vous?
Elle est fort commune, je l'avoue. Je serais bien embarrassé s'il fallait décider quels furent les plus grands fripons dans leurs [378] négociations, des Romains ou des Carthaginois, de Louis XI le très-chrétien, ou de Ferdinand le catholique, etc., etc., etc., etc., etc. Mais je demande s'il n'est pas permis de friponner pour le bien de l'État.
A.
Il me semble qu'il y a des friponneries si adroites que tout le monde les pardonne; il y en a de si grossières qu'elles sont universellement condamnées. Pour nous autres Anglais, nous n'avons jamais attrapé personne. Il n'y a que le faible qui 'trompe [140]. Si vous voulez avoir de beaux exemples de perfidie, adressez-vous aux Italiens du xve et du xvie siècle.
Le vrai politique est celui qui joue bien, et qui gagne à la longue. Le mauvais politique est celui qui ne sait que filer la carte, et qui tôt ou tard est reconnu.
C.
Fort bien ; et s'il n'est pas découvert, ou s'il ne l'est qu'après avoir gagné tout notre argent, et lorsqu'il s'est rendu assez puissant pour qu'on ne puisse le forcer à le rendre?
A.
Je crois que ce bonheur est rare, et que l'histoire nous fournit plus d'illustres filous punis que d'illustres filous heureux.
B.
Je n'ai plus qu'une question à vous faire. Trouvez-vous bon qu'une nation fasse empoisonner un ennemi public selon cette maxime : Salus reipublicae suprema lex esto?
A.
Parbleu ! allez demander cela à des casuistes. Si quelqu'un faisait cette proposition dans la chambre des communes, j'opinerais (Dieu me pardonne!) pour l'empoisonner lui-même, malgré ma répugnance pour les drogues. Je voudrais bien savoir pourquoi ce qui est un forfait abominable dans un particulier serait innocent dans trois cents sénateurs, et même dans trois cent mille : est-ce que le nombre des coupables transforme le crime en vertu ?
C.
Je suis content de votre réponse. Vous êtes un brave homme.
[379]
TREIZIÈME ENTRETIEN.
DES LOIS FONDAMENTALES.↩
B.
J’entends toujours parler de lois fondamentales ; mais y en a-t-il?
A.
Oui, il y a celle d’être juste; et jamais fondement ne fut plus souvent ébranlé,
C.
Je lisais, il n’y a pas longtemps, un de ces mauvais livres très-rares, que les curieux recherchent, comme les naturalistes amassent des fragments de substances animales ou végétales pétrifiés, s’imaginant par là qu’ils découvriront le secret de la nature. Ce livre est d’un avocat de Paris, nommé Louis Dorléans, qui plaidait beaucoup contre Henri IV par-devant la Ligue, et qui heureusement perdit sa cause. Voici comme ce jurisconsulte s’exprime sur les lois fondamentales du royaume de France :
« La loi fondamentale des Hébreux était que les lépreux ne pouvaient régner. Henri IV est hérétique : donc il est lépreux; donc il ne peut être roi de France par la loi fondamentale de l’Église. La loi veut qu’un roi de France soit chrétien comme mâle : qui ne tient la foi catholique, apostolique, et romaine, n’est point chrétien, et ne croit point en Dieu; il ne peut pas plus être roi de France que le plus grand faquin du monde, etc. » [141]
[380]
Il est très-vrai à Rome que tout homme qui ne croit point au pape ne croit point en Dieu; mais cela n'est pas absolument si vrai dans le reste de la terre : il y faut mettre quelque petite restriction, et il me semble qu'à tout prendre maître Louis Dorléans, avocat au parlement de Paris, ne raisonnait pas tout à fait aussi bien que Cicéron et Démosthène.
B.
Mon plaisir serait de voir ce que deviendrait la loi fondamentale du saint empire romain, s'il prenait un jour fantaisie aux électeurs de choisir un césar protestant, dans la superbe ville de Francfort-sur-le-Mein.
A.
Il arriverait ce qui est arrivé à la loi fondamentale qui fixe le nombre des électeurs à sept, parce qu'il y a sept cieux, et que le chandelier d'un temple juif avait sept branches.
N'est-ce pas une loi fondamentale en France que le domaine du roi est inaliénable? Et cependant n'est-il presque pas tout aliéné? Vous m'avouerez que tous ces fondements-là sont bâtis sur du sable mouvant. Les lois qu'on appelle lois fondamentales ne sont, comme toutes les autres, que des lois de convention, d'anciens usages, d'anciens préjugés qui changent selon les temps. Demandez aux Romains d'aujourd'hui s'ils ont gardé les lois fondamentales de l'ancienne république romaine. Il était bon que les domaines des rois d'Angleterre, de France, et d'Espagne, [381] demeurassent propres à la couronne quand les rois vivaient comme vous et moi du produit de leurs terres; mais aujourd'hui qu'ils ne vivent que de taxes et d'impôts, qu'importe qu'ils aient des domaines ou qu'ils n'en aient pas ? Quand François I" manqua de parole à Charles-Quint son vainqueur, quand il viola fort à propos le serment de lui rendre la Bourgogne, il se fit représenter par ses gens de loi que les Bourguignons étaient inaliénables; mais si Charles-Quint était venu lui faire des représentations contraires à la tête d'une grande armée, les Bourguignons auraient été très-aliénés.
La Franche-Comté, dont la loi fondamentale était d'être libre sous la maison d'Autriche, tient aujourd'hui d'une manière intime et essentielle à la couronne de France. Les Suisses ont tenu essentiellement à l'empire, et tiennent aujourd'hui essentiellement à la liberté.
C'est cette liberté qui est la loi fondamentale de toutes les nations : c'est la seule loi contre laquelle rien ne peut prescrire, parce que c'est celle de la nature. Les Romains peuvent dire au pape : Notre loi fondamentale fut d'abord d'avoir un roi qui régnait sur une lieue de pays; ensuite elle fut d'élire deux consuls, puis deux tribuns; puis notre loi fondamentale fut d'être mangés par un empereur, puis d'être mangés par des gens venus du Nord, puis d'être dans l'anarchie, puis de mourir de faim sous le gouvernement d'un prêtre. Nous revenons enfin à la véritable loi fondamentale, qui est d'être libres : allez-vous-en donner ailleurs des indulgences in articulo mortis, et sortez du Capitole, qui n'était pas bâti pour vous.
B.
Amen !
C.
Il faut bien espérer que la chose arrivera quelque jour. Ce sera un beau spectacle pour nos petits-enfants,
A.
Plût à Dieu que les grands-pères en eussent la joie! C'est de toutes les révolutions la plus aisée à faire; et cependant personne n'y pense.
B.
C'est que, comme vous l'avez dit [142], le caractère principal des hommes est d'être sots et poltrons. Les rats romains n'en savent pas encore assez pour attacher le grelot au cou du chat [F2N: La Fontaine, livre II, fable II.].
[382]
C.
N’admettons-nous point encore quelque loi fondamentale?
A.
La liberté les comprend toutes. Que l'agriculteur ne soit point vexé par un tyran subalterne ; qu’on ne puisse emprisonner un citoyen sans lui faire incontinent son procès devant ses juges naturels, qui décident entre lui et son persécuteur; qu’on ne prenne à personne son pré et sa vigne sous prétexte du bien public, sans le dédommager amplement; que les prêtres enseignent la morale, et ne la corrompent point; qu’ils édifient les peuples au lieu de vouloir dominer sur eux en s’engraissant de leur substance; que la loi règne, et non le caprice.
C.
Le genre humain est prêt à signer tout cela.
QUATORZIÈME ENTRETIEN.
QUE TOUT ÉTAT DOIT ÊTRE INDÉPENDANT.↩
B.
Après avoir parlé du droit de tuer et d’empoisonner en temps de guerre, voyons un peu ce que nous ferons en temps de paix.
Premièrement, comment les États, soit républicains, soit monarchiques, se gouverneront-ils?
A.
Par eux-mêmes apparemment, sans dépendre en rien d’aucune puissance étrangère, à moins que ces États ne soient composés d’imbéciles et de lâches.
C.
Il était donc bien honteux que l’Angleterre fût vassale d’un légat a latere, d’un légat du côté. Vous vous souvenez d’un certain drôle nommé Pandolphe, qui fit mettre votre roi Jean à genoux devant lui, et qui en reçut foi et hommage-lige, au nom de l’évêque de Rome Innocent III, vice-dieu, serviteur des serviteurs de Dieu, le 15 mai, veille de l’Ascension, 1213?
A.
Oui, oui, nous nous en soutenons, pour traiter ce serviteur insolent comme il le mérite.
[383]
B.
Eh, mon Dieu ! monsieur C, ne faisons pas tant les fiers, il n'y a point de royaume en Europe que l'évêque de Rome n'ait donné en vertu de son humble et sainte puissance. Le vice-dieu Stephanus [143] ôta le royaume de France à Chilpericus pour le donner à son principal domestique Pipinus, comme le dit votre Éginhard lui-même, si les écrits de cet Éginhard n'ont pas été falsifiés par les moines, comme tant d'autres écrits, et comme je le soupçonne.
Le vice-dieu Silvestre donna la Hongrie au duc Etienne, en Fan 1001, pour faire plaisir à sa femme Gizelle, qui avait beaucoup de visions.
Le vice-dieu Innocent IV, en 1247 , donna le royaume de Norvège à un bâtard nommé Haquin, que ledit pape de plein droit fit légitime, moyennant quinze mille marcs d'argent. Et ces quinze mille marcs d'argent n'existant pas alors en Norvège, il fallut emprunter pour payer.
Pendant deux siècles entiers, les rois de Castille, d'Aragon, et de Portugal, ne furent-ils pas tenus de payer annuellement un tribut de deux livres d'or au vice-dieu? On sait combien d'empereurs ont été déposés, ou forcés de demander pardon, ou assassinés, ou empoisonnés en vertu d'une bulle. Non-seulement, vous dis-je, le serviteur des serviteurs de Dieu a donné tous les royaumes de la communion romaine sans exception, mais il en a retenu le domaine suprême et le domaine utile ; il n'en est aucun sur lequel il n'ait levé des décimes, des tributs de toute espèce.
Il est encore aujourd'hui suzerain du royaume de Naples; on lui en fait un hommage-lige depuis sept cents ans. Le roi de Naples, ce descendant de tant de souverains [144], lui paye encore un tribut. Le roi de Naples est aujourd'hui en Europe le seul roi vassal; et de qui? juste ciel [145] !
A.
Je lui conseille de ne l'être pas longtemps.
Je demeure toujours confondu quand je vois les traces de l'antique superstition qui subsistent encore. Par quelle étrange [384] fatalité presque tous les princes coururent-ils ainsi pendant tant de siècles au-devant du joug qu'on leur présentait?
B.
La raison en est fort naturelle. Les rois et les barons ne savaient ni lire ni écrire, et la cour romaine le savait : cela seul lui donna cette prodigieuse supériorité dont elle retient encore de beaux restes.
C.
Et comment des princes et des barons qui étaient libres ont-ils pu se soumettre si lâchement à quelques jongleurs?
A.
Je vois clairement ce que c'est. Les brutaux savaient se battre, et les jongleurs savaient gouverner; mais lorsque enfin les barons ont appris à lire et à écrire, lorsque la lèpre de l'ignorance a diminué chez les magistrats et chez les principaux citoyens, on a regardé en face l'idole devant laquelle on avait léché la poussière; au lieu d'hommage, la moitié de l'Europe a rendu outrage pour outrage au serviteur des serviteurs; l'autre moitié, qui lui baise encore les pieds, lui lie les mains; du moins c'est ainsi que je l'ai lu dans une histoire qui, quoique contemporaine, est vraie et philosophique [146] . Je suis sûr que si demain le roi de Naples et de Sicile veut renoncer à cette unique prérogative qu'il possède d'être homme-lige du pape, d'être le serviteur du serviteur des serviteurs de Dieu, et de lui donner tous les ans un petit cheval avec deux mille écus d'or pendus au cou, toute l'Europe lui applaudira [147] .
B.
Il en est en droit, car ce n'est pas le pape qui lui a donné le royaume de Naples. Si des meurtriers normands [148], pour colorer leurs usurpations, et pour être indépendants des empereurs auxquels ils avaient fait hommage, se firent oblats de la sainte Église, le roi des Deux-Siciles, qui descend de Hugues Capet en ligne droite, et non de ces Normands, n'est nullement tenu d'être oblat. Il n'a qu'à vouloir.
Le roi de France n'a qu'à dire un mot, et le pape n'aura pas [385] plus de crédit en France qu’en Russie. On ne payera plus d’annates à Rome, on n’y achètera plus la permission d’épouser sacousine ou sa nièce ; je vous réponds que les tribunaux de Franceappelés parlements enregistreront cet édit sans remontrances.
On ne connaît pas ses forces. Qui aurait proposé, il y a cinquante ans, de chasser les jésuites de tant d’États catholiques aurait passé pour le plus visionnaire des hommes. Ce colosse avait un pied à Rome, et l’autre au Paraguai ; il couvrait de ses bras mille provinces, et portait sa tête dans le ciel. J’ai passé, et il n’était plus [149].
Il n’y a qu’à souffler sur tous les autres moines, ils disparaîtront de la surface de la terre.
A.
Ce n’est pas notre intérêt que la France ait moins de moines et plus d’hommes ; mais j’ai tant d’aversion pour le froc que j’aimerais encore mieux voir en France des revues que des processions. En un mot, en qualité de citoyen, je n’aime point à voir des citoyens qui cessent de l’être, des sujets qui se font sujets d’un étranger, des patriotes qui n’ont plus de patrie ; je veux que chaque État soit parfaitement indépendant.
Vous avez dit que les hommes ont été longtemps aveugles, ensuite borgnes, et qu’ils commencent à jouir de deux yeux. A qui en a-t-on l’obligation ? A cinq ou six oculistes qui ont paru en divers temps.
B.
Oui ; mais le mal est qu’il y a des aveugles qui veulent battre les chirurgiens empressés à les guérir.
A.
Eh bien ! ne rendons la lumière qu’à ceux qui nous prieront d’enlever leurs cataractes.
QUINZIÈME ENTRETIEN.
DE LA MEILLEURE LÉGISLATION.↩
C.
De tous les États, quel est celui qui vous paraît avoir les meilleures lois, la juriprudence la plus conforme au bien général et au bien des particuliers ?
[386]
A.
C'est mon pays, sans contredit, La preuve en est que, dans tous nos démêlés, nous vantons toujours notre heureuse constitution, et que, dans presque tous les autres royaumes, on en souhaite une autre. Notre jurisprudence criminelle est équitable et n'est point barbare : nous avons aboli la torture, contre laquelle la voix de la nature s'élève en vain dans tant d'autres pays ; ce moyen affreux de faire périr un innocent faible, et de sauver un coupable robuste, a fini avec notre infâme chancelier Jeffreys, qui employait avec joie cet usage infernal sous le roi Jacques II.
Chaque accusé est jugé par ses pairs ; il n'est réputé coupable que quand ils sont d'accord sur le fait : c'est la loi seule qui le condamne sur le crime avéré, et non sur la sentence arbitraire des juges. La peine capitale est la simple mort, et non une mort accompagnée de tourments recherchés. Étendre un homme sur une croix de Saint-André, lui casser les bras et les cuisses, et le mettre en cet état sur un roue de carrosse, nous parait une barbarie qui offense trop la nature humaine. Si, pour les crimes de haute trahison, on arrache encore le cœur du coupable après sa mort, c'est un ancien usage de cannibale, un appareil de terreur qui effraye le spectateur sans être douloureux pour l'exécuté. Nous n'ajoutons point de tourments à la mort ; on ne refuse point comme ailleurs un conseil à l'accusé ; on ne met point un témoin qui a porté trop légèrement son témoignage dans la nécessité de mentir, en le punissant s'il se rétracte ; on ne fait point déposer les témoins en secret, ce serait en faire des délateurs ; la procédure est publique : les procès secrets n'ont été inventés que par la tyrannie.
Nous n'avons point l'imbécile barbarie de punir des indécences [150] du même supplice dont on punit les parricides. Cette cruauté, aussi sotte qu'abominable, est indigne de nous.
Dans le civil, c'est encore la seule loi qui juge ; il n'est pas permis de l'interpréter : ce serait abandonner la fortune des citoyens au caprice, à la faveur et à la haine.
Si la loi n'a pas pourvu au cas qui se présente, alors on se pourvoit à la cour d'équité, par-devant le chancelier et ses assesseurs ; et s'il s'agit d'une chose importante, on fait pour l'avenir une nouvelle loi en parlement, c'est-à-dire dans les états de la nation assemblée.
[387]
Les plaideurs ne sollicitent jamais leurs juges; ce serait leur dire: Je yeux vous séduire. Un juge qui recevrait une visite d'un plaideur serait déshonoré ; ils ne recherchent point cet honneur ridicule qui flatte la vanité d'un bourgeois. Aussi n'ont-ils point acheté le droit de juger; on ne vend point chez nous une place de magistrat [151] comme une métairie : si des membres du parlement vendent quelquefois leur voix à la cour, ils ressemblent à quelques belles qui vendent leurs laveurs, et qui ne le disent pas. La loi ordonne chez nous qu'on ne vendra rien que des terres et les fruits de la terre; tandis qu'en France la loi elle-même fixe le prix d'une charge de conseiller au banc du roi qu'on nomme parlement, et de président qu'on nomme à mortier; presque toutes les places et les dignités se vendent en France, comme on vend des herbes au marché. Le chancelier de France est tiré souvent du corps des conseillers d'État; mais, pour être conseiller d'État, il faut avoir acheté une charge de maître des requêtes. Un régiment n'est point le prix des services, c'est le prix de la somme que les parents d'un jeune homme ont déposée pour qu'il aille trois mois de Tannée tenir table ouverte dans une ville de province.
Vous voyez clairement combien nous sommes heureux d'avoir des lois qui nous mettent à l'abri de ces abus. Chez nous, rien d'arbitraire, sinon les grâces que le roi veut faire. Les bienfaits émanent de lui ; la loi fait tout le reste.
Si l'autorité attente illégalement à la liberté du moindre citoyen, la loi le venge ; le ministre est incontinent condamné à l'amende envers le citoyen, et il la paye.
Ajoutez à tous ces avantages le droit que tout homme a parmi nous de parler par sa plume à la nation entière. L'art admirable de l'imprimerie est dans notre île aussi libre que la parole. Comment ne pas aimer une telle législation ?
Nous avons, il est vrai, toujours deux partis; mais ils tiennent la nation en garde plutôt qu'ils ne la divisent. Ces deux partis veillent l'un sur l'autre, et se disputent l'honneur d'être les gardiens de la liberté publique. Nous avons des querelles ; mais nous bénissons toujours cette heureuse constitution qui les fait naître.
C.
Votre gouvernement est un bel ouvrage, mais il est fragile.
A.
Nous lui donnons quelquefois de rudes coups, mais nous ne le cassons point.
[388]
B.
Conservez ce précieux monument que l'intelligence et le courage ont élevé : il vous a trop coûté pour que tous le laissiez détruire. L’homme est né libre : le meilleur gouvernement est celui qui conserve le plus qu’il est possible à chaque mortel ce don de la nature.
Mais, croyez-moi, arrangez-vous avec vos colonies, et que la mère et les filles ne se battent pas [152].
SEIZIÈME ENTRETIEN.
DES ABUS.↩
C.
On dit que le monde n’est gouverné que par des abus ; cela est-il vrai ?
B.
Je crois bien qu’il y a pour le moins moité abus et moitié usages tolérables chez les nations policées, moitié malheur et moitié fortune, de même que sur la mer on trouve un partage assez égal de tempêtes et de beau temps pendant l’année. C’est ce qui a fait imaginer les deux tonneaux de Jupiter et la secte des manichéens.
A.
Pardieu, si Jupiter a eu deux tonneaux, celui du mal était la tonne d’Heidelberg [153] ; et celui du bien fut à peine un quartaut. Il y a tant d'abus dans ce monde que, dans un voyage que je fis à Paris en 1751, on appelait comme d’abus six fois par semaine, pendant toute l’année, au banc du roi qu’ils nomment parlement.
B.
Oui; mais à qui appellerons-nous des abus qui règnent dans la constitution de ce monde?
N’est-cc pas un abus énorme que tous les animaux se tuent avec acharnement les uns les autres pour se nourrir, que les hommes se tuent beaucoup plus furieusement encore sans avoir seulement l’idée de se manger?
[389]
C.
Ah ! pardonnez-moi ; nous nous faisions autrefois la guerro pour nous manger; mais, à la longue, toutes les bonnes institutions dégénèrent.
B.
J’ai lu dans un livre[154] que nous n’avons, l’un portant l’autre, qu’environ vingt-deux ans à vivre ; que de ces vingt-deux ans, si vous retranchez le temps perdu du sommeil et le temps que nous perdons dans la veille, il reste à peine quinze ans clair et net; que sur ces quinze ans il ne faut pas compter l’enfance, qui n’est qu’un passage du néant à l’existence ; et que, si vous retranchez encore les tourments du corps, et les chagrins de ce qu’on appelle âme, il ne reste pas trois ans francs et quittes pour les plus heureux, et pas six mois pour les autres. N’est-ce pas là un abus intolérable?
A.
Eh ! que diable en conclurez-vous ? Ordonnerez-vous que la nature soit autrement faite qu’elle ne l’est ?
B.
Je le désirerais du moins.
A.
C’est un secret sur pour abréger encore votre vie.
C.
Laissons là les pas de clerc qu’a faits la nature ; les enfants formés dans la matrice pour y périr souvent et pour donner la mort à leur mère ; la source de la vie empoisonnée par un venin qui s’est glissé, de trou en cheville, de l’Amérique en Europe ; la petite vérole, qui décime le genre humain; la peste, toujours subsistante en Afrique ; les poisons dont la terre est couverte et qui viennent d’eux-mêmes si aisément, tandis qu’on ne peut avoir du froment qu’avec des peines incroyables : ne parlons que des abus que nous avons introduits nous-mêmes.
B.
La liste serait longue dans la société perfectionnée : car, sans compter l’art d’assassiner régulièrement le genre humain par la guerre, dont nous avons déjà parlé [155], nous avons l'art d’arracher [390] préparent la laine ; l’art d’accumuler tous les trésors d’une nation entière dans les coffres de cinq ou six cents personnes ; l’art de faire tuer publiquement en cérémonie [156], avec une demi-feuille de papier, ceux qui vous ont déplu, comme une maréchale d’Ancre, un maréchal de Marillac, un duc de Sommerset, une Marie Stuart; l’usage de préparer un homme à la mort par des tortures pour connaître ses associés, quand il ne peut avoir eu d’associés ; les bûchers allumés, les poignards aiguisés, les échafauds dressés pour des arguments en baralipton ; la moitié d’une nation occupée sans cesse à vexer l’autre loyalement. Je parlerais plus long-temps qu’Esdras, si je voulais faire écrire nos abus sous ma
dictée.
A.
Tout cela est vrai ; mais convenez que la plupart de ces abus horribles sont abolis en Angleterre, et commencent à être fort mitigés chez les autres nations.
B.
Je l’avoue ; mais pourquoi les hommes sont-ils un peu meilleurs et un peu moins malheureux qu’ils ne l’étaient du temps d’Alexandre VI, de la Saint-Barthélémy, et de Cromwell ?
C.
C’est qu’on commence à penser, à s’éclairer, et à bien écrire.
A.
J’en conviens : la superstition excita les orages, et la philosophie les apaise.
DIX-SEPTIÈME ENTRETIEN.
SUR DES CHOSES CURIEUSES.↩
B.
A propos, monsieur A, et croyez-vous le monde bien ancien ?
A.
Monsieur B, ma fantaisie est qu’il est éternel.
[391]
B.
Cela peut se soutenir par voie d'hypothèse. Tous les anciens philosophes ont crut la matière éternelle : or de la matière brute à la matière organisée il n'y a qu'un pas.
C.
Les hypothèses sont fort amusantes ; elles sont sans conséquence. Ce sont des songes que la Bible fait évanouir, car il en faut toujours revenir à la Bible.
A.
Sans doute, et nous pensons tous trois dans le fond, en l'an de grâce 1760, que, depuis la création du monde qui fut fait de rien, jusqu'au déluge universel fait avec de l'eau créée exprès, il se passa 1656 ans selon la Vulgate, 2309 ans selon le texte samaritain, et 2262 ans selon la traduction miraculeuse que nous appelons des Septante. Mais j'ai toujours été étonné qu'Adam et Eve, notre père et notre mère, Abel, Cain, Seth, n'aient été connus de personne au monde que de la petite horde juive, qui tint le cas secret jusqu'à ce que les Juifs d'Alexandrie s'avisassent, sous le premier et le second Ptolémée, de traduire fort mal en grec leurs rapsodies absolument inconnues jusque-là au reste de la terre.
Il est plaisant que nos titres de famille ne soient demeurés en dépôt que dans une seule branche de notre maison, et encore chez la plus méprisée ; tandis que les Chinois, les Indiens, les Persans, les Égyptiens, les Grecs et les Romains, n'avaient jamais entendu parler ni d'Adam ni d'Eve.
B.
Il y a bien pis : c'est que Sanchoniathon, qui vivait incontestablement avant le temps où l'on place Moïse, et qui a fait une Genèse à sa façon, comme tant d'autres auteurs, ne parle ni de cet Adam ni de cette Eve. Il nous donne des parents tout différents.
C.
Sur quoi jugez-vous, monsieur B, que Sanchoniathon vivait avant l'époque de Moïse ?
B.
C'est que, s'il avait été du temps de Moïse, ou après lui, il en aurait fait mention. Il écrivait dans Tyr, qui florissait très-longtemps avant que la horde juive eût acquis un coin de terre vers la Phénicie. La langue phénicienne était la mère-langue du pays; [392] les Phéniciens cultivaient les lettres depuis longtemps; les livres juifs l'avouent en plusieurs endroits. Il est dit expressément que Caleb s'empara de la ville des lettres [157], nommée Cariatlh-Séplier, c'est-à-dire Ville des livres, appelée depuis Dabir. Certainement Sanchoniathon aurait parlé de Moïse s'il avait été son contemporain ou son puîné. Il n'est pas naturel qu'il eût omis dans son histoire les mirifiques aventures de Mosé ou Moïse, comme les dix plaies d'Egypte et les eaux de la mer suspendues à droite et à gauche pour laisser passer trois millions de voleurs fugitifs à pied sec, lesquelles eaux retombèrent ensuite sur quelques autres millions d'hommes qui poursuivaient les voleurs. Ce ne sont pas là de ces petits faits obscurs et journaliers qu'un grave historien passe sous silence. Sanchoniathon ne dit mot de ces prodiges de Gargantua : donc il n'en savait rien ; donc il était antérieur à Moïse, ainsi que Job, qui n'en parle pas. Eusèbe, son abréviateur, qui entasse tant de fables, n'eût pas manqué de se prévaloir d'un si éclatant témoignage,
A.
Cette raison est sans réplique. Aucune nation n'a parlé anciennement des Juifs, ni parlé comme les Juifs ; aucune n'eut une cosmogonie qui eût le moindre rapport à celle des Juifs. Ces malheureux Juifs sont si nouveaux qu'ils n'avaient pas même, en leur langue, de nom pour signifier Dieu. Ils furent obligés d'emprunter le nom d'Adonaï des Sidoniens, le nom de Jehova ou Iao des Syriens, Leur opiniâtreté, leurs superstitions nouvelles, leur usure consacrée, sont les seules choses qui leur appartiennent en propre. Et il y a toute apparence que ces polissons, chez qui les noms de géométrie et d'astronomie furent toujours absolument inconnus, n'apprirent enfin à lire et à écrire que quand ils furent esclaves à Babylone. On a déjà prouvé [158] que c'est là qu'ils connurent les noms des anges, et même le nom d'Israël, comme ce transfuge juif Flavius Josèphe l'avoue lui-même.
C.
Quoi ! tous les anciens peuples ont eu une genèse antérieure à celle des Juifs, et toute différente?
A.
Cela est incontestable. Voyez le Shasta et le Veidam des Indiens, les cinq Kings des Chinois, le Zend des premiers Persans, [393] le Thaut ou Mercure trismégiste des Égyptiens ; Adam leur est aussi inconnu que le sont les ancêtres de tant de marquis et de barons dont l'Europe fourmille.
C.
Point d'Adam! cela est bien triste. Tous nos almanachs comptent depuis Adam.
A.
Ils compteront comme il leur plaira; les Étrennes mignonnes ne sont pas mes archives.
B.
Si bien donc que monsieur A est préadamite ?
A.
Je suis présaturnien, préosirite, prébramite, prépandorite.
C.
Et sur quoi fondez-vous votre belle hypothèse d'un monde éternel ?
A.
Pour vous le dire, il faut que vous écoutiez patiemment quelques petits préliminaires.
Je ne sais si nous avons raisonné jusqu'ici bien ou mal ; mais je sais que nous avons raisonné, et que nous sommes tous les trois des êtres intelligents [159] : or des êtres, intelligents ne peuvent avoir été formés par un être brut, aveugle, insensible ; il y a certainement quelque différence entre les idées de Newton et des crottes de mulet. L'intelligence de Newton venait donc d'une autre intelligence.
Quand nous voyons une belle machine, nous disons qu'il y a un bon machiniste, et que ce machiniste a un excellent entendement. Le monde est assurément une machine admirable : donc il y a dans le monde une admirable intelligence, quelque part qu'elle soit. Cet argument est vieux, et n'en est pas plus mauvais.
Tous les corps vivants sont composés de leviers, de poulies, qui agissent suivant les lois de la mécanique, de liqueurs que les lois de l'hydrostatique font perpétuellement circuler; et quand on songe que tous ces êtres ont du sentiment qui n'a aucun rapport à leur organisation, on est accablé de surprise.
Le mouvement des astres, celui de notre petite terre autour du soleil, tout s'opère en vertu des lois de la mathématique la [394] plus profonde. Comment Platon, qui ne connaissait pas une de ces lois; le chimérique Platon, qui disait que la terre était fondée sur un triangle équilatère, et l'eau sur un triangle rectangle; le ridicule Platon, qui dit qu'il ne peut y avoir que cinq mondes, parce qu'il n'y a que cinq corps réguliers ; comment, dis-je, l'ignorant Platon, qui ne savait pas seulement la trigonométrie sphérique, a-t-il eu cependant un génie assez heau, un instinct assez heureux pour appeler Dieu l'éternel géomètre, pour sentir qu'il existe une intelligence formatrice ?
B.
Je me suis amusé autrefois à lire Platon, Il est clair que nous lui devons toute la métaphysique du christianisme : tous les Pères grecs furent, sans contredit, platoniciens ; mais quel rapport tout cela peut-il avoir à l'éternité du monde, dont vous nous parlez?
A.
Allons pied à pied, s'il vous plaît. Il y a une intelligence qui anime le monde : Spinosa lui-même l'avoue. Il est impossible de se débattre contre cette vérité, qui nous environne et qui nous presse de tous côtés.
C.
J'ai cependant connu des mutins qui disent qu'il n'y a point d'intelligence formatrice, et que le mouvement seul a formé par lui-même tout ce que nous voyons et tout ce que nous sommes. Ils vous disent hardiment : La combinaison de cet univers était possible, puisqu'elle existe: donc il était possible que le mouvement seul l'arrangeât. Prenez quatre astres seulement. Mars, Vénus, Mercure, et la Terre ; ne songeons d'abord qu'à la place où ils sont, en faisant abstraction de tout le reste, et voyons combien nous avons de probabilités pour que le seul mouvement les mette à ces places respectives. Nous n'avons que vingt-quatre hasards dans cette combinaison, c'est-à-dire il n'y a que vingt-quatre contre un à parier que ces astres se trouveront où ils sont les uns par rapport aux autres. Ajoutons à ces quatre globes celui de Jupiter : il n'y aura que cent vingt contre un à parier que Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, et notre globe, seront placés où nous les voyons.
Ajoutez-y enfin Saturne : il n'y aura que sept cent vingt hasards contre un pour mettre ces six grosses planètes dans l'arrangement qu'elles gardent entre elles selon leurs distances données. Il est donc démontré qu'en sept cent vingt jets le seul [395] mouvement a pu mettre ces six planètes principales dans leur ordre.
Prenez ensuite tous les astres secondaires, toutes leurs combinaisons, tous leurs mouvements, tous les êtres qui végètent, qui vivent, qui sentent, qui pensent, qui agissent dans tous les globes, vous n'aurez qu'à augmenter le nombre des hasards ; multipliez ce nombre dans toute l'éternité, jusqu'au nombre que notre faiblesse appelle infini, il y aura toujours une unité en faveur de la formation du monde, tel qu'il est par le seul mouvement : donc il est possible que, dans toute l'éternité, le seul mouvement de la matière ait produit l'univers entier tel qu'il existe. Voilà le raisonnement de ces messieurs.
À.
Pardon, mon cher ami C; cette supposition me paraît prodigieusement ridicule pour deux raisons : la première, c'est que, dans cet univers, il y a des êtres intelligents, et que vous ne sauriez prouver qu'il soit possible que le seul mouvement produise l'entendement; la seconde, c'est que, de votre propre aveu, il y a l'infini contre un à parier qu'une cause intelligente formatrice anime l'univers. Quand on est tout seul vis-à-vis l'infini, on est bien pauvre [160].
Encore une fois, Spinosa lui-même admet cette intelligence. Pourquoi voulez-vous aller plus loin que lui, et plonger, par un sot orgueil, votre faible raison dans un abîme où Spinosa n'a pas osé descendre? Sentez-vous bien l'extrême folie de dire que c'est une cause aveugle qui fait que le carré d'une révolution d'une planète est toujours au carré des révolutions des autres planètes comme la racine du cube de sa distance est à la racine cube des distances des autres au centre commun? Mes amis, ou les astres sont de grands géomètres, ou l'éternel géomètre a arrangé les astres.
C.
Point d'injures, s'il vous plaît, Spinosa n'en disait point : il est plus aisé de dire des injures que des raisons. Je vous accorde une intelligence formatrice répandue dans ce monde; je veux bien dire avec Virgile (AEn., VI, 727) :
Mens agitât molem et magno se corpore miscet.
[396]
Je ne suis pas de ces gens qui disent que les astres, les hommes, les animaux, les végétaux, la pensée, sont l'effet d'un coup de dés.
A.
Pardon de m'être mis en colère, j'avais le spleen; mais, en me fâchant, je n'en avais pas moins raison.
B.
Allons au fait sans nous fâcher. Comment, en admettant un Dieu, pouvez-vous soutenir par hypothèse que le monde est éternel ?
A.
Comme je soutiens par voie de thèse que les rayons du soleil sont aussi anciens que cet astre.
C.
Voilà une plaisante imagination! Quoi! du fumier, des bacheliers en théologie, des puces, des singes, et nous, nous serions des émanations de la Divinité?
A.
Il y a certainement du divin dans une puce : elle saute cinquante fois sa hauteur; elle ne s'est pas donné cet avantage.
B.
Quoi ! les puces existent de toute éternité ?
A.
Il le faut bien, puisqu'elles existent aujourd'hui, et qu'elles étaient hier, et qu'il n'y a nulle raison pour qu'elles n'aient pas toujours existé. Car si elles sont inutiles, elles ne doivent jamais être; et dès qu'une espèce a l'existence, il est impossible de prouver qu'elle ne l'ait pas toujours eue. Voudriez-vous que l'éternel géomètre eût été engourdi une éternité entière? Ce ne serait pas la peine d'être géomètre et architecte pour passer une éternité sans combiner et sans bâtir. Son essence est de produire; puisqu'il a produit, il existe nécessairement : donc tout ce qui est en lui est essentiellement nécessaire. On ne peut dépouiller un être de son essence, car alors il cesserait d'être. Dieu est agissant : donc il a toujours agi; donc le monde est une émanation éternelle de lui-même; donc quiconque admet un Dieu doit admettre le monde éternel. Les rayons de lumière sont partis nécessairement de l'astre lumineux de toute éternité, et toutes les combinaisons sont parties de l'Être combinateur de toute éternité. [397] L'homme, le serpent, l'araignée, l'huître, le colimaçon, ont toujours existé, parce qu'ils étaient possibles.
Quoi ! vous croyez que le Démiourgos, la puissance formatrice, le grand Être, a fait tout ce qui était à faire ?
A.
Je l'imagine ainsi. Sans cela, il n'eût point été l'Être nécessairement formateur; vous en feriez un ouvrier impuissant ou paresseux qui n'aurait travaillé qu'à une très-petite partie de son ouvrage.
C.
Quoi! d'autres mondes seraient impossibles?
A.
Cela pourrait bien être : autrement il y aurait une cause éternelle, nécessaire, agissante par son essence, qui, pouvant les faire, ne les aurait point faits : or une telle cause qui n'a point d'effet me semble aussi absurde qu'un effet sans cause.
C.
Mais bien des gens pourtant disent que cette cause éternelle a choisi ce monde entre tous les mondes possibles,
A.
Ils ne paraissent point possibles s'ils n'existent pas. Ces messieurs-là auraient aussi bien fait de dire que Dieu a choisi entre les mondes impossibles. Certainement l'éternel artisan aurait arrangé ces possibles dans l'espace, il y a de la place de reste. Pourquoi, par exemple, l'intelligence universelle, éternelle, nécessaire, qui préside à ce monde, aurait-elle rejeté dans son idée une terre sans végétaux empoisonnés, sans vérole, sans scorbut, sans peste, et sans Inquisition ? Il est très-possible qu'une telle terre existe : elle devait paraître au grand Démiourgos meilleure que la nôtre; cependant nous avons la pire. Dire que cette bonne terre est possible, et qu'il ne nous l'a pas donnée, c'est dire assurément qu'il n'a eu ni raison, ni bonté, ni puissance; or c'est ce qu'on ne peut dire : donc s'il n'a pas donné cette bonne terre, c'est apparemment qu'il était impossible de la former.
B.
Et qui vous a dit que cette terre n'existe pas? Elle est probablement dans un des globes qui roulent autour de Sirius, ou du petit Chien, ou de l'œil du Taureau.
[398]
A.
En ce cas, nous sommes d'accord ; l'intelligence suprême a fait tout ce qu'il lui était possible de faire; et je persiste dans mon idée que tout ce qui n'est pas ne peut être.
C.
Ainsi l'espace serait rempli de globes qui s'élèvent tous en perfection les uns au-dessus des autres : et nous avons nécessairement un des plus méchants lots. Cette imagination est belle ; mais elle n'est pas consolante.
B.
Enfin vous pensez donc que de la puissance éternelle formatrice, de l'intelligence universelle, en un mot, du grand Être, est sorti nécessairement de toute éternité tout ce qui existe?
A.
Jl me parait qu'il en est ainsi.
B.
Mais en ce cas le grand Être n'a donc pas été libre?
A.
Être libre, je vous l'ai dit cent fois dans d'autres entretiens [161], c'est pouvoir. Il a pu, et il a fait. Je ne conçois pas d'autre liberté. Vous savez que la liberté d'indifférence est un mot vide de sens.
B.
En conscience êtes-vous bien sûr de votre système?
A.
Moi! je ne suis sûr de rien. Je crois qu'il y a un être intelligent, une puissance formatrice, un Dieu. Je tâtonne dans l'obscurité sur tout le reste. J'affirme une idée aujourd'hui, j'en doute demain; après-demain je la nie; et je puis me tromper tous les jours. Tous les philosophes de bonne foi que j'ai vus m'ont avoué, quand ils étaient un peu en pointe de vin, que le grand Être ne leur a pas donné une portion d'évidence plus forte que la mienne.
Pensez-vous qu'Épicure vît toujours bien clairement sa déclinaison des atomes, que Descartes fût persuadé de sa matière striée? Croyez-moi, Leibnitz riait de ses monades et de son [399] harmonie préétablie. Telliamed [162] riait de ses montagnes formées par la mer. L'auteur des molécules organiques est assez savant et assez galant homme pour en rire. Deux augures, comme vous savez [163], rient comme des fous quand ils se rencontrent. Il n'y a que le jésuite irlandais Needham qui ne rie point de ses anguilles.
B.
Il est vrai qu'en fait de systèmes il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille.
C.
Je suis très-aise d'avoir trouvé un vieux philosophe anglais qui rit après s'être fâché, et qui croit sérieusement en Dieu : cela est très-édifiant.
A.
Oui, têtebleue, je crois en Dieu, et j'y crois beaucoup plus que les universités d'Oxford et de Cambridge, et que tous les prêtres de mon pays : car tous ces gens-là sont assez serrés pour vouloir qu'on ne l'adore que depuis environ six mille ans, et moi, je veux qu'on l'ait adoré pendant l'éternité. Je ne connais point de maître sans domestiques, de roi sans sujets, de père sans enfants, ni de cause sans effet.
C.
D'accord, nous en sommes convenus; mais là, mettez la main sur la conscience, croyez-vous un Dieu rémunérateur et punisseur, qui distribue des prix et des peines à des créatures qui sont émanées de lui, et qui nécessairement sont dans ses mains comme l'argile sous les mains du potier?
Ne trouvez-vous pas Jupiter fort ridicule d'avoir jeté d'un coup de pied Vulcain du ciel en terre, parce que Vulcain était boiteux des deux jambes? Je ne sais rien de si injuste : or l'éternelle et suprême intelligence doit être juste; l'éternel amour doit chérir ses enfants, leur épargner les coups de pied, et ne les pas chasser de la maison pour les avoir fait naître lui-même nécessairement avec de vilaines jambes.
A.
Je sais tout ce qu'on a dit sur cette matière abstruse, et je ne m'en soucie guère. Je veux que mon procureur, mon tailleur, [400] mes valets, ma femme même, croient en Dieu ; et je m'imagine que j'en serai moins volé et moins cocu.
C.
Vous vous moquez du monde. J'ai connu vingt dévotes qui ont donné à leurs maris des héritiers étrangers.
A.
Et moi, j'en ai connu une que la crainte de Dieu a retenue, et cela me suffit. Quoi donc ! à votre avis, vos vingt dévergondées auraient-elles été plus fidèles en étant athées? En un mot, toutes les nations policées ont admis des dieux récompenseurs et punisseurs, et je suis citoyen du monde.
B.
C'est fort bien fait; mais ne vaudrait-il pas mieux que l'intelligence formatrice n'eût rien à punir? Et d'ailleurs, quand, comment punira-t-elle?
A.
Je n'en sais rien par moi-même ; mais, encore une fois, il ne faut point ébranler une opinion si utile au genre humain. Je vous abandonne tout le reste. Je vous abandonnerai même mon monde éternel si vous le voulez absolument, quoique je tienne bien fort à ce système. Que nous importe, après tout, que ce monde soit éternel, ou qu'il soit d'avant-hier? Vivons-y doucement, adorons Dieu, soyons justes et bienfaisants : voilà l'essentiel, voilà la conclusion de toute dispute. Que les barbares intolérants soient l'exécration du genre humain, et que chacun pense comme il voudra!
C.
Amen. Allons boire, nous réjouir, et bénir le grand Être.
FIN DE l'A, B, C.
Notes
[1] J'ai, de cet ouvrage, trois éditions ayant le même titre : « L'A, B, C, dialogue curieux traduit de l'anglais de M. Huet, à Londres, chez Robert Freeman, » mais sous trois millésimes différents ; 1762, in-8o de vii et 160 pages ; 1768, in-8o de iv et 135 pages ; 1769, in-8o de 120 pages.
L’édition portant la date de 1762 me paraît être l’originale; mais cette date est supposée. L’Homme aux quarante écus (voyez tome XXI, pages xiv et 304), qui est cité dans le seizième entretien, ne parut qu’en février 1768. L’A, B, C, ne vit le jour que plusieurs mois après. La première lettre où Voltaire en parle est celle à Christin, du 13 novembre 1768. C’est cet ouvrage qu’il désigne dans sa lettre à Mme du Deffant, du même mois de novembre, quand il lui dit : « Vous avez demandé cela, je vous envoie cela. Si votre ami avait lu cela. » Plusieurs lettres de Voltaire, du mois de décembre, à diverses personnes, contiennent aussi mention de l'A, B, C. C’est au 12 décembre 1768 qu’en parlent les Mémoires secrets. Les trois éditions de 1762, 1768, 1769, que j’ai désignées plus haut, ne contenaient que seize entretiens. Celui qui est aujourd’hui te treizième (Des Lois fondamentales) fut ajouté dans l’édition qui est à la suite de la Raison par alphabet, sixième édition, 1769, deux volumes in-8o. L’auteur y fit en même temps d’autres additions, et l’intitula l’A, B, C, dix-sept dialogues traduits de l'anglais de M. Huet. Le titre actuel est dans l’édition in-4o, tome XIII, daté de 1771. (B.)
[2] Ce que l'interlocuteur C dit de Tertullien, de Carnéade... se trouve dans les Prolégomènes du Droit de la Guerre et de la Paix. ( CL.)
[3]
Nec natura potest justo secernere iniquum.
Ce cruel vers se trouve dans la troisième satire. Horace veut prouver, contre les stoïciens, que tous les délits ne sont pas égaux. Il faut, dit-il, que la peine soit proportionnée à la faute.
... Adsit
Régula, peccatis quae pœnas irroget œquas.(I, sat. III, V. 117-118.)
C'est la raison, la loi naturelle qui enseigne cette justice; la nature connaît donc le juste et l'injuste. Il est bien évident que la nature enseigne à toutes les mères qu'il vaut mieux corriger son enfant que de le tuer; qu'il vaut mieux lui donner du pain que de lui crever un œil ; qu'il est plus juste de secourir son père que de le laisser dévorer par une bête féroce, et plus juste de remplir sa promesse que de la violer.
Il y a dans Horace, avant ce vers de mauvais exemple :
Nec natura potest justo secernere iniquum,
« la nature ne peut discerner le juste de l'injuste »; il y a, dis-je, un autre vers qui semble dire tout le contraire :
Jura inventa metu injusti fateare necesse est.
(Vers 111.)
« Il faut avouer que les lois n'ont été inventées que par la crainte de l'injustice. »
La nature avait donc discerné le juste et l'injuste avant qu'il y eût des lois. Pourquoi serait-il d'un autre avis que Cicéron et que tous les moralistes qui admettent la loi naturelle? Horace était un débauché qui recommande les filles de joie et les petits garçons, j'en conviens: qui se moque des pauvres vieilles, d'accord; qui flatte plus lâchement Octave qu'il n'attaque cruellement des citoyens obscurs, il est vrai ; qui change souvent d'opinion, j'en suis fâché; mais je soupçonne qu'il a dit ici tout le contraire de ce qu'on lui fait dire. Pour moi, je lis :
Et natura potest justo secernere iniquum ;
les autres mettront un nec à la place d'un et s'ils veulent. Je trouve le sens du mot et plus honnête comme plus grammatical : et natura potest, etc.
Si la nature ne discernait pas le juste et l'injuste, il n'y aurait point de différence morale dans nos actions : les stoïciens sembleraient avoir raison de soutenir que tous les délits contre la société sont égaux. Ce qui est fort étrange, c'est que saint Jacques semble tomber dans l'excès des stoïciens, en disant dans son Épître (ch. ii. v. 10): « Qui garde toute la loi, et la viole en un point, est coupable de l'avoir violée en tout. » Saint Augustin, dans une lettre à saint Jérôme, relance un peu l'apôtre saint Jacques, et ensuite l'excuse, en disant que le coupable d'une transgression est coupable de toutes parce qu'il a manqué à la charité, qui comprend tout. O Augustin ! comment un homme qui s'est enivré, qui a forniqué, a-t-il trahi la charité? ïu abuses perpétuellement des mots. O sophiste africain! Horace avait l'esprit plus juste et plus fin que toi. (Note de Voltaire.)
— N. B. Cet endroit d'Horace peut d'abord paraître obscur; cependant, en y faisant attention, on trouvera que le poète dit seulement : Consultez les annales du monde, vous verrez que la crainte de l'injustice a fait naître l'idée de nos droits. L'instinct ne nous apprend à discerner le juste de l'injuste que comme ce qui flatte nos sens de ce qui les blesse; la raison nous apprend donc que tous les crimes ne sont pas égaux, puisqu'ils ne font pas un tort égal à la société, et que c'est de l'idée de ce tort qu'est née l'idée de justice. Natura ne signifie qu'instinct, premier mouvement. (K.)
[4] L'ouvrage de Grotius est en latin, et intitulé De Jure belli et pacis ; la première édition est de 1624. Il a été traduit en français par Barbeyrac.
[5] Voyez tome XX, page 1, et. dans la Correspondance, la lettre à Linguet du 15 mars 1767.
[6] Liv. XXV, chap. xiii.
[7] Liv. XV, chap. v.
[8] Dans la préface de l'Esprit des lois, il y a : « On ne trouvera point ici ces traits saillants qui semblent caractériser les ouvrages d'aujourd'hui. »
[9] Voyez liv. VIII, ch. i, et xv ; et liv. XXV, ch. i.
[10] Liv. XXXII, ch. xxiv.
[11] Le dénombrement de 1751 ne donnait que vingt millions (voyez tome XX, p. 10); celui de 1827 en donne près de trente-deux, et celui de 1877, trente-sept.
[12] Liv. XXIV, ch. xxvi.
[13] L'édition de 1735 des Voyages de Chardin est divisée par chapitres, ainsi que celle qu'a donnée Langlès en 1811, dix volumes in-8° et atlas. Les premières éditions n'ont pas ces divisions. ]
[14] Liv. XVII, ch. VI.
[15] Liv. XXIV, ch. XXIV, xxv, xxvi.
[16] Liv. III, ch. V. (Note de Voltaire. )
[17] Voyez tome XXV, page 301.
[18] Liv. VII, ch. IX. (Note de Voltaire.)
[19] Voyez, dans les OEuvres morales de Plutarque, le dialogue De l'Amour. ]
[20] Passerai, en 1695, Richer, en 1734, Chabanon, en 1762, avaient traité ce sujet.
[21] Liv. III, ch. IX. (Note de Voltaire.)
[22] Voyez tome XII, pages 103 et suiv.
[23] Voyez tome XXIV, pages 142, 556.
[24] Liv. IV, ch. viii. (Note de Voltaire.)
[25] Liv. XXI, ch, xxii. (Id.)
[26] Ibid. ( Id.)
[27] Liv. VI, ch. V. (Note de Voltaire.)
[28] Voyez tome XV, page 469.
[29] Liv. II, ch. iv. (Note de Voltaire.)]
[30] Ibid. (Id.) ]
[31] De 1670.
[32] Liv. XV, ch. XIX. (Note de Voltaire.)
[33] Liv. XVI, ch. v. (Note de Voltaire.)
[34] Liv. XXI, ch. vi.
[35] Voyez tome XI, page 261; XIII, 234, 445; XXV, 559.
[36] Toutes les éditions portaient: « Je cherchais un fil dans ce labyrinthe; le fil est cassé presque à chaque article: j'ai trouvé, etc., » lorsqu'on 1818, d'après l'errata manuscrit de Decroix, l'un des éditeurs de Kehl, je donnai le texte actuel. (B.)
[37] Liv. III, ch. iii.
[38] Liv. III, ch. vi.
[39] Cette idée de Montesquieu a été regardée par les uns comme un principe lumineux, et par d'autres comme une subtilité démentie par les faits : qu'il nous soit permis d'entrer à cet égard dans quelques discussions.
1° Montesquieu, en disant que la vertu était le principe des républiques, et l'honneur celui des monarchies, n'a point voulu parler, sans doute, des motifs qui dirigent les hommes dans leurs actions particulières. Partout l'intérêt et un certain principe de bienveillance pour les autres, qui ne quitte jamais les hommes, sont le motif le plus fréquent ; la crainte de l'opinion, le second ; l'amour de la vertu est le dernier et le plus rare. Dans certains pays, la terreur ou les espérances religieuses tiennent lieu presque généralement de l'amour de la vertu.
Il est donc vraisemblable que, par principes des différents gouvernements, Montesquieu a entendu seulement les motifs qui y font agir les hommes dans leurs actions publiques, dans celles qui ont rapport aux devoirs des citoyens.
Or, sous ce point de vue, les républiques, étant l'espèce de gouvernement où les hommes peuvent tirer le plus d'avantage de l'opinion publique, paraissent devoir être les constitutions dont l'honneur soit plus particulièrement le principe.
2° L'expression de Montesquieu peut avoir encore un autre sens : elle peut signifier que, dans une monarchie, on évite les mauvaises actions comme déshonorantes, et dans une république comme vicieuses. Si par vicieuses on entend contraires à la justice naturelle, cette opinion n'est pas fondée : la morale des républicains est très-relâchée; en général, ils se permettent sans scrupule tout ce qui est utile à l'intérêt de la patrie, ou à ce que leur parti regarde comme l'intérêt de la patrie; tout ce qui peut leur mériter l'estime de leurs concitoyens ou de leur parti. Ils sont donc moins guidés par la véritable vertu que par l'honneur et la justice d'opinion.
3° Il y a enfin un troisième sens: Montesquieu a-t-il voulu dire que, dans les monarchies, on fait par amour de la gloire ce que, dans les républiques, on fait par esprit patriotique? Dans ce sens, nous ne pouvons être de son avis; l'amour de la gloire, la crainte de l'opinion est un ressort de tous les gouvernements. Il aurait fallu dire, dans ce sens, que l'honneur et la vertu sont le principe des républiques, et l'honneur seul celui des monarchies ; mais il y aurait eu encore une autre observation à faire. C'est qu'il existe dans toute constitution où le bien est possible un esprit public, un amour de la patrie différent du patriotisme républicain ; cet esprit public tient à l'intérêt que tout homme qui n'est point dépravé prend nécessairement au bonheur des hommes qui l'entourent, au penchant naturel que les hommes ont pour ce qui est juste et raisonnable. Une mauvaise constitution, un établissement mal dirigé, choquent l'esprit comme une table dont les pieds n'auraient pas la même forme choquerait les yeux. Il fallait donc se borner à dire que l'amour du bien public n'est pas le même dans les monarchies que dans les républiques; qu'il est, dans ces dernières, plus actif, plus habituel, plus répandu; mais que, dans les monarchies, il est souvent plus éclairé, plus pur, moins contraire à la morale universelle.
Une opinion susceptible de tant de sens différents, et qui, dans aucun, n'est rigoureusement exacte, ne peut guère être utile pour apprendre à juger des effets bons ou mauvais d'une loi. (K.)
[40] Liv. II, ch. I.
[41] Montesquieu n'a établi nulle part de distinction entre ce qu'il appelle monarchie et ce qu'il appelle despotisme: si, dans la monarchie, les corps intermédiaires ont le droit négatif, elle devient une aristocratie; s'ils ne l'ont pas, il n'y a d'autre différence entre les monarchies de l'Europe et les empires de l'Orient que celle des mœurs et des formes légales. Dans tous ces États, il y a des règles générales, des formalités reconnues dont jamais le souverain ne s'écarte. Le conseil du prince y est également supérieur à tous les tribunaux, dont il réforme à son gré les décisions. Le prince y décide également d'une manière arbitraire ce qu'on appelle affaire d'État. Mais, comme il y a plus de lumières en Europe, les tribunaux y sont mieux réglés, et les lois laissent moins de questions à décider à la volonté particulière des juges. Comme les mœurs y sont plus douces, les conseils des rois européans cherchent à montrer de la modération, et ceux des rois asiatiques à inspirer la terreur. Enfin une prison dont le terme n'est pas fixé est la plus forte peine que les monarques européans imposent de leur volonté seule, tandis que les despotes commandent souvent des exécutions sanglantes. Qu'on examine avec attention tous les gouvernements absolus, on n'y verra d'autres différences que celles qui naissent des lumières, des mœurs, des opinions des différents peuples. ( K.)
[42] Voyez la note 2, tome XXI, page 6.
[43] C'était le titre des membres du parlement.
[44] Le parlement se disait tuteur des rois.
[45] Voyez Emile, livre V. (Note de Voltaire.)
[46] Liv. V, ch. XIX. (id.)
[47] Au parlement de Bordeaux.
[48] Le mot de vérité est là employé assez mal à propos par Hobbes; il fallait aire justice. (Note de Voltaire.)
[49] Voyez l'article AME. tome XVII, pages 130-169.
[50] Voltaire, né en 1694, avait en 1768 soixante et quatorze ans.
[51] Actes des apôtres, xvii, 28.
[52] Voyez, plus loin, l'opuscule intitulé Tout en Dieu.
[53] Voltaire lui-même.
[54] Dans la 13e des Lettres philosophiques, voyez tome XXII, pages 121 et suiv.
[55] Voyez tome XIX, page 343; XXII, 82.
[56] Le cardinal de Retz, coadjuteur de Paris; voyez tome XIV. page 191. En 1790, l'abbé Maury (depuis cardinal), membre de l'Assemblée constituante, portait toujours deux pistolets qu'il appelait ses burettes. (B.)
[57] Voyez tome XXIV, page 476.
[58] La Saint-Barthélémy est de 1572; Voltaire écrivait en 1768.
[59] Voltaire lui-même ; voyez tome XXI, page 16.
[60] Voyez les Capitoli de monsignor La Casa, archevêque de Bénévent ; vous verrez comme il enfournait. (Note de Voltaire.) — Voltaire, tome XVIII, page 27, dit quel est le sujet du conte intitulé Capitolo del forno.
[61] En 1689.
[62] Voyez tome XI, page 137; XVIII, 337; XXVI, 548.
[63] Voyez tome XV, page 301; ou n'y compte que dix-sept officiers exécutés le 10 auguste 1746.
[64] Genèse, iv, 15. ]
[65] Ibid.. IV, 17.
[66] Cet ouvrage parut en 1764, 8 vol. in-4°.
[67] On retrouve cet entretien avec peu de différence dans le Dictionnaire philosophique, au mot Loi naturelle; voyez tome XIX, page 604.
[68] Rois, II, ch. XIII, V. 12, 13.
[69] Discours sur l'inégalité, par Rousseau (seconde partie) ; c'est un des exemples des contradictions de l'esprit humain, qu'on ait regardé l'auteur de ce passage scandaleux, et de tant d'autres, comme un prédicateur de la vertu, et M. de Voltaire comme un corrupteur de la morale. Il n'y a que les grands hommes auxquels on ne pardonne rien. (K.) ]
[70] Rousseau n'avait répondu à la dernière lettre que lui adressa Voltaire, le 21 septembre 1756, que par sa lettre du 17 juin 1760, et son billet insolemment laconique du 31 mai 1765. La lettre de 1760 contenait ces expressions: « Je ne vous aime point..., vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu... » Le philosophe de Ferney ne pouvait oublier en outre les déclamations de Jean-Jacques contre le théâtre et les auteurs dramatiques ; on venait enfin (5 février 1768) de mettre le feu à la salle de spectacle, à Genève; voilà ce qui motivait les reproches un peu durs dont Rousseau est l'objet dans ce passage. (CL.)
[71] Voyez, tome II du Théâtre, la fin de la dédicace d'Alzire.
[72] Cet alinéa et le suivant ont été reproduits presque textuellement dans l'article Curiosité des Questions sur l'Encyclopédie: voyez tome XVIII, page 308.
[73] Voltaire lui-même, dans Tancrède, acte III, scène iii.
[74] La Condamine ; voyez tome XVIII, page 308.
[75] Le 1er novembre 1755.
[76] Dans le dixième livre de l'Iliade, Ulysse et Diomède l'ont une expédition nocturne; Rhésus est une de leurs victimes, et non le compagnon d'Ulysse.
[77] Genèse, ch. xxxiv, v. 25 et suiv.
[78] Hérodote, livre 1er.
[79] Voyez tome XI, page 146.
[80] Van Swieten, médecin de la cour de Vienne, avait tué Charles-Joseph-Emmanuel; voyez la note, tome XXV, page 337.
[81] Voltaire lui-même; voyez tome XI, page 17.
[82] C'est-à-dire : « le prêtre mange le rosbif, et le peuple le regarde faire. »]
[83] Lycurgue; voyez, dans Plutarque, le Banquet des sept Sages.
[84] Voyez tome XIX, page 576.
[85] Henriade, chant Ier, vers 313-18.
[86] Raguse était alors une république aristocratique.
[87] Le porc.
[88] Voltaire cite souvent cette baleine ; mais l’Écriture ne dit pas le nom du grand poisson qui avala le petit prophète. Jonas, chap. II, v. 1; et Matthieu, chap. XII, V. 40. ( CL.)
[89] Voilà une grande vérité, très-peu connue, mais dite si simplement que les lecteurs frivoles ne l’ont pas remarquée; et on continue à répéter que M. de Voltaire était un philosophe superficiel, parce qu’il n’était ni déclamateur ni énigmatique. (K.)
[90] Frédéric II.
[91] Adolphe-Frédéric, beau-frère du roi de Prusse et père de Gustave III.
[92] Stanislas-Auguste Poniatowski.
[93] Catherine II.
[94] Les rives du Danube ont bien changé depuis l'impression de cet ouvrage. (K.) Les éditions de Kohl font allusion aux réformes de Joseph II.
[95]
C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière.
Épitre à Catherine II, 1771.)
[96] Georges 1er, roi d’Angleterre en 1714, était électeur de Hanovre.
[97] Nom du lieu où se tenait la foire Saint-Germain ; c’est sur cet emplacement qu’a été construit le marché Saint-Germain.
[98] Liv. XV, ch. V
[99] Nous ne pouvons être ici d'accord avec M. de Voltaire. 1° Les principes du droit naturel prononcent la nullité de toute convention dont il résulte une lésion qui prouve qu'elle est l'ouvrage de la démence de l'un des contractants, ou de la violence et de la fraude de l'autre. 2° Un engagement est nul, par la même raison, toutes les fois que les conditions de cet engagement n'ont point une étendue déterminée. 3° Quand il serait vrai qu'on pût se vendre soi-même, on ne pourrait point vendre sa postérité. Un homme ne pourrait avoir le droit d'en vendre un autre, à moins qu'il ne se fût vendu volontairement, et que cette permission fût une des clauses de la vente; l'esclavage ne serait donc alors légitime que dans des cas très-rares. D'ailleurs, un homme qui abuse de l'imbécillité d'un autre est précisément ce que monsieur A ne veut pas être. Il n'y a nulle parité entre l'état d'un esclave et celui d'un soldat. Les conditions de l'engagement d'un soldat sont déterminées ; son châtiment, s'il y manque, est réglé par une loi, et est infligé parle jugement d'un officier, qui est dans ce cas une espèce de magistrat, un homme chargé d'exercer une partie de la puissance publique. Cet officier n'est pas juge et partie comme le maître à l'égard de son esclave. Les soldats peuvent être réellement en certains pays dans une situation pareille à la servitude des nègres, et alors cet esclavage est une violation du droit naturel ; mais l'étal de soldat n'est pas en lui-même en état d'esclavage. (K.) — Voyez la note suivante des éditeurs de Kehl, qui eux-mêmes justifient Voltaire, après l'avoir presque accusé ici. (B.)
[100] De Jure belli et pacis.
[101] Esprit des lois, liv. XV, ch. vii.
[102] Cela suppose qu'on a droit de tuer un homme qui se rend; sans quoi, celui qui fait esclave un ennemi, au lieu de le tuer, est un peu plus coupable qu'un voleur de grand chemin qui ne tue point ceux qui donnent leur bourse de bonne grâce. Il vaut mieux faire un homme esclave que de le tuer, comme il vaut mieux voler qu'assassiner ; mais de ce qu'on a fait un moindre crime, il ne s'ensuit point qu'on ait sur le fruit de ce crime un véritable droit. Au reste, ces décisions de monsieur A ne sont pas la véritable opinion de M. de Voltaire. C'est un Anglais qu'il fait parler. Il a voulu peindre un caractère un peu dur, qui se soucie fort peu des hommes assez lâches et assez imbéciles pour rester dans l'esclavage, et qui trouve fort bon qu'on le fasse esclave s'il est assez faible pour préférer la vie à la liberté. (K.)
[103] Liv. XV, ch. VI. (Note de Voltaire.)
[104] Etat présent de la grande Russie, traduit de l'anglais de Perry. Paris, 1717, ln-12; voyez ce que dit Voltaire tome XVllI, page 604.
[105] Page 228. (Note de Voltaire.)]
[106] Voyez, dans les tomes suivants, les écrits de Voltaire sur les serfs du mont Jura.
[107] Rêves d’un homme de bien, disait le cardinal Dubois. (B.)
[108] Voyez tome XXIII, pages 542, 568 et 575.
[109] C’est ici une autre question. Puis-je, l’esclavage étant établi dans une société, acheter un esclave, qui sans cela deviendrait l’esclave d’un autre, que je traiterai avec humanité, à qui je rendrai la liberté lorsqu’il m’aura valu ce qu’il m’aura coûté, si alors il est encore en état de vivre de son travail, et à qui je ferai une pension s'il a vieilli à mon service? Je vois un esclave sur le marché, je lui dis: Mon ami, mes compatriotes sont des coquins qui violent le droit naturel sans pudeur et sans remords. On va te vendre 1,500 livres; je les ai; mais je ne puis faire ce sacrifice pour empêcher ces gens-là de commettre un crime de plus. Si tu veux, je t'achèterai, tu travailleras pour moi, et je te nourrirai; si tu travailles mal, tu es un vaurien, je te chasserai, et tu retomberas entre les mains dont tu sors; si je suis un brutal ou un tyran, si je te donne des coups de nerf de bœuf, si je te prends ta femme ou ta fille, tu ne me dois plus rien, tu deviens libre ; fie-toi à ma parole, je ne fais point le mal de sang-froid. Veux-tu me suivre ? Mais cachons ce traité: on ne souffre ici, entre ton espèce et la mienne, que les conventions qui sont des crimes; celles qui seraient justes sont défendues. Ce discours serait celui d'un homme raisonnable, mais celui qu'il aurait acheté ne serait pas son esclave. (K.)
[110] École des femmes, acte III, scène ii, septième maxime.
[111] Voyez tome XI, page 354.]
[112] Voyez tome XXIII, page 85 ; et page 85 du présent volume.
[113] Voyez la note, tome XXI, page 588.
[114] Voyez, ci-après, la Collection d’anciens évangiles.
[115] Voyez tome XVII, page 300.
[116] Matth., XVI, 18.
[117] Voyez, tome XXI. la note de la page 570.
[118] Voltaire n'a pas osé ici s'élever contre l'usage de confier au clergé les registres de l'état civil. Mais, deux ans plus tard, il dit nettement que le sacrement et le contrat sont deux choses bien différentes. (B.) — Voyez tome XX, page 20.
[119] Voltaire lui-même; voyez tome XI, page 387.
[120] Est-il besoin de dire que ce sont des animaux fabuleux?
[121] Espèce d'inquisition d'État établie eu Angleterre sous Henri VIII, et détruite en 1641, sous Charles Ier. (K.)
[122] Les États-Unis de l'Amérique ont été plus loin: il n'y a chez eux aucune religion nationale ; mais quelques-uns de ces États ont fait une faute en excluant les prêtres des fonctions publiques ; c'est leur dire de se réunir et de former imperium in imperio. Dans un pays bien gouverné, un prêtre ne doit avoir ni plus de privilèges ni moins de droits qu'un géomètre ou un métaphysicien. Les droits de citoyen n'ont rien de commun avec l'emploi qu'un homme fait de l'esprit que la nature lui a donné. (K.) ]
[123] Par Louis Racine.
[124] La bulle Unigenitus.
[125] Lettres à S. A. monseigneur le prince de*** ; voyez tome XXVI, page 488.
[126] Dans les Questions sur l’Encyclopédie, ce dialogue était donné sous ce mot : Droit (du) de la guerre, Dialogue entre un Anglais et un Allemand, et commençait au second alinéa, qui était dans la bouche de l’Allemand : « Qu’entendez-vous par le droit de la guerre ? »
[127] Voyez le troisième entretien, page 331.
[128] Par Saurin; le vers cité par Voltaire est à la scène iv de l'acte III. 27.
[129] Voyez tome XIV, pages 337 et suiv.
[130] Voyez page 22.
[131] Exode, XI, 2.
[132] Juges, III,210 et suiv.
[133] Judith, VIII. ]
[134] I. Rois, XXII, 2.
[135] 5. I. Rois, XXVII, 9-10.
[136] II. Rois, xi, 15.
[137] III. Rois, ii, 24-25.]
[138] Voltaire l'a déjà dit tome XIV, page 61 ; XXIV, 543, et XXVII, 255.
[139] Par le P. Maimbourg, 1678, in-4o, ou trois vol. in-12.
[140] Voltaire avait dit dans son Mahomet, acte II, scène v:
C'est le faible qui trompe...
[141] L’ouvrage de L. Dorléans, dont Voltaire a déjà parlé dans l’Essai sur les Mœurs (voyez tome XII, page 545), est intitulé Réponse des vrais catholiques français à l’Avertissement des catholiques anglais pour l'exclusion du roi de Navarre de la couronne de France, 1588, in-8o. Voici son texte :
« Nous conclurons bientôt que nul, soit hérétique, juif, ou d’autre secte de religion, brief qui ne soit catholique, ne doit ni ne peut justement, non plus que le plus grand faquin et roturier du monde, être roi de France... » (Page 224.)
« Si être lépreux (comme le roi Osias qui en fut déposé), si être hors de son sens humain, voire pour l’indisposition du corps, est une exclusion à toutes charges publiques et mesmes à la royauté, que sera-ce d’être forcené, hors de soi et contre le sens commun de Dieu et des fidèles, à l’occasion de l’indisposition causée par l’hérésie, qui est une furie beaucoup plus à fuir et dommageable, au jugement de saint Augustin et des saints Pères, experts en cela ; puisqu’au premier il n’y a à considérer ou craindre que l’inhabileté et incapacité à s’acquitter de sa charge; et au second non-seulement cela, mais une contrariété et opposition à ce qui est le principal devoir d’icelle? Car je ne pense pas qu’il y ait chrétien quelconque qui nie que la principale fin et charge d’un roi chrétien, et même de celui de France, ne soit de servir Dieu et Jésus-Christ, et avoir soin de conserver sa religion et de tenir la main à l'exécution de ses lois. Qui pense autrement présuppose une autre fin que Dieu et Jésus-Christ, et partant est un vrai juif et athée... sans autre expression, il s'entend assez entre les chrétiens, et par le commun sentiment des Français et des catholiques que le roi de France doit être chrétien et catholique... » (Pages 229 et 230.)
« Si par la loi de France et de la chrétienté, un Turc, un Juif, ou infidèle, ne peut être roi, encore qu'il soit le plus proche du sang, il résulte que la loi du royaume pour la religion est plus considérable en la succession des rois que la nature. Et si de toutes les prétendues religions autre n'est proprement et véritablement religion que la seule chrétienne et catholique (cela ne se peut nier des chrétiens), il s'ensuit de toute nécessité qu'on doit avoir égard seulement à la religion catholique et que pour être roi de France, il est plus nécessaire d'être chrétien et catholique que d'être homme et le plus proche de sang mâle. Qui dispute après cela mérite plutôt qu'un bourreau lui réponde qu'un philosophe, comme disait Aristote de ceux qui nient les maximes de la nature. » ( Pages 271 et 272.)
Voltaire citait trop souvent de mémoire, mais il n'altérait pas les textes ; comme on peut le voir par ce passage de L. Dorléans, et comme on l'a vu par les citations que nous avons faites du Traité sur le Suicide de l'abbé de Saint-Cyran (voyez tome XXV, page 568). (B.)
[142] Page 361.
[143] Etienne II ou III; voyez tome XI, pages 217 et suiv.
[144] Ferdinand IV, descendant de saint Louis par Philippe V et par Louis XIV.
[145] De Clément XIII, mort peu de temps après que Voltaire écrivait ainsi. (CL.)
[146] Siècle de Louis XIV, ch. ii; voyez tome XIV, page 165.
[147] Je ne sais si le marquis de Tanucci, premier ministre de Ferdinand IV, lut ce quatorzième entretien: ce qui est certain, c'est qu'il abolit, et pour toujours, en 1709, l'usage dans lequel étaient les rois de Naples de présenter annuellement une haquenée blanche au pape. (CL.)
[148] Voyez tome XI, pages 355 et suiv.
[149] Psaume XXXVI, 36.
[150] Allusion au supplice de La Barre; voyez la Relation, etc., tome XXV, page 501.
[151] Voltaire ne cesse de s'élever contre la vénalité des charges.
[152] Ce conseil était donné par Voltaire en 1768. Les Anglais, plusieurs années après, ont pu juger combien son avis était sage. (K.)
[153] Il y avait à Heidelberg une tonne qui contenait huit cents muids. (B.) — Cent muids. (G. A.)
[154] L’Homme aux quarante écus ; voyez tome XXI, page 314.
[155] Voyez onzième entretien, page 368.]
[156] Boileau, satire viii. vers 296.
[157] Juges, ch. I, V. 11. (Note de Voltaire.)
[158] Voyez tome XI, pages 138, 184.
[159] Une partie de ce qui suit a été reproduit dans les Questions sur l'Encyclopédie; voyez tome XVII, page 464. ]
[160] Nous sommes encore trop peu au fait des choses de ce monde pour appliquer le calcul des probabilités à cette question, et l'application de ce calcul aurait des difficultés que ceux qui ont voulu la tenter n'ont pas soupçonnées. (K.)
[161] Voyez tome XIX, page 197; XXV, 467 ; XXVI, 56, 93.
[162] De Maillet; voyez la note, tome XXI, page 331.
[163] Voyez la note, tome XX, page 515.