LEMERCIER DE LA RIVIÈRE,
L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques (1767)
Two Volumes in One
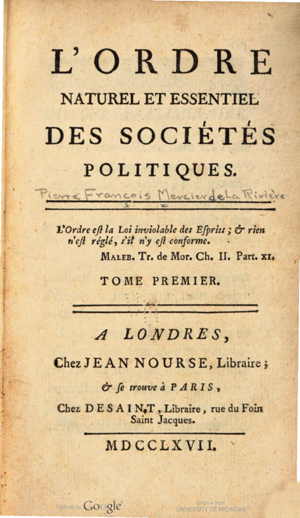 |
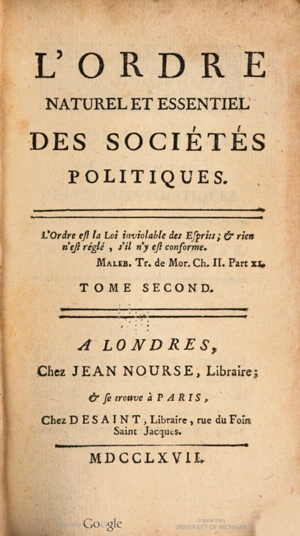 |
[Created: 30 November, 2024]
[Updated: 30 November, 2024] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 2 vols. (A Londres chez Jean Nourse, Librairie; & se trouve à Paris, chez Desaint, Libraire, 1767).http://davidmhart.com/liberty/Books/1767-Riviere_OrdreNature/Riviere_OrdreNaturel1767-vol1-2volsin1-ebook.html
Pierre-Paul Lemercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 2 vols. (A Londres chez Jean Nourse, Librairie; & se trouve à Paris, chez Desaint, Libraire, 1767).
Editor's Note: We have attempted to recreate the look of the original edition as best we could. We have used a one volume edition with modernised spelling and pagination (in italics) of that edition, to which we have added some of the original page numbers for the start of each chapter (in bold). The table of contents of the original edition was very long. We have made an abbreviated version for this online edition. The long version can be consulted in the facsimile PDF of the 1767 edition.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- reformatted margin notes to float within the paragraph
- inserted Greek and Hebrew words as images
Tables des Chapitres (bref)
Volume I contains Parts 1 and 2
Volume II contains Part 3.
Volume I
- DISCOURS PRELIMINAIRE, p. I-vii
- PREMIÈRE PARTIE. THÉORIE DE L’ORDRE
- CHAPITRE I. [I-3]
- La manière dont l’homme est organisé prouve qu’il est destiné par la nature à vivre en société. — Nécessité physique de la réunion des hommes en société. — Elle est nécessaire à la reproduction des subsistances, et par conséquent à la multiplication des hommes, qui est dans les vues du Créateur.
- CHAPITRE II. [I-16 / 16]
- Première source du juste et de l’injuste absolus ; en quoi ils consistent ; leurs rapports avec la nécessité physique de la société ; droits et devoirs dont la nécessité et la justice sont absolues. — Origine de la propriété personnelle et de la propriété mobilière ; ce qu’elles sont ; leurs rapports avec l’inégalité des conditions parmi les hommes. — Axiome qui renferme tout le juste absolu.
- CHAPITRE III. [I-27 / 21]
- Formation des sociétés particulières ; comme elles sont d’une nécessité physique. — Institution et nécessité physique de la propriété foncière, des lois conséquentes à cette propriété, et d’une autorité tutélaire pour en assurer l’observation. — Premières notions du juste absolu considéré dans les sociétés particulières. — Comment la somme des droits et celle des devoirs se servent mutuellement de mesure dans ces sociétés. — Fondement naturel et unique de la véritable grandeur des rois.
- CHAPITRE IV. [I-39 / 26]
- Premiers principes de l’ordre essentiel des sociétés particulières. — Définition de cet ordre essentiel. — Il est tout entier renfermé dans les trois branches du droit de propriété. — Sans cet ordre les sociétés particulières ne pourraient répondre aux vues de l’auteur de la nature, et remplir l’objet de leur institution. — Cet objet est de procurer au genre humain le plus grand bonheur et la plus grande multiplication possibles.
- CHAPITRE V. [I-50 / 30]
- De la liberté sociale ; en quoi elle consiste ; elle n’est qu’une branche du droit de propriété. — Simplicité de l’ordre social par rapport à la liberté. — Ses rapports nécessaires avec l’ordre physique de notre constitution et de la reproduction. — Nécessité dont elle est à l’intérêt général d’une société.
- CHAPITRE VI. [I-59 / 34]
- Essence, origine et caractères de l’ordre social ; il est une branche de l’ordre naturel qui est physique ; il est exclusif de l’arbitraire. — L’ordre naturel et essentiel de la société est simple, évident et immuable ; il constitue le meilleur état possible de la société et celui de chacun de ses membres en particulier, mais singulièrement du souverain et de la souveraineté ; il renferme ainsi en lui-même les moyens de sa conservation.
- CHAPITRE VII. [I-72 / 39]
- Suite du chapitre précédent : exposition sommaire de la théorie de l’ordre. — Simplicité et évidence non seulement de ses principes, mais encore de leurs conséquences. — La connaissance des premiers principes de l’ordre nous suffit pour que toute pratique qui contredit une seule de ses conséquences y soit pour nous un désordre évident.
- CHAPITRE VIII. [I-82 / 43]
- Des moyens nécessaires pour établir l’ordre et le perpétuer ; ils sont tous renfermés dans une connaissance suffisante de l’ordre. — L’évidence est le premier caractère de cette connaissance, et sa publicité est le second. — Nécessité de l’instruction publique, des livres doctrinaux dans ce genre, et de la plus grande liberté possible dans l’examen et la contradiction.
- CHAPITRE IX. [I-95 / 48]
- Suite du chapitre précédent. — De l’évidence ; définition de l’évidence ; ses caractères essentiels et ses effets. — Évidence des arguments qui prouvent la nécessité de la plus grande liberté possible dans l’examen et la discussion de l’évidence. — Force de l’opinion : ses dangers dans un état d’ignorance.
- CHAPITRE I. [I-3]
- SECONDE PARTIE. LA THÉORIE DE L’ORDRE MISE EN PRATIQUE.
- CHAPITRE X. [I-111]
- De la forme essentielle de la société. — Ses rapports avec la théorie de l’ordre essentiel. — Elle consiste en trois classes d’institutions sociales. — Objets que renferme chacune de ces trois classes. — Nécessité de développer les rapports des deux premières, dont l’une est l’institution des lois, et la seconde, l’institution d’une autorité tutélaire.
- CHAPITRE XI. [I-117 / 56]
- Développement de la première classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — Les lois s’établissent en même temps que la société. — Il en est de deux sortes : les unes sont naturelles, essentielles et universellement adoptées ; les autres conséquentes aux premières, sont positives, et particulières à chaque société ; définition des lois positives. — Le motif ou la raison des lois est avant les lois. — La raison des lois naturelles et essentielles est dans la nécessité absolue dont elles sont évidemment. — Ces lois naturelles doivent être la raison des lois positives. — Deux conditions nécessaires pour assurer la soumission confiante aux lois positives. — Nécessité de leur conformité parfaite avec les lois naturelles et essentielles. — Effets funestes d’une contradiction qui se trouverait entre ces deux sortes de lois.
- CHAPITRE XII. [I-133 / 62]
- Suite du développement de la première classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — Caractère de la certitude que les hommes doivent avoir de la justice et de la nécessité des lois ; comment en général la certitude s’établit. — Impossibilité sociale que le pouvoir législatif et la magistrature soient réunis dans la même main. — Nécessité des magistrats.
- CHAPITRE XIII. [I-146 / 67]
- Seconde suite du chapitre XI. — Comment s’établit parmi les peuples la certitude de la justice et de la nécessité des lois positives. — Les magistrats sont un des premiers et des plus puissants fondements de cette certitude ; par état ils doivent avoir une connaissance évidente de la raison essentielle des lois positives ; rapports de leurs devoirs essentiels avec la justice et la nécessité des lois. — Ils sont, plus particulièrement que les autres membres de la société, gardiens et défenseurs des lois. — La magistrature est, par le moyen des lois, le lien commun de la société.
- CHAPITRE XIV. [I-166 / 75]
- Développement de la seconde classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — L’autorité tutélaire consiste dans l’administration de la force publique dont le premier principe doit être la force intuitive et déterminante de l’évidence. — Premières observations tendant à prouver que le pouvoir législatif est inséparable de cette autorité.
- CHAPITRE XV. [I-174 / 78]
- Suite du chapitre précédent. — Dieu est le premier auteur des lois positives. — Définition du pouvoir législatif parmi les hommes : le législateur ne fait qu’appliquer les lois naturelles et essentielles aux différents cas qu’il est possible de prévoir, et leur imprimer, par des signes sensibles pour tous les autres hommes, un caractère d’autorité qui assure l’observation constante de ces lois. — Rapports de l’autorité législative avec celle de l’évidence. — Le pouvoir législatif est indivisible. — Combien les devoirs essentiels des magistrats lui sont précieux à tous égards : au moyen de ces devoirs et de l’évidence de l’ordre, ce pouvoir est absolument sans inconvénients dans les mains de la puissance exécutrice.
- CHAPITRE XVI. [I-198 / 87]
- Le pouvoir législatif ne peut être exercé que par un seul. — Examen particulier du système qui défère le pouvoir législatif à la nation en corps : contradictions évidentes que ce système renferme.
- CHAPITRE XVII. [I-213 / 93]
- Continuation du développement de la seconde classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — L’autorité tutélaire est nécessairement une, et par conséquent indivisible, soit qu’on la considère dans la manière dont elle s’établit, dans le premier principe dont elle émane, ou dans l’action qui lui est propre.
- CHAPITRE XVIII. [I-218 / 95]
- Suite du chapitre précédent. — La puissance exécutrice ne peut être exercée par plusieurs administrateurs. — Inconvénients généraux de cette pluralité vue en elle-même ; autres inconvénients particuliers qui naissent de la manière de composer le corps d’administrateurs.
- CHAPITRE XIX. [I-238 / 103]
- Seconde suite du chapitre XVII. — Conséquence résultante nécessairement des démonstrations précédentes. — L’autorité tutélaire ne peut être exercée que par un seul. — Définition du meilleur gouvernement possible vu dans l’intérêt commun de l’État gouvernant et de l’État gouverné. — Exposition des rapports nécessaires entre les intérêts d’un chef unique et ceux de la nation : il est co-propriétaire du produit net des terres de sa domination. — La souveraineté doit être héréditaire. — Cette condition est essentielle pour que le gouvernement d’un seul devienne nécessairement le meilleur gouvernement possible.
- CHAPITRE XX. [I-253 / 109]
- Troisième suite du chapitre XVII. — Premiers arguments pour prouver que dans une nation parvenue à la connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel de la société, le gouvernement d’un seul n’est susceptible d’aucun inconvénient. — Définition de l’autorité tutélaire. — Sans cette connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel, impossible d’établir un bon gouvernement.
- CHAPITRE XXI. [I-265 / 114]
- Quatrième suite du chapitre XVII. — Réfutation du système chimérique des contre-forces établies pour balancer l’autorité tutélaire dans le gouvernement d’un seul. — Partout où règne l’évidence de l’ordre, les établissements de ces contre-forces sont impossibles ; dans l’état d’ignorance ils le sont encore, mais par d’autres raisons.
- CHAPITRE XXII. [I-278 / 119]
- Continuation du même sujet. — Du despotisme. — Pourquoi il nous est odieux ; l’ignorance est la cause primitive des désordres qu’il a produits. — L’homme est destiné par la nature même à vivre sous une autorité despotique. — Il est deux sortes de despotismes ; l’un est personnel et légal ; l’autre est personnel et arbitraire : le premier est le seul conforme à l’ordre essentiel des sociétés ; le second est aussi funeste au despote même qu’aux peuples qu’il opprime.
- CHAPITRE XXIII. [I-285 / 122]
- Suite du chapitre précédent. — Le despotisme arbitraire considéré dans ses rapports avec l’autorité ; avec la sûreté personnelle et les intérêts du despote. — Combien ce despotisme lui est nécessairement désavantageux. — Sous le despotisme arbitraire il n’est point de véritable société, point de nation proprement dite.
- CHAPITRE XXIV. [I-301 / 128]
- Du despotisme légal. — Il devient nécessairement personnel, mais sans aucun inconvénient pour les peuples. — Combien il est avantageux aux souverains. — Parallèle de ses effets et de ceux du despotisme arbitraire. — Grandeur et puissance des souverains dans le despotisme légal. — Il procure et assure le meilleur état possible au souverain et à la souveraineté, ainsi qu’à la nation.
- Tables des Chapitrres et des Matières contenus dans le premier Volume, pp. II-319-353.
- CHAPITRE X. [I-111]
Volume II
TROISIÈME PARTIE. SUITE DU DÉVELOPPEMENT DE LA SECONDE PARTIE.
- CHAPITRE XXV. [II-6]
- Le despotisme légal est le même dans toutes les branches du gouvernement. — Division des différentes parties de l’administration en trois classes. — Examen de la première classe, composée des rapports des sujets entre eux. — Du recours au souverain contre les abus de l’autorité confiée aux magistrats. — Ce recours n’est pas susceptible d’arbitraire. — Le despotisme légal en cette partie est avantageux au souverain autant qu’à la nation.
- CHAPITRE XXVI. [II-20 / 142]
- Des rapports qui se trouvent entre la nation et le souverain : réciprocité du besoin qu’ils ont l’un de l’autre ; rapport et conformité de leurs intérêts. — Notions générales dont le développement démontrera que cette branche de gouvernement n’est point susceptible d’arbitraire.
- CHAPITRE XXVII. [II-25 / 144]
- Formation du revenu public ; ses causes, son origine, son essence. — Deux sortes d’intérêts communs au souverain et à la nation, qui paraissent opposés entre eux ; comment ils se concilient dans l’ordre essentiel des sociétés ; comment ils contrastent dans un état d’ignorance. — Impossible que le revenu public soit arbitraire ; il ne doit être que le résultat de la co-propriété des produits nets acquise incommutablement au souverain. — Entre cette co-propriété et les propriétés particulières il y a des bornes communes et immuables. — Intérêts personnels du souverain inséparables de ceux de la nation.
- CHAPITRE XXVIII. [II-52 / 155]
- Suite du chapitre précédent. — Ce qui est à faire avant que la copropriété du souverain puisse partager dans les produits des terres. — Ce que c’est qu’un produit brut ; ce que c’est qu’un produit net. — Ce dernier est le seul qui soit à partager entre le souverain et les propriétaires fonciers. — Reprises privilégiées du cultivateur sur le produit brut. — Dans une société conforme à l’ordre, ces reprises sont toujours et naturellement fixées à leur taux le plus bas possible par la seule autorité de la concurrence : dans cet état, le produit net est toujours aussi la plus grande richesse possible pour le souverain et pour les propriétaires fonciers, en raison de leur territoire.
- CHAPITRE XXIX. [II-68 / 161]
- Seconde suite du chapitre XXVII. — Comment le produit net doit se partager entre le souverain et les propriétaires fonciers. — L’état du propriétaire foncier doit être le meilleur état possible. — Sans cela les produits doivent s’anéantir. — Une partie du produit net n’est point disponible ; elle est affectée nécessairement aux charges de la propriété foncière. — Le despotisme personnel et légal est le seul qui puisse empêcher l’impôt de devenir préjudiciable aux produits. — Lois physiques concernant l’emploi du produit net : d’après ces lois le partage est toujours fait naturellement entre le souverain et les propriétaires fonciers ; et la portion du souverain est toujours la plus grande portion physiquement possible. — L’impôt est assujetti par la nature même, à une forme essentielle.
- CHAPITRE XXX. [II-91 / 170]
- De la forme essentielle de l’impôt. — Dans quel cas il est direct, et dans quel cas il est indirect. — Il est deux sortes d’impôts indirects, celui sur les personnes, et celui sur les choses commerçables : tous deux sont nécessairement arbitraires. — Pourquoi on leur donne le nom d’impôt indirect.
- CHAPITRE XXXI. [II-102 / 174]
- De la forme directe de l’impôt. — Combien elle est avantageuse au souverain. — Combien une forme indirecte lui serait préjudiciable. — Une forme indirecte occasionne nécessairement des doubles emplois dans l’établissement de l’impôt. — Inconvénients de l’arbitraire, qui forme le premier caractère de ces doubles emplois.
- CHAPITRE XXXII. [II-137]
- Effets et contre-coups des impôts établis sur les cultivateurs personnellement. — Quand ils sont anticipés ils coûtent à la nation quatre et cinq fois plus qu’ils ne rendent au souverain. — Progression de leurs désordres. — Effets et contre-coups des impôts établis sur les hommes entretenus par la culture. — Ils occasionnent nécessairement, comme les premiers, une dégradation progressive des revenus du souverain, de ceux de la nation, et par conséquent de la population.
- CHAPITRE XXXIII. [II-168 / 200]
- Les doubles emplois formés par les impôts indirects retombent tous sur les propriétaires fonciers. — Cette vérité démontrée par l’analyse des contre-coups d’un impôt sur les rentes et sur les loyers des maisons. — Le souverain paie lui-même une grande partie d’un tel impôt.
- CHAPITRE XXXIV. [II-183 / 206]
- Doubles emplois résultants des impôts sur les salaires de l’industrie, ou sur la vente des choses commerçables ; ils retombent tous à la charge du propriétaire foncier et du souverain, en raison de la portion que chacun d’eux prend dans le produit net des cultures. — Ces impôts sont dans tous les cas possibles, progressivement et nécessairement destructifs des revenus de la nation, de ceux du souverain, et de la population.
- CHAPITRE XXXV. [II-220 / 220]
- Des rapports entre une nation et les autres nations. — Il existe, sous une forme différente de celle des premiers temps, une société naturelle, générale et tacite parmi les nations ; devoirs et droits essentiels qui en résultent, et qui sont réciproques entre elles. — L’ordre naturel qui régit cette société générale, est ce qui assure à chaque nation son meilleur état possible. — Cet ordre, qui n’a rien d’arbitraire, doit être la base fondamentale de la politique. — Il est de l’intérêt d’un souverain et d’une nation de s’y conformer, quand même il ne serait point adopté par les autres nations. — Balance de l’Europe ; observations sur ce système.
- CHAPITRE XXXVI. [II-249 / 231]
- Du commerce. — Premières notions qui conduisent à reconnaître la nécessité de sa liberté. — Tout acheteur est vendeur, et tout vendeur doit être acheteur. — Les sommes de ces deux opérations doivent être égales entre elles. — Les ventes, même en argent, ne sont que des échanges de valeurs égales. — Erreurs et préjugés contraires à ces premières notions.
- CHAPITRE XXXVII. [II-267 / 238]
- Définition du commerce vu dans tous ses rapports essentiels. — De la manière dont il peut enrichir une nation : fausses idées des hommes à cet égard. — Son utilité est dans les rapports qu’il a avec les intérêts de la culture. — Le commerce extérieur n’est qu’un pisaller et un mal nécessaire.
- CHAPITRE XXXVIII. [II-279 / 243]
- De l’intérêt du commerce. — Ce qu’on doit entendre par cette façon de parler : il n’est point chez un peuple de commerçants le même que chez une nation agricole. — Véritable idée du commerçant. — Ce sont les consommateurs et non les commerçants, qui font le commerce. — Opposition entre les intérêts particuliers des commerçants et l’intérêt commun des autres hommes.
- CHAPITRE XXXIX. [II-302 / 252]
- Suite du chapitre précédent. — Par qui sont payés immédiatement les profits ou les salaires des commerçants ? — Erreurs relatives à cette question. — Comment l’intérêt particulier des commerçants se concilie, par le moyen de la liberté, avec l’intérêt des autres hommes. — La profession des commerçants est cosmopolite : rapports de cette vérité avec la nécessité d’une grande liberté de commerce. — Différences essentielles et plus détaillées entre un peuple de commerçants et les nations agricoles et productives. — Quel est chez elles le véritable intérêt du commerce : besoin qu’il a de la liberté.
- CHAPITRE XL. [II-326 / 261]
- Du meilleur état possible d’une nation ; en quoi il consiste ; besoin qu’il a de la plus grande liberté possible dans le commerce. — Fausses idées sur l’argent et sur la richesse d’une nation : sa véritable richesse n’est qu’une richesse en productions. — Une richesse en argent n’est que l’effet de la première, et ne s’entretient que par la première. — Différences essentielles entre ces deux sortes de richesses.
- CHAPITRE XLI. [II-343 / 268]
- Suite du chapitre précédent. — Erreurs contraires aux vérités qui y sont démontrées. — Balance du commerce. — Fausseté des systèmes établis à cet égard : leurs contradictions, et les préjudices qu’ils causent à une nation et à son souverain. — Fausses spéculations sur l’accroissement annuel de l’argent en Europe ; comme cet accroissement doit nécessairement se partager entre les nations commerçantes. — Nécessité de la libre circulation de l’argent. — Comment sa masse peut grossir dans une nation et en indiquer la richesse.
- CHAPITRE XLII. [II-371 / 279]
- Suite du chapitre précédent. — Fausse idée des produits de l’industrie. — Erreurs résultantes de l’illusion que font ces produits apparents. — Quand et comment l’industrie manufacturière peut être utile au commerce des productions. — Elle n’en augmente jamais les valeurs au profit de la nation. — Nécessité d’une grande liberté à tous égards pour rendre cette industrie utile à la nation. — Contradictions et inconvénients des systèmes opposés à cette liberté.
- CHAPITRE XLIII. [II-402 / 291]
- L’industrie n’est aucunement productive : démonstration particulière de cette vérité.
- CHAPITRE XLIV. [II-423 / 299]
- Récapitulation et conclusion de cet ouvrage. — La loi de la propriété, établie sur l’ordre physique, et dont la connaissance évidente est donnée par la nature à tous les hommes, renferme en son entier l’ordre essentiel des sociétés. — Cette loi unique et universelle est la raison essentielle et primitive de toutes les autres lois. — Ses rapports avec les mœurs. — Combien les systèmes publics d’un gouvernement influent sur la formation de l’homme moral. — Les vertus sociales ne peuvent être que passagères, dès qu’elles sont séparées de l’ordre essentiel des sociétés.
- Tables des Chapitres et des Matières contenus dans le second Volume, pp. II-497-547.
L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques, vol. 1 (1767)
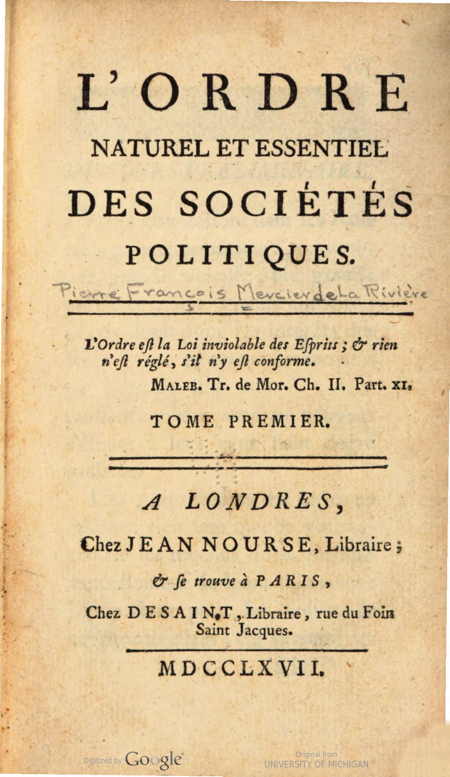
[I-vii / 7]
L’ORDRE NATUREL ET ESSENTIEL DES SOCIÉTÉS POLITIQUES
DISCOURS PRELIMINAIRE↩
Nous connaissons dans les rois trois principaux objets d’ambition : une grande richesse, une grande puissance, une grande autorité ; j’écris donc pour les intérêts des rois ; car je traite des moyens par lesquels leur richesse, leur puissance, leur autorité peuvent s’élever à leur plus haut degré possible.
Les propriétaires des terres ne désirent rien tant que de voir accroître les revenus qu’ils retirent annuellement de leurs domaines : j’écris donc pour les intérêts de ces propriétaires ; car je traite des moyens par lesquels toutes les terres peuvent parvenir à leur donner le plus grand revenu possible.
La classe qui vend ses travaux aux autres hommes, n’a d’autre but que d’augmenter ses salaires par son industrie : j’écris donc pour les intérêts de cette classe ; car je traite des moyens par lesquels la masse des salaires de l’industrie peut grossir dans toute l’étendue de sa plus grande mesure possible.
Les ministres des autels, comme hommes co-partageants dans le produit des terres, et comme dispensateurs des biens consacrés à secourir l’indigent, sont doublement intéressés à l’abondance des récoltes : j’écris donc pour les intérêts de ces ministres : j’écris donc pour les intérêts de l’indigent ; car je traite des moyens par lesquels on peut assurer aux récoltes la plus grande abondance possible.
Les commerçants, classe particulière d’hommes dont l’utilité est commune à toutes les nations, et qui ne peuvent commercer qu’en raison de la reproduction des richesses commerçables, ne doivent former des vœux que pour la multiplication de ces richesses : j’écris donc pour les intérêts des commerçants ; car je traite des moyens par lesquels on peut s’assurer la plus grande reproduction, et la plus grande consommation possible de toutes les richesses qui doivent entrer dans le commerce.
Les hommes enfin, en se réunifiant en société, n’ont eu d’autre objet que d’instituer parmi eux des droits de propriétés communes et particulières, à l’aide desquels ils pussent se procurer toute la somme du bonheur que l’humanité peut comporter, toutes les jouissances [8] dont elle nous rend susceptibles : j’écris donc pour les intérêts du corps entier de la société ; car je traite des moyens par lesquels elle doit nécessairement, et pour toujours, donner la plus grande consistance, la plus grande valeur à ces droits de propriétés communes et particulières, se placer ainsi et se maintenir dans son meilleur état possible.
Partout où nos connaissances peuvent pénétrer, nous découvrons une fin et des moyens qui lui sont relatifs : nous ne voyons rien qui ne soit gouverné par des lois propres à son existence, et qui ne soit organisé de manière à obéir à ces lois, pour acquérir, par leurs secours, tout ce qui peut convenir à la nature de son être, et à sa façon d’exister. J’ai pensé que l’homme n’avait pas été moins bien traité : les dons qui lui sont particuliers, et qui lui donnent l’empire de la terre, ne me permettent pas de croire que dans le plan général de la création, il n’y ait pas une portion de bonheur qui lui soit destinée, et un ordre propre à lui en assurer la jouissance.
Plein de cette idée, et persuadé que cette lumière divine qui habite en nous, ne nous est pas donnée sans un objet, j’en ai conclu qu’il fallait que cet objet fût de nous mettre en état de connaître l’ordre sur lequel nous devons régler notre façon d’exister pour être heureux. De là, passant à la recherche et à l’examen de cet ordre, j’ai reconnu que notre état naturel est de vivre en société ; que nos jouissances les plus précieuses ne peuvent se trouver qu’en société ; que la réunion des hommes en société, et des hommes heureux par cette réunion, est dans les vues du Créateur ; qu’ainsi nous devions regarder la société comme étant l’ouvrage de Dieu même ; et les lois constitutives de l’ordre social comme faisant partie des lois générales et immuables de la création.
Les premières difficultés qui se sont élevées contre cette façon de considérer l’homme, ont été tirées des maux qui résultent de notre réunion en société. Mais alors observant que parmi les choses les plus utiles pour nous, il n’en est point qui ne puissent nous devenir funestes par les abus que nous pouvons en faire, j’ai cru devoir examiner si les lois naturelles de la société sont les véritables causes de ces mêmes maux ; ou s’ils ne sont point plutôt les fruits nécessaires de notre ignorance sur les dispositions de ces lois.
Mes recherches sur ce point m’ont fait passer du doute à l’évidence : elles m’ont convaincu qu’il existe un ordre naturel pour le gouvernement des hommes réunis en société ; un ordre qui nous assure nécessairement toute la félicité temporelle à laquelle nous sommes appelés pendant notre séjour sur la terre, toutes les jouissances que nous pouvons raisonnablement y désirer, et auxquelles nous ne pouvons rien ajouter qu’à notre préjudice ; un ordre pour la [9] connaissance duquel la nature nous a donné une portion suffisante de lumières, et qui n’a besoin que d’être connu pour être observé ; un ordre où tout est bien, et nécessairement bien, où tous les intérêts sont si parfaitement combinés, si inséparablement unis entre eux, que depuis les souverains jusqu’au dernier de leurs sujets, le bonheur des uns ne peut s’accroître que par le bonheur des autres ; un ordre enfin dont la sainteté et l’utilité, en manifestant aux hommes un Dieu bienfaisant, les prépare, les dispose, par la reconnaissance, à l’aimer, à l’adorer, à chercher par intérêt pour eux-mêmes, l’état de perfection le plus conforme à ses volontés.
Plus j’ai voulu combattre cette évidence, et plus je l’ai rendue victorieuse pour moi : plût au Ciel que je pusse la démontrer aux autres comme je la sens, comme je la vois ; plût au Ciel qu’elle fût universellement répandue ; elle ne pourrait l’être qu’elle ne changeât nos vices en vertus ; qu’elle ne fît ainsi le bonheur de l’humanité.
[I-1 / 10]
PREMIÈRE PARTIE THÉORIE DE L’ORDRE
Nécessité physique de la société. — Comme elle nous conduit à la connaissance du juste et de l’injuste absolus. — Leur origine, en quoi ils consistent ; axiome qui renferme tout le juste absolu. — Comme les devoirs sont le principe et la mesure des droits. — Premiers principes constitutifs de l’ordre naturel et essentiel à chaque société particulière. — Rapports nécessaires de cet ordre essentiel avec l’ordre physique ; caractères principaux et avantages de cet ordre essentiel ; il est simple, évident et immuable ; il constitue le meilleur état possible de tout homme vivant en société. — Exposition sommaire de la théorie de cet ordre, servant encore à prouver la simplicité et l’évidence de ses principes et des conséquences qui en résultent. — Moyens de l’établir et de le perpétuer parmi les hommes.
[I-3]
CHAPITRE I.↩
La manière dont l’homme est organisé prouve qu’il est destiné par la nature à vivre en société. — Nécessité physique de la réunion des hommes en société. — Elle est nécessaire à la reproduction des subsistances, et par conséquent à la multiplication des hommes, qui est dans les vues du Créateur.
Il est évident que l’homme, susceptible de compassion, de pitié, d’amitié, de bienfaisance, de gloire, d’émulation, d’une multitude d’affections qu’il ne peut éprouver qu’en société, est destiné par la nature à vivre en société. Ce n’est que dans cette vue qu’elle a pu lui donner le germe des passions qui ne peuvent convenir qu’à un être social : si elle s’était proposé que l’homme vécût isolé comme les bêtes féroces, elle ne l’aurait pas organisé différemment de ce qu’elles le sont ; elle ne l’aurait pas disposé à recevoir, à sentir des affections qui n’ont de rapport qu’avec la société, et qui ne peuvent naître en lui qu’autant qu’il vit en société.
Plus nous approfondirons cette idée, et plus nous serons convaincus, par la contemplation de ce qui est naturellement en nous, que la réunion des hommes en société est dans le plan général de la création : nous avons reçu de Dieu une intelligence dont l’utilité ne [11] se développe qu’en société : par son moyen nos connaissances ont franchi les bornes du globe dans lequel nous nous étions trouvés renfermés ; nous sommes parvenus à multiplier, pour ainsi dire, notre existence personnelle, à penser, à agir dans les autres hommes, à donner à nos volontés la puissance de nous rendre présents en différents lieux à la fois : pourquoi donc aurions-nous reçu ces facultés intellectuelles par le secours desquelles les hommes les plus éloignés les uns des autres communiquent entre eux et s’entreservent, si ce n’est pour que la société des hommes existât par l’exercice habituel de ces mêmes facultés ?
Cette intelligence qui nous rend maîtres de tout ce qui respire, qui permet que notre faiblesse devienne la force dominante sur la terre, qui nous élève enfin à la connaissance évidente de tant de vérités sublimes et importantes à notre bonheur, nous laisserait dans un état qui, à plusieurs égards, serait fort inférieur à celui des brutes, si dans un homme elle n’était jamais enrichie des lumières qui lui sont préparées par les autres hommes.
Oui, notre intelligence, ce don si précieux, est une espèce de patrimoine commun qui n’a de valeur qu’autant que tous les hommes le font valoir en commun, et qu’ils en partagent les fruits en commun. Lors même que la mort nous sépare de la société, elle ne sépare point toujours la société de la portion d’intelligence que nous avons cultivée pendant notre vie : les découvertes que nous avons faites par son secours, tous les fruits en un mot que nous en avons retirés, subsistent encore après nous, lorsque nous avons bien voulu les communiquer, et ne point les dérober à la société. Notre intelligence nous survit ainsi pour l’utilité de nos associés ; ils semblent en hériter ; et voilà pourquoi nous disons des grands hommes, qu’ils ne meurent point ; que leur esprit habite encore partout où leurs lumières se sont répandues, partout où leurs vertus servent de modèle.
Comment donc pourrait-on croire que nous ne sommes point organisés pour vivre en société, tandis que nous nous apercevons tous les jours que par le moyen de notre intelligence, il subsiste encore une sorte de société entre nous et des hommes qui, depuis 2000 ans, ont disparu de dessus la terre : nous les révérons, nous les consultons ; à leur tour, ils nous parlent et nous instruisent ; ils communiquent avec nous enfin, puisqu’ils excitent en nous des sensations, et qu’ils nous suggèrent des idées, comme si nous jouissions encore de leur présence et de leur entretien.
Pour peu que nous fassions attention aux secours dont l’enfance et la vieillesse ne peuvent absolument se passer, il est certainement évident que l’homme est constitué de manière qu’il doit naître, et mourir en société. Ce que j’appelle naître, c’est vivre dans l’enfance, [12] dans cet âge où chaque jour nous acquérons, par une gradation insensible, le degré de forces suffisantes pour satisfaire, par nous-même, à ce que nos besoins exigent. Par la même raison, ce que j’appelle mourir, c’est la façon dont nous existons, lorsque courbés sous le poids des années, le déclin journalier de nos forces nous achemine peu à peu vers le dernier terme où la loi commune à tout être créé doit s’accomplir.
Si dans les extrémités de notre vie, cette faiblesse, qui devient en nous une impuissance absolue, trouve dans les inclinations et les devoirs des autres hommes, tous les secours dont elle a besoin, c’est à la société que nous en sommes redevables : notre réunion en société suppléant ainsi, dans l’homme social, tout ce que la nature a refusé à l’homme isolé, elle est donc évidemment une condition essentielle à notre existence.
Nous trouverons une quatrième preuve de la même vérité, si nous voulons donner quelque attention aux deux mobiles qui sont en nous les premiers principes de tous nos mouvements : l’un est l’appétit des plaisirs, et l’autre est l’aversion de la douleur. Par l’appétit des plaisirs on ne doit pas entendre seulement l’appétit des jouissances purement physiques, de ces sensations agréables qui naissent en nous nécessairement, selon la disposition naturelle de nos sens, et sans le concours de nos facultés intellectuelles ; mais sous le nom de plaisirs, il faut comprendre encore ce que nous pouvons nommer la délectation de l’âme, ces vives et douces affections qui la pénètrent si délicieusement ; qui la remplissent sans lui laisser aucun vide, qui naissent des rapports que nous avons avec les êtres de notre espèce, et que nous ne pouvons éprouver que dans la société.
De même quand je parle de l’aversion de la douleur, l’idée que je veux présenter ne doit point être resserrée dans ce qui concerne les maux physiques : elle embrasse encore toutes les situations pénibles, ennuyeuses et affligeantes dans lesquelles l’âme ne peut se trouver qu’à l’occasion de notre existence en société.
Ces sortes d’affections sociales, quoiqu’elles ne nous soient communiquées que par l’entremise de nos sens, prennent sur nous un tel empire, qu’elles nous forcent souvent à leur sacrifier nos sensations physiques les plus chères : c’est à ces affections sociales que nous obéissons, lorsque nous paraissons renoncer à nous-même pour ne plus vivre que dans les autres, pour ne plus jouir que de leurs propres jouissances, pour ne plus connaître le plaisir, qu’autant qu’il passe par eux pour arriver jusqu’à nous ; nous leur obéissons encore lorsque nous nous élevons jusqu’au mépris des richesses et de la vie, et que nous préférons la douleur physique, la mort même au [13] déshonneur ou à quelque autre chagrin qui naît de nos rapports avec la société.
Ces réflexions, toutes courtes qu’elles sont, suffisent pour prouver que la société nous devient beaucoup plus précieuse par les jouissances qu’elle nous procure dans l’ordre métaphysique, que par les jouissances physiques qu’elle nous assure ; qu’ainsi l’appétit des plaisirs, si avide de ces affections sociales, ne peut être satisfait que par le moyen de la société.
Je conviens cependant que ce mobile, considéré dans ses rapports avec l’ordre physique, nous soumet d’une manière bien plus sensible encore et bien plus absolue, à la nécessité rigoureuse de nous réunir en société : pressés par l’attrait du plaisir physique de satisfaire aux besoins essentiels à notre existence, et ne pouvant nous procurer, que par le moyen de la société, les choses relatives à ces mêmes besoins, il est évident que notre réunion en société est une suite naturelle et nécessaire de l’appétit des plaisirs.
Mais ce n’est point là que se bornent les rapports de ce mobile avec la société : quelle multitude de besoins et de jouissances factices ne voit-on pas naître pour nous à l’occasion de notre réunion en société ! L’appétit des plaisirs, en nous rendant sensibles à l’attrait de ces jouissances, ne nous annonce-t-il pas que nous sommes faits pour elles, et qu’elles sont faites pour nous ? Et quand il est démontré, comme il le sera dans la suite de cet ouvrage, que ces besoins et ces jouissances factices sont l’âme du mouvement social, du mouvement par lequel la société parvient à remplir les objets de son institution, ne nous devient-il pas évident que tout en nous est disposé pour que nous vivions en société ?
Ce que je viens de dire de ce premier mobile me dispense de parler du second : il est aisé de concevoir que la privation des jouissances recherchées par l’appétit des plaisirs, est pour nous une occasion de douleur ; et que l’aversion de la douleur concourt ainsi avec l’appétit des plaisirs, à la formation et au maintien de la société.
Une cinquième preuve que nous sommes destinés à vivre en société, ce sont les besoins physiques et essentiels auxquels notre existence nous assujettit uniformément : nous ne pouvons exister sans consommer ; notre existence est une consommation perpétuelle ; et la nécessité physique des subsistances établit la nécessité physique de la société. Si les hommes ne se nourrissaient que des productions spontanées de la terre, de celles qu’elle donne gratuitement, et sans travaux préparatoires, il faudrait un pays très vaste pour faire subsister un très petit nombre d’hommes ; mais nous savons par notre propre expérience que l’ordre physique de notre constitution tend à une multiplication très nombreuse. Cette disposition physique serait [14] donc une contradiction, un désordre dans la nature, en ce que les hommes ne pourraient se multiplier que pour s’entredétruire, si l’ordre physique de la reproduction des subsistances ne permettait pas qu’elles soient multipliées aussi à mesure que nous nous multiplions. Ce désordre serait d’autant plus grand, d’autant plus évident, qu’il s’étendrait jusque sur les vues que la nature s’est proposé dans la multiplication des autres animaux ; car elle est subordonnée, comme la nôtre, à celle des subsistances ; et nous sommes les seules créatures par le moyen desquelles les productions doivent se multiplier pour l’avantage commun de tous les êtres qui sont destinés à les consommer.
Cependant cette multiplication de subsistances ne peut s’opérer que par la culture, et la culture n’est possible que dans la société ; car il est évident que personne ne cultiverait si personne n’avait la certitude morale de jouir de la récolte, et que ce n’est que dans la société que cette certitude morale peut s’établir, parce qu’elle suppose des droits qui, comme on le verra dans la suite, ne peuvent avoir lieu qu’en société.
L’exemple des Lapons qui ne cultivent point, ne peut pas m’être objecté : chez eux la rigueur du climat s’oppose à la multiplication des hommes, parce qu’il s’oppose à la culture : aussi sont-ils très peu nombreux. Mais quelque faible que soit leur population, elle ne serait point ce qu’elle est, et elle ne pourrait se conserver dans le même état, si la société qui s’est établie parmi eux, ne leur assurait la propriété de leurs troupeaux, et la liberté de les faire pâturer.
Je ne crains pas non plus qu’on aille chercher chez quelques peuples de l’Amérique, des arguments pour me prouver que l’ordre physique de la génération ne rend pas la culture nécessaire. Je sais qu’il en est qui ne cultivent point ou presque point, quoique leur sol et leur climat soient également heureux ; mais ils détruisent leurs enfants, égorgent les vieillards, emploient des remèdes pour arrêter le cours naturel de la génération : leurs pratiques homicides sont donc autant de preuves que je peux réclamer pour établir, non pas qu’il ne peut exister une société sans culture, mais que dans les climats propres à la multiplication des hommes, il est d’une nécessité physique, d’une nécessité relative à leurs besoins physiques et à l’ordre physique de la génération, qu’ils soient cultivateurs ou meurtriers.
Je veux bien laisser dans ce premier moment la liberté d’instituer une société comme on le voudra ; je veux bien qu’elle ne soit point cultivatrice ; toujours est-il vrai que si les hommes n’ont pas formé entre eux une société quelconque, de laquelle il puisse résulter une sûreté contre la supériorité de la force et son usage arbitraire, il est [15] impossible qu’un homme puisse faire des approvisionnements, élever des troupeaux, en un mot s’assurer les moyens de subsister d’un automne à un autre automne. Partout où il n’y aurait de droits que ceux de la force, toute possession ne pourrait être que précaire et conditionnelle : un tel état serait un état de guerre perpétuelle et nécessaire : quiconque ne croirait pas être seul, se croirait nécessairement en danger, et nécessairement il faudrait qu’il détruisît pour n’être pas détruit.
Rien de plus simple, rien de plus évident que l’argument que je viens d’employer pour prouver la nécessité physique de la société : l’ordre physique de la génération nous montre que le genre humain est destiné par l’auteur de la nature à une multiplication très nombreuse ; cette multiplication cependant ne peut avoir lieu sans une abondance de subsistances relative et proportionnée à ses besoins ; or cette abondance ne peut naître que par le moyen de la culture qui ne peut s’établir sans la société : ainsi l’établissement de la société, comme moyen nécessaire à l’abondance des productions, est d’une nécessité physique à la multiplication des hommes, et fait partie de l’ordre de la création.
[I-16 / 16]
CHAPITRE II.↩
Première source du juste et de l’injuste absolus ; en quoi ils consistent ; leurs rapports avec la nécessité physique de la société ; droits et devoirs dont la nécessité et la justice sont absolues. — Origine de la propriété personnelle et de la propriété mobilière ; ce qu’elles sont ; leurs rapports avec l’inégalité des conditions parmi les hommes. — Axiome qui renferme tout le juste absolu.
La connaissance de la nécessité physique de la société nous conduit tout d’un coup à la connaissance du juste et de l’injuste absolus. Le juste absolu est une justice par essence, une justice qui tient tellement à la nature des choses, qu’il faudrait qu’elles cessassent d’être ce qu’elles sont, pour que cette justice cessât d’être ce qu’elle est.
Le juste absolu peut être défini, un ordre de devoirs et de droits qui sont d’une nécessité physique, et par conséquent absolue. Ainsi l’injuste absolu est tout ce qui se trouve contraire à cet ordre. Le terme d’absolu n’est point ici employé par opposition au relatif ; car ce n’est que dans le relatif que le juste et l’injuste peuvent avoir lieu ; mais ce qui, rigoureusement parlant, n’est qu’un juste relatif devient cependant un juste absolu par rapport à la nécessité absolue où nous sommes de vivre en société.
Quoi qu’il soit vrai de dire que chaque homme naisse en société, cependant dans l’ordre des idées, le besoin que les hommes ont de la société, doit se placer avant l’existence de la société. Ce n’est pas parce que les hommes se sont réunis en société, qu’ils ont entre eux des devoirs et des droits réciproques ; mais c’est parce qu’ils avaient naturellement et nécessairement entre eux des devoirs et des droits réciproques, qu’ils vivent naturellement et nécessairement en société. Or ces devoirs et ces droits, qui dans l’ordre physique sont d’une nécessité absolue, constituent le juste absolu.
Je ne crois pas qu’on veuille refuser à un homme le droit naturel de pourvoir à sa conservation : ce premier droit n’est même en lui que le résultat d’un premier devoir qui lui est imposé sous peine de douleur et même de mort. Sans ce droit, sa condition serait pire que celle des animaux ; car ils en ont tous un semblable. Or il est évident que le droit de pourvoir à sa conservation renferme le droit d’acquérir, par ses recherches et ses travaux, les choses utiles à son existence, et celui de les conserver après les avoir acquises. Il est évident que ce second droit n’est qu’une branche du premier : on ne peut pas dire avoir acquis ce qu’on n’a pas le droit de conserver ; ainsi le droit [17] d’acquérir et le droit de conserver ne forment ensemble qu’un seul et même droit, mais considéré dans des temps différents.
C’est donc de la nature même que chaque homme tient la propriété exclusive de sa personne, et celle des choses acquises par ses recherches et ses travaux. Je dis la propriété exclusive, parce que si elle n’était pas exclusive, elle ne serait pas un droit de propriété.
Si chaque homme n’était pas, exclusivement à tous les autres hommes, propriétaire de sa personne, il faudrait que les autres hommes eussent sur lui-même des droits semblables aux siens : dans ce cas on ne pourrait plus dire qu’un homme a le droit naturel de pourvoir à sa conservation ; lorsqu’il voudrait user d’un tel droit, les autres auraient aussi le droit de l’en empêcher ; son prétendu droit serait donc nul ; car un droit n’est plus un droit, dès que les droits des autres ne nous laissent pas la liberté d’en jouir.
Il y a longtemps que nous avons adopté l’axiome du droit romain, Jus constituit necessitas, et que sans connaître la force et la justice de cette façon de parler, nous disons que la nécessité fait la loi. Cet axiome cependant renferme une grande vérité ; il nous apprend que ce qui est d’une nécessité absolue, est aussi d’une justice absolue ; et d’après cette même vérité, nous devons faire le raisonnement que voici : Pour que chaque homme puisse remplir le premier devoir auquel il est assujetti par la nature, pour qu’il puisse subsister enfin, il est d’une nécessité absolue qu’il ait le droit de pourvoir à sa conservation ; pour qu’il puisse jouir de ce droit, il est d’une nécessité absolue que les autres n’aient pas le droit de l’en empêcher ; la propriété exclusive de sa personne, que désormais j’appellerai propriété personnelle, est donc pour chaque homme un droit d’une nécessité absolue ; et comme cette propriété personnelle exclusive serait nulle sans la propriété exclusive des choses acquises par ses recherches et ses travaux, cette seconde propriété exclusive à laquelle je donnerai, dans la suite, le nom de propriété mobilière, est d’une nécessité absolue comme la première dont elle émane.
Nous voici déjà bien avancés dans la connaissance du juste et de l’injuste absolus : une fois que nous voyons qu’il est d’une nécessité absolue que dans chaque homme sa propriété personnelle et sa propriété mobilière soient exclusives, nous sommes forcés de reconnaître aussi, dans chaque homme, des devoirs d’une nécessité absolue : ces devoirs consistent à ne point blesser les droits de propriété des autres hommes ; car il est évident que, sans les devoirs, les droits cesseraient d’exister.
L’homme, considéré par rapport aux animaux, n’a point de droits, parce qu’entre eux et lui c’est le pouvoir physique qui décide [18] de tout. L’idée qu’on doit se former d’un droit ne peut s’appliquer qu’aux rapports que les hommes ont nécessairement entre eux ; et dans ce point de vue, qui dit un droit, dit une prérogative établie sur un devoir, et dont on jouit librement, sans le secours de la supériorité des forces, parce que toute force étrangère, quoique supérieure, est obligée de la respecter. Sans cette obligation rigoureuse, l’homme endormi n’aurait aucun des droits de l’homme éveillé, ou plutôt personne n’aurait de droits, qu’en raison de son pouvoir physique, et la société ne subsisterait pas plus entre les hommes, qu’elle subsiste entre eux et les bêtes féroces.
Le voilà donc ce juste absolu, le voilà qui s’offre à nous dans toute sa simplicité : une fois que nous reconnaissons la nécessité physique dont il est, que nous vivions en société, nous voyons évidemment qu’il est d’une nécessité, et conséquemment d’une justice absolues, que chaque homme soit exclusivement propriétaire de sa personne et des choses qu’il acquiert par ses recherches et ses travaux ; nous voyons évidemment qu’il est d’une nécessité et d’une justice absolues que chaque homme se fasse un devoir de respecter les droits de propriété des autres hommes ; qu’ainsi parmi eux il n’est point de droits sans devoirs. J’ai même déjà fait observer que cette règle est l’ordre primitif de la nature ; car dans cet ordre primitif le droit de pourvoir nous-même à notre conservation, sitôt que nos forces nous le permettent, est établi sur un devoir absolu, sur un devoir dont nous ne pouvons nous affranchir, que nous n’en soyons punis par la douleur et la destruction de notre individu.
Cette dernière maxime du juste absolu nous montre encore qu’il n’est point de devoirs sans droits ; que ceux-là sont le principe et la mesure de ceux-ci ; que les devoirs enfin ne peuvent être établis dans la société, que sur la nécessité dont ils sont à la conservation des droits qui en résultent.
Si quelqu’un révoquait en doute cette vérité, il ne me serait pas difficile de l’en convaincre : un devoir, quel qu’il soit, prend sur la propriété personnelle qui doit être exclusive ; il est donc, par essence, incompatible avec cette propriété, à moins qu’il ne lui soit utile. Il est évident que si ce devoir lui était onéreux sans lui être d’aucune utilité, celui qui serait grevé de ce devoir, ne serait plus exclusivement propriétaire de sa personne : ainsi ce devoir, qui offenserait un droit naturel et conforme à la justice par essence, ne pourrait être rempli, qu’autant qu’on y serait contraint par une force supérieure : dans cet état, tout se ramènerait au pouvoir physique, désordre destructif de toute société. [19] L’idée d’un devoir qui ne serait absolument qu’onéreux, présente une contradiction bien frappante ; car d’un côté elle suppose un devoir, et de l’autre côté nul droit pour l’exiger. En effet un droit que la force seule établit, et qu’une autre force détruit, n’en est point un parmi les hommes. Tel serait cependant le titre de ceux qui voudraient assujettir un homme à des devoirs qui ne seraient pour lui d’aucune utilité, et qui par conséquent détruiraient en lui ses droits de propriété.
Revenons donc à l’ordre de la nature : là, nous trouvons que les devoirs sont nécessairement utiles ; qu’ils sont la source et le fondement des devoirs qui nous sont acquis, et qu’il nous importe de conserver ; que ces droits sont des propriétés exclusives par essence ; que leur imposer un devoir quelconque qui n’eut rien d’avantageux pour elles, ce serait les partager et par conséquent les détruire ; qu’ainsi elles ne peuvent se concilier avec d’autres devoirs que ceux qui sont conformes et nécessaires aux intérêts de ces mêmes propriétés exclusives. Nous pouvons donc renfermer tout le juste absolu dans un seul et unique axiome : POINT DE DROITS SANS DEVOIRS, ET POINT DE DEVOIRS SANS DROITS.
Je terminerai ce chapitre par une observation sur l’inégalité des conditions parmi les hommes : ceux qui s’en plaignent ne voient pas qu’elle est dans l’ordre de la justice par essence : une fois que j’ai acquis la propriété exclusive d’une chose, un autre ne peut pas en être propriétaire comme moi et en même temps. La loi de la propriété est bien la même pour tous les hommes ; les droits qu’elle donne sont tous d’une égale justice, mais ils ne sont pas tous d’une égale valeur, parce que leur valeur est totalement indépendante de la loi. Chacun acquiert en raison des facultés qui lui donnent les moyens d’acquérir ; or la mesure de ces facultés n’est pas la même chez tous les hommes.
Indépendamment des nuances prodigieuses qui se trouvent entre les facultés nécessaires pour acquérir, il y aura toujours dans le tourbillon des hasards, des rencontres plus heureuses les unes que les autres : ainsi par une double raison, il doit s’introduire de grandes différences dans les états des hommes réunis en société. Il ne faut donc point regarder l’inégalité des conditions comme un abus qui prend naissance dans les sociétés : quand vous parviendriez à dissoudre celles-ci, je vous défie de faire cesser cette inégalité ; elle a sa source dans l’inégalité des pouvoirs physiques, et dans une multitude d’événements accidentels dont le cours est indépendant de nos volontés ; ainsi dans quelque situation que vous supposiez les hommes, vous ne pourrez jamais rendre leurs conditions égales, à moins que [20] changeant les lois de la nature, vous ne rendiez égaux pour chacun d’eux, les pouvoirs physiques et les accidents.
Je conviens cependant que dans une société particulière, ces différences dans les états des hommes peuvent tenir à de grands désordres qui les augmentent au-delà de leur proportion naturelle et nécessaire ; mais qu’en résulte-t-il ? Qu’il faut se proposer d’établir l’égalité des conditions ? Non ; car il faudrait détruire toute propriété, et par conséquent toute société ; mais qu’il faut corriger les désordres qui font que ce qui n’est point un mal en devient un, en ce qu’ils disposent les choses de manière que la force place d’un côté tous les droits, et de l’autre tous les devoirs.
[I-27 / 21]
CHAPITRE III.↩
Formation des sociétés particulières ; comme elles sont d’une nécessité physique. — Institution et nécessité physique de la propriété foncière, des lois conséquentes à cette propriété, et d’une autorité tutélaire pour en assurer l’observation. — Premières notions du juste absolu considéré dans les sociétés particulières. — Comment la somme des droits et celle des devoirs se servent mutuellement de mesure dans ces sociétés. — Fondement naturel et unique de la véritable grandeur des rois.
Nous venons de voir qu’il a dû exister naturellement et nécessairement parmi les hommes une sorte de société universelle et tacite, dans laquelle chacun avait des devoirs et des droits essentiels. Cette société primitive existait par la seule connaissance du besoin que les hommes avaient les uns des autres, et de la nécessité où ils étaient de s’imposer des devoirs réciproques pour s’assurer des droits réciproques qui intéressaient leur existence. Dans ce premier état, les hommes venant à se multiplier, les productions gratuites et spontanées de la terre sont bientôt devenues insuffisantes ; et ils ont été forcés d’être cultivateurs. Alors il a fallu que les terres se partageassent, afin que chacun connût la portion qu’il pourrait cultiver.
De la nécessité de la culture a résulté la nécessité du partage des terres ; celle de l’institution de la propriété foncière ; et le tout ensemble a opéré nécessairement la division de la société universelle et tacite en plusieurs sociétés particulières et conventionnelles.
En général, avant qu’une terre puisse être cultivée, il faut qu’elle soit défrichée, qu’elle soit préparée par une multitude de travaux et de dépenses diverses qui marchent à la suite des défrichements ; il faut enfin que les bâtiments nécessaires à l’exploitation soient construits, par conséquent que chaque premier cultivateur commence par avancer à la terre des richesses mobilières dont il a la propriété : or comme ces richesses mobilières incorporées, pour ainsi dire, dans les terres, ne peuvent plus en être séparées, il est sensible qu’on ne peut se porter à faire ces dépenses, que sous la condition de rester propriétaire de ces terres ; sans cela la propriété mobilière de toutes les choses ainsi dépensées serait perdue. Cette condition a même été d’autant plus juste dans l’origine des sociétés particulières, que les terres étaient sans valeur vénale et sans prix, avant que les dépenses les eussent rendues susceptibles de culture.
D’après la nécessité physique de la propriété foncière il est aisé de concevoir la nécessité physique des sociétés particulières : en vain [22] un homme est constitué propriétaire d’une terre, il ne peut se décider à faire les dépenses nécessaires pour la mettre en valeur, qu’autant qu’il est socialement certain qu’il sera pareillement propriétaire de la récolte que la culture de cette terre pourra procurer. Mais pour établir cette certitude sociale en faveur des propriétaires fonciers et des cultivateurs, il a fallu chercher les moyens de mettre les récoltes à l’abri de tous les risques auxquels elles étaient nécessairement exposées, jusqu’à ce qu’elles fussent enlevées par ceux auxquels elles devaient appartenir. Les hommes se sont donc trouvés dans la nécessité physique de se diviser comme les terres même ; de former des sociétés particulières, dans lesquelles les uns fussent occupés de la culture, et les autres de la sûreté des récoltes.
Il est sensible que l’institution de ces sociétés particulières n’a pu se faire sans des conventions qui eussent un double objet : 1° celui d’assurer dans l’intérieur de chaque société, le sort des propriétaires fonciers, celui des cultivateurs, et de tous ceux qui seraient employés à la sûreté des récoltes ; 2° de mettre le corps entier de la société en état de n’avoir rien à craindre au dehors de la part des sociétés voisines. Alors, pour donner à ces conventions une consistance solide, et remplir les objets qu’on se proposait par leur moyen, il a fallu nécessairement instituer une autorité tutélaire, dans la protection de laquelle le corps social trouvât les secours et la garantie qu’il désirait : nous verrons dans la suite quelles sont les conditions essentielles pour que cette autorité réponde nécessairement aux vues de son institution.
C’est ainsi que la chaîne de nos besoins physiques sert à nous guider dans la recherche du juste absolu : à mesure qu’ils se développent à nos yeux, la nécessité physique de l’ordre auquel ils nous assujettissent nécessairement, se rend sensible ; et cette nécessité physique, qui est absolue, nous fait connaître ce qui est d’une justice absolue.
Dans le premier état où le genre humain se présente à nous, je veux dire, dans la société naturelle, universelle et tacite, nous apercevons clairement que l’homme ne peut exister sans la propriété exclusive de sa personne et des choses acquises par ses recherches et ses travaux ; que cette propriété étant la même dans tous les hommes, nous sommes ainsi forcés de reconnaître en chacun d’eux des devoirs et des droits d’une nécessité et d’une justice absolue.
Sitôt que les progrès de la multiplication des hommes les obligent d’employer leur industrie à multiplier les subsistances, le besoin qu’ils ont de la culture, les force d’instituer parmi eux une propriété foncière, qui devient ainsi d’une nécessité et d’une justice absolues. [23] Dès le moment que cette troisième sorte de propriété devient nécessaire à l’existence des hommes, la sûreté dont les récoltes ont besoin pour que la culture ait lieu, contraint la société générale de se diviser en sociétés particulières ; et dans ce second état nous découvrons de nouvelles branches du juste absolu ; nous voyons évidemment que ces sociétés particulières ne peuvent exister sans des conventions relatives à la sûreté si essentielle aux récoltes ; qu’ainsi les conventions qui établissent cette sûreté sont d’une nécessité et d’une justice absolues ; nous voyons évidemment que pour donner à ces mêmes conventions la solidité qui leur convient, il faut absolument instituer une autorité tutélaire ; par conséquent que d’un côté la protection que cette autorité doit leur accorder, et de l’autre côté l’obéissance aux ordres de cette même autorité sont d’une nécessité et d’une justice absolues.
Il est à propos de faire observer que la vérité de l’axiome qui embrasse tout le juste absolu, acquiert ici un nouveau degré d’évidence : à mesure que nous voyons nos devoirs s’accroître, nous voyons aussi nos droits s’accroître également. Dans le premier état des hommes ils n’avaient aucune sorte de propriétés communes ; leurs droits ne s’étendaient point au-delà de leurs propriétés exclusives tant personnelles que mobilières, et leurs devoirs ne les assujettissaient qu’à respecter entre eux ces mêmes propriétés, sans les obliger à se prêter des secours mutuels pour les défendre.
Dans leur second état les devoirs et les droits réciproques acquièrent une extension proportionnelle qui les rend bien plus précieux à l’humanité. Les hommes, obligés de cultiver, se trouvent ainsi chargés d’un nouveau devoir que la nature leur impose ; de ce nouveau devoir on voit naître une nouvelle sorte de droits, ceux de la propriété foncière qui assure celle des récoltes. Il est vrai qu’elle met en quelque sorte des bornes au droit primitif que tous les hommes avaient de se procurer des subsistances par leurs recherches ; mais aussi chacun de ceux qui jouissent de ces nouveaux droits, est dans l’obligation de les acheter par des dépenses, et de partager ainsi avec les autres hommes les avantages qu’il en retire ; par ce moyen ceux auxquels on impose, comme un nouveau devoir, l’obligation de respecter les récoltes, de veiller même à leur sûreté, se trouvent acquérir, par ce devoir, un nouveau droit, celui de participer à ces mêmes récoltes ; et ce nouveau droit les dédommage amplement du devoir qui en est le titre constitutif.
Ce n’est pas cependant que je veuille dire que tous les hommes qui ne cultivent point, soient dans une égale obligation de veiller à la sûreté des récoltes, et qu’ils aient un droit égal au partage qui doit en être fait. Mais pour tous ceux qui ne sont point commis aux fonctions [24] relatives à cette sûreté, il est d’autres moyens d’acquérir le droit de participer à ces mêmes récoltes ; et ces moyens sont toutes les ressources qu’ils peuvent trouver dans leur industrie, pour augmenter les jouissances du corps social : ils n’ont point à se plaindre d’avoir perdu le droit de recherche ; dès qu’ils se rendent utiles, les subsistances viennent les trouver ; ainsi en leur imposant le devoir de s’employer à l’utilité commune, on leur a donné des droits sur les produits de la culture ; et la manière dont ils satisfont à ce devoir, est ce qui décide de l’étendue de leurs droits.
On observera sans doute que la nécessité physique de la propriété foncière est la source où nous devons puiser toutes les institutions sociales qui constituent l’ordre essentiel des sociétés : de la nécessité de cette propriété nous voyons naître la nécessité de la propriété des récoltes ; de celle-ci la nécessité de les partager ; de cette troisième la nécessité des conventions ou des lois servant à régler ce partage ; de cette quatrième, la nécessité de toutes les autres institutions indispensables pour donner de la consistance à ces lois et aux droits qui en résultent : nous voyons ainsi se former la nécessité des magistrats pour être les organes des lois ; celle d’une autorité tutélaire pour assurer l’observation des lois ; celle enfin de tout ce qui doit concourir à mettre cette autorité en état de produire les effets qu’on en attend. Je n’entrerai point, quant à présent, dans le détail de toutes ces conséquences et des rapports nécessaires qu’elles ont entre elles ; je dirai seulement que la nécessité de la propriété foncière étant celle à laquelle la nécessité de toutes les autres institutions est subordonnée, il en résulte évidemment que le partage des récoltes doit être institué de manière que l’état du propriétaire foncier soit le meilleur état socialement possible.
Plus nous examinerons les rapports que les hommes ont entre eux dans cette nouvelle société, et plus nous serons convaincus que les nouveaux droits sont établis sur de nouveaux devoirs, et que les nouveaux devoirs sont établis sur de nouveaux droits : avant la formation des sociétés particulières le droit de chaque homme consistait, comme je viens de le dire, à ne point dépendre des autres, et son devoir se bornait à ne point les assujettir à dépendre de lui. Il en est tout autrement dans les sociétés particulières : il s’y forme une chaîne de dépendances réciproques qui deviennent des droits et des avantages réciproques : chaque homme est dans l’obligation de concourir à garantir les propriétés des autres hommes, et ce devoir lui donne un droit qui met les autres hommes dans l’obligation de concourir à lui garantir les siennes ; pour donner de la consistance à cette garantie mutuelle, il s’établit entre eux des propriétés communes, par le moyen desquelles chacun multiplie naturellement et [25] ses pouvoirs et ses jouissances ; ainsi par les nouveaux devoirs qu’il contracte, il acquiert de nouveaux droits, qui rendent nécessairement sa condition meilleure à tous égards.
Cette balance de devoirs et de droits réciproques et proportionnels établis les uns sur les autres se trouve être la même dans les devoirs et les droits de l’autorité tutélaire : si son droit est que les autres hommes lui obéissent, son devoir est aussi d’assurer les propriétés des autres hommes ; c’est parce qu’elle doit protection et sûreté, qu’on lui doit obéissance et partage dans les récoltes. Nous retrouvons donc partout la vérité de notre axiome : POINT DE DROITS SANS DEVOIRS, ET POINT DE DEVOIRS SANS DROITS.
Ce que je dis ici de l’autorité tutélaire nous conduit directement à nous former la plus haute idée de ceux qui en sont les dépositaires : on voit que cette autorité est le premier lien du corps politique ; que celui qui l’exerce est l’organe et le ministre de la justice par essence ; qu’il tient dans sa main le bonheur des hommes ; qu’en cela qu’il fait observer constamment un ordre de qui nous tenons tous les biens dont nous jouissons, il ne fait que partager dans les richesses qu’il procure ; il donne ainsi toujours plus qu’il ne reçoit ; il est une divinité à laquelle on ne peut rien offrir qui ne fasse partie de ses bienfaits.
[I-39 / 26]
CHAPITRE IV.↩
Premiers principes de l’ordre essentiel des sociétés particulières. — Définition de cet ordre essentiel. — Il est tout entier renfermé dans les trois branches du droit de propriété. — Sans cet ordre les sociétés particulières ne pourraient répondre aux vues de l’auteur de la nature, et remplir l’objet de leur institution. — Cet objet est de procurer au genre humain le plus grand bonheur et la plus grande multiplication possibles.
À peine avons-nous, pour ainsi dire, entrevu la nécessité physique des sociétés particulières, que nous découvrons un ordre essentiel, un ordre dont elles ne peuvent s’écarter sans trahir leurs véritables intérêts, sans cesser même d’être sociétés. Ce que j’appelle un ordre essentiel est, en général, un enchaînement de moyens sans lesquels il est impossible de remplir l’objet qu’on s’est proposé. Ainsi l’objet ultérieur de la formation des sociétés particulières, tel que nous l’apercevons dans les intentions de leur premier instituteur, étant le bonheur et la multiplication des hommes, il devient évident que l’ordre essentiel des sociétés est l’accord parfait des institutions sociales sans lesquelles ce bonheur et cette multiplication ne pourraient avoir lieu.
Pour rendre ces vérités plus sensibles, il est à propos de développer les rapports qui se trouvent entre le bonheur et la multiplication des hommes. Par la raison qu’un homme n’apporte dans ce monde que des besoins ; qu’il doit y trouver les choses nécessaires à sa subsistance, et qu’il ne peut exister sans consommer, il est évident que les hommes ne peuvent se multiplier, qu’en proportion des productions qui doivent entrer dans leurs consommations. L’objet immédiat de l’institution des sociétés particulières est donc la multiplication des productions.
Cet objet immédiat nous est manifesté par l’ordre physique, de manière que personne ne peut le révoquer en doute : tout le monde voit évidemment que l’espèce humaine est susceptible d’une multiplication bien supérieure au nombre d’hommes qui pourraient vivre des productions spontanées de la terre ; tout le monde voit évidemment que la multiplication des productions est physiquement nécessaire ; qu’elle est possible, et même certaine, en remplissant, de notre part, les conditions dont l’ordre physique la fait dépendre ; tout le monde voit évidemment que cette multiplication ne peut s’opérer sans la culture ; que la culture ne peut avoir lieu que dans les sociétés particulières ; par conséquent que leur institution est dans les vues de la nature, comme un moyen dont elle a fait choix pour que la [27] multiplication des hommes ne fût point arrêtée par un obstacle insurmontable, et qu’au lieu de leur devenir funeste, elle servît à l’accroissement de leur bonheur.
Aux yeux du Créateur le bonheur des hommes à naître est tout aussi présent que celui des hommes qui sont déjà nés ; il pourvoit à l’un et à l’autre par les mêmes moyens, par l’institution des sociétés, par l’intérêt qu’elles ont pour elles-mêmes à multiplier les productions, par l’ensemble de toutes les dispositions qui sont dans la nature pour servir leurs intentions à cet égard. Cette réflexion nous montre combien nous devons respecter l’ordre qui nous réunit en société ; combien nous sommes coupables devant Dieu, lorsque nous nous écartons de cet ordre divin, et que nous arrêtons le cours naturel de la multiplication des hommes, en arrêtant celui de la multiplication des productions.
La multiplication et le bonheur des hommes sont deux objets tellement enchaînés l’un à l’autre dans le système de la nature, qu’il n’est sur la terre aucune puissance qui ait le pouvoir de les séparer. Humainement parlant, le plus grand bonheur possible consiste pour nous dans la plus grande abondance possible d’objets propres à nos jouissances, et dans la plus grande liberté possible d’en profiter. Or cette grande abondance ne peut jamais exister sans une grande liberté ; car, comme il sera démontré dans le chapitre suivant, c’est à la liberté que nous sommes redevables de tous les efforts que font les hommes pour provoquer cette abondance. Ainsi dès qu’il est reconnu que dans les vues de la nature la plus grande abondance possible des productions est l’objet immédiat de l’institution des sociétés particulières, il devient évident qu’il est également dans ses vues que les hommes y jouissent de la plus grande liberté possible, et conséquemment que les deux ensemble leur assurent le plus grand bonheur possible.
Non seulement l’auteur de la nature a voulu que la multiplication des hommes ne pût s’opérer que par les moyens institués pour les rendre heureux, mais encore que cette multiplication à son tour servît à l’accroissement de leur bonheur. C’est par un effet naturel de cette multiplication, que la terre s’est couverte d’une multitude de productions diverses, et que par la voie du commerce, chaque climat s’approprie, en quelque sorte, les richesses des autres climats ; c’est à elle encore que nous sommes redevables des progrès de notre intelligence et de notre industrie, en un mot de tout ce que nous mettons en pratique pour varier et multiplier nos jouissances. Je sais que parmi ces jouissances il en est beaucoup dont la privation ne serait point un malheur pour nous, si elles nous étaient totalement inconnues ; mais cela n’empêche pas qu’il nous soit agréable de les posséder, 74. 28. [28] et que ces jouissances ajoutent à la somme commune du bonheur qui se partage entre les hommes.
Autre chose est le malheur, autre chose la diminution du bonheur : ne pas jouir d’un bien qu’on ne connaît pas, n’est point un malheur ; mais c’est un bonheur de moins ; par la même raison connaître ce bien et en jouir n’est point la cessation d’un malheur, mais c’est un bonheur de plus. C’est dans ce sens qu’il faut entendre que la grande multiplication des hommes leur devient avantageuse ; ils pourraient sans elle n’être pas malheureux ; mais ils en ont besoin pour devenir plus heureux.
L’ordre essentiel à toutes les sociétés particulières est donc l’ordre des devoirs et des droits réciproques dont l’établissement est essentiellement nécessaire à la plus grande multiplication possible des productions, afin de procurer au genre humain la plus grande somme possible de bonheur, et la plus grande multiplication possible. D’après cette définition de l’ordre essentiel, il devient évident qu’il n’est rien au monde qui puisse nous intéresser autant que la connaissance de cet ordre précieux ; mais ce qui nous prouve bien que l’auteur de la nature a voulu que nous fussions heureux, c’est que tous les hommes sont appelés à cette connaissance : rien de si simple que l’ordre essentiel des sociétés ; rien de si facile à concevoir que les principes immuables qui le constituent ; ils sont tous renfermés dans les trois branches du droit de propriété ; il est aisé de le démontrer.
La propriété personnelle est le premier principe de tous les autres droits : sans elle, il n’est plus ni propriété mobilière, ni propriété foncière, ni société.
La propriété mobilière n’est, pour ainsi dire, qu’une manière de jouir de la propriété personnelle, ou plutôt c’est la propriété personnelle elle-même considérée dans les rapports qu’elle a nécessairement avec les choses propres à nos jouissances ; on est donc obligé de respecter, de protéger la propriété mobilière, pour ne pas détruire la propriété personnelle, la propriété foncière et la société.
La propriété foncière est établie sur la nécessité dont elle est aux deux premières propriétés, qui sans elles deviendraient nulles : dès qu’il y aurait plus d’hommes que de subsistances, le besoin les mettrait dans le cas de s’entre-égorger, et alors il n’existerait plus ni propriété mobilière, ni propriété personnelle, ni société.
Ces trois sortes de propriétés sont ainsi tellement unies ensemble qu’on doit les regarder comme ne formant qu’un seul tout dont aucune partie ne peut être détachée, qu’il n’en résulte la destruction des deux autres. L’ordre essentiel à toute société est donc de les conserver toutes trois dans leur entier ; il ne peut rien admettre qui puisse blesser aucune de ces trois propriétés. [29] Mais, me dira-t-on, n’y a-t-il pas d’autres institutions sociales qui font nécessairement partie de l’ordre essentiel des sociétés ? Cela est vrai, mais elles n’y prennent place que comme conséquences nécessaires, et non comme premiers principes ; c’est au droit de propriété qu’il faut remonter pour trouver la nécessité de ces institutions.
J’ai dit, par exemple, dans le chapitre précédent, que les sociétés particulières n’avaient pu se former sans des conventions relatives aux devoirs et aux droits qui résultent nécessairement de la propriété foncière, et qu’elles ne pouvaient subsister que par le moyen d’une autorité tutélaire propre à assurer l’exécution constante de ces mêmes conventions. De là s’ensuit que ces conventions ou ces lois (car c’est le nom qu’on doit leur donner), et une autorité tutélaire pour les faire observer, prennent naissance dans la nécessité physique de la propriété foncière : faites disparaître cette propriété, il n’est plus besoin ni de ces lois, ni de l’autorité tutélaire ; il n’existe plus ni ordre social ni véritable société.
L’institution de ces lois et celle de cette autorité, ainsi que toutes les autres institutions qui résultent nécessairement de ces deux premières, ont donc un objet essentiel, un objet déterminé par la propriété foncière elle-même, ou si l’on veut, par la nécessité absolue dont elle est à la société. Il est évident que cet objet essentiel n’est autre chose que de consolider les devoirs et les droits résultants de cette propriété ; ainsi ces deux institutions n’ajoutent rien à l’ordre essentiel ; c’est cet ordre au contraire qui les fait ce qu’elles sont, et pour sa propre conservation.
L’ordre essentiel à toutes les sociétés est l’ordre sans lequel aucune société ne pourrait ni se perpétuer ni remplir l’objet de son institution. La base fondamentale de cet ordre est évidemment le droit de propriété, parce que sans le droit de propriété la société n’aurait aucune consistance, et ne serait d’aucune utilité à l’abondance des productions. Les autres parties de l’ordre essentiel ne peuvent être que des conséquences de ce premier principe ; il est ainsi de toute impossibilité qu’elles ne soient pas parfaitement d’accord avec lui pour tendre vers la plus grande multiplication possible des productions et des hommes, et assurer le plus grand bonheur possible à chacun de ceux qui vivent en société.
[I-50 / 30]
CHAPITRE V.↩
De la liberté sociale ; en quoi elle consiste ; elle n’est qu’une branche du droit de propriété. — Simplicité de l’ordre social par rapport à la liberté. — Ses rapports nécessaires avec l’ordre physique de notre constitution et de la reproduction. — Nécessité dont elle est à l’intérêt général d’une société.
J’ai dit dans le chapitre précédent qu’une grande abondance de productions ne pouvait avoir lieu sans une grande liberté. Cette vérité, dont je n’ai point encore donné la démonstration, est tout à la fois d’une grande importance et d’une grande simplicité. N’est-il pas vrai qu’un droit qu’on n’a pas la liberté d’exercer, n’est pas un droit ? Il est donc impossible de concevoir un droit de propriété sans liberté. Le droit de propriété considéré par rapport au propriétaire, n’est autre chose que le droit de jouir ; or il est évident que le droit de jouir ne peut exister sans la liberté de jouir. De même aussi la liberté de jouir ne peut avoir lieu sans le droit de jouir ; elle le suppose nécessairement ; car sans le droit, la liberté n’aurait aucun objet, à moins d’admettre dans un homme la liberté de jouir des droits d’un autre homme. Mais cette idée renfermerait une contradiction bien évidente ; elle supposerait dans le second des droits qu’il n’aurait point, puisqu’il ne pourrait les exercer ; ils appartiendraient au contraire à celui qui aurait la liberté d’en jouir.
Par la raison que le droit de jouir et la liberté de jouir ne peuvent exister l’un sans l’autre, on doit les regarder comme ne formant qu’une seule et même prérogative qui change de nom, selon la façon de l’envisager. Ainsi on ne peut blesser la liberté sans altérer le droit de propriété, et on ne peut altérer le droit de propriété, sans blesser la liberté.
Il est sensible que par le terme de liberté il ne faut point entendre cette liberté métaphysique qui ne consiste que dans la faculté de former des volontés ; c’est la faculté, la liberté de les exécuter dont il s’agit ici ; car sans la seconde, la première est absolument inutile.
Un homme conserve jusque dans les fers la liberté métaphysique de désirer, de vouloir ; mais il n’a pas alors la liberté physique de l’exécution. Je donne à cette seconde liberté le nom de physique, parce qu’elle ne se réalise que dans les actes physiques qu’elle a pour objet. Or il est évident que celle-ci est la seule qui puisse intéresser la société ; car dans la société tout est physique ; aussi est-ce sur l’ordre physique que l’ordre social est essentiellement et nécessairement établi. [31] Telle est l’idée qu’on doit se former de la liberté sociale, de cette liberté qui est tellement inséparable du droit de propriété, qu’elle se confond avec lui, et qu’il ne peut exister sans elle, comme elle ne peut exister sans lui. En effet qu’on dépouille un homme de tous droits de propriété, je défie qu’on trouve en lui vestiges de liberté : d’un autre côté, supposez quelqu’un qui soit privé de toute espèce de liberté, je défie qu’on puisse dire qu’il lui reste dans le fait et réellement aucun droit de propriété.
C’est donc à juste titre que j’ai dit que sans la liberté sociale on ne pouvait se promettre une grande abondance de productions. L’homme ne se met en action qu’autant qu’il est aiguillonné par le désir de jouir ; or le désir de jouir ne peut agir sur nous, qu’autant qu’il n’est point séparé de la liberté de jouir. Faites maintenant l’application de ces vérités aux opérations qui sont nécessaires pour provoquer une grande abondance de productions : il est certain que cette grande abondance ne peut s’obtenir que par de grandes dépenses et de grands travaux. Mais qui est-ce qui peut porter les hommes à faire ces travaux et ces dépenses, si ce n’est le désir de jouir ? Et que peut sur eux le désir de jouir, s’ils sont privés de la liberté de jouir ?
Ne cherchons point dans les hommes des êtres qui ne soient point des hommes : la nature, comme je l’ai déjà dit, a voulu qu’ils ne connussent que deux mobiles, l’appétit des plaisirs et l’aversion de la douleur : il est donc dans ses vues qu’ils ne soient pas privés de la liberté de jouir ; car sans cette liberté le premier de ces deux ressorts perd toute sa force, il devient absolument nul. Désir de jouir et liberté de jouir, voilà l’âme du mouvement social ; voilà le germe fécond de l’abondance, parce que cet ensemble précieux est le principe de tous les efforts que les hommes font pour se la procurer.
La liberté sociale peut être définie une indépendance des volontés étrangères qui nous permet de faire valoir le plus qu’il nous est possible nos droits de propriété, et d’en retirer toutes les jouissances qui peuvent en résulter sans préjudicier aux droits de propriété des autres hommes. Cette définition nous fait connaître combien est simple l’ordre essentiel des sociétés : nous ne sommes plus embarrassés pour déterminer la portion de liberté dont chaque homme doit jouir ; la mesure de cette portion est toujours évidente ; elle nous est naturellement donnée par le droit de propriété : telle est l’étendue du droit de propriété, telle est aussi l’étendue de la liberté.
Les préjugés dans lesquels les hommes ont vieilli, ne manqueront pas de s’élever contre ce que je dis pour prouver la nécessité physique dont il est que les hommes jouissent en société de la plus grande liberté possible. Mais quels que soient les sophismes qu’ils 93. 32. [32] aient à m’objecter, je peux y répondre par avance en établissant ici deux vérités : la première est que de la liberté il ne peut résulter que du bien ; la seconde que de la diminution de la liberté il ne peut résulter que du mal.
L’appétit des plaisirs ne cesse de nous porter vers le plus grand nombre possible de jouissances. Mais ce plus grand nombre possible n’est point une mesure connue : quelque soit la somme de nos jouissances, nous cherchons toujours à les varier et les augmenter encore. Cette tendance naturelle nous met dans le cas d’avoir besoin des autres hommes ; car ce n’est que par leurs secours que nous pouvons parvenir à cette augmentation de jouissances que nous désirons. Mais pour obtenir ces secours il faut en donner la valeur ; il faut avoir les moyens d’offrir jouissances pour jouissances : ainsi nous ne pouvons jamais nous proposer de jouir seuls et séparément des autres ; il faut nécessairement qu’ils soient associés à l’accroissement de nos jouissances ou que nous renoncions à cet accroissement.
La façon dont nous sommes organisés nous montre donc que dans le système de la nature chaque homme tend perpétuellement vers son meilleur état possible, et qu’en cela même il travaille et concourt nécessairement à former le meilleur état possible du corps entier de la société. Or il est évident qu’il ne peut conserver cette direction si précieuse à l’humanité, qu’autant qu’il jouit de la plus grande liberté ; ainsi la liberté d’un seul est avantageuse à tous ; on ne peut l’en dépouiller, sans lui occasionner des privations qui de proche en proche, viennent, comme un mal contagieux, affecter tous les autres membres de la société.
On s’est imaginé cependant que l’intérêt général demandait qu’on mît des bornes factices à la liberté ; qu’on ne permît pas aux hommes de mettre à profit toutes les jouissances que leur droit de propriété pouvait leur procurer. Cette idée est d’autant plus mal combinée, qu’elle met en opposition l’intérêt général avec les intérêts particuliers. Et qu’est-ce donc que l’intérêt général d’un corps, si ce n’est ce qui convient le mieux aux divers intérêts particuliers des membres qui le composent ? Comment peut-il se faire qu’un corps gagne quand ses membres perdent ? Mais, me dira-t-on peut-être, la valeur des bénéfices que les uns procurent à la société par ce moyen, ne peuvent-ils pas surpasser la valeur des pertes que les autres éprouvent ? Non, cela est impossible ; car, comme on le verra dans la suite de cet ouvrage, ces prétendus bénéfices pour la société sont imaginaires, et les pertes très réelles ; pertes même d’autant plus considérables, qu’elles se multiplient par leurs contre-coups, qui se font sentir jusque dans les parties qu’on a cru favoriser. Tels seront [33] toujours et nécessairement les effets cruels de tout système qui, en blessant le droit de propriété, attaquera l’essence de la société.
Voulez-vous qu’une société parvienne à son plus haut degré possible de richesse, de population, et conséquemment de puissance ? Confiez ses intérêts à la liberté ; faites que celle-ci soit générale ; au moyen de cette liberté, qui est le véritable élément de l’industrie, le désir de jouir irrité par la concurrence, éclairé par l’expérience et l’exemple, vous est garant que chacun agira toujours pour son plus grand avantage possible, et par conséquent concourra de tout son pouvoir au plus grand accroissement possible de cette somme d’intérêts particuliers dont la réunion forme ce qu’on peut appeler l’intérêt général du corps social, ou l’intérêt commun du chef et de chacun des membres dont ce corps est composé.
[I-59 / 34]
CHAPITRE VI.↩
Essence, origine et caractères de l’ordre social ; il est une branche de l’ordre naturel qui est physique ; il est exclusif de l’arbitraire. — L’ordre naturel et essentiel de la société est simple, évident et immuable ; il constitue le meilleur état possible de la société et celui de chacun de ses membres en particulier, mais singulièrement du souverain et de la souveraineté ; il renferme ainsi en lui-même les moyens de sa conservation.
Propriété, et par conséquent sûreté et liberté de jouir, voilà donc ce qui constitue l’essence de l’ordre naturel et essentiel de la société. Cet ordre n’est qu’une branche de l’ordre physique ; et par cette raison, ses principaux caractères sont de n’avoir rien d’arbitraire ; d’être au contraire simple, évident, immuable, le plus avantageux possible au corps entier d’une société, et à chacun de ses membres en particulier.
Il ne faut pas confondre l’ordre surnaturel avec l’ordre naturel : le premier est l’ordre des volontés de Dieu, connues par la révélation, et il n’est sensible qu’à ceux auxquels il a bien voulu le manifester. Le second au contraire se fait connaître à tous les hommes par le secours des seules lumières de la raison. L’autorité de cet ordre est dans son évidence, et dans la force irrésistible avec laquelle l’évidence domine et assujettit nos volontés.
L’ordre naturel est l’accord parfait des moyens physiques dont la nature a fait choix pour produire nécessairement les effets physiques qu’elle attend de leurs concours. J’appelle ces moyens, des moyens physiques, parce que tout est physique dans la nature ; ainsi l’ordre naturel, dont l’ordre social fait partie, n’est, et ne peut être autre chose que l’ordre physique.
Si quelqu’un faisait difficulté de reconnaître l’ordre naturel et essentiel de la société pour une branche de l’ordre physique, je le regarderais comme un aveugle volontaire, et je me garderais bien d’entreprendre de le guérir. En effet, c’est fermer les yeux à la lumière que de ne pas voir que l’institution de la société est le résultat d’une nécessité physique ; qu’elle se forme par un concours de causes physiques ; qu’elle est composée d’êtres physiques ; qu’elle agit et se maintient par des moyens physiques ; que les objets de son établissement sont physiques ; que les effets qui lui sont propres sont physiques ; qu’ainsi son ordre primitif et essentiel est physique ; car ce n’est que par les lois de l’ordre physique, que des causes ou des moyens physiques peuvent être liés à leurs effets physiques. [35] Cette vérité une fois reconnue, il en résulte évidemment que l’ordre social n’a rien d’arbitraire ; qu’il n’est point l’ouvrage des hommes ; qu’il est au contraire institué par l’auteur même de la nature, comme toutes les autres branches de l’ordre physique, qui dans toutes ses parties est absolument et toujours indépendant de nos volontés ; par conséquent que les lois immuables de cet ordre physique doivent être regardées comme étant, par rapport à nous, la raison primitive et essentielle de toute législation positive et de toutes les institutions sociales.
La simplicité et l’évidence de cet ordre social sont manifestes pour quiconque veut y faire la plus légère attention : n’est-il pas manifestement évident qu’il nous est physiquement impossible de vivre sans subsistances ? N’est-il pas manifestement évident que les hommes se multipliant suivant le cours naturel de l’ordre physique, dans les climats qui leur sont propres, il est physiquement impossible qu’ils ne manquent pas de subsistances, s’ils ne les multiplient par la culture ? N’est-il pas ainsi manifestement évident que toutes les institutions sociales requises pour que la culture puisse s’établir, deviennent d’une nécessité physique, par conséquent que la propriété foncière, qui donne le droit de cultiver, est d’une nécessité physique ; que la propriété mobilière, qui assure la jouissance de la récolte, est d’une nécessité physique ; que la propriété personnelle, sans laquelle les deux autres seraient nulles, est d’une nécessité physique ; que les travaux et les avances, sans lesquels les terres resteraient incultes, sont d’une nécessité physique ; que la liberté de jouir, sans laquelle ces travaux et ces avances n’auraient pas lieu, est d’une nécessité physique ; que la sûreté constante, sans laquelle le droit de propriété n’aurait aucune consistance, est d’une nécessité physique ; que les institutions sociales, sans lesquelles il n’y aurait ni sûreté ni liberté de jouir, sont d’une nécessité physique, d’une nécessité relative à l’ordre physique de la multiplication des subsistances, et généralement de tous les effets physiques qui, par le moyen de cette multiplication, doivent naturellement résulter de la société.
On peut donc dire avec vérité, qu’il n’est rien de plus simple, ni de plus évident que les principes fondamentaux et invariables de l’ordre naturel et essentiel des sociétés : pour les connaître dans leur source naturelle, dans leur essence, et même dans les conséquences pratiques qui en résultent, il ne faut que connaître l’ordre physique : dès que cet ordre est devenu évident, ces mêmes principes et leurs conséquences pratiques deviennent évidents pareillement. Aucune puissance humaine ne s’avisera jamais de faire des lois positives pour ordonner de semer dans la saison propre à sa récolte, et de récolter dans la saison propre à semer. [36] Il en sera de même de toutes les autres parties de l’ordre physique : sitôt qu’elles seront évidentes, leur évidence déterminera nécessairement et invariablement l’ordre social que les lois positives doivent adopter, pour ne pas préjudicier à la nation et encore plus au souverain ; je dis que cette évidence deviendra nécessairement législatrice, parce qu’alors on sera convaincu que cet ordre constitue le meilleur état possible de tous ceux qui lui sont assujettis ; que c’est de lui seul enfin qu’on doit attendre tout ce qui peut être un objet d’ambition pour les souverains et pour leurs sujets.
J’ai déjà dit qu’en général le plus grand bonheur possible pour le corps social consistait dans la plus grande abondance possible d’objets propres à nos jouissances, et dans la plus grande liberté possible d’en profiter. J’ai fait voir que cette grande abondance de jouissances était un effet nécessaire de l’établissement du droit de propriété, et que ce n’était que dans cet établissement qu’il fallait la chercher : or il est évident que ce qui procure au corps social son meilleur état possible, procure aussi le même avantage à chacun de ses membres en particulier, puisque chacun d’eux est appelé par l’ordre même, à partager dans cette somme de bonheur qui leur appartient en commun.
Pour prouver cette dernière proposition, il suffit de faire observer qu’une grande abondance de productions ne peut acquérir une grande utilité, que par le moyen de l’industrie, et qu’il est nécessaire à une société, d’avoir une classe industrieuse qui prête ses secours à la classe cultivatrice, et qui achète ainsi le droit de participer à l’abondance des récoltes. Il est donc évident que les productions ne peuvent se multiplier pour ceux qui en sont les premiers propriétaires, qu’elles ne se multiplient en même temps pour tous les autres hommes qui travaillent à leur procurer les moyens de varier et d’augmenter leurs jouissances ; qu’ainsi l’aisance et le bonheur de ceux-ci s’accroît en raison de l’aisance et du bonheur de ceux-là. Il est évident enfin que la richesse des récoltes annuelles est la mesure de la population, et de tout ce qui constitue la force politique d’une société ; par conséquent que l’accroissement de ses richesses à leur plus haut degré possible est ce qui, dans l’ordre politique, établit son meilleur état possible, c’est-à-dire sa plus grande puissance, et sa plus grande sûreté possibles.
Mais un article bien important à remarquer, c’est que le même ordre qui forme le meilleur état possible de la société prise individuellement, et de chaque citoyen en particulier, est bien plus avantageux encore au souverain, à ce chef dans les mains duquel l’autorité tutélaire est déposée avec tous les droits qui s’y trouvent nécessairement attachés. Premièrement, en sa qualité de souverain, il est, comme je le démontrerai dans un autre moment, co-propriétaire du [37] produit net des terres de sa domination : sous ce point de vue on peut le considérer comme étant, dans son royaume, le plus grand propriétaire foncier ; comme prenant la plus grande part dans l’abondance des productions ; comme ayant ainsi le plus grand intérêt personnel à la conservation de l’ordre qui est la source de cette abondance.
En second lieu, cet intérêt commun du souverain comme copropriétaire, s’accroît encore en lui comme souverain, attendu que c’est à sa souveraineté que ce droit de co-propriétaire est attaché ; et que la puissance nationale lui est bien plus nécessaire pour la conservation de sa souveraineté, qu’elle ne l’est à chacun de ses sujets pour la conservation de leurs propriétés particulières.
Une troisième et dernière considération, que la seconde semble naturellement amener, c’est qu’une nation gouvernée par l’ordre naturel et essentiel de la société, en a nécessairement une connaissance évidente, et par conséquent voit évidemment qu’elle jouit de son meilleur état possible. Or il ne se peut pas que ce coup d’œil ne réunisse toutes les volontés et toutes les forces de la nation au soutien de ce même ordre, et conséquemment pour défendre et perpétuer la souveraineté dans la main du chef qui n’emploie son autorité que pour le maintenir. Il est certain qu’une obéissance contrainte et servile ne ressemble point à celle qui est dictée par l’amour et par un grand intérêt qu’on trouve à obéir : la première n’accorde que ce qu’elle ne peut refuser ; la seconde vole au-devant du commandement, et ses efforts vont toujours beaucoup au-delà de ce qu’on croyait pouvoir exiger d’elle.
Dans un gouvernement conforme à l’ordre naturel et essentiel des sociétés, tous les intérêts et toutes les forces de la nation viennent se réunir dans le souverain, comme dans leur centre commun ; celles-ci lui sont tellement propres et personnelles, que sa volonté seule suffit pour les mettre en action ; on peut dire ainsi que sa force est dans sa volonté. Mais dans un gouvernement factice et contraire à cet ordre essentiel, l’autorité du souverain paraît être une autorité étrangère, parce que le souverain lui-même paraît être étranger : il ne peut commander, qu’autant qu’il est armé d’une force factice autre que celle de la nation, attendu que c’est moins à lui qu’à cette force empruntée, que la nation obéit.
Pour faire comprendre la différence énorme qui se trouve entre ces deux manières de gouverner, il suffit de faire observer que dans l’ordre politique, c’est toujours la partie la plus faible qui gouverne la partie la plus forte, et que la force de celui qui commande, ne consiste réellement que dans les forces réunies de ceux qui lui obéissent. Mais cette réunion de leurs forces suppose toujours et nécessairement [38] la réunion de leurs volontés ; réunion qui ne peut avoir lieu, ou du moins être constante, qu’autant que chacun est intimement convaincu que son obéissance est nécessaire pour lui assurer la jouissance de son meilleur état possible.
Ainsi dans un gouvernement institué suivant les lois de l’ordre, les richesses et les forces de la nation se trouvent être dans leur plus haut degré possible, et naturellement elles sont toutes dans la main du souverain ; sa puissance est à lui ; elle réside en lui ; au lieu que dans un gouvernement d’un genre différent, les forces de la nation sont moins à la disposition du souverain, qu’aux ordres de ceux qui lui louent leur ministère, et lui vendent ainsi les moyens de se faire obéir par la nation : alors sa puissance précaire, incertaine et chancelante n’est au fond qu’une véritable dépendance : il est lui-même dans des fers qu’il n’oserait entreprendre de briser.
D’après ce parallèle, il est aisé de juger combien le souverain en particulier est intéressé à la conservation de l’ordre naturel et essentiel de la société. Cet ordre qui constitue le meilleur état possible du corps social, le meilleur état possible de chacun de ses membres, le meilleur état possible de la souveraineté, le meilleur état possible du souverain, sous quelques rapports qu’on l’envisage, renferme donc en lui-même le principe de sa durée : il suffit qu’il soit connu pour qu’il s’établisse, et qu’il soit établi pour qu’il se perpétue : tous les intérêts, par conséquent toutes les forces qui se réunissent en sa faveur, répondent à jamais de sa conservation ; et à ce trait nous devons reconnaître encore l’ordre social comme étant une branche de l’ordre naturel et universel ; car le propre de l’ordre est de se perpétuer de lui-même, par la sagesse et la puissance d’un enchaînement qui assujettit les causes à produire toujours les mêmes effets, et les effets à devenir causes à leur tour.
[I-72 / 39]
CHAPITRE VII.↩
Suite du chapitre précédent : exposition sommaire de la théorie de l’ordre. — Simplicité et évidence non seulement de ses principes, mais encore de leurs conséquences. — La connaissance des premiers principes de l’ordre nous suffit pour que toute pratique qui contredit une seule de ses conséquences y soit pour nous un désordre évident.
Pour mieux caractériser encore la simplicité et l’évidence de l’ordre essentiel des sociétés, je crois devoir rassembler ici sous un même point de vue les premiers principes de cet ordre, et les conséquences qui en résultent nécessairement, sans cependant me laisser entraîner dans le détail de toutes les pratiques, de toutes les institutions sociales dont ces mêmes conséquences établissent la nécessité. L’exposé de cette théorie de l’ordre essentiel achèvera de prouver qu’il n’a rien de mystérieux, rien qui ne soit à la portée de tout homme qui voudra le méditer avec quelque attention.
En effet qui sont ceux qui ne sentent ni ne comprennent qu’ils sont nés avec le devoir et le droit de pourvoir à leur conservation ? Que la propriété personnelle est un droit naturel en eux, un droit qui est nécessairement donné à tout ce qui respire, un droit qui est essentiel à leur existence, et dont ils ne peuvent être dépouillés sans injustice, parce qu’il est absolu, comme le devoir même sur lequel il est établi. Qui sont ceux qui ne sentent ni ne comprennent, que si ce droit les met dans un état de guerre nécessaire avec les brutes, c’est parce qu’entre l’espèce humaine et les brutes aucun traité ne peut avoir lieu ; mais qu’il n’en est pas ainsi des hommes entre eux ; qu’il leur importe à tous de ne point se rendre ennemis les uns des autres en violant un droit qui leur est à tous également acquis ; que cet intérêt naturel et commun leur impose une obligation naturelle et commune de respecter réciproquement dans les êtres de leur espèce ce premier droit de propriété ; que par la force de cet intérêt commun, il subsiste naturellement entre les hommes une sorte de société universelle et tacite, dont toutes les lois dérivent de la propriété personnelle, et dont l’objet est que chacun jouisse librement de cette propriété.
Voila donc déjà le premier principe de l’ordre social dont la connaissance évidente n’exige de nous aucun effort de raison : la propriété personnelle est d’une justice et d’une nécessité qui se rendent sensibles pour tous les hommes ; or il est certain que dès qu’ils tiennent ce premier principe de l’ordre, il leur est facile de saisir le second ; de sentir et de comprendre la justice et la nécessité de la [40] propriété mobilière, qui n’est qu’un accessoire de la personnelle ; que de là, ils arrivent naturellement à sentir et comprendre la justice et la nécessité de la propriété foncière, qui prend naissance dans les deux premières propriétés ; qu’enfin ils ont tout ce qu’il leur faut pour sentir et comprendre la justice et la nécessité de la liberté sociale, de cette liberté de jouir, sans laquelle on voit s’évanouir tous droits de propriété, et par conséquent toute société. Certainement vous n’en trouverez pas un qui ne conçoive très bien qu’il ne doit point avoir la liberté de jouir des droits des autres ; que dans chaque homme le droit de jouir et la liberté de jouir sont inséparables ; et qu’ainsi la propriété est la mesure de la liberté, comme la liberté est la mesure de la propriété.
De ces premiers principes passons aux conséquences ; nous y trouverons la même simplicité, la même évidence. Sitôt qu’on a compris la nécessité de la propriété foncière, on est forcé naturellement de convenir que cette propriété doit nécessairement donner celle des récoltes ; qu’il est d’une nécessité absolue que la sûreté sociale de cette double propriété soit solidement instituée ; en conséquence, que les forces de la société se réunissent pour l’établir.
Qu’il est d’une nécessité absolue que la sûreté des récoltes soit payée à ceux qui la procurent ; et que le devoir de les protéger assure aux protecteurs le droit de les partager entre eux, les cultivateurs et les propriétaires fonciers.
Qu’il est d’une nécessité absolue qu’il soit institué des lois tant par rapport à la manière d’établir la sûreté des récoltes, que pour régler le partage qui doit en être fait entre ceux qui les font naître par leurs dépenses, et les autres hommes sans le secours desquels ces dépenses ne seraient point faites, faute de sûreté pour leurs produits.
Qu’il est d’une nécessité absolue que ce partage soit réglé, de façon que les produits engagent à faire les dépenses nécessaires pour les faire renaître ; conséquemment que les hommes ne voient rien de mieux pour leurs intérêts particuliers, que de s’occuper du défrichement et de la culture des terres, ainsi que des moyens de les fertiliser. Qu’il est d’une nécessité absolue que les proportions qui doivent être observées dans ce partage, soient stables et permanentes, afin que d’un côté le prix de la sûreté des récoltes soit toujours payé par les propriétaires, et que d’un autre côté les autres hommes ne détruisent pas la propriété foncière, et ne tarissent pas ainsi la source primitive des récoltes, en empiétant arbitrairement sur les droits de cette propriété.
Qu’il est d’une nécessité absolue que les droits de propriété aient des bornes connues, qui ne permettent à qui que ce soit d’étendre arbitrairement les siens aux dépens de ceux des autres ; car cet état 123.41. [41] serait un état de guerre destructif de la société, parce qu’il le serait de la propriété.
Qu’il est d’une nécessité absolue que la liberté de jouir ne soit ainsi limitée dans chaque homme, que par le droit de propriété et la liberté des autres hommes ; et qu’à cet égard il ne soit pas possible à l’arbitraire de jamais s’introduire dans les prétentions.
Qu’il est d’une nécessité absolue que des lois positives constatent les devoirs et les droits réciproques des hommes, et les consolident d’une telle manière, que la propriété et la liberté ne puissent jamais être blessées impunément.
Qu’il est d’une nécessité absolue que ces lois n’aient elles-mêmes rien d’arbitraire, et ne soient évidemment que l’expression de la justice par essence, afin que cette évidence rende publique la nécessité de la soumission à ces lois, et qu’elles ne soient pas elles-mêmes coupables des désordres qu’elles se proposeraient de prévenir.
Qu’il est d’une nécessité absolue que ces lois soient immuables, parce que la justice par essence est immuable ; qu’elles soient encore si simples et si claires dans leur énonciation, que l’arbitraire ne puisse se glisser dans la manière de les interpréter ou d’en faire l’application.
Qu’il est d’une nécessité absolue que la plénitude de l’autorité soit tellement acquise à ces lois, que dans aucun temps leur observation ne puisse dépendre d’aucune volonté arbitraire, sans quoi elles cesseraient d’être des lois ; les devoirs cesseraient d’être des devoirs, les droits d’être des droits, et la société d’être une société.
Qu’il est d’une nécessité absolue qu’elles aient pour organe des magistrats, qui n’ayant d’autre autorité que celle des lois, ne puissent avoir d’autres volontés, et qui soient ainsi toujours dans l’impossibilité de parler autrement que les lois.
Qu’il est d’une nécessité absolue que ces magistrats ne puissent, sous aucun prétexte, trahir leur ministère, et s’écarter de la fidélité inviolable que, par état, ils doivent aux lois, et d’une façon plus particulière encore que tous les autres sujets des lois.
Qu’il est d’une nécessité absolue que pour le maintien de l’autorité des lois, elles soient armées d’une force coercitive, et qu’à cet effet il existe une puissance tutélaire et protectrice, dont la force, toujours supérieure, soit le garant de l’observation invariable des lois.
Qu’il est d’une nécessité absolue que cette force supérieure soit unique dans son espèce, par la raison que la supériorité qui lui est essentielle est absolument exclusive de toute égalité.
Qu’il est d’une nécessité absolue que cette supériorité de force soit établie sur un fondement inébranlable ; par conséquent que le [42] principe constitutif de cette force soit de nature à ne jamais permettre qu’elle puisse se décomposer ; qu’ainsi ce principe ne peut rien admettre qui ne soit évident ; tout ce qui ne l’est pas, étant nécessairement sujet à changer, parce qu’il est nécessairement arbitraire.
Qu’il est enfin d’une nécessité absolue que cette puissance tutélaire et protectrice des lois ne puisse jamais devenir destructive des lois ; qu’ainsi il faut que tout soit disposé pour que ses plus grands intérêts soient toujours et évidemment inséparables de l’observation des lois, et que la force irrésistible de cette évidence la tienne dans l’heureuse impossibilité d’avoir d’autres volontés que celles des lois.
Je ne porterai pas plus loin quant à présent les conséquences qui résultent successivement de la propriété personnelle ; celles qui viennent de s’offrir naturellement à nous, et qui sont susceptibles d’être saisies par tous ceux auxquels on les présentera, forment ce que nous pouvons nommer la théorie de l’ordre essentiel des sociétés, et sont une preuve bien convaincante que cet ordre est simple et évident. Cette théorie a deux grands avantages : le premier est qu’elle est suffisante pour nous faire connaître toutes les institutions sociales qui conviennent à ce même ordre essentiel ; le second est que ces conséquences sont tellement enchaînées les unes aux autres, et tellement liées aux premiers principes de l’ordre, qu’on ne peut, dans la pratique, contrarier aucune d’entre elles, que le désordre ne soit aussitôt évident pour tous ceux qui connaissent seulement ces premiers principes. En effet quel que soit l’abus qui blesse une seule de ces conséquences, il est impossible qu’il ne fasse violence au droit de propriété et à la liberté ; or il est impossible aussi que ce désordre puisse avoir lieu, sans qu’il soit évident aux yeux de quiconque sait que la propriété et la liberté sont le fondement de l’ordre essentiel des sociétés.
[I-82 / 43]
CHAPITRE VIII.↩
Des moyens nécessaires pour établir l’ordre et le perpétuer ; ils sont tous renfermés dans une connaissance suffisante de l’ordre. — L’évidence est le premier caractère de cette connaissance, et sa publicité est le second. — Nécessité de l’instruction publique, des livres doctrinaux dans ce genre, et de la plus grande liberté possible dans l’examen et la contradiction.
Il est sensible que l’ordre naturel et essentiel des sociétés ne peut s’établir s’il n’est suffisamment connu ; mais aussi par la raison qu’il constitue notre meilleur état possible, il est sensible encore que sitôt qu’il est connu, son établissement doit être l’objet commun de l’ambition des hommes ; qu’il s’établit alors nécessairement, et qu’une fois qu’il est établi, il doit nécessairement se perpétuer. Je dis qu’il s’établit et se perpétue nécessairement, parce que l’appétit des plaisirs, ce mobile si puissant qui est en nous, tend naturellement et toujours vers la plus grande augmentation possible de jouissances, et que le propre du désir de jouir est de saisir les moyens de jouir. Les hommes ne peuvent donc connaître leur meilleur état possible, que toutes les volontés et toutes les forces ne se réunissent pour se le procurer et se l’assurer. Ainsi ne croyez pas que pour établir cet ordre essentiel, il faille changer les hommes et dénaturer leurs passions ; il faut au contraire intéresser leurs passions, les associer à cet établissement ; et pour y réussir, il suffit de les mettre dans le cas de voir évidemment que c’est dans cet ordre seulement qu’ils peuvent trouver la plus grande somme possible de jouissances et de bonheur.
Mais l’ordre naturel et essentiel des sociétés, considéré dans toutes les institutions sociales qui résultent successivement de la nécessité absolue de maintenir la propriété et la liberté, est un ensemble parfait, composé de différentes parties qui sont toutes également nécessaires les unes aux autres ; nous ne pouvons rien en détacher, ni rien y ajouter qu’à son préjudice et au nôtre. Il est donc certain qu’il ne peut être réputé suffisamment connu d’une société, qu’autant qu’il l’est dans toutes ses branches, et dans tous les rapports qu’elles ont entre elles ; qu’ainsi le premier caractère d’une connaissance suffisante de l’ordre est d’être explicite et évidente ; car c’est précisément dans l’harmonie parfaite de ces rapports, dans la justesse des moyens qui les enchaînent et les subordonnent les uns aux autres, que réside l’évidence de l’ordre : par conséquent la connaissance de l’ordre, ne peut être qu’une connaissance évidente, parce [44] qu’elle ne peut être qu’une connaissance explicite d’un enchaînement évident.
De même que tout ce qui n’est pas vérité n’est qu’erreur, de même aussi tout ce qui n’est pas évidence n’est qu’opinion ; et tout ce qui n’est qu’opinion est arbitraire et sujet au changement. Il est donc évident que de simples opinions ne peuvent suffire à l’établissement de l’ordre naturel et essentiel des sociétés : on ne peut élever un édifice solide sur un sable mouvant ; et il est impossible qu’un ordre qui ne comporte rien d’arbitraire, qui est et doit être immuable, puisse avoir pour base un principe arbitraire, et d’autant plus inconstant, que quelque sage qu’on puisse supposer une opinion, dès qu’elle n’est point évidente, elle n’est jamais qu’une opinion ; une autre opinion, fût-elle extravagante, peut la combattre et la renverser.
Cette dernière proposition indique clairement ce que j’entends ici par le mot d’opinion : je n’ai nul égard à la justesse ou à la fausseté des idées qui concourent à la former ; quelle que soit une croyance, une façon de penser, je l’appelle opinion, dès qu’elle n’est point le produit de l’évidence : ainsi l’opinion est ici l’opposé de l’évidence, et rien de plus.
Entre la certitude et le doute il n’y a point de milieu ; et il ne peut y avoir de certitude sans l’évidence : quel que soit l’objet de la certitude, si nous n’avons nous-même une connaissance évidente de cet objet, il faut du moins que nous ne puissions pas douter qu’il est évident pour ceux sur les témoignages desquels nous fondons notre certitude. Ainsi c’est toujours de l’évidence que la certitude résulte ou médiatement ou immédiatement : ou elle est dans l’évidence qui nous est propre, ou elle tient à l’évidence qui est dans les autres.
Cette observation nous montre bien clairement que l’ordre naturel et essentiel des sociétés ne peut jamais s’établir parmi des hommes qui ne seraient pas parvenus à en avoir une connaissance évidente ; et qu’il n’y a qu’une connaissance évidente qui puisse écarter le doute, l’incertitude, l’arbitraire et l’inconstance qu’il est impossible d’accorder avec l’immutabilité de cet ordre naturel et essentiel.
Le second caractère de la connaissance de l’ordre est la publicité ; et cela résulte de ce que l’ordre, comme je viens de le dire, ne peut être solidement établi, qu’autant qu’il est suffisamment connu. Si dans une société il ne se trouvait que quelques hommes seulement qui eussent une connaissance évidente de l’ordre, tant que la multitude resterait dans des opinions contraires, il serait impossible à l’ordre de gouverner ; il commanderait en vain, il ne serait point obéi. [45] De quelque manière qu’une société se partage entre la connaissance évidente de l’ordre et l’ignorance, toujours est-il vrai que si la première classe, la classe éclairée, n’est pas physiquement la plus forte, elle ne pourra dominer la seconde et l’assujettir constamment à l’ordre ; qu’enfin l’autorité de cette première classe ne pouvant alors se maintenir qu’en raison de la force physique qui lui est propre, son état sera perpétuellement un état de guerre intestine d’une partie de la nation contre une autre partie de la nation.
Par le mot de guerre intestine je ne désigne pas seulement celle qui se fait à main armée et à force ouverte ; mais j’entends parler encore de ces brigandages clandestins et déguisés sous des formes légales, de ces pratiques ténébreuses et spoliatrices qui immolent autant de victimes que l’artifice peut leur en ménager ; de tous les désordres en un mot, qui tendent à rendre tous les intérêts particuliers ennemis les uns des autres, et entretiennent ainsi parmi les membres d’un même corps politique, une guerre habituelle d’intérêts contradictoires, dont l’opposition et les efforts brisent tous les liens de la société. Cette situation est d’autant plus affreuse, qu’à l’exception de la force supérieure et dominante de l’évidence, il n’est point dans la nature de force égale à celle de l’opinion ; elle est terrible dans ses écarts ; et il n’est aucuns moyens par lesquels on puisse s’assurer de la contenir toujours dans le devoir, dès qu’elle est livrée à sa propre inconstance et à la séduction.
Je ne prétends pas cependant qu’il faille que tous les membres d’une société, sans aucune exception, aient une connaissance également explicite de tous les rapports que toutes les différentes branches de l’ordre ont entre elles. Je veux dire seulement que l’ordre ne peut complètement et solidement s’établir, qu’autant qu’on ne néglige aucune des institutions sociales qui sont nécessaires à sa conservation ; que toutes ces différentes institutions ne peuvent être adoptées que d’après la connaissance explicite qu’on a de leur enchaînement et de leur nécessité ; que cette connaissance explicite ne peut produire son effet, qu’autant qu’elle est assez publique, pour que la masse des volontés et des forces qu’elle réunit, forme une force absolument dominante dans la société.
Prenez garde que par le terme d’une force absolument dominante, je n’entends point caractériser cet état violent d’une domination établie sur la seule supériorité de la force physique. Cette force dominante dont il s’agit ici a l’avantage de n’avoir à vaincre aucune opposition : les hommes qui n’ont point, comme elle, une connaissance explicite de l’ordre considéré dans tous ses rapports, n’ont point la prétention de lui résister et de gouverner ; il leur suffit que dans les règles qu’elle établit, ils ne voient rien de contradictoire [46] avec les premiers principes de l’ordre, et les droits qui en résultent évidemment et invariablement pour chacun d’eux en particulier ; d’ailleurs ils ne peuvent jamais manquer de se rallier d’eux-mêmes à cette force dominante, parce qu’il leur est impossible de ne pas reconnaître la sagesse et la nécessité de ses institutions, dans les bons effets qu’elles produisent nécessairement en faveur de la propriété et de la liberté.
La publicité que doit avoir la connaissance évidente de l’ordre, nous conduit à la nécessité de l’instruction publique. Quoique la foi soit un don de Dieu, une grâce particulière, et qu’elle ne puisse être l’ouvrage des hommes seuls, on n’en a pas moins regardé la prédication évangélique comme nécessaire à la propagation de la foi : pourquoi donc n’aurait-on pas la même idée de la publication de l’ordre, puisque cette publication n’a pas besoin d’être aidée par des grâces et des lumières surnaturelles. L’ordre est institué pour tous les hommes, et tous les hommes naissent pour être soumis à l’ordre ; il est donc dans l’ordre qu’ils soient tous appelés à la connaissance de l’ordre ; aussi ont-ils tous une portion suffisante de lumières naturelles par le moyen desquelles ils peuvent s’élever à cette connaissance.
Par la raison qu’il est dans l’ordre que tous les hommes connaissent l’ordre, il est dans l’ordre aussi qu’ils apprennent tous à le connaître ; or ils ne peuvent y parvenir que par le moyen de l’instruction. Personne n’ignore combien l’intelligence d’un homme a besoin d’être aidée par celles des autres hommes : tant qu’elle reste absolument isolée, elle est sans force, sans vigueur ; elle languit comme une plante privée de toute chaleur et séparée des principes de la végétation.
Je n’entrerai point ici dans les détails des établissements nécessaires à l’instruction : je me contenterai de dire qu’ils font partie de la forme essentielle d’une société, et qu’ils ne peuvent être trop multipliés, parce que l’instruction ne peut être trop publique. J’ajouterai cependant que l’instruction verbale ne suffit pas ; qu’il faut des livres doctrinaux dans ce genre, et qui soient dans les mains de tout le monde. Ce secours est d’autant plus nécessaire, qu’il est sans inconvénient ; car l’erreur ne peut soutenir la présence de l’évidence : aussi la contradiction n’est-elle pas moins avantageuse à l’évidence, que funeste à l’erreur, qui n’a rien tant à redouter que l’examen.
Ce que je dis ici sur la nécessité des livres que j’appelle doctrinaux, et sur la liberté qui doit régner à cet égard, est pris dans la nature même de l’ordre et de l’évidence qui lui est propre : ou l’ordre est parfaitement et évidemment connu, ou il ne l’est pas ; au premier cas, son évidence et sa simplicité ne permettent pas qu’il puisse se [47] former des hérésies sur ce qui le concerne ; au second cas, les hommes ne peuvent arriver à cette connaissance évidente que par le choc des opinions : il est certain qu’une opinion ne peut s’établir que sur les ruines de toutes celles qui lui sont contraires ; il est certain encore que toute opinion qui n’a pas l’évidence pour elle, sera contredite jusqu’à ce qu’elle soit ou détruite, ou évidemment reconnue pour une vérité, auquel cas elle cessera d’être une simple opinion pour devenir un principe évident. Ainsi dans la recherche des vérités susceptibles d’une démonstration évidente, le combat des opinions doit nécessairement conduire à l’évidence, parce que ce n’est que par l’évidence qu’il peut être terminé.
Si quelqu’un s’avisait d’écrire pour faire croire aux hommes qu’ils peuvent se passer de subsistances ; qu’ils doivent faire des ouvrages sans matières premières ; que changer de lieu c’est se multiplier, ou quelque autre sottise semblable, il serait fort inutile que l’autorité politique s’employât pour empêcher qu’un tel livre fît quelque sensation dans la société : aussi, loin de s’en mettre en peine, se reposerait-on sur l’évidence des vérités contraires à ces erreurs, persuadé qu’elle se suffirait à elle-même, et qu’elle triompherait sans violence de tous les efforts ridicules qu’on voudrait lui opposer.
Il est tellement nécessaire de laisser au corps entier de la société la plus grande liberté possible de l’examen et de la contradiction ; il est tellement nécessaire d’abandonner l’évidence à ses propres forces, qu’il n’est aucune autre force qui puisse les suppléer : une force physique, quelque supérieure qu’elle soit, ne peut commander qu’aux actions, et jamais aux opinions. Ce qui se passe journellement est une preuve sensible de cette vérité : bien loin que nos forces physiques puissent quelque chose sur notre opinion, c’est au contraire notre opinion qui peut tout sur nos forces physiques ; c’est elle qui en dispose et qui les met en mouvement. La force commune ou sociale, qu’on nomme force publique, ne se forme que par une réunion de plusieurs forces physiques, ce qui suppose toujours et nécessairement une réunion de volontés, qui ne peut avoir lieu qu’après la réunion des opinions, quelles qu’elles soient. Ce serait donc renverser l’ordre et prendre l’effet pour la cause, que de vouloir donner à la force publique le pouvoir de dominer les opinions, tandis que c’est de la réunion des opinions qu’elle tient son existence et son pouvoir, et qu’ainsi elle ne peut avoir de la consistance, qu’en raison de celle qui se trouve dans les opinions même ; je veux dire, qu’autant qu’elles ne sont point de simples opinions, mais bien des principes devenus immuables parmi les hommes, parce qu’ils leur sont devenus évidents.
[I-95 / 48]
CHAPITRE IX.↩
Suite du chapitre précédent. — De l’évidence ; définition de l’évidence ; ses caractères essentiels et ses effets. — Évidence des arguments qui prouvent la nécessité de la plus grande liberté possible dans l’examen et la discussion de l’évidence. — Force de l’opinion : ses dangers dans un état d’ignorance.
Quelques observations sur l’évidence, sur son caractère et ses effets, ainsi que sur la force et le danger de l’opinion dans un état d’ignorance, achèveront de mettre dans tout son jour, ce que je viens de dire sur la nécessité de l’instruction publique, et sur la liberté avec laquelle les idées que chacun se forme de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, peuvent être exposées et contredites.
L’évidence, dit un de nos plus célèbres modernes, est un discernement clair et définitif des sentiments que nous avons, et de toutes les perceptions qui en dépendent : tel est l’avantage qu’elle a sur l’erreur, que celui qui se trompe ne connaît point la cause de la certitude qui résulte de l’évidence, et que celui qui la possède, connaît tout à la fois et la raison de sa certitude, et celle de l’erreur. Non seulement son caractère essentiel est d’être à l’épreuve de tout examen, mais l’examen même ne sert encore qu’à la manifester davantage, qu’à la rendre plus sensible, qu’à lui donner une force plus souverainement dominante, au lieu qu’un examen suffisant détruit toute prévention, tout préjugé, et établit à leur place, ou l’évidence, ou du moins le doute, lorsque les choses qu’on examine surpassent nos connaissances.
Dire que l’évidence est à l’épreuve de tout examen, c’est assurément une vérité évidente par elle-même, et qui prouve que la liberté d’examiner, de contredire l’évidence, est toujours et nécessairement sans aucun inconvénient.
Dire qu’un examen suffisant détruit toute prévention, tout préjugé, c’est encore une vérité manifestement évidente, qui établit, comme la première, la nécessité de la liberté qui doit régner dans l’examen et dans la contradiction ; car un examen ne peut être suffisant qu’autant que toutes les raisons de douter sont épuisées.
Dire que l’examen ne sert qu’à donner à l’évidence une force plus souverainement dominante, c’est une conséquence évidente et nécessaire des vérités antécédentes, et qui démontre que la liberté de l’examen et de la contradiction ne peut tendre qu’à nous soumettre à l’ordre d’une manière plus religieuse et plus absolue.
Dire enfin qu’un examen suffisant établit l’évidence à la place de l’erreur, toutes fois que les choses qu’on examine ne surpassent point nos [49] connaissances, c’est une dernière vérité résultante encore évidemment de celles qui précèdent, et d’après laquelle il devient évident que cette même liberté nous conduit nécessairement à la connaissance évidente et publique de l’ordre qui constitue le meilleur état possible d’une société ; car cet ordre naturel et essentiel n’a rien qui surpasse nos connaissances : nous sommes faits pour lui, pour le connaître et l’observer, comme il est fait pour nous, pour nous procurer les plus grands biens que nous puissions désirer.
C’est ainsi qu’en nous développant les caractères essentiels de l’évidence, le génie créateur que je viens de citer, nous démontre en quatre mots, la nécessité de la plus grande liberté possible dans la recherche et la discussion de la vérité. En appliquant à l’évidence particulière de l’ordre social ce qu’il dit de l’évidence en général, on aperçoit à l’instant combien cette même liberté et l’instruction publique sont nécessaires dans une société : pour s’en convaincre il suffit de considérer quelle serait notre ignorance sans les secours de l’instruction, et quelle est après l’instruction la force irrésistible de l’évidence, l’empire absolu qu’elle prend sur nous. Mais comme il n’est personne qui ne connaisse par lui-même le pouvoir dominant de l’évidence, personne qui n’éprouve qu’elle nous subjugue au point de faire naître en nous une volonté décidée de ne jamais nous en séparer, chacun peut, ainsi que moi, raisonner d’après ce qui se passe dans son intérieur ; il y trouvera tout ce que je pourrais dire à ce sujet.
Une chose évidente est une vérité qu’un examen suffisant a rendu tellement sensible, tellement manifeste, qu’il n’est plus possible à l’esprit humain d’imaginer des raisons pour en douter, dès qu’il a connaissance de celles qui l’ont fait adopter. De cette espèce, par exemple, sont les vérités géométriques, et généralement toutes celles qui sont démontrées par le calcul. Quand la terre serait éternellement couverte d’hommes, aucun d’eux ne s’aviserait de contredire ces vérités ; l’ignorance seule pourrait les méconnaître et les révoquer en doute ; mais cela ne subsisterait qu’autant que l’ignorance ne voudrait pas s’éclairer par un examen suffisant.
En supposant donc que les choses ne surpassent point les bornes de nos connaissances, et qu’elles ne soient point non plus de cette évidence primitive qui se manifeste par la seule entremise de nos sens, nous pouvons établir deux propositions : la première, qu’un examen suffisant rend tout évident ; la seconde, que sans un examen suffisant il n’est rien d’évident.
Qu’on me pardonne cette expression, mais il semble que par une espèce d’instinct nous connaissions, ou du moins nous sentions le besoin que nous avons de l’évidence : nos esprits ont une tendance 164.50. [50] naturelle vers l’évidence ; et le doute est une situation importune et pénible pour nous. Aussi pouvons-nous regarder l’évidence comme le repos de l’esprit ; il y trouve une sorte de bien-être qui ressemble fort à celui que le repos physique procure à nos corps ; on dirait même qu’il ne travaille que pour se procurer cette jouissance.
Cette tendance naturelle de nos esprits vers l’évidence est liée avec les deux mobiles qui sont en nous : l’appétit des plaisirs et l’aversion de la douleur ont grand intérêt de n’être point trompés dans le choix des moyens de se satisfaire ; voilà pourquoi nous ne pouvons être tranquilles, qu’après que nous avons acquis une certitude qui ne peut résulter que de l’évidence ; c’est par cette même raison encore que la liberté d’employer tous les moyens qui conduisent à l’évidence, fait une partie essentielle de la liberté de jouir, sans laquelle le droit de propriété cesserait d’exister.
On peut donc regarder l’évidence comme une divinité bienfaisante qui se plaît à donner la paix à la terre : vous ne voyez point les géomètres en guerre au sujet des vérités évidentes parmi eux : s’il s’élève entre eux quelques disputes momentanées, ce n’est qu’autant qu’ils sont encore dans le cas de la recherche, et elles n’ont pour objet que des déductions ; mais sitôt que l’évidence a prononcé pour ou contre, chacun met bas les armes, et ne s’occupe plus qu’à jouir paisiblement de ce bien commun.
Pour suivre cette comparaison, et profiter de tout le jour qu’elle répand sur les objets dont il s’agit ici, de l’évidence des vérités géométriques, passez à l’évidence des vérités sociales, à l’évidence de cet ordre naturel et essentiel qui procure à l’humanité son meilleur état possible ; par les effets connus de celle-là, cherchez à découvrir quels seraient nécessairement les effets de celle-ci ; quelle serait nécessairement la situation intérieure d’une société gouvernée par cette évidence ; quel serait nécessairement l’état politique et respectif de toutes les nations, si elle les avait toutes éclairées de sa lumière divine ; examinez si des hommes ralliés sous les étendards de cette même évidence, peuvent se diviser ; si quelque sujet de guerre pourrait être assez puissant pour les porter à lui sacrifier leur meilleur état possible et évident ; creusez plus avant encore, et voyez si les tableaux que cette médiation vous présente, n’excitent pas chez vous des sensations, ou plutôt des transports dont les secousses vous élèvent au-dessus de vous-même, et semblent vous avertir que, par le moyen de l’évidence, nous communiquons avec la divinité.
Mais pour vous rendre encore plus sensible à l’impression que ces mêmes tableaux feront sur votre cœur et sur votre esprit, placez en opposition tous les inconvénients qui, dans un état d’ignorance, peuvent résulter de la force de l’opinion. [51] Une chose est défendue sous peine des supplices les plus capables d’effrayer : que peuvent cette défense et ces supplices sur une opinion qui tend à les braver ? Rien ; nous n’en avons que trop d’exemples.
Un homme se trouve par sa naissance, placé dans une situation qui ferait le bonheur d’un grand nombre d’autres hommes, s’ils partageaient entre eux les avantages que lui seul réunit : que fait cet homme quand son opinion est déréglée ? Il lui sacrifie ces mêmes avantages ; il vit et meurt malheureux.
Un seul homme sans armes commande à cent mille hommes armés, dont le plus faible est plus fort que lui : qu’est-ce donc qui fait sa force ? Leur opinion ; ils le servent en la servant ; ils obéissent à ce chef, parce qu’ils sont dans l’opinion qu’ils lui doivent obéir.
Voulez-vous voir d’autres effets qui caractérisent la force de l’opinion ? Considérez ceux de l’honneur, de cette espèce d’enthousiasme qui nous fait préférer au repos le travail et la fatigue, aux richesses la pauvreté et les privations, à la vie la mort qu’il trouve le secret d’embellir.
L’opinion, quelle qu’elle soit, est véritablement la Regina d’el mundo ; lors même qu’elle n’est qu’un préjugé, qu’une erreur, il n’est dans l’ordre moral, aucune force comparable à la sienne ; féconde en prestiges de toute espèce, elle emprunte pour nous tromper, tous les caractères de la réalité ; source intarissable de bien et de mal, nous ne voyons que par elle, nous ne voulons, nous n’agissons que d’après elle ; selon qu’elle est ou n’est pas dans le vrai, elle fait les vertus et les vices, les grands hommes et les scélérats ; il n’est aucun danger qui l’arrête, aucune difficulté contre laquelle elle ne s’irrite ; tantôt elle fonde des empires, et tantôt elle les détruit.
Chaque homme est ainsi sur la terre un petit royaume gouverné despotiquement par l’opinion : il brûlera le temple d’Éphèse, si son opinion est de le brûler ; au milieu des flammes il bravera ses ennemis, si son opinion est de les braver ; le physique enfin paraît en nous lui être tellement subordonné, que pour commander au physique, il faut commencer par commander à l’opinion : mais comment peut-on commander à celle-ci, lorsqu’elle est le jouet de l’ignorance et de l’arbitraire ? Comment peut-on réunir et fixer les opinions sans le secours de l’évidence ? Ne voit-on pas que l’auteur de la nature n’a point institué d’autres moyens pour enchaîner nos volontés et notre liberté ?
[I-107 / 52]
SECONDE PARTIE.
LA THÉORIE DE L’ORDRE MISE EN PRATIQUE.
De la forme essentielle de la société : elle consiste dans trois sortes d’institutions ; celle des lois, et par conséquent des magistrats ; celle d’une autorité tutélaire ; celle enfin de tous les établissements nécessaires pour étendre et perpétuer dans la société la connaissance évidente de son ordre naturel et essentiel. — Dans le développement de la première classe de ces institutions, on voit qu’il est deux sortes de lois ; qu’il en est de naturelles et communes à tous les hommes ; qu’il en est de positives et particulières à chaque nation [1] ; que les premières sont d’une nécessité évidente et absolue ; que les secondes n’en doivent être que le développement ou plutôt l’application ; que l’établissement des magistrats est d’une nécessité semblable à celle de l’établissement des lois ; que leurs devoirs concourent singulièrement à assurer la stabilité et l’autorité de la législation positive ; qu’ils donnent de la consistance au pouvoir législatif, sans cependant aucunement le partager ; qu’ils sont le lien commun qui unit l’État gouverné à l’État gouvernant. — Que le pouvoir législatif est indivisible ; qu’il ne peut être exercé ni par la nation en corps, ni par plusieurs choisis dans la nation ; qu’il est des lois positives ainsi nommées par opposition aux lois naturelles inséparable de la puissance exécutrice ; que le chef unique qui l’exerce, n’est que l’organe de l’évidence ; qu’il ne fait que manifester par des signes sensibles, et armer d’une force coercitive les lois d’un ordre essentiel dont Dieu est l’instituteur.
Dans le développement de la seconde classe des institutions sociales, il est démontré que l’autorité tutélaire est une par essence ; qu’on ne peut la partager sans la détruire ; qu’elle ne peut être exercée sans inconvénient, que par un seul ; que la souveraineté doit être héréditaire ; que cette condition est une de celles qui sont essentielles pour que le gouvernement d’un seul soit nécessairement la meilleure forme possible de gouvernement ; que partout où règne une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel, cette forme de gouvernement est la plus avantageuse aux peuples, parce qu’elle établit un véritable despotisme légal ; qu’elle est aussi la plus avantageuse aux souverains, parce qu’elle établit en leur faveur le véritable despotisme personnel : que le despotisme arbitraire n’est point le vrai despotisme ; qu’il n’est point personnel, parce qu’il n’est point légal ; [53] qu’il est à tous égards contraire aux intérêts de celui qui l’exerce ; qu’il n’est que factice, précaire et conditionnel, au lieu que le despotisme légal est naturel, perpétuel et absolu ; que ce n’est que dans ce dernier que les souverains sont véritablement grands, véritablement puissants, véritablement despotes ; que ce despotisme personnel et légal assure le meilleur état possible dans tous les points à la nation, à la souveraineté et au souverain personnellement.
[I-111]
CHAPITRE X.↩
De la forme essentielle de la société. — Ses rapports avec la théorie de l’ordre essentiel. — Elle consiste en trois classes d’institutions sociales. — Objets que renferme chacune de ces trois classes. — Nécessité de développer les rapports des deux premières, dont l’une est l’institution des lois, et la seconde, l’institution d’une autorité tutélaire.
J’ai démontré dans la première partie, que le droit de propriété considéré dans tous ses rapports, est un droit naturel et essentiel ; qu’il est le premier principe de tous les droits et de tous les devoirs réciproques que les hommes doivent avoir entre eux ; que ces droits et ces devoirs, qui n’en sont que des conséquences nécessaires, deviennent essentiels comme lui, et que l’ordre naturel et essentiel des sociétés n’est au fond que l’ordre ou l’enchaînement de ces mêmes droits, et de ces mêmes devoirs. De la théorie de l’ordre passons maintenant à la pratique ; examinons quelle est la forme qu’il doit nécessairement donner à la société, pour que cette réciprocité de devoirs, de droits essentiels ne puisse éprouver aucune altération, et qu’ils se trouvent être dans tous les temps tels qu’ils résultent nécessairement du droit de propriété.
Deux conditions sont essentiellement requises pour que le droit de propriété soit conservé dans tout son entier : la première, est que ce droit soit en lui-même inébranlable, qu’il jouisse de la plus grande sûreté possible ; la seconde est que la plus grande liberté possible lui soit acquise invariablement ; car la plénitude du droit de propriété suppose nécessairement la plénitude de la liberté. La forme essentielle de la société est donc le concours de toutes les institutions sociales qui doivent se réunir pour consolider le droit de propriété et lui assurer toute la liberté qui le caractérise essentiellement.
Ce que j’ai dit dans le septième et le huitième chapitre de ma première partie nous annonce que toutes les institutions qui appartiennent 180.54. [54] à la forme essentielle de la société, peuvent se renfermer dans trois classes : l’institution des lois ; celle d’une autorité tutélaire ; celle enfin des établissements nécessaires pour répandre et perpétuer dans la société la connaissance évidente de son ordre essentiel.
Dans la nécessité de l’institution des lois, nous trouvons, comme je l’ai déjà fait observer, la nécessité de l’institution des magistrats, tous leurs devoirs essentiels et nécessairement inséparables de leur ministère, ainsi que les règles qu’il faut suivre invariablement pour assurer à toute la société l’utilité qui doit résulter de ces mêmes devoirs.
Dans la nécessité de l’institution d’une autorité tutélaire, nous découvrons aussi la nécessité de tous les droits dont elle doit jouir, et celle de tous ses devoirs essentiels ; nous voyons en même temps que ces derniers sont liés si essentiellement à ses véritables intérêts, et ses véritables intérêts si fortement, si évidemment attachés au maintien du droit de propriété et de la liberté, qu’il faut commencer par supposer l’ignorance et l’oubli total de l’ordre, non seulement dans le dépositaire de cette autorité, mais encore dans les magistrats, et même dans tout le corps politique, avant d’imaginer que ce dépositaire puisse former la volonté de s’écarter de ses devoirs, et qu’il puisse s’établir des pratiques dans lesquelles l’ordre soit compromis.
C’est pour prévenir cet oubli de l’ordre et ses effets funestes, que la troisième classe des institutions sociales est nécessaire : elle admet toutes les mesures qu’on peut prendre, tous les moyens qu’on peut embrasser pour étendre, perfectionner et perpétuer la connaissance évidente de l’ordre, et elle rejette tout ce qui pourrait tendre à concentrer et affaiblir cette connaissance. Au moyen de cette troisième classe d’institutions, on verra constamment régner l’évidence de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, de cet ordre le plus avantageux au corps social, parce qu’il est le plus avantageux à chacun de ses membres en particulier. Je dis qu’on verra constamment régner cette évidence, parce qu’elle est le fléau de l’arbitraire qui suit toujours devant elle ; elle ne lui permettra jamais de se glisser ni dans l’état gouvernant ni dans l’état gouverné ; quelque déguisement qu’il empruntât, il porterait toujours un caractère qui le trahirait, parce qu’il ne peut jamais ressembler à celui de l’évidence.
Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit précédemment sur cette troisième classe d’institutions sociales. La connaissance de l’ordre ne peut être ni trop publique ni trop évidente ; ainsi on ne peut employer trop de moyens pour assurer cette évidence et cette publicité. Mais je ne crois pas devoir passer aussi légèrement sur les deux premières classes des institutions qui constituent la forme essentielle [55] de la société : les rapports nécessaires qui se trouvent entre les lois et l’autorité tutélaire ; entre les devoirs, les droits et les intérêts de cette autorité ; entre ces mêmes intérêts, ceux de la nation et les devoirs des magistrats ; enfin, entre tous ces différents objets et la théorie ou les principes de l’ordre, demandent de notre part un examen rigoureux et une attention très suivie. Ces différents rapports ont besoin d’être approfondis ; ils n’ont servi jusqu’à présent qu’à faire éclore une multitude de systèmes contraires les uns aux autres, et séparément remplis de contradictions frappantes. Nous pouvons regarder cette variété de systèmes et même chacun d’eux en particulier, comme une preuve convaincante que l’évidence de ces mêmes rapports ne s’est point encore manifestée : par la raison qu’ils déterminent nécessairement la forme essentielle de la société, leur évidence aurait banni la diversité des opinions, et toutes les volontés se seraient ainsi ralliées à une même forme de gouvernement, comme étant la seule que l’ordre permette d’adopter.
[I-117 / 56]
CHAPITRE XI.↩
Développement de la première classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — Les lois s’établissent en même temps que la société. — Il en est de deux sortes : les unes sont naturelles, essentielles et universellement adoptées ; les autres conséquentes aux premières, sont positives, et particulières à chaque société ; définition des lois positives. — Le motif ou la raison des lois est avant les lois. — La raison des lois naturelles et essentielles est dans la nécessité absolue dont elles sont évidemment. — Ces lois naturelles doivent être la raison des lois positives. — Deux conditions nécessaires pour assurer la soumission confiante aux lois positives. — Nécessité de leur conformité parfaite avec les lois naturelles et essentielles. — Effets funestes d’une contradiction qui se trouverait entre ces deux sortes de lois.
Une multitude d’hommes rassemblés, qui n’admettraient entre eux aucuns devoirs respectifs, aucuns droits réciproques, ne formeraient certainement point une société : elle ne consiste pas uniquement dans le rapprochement des hommes ; car nous savons par notre propre expérience qu’elle peut subsister entre des hommes très éloignés les uns des autres, et ne pas subsister entre des hommes très voisins. Ce sont donc les conditions de la réunion qui font véritablement la réunion.
De là s’ensuit qu’il est impossible de concevoir une société particulière sans devoirs et sans droits réciproques ; c’est-à-dire, sans des conventions faites entre les membres de ce corps politique, pour leur intérêt commun ; par conséquent qu’il est impossible de concevoir une société sans lois ; car les lois ne sont autre chose que ces mêmes conventions, en vertu desquelles les devoirs et les droits réciproques sont établis de façon qu’il n’est plus permis de s’en écarter arbitrairement.
Ainsi, que les lois soient écrites ou qu’elles ne le soient pas, il n’en est pas moins vrai qu’elles naissent avec la société, ou plutôt qu’elles la précèdent ; puisque c’est par elles que la société s’établit, et prend une consistance. Elles sont donc la première des institutions sociales qui constituent la forme essentielle d’une société.
Dans tous les temps les hommes ont institué des lois pour déterminer positivement, comment le meurtre, le vol, et d’autres crimes de cette espèce seraient punis ; mais nous ne les voyons point faire des lois pour défendre précisément de tuer, de voler, de commettre d’autres forfaits semblables. Personne cependant ne s’avisera [57] de dire que ces mêmes crimes ne soient pas défendus par les lois de toutes les nations : par la raison qu’ils deviendraient évidemment destructifs de toute société, les législateurs ont regardé cette évidence comme une défense suffisamment connue ; et ils ont parti de là pour établir les peines dont les contraventions à cette défense seraient punies.
Quoique la loi naturelle qui défend de tuer, de voler, etc., etc., soit la même dans toutes les sociétés, elles n’infligent pas toutes les mêmes peines à ceux par qui ces crimes sont commis : les lois qui statuent sur ces peines, peuvent être déterminées par diverses circonstances que le législateur doit peser avec attention ; et en général, le genre de la punition est indifférent, pourvu qu’elle soit proportionnée à la nature du délit, et aux conséquences qui en résultent, au préjudice de l’ordre social.
Il est donc dans une société deux sortes de lois : il en est qui sont naturelles, essentielles et communes à toutes les sociétés ; il est aussi des lois positives, et même factices qui sont particulières à chaque société. La justice et la nécessité de ces lois naturelles, essentielles et universelles, sont d’une telle évidence, qu’elles se manifestent à tous les hommes, sans le secours d’aucun signe sensible : aussi ne sontelles point insérées dans les recueils ordinaires des lois ; c’est dans le code même de la nature qu’elles se trouvent écrites, et nous les y lisons tous distinctement à l’aide de la raison, de cette lumière qui illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.
Nous avons donné le nom de positives aux lois de la seconde espèce, parce qu’elles établissent d’une manière positive ce qui sans elles resterait arbitraire, ou du moins incertain pour la majeure partie des hommes : nous disons aussi qu’elles sont factices, à raison seulement de la manière de les établir ; car leur justice n’a rien de factice, mais quoiqu’elles doivent toutes être conséquentes au juste absolu, elles ont cependant besoin, pour se faire connaître, d’être écrites, ou du moins d’être établies d’une manière qui agisse sur les sens, et qui puisse ainsi rendre leurs dispositions manifestes pour toute intelligence.
Les lois naturelles et essentielles, ouvrage d’une sagesse divine, doivent être nécessairement les meilleures lois possibles, et elles sont immuables comme leur auteur. Les lois positives au contraire, ouvrage des hommes, et dictées par des opinions sujettes à l’erreur, peuvent être extravagantes, comme elles peuvent être sages, selon que l’ignorance ou une raison suffisamment éclairée préside à leur institution : il est clair aussi qu’elles ne peuvent être immuables qu’autant que nos opinions sont fixées par l’évidence ; car il n’y a que l’évidence qui ne soit point sujette au changement. [58] Il est bien important de distinguer dans les lois, la lettre de la loi, et la raison de la loi. La lettre de la loi est la disposition textuelle et positive de la loi ; la raison de la loi est le motif qui l’a dictée. Tu ne tueras point arbitrairement ; voilà la lettre de la loi ; car tu donnerais aux autres le droit de te tuer arbitrairement aussi, et tu détruirais ainsi la société : voilà la raison de la loi.
De cette loi naturelle et essentielle passons à la loi positive, et voyons ce que nous y trouvons. Celui qui tuera, nous dit-elle, sera puni de tel supplice ; je vois ainsi que le supplice du meurtrier n’est plus arbitraire ; qu’il doit être de telle espèce ; voilà tout ce qu’elle m’apprend ; et je reste dans l’ignorance du motif ou de la raison de cette loi, si pour connaître ce motif, je ne vais le chercher dans d’autres lois antérieures à celle-ci. Mais pour peu que je me livre à cet examen, je découvre qu’avant la loi positive qui établit la peine du meurtre, il était une autre loi naturelle par laquelle le meurtre était défendu : concevant alors que cette défense est essentiellement nécessaire à la société, je vois dans cette première loi naturelle et essentielle pourquoi le meurtrier doit être puni ; et ayant acquis ainsi la connaissance évidente de la raison de cette loi positive, je me trouve en état de juger de sa justice et de son utilité, ce qu’il me serait impossible de faire, si dans cette loi, je ne connaissais que la lettre de la loi.
Supposons deux lois qui condamnent également à la mort, l’une pour l’homicide, l’autre pour marcher à certaines heures du jour, ou pour quelque autre action semblable, n’est-il pas vrai qu’elles ne seront pas toutes deux regardées du même œil ? Que celle-là nous paraîtra juste, et celle-ci tyrannique ? Interrogeons nos cœurs, et voyons si nous n’y trouvons pas une disposition naturelle à nous soumettre à la première, à la défendre même de toutes nos forces, comme nécessaire à notre propre sûreté, et une autre disposition toute opposée qui nous incline naturellement à saisir tous les moyens qui pourront se présenter pour nous affranchir du joug cruel de la seconde loi.
Cette différence dans ces deux dispositions provient de la différence du jugement que nous portons sur le motif, sur la raison de chacune de ces deux lois. La raison de l’une lui imprime le caractère d’une nécessité évidente ; et cette évidence subjugue, enchaîne sans résistance notre esprit et notre volonté ; la raison de l’autre au contraire ne nous présentant rien d’essentiel, rien d’évidemment nécessaire, nous n’y voyons d’évident qu’une rigueur démesurée, qu’une injustice manifeste à laquelle notre sentiment intérieur, notre raison, et conséquemment notre volonté ne peuvent s’accoutumer. [59] C’est donc dans la raison des lois, et non dans la lettre des lois, qu’il faut chercher le premier principe d’une soumission constante aux lois ; car ce premier principe ne peut être autre chose que l’empire absolu que prend sur nos esprits l’évidence de la justice et de la nécessité des lois ; or cette évidence n’est jamais dans la lettre de la loi : ainsi pour établir généralement et invariablement cette soumission, il est deux conditions essentielles : la première, que la raison des lois soit démonstrative de leur justice et de leur nécessité ; la seconde, qu’elle soit d’une telle évidence, ou du moins d’une telle certitude, qu’il ne soit possible à personne d’en douter.
La raison des lois naturelles et essentielles est la nécessité absolue dont elles sont à l’existence de la société ; nécessité dont l’évidence frappe, saisit tous les esprits, et qui montre évidemment à tous les hommes, que si les lois positives étaient destructives des lois naturelles et essentielles, elles le seraient aussi de la société ; qu’ainsi ces mêmes lois naturelles et essentielles doivent être la raison primitive des autres lois, qui ne peuvent plus en être que des conséquences évidentes, du moins pour ceux dont cette évidence doit invariablement régler les procédés.
Si, par exemple, une loi positive ne condamnait l’homicide qu’à une très modique amende pour toute peine, on pourrait dire que l’homicide serait autorisé par cette loi ; qu’ainsi la loi positive serait à cet égard destructive de la loi naturelle et essentielle, par conséquent de la société. Cette supposition qui se rapporte beaucoup à nos mœurs et à nos lois anciennes dans des siècles d’ignorance et de barbarie dont nous rougissons aujourd’hui, suffit pour faire voir que la première condition requise pour instituer de bonnes lois positives, des lois dont l’autorité soit inébranlable, est leur conformité parfaite et évidente avec les lois naturelles et essentielles des sociétés. Cette règle invariable est le premier principe de toute législation : certainement une loi qui autoriserait des infractions arbitraires aux lois essentielles de l’ordre, ne serait pas propre à maintenir l’ordre ; et dès lors il serait impossible qu’on pût être constamment assuré de l’observation de cette loi.
Les lois positives ne doivent être que des résultats évidents de l’ordre, mais scellés du sceau de l’autorité publique, pour devenir ainsi des actes déclaratifs et confirmatifs des devoirs et des droits que les lois naturelles et essentielles de la société établissent nécessairement dans chacun de ses membres et pour leur intérêt commun. Si elles instituaient des devoirs et des droits d’une autre espèce que ceux qui dérivent de ces lois naturelles et essentielles, ces devoirs et ces droits nouveaux ne pourraient [60] être que contraires aux premières ; et dans ce cas les lois positives seraient sans cesse en opposition avec nos esprits et nos volontés.
Tous les droits qu’un être raisonnable peut ambitionner, se trouvent renfermés dans celui de la propriété ; car de ce droit résulte une liberté de jouir qui ne doit connaître de bornes que celles qui lui sont assignées par les droits de propriété des autres hommes. L’ordre essentiel de la société déterminant ainsi la mesure de la liberté dans chacun de ses membres, et cette mesure se trouvant être de la plus grande étendue qu’il lui soit possible d’avoir sans troubler cet ordre essentiel, il est impossible de rien ajouter à la liberté des uns qu’au préjudice de la liberté, et par conséquent de la propriété des autres, ce qui devient alors une injustice, un désordre qui ne peut être que funeste à la société.
Je dis que ce désordre ne peut être que funeste à la société, parce qu’il la met dans un état violent : mon voisin ne trouvera point mauvais qu’il ne lui soit pas libre d’aller cueillir ou endommager mes moissons ; mais par la même raison, il supportera toujours fort impatiemment qu’il me soit libre d’aller cueillir ou endommager les siennes ; comme il est évident à chaque homme qu’il ne doit point troubler les autres dans la jouissance de leurs propriétés, il lui est évident aussi que dans la jouissance des siennes, les autres ne doivent point le troubler. À la vue même d’un semblable préjudice qui sera fait aux autres hommes, il s’alarmera, il craindra pour lui-même, et cette inquiétude sera pour lui un tourment contre lequel sa raison même se révoltera perpétuellement.
Une loi positive qui contredirait cette justice naturelle, choquerait donc l’évidence, blesserait des droits qui nous sont évidents, et précieux ; elle serait ainsi, comme je viens de le dire, en opposition avec notre sentiment intérieur et nos volontés fixées invariablement par cette même évidence ; et voilà ce que j’appelle mettre la société dans un état violent, parce que c’est constamment faire violence à la nature, à des volontés qu’elle a données à tous les hommes pour le bonheur commun de leur espèce, et que les lois positives doivent protéger, comme étant les premiers principes de la réunion des hommes en société.
Que cet état violent ne puisse être que funeste à la société, je ne crois pas que cela me soit contesté : premièrement tout ce qui altère la liberté, altère le droit de propriété, et diminue d’autant les avantages que ce droit procure à la société, lorsque le désir de jouir et la liberté de jouir se trouvent réunis. En second lieu, il faudrait changer la nature de l’homme, déraciner en lui les mobiles qui le mettent en action, faire perdre à l’évidence la force dominante qu’elle a sur son esprit et sur ses volontés, pour que les hommes cessassent d’être [61] attachés à la liberté de jouir qui résulte du droit de propriété, et qu’ils ne cherchassent pas à se soustraire aux violences que cette liberté peut éprouver, ou du moins à s’en dédommager. Mais alors les dédommagements et la façon de se les procurer seraient nécessairement dans l’arbitraire ; chacun ne pourrait les attendre que de sa force personnelle, et les apprécierait au gré de son opinion qui ne connaîtrait plus de règles, puisque les lois positives seraient elles-mêmes déréglées : dans cet état de désordre chaque homme, ayant à craindre un autre homme, et par cette raison ne pouvant compter sur rien, se verrait réduit à se permettre tout ce qu’il pourrait faire, dans la crainte de ne pouvoir faire ce qu’il serait en droit de se permettre.
Un autre mal encore, ce serait celui des associations faites dans la vue d’augmenter la licence et les abus, en s’assurant de leur impunité : de ce chaos monstrueux on verrait sortir les meurtres, les vols, les brigandages de toute sorte, les crimes, les excès de toute espèce, avant-coureurs des grandes révolutions qui, dans de pareilles circonstances, n’ont jamais manqué d’être amenées par la corruption, la dépravation des mœurs, sitôt que les opinions ont pu se former un point de réunion.
Ce n’est point assez que les lois positives soient exactement conformes aux lois naturelles et essentielles de la société : cette première condition requise pour leur assurer une soumission constante, étant remplie, il en faut encore une seconde, qui est, comme on vient de le voir, que cette conformité soit connue de manière que personne ne puisse en douter ; car elles ne peuvent être fidèlement observées que par religion du for intérieur, religion qui ne peut s’établir que sur une connaissance indubitable de leur justice et de leur nécessité. Mais cette connaissance ne peut être la même chez tous les hommes : il en est pour qui elle doit être évidente ; il en est d’autres chez lesquels elle ne peut être qu’une certitude. On va voir dans les chapitres suivants, que ces deux sortes de connaissances ne diffèrent essentiellement que dans la façon de les acquérir.
[I-133 / 62]
CHAPITRE XII.↩
Suite du développement de la première classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — Caractère de la certitude que les hommes doivent avoir de la justice et de la nécessité des lois ; comment en général la certitude s’établit. — Impossibilité sociale que le pouvoir législatif et la magistrature soient réunis dans la même main. — Nécessité des magistrats.
Des hommes qui seraient persuadés que leurs lois positives sont de mauvaises lois, pourraient bien être contraints pendant un temps à les observer ; mais une telle soumission, qui est contre nature, ne pourrait être durable ; et il serait impossible qu’elle ne fût pas sujette à des écarts journaliers de la part de ceux qui croiraient les lois injustes à leur égard : la soumission aux lois est toujours et nécessairement relative à l’idée que nous avons de la justice et de la nécessité des lois.
Cette idée, pour être stable et permanente, doit être en nous ou une certitude primitive, qui est dans l’évidence même qui nous est propre, ou une certitude secondaire établie sur l’évidence qui se trouve dans les autres. Il ne faut pas confondre cette seconde espèce de certitude avec la confiance qui ne serait que l’effet d’une prévention ; car la prévention n’a rien de solide ; elle ne porte sur rien d’évident ; une autre prévention opposée peut même la détruire, et faire évanouir la confiance qui en était le produit ; au lieu que la certitude secondaire tient à l’évidence, sans cependant être en elle-même une connaissance évidente de la vérité qui en est l’objet. Mais pour ne point embarrasser par des expressions nouvelles, parlons le langage ordinaire, et donnons tout simplement le nom d’évidence à la certitude primitive, et celui de certitude à celle qui n’est que secondaire ou conséquente à la première.
Je n’ai jamais vu la Chine, mais je suis certain que la Chine existe, parce que je suis certain que ce fait est évident pour beaucoup d’autres dont le témoignage uniforme et constant ne se contredit point : par ce moyen j’ai des preuves suffisantes pour fonder, non pas une confiance, mais une certitude qui me tient lieu de l’évidence que les autres ont acquise, et sur laquelle ces preuves suffisantes sont établies. Ainsi cette certitude n’est point en moi une évidence ; mais cette unanimité dans les témoignages de ceux qui ont acquis cette même évidence, cette unanimité, dis-je, qui est la première cause ou la première occasion de ma certitude, est évidente.
Quoique l’ordre essentiel des sociétés soit fort simple dans ses principes, ses conséquences cependant sont si multiples, et elles [63] embrassent tant d’objets, qu’il n’est pas possible à la majeure partie des hommes d’avoir une connaissance explicite et évidente de la raison de toutes les lois positives, et des changements que les circonstances des temps peuvent exiger. Diverses causes, dont le détail serait superflu, concourent pour les tenir éloignés de cette connaissance explicite et évidente ; mais il n’est aucun motif qu’on puisse alléguer pour les priver de cette autre connaissance que nous nommons une certitude, et qui produit sur leur esprit tous les effets de l’évidence.
La certitude peut suppléer l’évidence, mais rien ne peut suppléer la certitude : c’est une folie de croire que dans le gouvernement des hommes elle puisse être remplacée par la confiance : dès que celle-ci n’a pour base ni évidence ni certitude, elle n’est plus qu’un enfant aveugle de la séduction ; sa faiblesse et son infirmité ne permettent pas de compter sur lui. Ainsi dans le moral ce n’est que sur l’évidence, et sur la certitude qu’elle communique à tout ce qui la touche, qu’on peut élever un édifice solide qui n’ait rien à redouter des écarts orageux de l’opinion, pour qui tout ce qui n’est pas évident ou indubitablement certain devient arbitraire.
La première conséquence que nous devons tirer de ces vérités préliminaires, c’est qu’il est socialement impossible que l’autorité législative et la magistrature, ou l’administration de la justice distributive, soient réunies dans la même main, sans détruire parmi les hommes toute certitude de la justice et de la nécessité de leurs lois positives : allons plus loin encore, et disons, sans détruire ces lois elles-mêmes ; car elles n’auraient plus ni la forme, ni aucun des caractères essentiels aux lois.
Comme on a souvent institué des formes très vicieuses, ce qu’on appelle forme est tombé dans une sorte de mépris. Il est pourtant vrai que rien ne peut exister sans une forme, et que la forme essentielle des choses est ce qui les fait ce qu’elles sont.
La forme essentielle des lois positives consiste dans les signes sensibles qui manifestent qu’on a suivi l’ordre des procédés qu’il faut garder nécessairement dans leur institution, 1° pour s’assurer de leur justice et de leur nécessité ; 2° pour rendre cette justice et cette nécessité certaines à tous ceux qui ne peuvent en acquérir une connaissance explicite et évidente. Or il est constant que cet ordre de procédés ne serait plus observé, si la puissance législatrice voulait encore se charger des fonctions de la magistrature : le législateur et le magistrat n’étant plus ainsi qu’une seule et même personne, il en résulterait que d’un côté le pouvoir d’instituer des lois ne trouverait dans les lumières, et dans les devoirs du magistrat, aucune ressource contre les surprises qui pourraient être faites au législateur ; tandis que d’un autre côté, la volonté du législateur ne pouvant dominer, enchaîner, assujettir celle du magis trat, [64] les lois les plus justes dans leurs dispositions se trouveraient incertaines et variables dans leur application.
Présentons dans d’autres termes encore ces importantes vérités, pour les rendre plus simples et plus frappantes : si le législateur était aussi magistrat, il ne pourrait que couronner et consommer comme magistrat, toutes les méprises qui lui seraient échappées comme législateur. Si le magistrat était aussi législateur, les lois n’existant que par sa seule volonté, il ne serait point assujetti à les consulter pour juger ; et il pourrait toujours ordonner comme législateur ce qu’il aurait à décider comme magistrat.
Ainsi ce ne serait que dans les seules volontés du législateur qu’il faudrait chercher la raison des lois positives ; car il les instituerait au gré de ses volontés arbitraires ; et ce ne serait que dans les seules volontés du magistrat qu’il faudrait chercher la raison de ses jugements ; car son indépendance le mettrait dans le cas de se permettre tout en les rendant. Ce double inconvénient nous prouve bien que ces lois seraient dépouillées de leurs caractères essentiels, qui sont l’évidence de leur justice et de leur nécessité, et une indépendance absolue de l’arbitraire. De telles lois positives ne seraient plus des lois, puisque leur application devenant arbitraire et incertaine, elles n’auraient plus rien de positif par essence.
Quand le pouvoir législatif et la magistrature sont séparés, comme ils doivent l’être, les lois une fois établies par la puissance législatrice, ont une autorité qui leur est propre, et qui leur donnant le droit de commander aux volontés du magistrat, leur assure une entière indépendance de toutes les autres volontés. Il est certain que le magistrat ne peut alors, et ne doit avoir d’autres volontés que celles des lois ; l’autorité qu’il exerce n’est point la sienne ; elle est celle des lois ; aussi n’est-ce point en lui que cette autorité réside, mais dans les lois ; aussi ses fonctions se bornent-elles à faire l’application des lois ; aussi ne fait-il que prononcer des jugements déjà dictés par les lois ; aussi est-il tenu de penser, de parler, d’ordonner comme les lois ; il n’est ainsi que leur ministre, que leur organe ; et c’est par cette raison qu’elles sont en sûreté dans ses mains ; et que par état il est nécessairement et particulièrement le dépositaire et le gardien des lois ; disons plus encore : de la raison primitive et essentielle des lois ; car c’est dans cette source qu’il faut puiser les lois à faire : j’expliquerai dans un moment ce que j’entends par ces expressions.
Mais si le pouvoir législatif et la magistrature étaient réunis, nous ne verrions plus dans le magistrat qu’une puissance absolument indépendante des lois, lorsqu’il s’agirait d’en faire l’application : ce ne seraient plus alors les volontés des lois qui deviendraient celles du magistrat ; ce seraient au contraire les volontés personnelles du [65] magistrat qui deviendraient celles des lois ; ses décisions ne pourraient plus être regardées comme étant dictées par les lois, et d’après leurs dispositions invariables, puisque les lois ne seraient elles-mêmes que des résultats de ses opinions ; qu’elles ne diraient que ce qu’il leur ferait dire ; qu’elles ne voudraient que ce qu’il leur ferait vouloir. Enfin l’autorité qui assurerait l’exécution de ses prétendus jugements, serait son autorité personnelle, et non l’autorité des lois ; car les lois n’ayant que celle qu’il voudrait bien leur prêter, et qu’il pourrait à chaque instant leur retirer, une telle autorité qui émanerait de lui, qui ne subsisterait que par lui, ne serait plus rien devant lui.
Ainsi au moyen de l’inconstance et de l’incertitude qui régneraient dans les lois positives ; au moyen de ce qu’elles n’auraient ni force, ni autorité, ni consistance ; au moyen de ce que leur application serait toujours incertaine ; de ce que le recours aux lois deviendrait le recours à l’opinion et à la volonté arbitraire du magistrat, on pourrait dire que dans une telle société, il n’y aurait ni lois, ni devoirs, ni droits positifs et réciproques : je laisse à juger du nom qu’on pourrait lui donner.
Nous verrons dans les chapitres suivants que le pouvoir législatif est inséparable de la puissance exécutrice, et que cette puissance, qui par essence est indivisible, ne peut être exercée que par un seul. Cette vérité est un des plus puissants arguments qu’on puisse employer pour démontrer l’impossibilité sociale dont il est que le législateur puisse remplir les fonctions du magistrat. Dès qu’il ne doit exister qu’un législateur unique, qu’un dépositaire unique de toute l’autorité, c’est sa volonté unique qui doit ordonner et dicter les lois. Ceux qu’il appelle à ses délibérations ne peuvent avoir qu’une voix consultative. Si elle était délibérative, l’autorité serait acquise à l’avis le plus nombreux, et dès lors ce ne serait plus un seul qui serait le souverain ; la souveraineté résiderait véritablement dans le plus grand nombre des voix qui se trouveraient réunies sur un même objet.
Mais puisque dans tous les cas où la volonté du souverain doit prononcer, aucun des opinants ne peut avoir voix délibérative, il est évident que s’il voulait exercer les fonctions du magistrat, tous les jugements qu’il rendrait émaneraient de sa seule et unique volonté ; il jugerait seul enfin ; et par cette raison il s’imposerait l’obligation rigoureuse de ne jamais se tromper, obligation bien reconnue pour être au-dessus des forces de l’humanité.
Quel est l’homme qui pourrait, sans frémir, entreprendre de rendre seul la justice à une multitude d’autres hommes ? Quel est l’homme qui pourrait se flatter que lui seul il pourrait toujours reconnaître l’injustice et la mauvaise foi, sous les dehors trompeurs qu’elles savent si bien emprunter ? La variété prodigieuse des faits, [66] les difficultés qu’on éprouve pour en constater la vérité, les artifices qu’on emploie souvent pour la déguiser, forment un labyrinthe dans lequel on voit s’égarer les magistrats les plus éclairés, les plus intègres, les plus consommés dans l’art de juger. Que serait-ce donc si un homme seul était chargé de ces pénibles et importantes fonctions ? Combien de fois, sans qu’il s’en aperçût, son cœur séduirait-il son esprit ? Quelles facilités n’aurait-on pas pour se ménager cette séduction ? Quelle carrière s’ouvrirait aux prétentions arbitraires et à l’oppression ? À quel excès l’espoir de l’impunité ne multiplierait-il pas les crimes ? Que de comptes à rendre à la justice divine par un tel souverain ! Ce prince infortuné, s’il connaissait le danger de son état, n’oserait lever les yeux vers le ciel.
Je pourrais alléguer beaucoup d’autres raisons pour prouver l’impossibilité sociale de la réunion de la magistrature à l’autorité législative ; mais il serait inutile de m’appesantir sur une vérité connue depuis une multitude de siècles, et dont les conséquences sont mises en pratique chez tous les peuples qu’on peut regarder comme formant des sociétés. Je peux donc avancer, sans craindre d’être contredit, que de la nécessité sociale des lois positives, résulte la nécessité sociale des magistrats. Cependant, quoique tous les hommes soient d’accord sur cet article, il paraît qu’on ne connaît point encore assez les rapports essentiels de cette nécessité avec l’existence de la société ; et c’est par cette raison que je crois nécessaire d’en faire un examen particulier.
[I-146 / 67]
CHAPITRE XIII.↩
Seconde suite du chapitre XI. — Comment s’établit parmi les peuples la certitude de la justice et de la nécessité des lois positives. — Les magistrats sont un des premiers et des plus puissants fondements de cette certitude ; par état ils doivent avoir une connaissance évidente de la raison essentielle des lois positives ; rapports de leurs devoirs essentiels avec la justice et la nécessité des lois. — Ils sont, plus particulièrement que les autres membres de la société, gardiens et défenseurs des lois. — La magistrature est, par le moyen des lois, le lien commun de la société.
Les magistrats dépositaires, gardiens et organes des lois, deviennent, en quelque sorte, des lois vivantes ; et par cette raison, la magistrature occupe nécessairement dans la société la place marquée pour les lois, entre la puissance législatrice et tous ceux qui doivent obéir aux lois. Dans tous les temps on l’a regardée comme formant le lien commun qui unit l’État gouverné à l’État gouvernant ; et c’est à juste titre, car ce lien si précieux est l’ouvrage des lois : sans elles il serait impossible au corps politique de se former. Or tout ce qu’on doit nécessairement attribuer aux lois, on doit également l’attribuer à la magistrature, dont les fonctions sont de faire parler et agir les lois, d’exercer l’autorité des lois, de manifester la volonté des lois, d’en faire l’application, et de leur donner ainsi une existence, une réalité qu’elles ne peuvent obtenir que par le ministère des magistrats qui s’identifient, pour ainsi dire, avec les lois.
Je dis, qui s’identifient, et cette expression n’a rien de forcé ; car si les lois ne peuvent parler que par la bouche du magistrat, les paroles du magistrat ne peuvent être que l’expression des volontés des lois ; elles habitent en lui ; elles vivent et pensent en lui ; et c’est parce que les lois et le magistrat se confondent ainsi, que la sûreté nécessaire aux lois doit être commune à la personne du magistrat comme organe des lois.
Maintenant on doit apercevoir aisément toute l’influence que les magistrats doivent avoir sur la soumission aux lois. La plupart des hommes étant hors d’état de s’élever à une connaissance explicite et évidente de la raison des lois positives, ceux-là, comme je l’ai dit, ne peuvent avoir qu’une certitude de la justice et de la nécessité de ces lois ; mais cette certitude si nécessaire pour fixer leurs esprits, et assurer leur soumission constante aux lois, comment peut-elle s’établir chez eux, si leurs sens ne sont frappés par des preuves suffisantes de cette justice et de cette nécessité ? Or ces preuves, pour être [68] suffisantes, doivent toujours et nécessairement avoir pour fondement le témoignage des magistrats, puisqu’ils sont publiquement reconnus et institués pour être les dépositaires et les gardiens des lois ; puisque comme gardiens et comme juges, ils doivent être éclairés par l’évidence de la raison primitive et essentielle des lois ; puisqu’enfin la sincérité de leur témoignage est encore elle-même attestée, certifiée par l’hommage impartial que lui rend une multitude d’hommes éclairés qui doivent se trouver dans une nation, dès que nous y supposons publique la connaissance évidente de l’ordre essentiel de la société.
Les titres de dépositaires, de gardiens des lois positives, et de la raison primitive et essentielle de ces lois, ne sont point des qualifications purement honorifiques, de vains titres sans fonctions : ce sont au contraire des titres indicatifs de fonctions réelles, de devoirs indispensables dans le magistrat, et dont l’institution est d’une nécessité absolue, comme celle de toutes les autres branches de l’ordre essentiel de la société.
Quoiqu’on puisse dire à juste titre que l’évidence parle et se rend sensible, cependant malgré celle qui doit se trouver dans les lois, nous les reconnaissons pour être muettes, en prenant cette expression dans le sens physique. Or elles peuvent se trouver dans le cas d’avoir à se défendre contre des surprises qui pourraient être faites à la puissance législatrice ; surprises d’autant plus dangereuses, qu’elle doit seule disposer de la force publique, comme on le verra dans les chapitres suivants. Les lois alors n’ont donc à opposer à la volonté de cette puissance que leur justice et leur nécessité. Mais puisqu’elles sont muettes physiquement, comment peuvent-elles mettre en évidence cette justice et cette nécessité ? Dans ce cas, comme dans tous les autres, elles ne peuvent s’exprimer que par la voix de ceux qui sont chargés de parler pour elles : ainsi le magistrat, comme organe physique des lois, est particulièrement chargé de la défense des lois.
Ce que je dis des lois faites nous montre quels sont les devoirs des magistrats par rapport aux lois à faire : comme elles doivent être toutes puisées dans les lois naturelles qui sont la raison primitive et essentielle de toutes les autres lois, l’évidence de cette raison primitive et essentielle est, pour ainsi dire, un dépôt dans leurs mains, et ils en doivent compte à la puissance législatrice, à la nation, à Dieu même, dont cette évidence nous manifeste les volontés suprêmes.
Toutes ces vérités sont si simples, si évidentes par elles-mêmes, qu’il suffit de les présenter dans leur ordre naturel, pour qu’elles deviennent sensibles sans le secours d’aucune démonstration. [69] Puisque les lois sont muettes physiquement, et qu’il faut des lois positives, il faut donc aussi des magistrats qui soient les organes physiques des lois.
Puisque les magistrats sont les organes physiques des lois, il faut donc qu’ils parlent pour les lois et comme les lois, dans tous les cas où les lois ont à parler.
Puisqu’ils doivent parler pour les lois et comme les lois, chaque fois qu’il y a nécessité, il faut donc qu’ils soient tenus de prendre toujours la défense des lois, par conséquent qu’ils soient constitués dépositaires et gardiens des lois.
Puisqu’ils doivent toujours veiller à la garde et à la défense des lois, il faut donc qu’ils aient une connaissance évidente de la justice et de la nécessité des lois, et conséquemment de leur raison primitive et essentielle ; car ce n’est qu’avec cette évidence qu’ils peuvent combattre pour les lois, contre les surprises faites à l’autorité.
Puisqu’ils doivent toujours avoir pour guide l’évidence de la raison primitive et essentielle des lois, le témoignage évident qu’ils rendent aux lois nouvelles, et contre lequel la partie éclairée de la nation ne réclame point, est donc pour les autres hommes une preuve suffisante qui établit en eux la certitude de la justice et de la nécessité de ces nouvelles lois ; or cette certitude étant ce qui assure nécessairement une soumission constante aux lois, la Magistrature se trouve être ainsi le lien commun qui unit l’État gouverné à l’État gouvernant, pour la prospérité commune de ces deux États.
Il ne faut pas croire cependant que les titres de dépositaires et de gardiens des lois n’appartiennent qu’aux magistrats exclusivement : le premier, le vrai dépositaire et gardien général des lois, c’est la nation elle-même à la tête de laquelle est le souverain. Rigoureusement parlant, le dépôt et la garde des lois ne peuvent appartenir qu’à ceux qui sont armés de la supériorité de la force physique pour procurer à ce dépôt la sûreté dont il a besoin essentiellement. Cela posé, c’est la nation en corps qui est naturellement et nécessairement dépositaire et gardienne de ses propres lois, parce qu’il n’est point dans la nation de force physique égale à celle qui résulte de la réunion des siennes. Mais comme cette force nationale n’agit que d’après la volonté du chef qui la commande, on peut dire dans un autre sens, que c’est au souverain que le dépôt et la garde des lois doivent appartenir.
Faute de s’entendre il s’est formé de grands débats sur cet article qui a donné lieu à toutes sortes de prétentions ; mais il est aisé de les terminer en disant : il est physiquement et socialement impossible que la sûreté des lois ait un autre principe que l’évidence de leur justice et de leur nécessité, parce qu’il n’y a que cette évidence qui [70] puisse réunir au soutien des lois, toutes les opinions, toutes les volontés et toutes les forces. Les dépositaires et les gardiens naturels des lois sont donc tous ceux qui se trouvent appelés à posséder cette évidence : ainsi le souverain qui doit toujours la prendre pour son guide, est le dépositaire et le gardien naturel des lois ; ainsi la nation, que je suppose éclairée par l’évidence publique de l’ordre essentiel des sociétés, qui conséquemment doit être composée d’une multitude d’hommes instruits de la raison primitive et essentielle des lois, est aussi leur dépositaire et leur gardien naturel ; ainsi les magistrats, qui par un devoir indispensable de leur état, sont plus particulièrement qu’aucun membre de la société, obligés d’être pénétrés de l’évidence répandue publiquement dans la nation, qui comme juges, deviennent, pour ainsi dire, envers le souverain et la nation, caution de cette évidence et de ses avantages, se trouvent plus particulièrement aussi les dépositaires et les gardiens des lois.
Ce que je viens de dire sur les conséquences résultantes de la qualité de juge, semble exiger quelque développement : si l’obligation d’avoir une connaissance évidente de la justice et de la nécessité des lois, et d’être leur défenseur, est inséparable de l’état du magistrat considéré comme organe des lois, la même obligation est bien plus rigoureuse encore dans le magistrat considéré comme juge, comme ministre de la justice, dont les lois positives ne doivent être que des résultats.
Quelqu’un pourrait-il honnêtement contester que dès qu’une injustice est évidente, il n’est plus permis à aucun homme de lui prêter son ministère ? Quelle que soit la loi naturelle et essentielle qui rende évidente une injustice, cette loi est un ordre de la divinité, dont rien ne peut suspendre l’exécution, sitôt qu’il est évidemment connu. Hélas ! que deviendrait l’humanité, si l’évidence d’une justice absolue ne constituait pas les hommes dans l’obligation étroite de ne pas prêter leur ministère pour la violer. Mais si ce devoir est absolu dans tous les hommes indistinctement, quelle nouvelle force n’acquiert-il pas dans les magistrats, qui, comme ministres de la justice, joignent à l’obligation commune de s’y conformer, l’obligation particulière de la faire observer.
Si vous détruisez le juste et l’injuste absolus, par conséquent l’existence des devoirs absolus, et l’obligation absolue de ne jamais s’en écarter au mépris de leur évidence, je vous défie d’imaginer aucun moyen de donner quelque consistance à la société ; je vous défie d’instituer un pouvoir qui puisse se communiquer sans courir risque de se détruire ; je vous défie d’établir une puissance dont la personne et l’autorité soient en sûreté. [71] Depuis le souverain, quel qu’il soit, jusqu’au dernier de ses sujets, la communication de son autorité souveraine forme une chaîne de pouvoirs intermédiaires et subordonnés les uns aux autres, au moyen de laquelle il tient dans sa main tout ce qui se trouve sous son empire. Tous les dépositaires en sous-ordre de son autorité peuvent être réduits à deux espèces : les uns sont chargés de l’administration de la justice, les autres de la force coercitive : s’il n’est point de devoirs absolus et évidents pour ceux-là, il n’en est point pour ceux-ci : dès lors je ne trouve plus cette chaîne ; elle est rompue, ou plutôt il est impossible qu’elle existe : l’obéissance elle-même n’est plus une chose sur laquelle on puisse compter dans ce système, puisqu’il n’admet aucun devoir absolu. Remarquez en cela comme on ne peut éviter de tomber dans les contradictions les plus absurdes, sitôt qu’on veut s’écarter de l’ordre : on rejette les devoirs absolus pour ne point mettre de bornes à l’obéissance ; et comment ne voit-on pas que par une conséquence nécessaire de ce principe, l’obéissance cesse aussi d’être un devoir, qu’ainsi en voulant l’étendre on la détruit ?
Ceux qui défendent ce système diront peut-être qu’ils ne nient point entièrement l’existence des devoirs absolus, mais qu’ils n’en admettent qu’un seul, qui est celui de l’obéissance : eh bien, j’adopte pour un moment leur façon de penser ; et en conséquence je leur fais observer qu’ils rendent arbitrairement despote quiconque est revêtu d’un commandement particulier. Mais le souverain, dira-t-on, devient despote par ce moyen : quelle erreur ! et moi je vous soutiens qu’il détruit sans ressource son autorité. Le souverain ne peut commander personnellement qu’à un très petit nombre d’hommes qui sont autour de lui ; ceux-ci au contraire commandent à une multitude d’autres hommes : si cette multitude est dans l’obligation absolue de toujours leur obéir, n’est-il pas évident qu’ils se trouvent nécessairement plus forts, plus réellement despotes que le souverain même ? Et s’il reste contre leur despotisme arbitraire quelque ressource, c’est celle que nous trouvons dans la progression de ce même despotisme, qui se communique à tous ceux qui commandent en sous-ordre, et à raison de la portion d’autorité qui leur est confiée. Ainsi celui qui a cent hommes à ses ordres est arbitrairement despote vis-à-vis de ces cent hommes ; celui qui en a mille, l’est aussi vis-àvis d’eux ; de même celui qui commande à vingt mille, à cent mille, le nombre n’y fait rien ; le despotisme arbitraire est le même dans tous les rangs du commandement, quoiqu’il n’en résulte pas la même force.
Voyez-donc dans ce système combien les effets qu’il produit sont contraires à ceux qu’on se propose : tandis qu’on veut rendre le [72] souverain plus indépendant, on le met dans une dépendance qui doit le faire trembler à chaque instant ; et pour vouloir ériger son autorité en pouvoir arbitrairement despotique, on la détruit, en assurant à chacun de ceux qui commandent, une obéissance absolue au gré de leurs volontés arbitraires ; dans ce chaos monstrueux il faut n’avoir aucune sorte de commandement pour ne point être despote ; tous ceux qui en ont un, sont tellement despotiques, qu’au moyen de l’obéissance absolue qui leur est due immédiatement, ils peuvent trouver les moyens de s’affranchir de celle qu’ils doivent à leur tour. De là résulte une chose bien singulière ; c’est que cette chaîne de despotes arbitraires est une chimère ; le despotisme ne réside plus véritablement que dans les commandants les plus inférieurs ; c’est-àdire, dans ceux qui commandent immédiatement aux hommes dont l’obéissance est le partage unique : cela posé, plus de despotisme dans le souverain.
Nous devons donc regarder comme un crime de lèse-majesté divine et humaine, l’action de soutenir qu’il n’est point de devoirs absolus dont on ne peut s’écarter, sitôt qu’ils sont évidents. En vain on m’objectera que cette règle est dangereuse, en ce qu’on peut prendre pour évident ce qui ne l’est pas. Cette méprise ne peut avoir lieu que dans un état d’ignorance, état où je ne connais rien dont on ne puisse abuser, et qui ne soit susceptible d’inconvénient. Je veux bien que dans cet état de désordre nécessaire cette loi sainte ne soit pas suivie ; mais qu’on me dise donc celle qu’on pourra lui substituer. Dans l’état d’ignorance tout est arbitraire, et par cette raison l’application de cette loi serait arbitraire aussi. Mais la cause des abus qui en résulteraient, serait dans l’ignorance, et non dans la loi ; ainsi ces mêmes abus ne sont point à craindre partout où l’évidence de l’ordre est publiquement répandue, et c’est le cas que nous supposons.
Il est donc certain qu’aucun homme, sans se rendre coupable envers le ciel et la terre, ne peut se charger de juger d’après des lois évidemment injustes ; il cesserait alors d’être un ministre de la justice, pour devenir un ministre d’iniquité. Si quelque loi, par exemple, ordonnait qu’un homme fût condamné au dernier supplice, sur la seule dénonciation d’un autre homme, et même sans aucune preuve de l’existence du délit imputé, n’est-il pas évident qu’une telle loi serait homicide ? N’est-il pas évident encore que le barbare, le furieux qui prononcerait des condamnations d’après cette loi monstrueuse, en partagerait l’atrocité, et deviendrait homicide comme elle ?
Il faut pourtant ou aller jusqu’à dire qu’on pourrait être, sans crime, l’organe d’une telle loi, et le ministre de ses abominations, ou convenir qu’un magistrat ne doit prêter son ministère à aucune loi [73] évidemment injuste ; car s’il le peut pour une loi, il le peut pour toutes, quelque coupables qu’elles soient ; l’évidence des excès, des outrages faits dans l’humanité à la divinité même ne peut plus l’arrêter.
Un magistrat qui jugerait sur des lois dont l’injustice lui serait évidente, agirait en cela comme un médecin qui traiterait ses malades suivant des méthodes prescrites par une autorité aveugle sur cet objet, et qu’il connaîtrait évidemment pour n’être propres qu’à leur donner la mort. Mais, me dira-t-on, ne peuvent-ils pas pécher par ignorance ? Non ; ils ne le peuvent pas, parce qu’étant obligés de ne se décider que d’après l’évidence, dans tous les cas qui en sont susceptibles, ils ne doivent point embrasser une profession pour laquelle ils n’ont pas les connaissances suffisantes. Qu’est-ce qui oblige un homme de se faire médecin, quand son ignorance l’expose à commettre journellement des assassinats ? Qu’est-ce qui oblige un homme de se faire magistrat, quand son ignorance l’expose journellement à dégrader la magistrature, à trahir les intérêts qui lui sont confiés ? Comment peut-il se regarder comme un ministre de la justice, s’il n’en a pas une connaissance évidente ? Et comment peutil connaître évidemment la justice, s’il ne la voit pas évidemment dans les lois, ou plutôt dans la raison primitive et essentielle des lois ?
Quelque frappants, quelque démonstratifs que ces arguments puissent être, ils acquièrent encore une nouvelle force, pour peu qu’on fasse attention à la grande simplicité de l’ordre, de ces lois naturelles et essentielles qui doivent être la raison primitive de toutes les autres lois. Propriété et liberté, voilà les deux points fondamentaux de l’ordre essentiel des sociétés. Une fois qu’on est pénétré de la justice et de la nécessité de ces deux lois divines ; une fois que l’évidence de leur justice et de leur nécessité est publiquement répandue dans une nation, il n’est plus possible que la conformité ou la contradiction des nouvelles lois avec les principes immuables de l’ordre ne soient pas évidentes, non seulement pour le corps des magistrats, mais encore pour tous les hommes qui n’ont point perdu l’usage de la raison.
De même que le médecin est tenu d’avoir une connaissance évidente de la nature et des effets des remèdes qu’il est dans le cas d’employer, de même aussi le magistrat est tenu d’avoir une connaissance évidente de la justice et de la nécessité des lois qu’il se charge librement de faire observer. Il ne lui est donc permis de juger les hommes qu’après avoir pénétré scrupuleusement dans la raison des lois, et avoir acquis l’évidence de leur justice ; voilà son premier devoir indispensable ; ajoutez-y maintenant une seconde obligation qui est également essentielle en lui, celle de ne jamais prêter son [74] ministère à des lois évidemment injustes, et voyez s’il est possible qu’il ne soit pas le dépositaire, le gardien et le défenseur des lois ; s’il est possible que le témoignage public qu’il rend librement à la sagesse des lois nouvelles, ne soit pas regardé comme le résultat d’une évidence acquise par un examen suffisant ; s’il est possible qu’un témoignage de cette importance, vérifié, pour ainsi dire, et contrôlé par la publicité des connaissances évidentes répandues dans la nation, n’établisse pas nécessairement la certitude de la justice et de la nécessité de ces mêmes lois dans tous ceux qui ne peuvent en acquérir une connaissance évidente ; s’il est possible enfin d’imaginer un motif de persuasion qui puisse suppléer celui que fournit un témoignage d’autant plus authentique, qu’il ne doit et ne peut s’annoncer, que comme un jugement qu’un devoir rigoureux ne permet de rendre qu’après que l’évidence même l’a dicté.
[I-166 / 75]
CHAPITRE XIV.↩
Développement de la seconde classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — L’autorité tutélaire consiste dans l’administration de la force publique dont le premier principe doit être la force intuitive et déterminante de l’évidence. — Premières observations tendant à prouver que le pouvoir législatif est inséparable de cette autorité.
C’est à juste titre que la seconde classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société, nous représente l’autorité tutélaire toujours armée de la force publique, et toujours précédée par l’évidence : il est sensible que l’administration de la force publique ne peut jamais être séparée de l’autorité tutélaire ; car c’est dans cette force que réside l’autorité. Il est sensible aussi que toutes les résolutions de cette autorité doivent être dictées par l’évidence de leur justice et de leur nécessité ; car la force publique, qui est elle-même l’autorité, n’acquiert de la consistance qu’autant que la force intuitive et déterminante de l’évidence en est le premier principe : le développement de cet ensemble est peut-être la partie la plus intéressante de cet ouvrage.
Ce que nous nommons autorité est le droit de commander, qui ne peut solidement exister, c’est-à-dire, ne rien perdre dans le fait de ce qu’il est dans le droit, sans le pouvoir physique de se faire obéir. Un tel droit n’en serait plus un, si dans le fait l’obéissance était arbitraire, si elle n’était dépendante que de la seule volonté de celui qui obéit. Mais pour qu’elle ne le soit pas, il faut qu’elle se trouve assujettie par un pouvoir physique qui ne peut résulter que de la supériorité de la force physique.
Le droit de commander et le pouvoir physique de se faire obéir ne sont donc exactement qu’une seule et même autorité présentée sous deux noms différents, parce qu’il est deux différentes façons de la considérer : à raison de la manière dont elle s’établit, elle est un droit, parce qu’elle est le résultat d’une convention, et plus encore parce que la justice et la nécessité de ses volontés doivent toujours être marquées au coin de l’évidence ; à raison de la manière dont elle doit agir sur la résistance que des désirs déréglés pourraient lui opposer, elle est un pouvoir physique, une force coercitive formée naturellement et nécessairement par la réunion des volontés qui ont fait entre elles cette convention, et qui toutes doivent être enchaînées par cette évidence dont je viens de parler. [76] Ou le principe de la réunion des volontés est évident, ou il ne l’est pas : au premier cas, ce principe est immuable, et la réunion se trouve avoir la plus grande solidité possible ; au second cas, ce principe, qui n’est qu’arbitraire, n’a rien de constant, et la réunion doit éprouver toutes les variations dont une opinion arbitraire est susceptible.
La réunion des volontés pour opérer celle des forces particulières ; la réunion des forces particulières pour former une force commune, une force publique ; le dépôt de cette force publique dans la main d’un chef, par le ministère duquel elle puisse commander et se faire obéir ; voilà comment s’établit l’autorité tutélaire ; voilà comme elle n’est autre chose qu’une force physique résultante d’une réunion de volontés ; et par conséquent comme il lui est impossible d’être ni puissante, ni bien affermie, si la force intuitive et déterminante de l’évidence n’est pas le principe de cette réunion.
Dans un sens on peut dire que le droit de commander n’appartient qu’à l’évidence ; car dans l’ordre naturel, l’évidence est l’unique règle de conduite que l’auteur de la nature nous ait donnée. Mais tous les hommes ne sont pas également susceptibles de saisir l’évidence ; et quand ils le seraient tous, l’intérêt du moment est souvent si pressant en eux, que l’évidence du devoir ne pourrait suffire pour contenir l’appétit des jouissances, quand il se trouverait désordonné. Il faut donc que parmi les hommes, l’autorité naturelle de l’évidence soit armée d’une force physique et coercitive, et qu’ainsi la puissance législatrice, quoiqu’elle commande au nom de l’évidence, dispose de la force publique, pour assurer l’observation de ses commandements. Quel que soit le dépositaire ou l’administrateur de la force publique, le pouvoir législatif est son premier attribut ; car il faut que l’évidence nous soit connue avant qu’elle puisse asservir nos volontés, et que les lois soient instituées avant que l’autorité puisse s’occuper du soin de les faire observer. Dicter des lois positives c’est commander ; et par la raison que nos passions sont trop orageuses pour que le droit de commander puisse exister sans le pouvoir physique de se faire obéir, le droit de dicter des lois ne peut exister sans le pouvoir physique de les faire observer. Il ne peut donc jamais être séparé de l’administration de la force publique et coercitive. Ainsi la puissance exécutrice, celle qui dispose de cette force, est toujours et nécessairement puissance législatrice.
Si, pour former deux puissances, on place dans une main le pouvoir législatif, et dans une autre le dépôt de la force publique, à laquelle des deux faudra-t-il obéir, lorsque les lois de la première et les commandements de la seconde seront en contradiction ? Si l’obéissance alors reste arbitraire, tout sera dans la confusion ; et [77] comme on ne peut obéir en même temps à deux commandements contradictoires, il faut qu’il soit irrévocablement décidé lequel doit être exécuté par préférence : or il est évident que cette décision ne peut avoir lieu, sans détruire une de ces deux puissances, pour n’en plus reconnaître qu’une seule dominante, à la voix de laquelle toutes les volontés, toutes les forces doivent se rallier pour faire exécuter constamment ses commandements, sans que rien puisse en empêcher. Ainsi quelques tournures, quelques modifications qu’on veuille donner à un tel système, il arrivera nécessairement que ces deux autorités se réuniront, et se confondront dans une seule ; que la puissance législatrice deviendra puissance exécutrice, ou que la puissance exécutrice deviendra puissance législatrice.
La manière dont se forme la force publique démontre bien évidemment que le pouvoir législatif est inséparable de l’administration de cette force : nous venons de voir qu’elle n’est que le produit d’une réunion de volontés ; qu’ainsi elle ne peut être solidement établie, qu’autant que la force intuitive et déterminante de l’évidence est le principe de cette réunion. Mais dès que les lois positives ne doivent être elles-mêmes que des résultats évidents des lois naturelles et essentielles de la société, il faut nécessairement ou qu’elles ne soient pas ce qu’elles doivent être, ou que la force publique leur soit acquise par l’évidence de leur justice et de leur nécessité. Comment donc se pourrait-il que la force publique ne fût pas constamment aux ordres du législateur, puisque le principe constitutif de cette force doit toujours être dans les lois qu’il établit ?
Comme la vérité et l’erreur ne peuvent jamais donner les mêmes résultats, les opinions, les volontés et les forces peuvent très bien se diviser dans une nation qui n’a nulle connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel de la société ; et de cette division peuvent naître plusieurs autorités. Mais un tel désordre ne peut avoir lieu partout où une connaissance explicite et évidente de cet ordre essentiel est publiquement établie : l’évidence, qui est une, réunit tous les esprits, toutes les opinions ; il n’est plus alors qu’une seule volonté, une seule force publique, une seule autorité ; ainsi puisqu’elle est seule et unique, elle se trouve être nécessairement et tout à la fois puissance législatrice et puissance exécutrice : à elle appartient le droit de dicter les lois ; à elle appartient le pouvoir de les faire observer.
[I-174 / 78]
CHAPITRE XV.↩
Suite du chapitre précédent. — Dieu est le premier auteur des lois positives. — Définition du pouvoir législatif parmi les hommes : le législateur ne fait qu’appliquer les lois naturelles et essentielles aux différents cas qu’il est possible de prévoir, et leur imprimer, par des signes sensibles pour tous les autres hommes, un caractère d’autorité qui assure l’observation constante de ces lois. — Rapports de l’autorité législative avec celle de l’évidence. — Le pouvoir législatif est indivisible. — Combien les devoirs essentiels des magistrats lui sont précieux à tous égards : au moyen de ces devoirs et de l’évidence de l’ordre, ce pouvoir est absolument sans inconvénients dans les mains de la puissance exécutrice.
On doit remarquer ici que le terme de faire des lois est une façon de parler fort impropre, et qu’on ne doit point entendre par cette expression, le droit et le pouvoir d’imaginer, d’inventer et d’instituer des lois positives qui ne soient pas déjà faites, c’est-à-dire, qui ne soient pas des conséquences nécessaires de celles qui constituent l’ordre naturel et essentiel de la société. Une loi positive ne peut jamais être indifférente au point de n’être ni bonne ni mauvaise ; car elle est nécessairement l’un ou l’autre, selon qu’elle est ou conforme ou contraire à cet ordre essentiel. Si elle était absolument indifférente, elle n’aurait point d’objet positif ; et dès lors elle ne serait plus une loi positive. Mais comme le pouvoir législatif ne peut être institué que pour établir de bonnes lois positives, des lois dont la raison primitive soit dans celles que Dieu nous a dictées lui-même, et selon lesquelles toute société doit être gouvernée, ce pouvoir n’est plus dans le législateur que le droit exclusif de manifester par des signes sensibles aux autres hommes, les résultats des lois naturelles et essentielles de la société, après qu’ils lui sont devenus évidents, et de les sceller du sceau de son autorité, pour leur imprimer un caractère qui soit pour tous les esprits et toutes les volontés le point fixe de leur réunion.
Cette définition, en nous apprenant que les lois positives doivent porter l’empreinte d’une autorité qui assure leur observation, nous ramène encore à la vérité que je viens de démontrer, à reconnaître que le pouvoir législatif est inséparable de l’administration de la force publique ; car sans cette administration le législateur, et par conséquent les lois positives seraient sans autorité.
J’ai dit précédemment que les lois positives n’étaient que l’application et le développement des lois naturelles et essentielles ; le pouvoir législatif n’est donc autre chose que le pouvoir d’annoncer [79] des lois déjà faites nécessairement, et de les armer d’une force coercitive : ainsi de quelque point que nous partions nous nous trouvons toujours dans l’impossibilité de séparer le pouvoir législatif et l’administration de la force publique ; car les lois positives ne deviennent ce qu’elles sont, qu’autant que cette force leur devient propre.
Quelque simples, quelque évidentes que soient les vérités contenues dans le chapitre précédent, c’est encore aujourd’hui une grande question parmi les hommes, de savoir dans quelles mains le pouvoir législatif doit être déposé pour le plus grand bien de la société ; mais tous leurs débats sur cet article tiennent à une fausse idée qu’on s’est formée du pouvoir législatif, et qui a pris naissance dans les abus qu’on a faits de ce pouvoir, dès les premiers moments qu’il a commencé à s’établir : alors l’institution d’une puissance exécutrice n’était point l’ouvrage de l’évidence ; par cette raison les volontés et les forces ne pouvaient jamais avoir un point fixe de réunion.
Comme on a vu beaucoup de mauvaises lois se succéder les unes aux autres dans toutes les sociétés particulières, sans porter d’autre caractère que celui d’une volonté arbitraire et momentanée, on s’est persuadé que l’autorité législative était le pouvoir de faire arbitrairement toutes sortes de lois positives, quelque injustes, quelque déraisonnables qu’elles pussent être : on n’a pas vu que ces lois bizarres n’étaient que des fruits de l’ignorance ; on n’a pas vu que si les hommes peuvent faire de mauvaises lois, ce n’est que parce qu’ils peuvent se tromper ; que se tromper et faire de mauvaises lois est un malheur, un accident de l’humanité, et nullement un droit, une prérogative de l’autorité ; que le pouvoir législatif n’autorise, en quelque sorte, à faire de mauvaises lois, que parce qu’il n’est point seul et par lui-même un préservatif contre la surprise et l’erreur ; que pour l’en garantir, il faut que le législateur soit aidé par un concours de lumières et de devoirs établis dans des hommes qui, sans participer en rien à son autorité, doivent cependant se réunir et faire force autour de lui ; que selon qu’il est ou n’est pas secondé par ces lumières et ces devoirs, le pouvoir législatif est ou n’est pas susceptible d’abus ; qu’ainsi les inconvénients qu’on lui attribuait, ne sont point dans ce pouvoir même, mais seulement dans des circonstances qui concouraient à l’égarer, et qui ne peuvent se rencontrer que dans des temps d’ignorance.
Il n’est jamais entré dans l’esprit d’un législateur que son autorité lui donnât le droit de faire des lois évidemment mauvaises : en tous cas, il serait tombé dans une singulière contradiction ; car un droit suppose une convention expresse ou tacite, une réunion de volontés déterminées librement par un intérêt commun, ou par la force d’une nécessité absolue dont l’évidence leur est sensible. Comment donc [80] pourrait-on s’imaginer que cette réunion, qui n’a qu’un bien pour objet, pût se perpétuer, s’il en résultait évidemment un mal ? On ne peut espérer de maintenir cette réunion par la force ; car la force n’existe qu’après la réunion et par la réunion. Qu’on se rappelle ici que dans la société les droits ne sont établis que sur les devoirs ; or certainement le premier devoir d’un législateur doit être de ne point faire des lois évidemment contraires aux intérêts de la société, puisque son autorité n’est instituée que pour protéger ces mêmes intérêts.
Si un despote asiatique me soutenait qu’il est en droit de faire une loi évidemment mauvaise, je lui dirais : Si vous en pouvez une, vous en pouvez deux, vous les pouvez toutes, quelles qu’elles soient : essayez-donc d’en faire une pour permettre l’homicide volontaire, ou pour défendre de cultiver. Là, sans doute ses prétentions s’arrêteraient ; et dans la raison qu’il sentirait de lui-même pour ne pas les porter jusqu’à cet excès, je puiserais des arguments simples, mais invincibles, qui lui feraient comprendre que dans aucun cas son autorité ne peut empiéter sur le domaine de l’évidence.
Les vérités dont il s’agit ici demandent une grande précision : il faut bien saisir que tous mes raisonnements sont fondés sur la force irrésistible de l’évidence que je suppose acquise à des hommes qu’on voudrait assujettir à des lois évidemment contraires à l’ordre et au bonheur de la société. Ainsi ne perdons pas de vue cette supposition ; car sans l’évidence nous sommes forcés d’abandonner les sociétés à tous les égarements de l’opinion, sans que rien puisse remédier aux maux qui doivent nécessairement en résulter.
Je conviens donc que partout où l’on vit dans l’ignorance sur ce qui constitue l’ordre naturel et essentiel des sociétés, un législateur peut, comme je l’ai dit, faire de mauvaises lois, parce qu’on n’en connaît pas de meilleures ; mais ces mauvaises lois ne le sont pas évidemment ; car si l’évidence de ce qu’elles ont de vicieux se manifestait, l’ignorance disparaîtrait, et dès lors l’intérêt commun et évident du législateur et de la nation conduirait à la réforme de ces lois, ou du moins les réduirait à rester sans aucune exécution.
La funeste prérogative de pouvoir faire de mauvaises lois suppose donc toujours l’ignorance dans le législateur et dans la nation ; elle suppose que les vices de ces lois ne sont, et ne peuvent être éclairés par l’évidence : ainsi quelque extension qu’on veuille donner à l’autorité législative, toujours est-il vrai qu’on ne pourra jamais lui attribuer le droit de pouvoir contredire manifestement l’évidence, et que le droit de dicter des lois sera nécessairement établi sur le devoir essentiel de n’en point faire qui soient évidemment destructives des biens qu’elles doivent assurer à la société. [81] Mais, me dira-t-on, ce devoir essentiel n’est point, par lui-même, une sûreté : qu’est-ce donc qui peut empêcher la puissance législatrice de s’en écarter ? À cela je réponds que ce sont les intérêts personnels et évidents de cette puissance, qui ne peut trouver que dans l’ordre son meilleur état possible ; que c’est encore cette force irrésistible que l’évidence de l’ordre acquiert par sa publicité : voilà les cautions qui sont la sûreté que vous demandez ; sûreté d’autant plus complète, que d’un côté vous ne pouvez supposer dans la puissance législatrice, l’intention d’anéantir un devoir qui évidemment est tout à son avantage ; tandis que d’un autre côté il n’est pas au pouvoir des hommes de faire perdre à l’évidence l’empire absolu qu’elle exerce naturellement sur eux, et d’empêcher que par le moyen de sa publicité, son autorité despotique ne soit toujours le principe constant d’une force physique à laquelle toute autre force est obligée de céder.
On voit maintenant ce que j’ai voulu dire par ce concours de lumières et de devoirs établis dans des hommes qui, sans partager aucunement l’autorité législative, doivent cependant faire force pour mettre le législateur à l’abri des surprises et de l’erreur : ces hommes sont les magistrats qui ne peuvent rendre d’après les lois, une justice qui n’est pas dans les lois ; qui avant de juger les autres hommes, sont ainsi tenus d’avoir une connaissance évidente de la justice et de la nécessité des lois ; qui ne peuvent, sans crime, sans cesser d’être des ministres de la justice, prêter leur ministère à des lois évidemment injustes ; qui par une suite des devoirs dont ils sont spécialement chargés envers le souverain et la nation, se trouvant plus particulièrement que leurs autres concitoyens, dépositaires et gardiens, non seulement des lois positives, mais encore des lois naturelles et essentielles instituées pour être la raison primitive des autres lois, doivent toujours être éclairés par l’évidence de cette raison, pour la faire connaître au législateur, dans tous les cas où on serait parvenu à égarer son opinion, à lui suggérer des lois contraires à ses véritables intentions, à ses propres intérêts, et à ceux des autres membres de la société.
Quelqu’un s’imaginera peut-être que les devoirs de la magistrature, tels que je les représente ici, sont destructifs du pouvoir législatif : cette méprise serait d’autant plus grossière, que ces mêmes devoirs ne peuvent que procurer à ce pouvoir, la plus grande consistance et la plus grande solidité possible, sans jamais lui porter la plus légère atteinte ; mais pour démontrer clairement cette vérité, il faut remonter à la véritable idée qu’on doit se former du pouvoir législatif. [82] On vient de voir que le pouvoir législatif n’est point le pouvoir de faire arbitrairement des lois évidemment mauvaises, évidemment destructives des biens qu’on attend de l’exercice de ce pouvoir, et qui sont l’objet de son institution. Les hommes en se réunissant en sociétés particulières pour être plus heureux, n’ont jamais pu se proposer un établissement qui dût évidemment et nécessairement les rendre plus malheureux : une contradiction si sensible, si évidente entre la fin et les moyens n’est pas dans l’humanité : nous pouvons bien nous tromper, ne pas nous rendre à l’évidence faute de la connaître, mais nous n’allons pas jusqu’à la contredire sciemment et de propos délibéré ; et quand nous avons formé une volonté, il n’est pas en nous de prendre pour arriver à notre but, une voie qui nous en écarte évidemment.
Si cependant il était une nation assez déraisonnable pour instituer chez elle un tel pouvoir arbitraire, je conviens qu’il ne pourrait se concilier avec les devoirs rigoureux dont les magistrats sont chargés dans l’ordre naturel et essentiel des sociétés ; mais aussi dans une telle nation ces devoirs n’existeraient pas, et les magistrats ne seraient pas magistrats. La preuve que j’en donne est que dans une société les devoirs dans les uns supposent nécessairement des droits dans les autres, et que là où il n’y aurait point de droits il n’y aurait point de devoirs. Or les membres de cette nation n’auraient entre eux aucuns droits réciproques ; car des droits et un pouvoir arbitraire pour en ordonner au gré de son caprice, sont deux choses évidemment incompatibles. Comme on ne connaîtrait ainsi dans une telle nation que des ordres arbitrairement donnés, et que, rigoureusement parlant, elle serait sans droits et sans lois, il en résulterait qu’elle serait aussi sans magistrats : l’autorité n’aurait besoin que d’esclaves pour être les instruments de ses volontés arbitraires.
Abandonnons cette hypothèse chimérique pour nous rapprocher de la nature et du vrai : le pouvoir législatif n’est au fond que le pouvoir d’instituer de bonnes lois positives : or de bonnes lois positives sont des lois parfaitement conformes à l’ordre naturel et essentiel des sociétés ; elles ne sont donc bonnes qu’autant qu’elles sont puisées dans l’évidence de cet ordre essentiel ; qu’elles sont, en un mot, dictées par cette évidence même au législateur : mais dans ce cas, ses volontés ne peuvent jamais rencontrer d’opposition ni dans les magistrats, ni dans la nation, dès que nous la supposons éclairée.
La législation positive peut être regardée comme un recueil de calculs tout faits ; car les lois positives ne sont que les résultats d’un examen dans lequel on a, pour ainsi dire, calculé les droits et les devoirs essentiels de chaque membre de la société dans les cas [83] prévus par ces lois. Lorsque ces calculs sont justes, ils ne peuvent éprouver aucune contradiction ; plus on les vérifie et plus leur justesse devient manifeste et publique ; mais s’ils ne le sont pas, leur erreur est évidente pour quiconque est en état de calculer ; et s’il est des magistrats qui soient tenus de prendre ces calculs pour règles de leurs jugements, il est évident qu’ils ne le peuvent pas, à moins que ces calculs ne soient réformés : au lieu de rendre justice, ils feraient des injustices évidentes, ce qui serait en eux le comble de l’atrocité. En pareil cas cependant on ne pourrait pas dire que ceux qui auraient relevé de telles erreurs, partagent ou détruisent l’autorité à laquelle elles seraient échappées au moment qu’elle aurait dressé ces calculs pour qu’on s’y conformât ; elle conserverait toujours dans son entier la plénitude du pouvoir législatif, qui certainement ne peut jamais s’étendre jusqu’à faire qu’une erreur évidente devienne une vérité : Dieu même n’a pas un tel pouvoir ; et quelque étendue que puisse être l’autorité législative, elle ne peut jamais rendre possible dans un homme ce qui est impossible dans Dieu.
Les lois positives ne devant rien avoir que d’évident, il ne peut donc jamais se trouver de la contrariété dans les opinions sur le fait de leur institution, que par une méprise ou une erreur qui n’est jamais aussi dans les intentions de la puissance législatrice ; car il est de son intérêt personnel de ne rien instituer qui soit évidemment contraire aux lois naturelles et essentielles qui constituent son meilleur état possible à tous égards, et doivent être la raison primitive de toutes ses volontés. Mais ces sortes de méprises ou d’erreurs ne peuvent avoir lieu dans une société où la connaissance évidente de l’ordre est publique, où, par conséquent, la puissance législatrice elle-même, le corps des magistrats et la majeure partie de la nation sont toujours et nécessairement éclairés par cette évidence, et se trouvent ainsi n’avoir qu’un même esprit, et qu’une même volonté.
Il est donc certain que les devoirs des magistrats sont entièrement à l’avantage de l’autorité législative dans une nation instruite telle que nous la supposons. Cette autorité, dont les intérêts personnels sont en tout point les mêmes que ceux de la nation, n’a rien à craindre que les méprises ; et de là nous pouvons juger combien doit lui être utile et précieux un corps de citoyens institués pour être, plus particulièrement encore que tous les autres, dépositaires et gardiens de l’évidence même ; qui en cette qualité sont chargés de veiller sans cesse autour de l’autorité législative ; de placer toujours entre elle et la mauvaise volonté des hommes ignorants ou mal intentionnés, le bouclier impénétrable de l’évidence ; d’assurer aux lois enfin une soumission générale et constante, en établissant la certitude de leur [84] sagesse, dans tous ceux qui ne sont pas en état d’en acquérir par eux-mêmes une connaissance évidente.
L’autorité législative ne peut avoir que l’ignorance pour ennemi : celui qui a posé les bornes de nos connaissances évidentes, a en même temps aussi posé les bornes de cette autorité ; or c’est vouloir la détruire que de chercher à lui donner ou plus ou moins d’étendue. Il n’y a point de milieu entre se conformer à l’ordre naturel et essentiel des sociétés, ou renverser ce même ordre ; car il n’est susceptible ni de plus ni de moins, attendu qu’il fait partie de l’ordre physique auquel les hommes ne peuvent rien changer. Cet ordre est ce qui procure les plus grands avantages possibles à l’État gouvernant et à l’État gouverné ; et l’autorité législative ne peut s’en écarter qu’au préjudice de l’un et de l’autre : pour qu’elle trahisse ses intérêts personnels dans ceux de la nation, il faut donc qu’elle soit séduite ; or elle ne peut l’être, qu’autant que l’ignorance rend possible la séduction. Mais dans ce cas cette autorité court des risques évidents ; car le propre de l’ignorance est de précipiter les hommes dans l’arbitraire ; par conséquent de rendre tout incertain, inconstant, variable en un mot au gré des opinions que rien ne peut fixer, et dont il est impossible de prévoir les écarts.
On me désapprouvera peut-être de revenir si souvent sur la même vérité ; mais aussi tout m’y ramène malgré moi : la force irrésistible de l’évidence est le seul fondement solide sur lequel on puisse établir un pouvoir législatif : la soumission aux lois ne peut être ni vraie, ni générale, qu’autant qu’elle est d’accord avec nos volontés, et elle ne peut l’être, qu’autant que l’évidence, ou du moins la certitude de la sagesse des lois est répandue dans la nation.
M’objecterait-on que l’autorité législative, disposant de la force publique, peut assurer, par le moyen de cette force, l’observation de ses lois, quelles qu’elles soient ; mais, comme on l’a déjà vu, cette force publique n’existe point par elle-même ; elle est le produit d’une réunion de plusieurs forces : or pour opérer cette réunion il faut recourir à la force intuitive et déterminante de l’évidence, ou à son défaut, employer des moyens dont on ne peut se servir sans les détruire, et qui s’éteignent tous les jours, quand les lois positives sont destructives de l’ordre essentiel des sociétés. Dans ce dernier cas, une telle autorité est réduite à devenir elle-même l’instrument de sa perte, à ne pouvoir chercher sa conservation que dans des expédients qui ne peuvent qu’accélérer sa chute.
Les bornes de nos connaissances évidentes sont donc les bornes naturelles du pouvoir législatif, parce qu’il n’y a que l’évidence qui puisse réunir constamment tous les esprits et toutes les volontés dans un même point d’obéissance : la force physique et publique, établie [85] sur la force irrésistible de l’évidence, se perpétue d’elle-même ; cette force irrésistible tient à la constitution de l’homme ; elle s’arme de ce qui est en lui pour dominer sur lui ; elle subjugue ses volontés sans offenser sa liberté ; elle ennoblit ainsi l’obéissance en la faisant participer à la sagesse du commandement ; elle est celle enfin par laquelle il a plu au Créateur que le genre humain fût invariablement gouverné, et conséquemment la seule qui puisse convenir à l’établissement du pouvoir législatif.
Mais toutes fois que cette force naturelle de l’évidence sera le fondement du pouvoir législatif, il est clair qu’il embrassera tout ce qui peut devenir évident, et qu’il sera socialement impossible de le diviser : tous les esprits étant ralliés à l’évidence, il ne se trouvera plus qu’une seule et unique volonté, par conséquent une seule et unique autorité. Ce n’est donc que par un effet naturel de l’ignorance, qu’il peut arriver que ce pouvoir soit partagé dans plusieurs mains : ainsi l’ignorance, comme contraire à l’unité d’autorité, et comme propre à lui donner une extension démesurée, qui ne peut que lui devenir funeste, est pour l’autorité législative un écueil dangereux, et le seul dont elle doit toujours s’éloigner.
On pourra peut-être m’opposer encore que des exemples multiples de tous les pays et de tous les siècles prouvent que la magistrature n’est point un préservatif contre l’institution des mauvaises lois ; mais ces exemples sont-ils choisis chez des nations qui avaient une connaissance évidente de l’ordre, ou appartiennent-ils à des peuples livrés à l’arbitraire, parce qu’ils l’étaient à l’ignorance et à l’erreur ? Dans ce dernier cas l’objection militerait pour moi, et non contre moi : les effets du désordre et ceux de l’ordre ne peuvent jamais se ressembler ; et certainement on ne peut rien conclure des uns aux autres : dans un état de désordre tout tend au mal, et dans l’ordre tout tend au bien ; au moyen de quoi le mal arrive nécessairement dans le premier, et le bien nécessairement dans le second.
Je ne jette les yeux sur aucune nation, sur aucun siècle en particulier : je cherche à peindre les choses telles qu’elles doivent être essentiellement, sans consulter ce qu’elles sont ou ce qu’elles ont été, dans quelque pays que ce soit. Comme la vérité existe par elle-même, qu’elle est vérité dans tous les lieux et dans tous les temps, sitôt que par l’examen et le raisonnement, nous sommes parvenus à la connaître avec évidence et dans toutes les conséquences pratiques qui en résultent, les exemples qui paraissent contraster avec ces conséquences, ne prouvent rien, si ce n’est que les hommes qui s’en sont écartés, n’avaient pas une connaissance évidente de cette vérité, et que leur ignorance leur a fait perdre les avantages qu’ils en auraient retirés.
[86]
L’ordre est un assemblage de différentes causes agissant réciproquement les unes sur les autres : détachez un seul de ses ressorts, les autres n’ont plus d’action. Si, par exemple, vous supposez une nation ignorante, je ne sais plus par quels moyens vous parviendrez sûrement à rassembler dans le corps de la magistrature, toutes les lumières qu’il doit avoir ; comment vous pourrez le maintenir constamment dans l’état où il doit être ; comment vous le préserverez toujours de la tiédeur et des influences d’un intérêt particulier désordonné. Il faut donc dans cette hypothèse, que les magistrats restent privés de la connaissance explicite et évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, et des devoirs essentiels que cet ordre leur impose ; mais alors l’autorité législative se trouve sans défense contre la surprise et l’erreur ; les intérêts de cette autorité même, et ceux de toute la société sont compromis, et de là naissent nécessairement des abus qu’on regrette, mais trop tard, parce qu’on n’apprend à les connaître que par les effets funestes dont ils sont toujours suivis. Il est certain que l’ordre ne peut être observé qu’autant qu’il est suffisamment connu ; il est certain encore qu’il n’est suffisamment connu que lorsqu’il l’est avec toute l’évidence dont il est susceptible ; il est certain enfin que s’il est des hommes qui soient nécessairement obligés d’en avoir une connaissance évidente, ce sont principalement les magistrats, puisque sans cette connaissance ils ne peuvent être véritablement magistrats. Ainsi toute société dont les institutions tendraient à les dispenser de la nécessité de cette connaissance évidente, serait dans un état de désordre ; et les malheurs contre lesquels les magistrats ne lui auraient été d’aucun secours, ne pourraient être proposés comme exemples, pour prouver que dans l’état contraire, dans un état conforme à l’ordre, leur ministère, aidé de la publicité de cette évidence, n’est pas ce qui doit constamment nous garantir de ces mêmes malheurs.
[I-198 / 87]
CHAPITRE XVI.↩
Le pouvoir législatif ne peut être exercé que par un seul. — Examen particulier du système qui défère le pouvoir législatif à la nation en corps : contradictions évidentes que ce système renferme.
Que le droit de dicter des lois qui ne sont que l’expression de l’évidence, ne puisse être séparé du droit de disposer des forces que cette même évidence réunit au soutien de ses lois, et qu’ainsi la puissance législatrice et la puissance exécutrice ne puissent être qu’une seule et même puissance, je crois que ce sont des vérités suffisamment démontrées. La grande question est donc de savoir dans quelles mains il convient mieux de placer la puissance exécutrice ; s’il est dans l’ordre essentiel des sociétés qu’il n’y ait qu’un seul dépositaire de la force publique, ou si cet ordre permet que cette force se partage entre plusieurs.
On ne peut former cette question qu’autant qu’on suppose qu’il s’agit d’un gouvernement à instituer parmi des hommes vivants dans l’ignorance, et n’ayant nulle idée de l’ordre naturel et essentiel des sociétés : partout où règne une connaissance évidente et publique de cet ordre, il est physiquement impossible qu’il puisse subsister un autre gouvernement que celui d’un seul. Je réserve pour les chapitres suivants la démonstration évidente de cette vérité : je me propose seulement dans celui-ci de faire voir tout le faux d’un système fort accrédité, suivant lequel le pouvoir législatif ne peut être exercé que par la nation en corps.
Ce système doit le jour à l’idée qu’on s’était formée d’une égalité qu’on croyait voir dans les conditions des hommes considérés dans ce qu’on a nommé l’état de pure nature, c’est-à-dire, dans celui qui a précédé l’institution des sociétés particulières et conventionnelles. La première contradiction qui se fait remarquer dans cet ensemble, c’est que la loi de la propriété, cette loi fondamentale des sociétés, cette loi qui est la raison primitive de toutes les autres lois, se trouve nécessairement exclusive de l’égalité. Cette égalité chimérique, qui est d’une impossibilité physique dans quelque état que vous supposiez les hommes, n’a donc jamais pu donner le droit de participer au pouvoir d’instituer des lois, puisque le maintien de l’égalité n’était pas l’objet des lois qu’il s’agissait d’instituer.
Supposez deux hommes seulement ; à raison des différences qui se trouveront entre leurs facultés, ainsi qu’entre les hasards qu’ils rencontreront, leurs conditions ne seront point égales : faites que pour s’entraider mutuellement, ils forment une société ; elle n’aura [88] point certainement pour but d’établir entre eux l’égalité ; car à ce marché l’un gagnerait et l’autre perdrait, auquel cas ce dernier ne consentirait point à la société ; mais leur objet sera de rendre meilleur l’état de chacun d’eux, en proportion des avantages dont il jouissait déjà, et qui doivent le suivre en société.
Ainsi avant l’institution des sociétés particulières et conventionnelles les hommes avaient des droits qui dans le fait étaient inégaux ; et ces sociétés n’auraient jamais pu se former, si l’on se fût proposé de faire cesser cette inégalité qui tient au droit de propriété, premier principe constitutif de toute société. Les conventions ou les lois essentielles à l’institution des sociétés ont au contraire nécessairement dû se proposer de faire respecter l’inégalité que ces droits avaient entre eux, et dont on ne pouvait changer les proportions sans blesser cette justice par essence qui les avait elle-même déterminées.
Cependant si nous consultions chaque homme en particulier, nous trouverions en général qu’ils voudraient tous avoir des droits et point de devoirs ; recevoir beaucoup et ne donner rien. Ce penchant naturel ne leur permet pas d’être législateurs ; aussi l’auteur de la nature ne leur a-t-il point laissé les lois à faire ; mais il leur présente des lois toutes faites, et il leur a donné une portion de lumière suffisante pour en connaître évidemment la justice et la nécessité. Le pouvoir législatif ne peut donc appartenir de droit qu’à ceux qui ont acquis cette connaissance évidente, et ce pouvoir ne peut être exercé sans aucun inconvénient, qu’autant que la force de cette évidence n’est point combattue par celle des intérêts particuliers ; car alors il y aurait à craindre que celle-ci ne devînt dominante. Cette seule observation suffit pour prouver que le pouvoir législatif ne peut être le partage d’une nation, d’une multitude d’hommes parmi lesquels il subsiste et doit subsister des droits inégaux, et qui cependant voudraient tous séparément que l’inégalité fût en leur faveur.
Un des grands arguments qu’on emploie pour prouver que la nation doit être elle-même la puissance législatrice, c’est de dire que les hommes ont dû commencer par être en commun les instituteurs de leurs lois en formant des sociétés particulières. Mais en cela même on se trompe grossièrement ; car dans l’origine des sociétés particulières, les hommes n’ont eu rien à faire que de se soumettre à des lois déjà faites, à des lois simples dont la justice et la nécessité étaient pour chacun d’eux de la même évidence.
Dans ces premiers temps les hommes étaient peu nombreux, et les rapports qu’ils avaient entre eux n’étaient pas multiples, comme ils le sont devenus à mesure que la population s’est accrue. Tant que les lois ont pu conserver ce premier degré de simplicité, on peut dire, en quelque sorte, que tous les hommes étaient législateurs, parce que [89] cette simplicité leur rendait sensible à tous la justice et la nécessité des lois auxquelles ils se soumettaient librement, quoique nécessairement.
Il ne faut pas confondre une société naissante avec une société formée : quand il s’agit de se réunir en société, chacun est nécessairement législateur, parce qu’il n’y a point encore d’État gouvernant, et que chacun est le maître de ne pas souscrire aux conditions de la réunion. Mais lorsqu’une société renferme une multitude d’hommes très nombreuse, et qu’il s’agit de constater d’une manière claire et positive tous les devoirs et tous les droits réciproques qu’ils doivent avoir entre eux, cette multitude ne peut plus être législatrice : il ne s’agit plus pour elle d’établir des lois, mais seulement de développer les conséquences de celles qui déjà sont établies, et d’en faire l’application aux différents cas qui doivent se présenter successivement. Ceux qui composent cette multitude ne peuvent alors s’attribuer de telles fonctions : en les exerçant ils se trouveraient être juges et parties ; et l’opposition de leurs intérêts particuliers les mettrait dans la nécessité de recourir à la force pour les faire valoir. Il devient donc d’une nécessité absolue que le pouvoir législatif soit déposé dans des mains qui n’aient rien de commun avec les motifs qui peuvent concourir à l’égarer ; qu’il soit confié dans tout son entier à une puissance qui ne puisse avoir d’autre intérêt que celui de conserver, par rapport à chacun en particulier, l’ordre des devoirs et des droits tels qu’ils doivent être nécessairement d’après les lois fondamentales et constitutives de la société. Or il est évident, ainsi que je le démontrerai, que cette puissance ne peut être que le souverain, tel que l’ordre essentiel des sociétés veut qu’il soit institué.
Ceux qui ont adopté l’idée de déférer à une nation le pouvoir législatif, ont encore imaginé de la considérer comme ne formant qu’un seul corps ; et de là, ils ont conclu que ce corps ne devait avoir d’autre législateur que lui-même, parce qu’il ne pouvait recevoir des lois que de ses propres volontés.
C’est ainsi que les termes que nous employons au figuré, sont sujets à nous égarer par le peu de justesse qui règne dans leur application. Nous regardons une nation comme un corps ; nous disons qu’elle forme un corps, sans examiner ni pourquoi, ni comment. Il est certain qu’elle forme un corps dans tous les cas où un intérêt commun et connu imprime à tous ceux qui la composent une volonté commune ; car c’est précisément cette unité de volonté qui permet que plusieurs puissent être considérés comme ne formant qu’un seul et même individu.
Quand on envisage une nation dans les rapports qu’elle a avec le souverain, on voit tous ses membres soumis à une même autorité, [90] agissant par conséquent d’après une même volonté ; dans ce point de vue, ils forment un corps, et ils le forment toujours, parce qu’étant tous et toujours gouvernés par une même volonté, ils ont tous et toujours la même direction. Mais entrez dans quelques détails ; décomposez cette nation ; suivez sa distribution naturelle en différentes possessions, en différents ordres de citoyens ; interrogez chaque classe en particulier ; vous les trouverez toutes désunies, et divisées par des intérêts opposés ; alors vous verriez que chaque classe est un corps séparé, qui se subdivise à l’infini, et que cette nation, qui vous paraissait n’être qu’un corps, en forme une multitude qui voudraient tous s’accroître aux dépens les uns des autres.
Cette grande opposition qui règne entre les intérêts particuliers des différentes classes d’hommes qui composent une nation, ne permet pas qu’on puisse à cet égard la considérer comme un corps : pour qu’elle ne formât réellement qu’un corps, il faudrait qu’il y eût chez elle unité de volonté ; et pour qu’il y eût unité de volonté, il faudrait qu’il y eût unité d’intérêt ; sans cela impossible de concilier les prétentions. Ce qu’on appelle une nation en corps, telle qu’on la veut pour qu’elle puisse exercer le pouvoir législatif, n’est donc autre chose qu’une nation assemblée dans un même lieu, où chacun apporte ses opinions personnelles, ses prétentions arbitraires, et la ferme résolution de les faire prévaloir. Voilà ce prétendu corps qu’on veut établir législateur ; il faut convenir qu’il est choisi fort singulièrement ; mais n’importe, allons aux voix et délibérons.
Il n’est que deux façons de procéder aux délibérations : les résultats doivent être formés par l’unanimité complète de tous les suffrages, ou seulement par leur pluralité. L’unanimité complète est une chose dont on ne peut se flatter, vu la contradiction des intérêts, des prétentions, et même des opinions. D’ailleurs s’assujettir à ne déférer qu’à cette unanimité, ce serait une loi choquante et contre nature ; car alors un seul et unique opposant, quel qu’il fût, serait toujours présumé être lui seul aussi sage, aussi éclairé que tous les autres ensemble ; et il se trouverait aussi fort que toute la nation en corps. Une telle loi mettrait les hommes dans le cas de respecter également la vérité la plus évidente, l’intérêt commun le plus généralement reconnu, et une simple opinion particulière qui leur serait opposée sans raison. Comme les suites funestes de cette absurdité sont connues de tout le monde, je les écarte pour arriver à la seconde façon de délibérer.
Voici donc que la loi proposée est reçue à la pluralité des suffrages : mais alors ce n’est plus toute la nation en corps qui fait la loi ; c’est une portion seulement de la nation qui la dicte à l’autre portion ; ainsi l’une la fait, et l’autre la reçoit contre sa volonté : [91] celle-ci par conséquent ne fait point partie du corps législatif ; si elle souscrit à la loi, ce n’est pas qu’elle l’accepte librement et volontairement, mais c’est qu’elle y est contrainte par des forces supérieures aux siennes.
On a donc abusé du mot, lorsqu’on a prétendu que la nation en corps pouvait être législatrice, et qu’on s’est flatté d’écarter par ce moyen les inconvénients qui se trouvent dans l’opposition des intérêts particuliers. Le rapprochement momentané des individus ne fait pas cesser cette opposition : de ce rapprochement fait ou à faire il résulte seulement des associations ; et ces associations forment un parti qui se trouvant le plus nombreux, le plus fort, devient dominant dans la délibération : l’assemblée finit ainsi par asservir la faiblesse des uns à la force des autres. Je laisse à décider si en pareil cas cette nation qu’on regarde comme un corps, n’est pas au contraire une nation très réellement divisée.
Quoi qu’il en soit, la loi est reçue ; elle est faite, et la nation, qui ne peut rester toujours assemblée, se disperse. Aussitôt elle cesse d’être un corps ; car elle n’en était un qu’à raison de ce qu’elle se trouvait toute réunie dans un même lieu. Alors ceux qui ont été d’un avis contraire à la loi, ont tout l’avantage : les autres qui ont fait force pour l’établir, ne font plus force pour la faire observer ; elle est absolument abandonnée à la discrétion de ceux dont l’autorité prend la place de celle de la nation en corps. Ainsi le résultat de toute cette opération faite par la nation en corps, est que les uns n’ont pu parvenir à faire une loi, et que les autres ont fait une loi nulle, parce qu’elle est sans autorité.
Pour sentir combien une telle loi est nécessairement dénuée d’autorité, il faut faire attention qu’en pareil cas son institution n’est pas l’ouvrage de l’évidence, mais celui de la pluralité des suffrages, et de la supériorité de la force acquise à leur pluralité dans le moment de leur réunion passagère. Que reste-t-il donc après l’institution de la loi ? Il reste une loi dont la justice et la nécessité n’ont rien d’évident ; il reste des magistrats qui ne voient point une justice évidente ni dans la lettre, ni dans la raison de la loi ; il reste une puissance exécutrice qui se croit très indépendante d’une loi faite par une puissance législatrice qui ne subsiste plus ; ainsi cette loi n’a ni en elle, ni autour d’elle, aucune autorité qui puisse la faire respecter.
Mais, dira-t-on, si ceux qui, après la dissolution de l’assemblée nationale, restent chargés du soin de faire observer les lois, les méprisent, et s’élèvent au-dessus d’elles, la nation elle-même peut y remédier : à cet effet elle peut indiquer des assemblées à des époques fixes et périodiques, pour y recevoir les plaintes des infractions faites aux lois. Cet expédient, qui d’ailleurs ne pourrait convenir qu’à un [92] peuple très peu nombreux, et resserré dans un territoire fort étroit, tend précisément à ériger l’assemblée nationale en tribunal supérieur, et en cela on tombe dans une contradiction choquante ; car dans l’assemblée nationale tous ceux dont on se plaindrait comme infracteurs des lois, ou comme ayant profité de leurs infractions, auraient séance et voix délibérative comme les autres ; ils se trouveraient ainsi juges et parties : cependant si vous voulez les en exclure, de telles assemblées ne seront plus celles de la nation en corps, mais un corps particulier formé dans la nation, et qui par conséquent jouira d’un pouvoir arbitraire, qui le rendra pleinement indépendant de la nation.
À la contradiction évidente et absurde qui règne dans un tel système ajoutez qu’il tend à anéantir la magistrature et la puissance exécutrice ; car dans cette supposition, il n’y aurait de juges souverains, ni d’autorité souveraine, que dans l’assemblée de la nation : ainsi la nation en corps serait tout à la fois puissance législatrice, puissance exécutrice et corps de magistrature : par ce moyen tout serait confondu : lorsqu’elle serait assemblée, elle formerait une puissance absolument et nécessairement indépendante des lois déjà faites ; tout parti qui aurait pour lui le plus grand nombre des opinions ne reconnaîtrait aucune autorité supérieure à la sienne ; et dans cet état il n’existerait qu’une autorité sans lois, qu’un État gouvernant sans État gouverné ; mais dès qu’elle serait dispersée, il ne resterait plus après la dissolution de cette puissance arbitraire, que des lois sans autorité, et un État gouverné sans État gouvernant : les suites nécessaires d’un tel désordre sont trop sensibles, pour que je puisse me permettre aucune réflexion à leur sujet.
[I-213 / 93]
CHAPITRE XVII.↩
Continuation du développement de la seconde classe des institutions qui constituent la forme essentielle de la société. — L’autorité tutélaire est nécessairement une, et par conséquent indivisible, soit qu’on la considère dans la manière dont elle s’établit, dans le premier principe dont elle émane, ou dans l’action qui lui est propre.
J’ai à démontrer que l’autorité tutélaire, ou l’administration de la force publique ne peut être déposée que dans les mains d’un seul, du moins sans blesser l’ordre naturel et essentiel des sociétés. Pour mettre cette vérité dans tout son jour, je commence par examiner de quelle nature est cette autorité ; quel est son caractère essentiel ; comment elle doit se former, se perpétuer et agir.
L’autorité tutélaire doit être regardée comme étant d’institution divine, ainsi que les autres branches de l’ordre naturel et essentiel des sociétés. Quoique dans l’origine des choses les hommes n’aient dû l’établir entre eux que librement et volontairement, toujours est-il vrai qu’ils y ont été contraints par la même nécessité qui les obligeait de se réunir en société, puisque sans l’établissement de cette autorité, leur société n’aurait pu ni se former ni subsister.
Réunissez sur un même objet une multitude d’opinions et de volontés : de cette première réunion naîtra naturellement et nécessairement une réunion de forces physiques au soutien de ces mêmes volontés ; et du tout ensemble résultera naturellement et nécessairement ce que nous nommons une autorité ; c’est-à-dire, un droit de commander appuyé sur le pouvoir physique de se faire obéir.
Si ces mêmes opinions et ces volontés viennent à se désunir, à se diviser, par exemple, en deux partis, les forces se diviseront également ; il se trouvera deux forces, deux autorités, par conséquent deux sociétés ; car il est impossible que dans une même société il existe deux autorités. En effet, elles seraient ou égales ou inégales entre elles : au premier cas, l’une et l’autre, prises séparément, deviendraient nulles ; au second cas, la dominante serait la véritable et unique autorité. Quand je dis que séparément chacune des deux deviendrait nulle, il faut prendre ce terme à la lettre ; car étant égales entre elles, elles ne pourraient rien l’une sans l’autre : toutes deux ainsi n’auraient le pouvoir de se faire obéir qu’autant qu’elles se réuniraient ; mais dès qu’elles se seraient réunies, elles ne formeraient plus ensemble qu’une seule autorité qui se trouverait naître de leur réunion. [94] L’autorité, considérée dans l’action qui lui est propre, n’est que le pouvoir physique de se faire obéir, ce qui suppose une force physique supérieure. Or il est certainement évident qu’il ne peut se trouver en même temps et dans une même société, deux forces physiques supérieures. Il peut bien cependant se former deux forces particulières et distinctes l’une de l’autre ; mais il n’est pas possible qu’elles soient toutes deux supérieures ; aussi cet état est-il un état de guerre qui ne peut se pacifier que par l’extinction totale de l’une de ces deux forces.
Il est donc de l’essence de l’autorité de ne point être partagée : la diviser ce serait la réduire à l’impossibilité d’agir, et par conséquent l’annuler ; car l’autorité n’est autorité, qu’autant qu’elle peut agir pour faire exécuter ses volontés.
Mais si elle est nécessairement une par rapport à l’action qu’elle doit avoir, elle l’est encore nécessairement par rapport au principe dont elle émane : l’autorité résidant dans la force publique dont elle dispose, et la force publique, qui n’est autre chose que la réunion des forces particulières, ne pouvant être solidement établie, qu’autant que cette réunion est l’ouvrage de la force intuitive et déterminante de l’évidence qui commence par réunir toutes les volontés, il est certain que partout où se trouve une connaissance évidente de l’ordre, il ne peut exister deux forces publiques : l’évidence qui est une ne peut présenter qu’un seul point de réunion pour les volontés et les forces ; elles ne peuvent donc se diviser, qu’autant qu’elles sont privées de l’évidence, ou du moins de la certitude qui la supplée, et qu’égarées ainsi par l’ignorance, elles se trouvent livrées à l’arbitraire.
Partant de l’évidence nous trouvons donc unité de volonté, de force et d’autorité ; et cette autorité unique est la seule que l’ordre naturel et essentiel des sociétés puisse admettre ; car cet ordre veut que l’évidence soit la règle de nos actions, puisque nous sommes tout à la fois organisés pour la connaître, et pour qu’elle asservisse sans violence toutes nos volontés.
[I-218 / 95]
CHAPITRE XVIII.↩
Suite du chapitre précédent. — La puissance exécutrice ne peut être exercée par plusieurs administrateurs. — Inconvénients généraux de cette pluralité vue en elle-même ; autres inconvénients particuliers qui naissent de la manière de composer le corps d’administrateurs.
De l’unité essentielle à l’autorité résulte une conséquence évidente, c’est qu’elle ne peut être exercée par plusieurs. La force publique qui constitue l’autorité, ne peut rien par elle-même et sans le ministère d’un agent qui lui donne la direction qu’elle doit suivre : par elle-même elle est aveugle ; il lui faut un guide pour l’empêcher de s’égarer. Le propre de cette force est donc de rester sans mouvement, jusqu’à ce que la volonté qui est en droit de la commander, la fasse agir. Par ce moyen cette même force devient personnelle à la volonté qui la met en action ; c’est dans cette volonté qu’elle réside en son entier. De là s’ensuit que lorsque l’administration de la force publique est dans les mains de plusieurs, cette force se trouve naturellement et nécessairement partagée en autant de portions qu’il y a de volontés instituées pour ordonner de son mouvement ; ainsi par cette raison l’ordre réprouve cette forme de gouvernement.
Je sais qu’on peut alléguer que chacune de ces volontés en particulier et séparément des autres, ne dispose point de cette force ; qu’elle ne leur est acquise qu’autant qu’elles sont toutes réunies, ou du moins qu’elles sont dominantes par leur nombre. Mais chaque branche de cette alternative tend à établir l’autorité sur une autre base que sur la force protectrice de l’évidence : cette façon de dénaturer ainsi l’autorité dans son principe la conduit à occasionner de grands désordres.
Si dans un corps d’administrateurs une seule volonté peut arrêter l’effet de toutes les autres, c’est opposer à l’activité qui caractérise l’autorité, une force de résistance invincible pour elle ; c’est la réduire à l’inaction ; c’est l’anéantir : l’autorité, dont le propre est d’agir, ou du moins de pouvoir agir, n’existe alors ni dans ceux qui veulent, puisque leurs volontés ne peuvent la mettre en action, ni dans celui qui ne veut pas, puisque son opposition ne sert qu’à priver l’autorité du mouvement sans lequel elle n’est plus rien. Une telle police ne peut jamais subsister paisiblement, car elle est contre nature : elle attribue à une erreur évidente, la même autorité qu’aux vérités publiquement reconnues ; elle place sur une ligne parallèle, l’intérêt particulier d’un seul et l’intérêt commun de tous ; par ce moyen elle [96] met en opposition la faiblesse et la force : il n’est donc point étonnant qu’on voie en pareil cas les hommes s’entre-égorger pour se mettre d’accord.
Pour éviter ces inconvénients, le moyen qu’on emploie est d’assujettir le corps d’administrateurs à se décider par la pluralité des suffrages. Mais cette méthode, qui ne peut avoir lieu que dans des cas problématiques et susceptibles d’une diversité d’opinions, contraste sensiblement avec l’évidence, que l’autorité doit toujours prendre pour guide : ce qui partage les opinions ne peut être regardé comme évident ; or comme en fait de gouvernement tout doit être évident, il ne doit s’y trouver rien d’arbitraire, et il ne peut y avoir diversité d’opinions, que par un effet de l’ignorance ou de la mauvaise volonté des délibérants.
Ainsi l’obligation de déférer à la pluralité des suffrages suppose nécessairement dans un corps d’administrateurs, ou de l’ignorance ou de la mauvaise volonté ; mais malheureusement cette manière de délibérer ne peut remédier ni à l’une ni à l’autre : quelques voix de plus ou de moins ne peuvent jamais être regardées comme des preuves suffisantes de la justesse ou de la fausseté d’une opinion ; et l’expérience nous apprend que pendant longtemps une erreur accréditée réunit beaucoup plus de partisans, que la vérité qui lui est contraire ; aussi quelque nombreux que des suffrages puissent être, leur multitude ne peut-elle jamais rendre évident ce qui ne l’est pas ; leur opinion n’est jamais qu’une opinion, qui par conséquent est sujette à changer ; car il n’y a d’immuable que l’évidence.
Quant à la mauvaise volonté, comme elle résulte des intérêts particuliers, on ne peut jamais être assuré que le nombre de ceux que ces intérêts particuliers dominent, ne soit pas le plus grand : ainsi à cet égard la pluralité des suffrages ne peut encore être d’aucune sûreté.
Malgré les différences prodigieuses qui se trouvent, à plusieurs égards, parmi les hommes, il est en eux deux mobiles communs qui les mettent tous en action : l’appétit des plaisirs et l’aversion de la douleur sont ces mobiles communs qui tiennent à notre constitution, et qui sont les principes de tous nos mouvements. Vouloir que l’homme agisse dans un sens contraire à l’impulsion de ces mobiles, c’est prétendre changer l’ordre immuable de la nature ; c’est se proposer de rendre les effets indépendants des causes ; c’est entreprendre de faire remonter une rivière vers sa source.
J’ai déjà dit que par les termes de plaisirs et de douleur, il faut entendre, non seulement nos sensations physiques, mais encore nos affections morales ou sociales ; et j’ai fait observer que très souvent ces dernières, qui doivent beaucoup à l’opinion, agissent sur nous [97] bien plus puissamment, bien plus despotiquement que les premières. Aussi après la force de l’évidence, n’est-il point de force égale à celle de l’opinion. Heureux, heureux les hommes dont la société est instituée de manière que l’opinion ne puisse empêcher le désir de jouir de tourner au profit commun du corps social ! Il doit alors se former des prodiges de vertu dans tous les genres que l’ordre essentiel de la société peut comporter.
Mais ce n’est point dans un gouvernement où l’autorité est partagée dans les mains de plusieurs, que l’opinion et le désir de jouir doivent naturellement et constamment tendre au bien commun de la société. Cette forme de gouvernement pêche dans son principe, en ce qu’elle prend pour arbitres de l’intérêt public, des agents qui peuvent avoir des intérêts particuliers très opposés : alors le désir de jouir doit naturellement les incliner à préférer leurs intérêts particuliers à l’intérêt public.
Je ne prétends pas dire que cela se passe ainsi toujours et dans tous les pays qui ont adopté un gouvernement de cette espèce : le cours des désordres qui lui sont propres, peut trouver de temps en temps une barrière dans les vertus personnelles de ceux qui gouvernent ; et je déclare encore une fois que je ne parle d’aucune nation, ni d’aucun siècle en particulier ; mais je soutiens, et je ne crains pas d’être contredit, je soutiens, dis-je, qu’en général l’intérêt public n’est pas dans des mains sûres, quand il s’y trouve en opposition avec les intérêts particuliers de ceux auxquels il est confié ; qu’il est au contraire évident qu’alors il a tout à craindre de ces mêmes intérêts particuliers, et du désir de jouir.
Si plusieurs administrateurs aperçoivent de grands avantages personnels dans quelques préjudices faits ou à faire à la nation, je demande qui est-ce qui pourra l’empêcher d’être sacrifiée ? Ce ne seront pas les mobiles par lesquels la nature s’est proposé de nous conduire ; car ils agissent alors dans ces administrateurs contre l’intérêt de la nation : ce ne sera pas non plus une autre autorité, contraire à celle dont ils disposent, puisqu’ils tiennent en main toute la force publique : le danger de la nation est donc évident ; il prend sa source dans la nature même de notre constitution.
En vain m’alléguera-t-on que ce malheur ne résulte pas toujours de cette forme de gouvernement ; je l’accorde ; et je sais qu’il peut se trouver des hommes vertueux, uniquement par amour pour la vertu ; mais cette façon de jouir n’est pas celle du plus grand nombre ; nous savons au contraire qu’elle est très rare, et même que plus elle est vraie et moins elle est connue : ainsi dans la plupart des hommes le désir de jouir peut devenir funeste à l’administration ; il le doit même, suivant l’ordre de la nature, lorsque l’administrateur trouve [98] dans les abus de son autorité, les moyens de satisfaire ce désir. Cette forme de gouvernement est donc tout au moins dangereuse, et cela me suffit pour prouver qu’elle n’est pas celle qui convient à l’ordre essentiel des sociétés ; car l’ordre ne peut et ne doit avoir rien de dangereux, attendu que le propre de l’ordre est de tendre nécessairement au plus grand bien possible, et que dans l’ordre le plus grand bien possible arrive nécessairement.
Je ne disconviens pas cependant que l’inconvénient des intérêts particuliers puisse trouver un contrepoids dans les lumières de la nation : il n’est pas douteux que dans une nation éclairée, dans une nation qui aurait une connaissance évidente de ses véritables intérêts, le corps d’administrateurs ne pourrait abuser de son autorité, parce qu’alors l’évidence de l’abus anéantirait cette même autorité. Je ne répéterai point ce que j’ai dit sur le pouvoir de l’évidence ; comme elle réunit à elle toutes les volontés, toutes les forces, et par conséquent toute l’autorité ; il ne s’agit ici que de tirer la conséquence de ces vérités, et de voir que l’autorité de ce corps d’administrateurs s’anéantirait nécessairement, dès qu’il aurait contre lui la force irrésistible de l’évidence, principe unique d’une puissante et solide autorité.
Mais en accordant que dans le gouvernement dont il s’agit, les lumières de la nation peuvent la garantir des inconvénients dont il est nécessairement susceptible, je dois observer que cette hypothèse implique contradiction : là où se trouve un tel gouvernement, nous ne pouvons supposer que la nation possède une connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, puisque cet ordre ne peut jamais admettre une forme de gouvernement qui place l’intérêt commun d’une société, en opposition avec les intérêts particuliers de ses administrateurs ; et qui, en déposant l’autorité publique dans plusieurs mains, parvient à diviser ce qui par essence est indivisible.
La contradiction qui règne dans cette hypothèse, est d’autant plus frappante, que tandis qu’on suppose une nation assez instruite pour que l’évidence réunisse toutes ses volontés contre ce qui pourrait blesser les lois de l’ordre essentiel des sociétés, on suppose en même temps ses administrateurs, assez ignorants pour que leurs opinions puissent se diviser, et qu’il soit nécessaire de les assujettir à la loi de la pluralité des suffrages, faute de pouvoir se rallier à l’évidence. On veut ainsi que ce qui est évident pour toute la nation, ne le soit pas pour ses administrateurs ; on veut que sans consulter l’évidence de l’ordre, ce soit la pluralité des suffrages qui dicte le commandement, et que ce soit cependant cette même évidence qui détermine ceux qui doivent l’exécuter ; on veut que ceux qui commandent puissent se tromper, et que ceux qui obéissent ne le puissent [99] pas ; on veut enfin que l’autorité soit d’un côté, et d’un autre côté la force irrésistible de l’évidence en opposition avec l’autorité dont elle doit être le principe : c’est renverser les notions les plus évidentes ; c’est vouloir des choses manifestement contradictoires, des choses physiquement et moralement impossibles.
Toute nation qui croit que l’autorité doit être acquise à la pluralité des suffrages, et qui donne à cette pluralité le pouvoir de tenir la place de l’évidence, n’a certainement point une connaissance évidente de l’ordre qui constitue son meilleur état possible : si elle avait cette connaissance évidente, sa première loi serait de ne jamais être gouvernée que par cette évidence qui réunirait à elle tous les esprits, toutes les volontés et toutes les forces ; l’évidence jouissant ainsi de toute l’autorité qui lui est propre, cette nation éclairée ne serait point dans le cas de compter les suffrages, et d’abandonner son sort à la faible présomption résultante d’une pluralité qui ne peut ni établir, ni détruire l’évidence. En deux mots, la pluralité des suffrages n’a pu être imaginée que pour les cas problématiques, et pour suppléer l’évidence ; ainsi partout où cette pluralité décide, il est certain que l’évidence de l’ordre ne gouverne pas ; par conséquent qu’elle n’est point acquise ; car si elle l’était, elle gouvernerait. Or sitôt que l’ordre n’est point évident, le gouvernement devient nécessairement arbitraire : entre l’évident et l’arbitraire on ne connaît point de milieu.
Je ne crains pas de répéter ce que j’ai déjà dit : la pluralité des suffrages ne peut jamais rendre évident ce qui ne l’est pas. Cette façon de délibérer n’est utile que dans les cas qui n’ayant rien d’évident, ne présentent à l’esprit qu’un certain nombre de faits et de conjectures dont le rapprochement et l’examen sont nécessaires pour former ce qu’on appelle une opinion. Mais les premiers principes de l’administration et leurs conséquences n’ont rien de conjectural ; ils sont susceptibles de démonstration évidente comme toutes les vérités géométriques : et comment ne le seraient-ils pas, puisqu’ils sont tous renfermés dans le droit de propriété ? C’est donc une contradiction manifeste que de supposer qu’une nation ait une connaissance évidente et publique de son ordre essentiel, et néanmoins qu’elle puisse donner à son gouvernement une forme qui ne peut avoir lieu que quand les principes en sont incertains et arbitraires.
Résumons-nous donc, et disons : par trois raisons, le dépôt de l’autorité dans les mains de plusieurs administrateurs est contraire à l’ordre essentiel de la société : 1°. Il divise l’autorité qui par essence ne comporte point de partage. 2°. Il expose l’intérêt public à toute la fureur des intérêts particuliers ; il fait contraster ainsi le devoir avec les mobiles qui nous font agir. 3°. Il attache au nombre des suffrages, [100] une autorité despotique qui ne peut et ne doit appartenir qu’à l’évidence ; par ce moyen ce n’est point l’évidence qui gouverne ; c’est l’opinion, ou, si l’on veut, c’est la volonté d’un certain nombre d’hommes livrés à une même opinion.
Ce dernier inconvénient ne peut être apprécié ; il est sans bornes ; il est la source de tous les autres. En effet, je suppose que l’avis le plus nombreux soit dicté par des intérêts particuliers, et que le moins nombreux ait pour lui l’évidence ; n’est-il pas monstrueux que ce soit le premier qui l’emporte ; et que la forme du gouvernement fournisse à la mauvaise volonté, un titre qui lui donne le droit de triompher de l’évidence même ? Cet excès de désordre est cependant inévitable en pareil cas ; car cette évidence est étouffée sous le poids des opinions qui lui sont opposées ; et la nation qui s’est fait une règle de croire aveuglément au plus grand nombre des suffrages, qui d’ailleurs, par toutes les raisons que j’ai dites précédemment, n’est pas alors en état de les juger elle-même, reste absolument sans défense contre tous les fléaux dont cette mauvaise volonté peut l’accabler, surtout si cette mauvaise volonté se trouve dans des hommes qui par leurs talents et leurs richesses, soient parvenus à se rendre puissants.
Lorsque je suis convenu qu’un corps d’administrateurs peut gouverner avec sagesse et avec équité, j’ai toujours sous-entendu que ce corps ne serait pas tout à la fois dépositaire de l’autorité publique et chargé des fonctions de la magistrature : j’ai démontré dans les chapitres précédents que cet assemblage serait destructif de tout ordre social, parce qu’il tendrait à rendre tout arbitraire.
Ce n’est donc qu’en séparant ces deux états, et instituant entre les administrateurs et la nation, un corps de magistrats, tel qu’il doit être, que je reconnais qu’il peut se faire que pendant un temps, une nation soit bien gouvernée par plusieurs ; mais alors c’est aux qualités personnelles des administrateurs, et non à la forme du gouvernement, qu’on en est redevable ; car par elle-même cette forme est évidemment vicieuse ; quelques précautions qu’on prenne, il est deux inconvénients dont il est impossible de la garantir pour toujours : le premier est, comme je viens de le dire, celui des intérêts particuliers, qui dans ces administrateurs peuvent se trouver très contraires à l’intérêt public ; le second est la licence que l’administration de l’autorité peut faire naître dans ceux qui en sont chargés : insensiblement l’autorité de la chose ou de la place devient celle de la personne ; et bientôt cette autorité, devenue personnelle, se trouve être une source d’abus préjudiciables au droit de propriété et à la liberté des citoyens. [101] Je pourrais ajouter encore que quel que soit le corps des administrateurs, on ne peut jamais empêcher qu’il ne s’y rencontre souvent des hommes qui, par un effet naturel de leur génie et de leur caractère, se rendent dominants, et parviennent ainsi à s’approprier un pouvoir despotique et arbitraire, qui est d’autant plus dangereux, que le désir de jouir les presse à chaque instant d’en abuser. Voilà pourquoi nous voyons si souvent dans l’histoire, des hommes à grandes passions ou à grands talents, tantôt immolés, et même injustement, à la liberté de la nation, et tantôt parvenus rapidement à lui donner des fers.
Jusqu’ici je n’ai parlé que des inconvénients qui sont essentiellement attachés au gouvernement de plusieurs : ceux-là sont, pour ainsi dire, dans la nature même de la chose ; mais il en est d’autres encore qui résultent de sa forme, c’est-à-dire, de la manière dont le corps d’administrateurs peut être composé.
Le gouvernement aristocratique multiplie les despotes arbitraires ; j’entends par ce nom, des gens puissants qui se croient audessus des lois. Chaque grand propriétaire commande despotiquement à la portion du peuple qui correspond à lui : de là les vexations arbitraires, les tyrannies, les excès de toute sorte : les peuples sont opprimés, parce qu’ils sont comptés pour rien, quoiqu’ils soient une des principales sources des richesses et des forces de l’État.
Cette situation désastreuse n’est pas le seul mal que produise le gouvernement des grands : chacun de ces despotes voit dans les autres despotes, des puissances rivales et redoutables pour lui : bientôt cette rivalité se change en associations ; et ces associations conduisent à l’anarchie, aux désordres dans tous les genres ; il ne reste au peuple de ressource que de s’enfuir sur le Mont-sacré : dans un pays où l’ordre puisse le mettre à l’abri de l’oppression.
D’un autre côté le peuple proprement dit, livré à l’ignorance et aux préjugés, ne regarde jamais qu’autour de lui : chaque canton croit voir tout l’intérêt de l’État dans celui de son canton ; chaque profession croit voir tout l’intérêt de l’État dans celui de sa profession ; la science des rapports lui est absolument inconnue, il ne lui est pas possible de remonter des effets aux causes, encore moins de se livrer à l’étude des liaisons qu’elles ont entre elles. Il lui devient donc moralement impossible d’agir par principe et par mesure : toujours crédule et susceptible de prévention, pour le persuader il faut le gagner, pratiquer auprès de lui les mêmes insinuations comme pour le séduire ; par cette raison toujours inconstant et orageux, ses résolutions indélibérées ne sont jamais que le produit de la sensation du moment. [102] En général, les grands propriétaires croient que le peuple est fait pour eux, et que tout leur est dû. Le peuple à son tour, envieux de l’état des grands propriétaires, est souvent tenté de regarder comme une injustice, l’inégalité du partage entre eux et lui ; et cette opinion tend à l’aveugler sur le choix des moyens de rétablir entre eux et lui une sorte d’équilibre.
Il est donc certain qu’on ne peut, sans de nouveaux inconvénients, choisir les administrateurs dans l’un de ces deux états exclusivement à l’autre : chacun d’eux a des systèmes, ou plutôt des préjugés qui lui sont propres, et qui ne permettent pas que l’un puisse gouverner, sans que l’autre soit accablé du poids de l’autorité.
Quand même le corps d’administrateurs serait mi-parti ; quand même ils seraient choisis en nombre égal parmi les grands et parmi le peuple, chacun de ces deux partis n’en serait pas moins attaché aux préjugés et aux prétendus intérêts particuliers de sa classe ; ainsi ce mélange ne servirait qu’à mettre une plus grande division dans ce corps, dont les membres alors ne pourraient difficilement se concilier, qu’en se prêtant mutuellement à sacrifier l’intérêt public à leurs intérêts personnels bien ou mal entendus.
Je ne m’arrêterai point à démontrer que toute la nation en corps ne peut exercer l’autorité : l’autorité n’existerait réellement qu’autant que ce corps existerait lui-même ; or pour que la nation pût former un corps toujours existant, il faudrait qu’elle fût toujours assemblée ; chose impossible ; elle est au contraire dans la nécessité d’être toujours dispersée. D’ailleurs si la nation en corps s’était réservé l’exercice de l’autorité tutélaire, il en résulterait, comme je l’ai dit précédemment, qu’alternativement il se trouverait une autorité sans lois, et des lois sans autorité ; un État gouvernant sans État gouverné, et un État gouverné sans État gouvernant, ce qui serait une absurdité de la plus grande évidence.
[I-238 / 103]
CHAPITRE XIX.↩
Seconde suite du chapitre XVII. — Conséquence résultante nécessairement des démonstrations précédentes. — L’autorité tutélaire ne peut être exercée que par un seul. — Définition du meilleur gouvernement possible vu dans l’intérêt commun de l’État gouvernant et de l’État gouverné. — Exposition des rapports nécessaires entre les intérêts d’un chef unique et ceux de la nation : il est co-propriétaire du produit net des terres de sa domination. — La souveraineté doit être héréditaire. — Cette condition est essentielle pour que le gouvernement d’un seul devienne nécessairement le meilleur gouvernement possible.
Quelle est donc la meilleure forme de gouvernement ? Quelle est donc celle qui se trouve si parfaitement conforme à l’ordre naturel et essentiel de la société, qu’il ne puisse en résulter aucun abus ? Cette meilleure forme de gouvernement est celle qui ne permet pas qu’on puisse gagner en gouvernant mal, et qui assujettit au contraire celui qui gouverne, à n’avoir pas de plus grand intérêt que de bien gouverner. Or ce point de perfection, vous ne pouvez le trouver que dans le gouvernement d’un seul ; dans le gouvernement d’un chef unique qui soit le centre commun dans lequel tous les intérêts des différents ordres de citoyens viennent se réunir sans se confondre ; et qui pour son intérêt personnel, les protège tous, les maintienne tous dans toute la plénitude de leurs droits, et sache ainsi garder le point d’équilibre où l’ordre essentiel des sociétés les a placés pour leur utilité réciproque.
Quand je dis un chef unique, je n’entends parler que d’un souverain par droit d’hérédité, et non d’un souverain par élection : ils diffèrent l’un de l’autre en ce que le premier est un véritable propriétaire, et que le second n’est qu’un usufruitier, qui par conséquent se trouve fortement intéressé à profiter de son usufruit pour augmenter la grandeur de sa famille, ainsi que la fortune dont il jouit à tout autre titre que celui de souverain.
Avant de passer à d’autres observations, je préviens que je n’examine point comment les souverains électifs gouvernent, ni comment ils ont gouverné. Je dirai de cette forme de gouvernement ce que j’ai dit des autres : ses vices peuvent trouver des contrepoids dans les vertus personnelles de celui qui gouverne ; mais n’étant ni historien, ni critique, ni courtisan, je n’ai nul motif pour approfondir si cela est, ou si cela n’est pas ; car en supposant que cela soit, on ne peut rien conclure de ce hasard heureux. Quelque sage, quelque éclairé qu’un tel prince puisse être, il n’en est pas moins vrai que la [104] forme de son gouvernement est un désordre, en ce qu’elle établit en lui de puissants intérêts qui peuvent le porter à abuser de son autorité : il ne faut que faire une légère attention à la différence qui se trouve entre un homme et un autre homme, pour être convaincu que les vertus morales et personnelles ne peuvent jamais servir de base à un gouvernement, qui est une institution faite pour subsister à perpétuité : compter sur le personnel c’est tomber dans l’arbitraire ; c’est rendre variable et accidentel, ce qui doit être nécessaire et immuable.
Dans les monarchies électives il est trois temps qu’il faut considérer : celui de l’élection, celui qui la précède, et celui qui la suit. L’élection doit être toujours et nécessairement troublée par une multitude de prétentions et d’intérêts particuliers qui ne manquent jamais de diviser tant les nationaux que les puissances étrangères qui croient devoir influer sur ces opérations ; ces troubles sont de telle nature, que pour l’ordinaire on arrose de sang l’élection d’un ministre de paix.
Quand, au mépris d’une expérience constante, on supposerait que la liberté règne dans une assemblée nationale convoquée pour l’élection d’un souverain, il serait physiquement et moralement impossible que le choix pût être fixé par des connaissances évidentes ; car il est physiquement et moralement impossible de connaître évidemment l’intérieur d’un homme, surtout lorsqu’il se croit intéressé fortement à ne point se laisser pénétrer. Quand il s’agit de sonder la profondeur et les replis du cœur humain, on ne peut que présumer, estimer, avoir opinion ; et quand il serait véritablement ce qu’il paraît être dans les circonstances où il se trouve, on ne peut se promettre avec sûreté que dans toute autre circonstance il sera toujours ce qu’il est. Mais si nous ne pouvons porter d’autre jugement sur les hommes que nous fréquentons le plus, comment une nation entière peut-elle se décider avec quelque certitude sur le choix d’un souverain, tandis que ce qu’on peut appeler la multitude, ne connaît que par des relations fort éloignées et fort équivoques, ceux parmi lesquels elle doit choisir ?
Le temps de l’élection ne peut donc être qu’un temps orageux à tous égards, où toutes les passions dont les hommes sont susceptibles, se rassemblent pour se déployer et se mouvoir au gré de l’opinion. Mais il ne faut pas croire que ce temps soit celui qu’elles attendent pour agir : les événements qu’il amène doivent être préparés de longue main, par tous les inconvénients qui résultent nécessairement des cabales et des différentes pratiques que chacun des prétendants emploie pour se faire des partisans per fas aut nefas : la nation se divise ainsi en plusieurs partis, disons mieux, en plusieurs [105] nations ennemies les unes des autres : je laisse à penser ce que l’intérêt commun doit en souffrir.
Les maux dont je viens d’indiquer les sources paraîtraient peutêtre légers, si l’élection pouvait les terminer : mais les intérêts particuliers du souverain élu, et les prétentions du parti dont la puissance l’a couronné, doivent nécessairement en faire naître d’une autre espèce : toutes les places de l’administration ne doivent plus être remplies que par les créatures de ce nouveau souverain ; et comme elles ne peuvent avoir d’autre intention que celle de tirer de leur faveur les plus grands avantages possibles, il se perpétue naturellement entre elles et lui une espèce d’association dont le résultat ne peut être que funeste à la nation ; car ce n’est que sur la nation que le souverain peut prendre de quoi payer ceux qui lui sont ainsi vendus ; et d’un autre côté ceux qui se vendent au souverain, sont intéressés à lui livrer la nation pour être payés.
Ces sortes d’associations sont impossibles dans une monarchie héréditaire, lorsque le souverain n’est point aveuglé sur ses véritables intérêts. Comme il est propriétaire né de la souveraineté, dont les intérêts sont les mêmes que ceux de la nation, il ne peut trahir ceux de la nation, qu’il ne trahisse aussi ceux de la souveraineté, qui sont les siens propres. Or, il serait contre nature qu’il le fît avec connaissance de cause, aucun de ses sujets ne pouvant, ou du moins ne devant avoir d’autres prétentions que celles qui sont dans l’ordre et la justice. Toutes personnes chargées de quelque administration lui doivent donc alors un compte rigoureux de leur conduite ; et à cet égard il ne peut subsister d’autres abus que ceux qui peuvent résulter de l’ignorance, et qui par conséquent ne peuvent avoir lieu dans une nation parvenue à une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel des sociétés.
Il faut observer ici que ce préservatif contre tous les abus de l’administration, ne peut se trouver dans une monarchie élective ; car toute nation qui aura une connaissance évidente et publique de son ordre essentiel, se gardera bien de rendre les intérêts de la souveraineté étrangers à ceux du souverain. Ainsi dès qu’il est électif, il est certain que cette connaissance évidente et publique n’est point acquise à la nation ; et conséquemment que son ignorance rend possibles tous les désordres que l’arbitraire peut introduire dans l’administration.
Cette dernière observation m’en suggère encore une autre par laquelle je me propose de terminer cette dissertation : par la raison que nous ne pouvons supposer une monarchie élective gouvernée par l’évidence d’un ordre naturel et essentiel à toute société, il faut donc que sa législation positive, son administration civile et politique ne [106] soient que de simples opinions ; elles sont par conséquent exposées à beaucoup de variations ; car par leur nature elles ne peuvent être immuables. Mais si le souverain veut les changer, le pourra-t-il, ou ne le pourra-t-il pas ? S’il le peut, il est despote, et despote arbitraire, auquel cas plus de lois constantes, plus de droits certains, plus de devoirs, plus de société, plus de nation ; s’il ne le peut pas, il n’est point véritablement souverain ; la plénitude de l’autorité réside dans la puissance quelconque qui rend nulles les volontés qu’il a formées ; le despotisme arbitraire appartient ainsi à cette puissance, et point du tout au souverain.
Ce n’est donc que dans les monarchies héréditaires qu’on peut trouver un véritable souverain. Non pas cependant qu’il puisse arbitrairement renverser et changer les lois ; mais s’il ne le peut pas, c’est qu’il en est empêché par une puissance qui ne lui permet pas même d’en avoir la volonté. Il n’existe point dans ses États, comme dans une monarchie élective, une force factice et arbitraire placée en opposition avec son autorité : la force naturelle et despotique de l’évidence est la seule qui subsiste, et qui ne pouvant jamais contraster avec les intérêts du souverain, ne peut jamais en contrarier les volontés. Il peut donc les faire exécuter toutes ; il ne pourrait rencontrer des obstacles que pour celles qu’il ne lui serait pas possible de former, dès que la nation et lui se trouveraient éclairés. Les plus grands intérêts du souverain étant attachés évidemment à l’observation de l’ordre, il ne peut s’élever contre l’ordre sans trahir ses intérêts évidents ; et comme on ne peut jamais lui supposer de telles intentions, qui seraient contre nature, on peut dire qu’il peut tout, excepté ce qu’il lui est impossible de vouloir ; au lieu que le souverain électif est dans le cas de vouloir tout, mais sans avoir en lui l’autorité nécessaire pour faire exécuter.
La souveraineté héréditaire rend le souverain co-propriétaire du produit net de toutes les terres de sa domination : en cette qualité, son intérêt est le même que celui de tous les propriétaires qui possédant ces terres comme par indivis, les exploitent ou les font exploiter, et prennent dans ce produit net une portion qui est inséparable de leur droit de co-propriété. Il lui importe donc comme à eux, que ce même produit net, par l’abondance et le bon prix des productions, monte à son plus haut degré possible.
D’un autre côté, le droit de co-propriétaire dans le souverain n’étant autre chose que le droit de la souveraineté même, et ne pouvant être exercé séparément de cette dignité, le prince ne peut conserver la jouissance de ce droit, qu’autant que des forces étrangères ne viennent point ou ravir ou partager sa souveraineté. Il est donc encore de la plus grande importance pour lui de ne rien faire [107] qui puisse altérer la richesse de la nation, parce que c’est cette richesse qui est le principe et la mesure de la puissance qui fait la sûreté de la souveraineté.
On voit ici la différence essentielle qui se trouve entre un souverain par droit de succession et un corps d’administrateurs. Chacun des membres de ce corps est un propriétaire particulier, qui par différentes pratiques illégitimes, peut se procurer de grandes richesses aux dépens de ses concitoyens ; il n’a rien de commun avec leurs fortunes ; elles lui sont absolument étrangères ; et voilà pourquoi il peut s’enrichir en les appauvrissant ; au lieu que le souverain dont je parle ne peut appauvrir ses sujets qu’il ne s’appauvrisse, ni augmenter ses revenus qu’en augmentant ceux de ses co-partageants.
Chaque membre d’un corps d’administrateurs doit mettre une grande différence entre les appointements d’une place que divers événements peuvent lui enlever, et le produit des biens-fonds dont il a la propriété : comme il jouit de ceux-ci indépendamment de ses fonctions publiques, et que cette propriété est attachée à sa personne, il lui importe beaucoup de faire servir son administration à l’accroissement de cette même propriété ; ainsi il n’est pas dans le cas de tenir tout de sa place, au lieu qu’un souverain héréditaire tient tout de sa souveraineté, perdrait tout en la perdant, par conséquent ne voit aucun avantage qui puisse être mis en balance avec ceux qu’elle lui procure, et qu’il ne peut conserver qu’en la conservant.
Un tel souverain est, par rapport à ses États, un propriétaire qui conduit lui-même et pour son propre compte, l’administration de ses domaines ; il n’a d’autre intérêt que d’en augmenter le produit : tout autre administrateur n’est qu’un économe qui gère pour des intérêts auxquels il est tellement étranger, que c’est par eux qu’il est payé, et qu’il ne peut rien gagner qui ne soit pris sur eux.
Ceci vous présente un point fixe qu’il est important de bien saisir : le souverain, comme co-propriétaire, a son intérêt personnel qui n’est point le résultat d’un partage dans les intérêts des autres co-propriétaires ; de sorte qu’on peut dire que c’est la terre qui paie la portion du souverain, sans toucher à celle qui appartient au propriétaire qui la fait cultiver. Aussi quand on achète une terre, ne l’estime-t-on qu’à raison de son produit net, déduction faite de la portion que le souverain doit prendre dans ce produit. Mais les autres administrateurs ne sont payés qu’autant qu’ils partagent dans les produits nets qui appartiennent à leurs concitoyens ; au moyen de quoi cette forme d’administration tend naturellement aux abus de l’autorité, parce que tout homme salarié a naturellement intérêt de faire augmenter ses salaires, ce qu’il ne peut faire qu’aux dépens de [108] ceux qui le paient, tandis que les revenus du souverain ne peuvent s’accroître qu’en raison de l’accroissement de ceux de ses sujets.
Un souverain dont les intérêts sont ainsi inséparablement unis à ceux de la nation dont il est le chef, doit certainement chercher à lui procurer tous les avantages qu’elle attend d’une telle administration. Le meilleur état possible du souverain ne peut s’établir que sur le meilleur état possible de la nation. À ce trait, on peut voir que cette forme de gouvernement porte le caractère sacré de l’ordre naturel et essentiel des sociétés ; car le propre de cet ordre est de tenir tous les membres d’une société dans une telle dépendance réciproque, qu’aucun d’eux ne puisse agir pour ses propres intérêts, qu’il n’agisse en même temps pour l’intérêt commun des autres. Reste donc à prouver maintenant que partout où règne une connaissance évidente de ce même ordre naturel et essentiel, un tel gouvernement ne peut être susceptible d’aucun inconvénient.
[I-253 / 109]
CHAPITRE XX.↩
Troisième suite du chapitre XVII. — Premiers arguments pour prouver que dans une nation parvenue à la connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel de la société, le gouvernement d’un seul n’est susceptible d’aucun inconvénient. — Définition de l’autorité tutélaire. — Sans cette connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel, impossible d’établir un bon gouvernement.
Les hommes que l’habitude et l’éducation ont accoutumés à tout autre gouvernement que celui d’un seul, ou qui croient avoir à se plaindre des inconvénients qui souvent se trouvent réunis dans ce dernier, ne peuvent cependant s’empêcher de convenir que s’il était possible qu’un souverain fût toujours éclairé, toujours sage, toujours juste, son gouvernement serait préférable à celui d’un corps quelconque d’administrateurs ; mais en même temps ils nient cette possibilité ; et d’après des exemples sans nombre, ils soutiennent que l’autorité placée dans la main d’un chef unique, doit tôt ou tard devenir funeste à la société.
Si ceux qui raisonnent ainsi, avaient examiné pourquoi il a résulté tant d’abus de cette forme de gouvernement, ils en auraient reconnu les véritables causes, et ils auraient vu qu’ils ne sont point propres et personnels au gouvernement d’un seul ; mais qu’ils sont tous communs à tous les gouvernements privés d’une connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés.
L’ordre est un ensemble parfait dont rien ne peut être détaché, et auquel on ne peut rien ajouter : tout ce qui s’y trouve ou de plus ou de moins est un désordre dont nécessairement d’autres désordres doivent résulter. Ainsi telle institution sociale qui dans cet ensemble, produirait tous les biens qu’on peut désirer, devient nécessairement abusive et pernicieuse ou du moins inutile, dès qu’elle se trouve séparée des autres institutions qui doivent concourir avec elle dans l’ordre naturel et essentiel des sociétés. L’autorité prise ici pour la force physique, étant aveugle, et ne pouvant se conduire elle-même, elle fait le mal comme le bien, selon la direction qui lui est donnée : Ce n’est point à elle, mais bien à cette direction qu’il faut attribuer les mauvais effets qu’elle produit ; il est sensible enfin que l’autorité éclairée par la connaissance évidente de l’ordre, et l’autorité égarée dans les ténèbres de l’ignorance ne doivent se ressembler ni dans leurs procédés, ni par conséquent dans leurs effets.
Ce dernier cas est celui du tableau révoltant que l’histoire de l’humanité met sous nos yeux : nous y voyons l’autorité ne point [110] naître de la force intuitive et déterminante de l’évidence ; ne rien tenir de l’évidence, ne jamais consulter l’évidence : arbitraire dans les principes de son institution, il fallait bien qu’elle le devînt dans ses volontés, et dans sa façon d’agir : elle ressemblait alors à ces météores qui parcourent et embrasent les airs, sans que leurs mouvements soient assujettis à aucune règle connue : aussi comme eux, la voyait-on souvent se dissiper d’elle-même et disparaître dans un instant.
Consultez l’antiquité et parcourez les différentes formes de gouvernement, vous trouverez partout des effets monstrueux de l’autorité, qui se sont plus ou moins multipliés selon que ses États étaient plus ou moins étendus. J’avoue cependant que placée dans les mains d’un seul, elle a commis plus d’horreurs ; mais aussi son théâtre était plus vaste, et par cette raison, elle avait plus d’occasions et plus de facilités. Je dis que son théâtre était plus vaste, parce qu’à l’exception de Rome et de Carthage, les États gouvernés par un corps d’administrateurs ont été très bornés ; à quoi j’ajoute que ce n’est pas dans l’histoire de ces deux républiques qu’on puisera des arguments pour prouver que le partage de l’autorité ne produit aucun désordre.
Quoi qu’il en soit, j’admets que dans l’état d’ignorance l’autorité est plus dangereuse dans les mains d’un seul, qu’elle ne l’est dans les mains de plusieurs. Ce qui me décide à le croire, c’est que dans cette seconde espèce de gouvernement, la mauvaise volonté peut trouver des oppositions pour faire le mal, comme la bonne volonté peut en trouver pour faire le bien : les intérêts particuliers s’entre-servent souvent de contrepoids, et cela même doit leur arriver jusqu’à ce qu’ils se soient conciliés au préjudice de l’intérêt commun.
C’est moins les faits qu’il faut consulter que les causes qui les ont produits : ce n’est que sur cette base qu’on peut établir un raisonnement solide, parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets : or en examinant la cause première des faits, nous trouverons que ce n’est point parce que l’autorité se trouvait dans les mains d’un seul, qu’elle est devenue un fléau terrible ; que c’est au contraire parce que les hommes n’avaient point alors une connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés ; vérité que personne ne peut révoquer en doute, puisque cet ordre ne se trouve dans aucune législation des anciens, ni même dans aucun de leurs philosophes.
Dans quelques mains que l’autorité soit placée, il faut nécessairement qu’elle soit orageuse, et qu’elle devienne destructive, dès qu’une société n’est point organisée suivant les lois de l’ordre naturel et essentiel. Mais cet ordre ne peut s’établir s’il n’est évidemment [111] connu : ainsi une connaissance évidente de l’ordre est la première condition requise pour qu’il ne puisse résulter aucun abus de l’autorité.
Suivant cet ordre essentiel, l’autorité tutélaire est l’administration d’une force sociale et physique instituée dans la société et par la société, pour assurer parmi les hommes la propriété et la liberté, conformément aux lois naturelles et essentielles des sociétés.
Cette force est force sociale, parce que loin d’exister par elle-même, c’est dans la société qu’elle prend naissance ; elle y est formée par la réunion des intérêts et des volontés.
Elle est force physique, parce que cette réunion de volontés opère en faveur de cette autorité la réunion de toutes les forces physiques de la société.
Elle est instituée dans la société et par la société, parce que cette réunion de volontés et de forces ne peut avoir lieu qu’après que les hommes se sont réunis dans un corps social.
Elle est établie pour assurer parmi les hommes la propriété et la liberté, parce que ce n’est que dans la vue d’établir solidement l’une et l’autre, que chaque société s’est formée, et que sans l’une et l’autre aucune société ne pourrait subsister.
Enfin elle doit les maintenir telles que l’exigent les lois naturelles et essentielles des sociétés, parce que ces lois naturelles et essentielles qui tiennent à l’ordre physique, et qu’aucune puissance humaine ne peut changer, doivent être la raison primitive de toutes les lois positives que cette autorité peut instituer.
Ainsi l’autorité, telle que je la représente ici, est le gage de la sûreté publique ; c’est par elle seule que les droits naturels et essentiels de chaque citoyen acquièrent la solidité qu’ils doivent avoir : comment donc pourrait-elle devenir funeste à la société dont elle cimente et perpétue l’union ? Ce malheur ne peut arriver que de deux manières ; il ne peut naître que de l’ignorance ou de la mauvaise volonté : mais partout où nous supposerons une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel, l’ignorance et la mauvaise volonté ne peuvent jamais égarer le dépositaire de l’autorité.
Ce n’est pas cependant que la personne même de ce dépositaire ne puisse manquer des lumières suffisantes pour son administration : ce léger inconvénient doit même se trouver souvent dans une monarchie héréditaire : les souverains peuvent être appelés au gouvernement avant que l’âge leur permette d’avoir les facultés requises pour bien gouverner ; et ce cas est particulièrement celui des minorités. Mais dans une nation qui d’après une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel de la société, a donné à [112] son gouvernement la forme essentielle qu’il doit avoir, les lois, qui ont pour elles la force despotique de l’évidence, veillent pour le souverain mineur et pour la nation, de manière que cette force dominante et irrésistible fait la sûreté de leurs intérêts communs.
Mais, me dira-t-on, le corps des magistrats, dont les lumières et les devoirs essentiels sont si nécessaires au maintien des lois dans toute leur pureté, ne peut-il pas lui-même se laisser corrompre et céder à des intérêts particuliers ? Non ; cela est impossible dans l’hypothèse où nous sommes : dès qu’on suppose une connaissance évidente de l’ordre répandue dans toute une société, il faut regarder les magistrats comme comptables de leur conduite à cette évidence publique, et comme n’ayant rien tant à craindre que la justice de ses jugements rigoureux.
Je conviens cependant que cette évidence publique ne peut être la même dans tous les membres de cette société ; mais aussi ne faut-il pas la concentrer dans les magistrats seulement : dans notre supposition au contraire, nous devons les regarder comme placés au milieu d’un cercle très étendu, très nombreux, qui participe à leurs connaissances, et qui pouvant juger sainement de leurs opérations, est en état d’éclairer l’autre partie de la nation. C’est de ce cercle de gens lumineux que partent les éloges du public et sa censure, qui, à l’aide des mobiles que la nature a placés en nous, et de la force propre aux affections sociales, font naître une émulation et une crainte salutaires qui servent de contrepoids aux motifs par lesquels nous pourrions être détournés des voies de l’honneur et de la vertu.
Nous voyons souvent que l’homme le plus injuste veut néanmoins paraître juste ; au moment même qu’un intérêt criminel triomphe en lui de l’évidence de ses devoirs, il sent que la seule publicité de ses crimes suffit pour l’en punir ; et il ne peut étouffer dans son âme le sentiment qui rend cette punition redoutable pour lui. Hélas ! combien d’hommes seraient devenus coupables, s’ils n’avaient été contenus par la honte de le paraître ! Il est certain qu’un homme n’osera jamais se permettre la plus légère infidélité, tant qu’il sera persuadé qu’elle serait en évidence aux yeux de tous ceux qu’elle intéresserait. Telle est la situation des magistrats et de tous ceux qui sont chargés de quelque administration dans une nation parvenue à une connaissance évidente et publique de l’ordre : cette évidence qu’on ne peut choquer impunément, en l’éclairant fait sa sûreté dans tous les temps.
On remarquera, sans doute, dans cet ouvrage que l’évidence est la base sur laquelle porte tout l’édifice de la société. Mais c’est à juste titre que je ramène tout à l’évidence, car sans l’évidence il est impossible d’imaginer rien de parfait, rien de solide. [113] J’ai déjà dit qu’il n’y a pour nous que vérité ou erreur, qu’évidence ou opinion. Il est donc manifeste que les principes d’un gouvernement doivent nécessairement devenir arbitraires, dès qu’ils ne sont pas évidents ; c’est-à-dire, dès qu’ils ne sont pas le fruit d’une connaissance explicite et évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés ; car encore une fois, l’ordre ne peut s’établir, qu’autant qu’il est suffisamment connu ; et il n’est suffisamment connu, qu’autant qu’il l’est évidemment, puisque tout ce qui n’est pas évident reste arbitraire.
Si donc vous ôtez aux hommes cette connaissance évidente, je vous donne le choix parmi les différentes formes de gouvernement : quelle que soit celle que vous préfériez, vous y trouverez tous les vices inséparables de l’arbitraire ; et quelques mesures qu’on prenne pour empêcher les abus de l’autorité, il faudra toujours et nécessairement ou qu’elle devienne oppressive, ou qu’elle soit dans un état de faiblesse qui rende nul ce lien politique ; auquel cas la société ne sera plus une société.
[I-265 / 114]
CHAPITRE XXI.↩
Quatrième suite du chapitre XVII. — Réfutation du système chimérique des contre-forces établies pour balancer l’autorité tutélaire dans le gouvernement d’un seul. — Partout où règne l’évidence de l’ordre, les établissements de ces contre-forces sont impossibles ; dans l’état d’ignorance ils le sont encore, mais par d’autres raisons.
L’arbitraire, en cela qu’il est une production monstrueuse de l’ignorance, ne sait remédier à un désordre que par un autre désordre. Dans cet état, les hommes deviennent nécessairement le jouet de l’inconstance orageuse de l’opinion. Ces vérités si simples, si évidentes par elles-mêmes ont cependant échappé à de grands génies ; et de leur inattention à ce sujet est provenu le système des contreforces qu’ils ont prétendu devoir être opposées à l’autorité, pour en arrêter les abus.
Ou les principes d’un gouvernement sont évidents, ou ils ne le sont pas : s’ils le sont, toutes les forces et toute l’autorité sont acquises à leur évidence ; ainsi les contre-forces ne peuvent avoir lieu ; il n’y a pour lors qu’une seule force, parce qu’il n’y a qu’une seule volonté. Si au contraire ces principes ne sont pas évidents, l’établissement des contre-forces est une opération impraticable ; car quelle contre-force peut-on opposer à celle de l’ignorance, si ce n’est celle de l’évidence ? Comment dissiper les ténèbres de l’erreur, si ce n’est par la lumière de la vérité ? Qu’est-ce que c’est que le projet de choisir un aveugle pour servir de guide à un autre aveugle ? On craint l’ignorance dans le souverain, et pour empêcher qu’elle ne l’égare, on lui oppose d’autres hommes qui ne sont pas en état de se conduire eux-mêmes ; voilà ce qu’on appelle des contre-forces : il faut convenir qu’elles sont bien mal imaginées ; qu’il est inconcevable qu’on ait pu se persuader que l’ignorance pût servir utilement de contre-force à l’ignorance.
En adoptant même cette chimère, ne voit-on pas qu’il est impossible de s’assurer que chaque force sera demain ce qu’elle paraît être aujourd’hui ? Je dis ce qu’elle paraît être, car on ne peut jamais avoir aucune certitude de son véritable état actuel, vu qu’il dépend de diverses dispositions morales qui peuvent bien être présumées, mais non pas connues avec évidence. Ainsi, à considérer ces contre-forces dans le premier moment de leur institution, dans l’action même de les former, on voit qu’elles ne sont qu’un jeu ridicule de l’opinion.
Ceux qui ont imaginé le système des contre-forces, ont pensé que le pouvoir du souverain pouvait être modifié par un autre pouvoir [115] opposé, tel que celui d’une puissance établie pour en être le contrepoids et le balancer. Si dans l’exécution de cette idée bizarre on pouvait parvenir à instituer deux puissances parfaitement égales, séparément elles seraient toutes deux nulles, ainsi que je l’ai déjà démontré ; si au contraire elles étaient inégales, il n’y aurait plus de contre-forces. Voilà une première contradiction bien évidente.
On s’est persuadé sans doute qu’il en est des contre-forces morales comme des contre-forces physiques, qui par la contrariété de leur direction, déterminent nécessairement certains corps à rester dans une situation mitoyenne. Mais on n’a pas vu que dans le physique la direction donnée ne dépend point de l’opinion des choses qui font contre-force, et que dans le moral au contraire ceux qui font contre-force, peuvent eux-mêmes changer leur direction au gré de leur opinion. Ainsi au moyen de ce qu’on ne peut être certain que cette direction soit toujours la même en eux, il devient impossible de pouvoir compter sur leurs contre-forces ; et ce système qui suppose uniforme et constant ce qui est évidemment connu pour ne pouvoir l’être, tombe en cela dans une seconde contradiction évidente.
Si l’auteur qui a le plus soutenu ce projet chimérique, pouvait me répondre, je lui demanderais comment il a compté calculer les contre-forces pour trouver leur point d’équilibre. Dans l’ordre social toute force est le produit d’une réunion d’opinions et de volontés, et le principe de cette réunion est ou évident ou arbitraire. Dans le système en question, on ne peut supposer que ce principe soit évident, parce qu’alors, comme je viens de le dire, il n’y aurait qu’une seule volonté, et une seule force sociale. Mais puisqu’il ne peut être qu’arbitraire, on ne peut plus calculer ni le principe ni son produit : dès que les opinions sont séparées de l’évidence, il est certain que nous ne pouvons ni connaître leur force, ni nous assurer de leur durée.
Établissons pour un moment une contre-force, et supposons qu’un souverain ne puisse rien ordonner que du consentement de son conseil ; composons même ce conseil de telle sorte qu’il forme la plus grande contre-force possible : alors ce n’est plus le gouvernement d’un seul, c’est le gouvernement de plusieurs, d’un corps composé d’un chef et de son conseil, dont chaque membre participe ainsi à la souveraineté. Ce corps cependant se trouve institué de manière qu’il forme réellement deux puissances dont les forces sont destinées à se trouver en opposition ; car le souverain supposé ne peut rien sans son conseil, et le conseil entier ne peut rien sans le souverain. Examinons maintenant la valeur de cette disposition, et si ces deux puissances font réciproquement contre-force. [116] Je conviens que le souverain fait contre-force vis-à-vis la puissance de son conseil ; et l’effet de cette contre-force est de mettre le souverain dans le cas de pouvoir s’opposer au bien comme au mal. Il n’y a donc point un avantage certain à établir que le conseil ne peut rien sans le souverain. Je trouve ce même inconvénient dans la prétendue contre-force du conseil ; l’ignorance peut la rendre très préjudiciable ; elle peut perdre la nation au lieu de la servir. Mais à ce premier inconvénient il s’en joint un second ; c’est que cette espèce de contre-force n’est rien moins que ce qu’elle paraît : impossible d’empêcher ceux qui concourent à la former, d’être dominés par leurs intérêts particuliers : dès lors plus de contre-force ; sa direction ne peut plus être fixée ; celle-ci doit nécessairement changer au gré de ses intérêts. Ajoutez que ces sortes de variations sont même d’autant plus naturelles, que tout devient arbitraire dès que les hommes ne sont point éclairés par l’évidence de l’ordre ; or quand tout est arbitraire, on ne peut accuser personne d’avoir évidemment trahi son ministère. Ainsi dans le cas supposé, la contre-force du conseil est absolument nulle, à moins qu’on ne commence par en opposer une aux intérêts particuliers ; mais celle-ci ne peut se trouver que dans la force irrésistible de l’évidence.
Sous quelque face que nous considérions ce système spécieux, nous y trouvons donc les mêmes contradictions. Il consiste au fond à opposer une opinion à une autre opinion ; des volontés arbitraires à d’autres volontés arbitraires ; des forces inconnues à d’autres forces inconnues : dans cet état, il est impossible que des intérêts particuliers ne soient pas la mesure de la résistance que ces forces peuvent éprouver tour à tour, ainsi que les motifs secrets de leur conciliation ; il est impossible qu’entre ces mêmes forces il ne se perpétue pas une guerre sourde et insidieuse, pendant laquelle les brigues, les séductions, les trahisons de toute espèce deviennent des pratiques habituelles et nécessaires ; guerre cruelle et destructive qui se fait toujours aux dépens des intérêts de la nation, nécessairement victime de la cupidité des combattants.
Dans un gouvernement dont les principes sont arbitraires, il est inutile de se mettre l’esprit à la torture pour trouver des contreforces ; car ce qui rend vicieux ce gouvernement, c’est précisément la multitude des contre-forces qui s’y forment naturellement, parce qu’il s’établit naturellement un grand nombre d’opinions différentes, et d’intérêts particuliers opposés les uns aux autres : aussi cette division tend-elle à l’anarchie et à la dissolution de la société. Pour faire cesser ce désordre toutes forces factices sont impuissantes, parce que toute opinion n’est forte qu’en raison de la faiblesse de celles qui lui [117] sont contraires. On ne peut donc employer alors que la force naturelle de l’évidence, comme seul et unique contre-force de l’arbitraire.
La force de l’évidence est dans l’évidence même ; aussi est-il certain que sitôt que l’évidence est connue, sa force devient irrésistible : elle ne peut donc rencontrer des contre-forces que dans l’ignorance ; mais il suffit d’éclairer celle-ci pour la désarmer. Il n’en est pas ainsi de la force d’une simple opinion ; non seulement elle a tout à craindre de l’évidence, contre laquelle elle ne peut rien ; mais elle a pour ennemis encore autant d’autres forces particulières qu’il peut s’établir d’opinions diverses. Toutes ces forces qui sont également des productions de l’ignorance, qui ne tiennent rien d’elles-mêmes, et doivent à l’ignorance tout ce qu’elles sont, combattent entre elles à armes égales ; ce sont des aveugles qui s’attaquant réciproquement, ne peuvent connaître que les maux qu’ils éprouvent, et jamais ceux qu’ils font. De remèdes à cette confusion, il n’en est point ; il faut absolument se décider entre n’admettre qu’une autorité unique, établie sur l’évidence, ou une multitude d’autorités arbitraires dans leurs institutions comme dans leurs procédés, et qui ne peuvent cesser de s’entrechoquer.
Il est donc certain que ce n’est que dans une nation parvenue à une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, qu’on n’a rien à craindre de l’autorité tutélaire : cette connaissance évidente et publique ne peut exister sans procurer à la société la forme essentielle qu’elle doit avoir ; or cette forme essentielle une fois établie, elle doit trouver en elle-même tous les moyens nécessaires pour se conserver ; car le propre de l’ordre est de renfermer en lui-même tout ce qu’il lui faut pour se perpétuer.
Ainsi dans une telle société toutes les lois positives ne pourront être que des résultats évidents des lois naturelles et essentielles.
Ainsi ces mêmes lois positives seront toutes favorables au droit de propriété et à la liberté.
Ainsi le corps des magistrats gardiens et dépositaires de ces lois, ne sera composé que de citoyens ayant les qualités requises pour la sainteté de leur ministère.
Ainsi ces magistrats, comptables de leurs fonctions au souverain et à l’évidence publique, qui en éclairant la nation veillera sans cesse sur eux, seront contraints de ne jamais parler un autre langage que celui de la justice et de l’évidence.
Ainsi les lumières, le zèle et la fidélité de ces mêmes magistrats ne cesseront d’être pour le souverain une ressource assurée contre les surprises qui pourraient être faites à son autorité, au mépris de ses intérêts évidents et de ceux de ses sujets. [118] Ainsi l’évidence de la sagesse et de la justice des lois positives sera le garant de leur immutabilité et de leur observation la plus exacte, jusque dans les temps où la personne même du souverain ne serait pas en état de les protéger.
Ainsi la force despotique de cette évidence sera le titre primitif de leur autorité sacrée, sous la protection de laquelle toutes les personnes et tous les droits seront également et toujours en sûreté.
Ainsi les peuples verront leur meilleur état possible dans leur soumission constante à ces lois ; ils béniront, ils adoreront le souverain en lui obéissant ; et leurs richesses ne croissant que pour être partagées avec le monarque qui leur en procure la jouissance paisible, son intérêt personnel et son autorité bienfaisante doivent assurer à jamais la conservation de cet ordre divin, qui est le principe évident de leur prospérité commune.
Cette légère esquisse me dispense de parler des effets de la mauvaise volonté : premièrement, ils seraient inconciliables avec la force irrésistible dont jouira toujours l’évidence de l’ordre naturel et essentiel ; en second lieu, il est contre nature de supposer dans un souverain, une mauvaise volonté évidente ; un dessein manifeste de trahir évidemment ses propres intérêts dans ceux de ses sujets, et de travailler ainsi lui-même à l’anéantissement de sa puissance et de sa souveraineté. Mais quand même cette manie inconcevable et inadmissible serait possible en spéculation, toujours est-il vrai qu’elle doit être bien plus rare dans un souverain qui ne peut s’y livrer qu’à son préjudice, que dans un corps d’administrateurs qui peuvent s’abandonner à leur mauvaise volonté sans trahir leurs intérêts personnels, et même en les servant ; par conséquent que le gouvernement d’un seul est encore à cet égard préférable à tout autre gouvernement qui n’est point également protégé par l’évidence et par les intérêts même du dépositaire de l’autorité. S’il reste quelques nuages sur cette vérité, j’ose me flatter que les chapitres suivants achèveront de les dissiper.
[I-278 / 119]
CHAPITRE XXII.↩
Continuation du même sujet. — Du despotisme. — Pourquoi il nous est odieux ; l’ignorance est la cause primitive des désordres qu’il a produits. — L’homme est destiné par la nature même à vivre sous une autorité despotique. — Il est deux sortes de despotismes ; l’un est personnel et légal ; l’autre est personnel et arbitraire : le premier est le seul conforme à l’ordre essentiel des sociétés ; le second est aussi funeste au despote même qu’aux peuples qu’il opprime.
Le grand argument de ceux qui sont ennemis de toute monarchie, est que cette forme de gouvernement conduit au despotisme. Ce nom nous peint toujours une chose odieuse, contraire à l’ordre, aux droits naturels de l’humanité. Cette aversion nous est naturellement suggérée par la seule contemplation des désordres qu’il a produits : frappés de l’horreur qui nous saisit à la vue de ce tableau, nous sommes révoltés sur-le-champ contre le despotisme ; nous le regardons comme un fléau terrible et habituel ; nous le condamnons ainsi sans chercher à approfondir d’où proviennent les maux qu’il a faits ; s’ils lui sont propres ou s’ils lui sont étrangers ; et nous ne nous servons plus des termes de despote et de despotisme que pour exprimer une sorte d’autorité monstrueuse que l’ordre et la raison ne peuvent reconnaître, et dont il faut absolument purger la société.
C’est ainsi que les faits, détachés de leurs causes premières, sont pour nous une source d’erreurs. On a raison de s’élever contre le despotisme considéré tel qu’il a presque toujours été chez quelques nations ; mais le despotisme factice et déréglé, dont nous sommes effrayés à juste titre, et le despotisme naturel, tel qu’il est institué par l’ordre même, ne se ressemblent point : il est également impossible que le premier ne soit pas orageux, destructif, accablant, et que le second ne produise pas tous les biens que la société peut désirer.
Qui est-ce qui ne voit pas, qui est-ce qui ne sent pas que l’homme est formé pour être gouverné par une autorité despotique ? Qui est-ce qui n’a pas éprouvé que sitôt que l’évidence s’est rendue sensible, sa force intuitive et déterminante nous interdit toute délibération ? Elle est donc une autorité despotique, cette force irrésistible de l’évidence, cette force qui pour commander despotiquement à nos actions commande despotiquement à nos volontés.
Le despotisme naturel de l’évidence amène le despotisme social : l’ordre essentiel de toute société est un ordre évident ; et comme l’évidence a toujours la même autorité, il n’est pas possible que [120] l’évidence de cet ordre soit manifeste et publique, sans qu’elle gouverne despotiquement.
C’est par cette raison que cet ordre essentiel n’admet qu’une seule autorité, et par conséquent un seul chef : l’évidence ne pouvant jamais être en contradiction avec elle-même, son autorité est nécessairement despotique, parce qu’elle est nécessairement une ; et le chef qui commande au nom de cette évidence, est nécessairement despote, parce qu’il se rend personnelle cette autorité despotique.
S’il est incontestable que nous sommes organisés pour connaître l’évidence et nous laisser gouverner par elle ; s’il est incontestable que l’ordre essentiel de toute société est un ordre évident, il résulte de ces deux propositions, qu’il est dans les vues de la nature que le gouvernement social soit un gouvernement despotique, et que l’homme, en cela qu’il est destiné à vivre en société, est destiné à vivre sous le despotisme. Une autre conséquence encore, c’est que cette forme de gouvernement est la seule qui puisse procurer à la société son meilleur état possible ; car ce meilleur état possible est le fruit nécessaire de l’ordre : ce n’est que par une observation scrupuleuse de l’ordre qu’il peut s’obtenir ; ainsi ce n’est qu’autant que l’évidence de l’ordre gouverne despotiquement, que les hommes peuvent parvenir à jouir de tout le bonheur que l’humanité peut comporter.
Le despotisme n’a fait que du mal, nous dit-on : donc il est essentiellement mauvais. Assurément cette façon de raisonner n’est pas conséquente : on pourrait dire aussi, la société occasionne de grands maux ; donc elle est essentiellement mauvaise ; et ce second argument vaudrait le premier. Oui sans doute, le despotisme a fait beaucoup de mal ; il a violé les droits les plus sacrés de l’humanité ; mais ce despotisme factice et contre nature n’était pas le despotisme naturel de l’évidence de l’ordre : ce dernier assure les droits que le premier détruit.
Il n’est point pour nous de milieu entre être éclairés par l’évidence ou être livrés à l’ignorance et à l’erreur. De là, deux sortes de despotisme, l’un légal, établi naturellement et nécessairement sur l’évidence des lois d’un ordre essentiel, et l’autre arbitraire, fabriqué par l’opinion, pour prêter à tous les désordres, à tous les écarts dont l’ignorance la rend susceptible.
Le désir de jouir est également le premier principe de ces deux despotismes ; mais dans celui-là l’action de ce mobile est dirigée par l’évidence de l’ordre, et dans celui-ci elle est déréglée par l’opinion, qui, égarée par l’ignorance, ne met point de bornes à ses prétentions. De là s’ensuit que le despotisme légal, qui n’est autre chose que la force naturelle et irrésistible de l’évidence, qui par conséquent assure [121] à la société l’observation fidèle et constante de son ordre essentiel, de son ordre le plus avantageux, est pour elle le meilleur gouvernement possible, et l’état le plus parfait qu’elle puisse désirer : de là s’ensuit encore que le despotisme qui se forme dans un état d’ignorance est arbitraire dans toutes ses parties : il l’est dans son institution, car il prend naissance dans des prétentions arbitraires ; il l’est dans la façon de se maintenir, car il ne se prolonge que par l’utilité dont il est à des prétentions arbitraires ; il l’est dans ses procédés, car il ramène tout à la force qui sert ses prétentions arbitraires.
Le voilà ce despotisme terrible, ce despotisme arbitraire que l’ordre réprouve, parce que l’ordre et l’arbitraire sont absolument incompatibles ; le voilà tel que l’ignorance l’a enfanté en différents temps pour le malheur commun des despotes et des infortunés qu’ils tenaient dans l’oppression. Les suites cruelles qu’il doit avoir pour les peuples sont trop connues pour que j’entre dans aucun détail à ce sujet ; mais ce que je dois faire principalement remarquer, c’est que ce despotisme n’est pas moins redoutable, pas moins funeste à l’oppresseur, qu’il l’est aux opprimés. Cette vérité sera pour nous une nouvelle preuve que dans l’ordre tout se tient ; que le bonheur particulier de chaque individu est lié au bonheur général ; que le meilleur état possible des sujets devient nécessairement le meilleur état possible des souverains.
[I-285 / 122]
CHAPITRE XXIII.↩
Suite du chapitre précédent. — Le despotisme arbitraire considéré dans ses rapports avec l’autorité ; avec la sûreté personnelle et les intérêts du despote. — Combien ce despotisme lui est nécessairement désavantageux. — Sous le despotisme arbitraire il n’est point de véritable société, point de nation proprement dite.
Le despotisme arbitraire est un composé de quatre parties qu’il faut considérer séparément. Ces quatre parties sont le despotisme, le despote, la force physique qui fait son autorité, et les peuples qu’il contraint de lui obéir. Le despotisme arbitraire est une production bizarre de l’ignorance, une force physique qui se sert de sa supériorité pour opprimer. Cette force n’existe point par elle-même et dans un seul individu ; elle est le résultat d’une association ; et cette association se forme par un concours de prétentions et d’intérêts arbitraires qui s’unissent à cet effet. Mais par la raison que ces prétentions et ces intérêts sont arbitraires, leur position respective peut changer à tout instant, et les conduire à se désunir ; alors plus d’association ; plus de force supérieure ; plus de despotisme : son existence n’est ainsi nécessairement que précaire et conditionnelle.
Cependant la chute du despotisme doit entraîner celle du despote, car point de despote sans despotisme : ainsi tous les risques que le despotisme court habituellement, sont communs au despote. Mais outre ces premiers risques il en est d’autres encore qui sont propres et particuliers à la personne de ce dernier : le despotisme ne tient point au despote, comme le despote tient au despotisme ; et la force qui soutient le despotisme peut, sans changer la forme du gouvernement, sacrifier à ses prétentions arbitraires la personne même du despote.
Quand des exemples multiples ne nous apprendraient pas combien ces petites révolutions sont naturelles et faciles, quelques réflexions suffiraient pour nous les démontrer. La force qui sert de base à l’autorité du despote arbitraire, n’est ni à lui ni en lui ; elle n’est au contraire qu’une force empruntée ; et c’est d’elle qu’il tient tout, tandis qu’elle ne tient rien de lui. Il est donc absolument dans la dépendance de cette force ; car il ne peut jamais en disposer malgré elle, au lieu qu’elle peut toujours disposer de lui malgré lui.
Cette observation nous montre que le despote arbitraire n’est rien moins que ce qu’il paraît être ; c’est une espèce de corps transparent et fragile au travers duquel on aperçoit la force qui l’environne : on peut le comparer à ces figures de bois ou d’osier, qui [123] semblent faire mouvoir une machine à laquelle elles sont attachées, tandis que c’est cette même machine qui leur imprime tous leurs mouvements. Le despotisme est véritablement acquis à la force d’association qui le maintient ; et les intérêts personnels arbitraires qui forment cette association, sont les ressorts intérieurs du despotisme arbitraire. Le despote n’est ainsi qu’un simulacre qui se meut au gré de cette force dont il est tellement dépendant, qu’il ne peut se passer d’elle, et qu’elle peut au contraire se passer de lui.
Dans le dernier état de l’Empire romain, le despotisme arbitraire s’était emparé du gouvernement. Mais quels avantages les despotes en ont-ils retirés ? Nous voyons une succession d’empereurs alternativement immolés au caprice de leur armée révoltée, ou à l’enthousiasme d’un petit nombre de conjurés à qui la trahison tenait lieu de force. Ceux qui, à l’exemple de Sylla, dépouillaient les citoyens pour enrichir les soldats, excitaient dans Rome des conspirations ; ils périssaient par la main des citoyens. Ceux qui, loin de se propicier le soldat par des profusions, cherchaient à mettre un frein à sa cupidité, blessaient les prétentions arbitraires des gens de guerre ; ils périssaient par la main des soldats. L’opinion livrée à toute la fureur des passions et à tous les égarements de l’ignorance, disposait de la force publique, parce que c’était cette même opinion qui la formait. Cette force tenait sous le joug de la tyrannie ceux même auquel elle vendait le droit chimérique de lui commander : les despotes qu’elle établissait, obligés de chercher la mort dans la haine du citoyen, pour ne pas la trouver dans le mécontentement de l’armée, étaient ainsi privés de la propriété de leur personne : ces prétendus maîtres si grands, si redoutables, n’avaient pas même la liberté d’être justes et vertueux ; ils se trouvaient réduits à n’être que les esclaves d’une puissance arbitraire, qui ne leur prêtait son pouvoir que pour les rendre les instruments serviles de son ambition aveugle. Partout où le despotisme arbitraire s’est établi, et principalement chez les Asiatiques, nous lui avons vu constamment produire les mêmes effets, et devenir également funeste aux despotes qui n’étaient point assez sages pour se conduire sur d’autres principes.
Ainsi l’épée dont le despote s’arme pour frapper, est la même qui se trouve suspendue par un fil au-dessus de sa tête ; et la force qui est le fondement de sa puissance arbitraire y est précisément celle qui le dépouille de son autorité, et qui menace sa personne à chaque instant. Cette position est d’autant plus cruelle, que ce qu’elle a d’affreux n’est balancé par aucun avantage ; car le despotisme arbitraire, considéré dans ses rapports avec les peuples, n’a pas moins d’inconvénients pour le despote. [124] En effet, à parler rigoureusement, un despote arbitraire commande, mais ne gouverne pas : par la raison que sa volonté arbitraire est au-dessus des lois qu’il institue arbitrairement, on ne peut pas dire qu’il y ait des lois dans ses États ; or un gouvernement sans lois est une idée qui implique contradiction ; ce n’est plus un gouvernement. À la faveur d’une force empruntée ce despote commande donc à des hommes que cette force opprime ; mais ces hommes ne sont point des sujets, et ne forment point ce qu’on peut appeler une nation, c’est-à-dire, un corps politique dont tous les membres sont liés les uns aux autres par une chaîne de droits et de devoirs réciproques, qui tiennent l’État gouvernant et l’État gouverné inséparablement unis pour leur intérêt commun.
J’ai déjà dit et redit que les devoirs sont établis sur les droits, comme les droits le sont sur les devoirs : mais sous le despotisme arbitraire il n’en existe réellement d’aucune espèce ; le nom même de droits et de devoirs doit y être inconnu : quiconque jouit de la faveur du despote arbitraire, peut au gré de son caprice dépouiller les autres hommes de leurs biens, de leur vie, de leur liberté ; il n’y a donc parmi eux aucune sorte de propriété constante, par conséquent aucuns droits réciproques et certains. Ce désordre s’accroît toujours en raison du nombre de ceux auxquels le despote communique une portion de son autorité : le système de ce prétendu gouvernement étant de rapporter tout à la force, chacun de ceux qui commandent en sousordre, est autorisé par ce même système, à se permettre tout ce que lui permet la force dont il a la disposition.
C’est sous ce despotisme arbitraire qu’on peut dire qu’il n’existe qu’un seul et unique devoir absolu, celui d’obéir. Mais quoique j’aie déjà démontré dans le chapitre XIII que l’idée de ce prétendu devoir unique et absolu renferme des contradictions évidentes, cet objet est d’une trop grande importance, pour me contenter de ce que j’ai dit à son sujet.
Si l’obligation d’obéir est un devoir unique et absolu, cette obligation est donc sans bornes ; elle est la même dans tous les cas, et quelle que puisse être la chose commandée. Je demande à présent s’il est quelqu’un qui puisse entendre sans horreur, sans frémir, que tout homme placé pour obéir à un autre, est dans une obligation indispensable, dans une obligation absolue d’exécuter tout ce que son supérieur lui ordonne. Ne voit-on pas d’un coup d’œil que tous les liens du corps politique sont rompus ; qu’autant il est de commandants, autant il est d’autorités despotiques indépendantes les unes des autres ? Un furieux se trouve avoir cent hommes à ses ordres ; dans ce système il faut aller jusqu’à soutenir qu’ils sont indispensablement obligés de s’armer pour tous les forfaits qu’il leur [125] commande : quel que soit l’objet sur lequel sa fureur veuille se déployer, les plus grands crimes et les plus évidents deviennent pour eux un devoir ; et d’après le principe dont il s’agit, ils seraient coupables s’ils étaient arrêtés par l’évidence des atrocités qu’on leur ordonne de commettre.
Je viens de dire que dans ce système absurde tous les liens du corps politique sont rompus ; pour le prouver d’une manière bien sensible, il me suffit de faire observer qu’il n’est plus aucun moyen d’assurer à l’autorité l’obéissance qu’on doit naturellement à ses ordres. Quiconque commande doit être obéi ; quiconque commande est donc despote. Mais s’il est despote il ne peut être commandé ; et lorsqu’il l’est, son obéissance est absolument volontaire ; car s’il lui plaît de donner aux hommes qui lui sont soumis, des ordres contraires à ceux qu’il reçoit, ces hommes doivent exécuter ses volontés particulières, et point du tout celles de ses supérieurs. Dans cet état d’insubordination, impossible qu’il existe aucune autorité réelle autre que celle qu’on exerce immédiatement sur des hommes qui n’ont aucune sorte de commandement. Au milieu de cette confusion, impossible qu’on puisse entendre la voix d’une autorité première ; impossible de former cette chaîne de devoirs évidents qui forcent toutes les volontés de se rallier à elle pour ne point s’en séparer, si jamais cette séparation leur était commandée, au mépris de ces mêmes devoirs.
Les peuples qui gémissent sous le joug du despotisme arbitraire, ne forment donc point une nation, parce qu’ils ne forment point entre eux une société ; car il n’est point de société sans droits réciproques, et il n’est point de droits là où il n’est point de propriété. Chaque homme ne voit dans les autres hommes que des ennemis, parce que s’ils ne le sont pas déjà, ils peuvent le devenir d’un instant à l’autre. Dans cette position, il n’existe que des intérêts particuliers, et nullement un intérêt commun, si ce n’est dans un seul et unique point, qui est la destruction du despotisme pour établir, sur ses ruines, une société qui du moins ait forme de société.
Il est évident que des peuples qui n’ont entre eux aucuns droits certains, aucuns devoirs réciproques, aucun autre intérêt commun qu’un intérêt qui les rend ennemis du pouvoir sous le poids duquel ils sont accablés, ne tiennent à ce pouvoir par aucun lien social ; car il n’existe point de lien social sans société ; et il n’existe point de société entre un oppresseur et des opprimés : elle est totalement anéantie dès que les procédés arbitraires d’une force supérieure détruisent la réciprocité des droits et des devoirs.
Je ne dirai point ici combien cette situation violente met la personne du despote arbitraire en danger ; je ne dirai point que cet [126] intérêt commun, toujours prêt à s’armer contre lui, peut opérer des associations qui lui deviennent funestes ; que plus le despotisme arbitraire veut resserrer les liens de l’esclavage, et plus il augmente l’intérêt et le désir d’en sortir ; que pour connaître combien cette dégradation morale peut devenir fatale à ceux qui en sont les auteurs, il est inutile de consulter des temps éloignés de nous, qu’il suffit de passer les mers, et d’y voir ce que les maîtres ont à craindre des esclaves qui ont formé la volonté de sortir de l’oppression ; j’observerai seulement que le danger du despote est d’autant plus grand et d’autant plus habituel, que sa perte n’a pas besoin d’être préparée de longue main, et qu’elle peut être consommée sans de grands mouvements : un vil esclave, un intérêt obscur, une intrigue sourde et basse suffisent pour porter des coups dont le despote arbitraire ne peut jamais être garanti par toutes les forces dont il est environné. Une chose même terrible à mon gré, et que je ne peux envisager de sang-froid, c’est que le despotisme arbitraire est fait pour assurer l’impunité du crime au succès de ces sortes d’entreprises : la volonté du despote étant la loi suprême, et s’anéantissant avec lui, la poursuite d’un tel attentat dépend uniquement des volontés de celui qui le remplace : ainsi toute fois que ce dernier est coupable lui-même, il n’est plus de loi qu’il ait à redouter.
Mais nous, dont les mœurs ne nous permettent pas de croire à ses forfaits ; nous dont les souverains trouvent leur sûreté personnelle dans l’autorité sacrée des lois, et dans l’amour de leurs sujets, détournons nos regards de dessus ces objets qui nous font horreur, et contentons-nous de parcourir les effets du despotisme arbitraire dans les rapports d’intérêts réciproques qui se trouvent entre les peuples et le despote.
Le despotisme arbitraire, en cela qu’il est destructif du droit de propriété, devient absolument exclusif de l’abondance ; il éteint toute activité ; il anéantit toute industrie ; il tarit la source de toute richesse dans toute l’étendue de sa domination. Le produit des terres se trouve ainsi presque réduit à rien, en comparaison de ce qu’il pourrait ou devrait être ; et les revenus du despote diminuent d’autant, ainsi que la population et tout ce qui concourt à constituer la force politique. Je dis que ses revenus diminuent d’autant, parce que l’impôt, comme on le verra dans les chapitres suivants, ne peut être fourni que par les produits des terres [2], et il a une mesure naturelle qu’aucune puissance humaine ne peut outrepasser, si ce n’est au préjudice de l’impôt même qu’elle voudrait augmenter.
[127]
Cependant la diminution des revenus du despote arbitraire ne le dispense point d’être grevé d’un tribut considérable ; car on peut appeler de ce nom les sommes qu’il est obligé de sacrifier pour acheter la force qui fait le soutien de son autorité. Il arrive même, par une contradiction commune à tout ce qui est contraire à l’ordre, que plus il a besoin de cette force, et moins il est en état de la payer : plus le despote abuse de son pouvoir, et plus il énerve ses propres revenus par les obstacles qu’il met à la reproduction : alors le mécontentement général croît en raison de ce que la reproduction s’affaiblit. Il est sensible que dans cette position le despote arbitraire augmente le besoin qu’il a d’être protégé par la force, et qu’à proportion de l’accroissement de ce besoin, les moyens de satisfaire aux dépenses qu’il exige, éprouvent de la diminution. Il se trouve donc dans le cas d’avoir plus à payer et moins à recevoir ; je ne crois pas qu’il y ait un désordre plus évidemment contraire à ses propres intérêts.
Il est aisé maintenant d’apprécier à sa juste valeur le despotisme arbitraire : il dévore sa propre substance, en détruisant le germe de la richesse, de la population, de la force politique de l’État ; il tient le despote dans une dépendance nécessaire et dispendieuse pour lui ; en même temps qu’il diminue doublement les revenus de ce prince, il en laisse la personne et l’autorité perpétuellement exposées à tous les orages de l’opinion et des prétentions arbitraires ; il brise enfin tous les liens du corps politique ; au moyen de quoi danger pour l’État, à raison de sa faiblesse ; danger pour l’autorité, parce qu’elle n’a nulle consistance ; danger pour la personne du despote, parce qu’il n’est pour elle aucune sûreté ; danger partout, en un mot, et pour tout ce qui tient à ce despotisme désastreux. Quels sont donc ses attraits perfides, pour que tant de souverains n’aient pu se défendre de leur séduction, et en soient devenus les victimes ? Ces attraits ne sont que des jeux de l’opinion, des prestiges qui ne peuvent en imposer qu’à l’ignorance : si ces princes infortunés eussent eu une connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, ils auraient trouvé dans son despotisme légal, la véritable indépendance, le véritable despotisme personnel qui faisait l’objet de leur ambition ; par son moyen, ils seraient parvenus naturellement et rapidement au dernier degré possible de richesses, de puissance, de gloire et d’autorité ; leur bonheur alors leur aurait paru d’autant plus vrai, d’autant plus parfait, qu’il eût été le fruit d’un ordre qui se maintient de lui-même ; qui n’exige des souverains aucuns sacrifices ; il n’a besoin que d’être suffisamment connu pour s’établir, et il lui suffit d’être établi pour se perpétuer.
[I-301 / 128]
CHAPITRE XXIV.↩
Du despotisme légal. — Il devient nécessairement personnel, mais sans aucun inconvénient pour les peuples. — Combien il est avantageux aux souverains. — Parallèle de ses effets et de ceux du despotisme arbitraire. — Grandeur et puissance des souverains dans le despotisme légal. — Il procure et assure le meilleur état possible au souverain et à la souveraineté, ainsi qu’à la nation.
Ce n’est point assez d’avoir démontré combien le despotisme arbitraire, si cruel pour les peuples, est contraire à tous les intérêts du despote ; il faut maintenant faire voir combien le despotisme légal, si favorable, si nécessaire au bonheur des sujets, est, en tout point, avantageux au souverain et à la souveraineté.
Quand le despotisme est légal, des lois immuables, dont la justice et la nécessité sont toujours en évidence, rendent la majesté du souverain et son autorité despotique toujours présentes jusque dans les parties de son empire les plus éloignées de sa personne ; comme ses volontés ne sont que l’expression de l’ordre, il suffit qu’elles soient connues pour qu’elles soient fidèlement observées ; et au moyen de l’évidence qui manifeste leur sagesse, il gouverne ses États, comme Dieu, dont il est l’image, gouverne l’univers, où nous voyons toutes les causes secondes assujetties invariablement à des lois dont elles ne peuvent s’écarter ; ce monarque ne s’occupe plus que du bien qui ne peut s’opérer sans son ministère ; la paix qui règne sans cesse dans son intérieur, répand au dehors ses douceurs inestimables ; plus elles se multiplient, pour les autres, et plus elles se multiplient pour lui-même ; la garde qui l’environne, n’est qu’une décoration extérieure, et nullement une précaution nécessaire ; sa personne est partout en sûreté au milieu d’un peuple aussi riche, aussi nombreux, aussi heureux qu’il peut l’être ; il féconde, pour ainsi dire, par ses regards, les terres les plus ingrates ; il se rend personnel le bonheur d’une multitude de sujets qui l’adorent, dans la persuasion qu’ils lui en sont redevables ; et l’abondance qui naît de toutes parts, ne se partage entre eux et lui que pour le rendre une source intarissable de bienfaits.
Un tel souverain doit avoir pour amis et pour admirateurs toutes les nations étrangères : pénétrées de vénération et de respect pour une puissance qui peut les étonner, mais jamais les alarmer, il me semble les voir venir mêler aux pieds de son trône, leurs hommages à ceux que l’amour filial de ses sujets s’empresse de lui rendre chaque jour ; dans tout ce qui s’offre à ses yeux il découvre un nouveau [129] sujet de gloire, un nouvel objet de jouissance ; il est sur la terre moins un homme qu’une divinité bienfaisante dont le temple est dans tous les cœurs, et qui paraît ne s’être revêtue d’une forme humaine, que pour ajouter aux biens que sa sagesse procure, ceux qu’on éprouve en jouissant de sa présence.
On a cherché à distinguer l’autorité des lois et l’autorité personnelle du souverain ; mais cette idée est encore une de ces productions ridicules qu’on ne peut attribuer qu’à l’ignorance. Si ces deux autorités ne sont point une seule et même autorité, je demande de qui les lois tiennent celle dont elles jouissent, et laquelle des deux est supérieure à l’autre. Si celle du souverain est la supérieure et la dominante, l’autorité des lois n’est plus rien ; si au contraire la supériorité est acquise à celle-ci, qu’on me dise donc de qui les lois l’ont reçue ; certainement les lois ne peuvent tenir leur autorité que de la puissance législatrice : si donc cette puissance ne jouit pas de l’autorité dans toute sa plénitude, il est évident qu’elle ne peut la communiquer aux lois qu’elle institue.
Dans l’état d’ignorance et de désordre on peut diviser l’autorité ; et j’ai fait voir les inconvénients qui en résultent nécessairement ; j’ai fait voir que si la puissance législatrice n’est pas en même temps puissance exécutrice, les lois qu’elle établit ne sont plus des lois, parce que la puissance exécutrice est la seule qui puisse constamment assurer leur observation. Je conviens donc que dans l’état d’ignorance, on peut mettre une différence entre l’autorité des lois et celle de la puissance exécutrice ; mais j’observe aussi que dans cet état, il faut nécessairement qu’une des deux se trouve nulle, et c’est toujours celle des lois ; car c’est de la puissance exécutrice qu’elles empruntent alors toute leur force, vu qu’elles ne sont plus autre chose que les volontés arbitraires de cette puissance.
Dans l’état opposé, dans celui d’une connaissance évidente de l’ordre, les lois positives, qui ne sont que l’expression d’un ordre évident, que l’application de ses lois essentielles, tiennent, il est vrai, toute leur autorité de cette évidence qui est leur premier instituteur ; mais si, dans le fait, elles jouissent de cette autorité, et si elles deviennent despotiques, c’est parce que la même autorité réside dans la puissance exécutrice ; de façon qu’entre la nation et l’autorité de l’évidence on aperçoit toujours l’autorité personnelle du souverain, par le ministère duquel l’évidence se fait connaître d’une manière sensible à tous ceux qui vivent sous sa domination.
Avant que les conséquences des lois essentielles de l’ordre soient adoptées comme lois positives, leur justice et leur nécessité ont commencé par devenir évidentes à la puissance législatrice ; elle les a reçues, pour ainsi dire, de l’évidence pour les dicter à ses sujets. Ces [130] lois positives sont ainsi tout à la fois l’expression d’un ordre évidemment nécessaire, et celle des volontés du souverain. Impossible donc qu’il puisse exister alors deux autorités distinctes ; impossible que le despotisme des lois ne soit pas personnel à la puissance qui commande et agit d’après l’évidence dont les lois ne sont que l’expression ; impossible même d’imaginer un autre despotisme légal que celui qui, par un effet de la force irrésistible de l’évidence, est acquis aux volontés du souverain avant d’être acquis aux lois positives, c’est-à-dire, avant que ces mêmes volontés soient revêtues de la forme qui leur donne le caractère et le nom de lois.
Quelle différence énorme à tous égards entre la situation d’un souverain que chacun regarde comme un bien qu’il craint de perdre, et celle d’un despote arbitraire que chacun regarde comme un mal qu’il ne supporte qu’autant qu’il ne peut s’en affranchir. L’autorité du despote arbitraire n’est que précaire et chancelante, parce qu’il est impossible de fixer les opinions, les divers intérêts, et les prétentions qui lui servent de base ; celle du despote légal est inébranlable, parce que l’évidence qui en est le principe, est invariable, et produit toujours les mêmes effets.
La puissance du despotisme arbitraire n’est au fond qu’une association de plusieurs forces physiques réunies pour asservir d’autres forces physiques, qui ne sont plus faibles, que parce qu’elles sont divisées : celle du despotisme légal est le produit d’une réunion générale de toutes les forces ; ce n’est pas parce qu’elle est supérieure qu’elle devient despotique ; c’est parce qu’elle est unique, et qu’il ne peut s’en former une autre.
Le despote arbitraire n’est point propriétaire de l’autorité qu’il exerce ; elle n’est qu’empruntée, puisqu’elle appartient réellement à ceux qui l’ont formée par une association qui n’a rien que d’arbitraire : celle du despote légal lui est propre et personnelle ; elle est à lui, parce qu’elle est inséparable de l’évidence qu’il possède, et qui, habitant en lui, fait que sa volonté devient le point de réunion de toutes les autres volontés et de toutes les forces. Ainsi le premier, toujours et nécessairement dépendant, n’est despote que de nom ; et le second, toujours et nécessairement indépendant, est despote en réalité. Il est dans la nature de l’autorité du despote arbitraire d’être toujours et nécessairement odieuse, parce qu’elle est destinée à tyranniser les volontés, à contraindre l’obéissance par la force physique : celle du despote légal n’étant que la force intuitive et déterminante de l’évidence, il lui est naturel de n’être, pour ses sujets, qu’un objet de respect et d’amour, parce qu’il lui est naturel d’asservir leurs
volontés sans leur faire aucune violence. [131] Le despotisme arbitraire, nécessairement destructif de la richesse du despote et de la puissance politique de l’État, renferme en lui-même le principe de sa destruction : le despotisme légal, procurant nécessairement le meilleur état possible à la nation, à la souveraineté, et au souverain personnellement, renferme en lui-même le principe de sa conservation.
Dans le despotisme arbitraire les volontés du despote ne sont point destinées à lui survivre ; elles meurent avec lui ; par cette raison les ennemis de ses volontés deviennent toujours les ennemis de sa personne ; et comme il est moralement impossible qu’elles ne fassent pas un grand nombre de mécontents, il se trouve ainsi dans une impossibilité physique et morale de se procurer aucune sûreté personnelle contre les opinions, les intérêts et les prétentions arbitraires que ses volontés doivent blesser à chaque instant : dans le despotisme légal l’évidence, qui commande avant que le souverain ordonne, fait que les volontés du monarque deviennent les volontés constantes et uniformes de toute la nation ; elles jouissent après lui de la même autorité despotique dont elles jouissaient pendant sa vie ; cette autorité leur est même tellement propre, que l’évidence de leur justice ne permet pas de former des prétentions qui leur soient contraires ; ainsi la sûreté la plus absolue, la plus entière, est naturellement et nécessairement acquise pour toujours à sa personne : on ne s’élève point contre lui, parce qu’on ne peut s’élever contre ses volontés ; et on ne peut s’élever contre ses volontés, parce qu’il faudrait s’élever contre la force de l’évidence, et contre toutes les forces réunies de la nation.
Partout où la connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel des sociétés se trouvera tellement répandue, que chacun, éclairé par cette lumière, attache son bonheur au maintien religieux des lois, il doit régner un despotisme personnel et légal, qui est le seul et unique véritable despotisme, parce qu’il est le seul qui existe par lui-même, qui se maintienne par lui-même, et qui ne puisse jamais être ébranlé. Malgré l’aversion naturelle qu’on avait du despotisme, on a bien senti qu’on ne pouvait s’arracher à l’arbitraire, qu’en se livrant à une autorité absolue, qui enchaînât toutes les opinions ; mais faute d’avoir remonté à un ordre social primitif et essentiel, faute d’avoir connu la force irrésistible de son évidence, on était toujours dans le cas de redouter cette autorité unique, parce qu’on ne voyait point comment elle ne serait pas arbitraire elle-même dans ses volontés : par cette raison, le seul mot de despotisme personnel inspirait une certaine horreur dont on ne pouvait se défendre, et on cherchait, sans le trouver, le despotisme légal dont on parlait sans le connaître : tandis que les puissances qui gouvernaient, ne comprenaient point [132] qu’il ne peut jamais exister un véritable despotisme personnel, s’il n’est légal, les peuples ignoraient aussi qu’il ne peut jamais exister un véritable despotisme légal, qu’il ne soit personnel.
Euclide est un véritable despote ; et les vérités géométriques qu’il nous a transmises, sont des lois véritablement despotiques : leur despotisme légal et le despotisme personnel de ce législateur n’en sont qu’un, celui de la force irrésistible de l’évidence : par ce moyen, depuis des siècles le despote Euclide règne sans contradiction sur tous les peuples éclairés ; et il ne cessera d’exercer sur eux le même despotisme, tant qu’il n’aura point de contradictions à éprouver de la part de l’ignorance : la résistance opiniâtre de cette aveugle est la seule dont le despotisme personnel et légal ait à triompher ; aussi l’instruction et la liberté de la contradiction sont-elles les armes dont il doit se servir pour la combattre, parce qu’il n’a besoin que de l’évidence pour assurer sa domination.
Il n’est rien au monde de si propre à nous inspirer l’amour de l’ordre, que l’évidence de sa justice, de sa nécessité, des avantages que nous en retirons, et des maux que son relâchement nous ferait éprouver : dès que rien n’empêche que le flambeau de cette évidence répande partout sa lumière, chacun y participe en raison du besoin qu’il en a pour se conduire, et voit dans les biens que l’ordre procure, un patrimoine dont il ne peut perdre la propriété, tant que l’ordre subsistera. La justice et la sainteté de cet ordre portent tellement l’empreinte sacrée de son divin instituteur, qu’on regarde ses lois invariables comme les clauses d’un contrat passé entre le ciel et la terre, entre la divinité et l’humanité : persuadés que notre soumission à ces lois doit être, de notre part, un culte agréable à Dieu, elles deviennent autant d’articles de foi, pour lesquels nous sentons naître dans nos cœurs, cet amour, cet enthousiasme dont les hommes ont toujours été susceptibles pour leur religion. Je ne dis point encore assez ; car aux biens surnaturels et inestimables que la religion promet aux fidèles observateurs de l’ordre, se joignent les avantages naturels et temporels que l’ordre nous prodigue ; ils ajoutent ainsi à un intérêt éloigné, qui n’est assuré que par la foi, un intérêt présent et sensible, qui ne peut qu’attacher plus étroitement, plus religieusement les hommes à la pratique de la vertu.
Si les rois sont véritablement grands, véritablement rois, ce n’est que dans un gouvernement de cette espèce : toute l’autorité leur est acquise sans partage ; et au moyen de ce que l’évidence dicte toutes leurs volontés, on peut dire, en quelque sorte, qu’ils sont associés à la raison suprême dans le gouvernement de la terre ; qu’en cette qualité sa sagesse divine, que l’évidence leur communique, et qui habite toujours en eux, les constitue dans la nécessité de faire le bien, et [133] dans l’impuissance de faire le mal ; qu’ainsi par leur entremise, le ciel et la terre s’entre-touchent, la justice et la bonté de Dieu ne cessant de se manifester aux hommes, de leur être présentes dans les ministres de son autorité.
Ceux-là sont donc coupables du crime de haute trahison, de lèsemajesté divine et humaine, qui cherchant à légitimer tous les abus de l’autorité, dans l’espérance d’en profiter, s’efforcent secrètement d’insinuer aux souverains que leur despotisme est arbitraire et absolument indépendant de toute règle ; que leurs volontés seules enfin constituent le juste et l’injuste. Cette perfidie ne peut réussir qu’à la faveur d’un défaut de lumières, qui ne permet pas aux souverains de voir évidemment que l’ordre social est naturellement et nécessairement établi sur l’ordre physique même, qu’il n’est point en leur puissance de changer : faute de connaître cette vérité, ils se laissent persuader qu’un pouvoir arbitraire peut leur être d’une grande utilité pour faire le bien ; mais un pouvoir arbitraire ne peut servir qu’à faire le mal ; car il n’y a que le mal qui puisse être arbitraire, soit dans la forme soit dans le fond : tout ce qui est dans l’ordre, a des lois immuables qui n’ont rien d’arbitraire, et qui produisent nécessairement le bien pour lequel elles sont instituées : ainsi ce n’est qu’autant qu’un despote s’écarterait des lois de l’ordre pour se livrer au désordre, qu’il pourrait faire un usage arbitraire de son pouvoir ; or il est démontré que l’ordre est tout à l’avantage du souverain et de la souveraineté ; que le désordre ne peut que lui devenir funeste, à lui personnellement et à son autorité, qui ne peut être séparée de la force intuitive et déterminante de l’évidence, qu’elle ne se trouve à la discrétion de toutes les prétentions arbitraires qui peuvent naître de l’ignorance et de l’opinion, les seuls ennemis que sa puissance ait à redouter.
Heureuses, heureuses les nations qui jouissent du despotisme de l’évidence : la paix, la justice, l’abondance, la félicité la plus pure habitent sans cesse au milieu d’elles ; plus heureux encore les souverains à qui l’on peut dire sans les offenser :
« Puissants maîtres de la terre, votre puissance vient de Dieu ; c’est de lui que vous tenez votre autorité absolue, parce qu’elle est celle de l’évidence dont Dieu est l’instituteur ; gardez-vous de la changer, cette autorité sacrée, contre un pouvoir qui ne peut être arbitraire en vous, qu’autant qu’il l’est dans son principe : votre puissance, qui est naturelle, absolue, indépendante, ne serait plus qu’une puissance factice, incertaine, dépendante de ceux même qu’elle doit gouverner. Vous êtes rois ; mais vous êtes hommes : comme hommes, vous pouvez arbitrairement faire des lois ; comme rois, vous ne pouvez que dicter des lois déjà faites par la divinité dont vous êtes les organes ; comme hommes, [134] vous avez la liberté du choix entre le bien et le mal, et l’ignorance humaine peut vous égarer ; comme rois, le mal et l’erreur ne peuvent être en vous, parce qu’ils ne peuvent être en Dieu, qui, après vous avoir établis ministres de ses volontés, vous les manifeste par l’évidence ; le despotisme personnel et légal qu’elle vous assure à jamais, est le même que celui du roi des rois ; comme lui vous êtes despotes, comme lui vous le serez toujours, parce qu’il n’est pas dans la nature de l’évidence qu’elle et vous puissiez cesser de l’être ; et votre despotisme vous comblera de gloire et de prospérités dans tous les genres, parce qu’il n’est pas dans l’ordre, dont l’évidence vous éclaire, que le meilleur état possible des peuples ne soit pas le meilleur état possible des souverains. »
L’Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques, vol. 2 (1767)
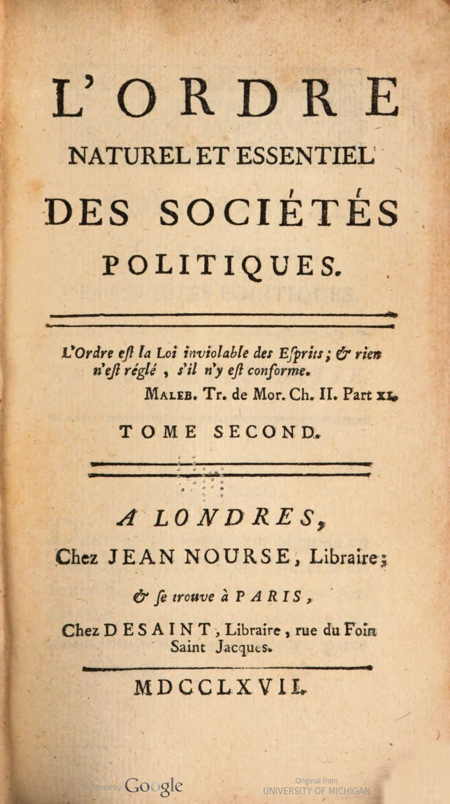
[II-1 / 135]
TROISIÈME PARTIE.
SUITE DU DÉVELOPPEMENT DE LA SECONDE PARTIE.
Dans un gouvernement organisé en tout point suivant l’ordre naturel et essentiel des sociétés, le despotisme personnel d’un souverain unique est sans aucun inconvénient à tous égards, parce que ce despotisme personnel est toujours et nécessairement légal.
Distribution des différentes parties de l’administration en trois classes, savoir, les rapports des sujets entre eux ; les rapports entre le souverain et ses sujets ; les rapports entre une nation et les autres nations. — Chacune de ces trois classes est, dans l’ordre naturel des sociétés, soumise à des lois immuables, dont on ne peut s’écarter qu’au préjudice commun du souverain et de la nation, et dont l’évidence établit par conséquent un despotisme légal que rien ne peut ébranler, tant que cette évidence conserve sa publicité.
Exposition sommaire des rapports que les sujets ont entre eux. Comment les magistrats ne peuvent, à cet égard, abuser de l’autorité qui leur est confiée. — Du recours au souverain contre ces abus. — Ce recours est sans aucun inconvénient, parce qu’il n’est point susceptible d’arbitraire.
Exposition sommaire des rapports entre le souverain et ses sujets. — Ces rapports sont exclusifs de l’arbitraire. — De l’impôt. — L’ordre naturel des sociétés établit des principes évidents qui déterminent nécessairement la mesure proportionnelle des revenus du souverain et la forme de leur perception. Le souverain est copropriétaire du produit net des terres de sa domination : ses revenus sont le résultat du partage qu’il doit faire dans ce produit net, avec les autres co-propriétaires. — Impossible que ces droits respectifs de co-propriété soient arbitraires.
La forme de l’impôt doit être directe : ce que c’est que cette forme directe ; elle assure au souverain le plus grand revenu possible, sans que personne paie l’impôt. — Ce que c’est qu’une forme indirecte : ses inconvénients. — Doubles emplois qu’elle occasionne ; ils retombent tous sur les propriétaires fonciers ; ils sont destructifs de la richesse et de la puissance du souverain.
Exposition sommaire des rapports entre une nation et une autre nation : ils sont les mêmes qu’entre un homme et un autre homme dans l’ordre de la nature ; ils sont la base essentielle de la politique, qui, séparée de ces principes, ne peut être que contradictoire avec les vues qu’elle se propose. [136] Comme l’établissement de l’ordre dans une nation lui assure, parmi les autres nations, la plus grande consistance politique qu’elle puisse se procurer.
Du commerce. — Rapports du commerce extérieur avec les intérêts communs du souverain et de la nation. — Ces rapports établissent évidemment la nécessité de la plus grande liberté possible dans le commerce. — Contradictions des systèmes opposés à cette vérité.
Récapitulation de cet ouvrage et conclusion.
[II-6]
CHAPITRE XXV.↩
Le despotisme légal est le même dans toutes les branches du gouvernement. — Division des différentes parties de l’administration en trois classes. — Examen de la première classe, composée des rapports des sujets entre eux. — Du recours au souverain contre les abus de l’autorité confiée aux magistrats. — Ce recours n’est pas susceptible d’arbitraire. — Le despotisme légal en cette partie est avantageux au souverain autant qu’à la nation.
Il n’est pas une branche du gouvernement social que le despotisme légal ne doive embrasser, parce qu’il n’en est pas une qui soit étrangère à l’ordre ; pas une qui pour l’intérêt commun du souverain et des sujets, ne doive essentiellement être soumise à des lois naturelles et immuables, dont la justice et la nécessité soient de la plus grande évidence.
Tous les différents objets d’un gouvernement peuvent être compris dans trois classes : les rapports des sujets entre eux ; les rapports entre la nation et le souverain ; les rapports politiques de l’État avec les autres peuples. Examinons séparément chacune de ces trois classes ; nous trouverons qu’elles appartiennent également au despotisme légal.
Les rapports des sujets entre eux sont tous leurs devoirs et droits réciproques résultants de leur droit de propriété, et de la liberté de jouir qui en est inséparable. Lorsque les lois positives, relatives à ces devoirs et à ces droits, sont établies, comme elles doivent l’être, d’après l’évidence de leur justice et de leur nécessité, le soin de faire observer ces lois avec une exactitude scrupuleuse, est nécessairement confié à des magistrats, qui ne peuvent absolument s’en écarter. Je dis qu’ils ne le peuvent absolument, parce qu’ils ne pourraient commettre des injustices, qu’elles ne devinssent publiquement évidentes ; [137] dans ce cas, la force dominante de leur évidence, cette force qui devient propre aux lois, qui constitue l’autorité protectrice des lois, armerait le souverain contre de tels abus ; et par son secours l’ordre serait aussitôt rétabli.
Je touche ici un point d’administration bien délicat et bien important : il semble nous conduire à l’arbitraire, par les contradictions apparentes qu’il présente, lorsqu’il n’est pas suffisamment approfondi : d’un côté, le législateur ne peut être magistrat, parce que, comme je l’ai démontré, les lois ne seraient plus des lois ; leur exécution devenant alors nécessairement dépendante de ses volontés arbitraires : d’un autre côté, l’autorité du législateur est la même autorité qui doit assurer l’observation constante des lois ; il faut donc nécessairement qu’il puisse connaître des jugements rendus par les juges ordinaires, qu’il soit l’arbitre suprême auquel on puisse recourir dans tous les cas où ils contreviendraient aux lois. De là s’ensuit qu’il paraît se trouver tout à la fois dans l’impossibilité d’être juge, et dans l’impossibilité de ne pas l’être ; voyons donc comment l’ordre fait disparaître cette contradiction.
Il est évident que si le recours au souverain n’était pas une voie ouverte aux sujets, pour obtenir justice contre les abus que les magistrats pourraient faire de leur autorité, le même despotisme arbitraire qu’on redoute dans la main du souverain, se trouverait dans celle des magistrats, puisque leurs jugements, quelque évidemment injustes qu’ils pussent être, seraient irréformables. Un tel désordre opérerait l’anéantissement de la puissance législatrice ; car son droit exclusif d’instituer des lois se trouverait séparé du pouvoir de les faire observer.
Pour effacer sans retour toute apparence de contradiction dans cette branche d’administration légale, il est deux choses à considérer : la première, que dans un gouvernement conforme à l’ordre, les lois positives doivent être d’une justice et d’une nécessité publiquement évidentes ; la seconde, que pour parvenir à faire l’application des lois, il faut que le juge réunisse deux sortes de connaissances ; premièrement, celle de la loi d’après laquelle il doit juger ; et cette connaissance doit être explicite et évidente ; secondement, celle des faits particuliers, qui établissent l’espèce qui se présente à juger d’après la loi ; et cette seconde connaissance peut rester conjecturale, parce qu’elle a souvent pour objet une multitude de faits ténébreux, au travers desquels la lumière de la vérité ne peut pénétrer que très difficilement. Il est évident qu’en pareil cas, le jugement à rendre par les magistrats ne peut être régulièrement rendu, qu’autant qu’ils ont pris toutes les mesures possibles pour éclairer leur religion. [138] Des magistrats qui me condamneraient sans m’entendre ; des magistrats qui refuseraient de m’admettre à faire preuve des faits propres à détruire nécessairement et sans retour, ce qu’on m’impute ; des magistrats de qui je ne pourrais obtenir le temps évidemment nécessaire à ma défense ; des magistrats enfin dont les procédés préparatoires au jugement tiendraient ma cause, et par conséquent ma personne, dans un état d’oppression, ne pourraient être regardés comme ministres des lois, comme jugeant d’après les lois, puisqu’ils ne pourraient être censés avoir acquis la seconde connaissance qui leur est nécessaire pour faire l’application des lois. Leur jugement alors n’aurait aucun caractère d’un jugement rendu par des magistrats ; et il est évident qu’il serait dans l’ordre de la justice que je pusse recourir au souverain ; lui exposer l’irrégularité des procédés de mes juges ; lui demander de me protéger contre leur violence, et de me donner d’autres magistrats, devant lesquels il me fût possible de défendre mes droits.
On voit ici la nécessité de distinguer dans les jugements la forme et le fond : la forme est ce que je viens de nommer les procédés préparatoires au jugement, les voies par lesquelles le juge est obligé de marcher à la connaissance de la vérité des faits d’après lesquels il doit donner une décision. Le fond est l’espèce à juger, telle qu’elle est établie par ces mêmes faits, et la valeur des droits qui en résultent entre les parties qui se trouvent avoir des prétentions contraires. Les faits bien éclaircis, bien constatés, la loi juge, et le magistrat prononce : ainsi le jugement sur le fond est l’ouvrage de la loi ; et les procédés qui conduisent au jugement, sont l’ouvrage du magistrat.
D’après cette distinction il est aisé de voir dans quels cas le recours au souverain doit avoir lieu, et quel doit en être l’objet : les juges auxquels on ne peut reprocher d’avoir négligé quelques moyens d’instruire leur religion, ne peuvent être accusés ni de prévention, ni de séduction, ni de partialité, ni d’aucune autre disposition semblable : alors leur jugement ne peut être attaqué devant le souverain, quand même il ne serait pas rendu d’une voix unanime ; car étant obligés de juger d’après des conjectures, il n’est point étonnant que leurs opinions se partagent ; et voilà pourquoi il est nécessaire qu’il y ait plusieurs juges pour rendre un même jugement.
Mais toutes fois que les procédés préparatoires au jugement annoncent évidemment dans les juges, une disposition qui ne peut se concilier avec leur ministère, une disposition qui ne permet pas de supposer en eux l’impartialité qui leur est essentielle, le recours au souverain est de droit ; il est conforme à l’ordre, parce qu’il n’y a dans la nation que l’autorité souveraine qui puisse arrêter le cours de tels procédés, qui sont un désordre. [139] Il faut observer que l’objet de ce recours n’est point de faire réformer par le souverain, le jugement des magistrats sur le fond ; mais de lui faire annuler ce jugement ; de lui faire déclarer que ce jugement doit être regardé comme n’ayant point été rendu ; car en effet il n’a pu l’être, les juges n’étant point suffisamment instruits des faits sur lesquels ils avaient à délibérer pour en connaître les rapports avec la loi ; en conséquence, l’ordre demande absolument que le souverain renvoie les parties par-devant d’autres magistrats, qui, pour faire parler la loi, constatent les faits par tous les éclaircissements que les premiers ont négligé de se procurer.
Il est sensible qu’une telle opération ne met point le souverain dans le cas d’être à la fois législateur et magistrat : il ne connaît point du jugement rendu par la loi, et il ne le pourrait ; car le souverain et la loi ne sont qu’une même autorité, puisque la loi n’est que l’expression de la volonté du souverain. Recourir au souverain contre un jugement rendu par la loi, ce serait appeler du souverain au souverain, attendu que ce jugement doit être regardé comme son propre ouvrage, parce qu’il est celui de la loi : une telle pratique est donc inadmissible, par la seule raison qu’elle ne tendrait qu’à mettre le souverain en contradiction avec lui-même : une fois qu’un juge a jugé, il ne peut plus juger une seconde fois ; ce serait cependant ce qui arriverait, si après que la loi a jugé, le souverain qui a jugé par elle, voulait rendre un nouveau jugement.
L’ordre veut donc nécessairement que dans le cas supposé, le souverain, comme je viens de le dire, se borne à déclarer que la loi n’a pas jugé, parce qu’elle n’a pu juger ; et qu’il renvoie ensuite devant des magistrats qui la mettent en état de le faire : par ce moyen le souverain ne juge lui-même que les procédés des magistrats ; et il peut le faire sans aucun inconvénient, sans tomber dans aucune contradiction, parce que leurs procédés ne sont point son ouvrage[3] .
Je ne crains pas qu’on m’objecte que si le souverain ne peut connaître que de la forme des jugements, sans entrer dans l’examen du fond, il sera facile aux juges de préparer des injustices par une marche régulière. Ceux qui me feraient cette objection entendraient sans doute par le terme d’injustice une injustice évidente ; car si elle [140] ne l’était pas, on n’aurait nul droit de la caractériser d’injustice. Mais une injustice évidente commise par des magistrats, est une chose qu’on ne peut jamais supposer dans une nation parvenue à une connaissance évidente et publique de l’ordre, et dont les lois positives sont toutes marquées au coin de cette évidence. Une injustice évidente serait la violation d’un droit évident : or si ce droit était évident, son évidence serait publique ; dans ce cas, il ne s’élèverait point de contestation à son sujet, pour fournir aux juges l’occasion de commettre une injustice évidente ; et s’il était possible que ce droit fût contesté, son évidence triompherait, par la seule force qu’elle trouverait dans sa publicité.
Il ne faut pas assimiler une nation éclairée à une nation qui vit dans l’ignorance : dans la première l’évidence est despotique, et personne ne peut se soustraire ouvertement à son despotisme, car l’action de choquer ouvertement l’évidence blesserait évidemment l’intérêt général, l’intérêt commun du souverain et de la nation, et les armerait sur-le-champ contre ce désordre évident. Dans la seconde, tout devient ou paraît arbitraire ; et l’évidence peut être contredite, parce qu’elle n’est jamais assez répandue pour que les regards soient généralement attachés sur elle. Les hommes alors séparés les uns des autres par la diversité de leurs opinions et de leurs intérêts particuliers, ne font quelque attention aux objets, qu’autant qu’ils sont liés avec ces mêmes intérêts particuliers ; et c’est toujours par cette liaison qu’ils en jugent. Dans cette position une injustice évidente ne peut faire une sensation publique ; tandis qu’elle est totalement inconnue du plus grand nombre, il arrive que parmi ceux qu’elle intéresse, les uns la blâment, et les autres lui applaudissent : ainsi son évidence est sans force, parce qu’elle n’acquiert aucune publicité.
Si je poussais plus loin cette dissertation, elle me conduirait à répéter ce que j’ai dit dans les chapitres précédents sur l’autorité despotique de l’évidence dans une nation instruite, ainsi que sur la manière dont cette autorité se communique aux lois, et assure à perpétuité l’observation la plus scrupuleuse des devoirs du magistrat. Je termine donc ce chapitre, en disant qu’il est évident que la forme essentielle de la société établit le despotisme légal dans la partie du gouvernement qui a pour objet de maintenir l’ordre des rapports que les sujets ont entre eux ; et que ce despotisme légal est avantageux au souverain autant qu’à la nation ; car ces rapports n’étant que les droits et les devoirs résultants du droit de propriété, leur ordre ne peut être troublé qu’au préjudice de ce même droit de propriété ; par conséquent au détriment des produits qui ne peuvent renaître sans lui, et dans lesquels le souverain partage avec la nation. [141] Il est vrai que ce despotisme légal, étant un effet nécessaire de l’évidence, il écarte absolument l’arbitraire, et rend impraticables dans les souverains, comme dans les magistrats, les abus de l’autorité, qui troubleraient l’administration de la justice ; mais si les rois pouvaient commettre arbitrairement toute sorte d’injustices, ils ne seraient plus les images vivantes d’un être souverainement et essentiellement juste ; ils cesseraient d’être rois, dès qu’ils cesseraient d’agir en rois ; et de quoi leur servirait d’avoir cette liberté funeste, cette liberté qui n’est pas même dans celui qui les a faits ce qu’ils sont ? Ils ne pourraient en faire usage, sans dégrader leur dignité, et sans trahir, à tous égards, leurs véritables intérêts.
[II-20 / 142]
CHAPITRE XXVI.↩
Des rapports qui se trouvent entre la nation et le souverain : réciprocité du besoin qu’ils ont l’un de l’autre ; rapport et conformité de leurs intérêts. — Notions générales dont le développement démontrera que cette branche de gouvernement n’est point susceptible d’arbitraire.
Les rapports qui subsistent entre le souverain et ses sujets, sont les mêmes que ceux qui se trouvent naturellement et nécessairement entre la nation et la souveraineté : ce sont des rapports d’une utilité, ou plutôt d’une nécessité réciproque ; car sans la nation, il n’y aurait ni force publique ni souveraineté ; et sans la souveraineté, il n’y aurait ni ordre social, ni nation proprement dite.
La souveraineté vue en elle-même n’est autre chose que la force publique formée par le concours et la réunion de toutes les forces particulières. Observez que par le mot de forces, il faut entendre non seulement les forces physiques de nos corps, mais encore les richesses qui servent à multiplier ces mêmes forces, et à fournir aux dépenses nécessaires à l’emploi des forces physiques. La souveraineté, qui n’acquiert ces richesses que par le ministère de ses sujets, tient donc toute sa force de la nation ; et en cela, la nation est utile et nécessaire à la souveraineté. D’un autre côté, c’est à l’aide de la force qui constitue la souveraineté, que l’ordre se maintient, et que la sûreté civile et politique de la société s’établit. La nation, considérée comme corps social, n’a donc d’autre consistance que celle que lui donne la puissance politique de la souveraineté ; et en cela, la souveraineté est utile et nécessaire à la nation.
De ces premières notions résultent évidemment deux grandes vérités : la première qu’il est de l’intérêt de la souveraineté que la nation, dont elle tire toute sa richesse, toute sa force, soit dans le meilleur état possible de richesse et de population ; la seconde, qu’il est de l’intérêt de la nation que la souveraineté, dont elle attend toute sa sûreté, soit dans son dernier degré possible de puissance.
Ainsi l’ordre des rapports qui se trouvent entre la nation et la souveraineté, est tel que les véritables intérêts de l’une sont inséparables des véritables intérêts de l’autre ; par conséquent que l’évidence de cet ordre devient l’évidence de l’intérêt commun du souverain et des sujets. De là nous devons conclure qu’il est moralement impossible que l’évidence de cet ordre, de sa nécessité, de l’intérêt commun qui en résulte, puisse être publiquement reconnue, sans devenir despotique ; et comment son despotisme légal pourrait-il ne [143] pas s’établir en cette partie, quand tous les intérêts réunis par leur évidence, demandent qu’il s’établisse ?
En vain on voudrait chercher dans le souverain, un intérêt personnel contraire à celui de la nation et de la souveraineté : cet intérêt ne pourrait avoir pour objet que d’augmenter arbitrairement le revenu public. Je conviens que ce désir peut naître dans les souverains ; mais j’ajoute en même temps que ce n’est qu’autant qu’il ne sera pas évident que cette partie ne comporte rien d’arbitraire ; qu’elle est soumise à des lois essentielles et immuables établies par l’ordre physique même ; que l’observation constante de ces lois est la seule voie par laquelle un souverain puisse parvenir au dernier degré possible de richesse ; que de toute autre manière, ce qu’il pourrait faire pour l’augmenter, ne servirait qu’à la détruire ; que la richesse des sujets enfin est toujours et nécessairement la mesure proportionnelle de celle du souverain ; qu’ainsi sa plus grande richesse possible ne peut résulter que de la plus grande richesse possible de la nation.
Il est certain que si ces vérités sont publiquement évidentes, il n’est plus d’abus à craindre dans la formation du revenu public ; et comme les abus dans ce genre sont la source de tous les autres, je vais tâcher de démontrer qu’il n’en est aucun dont l’ordre social, toujours fondé sur l’ordre physique, soit susceptible ; et qu’une administration telle que ce même ordre l’établit nécessairement, est nécessairement aussi la plus conforme aux intérêts personnels du souverain et à ceux de la nation.
[II-25 / 144]
CHAPITRE XXVII.↩
Formation du revenu public ; ses causes, son origine, son essence. — Deux sortes d’intérêts communs au souverain et à la nation, qui paraissent opposés entre eux ; comment ils se concilient dans l’ordre essentiel des sociétés ; comment ils contrastent dans un état d’ignorance. — Impossible que le revenu public soit arbitraire ; il ne doit être que le résultat de la co-propriété des produits nets acquise incommutablement au souverain. — Entre cette co-propriété et les propriétés particulières il y a des bornes communes et immuables. — Intérêts personnels du souverain inséparables de ceux de la nation.
J’ai déjà représenté plusieurs fois les souverains comme copropriétaires du produit net des terres de leur domination : je ne crois pas qu’on puisse trouver parmi les institutions sociales, rien de plus heureux pour eux et pour leurs sujets tout à la fois : d’un côté, le revenu d’un souverain se trouve être le produit d’un droit semblable à tous les autres droits de propriété, et qui tient, comme eux, à l’essence même de la société ; d’un autre côté, les sujets ne voient rien dans ce droit qui puisse leur paraître onéreux : le souverain considéré dans son droit de co-propriété, n’est plus à leurs yeux qu’un grand propriétaire, qui ne jouit point aux dépens des autres ; qui tout au contraire, leur est uni par l’intérêt commun qu’ils ont tous à donner la plus grande consistance et la plus grande valeur possibles à leurs propriétés communes.
Tel est le revenu public, et telle est la force publique dans une nation. Telle est cette force publique, et telle est la sûreté civile et politique du corps social ; conséquemment la sûreté de la propriété, et de tous les droits qui en résultent. Sous ce premier point de vue il importe donc beaucoup à une nation, que le revenu public parvienne à son plus haut degré de richesse physiquement possible ; ainsi son intérêt et celui du souverain sont le même à cet égard.
Il importe encore à la nation, que les revenus particuliers dont elle jouit personnellement, soient les plus grands revenus physiquement possibles ; qu’ils forment pour elle personnellement, une grande masse de richesses disponibles : mais cette grande masse de richesses disponibles ne peut exister chez elle, qu’elles ne lui procurent une nombreuse population, et qu’en cela, la puissance du souverain, par conséquent la force et la sûreté politique de la société, n’augmentent à proportion : l’intérêt de la nation devient donc encore, en cette partie, l’intérêt personnel du souverain. [145] Au premier coup d’œil cependant ces deux intérêts paraissent se contredire dans le souverain comme dans la nation : en effet toujours ils se sont contredits, et toujours ils se contrediront, tant qu’on n’aura pas une connaissance évidente des rapports essentiels qu’ils ont entre eux, et qui indiquent naturellement les moyens de les concilier.
Si le souverain augmente son revenu, aux dépens de ceux de la nation, ou si la nation augmente les siens, aux dépens de celui du souverain, un des deux intérêts est sacrifié ; le souverain ou la nation cessent alors de jouir de leur plus grande richesse possible. Ce n’est donc par aucune de ces deux voies, que ces mêmes intérêts peuvent s’accorder : impossible même que le sacrifice de l’un n’entraîne pas la ruine de l’autre : si le revenu du souverain s’affaiblit, la force politique et la consistance du corps social s’altèrent en proportion ; alors la propriété se trouve essentiellement compromise : si ce sont les revenus particuliers de la nation qui diminuent, la propriété est attaquée dans son essence ; le germe de l’abondance des productions est étouffé ; la richesse de la nation, la population et la puissance du souverain s’évanouissent ; le corps social ne fait plus que languir jusqu’à ce qu’il soit détruit.
Ainsi ces deux intérêts, qui paraissent opposés entre eux, sont faits pour être exactement compensés ; pour être liés ensemble de manière qu’ils soient dans une dépendance mutuelle, et s’entresoutiennent réciproquement ; aucun d’eux ne peut éprouver un échec que l’autre n’en reçoive le contre-coup. La nécessité absolue de cet accord parfait entre eux, est un fil qui doit nous guider perpétuellement dans la recherche de l’ordre essentiel et invariable que nous devons suivre à cet égard.
Les moyens de satisfaire à cette nécessité absolue n’ont rien de mystérieux : sitôt qu’on reconnaîtra le souverain pour co-propriétaire du produit des terres de sa domination, nous trouverons dans les rapports de l’ordre social avec l’ordre physique, toutes les lois essentielles qui concernent cette co-propriété, et rendent son intérêt inséparable de ceux de la nation. Alors nous serons convaincus par l’évidence de ces lois essentielles, non seulement que la formation du revenu public n’a rien d’arbitraire, mais encore qu’elle est assujettie à un ordre tellement nécessaire, qu’on ne peut s’en écarter, qu’au préjudice commun du souverain même et de la nation.
Pour peu que nous fassions attention au terme de co-propriété, cet ordre nécessaire va de lui-même se manifester à nos yeux : d’abord il nous avertit qu’il faut nécessairement instituer le revenu public d’une manière qu’il ne puisse jamais être préjudiciable aux droits sacrés de la propriété dont les sujets doivent jouir ; il nous fait connaître ensuite, [146] qu’en conséquence de ce premier principe, ce revenu ne doit être autre chose que le produit de la co-propriété qui est jointe à la souveraineté : alors examinant quel peut être le produit de cette co-propriété, nous voyons qu’il suppose nécessairement un partage à faire du revenu des terres entre le souverain et les autres co-propriétaires de ce revenu ; partage dont le droit immuable de chaque co-propriétaire doit régler pour toujours les proportions, quelque révolution en bien ou en mal que ce même revenu puisse éprouver.
La formation du revenu public ainsi simplifiée, il est évident que tout ce que vous y ajouteriez de plus, blesserait les proportions suivant lesquelles le partage doit être fait, et serait pris nécessairement sur les revenus particuliers de la nation. De là résulterait 1°. que les intérêts du souverain et ceux de la nation, au lieu d’être des intérêts communs, deviendraient opposés les uns aux autres, puisque pour augmenter le revenu du souverain on détruirait la richesse de la nation ; 2°. qu’on établirait dans le souverain un pouvoir arbitraire, qui seul et par lui-même anéantirait tout droit de propriété dans les sujets, par conséquent la première des conditions essentielles à la culture, et le principe constitutif de toute société.
Puisqu’il est ainsi socialement impossible d’étendre le revenu du souverain au-delà du produit de sa co-propriété, il en résulte évidemment que cette co-propriété doit avoir elle-même une mesure fixe et déterminée ; car si l’on pouvait lui donner une extension arbitraire, il est évident que le souverain, au lieu d’être co-propriétaire seulement, se trouverait propriétaire unique, et qu’il n’existerait réellement aucun autre droit de propriété que le sien : alors l’état commun et respectif de la nation et du souverain serait dénaturé : la nation ne formerait plus un corps politique dont le souverain est le chef ; et la souveraineté ne serait plus qu’une propriété foncière démesurée, qui resterait inculte, et nécessairement serait incapable de fournir les moyens de résister aux forces étrangères, qui certainement viendraient bientôt s’emparer de ces déserts.
Nous tenons donc déjà deux règles fondamentales concernant la formation du revenu public : la première, que pour ne point détruire les droits de propriété dans les sujets, il ne doit avoir rien d’arbitraire ; la seconde, que pour n’avoir rien d’arbitraire, il ne doit être que le produit d’une co-propriété acquise incommutablement au souverain, et renfermée dans des bornes qui soient posées tout à la fois et pour elle et pour toutes les propriétés particulières. Dans cet ordre naturel et immuable, il est évident que le revenu public et le revenu particulier de chaque propriétaire n’étant que le résultat d’un partage dans une masse commune, ils se trouvent naturellement en société, sans jamais [147] pouvoir se confondre ; qu’ils ne peuvent croître l’un sans l’autre ; qu’ainsi les intérêts du souverain et ceux de la nation, quoiqu’aux yeux de l’ignorance ils paraissent opposés entre eux, sont cependant des intérêts communs, qui, bien loin de s’entre-choquer mutuellement, adoptent les mêmes principes, tendent au même but, et pour le remplir, ne peuvent employer que les mêmes moyens. Ô bonté suprême, ordre divin, qui voulez que le meilleur état possible des rois, soit établi sur le meilleur état possible des peuples, si les hommes à cet égard ne sont pas aussi heureux qu’ils pourraient et devraient l’être ; si le gage naturel de leur prospérité commune se change en un fléau destructeur, ce n’est pas vous, ce sont eux-mêmes qu’ils en doivent accuser ; leurs préjugés les aveuglent, et les empêchent de voir que leur bonheur est placé dans leurs mains ; qu’il est le fruit nécessaire de l’observation de vos lois ; de ces lois qu’on ne peut violer, sans éprouver les peines attachées invariablement à ce dérèglement.
Pour mettre dans la plus grande évidence les deux règles fondamentales que je viens d’établir d’après l’ordre physique même, remontons à l’origine des sociétés particulières : lorsqu’elles ont pris une forme et une consistance ; lorsqu’elles sont devenues de véritables corps politiques, elles se sont trouvées dans le cas d’avoir des besoins politiques qui exigeaient d’elles des dépenses ; pour y satisfaire il a fallu instituer des fonds publics ; et pour instituer ces fonds publics, on a dû nécessairement fixer la proportion dans laquelle chaque revenu particulier y contribuerait. Nous n’avons point à examiner quelle a dû être cette proportion ; la seule vérité que nous ayons à saisir ici, c’est que cette institution d’un revenu public étant faite en faveur de la propriété, elle n’a pu ni dû être destructive de la propriété.
De cette première vérité résulte évidemment que la contribution au revenu public n’a pu ni dû rester arbitraire, ni dans les contribuables, ni dans l’autorité qui avait l’administration de ce revenu : arbitraire dans les contribuables, les besoins du corps politique auraient pu n’être pas satisfaits ; elle eût donc été hors d’état de remplir l’objet de son institution ; de procurer aux propriétés particulières, la sûreté, la stabilité qui leur étaient essentielles ; arbitraire dans l’administrateur, la propriété foncière serait devenue nulle, en ce qu’elle se serait trouvée séparée de la propriété des produits. Une telle désunion est physiquement impossible par deux raisons : premièrement, le droit de propriété n’est autre chose que le droit de jouir ; or on ne peut jouir d’une propriété foncière que par le moyen de ses produits ; en second lieu, personne ne voudrait travailler et dépenser pour faire renaître des produits, dès qu’un pouvoir arbitraire pourrait en disposer à son gré. [148] Il est sensible que si les hommes avaient en cette partie établi un tel pouvoir, ils auraient perdu sur-le-champ et le droit et la liberté de jouir ; ainsi, pour conserver leurs propriétés, ils auraient commencé par s’en dépouiller ; pour fonder un revenu public, ils auraient commencé par éteindre le germe de la reproduction ; pour se donner une consistance sociale, ils auraient commencé par détruire le premier principe de toute société.
La proportion de la contribution au revenu public a donc été dès l’origine des sociétés, assujettie, par une nécessité physique, à une mesure certaine et constante, du moins pour les temps qui n’exigeaient point des dépenses extraordinaires, telles que celles qu’une nation serait dans le cas de faire, pour résister aux entreprises d’une puissance étrangère qui voudrait lui donner des fers.
Cette proportion ayant été réglée, et se trouvant invariable, il est évident que l’obligation de s’y conformer dans la contribution au revenu public, est devenue une charge réelle, inséparable des biensfonds, dans quelques mains qu’ils passassent ; il est évident encore que les terres cultivées n’ont pu être échangées, vendues, transmises, en un mot, à un nouveau propriétaire, qu’à la charge, par lui, de satisfaire à cette obligation.
Ainsi s’est fait nécessairement une sorte de partage du produit des terres entre les propriétaires fonciers et l’administrateur du revenu public ; partage qui a rendu le corps politique, par conséquent le souverain qui le représente, co-propriétaire de ce produit ; partage, qui bien loin d’avoir été onéreux aux premiers propriétaires fonciers, s’est trouvé nécessaire et avantageux pour eux, puisqu’il leur procurait la sûreté de leurs propriétés, et la liberté d’en jouir : aussi n’a-til eu lieu qu’à raison de son utilité.
Avant ce partage le corps politique n’ayant aucune consistance, le droit de propriété n’était point, dans le fait, un droit solide et constant, et la possession des terres, si tant est qu’elles fussent cultivées, ne pouvant être garantie par aucune force capable de la mettre à l’abri des violences, elles ne pouvaient avoir aucune vénalité, aucune valeur courante dans le commerce. Mais au moyen de ce partage, la propriété foncière devenant un droit certain, aussi solidement établi qu’il pouvait l’être, les terres ont pu être défrichées sans aucun risque pour la dépense que le défrichement exigeait ; alors elles ont acquis une valeur vénale, non en raison de la totalité de leur produit net, mais en raison seulement de la portion de ce produit net que ce même partage laissait à la disposition du propriétaire foncier. Cette portion seule est devenue aliénable ; l’autre portion ne pouvant l’être, puisqu’elle était désignée pour devoir appartenir incommutablement au souverain, et former dans sa main une sorte de richesse [149] commune, destinée à l’utilité commune de toute la nation ; ainsi dès lors tous les acquéreurs n’ont payé les terres qu’à un prix relatif à la portion que leur acquisition leur donnait droit de prendre dans le produit de ces mêmes terres.
Si le revenu public s’est, en quelque sorte, formé aux dépens des revenus particuliers dont jouissaient les premiers possesseurs des terres, il est sensible qu’ils n’ont fait ce prétendu sacrifice, que parce qu’il leur était avantageux de le faire, et que sans cela, ils ne pouvaient s’assurer aucune propriété foncière, aucuns produits. Mais après eux quiconque a acquis la propriété d’une terre cultivée, ne peut pas dire qu’il contribue de son bien à ce même revenu, à moins que la proportion du partage à faire avec le souverain n’ait changé, et n’ait augmenté l’impôt depuis l’acquisition : il est vrai que la terre que possède cet acquéreur, l’assujettit à payer un impôt ; mais aussi c’est elle-même qui lui fournit les valeurs nécessaires pour satisfaire à ce paiement ; par ce moyen cette charge se trouve acquittée sans qu’il soit rien pris sur le produit net que le nouveau propriétaire a compté se procurer en acquérant la terre. Ne me dites pas que sans l’impôt, ce produit net serait plus considérable pour ce même propriétaire ; il est vrai que ce produit net serait plus considérable pour les possesseurs de cette terre ; mais alors ou le même homme ne serait pas propriétaire de ce produit net en son entier, ou il l’aurait payé plus cher à proportion.
Supposons que le prix courant des terres soit le denier 20 : un particulier, avec 40 000 francs, achète une terre de 2 000 liv. de revenu, et qui donne 1 000 liv. à l’impôt ; mais elle en vaudrait 60 000, si l’impôt ne prenait pas ces 1 000 livres dans le produit net de cette terre ; ainsi son acquéreur ou rendrait annuellement ces 1 000 livres à quelque co-propriétaire de ce produit net, ou il aurait déboursé 20 000 francs de plus pour cette acquisition.
Les 1 000 livres payées par la terre à l’impôt sont donc totalement étrangères à son acquéreur : que cette somme fixe et déterminée soit remise annuellement au souverain ou à d’autres co-propriétaires du produit net de cette terre tant qu’elle donnera le même revenu total, rien de plus indifférent à l’intérêt direct et immédiat de cet acquéreur : comme propriétaire il ne paie rien à l’impôt, quoiqu’il participe, en cette qualité, à tous les avantages qui résultent de l’institution de l’impôt.
J’observe en passant que c’est à regret que je donne au revenu public le nom d’impôt : ce terme est toujours pris en mauvaise part ; il annonce une charge dure à porter, et dont chacun voudrait être exempt : le revenu public au contraire, tel qu’il se présente ici, n’a rien d’affligeant : en remontant à son institution, on voit qu’elle est [150] le fruit de son utilité ; depuis ces premiers temps ce revenu n’est pour le souverain, que le produit d’une propriété foncière distincte de toutes les autres propriétés qui appartiennent à ses sujets ; encore ce produit est-il employé pour l’utilité commune de la société, de sorte qu’à raison de cette utilité commune, il devient un patrimoine commun, dont on jouit en commun, tout aussi réellement que chacun jouit de son patrimoine particulier.
Il me semble que nos idées acquièrent une grande clarté, en distinguant ainsi deux époques, celle d’une société naissante et celle d’une société formée : dans la première, nous trouvons que les propriétaires fonciers payaient l’impôt ; que ce sont eux, qui par les dépenses primitives qu’ils ont faites pour préparer les terres à recevoir la culture, les ont mises en état de donner les produits destinés à l’impôt ; qu’ils n’ont point été remboursés de ces dépenses ; qu’ainsi l’impôt a été pris constamment sur des produits dont ils étaient en possession, mais dont ils ont préféré de distraire une portion pour convertir leur possession incertaine en pleine propriété, et s’assurer ainsi la jouissance constante et paisible de l’autre portion.
Il n’en est pas de même des propriétaires fonciers dans une société formée ; dans une société où les terres ont tellement changé de main, qu’il ne reste plus aucune trace de leurs premiers possesseurs, ni de leurs intérêts personnels : en la supposant organisée suivant son ordre essentiel ; suivant cet ordre qui ne comporte rien d’arbitraire, l’impôt y conserve bien sa même destination ; mais il n’est le fruit d’aucun sacrifice fait par ces propriétaires fonciers : nous voyons au contraire que dans une telle société, le produit net des terres est destiné à se partager entre le souverain et eux ; que la proportion suivant laquelle ce partage doit être fait, est établie d’une manière invariable ; qu’en vertu de cette proportion constante et connue, le sort des propriétaires fonciers est assuré ; que par ce moyen, les terres ont acquis dans le commerce, une valeur vénale relative au partage à faire de leur produit net entre l’acquéreur et l’impôt ; que cette valeur vénale est telle que l’acquéreur ne paie que le prix de la portion du produit net dont il doit jouir ; que l’autre portion n’est point aliénable ; qu’elle n’entre dans aucune considération lors de l’estimation des terres à vendre ; qu’ainsi les nouveaux propriétaires ne contribuent nullement à l’impôt, qui ne prend rien sur leurs capitaux quand ils achètent, ni sur les revenus que ces mêmes capitaux doivent leur donner après l’acquisition.
Il est donc évident que dans une société formée, la loi la plus essentielle, la loi fondamentale concernant l’impôt, est qu’il n’ait rien d’arbitraire : voilà le point fixe dans lequel l’ordre à cet égard consiste essentiellement. Cette règle est d’une nécessité physique, parce [151] qu’un impôt arbitraire, en annulant la propriété mobilière des produits, annulerait aussi la propriété foncière dont l’ordre physique ne peut absolument se passer ; il deviendrait ainsi destructif de la reproduction annuelle, par conséquent de sa propre substance : l’anéantissement des richesses de la nation entraînerait nécessairement celui des revenus du souverain, et celui de la souveraineté.
Quand l’impôt n’est point arbitraire, la propriété foncière se trouve inséparablement unie à la propriété mobilière d’une portion fixe dans les produits ; ces deux propriétés concourent ensemble à former la valeur vénale des biens-fonds ; alors l’action d’acquérir une terre est un contrat passé, au nom de toute la nation, entre l’acquéreur et l’autorité tutélaire ; contrat synallagmatique par lequel cette autorité lui garantit la propriété de la portion du produit dont il paie la valeur et acquiert la jouissance, tandis que de son côté, il s’engage aussi de laisser cette même autorité jouir constamment de l’autre portion qu’il n’a point acquise. Dès ce moment, cet acquéreur forme librement et volontairement une société avec le souverain même : si ce particulier parvient à augmenter le produit net de sa terre, cette augmentation se partagera entre le souverain et lui, dans une proportion établie par une loi constante, uniforme, générale, et reconnue tacitement par lui-même dans son contrat d’acquisition.
Le terme de société doit être pris à la lettre ; car le souverain, en sa qualité de co-propriétaire du produit, doit participer à toutes les variations en bien ou en mal que ce même produit peut éprouver. Il ne faut donc pas confondre la part proportionnelle que le souverain doit prendre dans les produits en vertu de son droit de co-propriété, avec un impôt fixe et invariable établi sur telle ou telle portion de terre. Le seul avantage qu’on puisse trouver dans ce dernier impôt, c’est qu’après son établissement, il ne prête point à l’arbitraire : mais il a des inconvénients majeurs auxquels il est physiquement impossible de remédier.
Les terres ne produisent qu’en proportion des avances qu’elles reçoivent ; or celles-ci n’ont rien d’uniforme, surtout dans un état où la culture n’est point encore dans sa perfection : les impôts fixes sont donc nécessairement préjudiciables ou au souverain ou aux propriétaires fonciers, lorsque leur évaluation n’a pour base que la mesure et la qualité des terres, et non leurs produits connus. Dans les mains d’un cultivateur malaisé une terre ne donnera qu’un revenu médiocre : confiez la culture à un riche cultivateur, la même terre donnera le double du revenu. Dans le premier cas, l’impôt peut se trouver être une surcharge, tandis que dans le second, le souverain perd une partie de ce qu’il doit prendre dans le produit. [152] Il est encore d’autres inconvénients propres et particuliers à ce genre d’impôt ; mais sans les présenter en détail, je me contente d’observer qu’il est essentiellement vicieux en ce qu’il suppose le produit, et qu’il en est indépendant ; au lieu que l’impôt proportionnel perçu par forme de partage, ne se mesure point sur un produit supposé, mais bien sur un produit réel, et avec lequel il est toujours parfaitement d’accord. Cette balance a deux grands avantages : le premier, que le revenu public est toujours le plus grand qu’il soit possible, sans que personne soit grevé, et puisse se plaindre d’y contribuer ; le second, est que le souverain n’est jamais étranger aux progrès de la culture : il s’établit naturellement et nécessairement entre ses sujets et lui, une communauté d’intérêts dont l’accroissement de la richesse nationale est l’objet, et qui forme ainsi le lien le plus puissant du corps politique.
Cette communauté d’intérêts résultante de l’impôt proportionnel est un article bien important aux progrès dont la culture est susceptible dans un royaume agricole : chaque propriétaire foncier qui fait des dépenses en améliorations, ne s’y détermine que parce qu’il est assuré que la valeur vénale de sa terre augmentera d’autant ; et cette assurance lui vient de la certitude qu’il a que la portion qu’il doit prendre dans ces améliorations, ne lui sera point enlevée par l’impôt. Remarquez encore en cela combien l’impôt proportionnel est préférable à un impôt fixe et indépendant des produits : dans ce dernier cas, un propriétaire foncier n’est point à l’abri de la crainte d’une nouvelle évaluation, qui lui fasse perdre le fruit et la propriété de toutes les sommes dépensées en améliorations.
Je ne fais qu’indiquer ici les avantages qui résultent de la vénalité des terres ; j’entends, de la certitude morale de pouvoir les vendre à un prix relatif aux dépenses que l’on fait pour les améliorer. Les aperçus que je présente, suffisent pour montrer combien il est intéressant pour un souverain et pour une nation, que la proportion établie entre les revenus des propriétaires fonciers et l’impôt ne soit sujette à aucune variation ; car c’est l’immutabilité de cette proportion qui décide de cette vénalité.
Dénaturons maintenant cet ordre essentiel, et rendons l’impôt arbitraire : que vendra-t-on, quand on voudra vendre une terre ? Et qui est-ce qui se présentera pour l’acheter ? Une terre n’est vénale qu’autant qu’elle a une valeur certaine ; et elle n’a une valeur certaine, qu’autant qu’elle donne un revenu certain : celles même dont le produit est absolument casuel, sont considérées comme ayant un revenu certain ; on parvient à le fixer, malgré ses variations, en formant de plusieurs années une année commune. Un tel casuel peut être évalué tant que le cours des révolutions qu’il éprouve, est dans [153] l’ordre de la nature et des mouvements d’une société ; mais son évaluation n’est plus possible, sitôt qu’il dépend absolument d’un pouvoir arbitraire : dans le premier cas, on vend du moins une propriété ; dans celui-ci, on n’en vend point une véritable ; car on n’est point véritablement propriétaire d’une chose dont une autorité quelconque peut arbitrairement nous dépouiller.
Il est évident que dans une telle position, le propriétaire foncier, ne l’étant pas d’une portion fixe et assurée dans le produit de ses terres, il ne peut vendre une propriété qu’il n’a pas. Mais dès qu’il n’est aucune portion du produit qui soit vénale, les terres ne le sont plus aussi : il n’est plus possible ni de les vendre, ni de les faire entrer dans les engagements que les membres d’une même société ont si souvent besoin de contracter entre eux. Ainsi plus de ressources pour les propriétaires fonciers ; il faut absolument qu’ils périssent, si quelque évènement les met hors d’état de soutenir les charges de la propriété : un mur de séparation se trouve élevé entre les richesses pécuniaires et les biens-fonds ; ces deux sortes de richesses ne peuvent plus s’unir pour se féconder mutuellement ; celles-là, pour trouver de l’emploi, passent chez l’étranger, et laissent les terres incultes, faute des bâtiments nécessaires à leurs exploitations, ou d’autres dépenses semblables, dont les propriétaires fonciers sont tenus ; mais qu’ils ne peuvent plus faire, parce qu’ils n’en ont plus les moyens.
Les terres ne se fertilisent que par des dépenses ; et une partie de ces dépenses sont à la charge du propriétaire foncier : il est donc d’une nécessité physique que les richesses pécuniaires, stériles par elles-mêmes, puissent se marier avec les richesses foncières, pour que de leur union résulte une abondance de productions, qui sans cela ne peut avoir lieu ; il est donc d’une nécessité physique que les terres acquièrent dans le commerce, une valeur certaine et courante, qui permette ou de les vendre ou de les engager ; qui les mette, en un mot, dans le cas d’attirer à elles les richesses pécuniaires dont elles ont besoin ; il est donc d’une nécessité physique que les terres donnent à leurs propriétaires, un revenu certain, dont la propriété certaine assure aux terres une valeur qui les rende commerçables ; il est donc d’une nécessité physique que l’impôt ne soit point arbitraire ; que la proportion qui règle le partage à faire du produit net entre le souverain et les propriétaires fonciers, soit fixe et invariable ; sans cela plus de propriété foncière ; plus de culture ; plus de produits ; plus d’impôt ; plus de nation ; plus de souveraineté.
Si au contraire cette loi fondamentale de l’ordre essentiel est suivie, l’état du propriétaire foncier est, dans la société, l’état le plus avantageux possible, à raison de sa solidité ; la préférence lui étant [154] acquise sur tous les autres états, chacun à l’envi s’empresse de convertir ses richesses mobilières en richesses foncières ; on ne connaît plus de meilleure façon d’employer son argent, que celle, pour ainsi dire, de le semer pour le multiplier ; on voit naître ainsi la plus grande abondance possible dans tous les genres de productions ; l’industrie, la population, les revenus du souverain, sa puissance politique, tout enfin croît nécessairement en raison de cette même abondance ; pour comble de bonheur, personne alors ne paie l’impôt ; et cependant tout le monde jouit des avantages qu’il assure à la société.
[II-52 / 155]
CHAPITRE XXVIII.↩
Suite du chapitre précédent. — Ce qui est à faire avant que la copropriété du souverain puisse partager dans les produits des terres. — Ce que c’est qu’un produit brut ; ce que c’est qu’un produit net. — Ce dernier est le seul qui soit à partager entre le souverain et les propriétaires fonciers. — Reprises privilégiées du cultivateur sur le produit brut. — Dans une société conforme à l’ordre, ces reprises sont toujours et naturellement fixées à leur taux le plus bas possible par la seule autorité de la concurrence : dans cet état, le produit net est toujours aussi la plus grande richesse possible pour le souverain et pour les propriétaires fonciers, en raison de leur territoire.
Nous avons vu dans le chapitre précédent, que le revenu public ne devait avoir rien d’arbitraire, et qu’il ne pouvait être autre chose que le résultat d’un partage à faire du produit des terres entre le souverain et les propriétaires fonciers, en vertu de la co-propriété de ce même produit dévolue à la souveraineté. J’ai fait observer que cette co-propriété devait être bornée comme toutes les propriétés particulières ; que sans cela, elle les envahirait et les annulerait toutes ; qu’ainsi au lieu de consolider la société, elle la détruirait dans son principe essentiel.
Cette dernière vérité est par elle-même d’une évidence si frappante que je pourrais me dispenser d’y revenir ; mais elle est aussi d’une telle importance, et elle a tant de préjugés à vaincre avant de s’établir solidement parmi les hommes, que je crois à propos de la faire envisager dans tous les rapports qu’elle se trouve avoir avec la reproduction. En conséquence je vais tâcher de développer comment l’ordre physique de la reproduction veut que les produits des terres soient partagés ; comment cet ordre établit les lois fondamentales de ce partage ; comment ces lois règlent tout à la fois les droits des propriétaires fonciers, et ceux qui appartiennent au souverain en vertu de sa co-propriété.
Le produit des terres se divise en produit brut et en produit net. Comme en général un produit ne s’obtient que par le moyen de dépenses préalables, il commence d’abord par être un produit brut, c’est-à-dire, une masse plus ou moins forte de productions, chargée de restituer la valeur de toutes les dépenses qui l’ont fait naître. Quand sur cette masse ces mêmes dépenses ont été reprises, le surplus qui reste, est un produit net ; il est tout gain pour la société, parce qu’il est par lui-même, et à tous égards, un accroissement de richesses pour la société. [156] Personne n’ignore que sans les avances du cultivateur, la terre ne nous donnerait presque aucunes productions. Il faut donc qu’il y ait toujours dans la société, une portion de ses richesses mobilières qui soit consacrée à faire ces avances, et qui ne puisse être détournée de son emploi. De là résulte qu’avant que la société puisse disposer arbitrairement du produit des terres, il est d’une nécessité physique que sur ces mêmes produits, on prélève le montant des reprises à faire pour raison des avances du cultivateur : sans cela ces avances, et par conséquent les produits ne pourraient plus se renouveler.
Ainsi avant que le souverain et les propriétaires fonciers puissent, en leur qualité, exercer aucun droit sur le produit des terres, il est de toute nécessité que le produit net soit dégagé du produit brut ; ainsi ce produit net, ce produit quitte et libéré des indemnités dues au cultivateur, est le seul qui puisse et doive être partagé entre les propriétaires fonciers et le souverain ; ainsi à cet égard la nature a elle-même posé des bornes au-delà desquelles le souverain ne peut étendre sa co-propriété ; s’il entreprend de les passer, de violer les droits sacrés du cultivateur, ce ne peut être qu’au préjudice des avances de la culture, et conséquemment de la reproduction ; car les terres ne se fécondent qu’en raison des avances qu’elles reçoivent.
Observez que cette première règle est toujours la même, quel que soit le cultivateur : que cet homme soit lui-même propriétaire des terres qu’il exploite, ou qu’il soit un étranger entrepreneur de la culture de ces terres, il n’en a pas moins les mêmes avances à faire pour cette culture, et les mêmes reprises à exercer pour l’entretien de ces avances. Ainsi dans le cas où ce cultivateur se trouverait être le propriétaire foncier, le souverain ne pourrait toujours partager que dans le produit net, et suivant la proportion établie, afin de ne point porter atteinte au droit de propriété.
Avant de songer à partager le produit net entre le souverain et les propriétaires fonciers, il faut donc commencer par nous occuper du partage à faire du produit brut entre eux et le cultivateur : à cet égard, nous devons le regarder comme un homme tout à fait distinct des propriétaires fonciers, parce que les dépenses de la culture sont tout à fait distinctes de celles qu’il faut faire pour acquérir des propriétés foncières, ou pour les entretenir dans un état convenable à leur culture. Par cette raison, il est à propos d’examiner si ce premier partage est assujetti par l’ordre physique, à des lois propres à régler les différents intérêts qui se trouvent ici en opposition, et à les concilier entre eux de manière que la classe cultivatrice et la classe propriétaire jouissent également et constamment de la plus grande portion que chacune d’elles puisse prétendre dans les produits bruts. [157] Le cultivateur, comme cultivateur, a deux sortes d’avances à faire ; les avances primitives, qui sont l’achat de toutes les choses nécessaires à son établissement, et les avances annuelles, qui sont toutes les dépenses que sa personne et ses travaux occasionnent pendant l’année, et jusqu’à ce que la récolte soit faite.
Je ne calculerai point ici les reprises que ces doubles avances l’obligent de faire sur les produits bruts, pour pouvoir continuer ses dépenses et ses travaux ; je dirai seulement que, toute proportion gardée, ses salaires et les intérêts de ses avances doivent lui être payés par le produit de la culture, au moins aussi cher qu’ils le seraient dans une autre profession ; si vous rendez sa condition, à cet égard, pire que celle des autres hommes, la culture sera bientôt abandonnée, parce qu’il préférera l’emploi le plus lucratif de ses richesses mobilières, sans qu’il soit possible de l’en empêcher. Les richesses en argent qui servent à faire les achats des choses nécessaires aux avances de l’exploitation, sont des richesses occultes et fugitives, qui trouvent toujours le secret de se dérober à la contrainte, et d’aller où l’intérêt des possesseurs les appelle : impossible de forcer un homme à se faire cultivateur ; impossible de l’obliger à consacrer à la culture, une richesse clandestine, et dont, par cette raison, l’emploi ne dépend que de sa volonté ; il ne cultivera, il ne dépensera qu’autant qu’il trouvera son intérêt à cultiver et à dépenser : c’est une condition sine qua non.
De cette première vérité, je passe à une seconde ; c’est que les reprises du cultivateur ne sont jamais que ce qu’elles doivent être nécessairement, quand le gouvernement se trouve conforme à l’ordre ; c’est-à-dire, quand la liberté sociale est telle que l’ordre veut qu’elle soit : alors sans le secours d’aucune autorité civile, l’autorité naturelle de la concurrence qui se trouve entre les cultivateurs, déterminent la mesure essentielle de leurs reprises, et les maintient dans la proportion nécessaire qu’elles doivent avoir avec les bénéfices de toutes les autres professions.
Tant que l’état de cultivateur ne sera point incertain et dangereux ; tant qu’il ne sera point exposé directement ou indirectement à des vexations arbitraires, et toujours imprévues ; tant qu’il sera immune, qu’il ne dépendra que des engagements qu’il aura librement contractés pour exercer sa profession ; tant que cette même profession enfin, bien loin d’être dégradée dans l’opinion déréglée des hommes, sera parmi eux honorée comme elle doit l’être, et jouira de toute la liberté dont elle a besoin, on la verra, parée de toutes ses beautés naturelles, se placer sur une ligne parallèle, et à côté de toutes les autres professions lucratives, pour appeler à elle les richesses mobilières ; alors les possesseurs de ces richesses s’empresseront [158] à l’envi de les lui consacrer ; et cette concurrence permettant aux propriétaires fonciers de ne consulter que leurs propres intérêts dans le choix des cultivateurs, il en résultera que la préférence ne sera donnée qu’à ceux dont les offres et les facultés seront plus à l’avantage du produit net.
Il faut convenir qu’en cette partie l’administration n’est point embarrassante ; elle n’a rien à faire ; il lui suffit de ne rien empêcher ; de ne priver la culture ni de la liberté ni des franchises qui lui sont essentielles ; d’abandonner aux propriétaires fonciers le soin de débattre vis-à-vis des entrepreneurs de culture, les intérêts du produit net ; car ces débats, qui seront toujours rigoureux, ne peuvent être au profit des premiers, qu’ils ne soient au profit du souverain ; de laisser ainsi la concurrence en possession d’être l’arbitre naturel et souverain de ces mêmes débats ; la balance à la main, celle-ci ne manquera jamais d’apprécier et de réduire à sa juste valeur, ce qui doit appartenir aux cultivateurs dans les produits bruts, soit comme salaires de leurs travaux, soit comme indemnités et intérêts de leurs avances ; ils seront donc constamment assujettis par elle à ne prendre dans ces produits bruts, que la portion qu’on ne peut absolument leur refuser ; et cette portion étant ainsi la plus modique qu’il soit possible, celle qui formera le produit net, pour se partager entre les propriétaires et le souverain, sera par conséquent toujours aussi forte qu’elle peut et doit l’être.
Faites attention à notre dernière conséquence : la portion des produits bruts, qui formera le produit net, sera toujours aussi forte qu’elle peut et doit l’être : cette proposition est d’une vérité rigoureuse dans tous les sens qu’elle présente ; par la sagesse d’un tel gouvernement assurant pour toujours à la culture, les plus grosses avances possibles, l’État peut toujours aussi compter sur les plus gros produits bruts possibles en proportion de son territoire ; et au moyen de ce que la concurrence ne permet aux cultivateurs de retenir sur ces produits, que la portion qui leur est nécessaire pour les mettre en état de perpétuer ces mêmes avances, il se trouve que le produit net prend tout ce qu’il peut prendre dans les plus gros produits bruts possibles ; qu’il est ainsi pour ceux qui doivent le partager, la plus grande richesse possible.
Maintenant que nous voyons comment se forment les plus grands produits nets possibles, pour que le plus grand revenu possible soit acquis au souverain, il ne reste plus qu’une condition à remplir ; c’est de lui assigner la plus grande part possible dans ces produits nets. Mais pour déterminer cette plus grande part possible, c’est encore l’ordre physique qu’il nous faut consulter : nous n’avons [159] point d’autre boussole que l’évidence de ses lois, ni d’autres moyens pour montrer ce que les souverains ne peuvent se permettre, sans préjudicier à leurs propres intérêts.
Cependant, avant de nous livrer à cet examen, je crois à propos de prévenir une objection. Le tableau, me dira-t-on, que vous venez de présenter, suppose toutes les terres affermées, et les produits nets connus par des baux faits de bonne foi ; or cette supposition est en cela doublement vicieuse.
Je sais qu’il arrive souvent que des terres ne sont point affermées ; mais il en est peu qui ne l’aient été, ou du moins qui ne ressemblent à d’autres terres de leur voisinage qui sont affermées : je conviens qu’au défaut des baux, il ne reste que la voie de la comparaison et de l’évaluation, pour déterminer la portion que le souverain doit prendre dans le produit net d’une terre. Mais aussi ces évaluations n’auront rien de dangereux, dès que les points de comparaison qui leur serviront de base, n’auront rien d’arbitraire. D’ailleurs ce qui n’est pas affermé aujourd’hui le sera demain ; tôt ou tard son produit net sera donc constaté par des actes authentiques, et en attendant, les terres voisines affermées, et reconnues de même qualité, serviront de boussole. À l’égard des fraudes qu’on peut pratiquer à l’occasion de la passation des baux à ferme, elles ne peuvent guère être que momentanées ; ajoutez à cela qu’il est bien des moyens pour les découvrir, et même pour les prévenir, du moins en grande partie.
Ces fraudes ne peuvent être pratiquées que de deux manières : 1°. par des contre-lettres ; mais elles n’auront pas lieu quand elles seront déclarées par la loi ne pouvoir jamais être obligatoires, etc. ; 2°. par une indemnité en argent, donnée par les fermiers lors de la passation des baux. Mais calculez bien ces indemnités, ces pots-devins, car c’est le nom que nous leur donnons, et vous trouverez qu’il n’est pas à craindre qu’on emploie de tels expédients pour éluder le paiement d’une modique portion de l’impôt. En effet ces expédients ne pourraient avoir lieu qu’autant qu’un fermier aurait des fonds inutiles aux avances dont il est chargé ; car s’il prend le pot-de-vin sur ces mêmes avances à faire, il faudra qu’on lui tienne compte du vide que le détournement de cette somme occasionnera dans la reproduction. Alors un tel arrangement devient impossible, par la raison que la somme qu’il donnerait pour pot-de-vin, est destinée à rendre annuellement 200% en l’employant à la culture. Mais en supposant qu’un fermier soit assez riche pour distraire de ses avances, le pot-de-vin qu’on lui demande, toujours faudra-t-il qu’on lui tienne compte des intérêts sur le pied de 10% au moins, et qu’il profite de quelque chose encore dans la fraude à laquelle il veut bien se prêter : au moyen de cela, le bénéfice se réduit presque à rien pour [160] le propriétaire foncier, qui d’ailleurs par cette pratique, préjudicie à la valeur vénale de sa terre.
Il ne faut pas juger de cet objet par l’idée qu’on pourrait s’en former dans un état de désordre ; chez les nations où la culture étant languissante, le produit net se trouverait dans un cours de dégradation progressive, par une suite naturelle de la mauvaise forme des impositions : dans l’état opposé, chez une nation où l’on ne connaîtrait d’impôt qu’un impôt sur le revenu des terres, où par conséquent cet impôt n’aurait rien d’arbitraire, les revenus ne seraient, pour ainsi dire, sujets à aucunes variations sensibles ; tous s’achemineraient du même pas vers leur plus haut degré d’accroissement, et acquerraient ainsi une sorte de publicité qui rendrait moralement impossible la mauvaise foi sur l’article des baux, surtout si les lois empêchaient qu’on pût sans danger la mettre en pratique : il faudrait que la fraude fût bien modique, pour qu’elle ne devînt pas notoire.
Ces observations rassemblées, et que j’élague considérablement, vous prouvent bien que les petits inconvénients dont il s’agit ici, ne peuvent être d’aucune considération dans la masse générale des avantages que le souverain et la nation trouvent nécessairement à se conformer, sur ce point, à l’ordre de la nature, à cet ordre qui favorise en toute manière l’accroissement des produits dans lesquels le souverain doit toujours prendre une part proportionnelle. Il ne faut pas s’occuper de si faibles objets quand il s’agit d’un grand nombre de millions pour le revenu public et pour les revenus particuliers des propriétaires, ainsi que de la force politique d’un État et de tout ce qui doit concourir à sa plus grande prospérité.
[II-68 / 161]
CHAPITRE XXIX.↩
Seconde suite du chapitre XXVII. — Comment le produit net doit se partager entre le souverain et les propriétaires fonciers. — L’état du propriétaire foncier doit être le meilleur état possible. — Sans cela les produits doivent s’anéantir. — Une partie du produit net n’est point disponible ; elle est affectée nécessairement aux charges de la propriété foncière. — Le despotisme personnel et légal est le seul qui puisse empêcher l’impôt de devenir préjudiciable aux produits. — Lois physiques concernant l’emploi du produit net : d’après ces lois le partage est toujours fait naturellement entre le souverain et les propriétaires fonciers ; et la portion du souverain est toujours la plus grande portion physiquement possible. — L’impôt est assujetti par la nature même, à une forme essentielle.
L’ordre physique est un ordre absolu, un ordre immuable dont nous ne pouvons nous écarter qu’à notre préjudice. Les souverains ne peuvent donc rien prendre dans le produit net des terres au-delà de la plus grande portion physiquement possible. Mais quelle est-elle, cette portion ? Voilà ce qu’il est essentiel de rendre évident : en conséquence, il faut distinguer, comme nous l’avons déjà fait, deux temps différents, celui des sociétés naissantes, et celui des sociétés formées.
Dans les sociétés naissantes le revenu public institué librement, quoique nécessairement, en faveur de la propriété, n’a pu tellement la grever, que l’état du propriétaire foncier cessât d’être préférable à tous les autres : sans cela, cet état eut été nécessairement abandonné, ou plutôt personne ne l’aurait embrassé. Il est dans notre constitution de tendre toujours vers notre meilleur état possible ; nous y sommes entraînés par la pente naturelle du désir de jouir qui naît et meurt avec nous : ainsi dans les sociétés naissantes la propriété foncière a dû nécessairement être l’état le plus avantageux : ce n’a été qu’à cette condition qu’il a pu se former un revenu public ; car ce n’a été qu’à cette condition qu’il a pu s’établir des propriétaires fonciers, pour faire les dépenses primordiales de la propriété foncière, et celles de son entretien.
Si cette prérogative de la propriété foncière a été d’une nécessité absolue dans les sociétés naissantes, elle se trouve être encore de la même nécessité dans les sociétés formées : dans celles-ci comme dans celles-là, la propriété foncière n’est point un don gratuit ; elle ne s’acquiert et ne se conserve que par des dépenses, qui ne peuvent être faites qu’à raison de leur utilité. Puisque les mobiles qui agissent en [162] nous, n’ont point changé de nature ; puisque les impulsions de l’appétit des plaisirs sont les mêmes qu’elles ont toujours été, il est sensible que lorsqu’il s’agira d’employer nos richesses, nous préférerons toujours l’emploi qui nous promet le plus de jouissances ; et qu’ainsi nous ne nous porterons à convertir nos richesses mobilières en richesses foncières, qu’autant que nous croirons cette conversion avantageuse pour nous.
Dans les sociétés naissantes, la nécessité de rendre l’état des propriétaires fonciers le meilleur état possible, résultait de la nécessité de les engager à défricher, à construire les bâtiments nécessaires à l’exploitation des terres, à creuser des canaux pour les arroser ou les dessécher, à planter, à faire, en un mot, les divers travaux sans lesquels en général la culture ne pouvait avoir lieu. Ne croyez pas que toutes ces dépenses premières une fois faites, la propriété foncière se trouve exempte de toutes charges : la situation des propriétaires fonciers n’a nullement changé à cet égard, et c’est une vérité fondamentale qu’on ne peut mettre dans un trop grand jour.
Nous ne connaissons point de nation qui n’ait plus ou moins de terres à défricher : en cela, chaque société formée est comme une société naissante ; ces terres ne seront défrichées, qu’autant que l’état du propriétaire foncier sera le meilleur état possible, sans néanmoins que ce soit au préjudice et en diminution du meilleur état possible du souverain ; car ces deux intérêts ne doivent jamais se diviser.
Mais quand même les terres seraient toutes en valeur, on ne pourrait rien changer encore à la condition de la propriété foncière : il est constant que beaucoup de domaines se dégradent de différentes manières ; et que pour être rétablis, ils exigent de fréquentes dépenses qui ne peuvent être faites que par des propriétaires fonciers. D’ailleurs indépendamment du cas forcé de la dégradation, nous avons celui de l’amélioration : il est très peu de terres, qu’on ne puisse améliorer par des dépenses qui ne peuvent convenir qu’aux propriétaires fonciers ; or il est certain que si, en cette qualité, leur état n’est pas le meilleur état possible, aucune de ces deux sortes de dépenses n’aura lieu : certainement elles ne seront pas faites, dès que chacun en particulier trouvera son intérêt à ne pas les faire.
Ne comptons pour rien cependant ces trois premières observations ; en voici une quatrième qui sera plus sensible, parce qu’elle embrasse des objets plus étendus et plus connus. L’exploitation de la majeure partie des terres ne peut se passer de divers bâtiments ; plusieurs même sont dans le cas de ne pouvoir être cultivées, qu’autant que les eaux qui les avoisinent et les arrosent, sont contenues et dirigées par des ouvrages pratiqués à cet effet : or, il est évident que l’entretien de toutes ces différentes parties est une charge de la propriété [163] foncière, et que si l’état du propriétaire foncier n’est pas le meilleur état possible, j’entends, si le produit dont il jouit n’est pas de nature, que son plus grand intérêt soit de l’entretenir par les dépenses nécessaires à cet effet, il ne se portera point à faire ces mêmes dépenses.
Cette quatrième observation, quoiqu’elle soit d’une grande importance par elle-même, acquiert encore une nouvelle force, quand on la rapproche de la manière dont les hommes parviennent à l’état de propriétaire foncier dans une société formée. Les acquéreurs des terres, il est vrai, achetant ordinairement des terres toutes défrichées, des terres en rapport, n’ont point à faire les mêmes travaux et les mêmes dépenses que les premiers possesseurs ont faites lors des sociétés naissantes ; mais aussi ces acquéreurs remboursent-ils ces mêmes dépenses par le prix dont ils paient leurs acquisitions ; or, en vertu de ce remboursement, chaque acquéreur entre nécessairement en possession de tous les droits que son vendeur avait sur le produit net des terres vendues ; et la filiation des vendeurs forme ainsi une chaîne, au moyen de laquelle le dernier acquéreur représente le premier possesseur, et doit en avoir tous les droits en propriété.
Il est évident que si dans l’origine de la société, l’état du propriétaire propriétaire foncier n’avait pas été le meilleur état possible, les terres n’auraient pas été cultivées ; il est évident que pour constituer ce meilleur état possible, il a fallu que le revenu des terres, déduction faite de l’impôt, se trouvât être le plus fort produit qu’on pouvait se promettre de ses dépenses, et que la propriété de ce revenu fût assurée pour toujours aux propriétaires des richesses mobilières employées à le former.
Tels sont les deux avantages dont les premiers possesseurs des terres ont dû jouir nécessairement, et sans le concours desquels les terres n’auraient jamais acquis, dans le commerce, une valeur vénale représentative des premières dépenses faites pour les mettre en état de recevoir la culture. Mais dès que nous connaissons l’état nécessaire des premiers possesseurs dans une société naissante, nous connaissons aussi l’état nécessaire de ceux qui les remplacent et les représentent dans une société formée, puisque ceux-ci doivent jouir de tous les droits de ceux-là ; ainsi l’état des propriétaires fonciers doit être aujourd’hui, comme il a dû toujours l’être, le meilleur état possible. Quand je dis que dans une société formée l’état du propriétaire foncier doit être le meilleur état possible, je ne veux point faire entendre qu’on doive lui accorder des privilèges particuliers, des prérogatives sur les autres états : il n’a besoin que de celles qui lui sont attribuées par la nature, et dont il doit jouir nécessairement pour l’avantage [164] commun de toute la société. La reproduction n’est-elle pas le premier principe de toutes richesses, de toutes les jouissances que nous pouvons nous procurer ? Cela posé, le premier agent dont la reproduction a besoin, est donc l’homme le plus essentiel à la société ; or ce premier agent, c’est le propriétaire foncier : ainsi le titre de ses prérogatives se trouve dans la nécessité physique de la reproduction.
Un homme a des richesses mobilières à employer ; il commence par examiner quel sera l’emploi le plus utile pour lui : la société ne lui en présente que trois sortes : un emploi en achat de propriétés foncières ; un emploi en entreprises de culture ; un emploi en quelqu’une des diverses opérations auxquelles les reproductions donnent occasion. Mais observez que les richesses mobilières ne peuvent se procurer ces deux derniers emplois, qu’autant qu’elles ont commencé par se consacrer au premier ; car il n’y a lieu aux travaux de l’industrie, qu’après qu’il s’est établi des cultivateurs ; et l’établissement des cultivateurs doit toujours être précédé de celui des propriétaires fonciers.
Si donc une société était organisée de manière qu’on préférât à l’état de propriétaire foncier, les différents emplois que l’industrie peut offrir aux richesses mobilières, il en résulterait que la reproduction s’éteindrait ; et que ces mêmes emplois ne seraient plus possibles : alors les richesses mobilières ou pécuniaires s’éclipseraient ; elles passeraient chez l’étranger, tandis que la nation s’appauvrirait et se dépeuplerait de jour en jour.
Les privilèges du propriétaire foncier ne lui sont donc point particuliers ; ce sont au contraire des privilèges dont l’utilité réfléchit sur tous les autres hommes, et qu’il importe au souverain même de conserver. Nous pouvons dire plus encore : c’est qu’ils ne sont point d’une nature différente de celle des droits dont tous les hommes doivent jouir également : ces privilèges consistent dans la sûreté et la liberté qui sont essentielles à la propriété foncière, parce qu’elles sont essentielles à toute autre propriété. Ainsi toute la faveur que les propriétaires fonciers exigent du gouvernement, c’est qu’ils ne puissent être troublés dans la jouissance paisible de leurs droits naturels : à ce prix, leur état devient naturellement et nécessairement le meilleur état possible, parce qu’alors il est physiquement impossible qu’il ne le soit pas.
Il est constant qu’une multitude d’événements périodiques, et de différente espèce, occasionne une telle révolution dans la fortune des propriétaires fonciers, qu’on peut dire qu’elle les met tour à tour dans l’impuissance de soutenir les charges de la propriété foncière. Alors il faut que des acquéreurs se présentent pour les remplacer, avec des richesses mobilières capables de satisfaire à ces mêmes [165] charges. Mais on sent bien que ce remplacement ne peut avoir lieu, qu’autant que la propriété foncière est maintenue religieusement dans tous ses droits essentiels, et que l’état du propriétaire foncier continue d’être ainsi le meilleur état possible.
Ce que je dis ici des charges de la propriété foncière, nous montre que le revenu des terres n’est point dans tout son entier véritablement disponible ; qu’il en est une partie spécialement affectée aux dépenses que ces charges exigent ; qu’on ne peut la détourner de son emploi naturel et nécessaire, sans préjudicier à la culture, par conséquent au revenu du souverain et à la richesse de la nation ; qu’ainsi cette partie ne doit point entrer dans la masse à partager entre les propriétaires fonciers et l’impôt. En cela nous voyons distinctement une seconde borne posée par l’ordre physique, et que le souverain ne peut franchir sans blesser ses intérêts personnels, et ceux de la souveraineté.
Dans le code physique nous trouvons trois lois immuables concernant la reproduction : la première porte que les avances de la culture, sans lesquelles il n’est point de reproductions, ne pourront être faites par les cultivateurs, qu’après les dépenses à faire par les propriétaires fonciers ; la seconde ordonne expressément que ces doubles avances ne cesseront jamais de se renouveler dans leur ordre essentiel, suivant que le cours naturel de la destruction l’exige, et ce sous peine de l’anéantissement des produits et de la société : en conséquence, dit la troisième loi, il est fait défense, sous les peines ci-dessus énoncées, aux propriétaires fonciers, et à toute puissance humaine, de rien détourner de la portion qui doit être prélevée sur les produits, pour perpétuer ces mêmes avances.
D’après cette législation naturelle et divine, il est évident 1°. que sur les produits bruts, c’est-à-dire, sur la masse totale des reproductions, on doit d’abord prélever les reprises à faire par le cultivateur ; 2°. que dans le surplus, qui est un produit net, un accroissement de richesses, il ne faut pas regarder comme disponible, la portion nécessaire à l’acquittement des charges de la propriété foncière ; que le surplus est dans le vrai, la seule partie qui puisse se partager entre le souverain et les propriétaires fonciers, par la raison qu’elle est la seule dont la société puisse arbitrairement disposer.
Une fois que sur un produit brut on a prélevé les reprises du cultivateur, pour ne laisser que le produit net, le partage de la portion qui dans ce produit net est réellement disponible, se trouve naturellement tout fait entre le souverain et le propriétaire foncier, si l’impot n’a rien d’arbitraire ; car c’est là le point essentiel.
Je dis que ce partage se trouve tout fait, parce qu’alors chacun de ces deux co-propriétaires du produit net disponible a des droits certains, [166] des droits essentiellement nécessaires d’après lesquels la part proportionnelle qu’ils doivent prendre l’un et l’autre dans ce produit net disponible, a été tout d’abord nécessairement et régulièrement déterminée. Dans ce point seulement une société naissante diffère d’une société formée : dans celle-là, il a fallu examiner et fixer quelle serait la part proportionnelle que l’impôt prendrait dans le produit net disponible ; au lieu que dans celle-ci, il ne s’agit point de régler la proportion à suivre dans le partage, mais seulement de partager d’après la proportion qui se trouve établie. Il n’y a plus de loi à faire à cet égard ; il faut se conformer à la loi faite ; la société naissante l’a instituée ; et depuis ce moment tous les contrats d’acquêts ont été autant d’actes confirmatifs de cette loi, autant d’actes où elle a parlé pour manifester et assurer de nouveau les droits proportionnels du souverain et ceux de l’acquéreur, relativement à l’accroissement ou au décaissement du produit disponible. Le partage entre eux ne peut donc éprouver aucune difficulté dans une société formée, à moins que la loi qui en ordonne, ne perdît l’autorité despotique dont elle doit jouir, et que l’impôt ne devînt arbitraire ; révolution qui, comme je l’ai déjà dit, ne peut être que le fruit de l’ignorance, parce qu’elle ne peut arriver sans entraîner après elle la destruction de la propriété foncière, et même de tous droits de propriété, par conséquent de la nation et de la souveraineté.
Les lois essentielles et invariables de l’ordre physique ont donc de tous côtés circonscrit la co-propriété du souverain ; de tous côtés on trouve en évidence les limites qui lui sont assignées comme nécessaires à la conservation de son plus grand revenu possible : ici, c’est le privilège du cultivateur : si ses droits ne lui sont conservés dans leur entier, plus de culture, plus de productions, plus de revenu, ni pour le souverain ni pour la nation ; là ce sont les dépenses inséparables de la propriété foncière : si on lui enlève les moyens d’y pourvoir, on met les terres dans la nécessité de se dégrader au point de rendre la culture impraticable, autre cause de l’anéantissement des produits ; de toutes parts enfin ce sont les attributs essentiels de cette même propriété foncière, propriété dont le souverain est obligé, pour son intérêt personnel, de protéger les droits, puisque c’est sur eux que les siens sont établis ; propriété sans laquelle la culture devenant presque nulle faute d’avances, les productions ne pourraient plus renaître ; propriété qui décide de la vénalité des terres et des dépenses qu’on fait pour les améliorer ; propriété qu’on ne peut par conséquent détruire dans les sujets, sans détruire aussi le domaine même de la souveraineté, et dont les produits ne peuvent croître à leur profit particulier, qu’ils ne croissent en même temps au profit commun du revenu public. [167] De quels abus l’établissement de l’impôt pourrait-il donc être susceptible dans le gouvernement d’un seul ? Il est physiquement impossible que le souverain, sans se préjudicier à lui-même, veuille augmenter son revenu aux dépens de ceux de la nation ; ainsi ce projet ne peut être formé de sa part, qu’autant qu’il serait séduit et aveuglé sur ses véritables intérêts par l’ignorance de l’ordre qu’il lui est avantageux de garder dans toute sa pureté. Plus vous le supposerez avide de richesses, et plus il sera fortement attaché à la conservation de ce même ordre, si son évidence est tellement publique, qu’on ne puisse lui en imposer sur cet article. Dans cette partie comme dans toutes les autres branches du gouvernement, si vous écartez l’ignorance, dont le despotisme est nécessairement destructif, parce qu’il est arbitraire, le despotisme personnel ne sera que le despotisme légal de l’évidence d’un ordre essentiel, dans lequel il est de toute nécessité que l’état des propriétaires fonciers soit le meilleur état possible, afin que toutes les terres soient mises en valeur ; qu’elles reçoivent toutes les améliorations dont elles sont susceptibles ; que tous les genres de culture parviennent à leur dernier degré de vigueur et de perfection ; que le souverain et la nation se maintiennent constamment dans la plus grande richesse possible ; que l’ordre social enfin puisse remplir l’objet de l’institution des sociétés particulières, et par la plus grande abondance possible des productions, assurer le plus grand bonheur possible à la plus grande population possible.
Si par une suite de quelques désordres qui auraient considérablement altéré les revenus des terres, l’impôt se trouvait être démesuré, tellement exagéré que la part des propriétaires fonciers n’eût plus aucune proportion avec les charges inséparables de leur propriété, un tel malheur ne serait pas l’effet du gouvernement d’un seul, mais celui des abus qui auraient ou accompagné ou suivi son institution. En pareil cas même on ne pourrait pas dire pourquoi le gouvernement d’un seul ne serait pas plus propre que tout autre gouvernement à remédier à cet inconvénient : certainement il n’aurait besoin pour cela, que d’une connaissance évidente de l’ordre à rétablir : cette connaissance évidente une fois acquise, les intérêts, et conséquemment la volonté du souverain, seraient que toutes les forces de la nation se porteraient de concert vers le rétablissement de cet ordre ; il s’opérerait donc alors ce rétablissement heureux ; car il serait moralement et même physiquement impossible qu’il ne s’opérât pas. D’ailleurs il n’aurait rien d’embarrassant ; il consisterait uniquement à faire cesser les désordres qui altèrent les produits des terres : à mesure que ceux-ci reviendraient dans leur état naturel, on verrait tout à la fois l’impôt s’alléger, et cependant former un plus grand revenu public. [168] Nous ne pourrions raisonner ainsi en parlant d’un gouvernement où l’autorité serait partagée dans les mains de plusieurs : le malheur commun de la nation serait alors la source d’une multitude d’avantages particuliers, d’intérêts exclusifs, qui, quoique divisés entre eux, seraient cependant toujours unis, quand il s’agirait de faire force pour éloigner toute réforme. D’ailleurs on a déjà vu que l’ordre réprouve cette forme de gouvernement ; qu’ainsi on ne peut y supposer une connaissance évidente de l’ordre : sans cette connaissance cependant le retour à l’ordre est impossible ; on ne peut l’attendre que du despotisme légal de son évidence, tel qu’il doit être dans le gouvernement d’un seul.
Avant de clore cette dissertation, je reviens sur une proposition que j’ai ci-dessus avancée : j’ai dit que dans le cas supposé d’un impôt démesuré, sans cependant être arbitraire, on n’aurait besoin pour y remédier, que d’une connaissance évidente de l’ordre. Cette proposition est d’autant plus vraie, que ce désordre ne peut exister sans causer des maux évidents ; il ne manque donc alors pour les faire cesser que la connaissance évidente de leurs causes, et de la nécessité du retour à l’ordre. Quand je dis que ces maux sont évidents, c’est qu’il suffit des yeux du corps pour voir évidemment quand la culture est languissante ; quand il reste beaucoup de terres en friche ; quand il se fait une dégradation progressive dans cette partie ; quand la population diminue ; quand les revenus naturels et réels s’éteignent successivement ; quand les revenus factices et simulés les remplacent pour les surcharger de plus en plus : tels sont en général les effets destructeurs d’un impôt démesuré, ou plutôt désordonné, de tout gouvernement enfin où le sort du propriétaire foncier n’est pas ce qu’il devrait être, où son état n’est pas le meilleur état possible. Quelles que soient les causes de ce désordre, il est certain qu’on ne peut les faire cesser qu’après les avoir approfondies, qu’après avoir acquis une connaissance évidente de l’ordre dont on s’est écarté sans le savoir : il est certain encore que dans un État monarchique, cette connaissance évidente suffit pour rétablir cet ordre, parce qu’alors les intérêts communs du souverain, des propriétaires fonciers, de tous ceux qui tiennent nécessairement au corps politique de l’État, veulent absolument ce rétablissement ; en un mot, parce que toutes les volontés, et par conséquent toutes les forces de l’État se réunissent à cet effet dans le souverain.
C’est donc une vérité bien constante que partout où règne une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel à chaque société, partout où le despotisme personnel est légal, l’autorité, bien loin de pouvoir devenir abusive par rapport à l’institution du revenu public, se trouve être nécessairement le plus ferme appui [169] de cet ordre, et cela par la seule raison qu’il est l’unique moyen par lequel le souverain puisse s’assurer le plus grand revenu possible.
Cet ordre, ai-je dit, se trouve tout entier renfermé dans deux règles fondamentales : la première, que l’impôt n’ait rien d’arbitraire ; la seconde, qu’il ne soit que le résultat de la co-propriété acquise au souverain dans les produits nets des terres de sa domination. En développant ces deux règles essentielles j’ai fait voir comment elles tenaient l’une à l’autre ; comment l’ordre physique avait posé les bornes évidentes des droits résultants de cette co-propriété ; combien il importe au souverain même de respecter, de maintenir l’institution naturelle de ces bornes salutaires. Mais en supposant cet ordre nécessaire gardé comme il doit l’être, il s’ensuit que la perception de l’impôt est assujettie à une forme essentielle, à une forme qui le met nécessairement à l’abri de tous les inconvénients que le souverain a tant d’intérêt d’écarter. Cette forme est facile à découvrir d’après les principes que je viens d’établir ; cependant elle a été jusqu’à présent si peu connue, et les pratiques qui lui sont opposées, sont si universellement adoptées, que je crois devoir en parler de manière que les préjugés les plus accrédités ne puissent échapper à la force de l’évidence avec laquelle je me propose de les combattre.
[II-91 / 170]
CHAPITRE XXX.↩
De la forme essentielle de l’impôt. — Dans quel cas il est direct, et dans quel cas il est indirect. — Il est deux sortes d’impôts indirects, celui sur les personnes, et celui sur les choses commerçables : tous deux sont nécessairement arbitraires. — Pourquoi on leur donne le nom d’impôt indirect.
L’impôt est une portion prise dans les revenus annuels d’une nation, à l’effet d’en former le revenu particulier du souverain, pour le mettre en état de soutenir les charges annuelles de sa souveraineté. De cette définition résulte évidemment que l’impôt, qui n’est qu’une portion d’un produit net annuel, ne peut être établi que sur les produits nets annuels ; car produit net et revenu ne sont qu’une seule et même chose : qui dit un revenu, dit une richesse disponible, une richesse qu’on peut consommer au gré de ses désirs, sans préjudicier à la reproduction annuelle ; or on a déjà vu qu’il n’y a que les produits nets qui soient ainsi disponibles.
Ces premières notions nous indiquent quelle est la forme essentielle de l’impôt : ce qui n’est qu’une portion d’un produit net, ne peut être pris que sur un produit net ; on ne peut donc demander l’impôt, qu’à ceux qui se trouvent possesseurs de la totalité des produits nets dont l’impôt fait une partie.
Ainsi la forme essentielle de l’impôt consiste à prendre directement l’impôt où il est, et à ne pas vouloir le prendre où il n’est pas. D’après ce que j’ai dit dans les chapitres précédents, il est évident que les fonds qui appartiennent à l’impôt, ne peuvent se trouver que dans les mains des propriétaires fonciers, ou plutôt des cultivateurs ou fermiers qui à cet égard les représentent : ceux-ci reçoivent ces fonds de la terre même ; et lorsqu’ils les rendent au souverain, ils ne donnent rien de ce qui leur appartient ; c’est donc à eux qu’il faut demander l’impôt, pour qu’il ne soit à la charge de personne. Changer cette forme directe de l’établissement de l’impôt, pour lui donner une forme indirecte, c’est renverser un ordre naturel dont on ne peut s’écarter sans les plus grands inconvénients.
La forme de l’impôt est indirecte lorsqu’il est établi ou sur les personnes mêmes ou sur les choses commerçables : dans l’un et l’autre cas les préjudices qu’il cause au souverain et à la nation sont énormes et inévitables ; et ils sont à peu près les mêmes, quoiqu’ils aient une marche et une gradation différentes.
L’impôt sur les personnes est nécessairement un impôt arbitraire, destructif par conséquent du droit de propriété ; car quelle mesure [171] évidente peut-on suivre pour fixer la quotité d’un tel impôt ? Il est impossible d’en indiquer une : par lui-même notre individu ne fait que des consommations ; par lui-même il ne produit rien, et ne peut rien payer ; il n’y a donc aucun rapport connu, disons plus, aucun rapport possible entre nos individus et un impôt établi sur eux : un tel impôt ne peut avoir d’autre mesure que l’estimation arbitraire de celui qui en ordonne ; car tout ce qui n’a rien d’évident est arbitraire.
L’impôt sur les choses commerçables a le même défaut : sous quelque aspect qu’on l’envisage, il est impossible de partir d’un point évident pour en déterminer la proportion : le prix auquel la chose imposée sera vendue, est adventice et très inconstant ; les facultés de celui qui la vendra, et ce qu’elle lui coûte à lui-même, sont des particularités totalement ignorées ; les richesses de celui qui l’achètera ou qui voudra l’acheter pour la consommer, ne peuvent même se présumer ; la quantité de choses semblables qui pourront être consommées, loin d’être uniforme, est sujette à mille variations ; cet impôt, soit dans son produit total, soit dans ses proportions avec les objets qui ont rapport à lui, n’ayant ainsi rien que d’incertain et d’inconnu, il est impossible qu’il ne soit pas arbitraire.
L’impôt sur les personnes ou sur les choses commerçables étant donc absolument et nécessairement un impôt arbitraire, c’en est assez pour le rendre incompatible avec l’ordre essentiel des sociétés, et cela, en supposant même que cet impôt ne forme point un double emploi ; je veux dire, que le souverain n’ait pas déjà pris directement la portion qui lui revient dans les produits nets des terres.
Quand je dis qu’un tel impôt, en cela seul qu’il est arbitraire, devient incompatible avec l’ordre essentiel des sociétés, il faut prendre à la lettre cette façon de parler. En effet qu’est-ce que c’est que la propriété foncière ? C’est une propriété représentative de la propriété mobilière, par la raison qu’un bien-fonds représente les richesses mobilières qu’on a dépensées pour l’acquérir. Qu’est-ce que c’est qu’une propriété mobilière ? C’est la propriété personnelle même, considérée dans les effets qu’elle doit produire nécessairement : on ne peut être propriétaire de son individu, qu’on ne le soit aussi de ses travaux et par conséquent des fruits qui en résultent. Ainsi, à proprement parler, il n’y a qu’un seul droit de propriété, qui est la propriété personnelle ; ainsi c’est cette propriété personnelle que vous anéantissez, lorsque vous faites violence à la propriété mobilière ; ainsi cette violence éteint le germe de la propriété foncière qui n’est qu’une autre branche de la propriété personnelle ; ainsi par l’impôt arbitraire dont il s’agit, tous droits de propriété, et par conséquent toute société se trouvent détruits.
[172]
Impossible d’ailleurs que la répartition de l’impôt soit arbitraire, sans que chacun cherche à payer le moins qu’il peut, et à se décharger de sa cotisation sur les autres : ce point de vue prête à tous les écarts de l’opinion ; impossible qu’à cet égard elle ne soit souvent blessée, et qu’elle le soit sans causer des inimitiés cruelles : la haine, la jalousie, la vengeance, les affections particulières, les intérêts personnels, le dérèglement des mœurs, voilà donc ce qui préside à cette répartition ; impossible qu’elle ne devienne pas un moyen d’oppression ; une pratique destructive, et par conséquent toujours redoutable. De la crainte qu’elle imprime, naît naturellement et nécessairement dans la plupart des contribuables, la ferme résolution de ne point s’exposer à ses fureurs ; ils ne voient point de plus grand intérêt pour eux que de dérober à la société, la connaissance du peu de richesses qu’ils possèdent ; bien loin d’en faire des emplois utiles pour eux et pour les autres, ils en sont détournés par cette même crainte, chaque fois que ces emplois sont de nature à acquérir une certaine publicité.
Ce système léthargique s’étend jusqu’à ceux qui n’ont pour tout bien que leurs salaires journaliers : ils voient que la répartition arbitraire de l’impôt ne leur permet pas d’accumuler ces mêmes salaires ; ils voient que leur droit de propriété mobilière n’acquiert une réalité que par les consommations qu’ils peuvent faire clandestinement, et que ce droit n’a pour eux, d’autre durée que celle du moment même où ils consomment : pleins de cette idée qu’une expérience journalière nourrit et fortifie, ils se gardent bien de mettre un intervalle entre le gain de leurs salaires et leur consommation : sitôt que ces salaires sont acquis, ils se hâtent de les dépenser, et ils ne retournent au travail, que lorsqu’ils y sont rappelés par la nécessité.
Cette politique naturelle est tellement adoptée par tous les malheureux qui gémissent sous le poids d’une imposition arbitraire, que bien des gens se sont persuadé qu’il importait au bien public que ces hommes fussent toujours tenus dans un état d’indigence : ô vous, qui croyez que le malheur des uns est nécessaire au bonheur des autres, quelle idée vous êtes-vous donc formée de la justice et de la bonté de Dieu ? Quelle notion avez-vous du bien public, lorsque vous condamnez à une misère habituelle, la majeure partie des hommes dont le public est composé ? Brisez les chaînes qui empêchent ces infortunés de se mouvoir ; changez leur état d’oppression, en un état de propriété et de liberté ; alors vous ne verrez plus en eux que des hommes comme vous ; des hommes avides de jouissances, cherchant à les multiplier par des travaux, et pour leur utilité personnelle devenant utiles à tous. [173] Quand même il serait possible qu’un impôt arbitraire n’occasionnât aucun des abus dont il est susceptible, comme arbitraire, la forme d’un tel impôt, qui contraste avec l’ordre physique, ne renfermerait pas moins en elle-même des inconvénients nécessaires, qui deviennent, malgré nous, tellement destructifs des richesses de l’État, qu’il nous est physiquement impossible d’arrêter le cours de cette destruction.
Les inconvénients dont je veux parler sont dans la nature même de l’impôt indirect. Le nom qu’on lui donne ici annonce qu’il n’est point supporté par ceux sur lesquels il semble être directement établi, et cela est vrai, comme on le verra dans les chapitres suivants : lors même qu’il paraît totalement étranger aux propriétaires fonciers, il retombe sur eux, et à grands frais ; car il leur coûte toujours beaucoup plus qu’il ne rend au souverain ; il leur occasionne même en certains cas, des pertes sèches dont personne ne profite ; des diminutions progressives de la masse commune des richesses disponibles, dans lesquelles le souverain doit partager, et qui sont la mesure de sa puissance politique.
Si ces inconvénients avaient été connus, s’ils avaient été mis en évidence, certainement ils auraient fait proscrire pour jamais tout impôt indirect : aucun souverain n’aurait cherché à augmenter son revenu par des procédés qui le détruisent, et qui, par cette raison même, ne peuvent être mis en pratique, qu’ils ne le constituent dans la cruelle nécessité d’augmenter d’année en année de tels impôts, par conséquent d’aggraver d’année en année les maux qu’ils occasionnent. C’est donc dans cette évidence que nous devons puiser nos arguments pour achever de démontrer qu’il est pour l’impôt une forme essentielle, une forme dont le souverain ne peut s’écarter qu’à son préjudice ; qu’ainsi ses intérêts en cette partie sont tellement liés à ceux de la nation, que pour rendre impossible tous les abus qu’elle aurait à redouter, il suffit d’unir à l’autorité personnelle du souverain, l’autorité despotique de cette même évidence ; de rendre, en un mot, publiquement évident combien il perdrait en voulant s’écarter d’un ordre qui lui assure constamment son plus grand revenu possible, et le plus haut degré de puissance auquel il puisse espérer de parvenir.
[II-102 / 174]
CHAPITRE XXXI.↩
De la forme directe de l’impôt. — Combien elle est avantageuse au souverain. — Combien une forme indirecte lui serait préjudiciable. — Une forme indirecte occasionne nécessairement des doubles emplois dans l’établissement de l’impôt. — Inconvénients de l’arbitraire, qui forme le premier caractère de ces doubles emplois.
La forme directe de l’impôt est une forme essentielle, sous quelque rapport qu’elle soit considérée : soit que vous consultiez les intérêts du souverain, soit que vous consultiez ceux de ses sujets, vous la trouverez d’une égale nécessité.
Qu’est-ce que l’impôt dans l’ordre essentiel des sociétés ? C’est le produit d’un partage dans le revenu des terres ; partage qui se fait en vertu d’un droit de co-propriété qui appartient au souverain. Un tel impôt est donc aussi certain que la renaissance annuelle des revenus de la nation ; il est établi sur l’ordre physique de la reproduction ; il l’est encore sur notre constitution même ; sur les mobiles qui nous portent naturellement à nous assurer de la reproduction, à l’accélérer et l’accroître autant qu’il est en notre pouvoir.
Ainsi dans l’ordre essentiel des sociétés, l’impôt est totalement indépendant ; le produit qu’il donne annuellement, est le fruit nécessaire d’un enchaînement de diverses causes, qui seront toujours les mêmes, et qui produiront toujours les mêmes effets. Mais il ne peut conserver cet avantage précieux, qu’autant qu’on ne change point sa forme essentielle ; que le souverain prend directement la part proportionnelle que sa co-propriété lui donne droit de prendre dans les produits nets des terres de sa domination.
Si le souverain cessait d’user ainsi de son droit, de partager directement dans les produits nets, par quelle voie pourrait-il s’en dédommager ? Dans quelles mains irait-il chercher l’impôt qu’il aurait laissé dans celles des propriétaires fonciers ? Quelles que fussent les personnes auxquelles il voulût s’adresser à cet effet, elles ne pourraient lui remettre l’impôt, qu’autant qu’elles-mêmes l’auraient reçu de ceux qui en font renaître les fonds annuellement : mais s’il dépend arbitrairement de ceux-ci de se dessaisir de ces fonds ou de les garder, le recouvrement de l’impôt devient dépendant de tous les caprices de l’opinion dans les sujets, et le revenu public n’est plus un revenu certain, tel qu’il doit l’être pour l’intérêt commun du souverain et de la nation.
Indépendamment de cette incertitude, dont les suites ne peuvent être que funestes, la lenteur du recouvrement serait encore un inconvénient [175] majeur : les fonds de l’impôt restés dans les mains des propriétaires fonciers, ne pourraient en sortir que peu à peu, et souvent par une suite d’opérations très tardives : en attendant qu’ils parvinssent au souverain, par quels moyens pourrait-il subvenir aux charges journalières dont le revenu public est grevé ? Les ressources qu’il trouverait peut-être en pareil cas, lui seraient nécessairement vendues fort cher ; et leur cherté aggraverait encore de plus en plus le mal auquel il serait toujours pressé de remédier.
Je suis propriétaire d’une terre qui me donne un revenu annuel de quatre mille livres, et qui paie au souverain deux mille livres d’impôt. Le revenu du souverain naît et se perçoit en même temps que le mien : sur le retour périodique et constant de cette richesse, nous pouvons également régler notre dépense pour chaque jour : en cela nous jouissons d’un avantage nécessaire, parce que chaque jour est marqué par des dépenses qui ne peuvent se différer. Voilà comment le revenu public se forme dans l’ordre naturel ; mais si au préjudice de ce même ordre, on me laisse possesseur des deux mille livres qui doivent appartenir au souverain ; si elles ne peuvent arriver jusqu’à lui, qu’autant que mes dépenses les font passer par des mains étrangères, il peut très bien se faire qu’il ne reçoive jamais une partie de ces deux mille livres, et que le peu qu’il en touchera, ne lui parvienne que longtemps après le moment du besoin.
Nous voyons donc évidemment qu’il est physiquement et socialement impossible de dénaturer ainsi le revenu public ; qu’il est physiquement et socialement impossible qu’on puisse subvenir à des dépenses certaines et journalières, par le moyen d’une richesse accidentelle et incertaine dans sa quotité comme dans la marche de son recouvrement ; par conséquent qu’il est d’une nécessité physique et sociale que le souverain prenne directement et immédiatement dans les produits nets, la part proportionnelle qui lui appartient en vertu de son droit de co-propriété.
Si vous doutez encore de cette vérité, jetez un coup d’œil sur la société ; voyez comme elle se divise sommairement en deux classes d’hommes ; les uns qui sont toujours premiers propriétaires des productions renaissantes ; les autres qui ne participent à ces productions, qu’autant qu’ils les reçoivent en paiement des travaux de leur industrie. Examinez ensuite quelle est celle de ces deux classes qui est annuellement créatrice des produits dans lesquels le souverain doit partager ; et comment ces produits passent de cette première classe à la seconde : bientôt vous reconnaîtrez que tous les revenus de la seconde classe ne sont que des espèces de salaires qui lui sont payés par les premiers propriétaires des productions ; par conséquent que cette seconde classe, qui jamais n’est créatrice des [176] valeurs qu’elle consomme ou qu’elle dépense, ne peut donner qu’en raison de ce qu’elle reçoit de ces premiers propriétaires ; qu’elle ne reçoit d’eux qu’à mesure qu’ils jugent à propos d’acheter ses services ; qu’ainsi l’impôt, qui ne serait établi que sur les salaires ou les prix payés pour ces services, se trouverait toujours acquitté par les productions, mais ne pourrait jamais avoir rien de certain.
C’est donc une vérité de la plus grande évidence, que l’impôt doit être pris sur les produits nets des terres, et demandé par conséquent à ceux qui sont possesseurs de ces produits : ceux-là ne sont, pour ainsi dire, que dépositaires des fonds destinés à l’impôt ; c’est à eux qu’il faut directement s’adresser pour faire passer ce dépôt, de leurs mains dans celles du souverain immédiatement.
Je m’attends bien qu’on m’accordera sans peine que le souverain doit partager dans le produit net des terres, avec les propriétaires fonciers, et qu’il faut éviter tout circuit pour le faire jouir de la portion qu’il doit prendre dans ce produit. Mais ce qu’on me contestera sans doute, c’est que le souverain ne puisse augmenter constamment son revenu par d’autres voies, par d’autres impôts établis sur d’autres richesses que sur les produits nets des terres.
Si pour décider cette question nous remontons aux premières notions de l’impôt et de l’ordre immuable suivant lequel les richesses se consomment et se reproduisent, nous ne concevrons plus qu’elle puisse être proposée sérieusement ; nous chercherons en vain ces autres richesses sur lesquelles on pourrait établir un impôt à perpétuité, et sans les anéantir ; nous n’en trouverons point qui puissent se prêter à nos vues, parce que nous n’en trouverons point qui, lorsqu’elles ont été dépensées, puissent se renouveler par un autre moyen que par un partage dans le produit des terres ; en un mot, nous reconnaîtrons ce produit pour être la seule et unique richesse annuellement renaissante dans la société, pour fournir à toutes les dépenses de la société ; une fois convaincus qu’il ne peut circuler dans la société d’autre richesse qu’un produit sur lequel on a dû commencer par prélever l’impôt, nous nous bornerons à demander si la même richesse peut, sans inconvénient, payer plusieurs fois la même dette ; car c’est là que cette question alors se réduira.
L’impôt, considéré par rapport à celui qui le paie, est une dépense annuelle, qui certainement ne peut être supportée que par une reproduction annuelle. Pour que je puisse tous les ans payer 100 pistoles à l’impôt, et cela sans interruption, il est d’une nécessité absolue qu’il y ait une cause productive qui tous les ans aussi renouvelle dans mes mains, ces mêmes 100 pistoles : il est sensible qu’une fois que je les ai données, je ne les ai plus, et qu’il faut qu’elles me soient rendues, pour que je puisse les donner une seconde fois. Quel [177] que soit celui qui me les rende, il en est de lui comme de moi ; il ne peut me les rendre toujours, qu’autant qu’on les lui rend à lui-même ; il faut donc que cette chaîne aboutisse à un homme pour qui cette somme se renouvelle toujours par la voie de la reproduction, et qui, de main en main, me la fasse passer pour la donner à l’impôt. Mais dans ce cas je demande, qui est-ce qui paie l’impôt ? Est-ce moi, qui ne fais que recevoir ces 100 pistoles pour les porter à l’impôt ? Ou bien est-ce celui par qui ces 100 pistoles me sont fournies ? Je crois qu’on ne doit point être embarrassé pour me répondre ; et qu’il est évident que le premier qui fournit les 100 pistoles, est celui qui paie véritablement l’impôt : à cet égard, je ne suis, en quelque sorte, qu’un agent intermédiaire entre lui et l’impôt.
L’argent, qui est le gage et le signe de toutes les valeurs, et dont, par cette raison, on se sert pour payer l’impôt, ne pleut point dans nos mains : personne n’a d’argent qu’autant qu’il l’achète, qu’autant qu’il échange une valeur quelconque pour de l’argent. Si donc je paie l’impôt avec de l’argent que je n’ai point acheté, avec de l’argent en échange duquel je n’ai fourni aucune valeur, il est certain que ce n’est pas sur moi que frappe l’impôt, mais bien sur celui qui m’a donné l’argent nécessaire pour satisfaire à ce paiement : c’est le cas de ces hommes publics, qui tous les jours font des paiements considérables sans s’appauvrir, parce qu’ils les font pour le compte d’autrui, et avec l’argent d’autrui.
Ces premières notions, toutes simples qu’elles sont, nous conduisent cependant à voir très clairement par qui se trouve acquitté un impôt qui semble n’être pas établi sur les premiers propriétaires du produit des terres. Dans la main de ces premiers propriétaires on ne voit que des valeurs en productions ; que des productions en nature, ou des sommes d’argent qui les représentent ; dans la main des autres hommes on ne voit que de l’argent reçu en échange de travaux, et l’on se persuade que ce sont ces travaux qui ont produit cet argent ; on ne prend pas garde que dans cette dernière main, il n’est point une valeur nouvellement reproduite ; qu’il n’est au contraire qu’une portion de ces mêmes valeurs qui déjà appartenaient aux premiers propriétaires des productions, et avaient été partagées entre eux et le souverain. L’argent qui sert à payer l’impôt, peut bien successivement passer dans plusieurs mains ; mais il faut examiner si le dernier qui le porte à l’impôt, a fourni la valeur de cet argent : s’il ne l’a pas fournie, il nous faut remonter à celui qui lui a remis l’argent, et poursuivre ainsi notre recherche jusqu’à ce que nous ayons trouvé le véritable propriétaire de cet argent, celui qui réellement l’a acheté, mais qui ensuite, au lieu de le revendre, l’a donné pour le faire passer de main en main à l’impôt. [178] J’ai à mes gages un homme à qui je donne 100 francs, parce que 100 francs sont le prix nécessaire de sa main-d’œuvre, le prix fixé par une concurrence établie sur une grande liberté ; ces 100 francs sont à lui ; il les reçoit de moi en échange d’une valeur de 100 francs en travaux : établissez sur lui un impôt de la même somme ; il ne pourra plus vivre, à moins que je ne lui donne 200 francs. Cependant pour ces 200 francs, je ne recevrai de lui que les mêmes travaux, que la même valeur qu’il me donnait auparavant : il y aura donc la moitié de cette somme que je lui donnerai sans qu’il l’achète, et dont il se servira pour payer l’impôt : d’après cela n’est-il pas sensible que c’est sur moi que l’impôt retombe, et non sur lui ?
Tout impôt acquitté par un salarié dont les salaires augmentent en proportion, n’est certainement point supporté par le salarié ; cet impôt est à la charge de ceux qui, par l’augmentation de ses salaires, lui fournissent gratuitement les moyens de payer. On me dira peutêtre qu’un tel impôt n’occasionne pas toujours une pareille augmentation de salaires ; c’est un article que j’examinerai dans un autre moment : quant à présent n’abandonnons point notre objet, et démontrons rigoureusement que toute richesse sur laquelle on voudrait établir un impôt, n’est qu’une portion du produit des terres, produit qui déjà se trouve avoir payé l’impôt.
Il est certain que cette proposition ne peut souffrir aucune difficulté par rapport aux propriétaires fonciers : un impôt établi sur eux personnellement, et en considération des revenus que leur donnent leurs propriétés foncières, forme bien évidemment un double emploi : ils ne peuvent payer cet impôt qu’avec un produit qui ne passe dans leurs mains, qu’après qu’on en a séparé la portion destinée pour l’impôt, et qui est totalement distincte de celle qui doit leur rester en propriété. Si le double emploi peut paraître douteux, ce n’est donc que relativement aux impôts sur les autres hommes : ainsi c’est là l’objet particulier qui doit fixer notre attention.
Les richesses ne nous parviennent que de deux manières ; par la voie de la reproduction qui les multiplie, ou par quelque opération en vertu de laquelle nous sommes admis à partager dans le bénéfice de cette multiplication. En deux mots, il faut tenir ses richesses ou de la terre immédiatement, ou de ceux au profit de qui la terre les a reproduites. Un homme salarié peut bien en salarier d’autres à son tour ; mais cet homme ne fait que partager ce qu’il a reçu et ne peut continuer de donner qu’autant qu’il continue de recevoir : il faut donc que nous remontions à une source primitive de tous les salaires qui se distribuent ; à une source qui d’elle-même les renouvelle perpétuellement ; car ils sont tous destinés à être absorbés par la consommation. [179] Tous les cas où il se fait des paiements en argent, reviennent à celui que j’ai ci-dessus supposé : il faut que je tienne de quelqu’un les 100 francs que je donne à mon salarié ; mais pour avoir ces 100 francs, il a fallu que je les achetasse, que je donnasse en échange une autre valeur égale : ainsi au fond mon opération est pour moi la même que si j’avais donné tout simplement à mon salarié, cette autre valeur en nature, au lieu de la convertir en argent : impossible donc que je puisse toujours salarier en argent ce même homme, si tous les ans cette autre valeur ne se renouvelle pour moi. Je sais que je peux la gagner par mon industrie, au lieu de me la procurer par la voie de la reproduction annuelle ; mais pour que je la gagne, il faut qu’elle existe ; par conséquent qu’il y ait une classe d’hommes pour qui elle renaisse annuellement. Cette classe d’hommes est évidemment la classe propriétaire des productions : cela n’a pas besoin de commentaire ; ainsi c’est de cette classe, c’est des richesses qu’elle fait renaître, que proviennent toutes les richesses qui se distribuent parmi les autres hommes.
Cette vérité est une vérité fondamentale qu’il est nécessaire de mettre dans le plus grand jour. Pour la rendre plus sensible, proscrivons pour un moment l’usage de l’argent, bannissons-le du commerce, et n’y faisons plus entrer que des productions et des marchandises en nature. Dans cette hypothèse vous ne voyez plus que les premiers propriétaires des productions qui puissent communiquer des richesses aux autres hommes : c’est cette classe propriétaire qui fournit les matières premières des marchandises ; c’est cette classe propriétaire qui donne des productions en échange des travaux de main-d’œuvre ; une partie de ces productions peuvent passer de main en main jusqu’à ce qu’elles soient entièrement consommées ; mais dans quelque main que vous les trouviez, vous ne voyez toujours en elles, qu’une richesse qui provient de cette classe propriétaire.
En vain direz-vous que les agents de l’industrie, en façonnant les matières premières, en ont augmenté les valeurs ; je le veux bien ; mais qui est-ce qui leur a payé cette augmentation ? la classe propriétaire, qui, pour salaires de leurs travaux, leur a donné des productions ; ainsi la valeur de leurs travaux ne se réalise pour eux, qu’autant qu’elle est convertie en productions ; ainsi les richesses que leurs travaux leur procurent, ne sont point de nouvelles richesses dont ils soient créateurs ; ce ne sont que des valeurs qui existaient déjà, et qui tout simplement n’ont fait que passer des mains de la classe propriétaire dans les leurs.
Ne nous arrêtons pas plus longtemps à la fausse idée qu’on a de cette prétendue augmentation que l’industrie paraît procurer à la [180] première valeur des matières qu’elle emploie ; poursuivons notre hypothèse ; et sans rétablir l’usage de l’argent, formons le revenu public. N’est-il pas évident qu’il ne peut plus être composé que de productions en nature ? N’est-il pas évident qu’une fois que le souverain aura pris dans cette masse de productions, toute la portion qu’il doit y prendre, ces mêmes productions ne doivent plus rien à l’impôt, et que s’il veut partager de nouveau dans ces valeurs, ce nouveau partage est un double emploi ? Pourquoi, dira-t-on, ne pourrait-il pas aussi exiger en nature des valeurs en travaux de l’industrie ? J’y consens ; mais tandis que les agents de l’industrie travailleront pour le souverain, qui est-ce qui les nourrira ? Qui est-ce qui leur donnera les moyens de subvenir aux diverses dépenses auxquelles ils sont chaque jour assujettis par leur existence ? Ne voyez-vous pas qu’une valeur en travaux, n’est qu’une valeur en consommations déjà faites ou du moins à faire nécessairement par l’ouvrier personnellement ? Qu’ainsi il est impossible que les travaux soient faits, si quelqu’un ne fournit les choses qui entrent dans ces consommations ? Si ce quelqu’un est le souverain, c’est donc lui qui paie les travaux ; si c’est un autre homme, les travaux exigés par le souverain deviennent donc un impôt indirect sur les productions que cet autre homme possède ; et cet impôt pris sur une richesse qui ne lui doit plus rien, forme donc évidemment un double emploi.
Cette façon de présenter les salaires de l’industrie payés par les productions en nature, n’a rien d’imaginaire : si l’argent sert à faire ces paiements, c’est parce qu’avec de l’argent on se procure les choses usuelles qui entrent dans nos consommations : l’argent n’est ainsi qu’un intermédiaire ; et lorsque nous l’écartons pour ne plus voir que les choses qu’il représente, nous ne faisons que simplifier les opérations qu’il complique. On sent bien, comme je viens de le dire, qu’on ne peut avoir de l’argent, qu’autant qu’on l’achète, en donnant d’autres valeurs en échange : pour avoir toujours de l’argent, il faut donc avoir toujours des valeurs avec lesquelles on puisse l’acheter. Mais ces valeurs sont des choses que nous anéantissons par nos consommations ; nous n’avons par conséquent que la reproduction qui puisse nous restituer ces valeurs après que nous les avons consommées : il faut qu’elles soient reproduites, pour que la circulation de l’argent se perpétue par le moyen des échanges qu’on fait de l’argent contre ces productions.
Dans toutes les opérations de commerce que les hommes font entre eux, il est un point fixe sur lequel nous ne devons cesser d’attacher nos regards : ce point fixe est la consommation des choses usuelles. L’argent circule, mais ne se consomme point : sa circulation n’est au fond, qu’une continuité d’échanges faits de l’argent [181] contre les choses que nous consommons, c’est-à-dire, contre les productions ; car on n’échange pas de l’argent contre de l’argent : on l’échange quelquefois contre des travaux ; mais dans ce cas, comme dans tous les autres, il n’est qu’un gage intermédiaire ; les ouvriers qui le prennent en paiement, ne le reçoivent que parce qu’il représente une valeur en productions : sans cela ils exigeraient des productions, et refuseraient votre argent.
De tout ceci il résulte qu’une valeur en argent n’est au fond qu’une valeur en productions, qui n’a fait que changer de forme, sans rien gagner à ce changement. Ainsi tout ce que vous ne pouvez prendre sur les productions même, vous ne pouvez aussi le prendre sur l’argent qui n’est que leur représentant.
J’ai 100 mesures de blé qui ne vous doivent rien : si je les convertis en 100 écus d’argent, il s’ensuivra que ces 100 écus ne vous doivent rien non plus ; et que si je dispose de cet argent au profit de quelqu’un que j’emploie, la totalité de cette somme lui appartient, comme lui aurait appartenu la totalité de mon blé, si je le lui avais remis en nature. Ajoutez à cela que dans quelques mains que passent successivement ces 100 écus, ils sont toujours également dans le cas de ne rien vous devoir, parce qu’ils sont toujours une valeur représentative d’une valeur en blé qui ne vous devait rien.
Ces vérités, ainsi simplifiées, doivent paraître triviales, et je le souhaite : leurs conséquences en seront plus frappantes, plus victorieuses. Cependant quelque simples, quelque évidentes qu’elles soient, on les a perdu de vue dans la pratique chez presque toutes les nations policées. La circulation de l’argent a fait illusion au point qu’on ne s’est plus occupé que de l’argent. Par le moyen de cette circulation, dont on néglige d’examiner les causes, on le voit revenir dans les mains des agents de l’industrie ; et l’on prend ce retour pour une reproduction : en conséquence, on se persuade que cette reproduction simulée peut produire les mêmes effets qu’une reproduction réelle. D’après cette méprise on a conclu qu’une partie de cette prétendue reproduction devait entrer dans la formation du revenu public ; on n’a pas fait attention que l’argent reçu par ces agents, n’était qu’une valeur factice et conventionnelle, établie dans la société, pour être le gage et le représentant des valeurs en productions ; qu’ainsi prendre une partie de cet argent pour l’appliquer au revenu public, c’était prendre dans les productions même, une nouvelle portion en sus de la première appartenante à ce même revenu, et qu’on avait déjà remise au souverain.
Les termes d’agents de l’industrie et de salaires ne doivent point être pris ici dans un sens étroit et littéral : ce que je dis à leur sujet doit s’étendre et s’appliquer à tous les hommes qui, sans être [182] premiers propriétaires des productions, jouissent cependant d’un revenu quelconque : ce n’est que sur la reproduction que ces revenus se trouvent établis ; ils ne sont que des portions plus ou moins fortes des produits de la culture.
Le propriétaire d’une maison la loue mille francs par an, certainement ce n’est pas cette maison qui produit elle-même ces mille francs dont jouit annuellement ce propriétaire ; il ne les reçoit, qu’autant qu’il trouve un locataire en état de les lui payer chaque année. Ainsi première vérité : Le loyer d’une maison n’est point, pour la société, une augmentation de revenu, une création de richesses nouvelles ; il n’est au contraire qu’un mouvement, qu’un changement de main, qui survient dans la possession d’une richesse déjà existante : le propriétaire qui a reçu son loyer, ne se trouve avoir 1 000 francs, que parce qu’un autre qui les avait, ne les a plus.
Considérons donc cette somme de 1 000 livres dans les mains du locataire, et voyons d’où elle peut lui provenir annuellement. Si cet homme est un propriétaire foncier, cette somme représente, dans ses mains, une pareille valeur en productions qu’il a converties en argent, après les avoir partagées avec le souverain, et dont ce même homme doit librement disposer, en vertu de la pleine propriété qui lui en est acquise par ce partage. Ainsi seconde vérité : Le loyer d’une maison n’est qu’une portion d’une richesse qui ne doit plus rien à l’impôt.
Ce locataire, il est vrai, peut n’être pas un propriétaire foncier : alors il nous faut examiner qui est-ce qui lui fournit tous les ans, les 1 000 livres pour payer son loyer ; car il n’est point créateur de cette somme. Il l’acquiert, me direz-vous, par ses salaires ; mais ceux qui lui paient annuellement ces salaires, ne sont-ils pas obligés d’acheter l’argent par des valeurs qu’ils donnent en échange, et qui ne reviennent plus dans leurs mains ? Il faut donc que toujours ces 1 000 livres partent primordialement des propriétaires fonciers, les seuls pour qui renaissent chaque année des valeurs avec lesquelles ils achètent l’argent, pour l’employer ensuite à payer des salaires, et généralement tout ce qu’on peut assimiler à cette sorte de dépense.
Je sais qu’entre ces propriétaires fonciers et ce locataire, il peut se trouver plus ou moins d’intermédiaires ; mais leur nombre n’y fait rien : ce ne sont que des degrés de plus pour remonter à la reproduction, source primitive de la circulation de l’argent. Toutes les valeurs qu’on donne en échange de l’argent, sont des choses qui se consomment : si ces mêmes choses n’étaient pas reproduites, il ne se pourrait plus faire ni échanges, ni circulation d’argent. Ainsi ce n’est jamais que la reproduction, qui entretient la circulation de l’argent ; disons plus : ce n’est jamais qu’une valeur en productions, qui circule sous la forme d’une valeur en argent ; et qui ne gagnant rien à [183] ce déguisement, n’est jamais autre chose que cette même richesse sur laquelle on a prélevé la part proportionnelle du souverain.
Il en est du rentier comme du propriétaire d’une maison : nulle différence entre le loyer d’une maison qui tient lieu d’une somme d’argent, et le loyer d’une pareille somme d’argent prêtée en nature : le contrat qui est le titre du rentier, ne produit pas plus la rente, que la maison produit le loyer : l’un et l’autre sont payés avec des richesses déjà existantes, et n’opèrent qu’un changement de main dans ces richesses. Ainsi, soit directement, soit indirectement, c’est toujours avec une valeur en productions, que la rente est payée ; par ce moyen la rente se trouve faire partie d’une richesse qu’un partage déjà fait avec le souverain, a rendue franche et quitte de tout impôt.
Par le terme de rentier nous entendons ceux qui sont acquéreurs d’un revenu fixe et annuel en argent. Il est clair que ces acquéreurs sont des co-propriétaires de la valeur en argent des produits nets de la culture ; il est clair que la portion qu’ils y prennent, ne leur parvient qu’après que la totalité de ces produits nets a été partagée avec le souverain. Ainsi la rente peut être définie, une portion à prendre dans un revenu qui ne doit plus rien à l’impôt.
Ce que je viens d’observer sur les rentes et sur les loyers des maisons, me dispense de parler des autres revenus factices et simulés : on voit évidemment qu’il n’y a dans une nation de revenus réels, que ceux qui se forment constamment par la voie de la reproduction ; en un mot, que tous les revenus ne sont au fond que des portions prises directement ou indirectement dans les valeurs que la reproduction donne annuellement ; qu’ainsi l’on a pris les effets pour les causes, quand on a cru voir dans la circulation de l’argent, des richesses autres que les produits des terres, et sur lesquelles on pouvait établir un impôt particulier, sans former un double emploi.
Si les premiers propriétaires du produit des terres n’eussent jamais payé qu’avec des productions en nature, il eut été difficile de tomber dans une telle méprise, de ne pas voir que les productions distribuées à la classe industrieuse, sont les mêmes que celles dans lesquelles le souverain a partagé, et qui, au moyen de ce partage, sont devenues pleinement disponibles pour leurs propriétaires. Mais ces premiers propriétaires, au lieu de payer avec leurs productions en nature, les convertissent en argent, et paient avec cet argent, parce que cela facilite leurs opérations : et qu’importe au fond cette métamorphose ? Qu’importe que les valeurs disponibles dont ils doivent jouir, changent de forme ou n’en changent pas ? Après leur conversion en argent, en sont-elles moins ces mêmes richesses dans lesquelles le souverain a pris la part proportionnelle qui devait lui revenir, et dont le souverain a intérêt de garantir la propriété à ses [184] co-partageants ? Leur nouvelle forme les a-t-elle fait augmenter ? Et s’il ne leur est point survenu d’augmentations, comment la même richesse qui a payé ce qu’elle devait à l’impôt, peut-elle le lui devoir encore ?
Supposons un fonds de terre qui produise de l’argent en nature ; qui tous les ans donne à son propriétaire 100 écus, et 50 au souverain : n’est-il pas vrai que ces 50 écus une fois remis au souverain, le propriétaire de cette terre doit avoir la disposition libre des 100 autres écus ? Mais s’il ne peut les faire passer dans une main étrangère, sans que l’impôt en prenne un sur deux, il est évident que cet homme n’est plus propriétaire que d’un sur deux, que de 50 écus sur les 100, qui lui sont laissés cependant pour en disposer à son gré, et comme étant les fruits inséparables de sa propriété foncière. L’impôt alors forme donc évidemment un double emploi ; il commence par prendre la portion qui lui appartient dans ce produit ; puis il partage encore dans la portion du propriétaire foncier.
Mais parce que ce propriétaire ne cueille pas l’argent en nature ; parce que pour jouir de ces productions, il les convertit en argent, cet argent en est-il moins le produit de sa propriété foncière ? Ce produit ne lui est-il pas même remis en argent par ses fermiers, comme s’ils l’avaient cueilli réellement sur ses terres ? N’est-ce pas d’un produit en argent que le partage se fait entre le souverain et lui ? Et après ce partage, ce même argent, sur lequel la portion du souverain a été prélevée, peut-il encore être en partie pris pour le revenu public, sans que l’impôt forme un double emploi ?
Je sais qu’on répond à cela qu’un impôt pris sur cet argent, ne frappe pas toujours sur celui qui en est premier propriétaire ; que souvent ces sortes d’impôts ne portent que sur ceux qui le remplacent dans la possession de ce même argent. Cette réponse ne fait point disparaître le double emploi ; car en admettant cette proposition, il n’en serait pas moins évident que cet argent ou les productions qu’il représente, proviennent d’un partage déjà fait avec le souverain ; elle ne pourrait donc tendre qu’à prouver que ce double emploi ne grève point les propriétaires fonciers, quand l’impôt n’est pas établi sur eux personnellement ; or à cet égard, elle ne peut valoir qu’en supposant que le dernier possesseur de l’argent, celui qui le porte à l’impôt, en a fourni la valeur à un autre de qui il le tient ; que cet autre avait pareillement acheté cet argent, et ainsi de tous les possesseurs intermédiaires, en remontant jusqu’au premier possesseur, le propriétaire foncier : mais si aucun de ces possesseurs intermédiaires n’a réellement acheté l’argent qu’on donne à l’impôt ; si lorsque le propriétaire foncier s’en est dessaisi, il n’a réellement reçu aucune valeur en échange, n’est-il pas vrai que c’est lui qui se [185] trouve réellement chargé de l’impôt, quoique le paiement paraisse fait par des étrangers ?
Ainsi relativement à cette objection, toute la question se réduit à savoir à quelles conditions l’argent sort des mains de ce propriétaire foncier, pour passer successivement à l’impôt. Mais en attendant que j’approfondisse cette même question, toujours reste-t-il pour constant que le double emploi dont je viens de parler, est évident : cela posé, commençons par attacher nos regards sur les rapports généraux qu’il a nécessairement avec les premiers principes de l’ordre essentiel des sociétés : quand nous aurons vu comment il contraste avec les premiers principes, nous nous livrerons à l’examen particulier de ses contre-coups, et cette recherche nous fera connaître sur qui retombent les surcharges qu’il occasionne.
Le premier inconvénient de ce double emploi est celui que j’ai présenté dans le chapitre précédent : il imprime à l’impôt le caractère d’un pouvoir arbitraire qui tend à anéantir tout droit de propriété, et attaque ainsi, dans son essence, l’ordre constitutif des sociétés. Les rapports de ce désordre avec les intérêts particuliers de la nation sont sensibles et évidents ; mais leurs rapports avec les intérêts particuliers du souverain ne le sont pas moins ; car, comme on l’a déjà vu, ces deux sortes d’intérêts sont si parfaitement, si inséparablement unis, qu’on doit les regarder comme étant les mêmes à tous égards : d’ailleurs la chaîne qui les lie dans le point de vue dont il s’agit ici, est facile à concevoir dans toute sa simplicité.
Le souverain n’est point lui-même créateur de son revenu : le revenu public, dont il dispose pour l’acquittement des charges publiques, n’est qu’une portion de la masse totale que forment les différents revenus particuliers. Ces revenus particuliers ne sont point des productions gratuites et spontanées de la terre ; il faut au contraire les acheter par des dépenses ; ainsi tout ce qui tend à diminuer ces dépenses, tend à diminuer aussi ces mêmes revenus particuliers, par conséquent le revenu public.
La première condition requise pour que la culture puisse recevoir de grandes avances, est que ceux qui sont chargés de faire ces avances, possèdent de grandes richesses ; la seconde, que ces avances donnent des produits proportionnés à la valeur dont elles sont ; la troisième, que la propriété de ces produits soit assurée à ceux qui les font renaître par leurs dépenses. Les deux premières conditions ne peuvent absolument rien sans la dernière : les moyens d’agir ne produisent aucune action, lorsqu’on n’a ni aucun intérêt pour agir, ni aucune volonté d’agir ; or, ici ce n’est que dans la propriété des produits, qu’il faut chercher cet intérêt et cette volonté. D’ailleurs sans cette propriété, comment les richesses qui serviraient [186] à faire les avances de la culture, pourraient-elles se perpétuer ? Elles ne s’entretiennent que par le produit qu’elles donnent à ceux qui les font.
Ne vous persuadez pas que cette propriété des produits ne puisse être blessée que dans la personne même de leurs premiers propriétaires ; il est physiquement impossible qu’elle ne le soit pas encore par toutes les atteintes qu’on peut porter à la propriété mobilière dans les autres hommes. Une chose bien constante, c’est que nous ne travaillons que pour jouir ; nous ne travaillons qu’autant que nous espérons retirer de nos travaux, des fruits que nous pourrons convertir en jouissances. Mais cet espoir ne pouvant s’établir en nous, si la propriété mobilière de ces mêmes fruits ne nous est assurée, on peut regarder cette propriété comme le germe de tous les travaux de l’industrie. Je demande à présent s’il n’existe pas une proportion nécessaire entre la masse de ces mêmes travaux, et celle des produits de la culture.
En vain me conserverez-vous religieusement la propriété des denrées que je récolte ; ma consommation en nature prélevées, si je ne peux convertir le surplus en jouissances, ce surplus ne m’est d’aucune utilité ; et s’il ne m’est d’aucune utilité, je ne ferai certainement aucune dépense pour m’en procurer la reproduction. Il est donc essentiel à la reproduction de ce surplus, que je le distribue à d’autres hommes dont l’industrie me permette de jouir, sous une forme nouvelle, de cette richesse, qui sous sa première forme, serait dégénérée en superflu. Mais cette opération ne peut se faire qu’autant que l’industrie se verra propriétaire des productions que je peux lui offrir en échange de ses travaux : sans cela ces mêmes travaux n’auront pas lieu ; leur cessation deviendra pour moi une privation de la liberté de jouir ; et dès lors la propriété de mes productions devient nulle ; car sans la liberté de jouir, le droit de propriété, qui n’est autre chose que le droit de jouir, n’est plus rien.
C’est ainsi que chaque branche de l’ordre essentiel des sociétés, dès que vous voulez l’approfondir, vous présente tous les hommes unis entre eux par les liens d’une utilité réciproque ; c’est ainsi que depuis le souverain jusqu’au dernier de ses sujets, vous ne voyez pas un membre de chaque société particulière, dont le meilleur état possible ne soit toujours et nécessairement établi sur le meilleur état possible des autres membres de la même société. Mais je me suis déjà trop étendu sur l’intérêt commun qu’ils ont tous à maintenir dans chacun d’eux le droit de propriété, pour que je puisse me permettre ici de plus longs détails : je brise donc sur cet article pour considérer sous de nouveaux points de vue les doubles emplois que forment les impôts indirects, afin d’en montrer tous les inconvénients, [187] et de faire voir comme il est physiquement impossible qu’ils ne deviennent pas destructifs des revenus communs de la nation et du souverain.
[II-137 / 188]
CHAPITRE XXXII.↩
Effets et contre-coups des impôts établis sur les cultivateurs personnellement. — Quand ils sont anticipés ils coûtent à la nation quatre et cinq fois plus qu’ils ne rendent au souverain. — Progression de leurs désordres. — Effets et contre-coups des impôts établis sur les hommes entretenus par la culture. — Ils occasionnent nécessairement, comme les premiers, une dégradation progressive des revenus du souverain, de ceux de la nation, et par conséquent de la population.
Toute richesse provient de la terre, et il n’y a dans la société que les reproductions annuelles qui puissent fournir aux dépenses, aux consommations annuelles de la société. Ainsi lorsque les productions ou leur valeur en argent ont été partagées avec le souverain, l’impôt ne peut prendre une nouvelle portion dans cette richesse, qu’il ne forme un double emploi. Mais les effets de ce double emploi varient, selon l’assiette et la marche de l’impôt, je veux dire, selon l’état des personnes auxquelles il enlève une portion de leurs richesses. Pour connaître et apprécier ces effets, il nous faut remonter à une première vérité, à un axiome qui présentement n’éprouve aucune contradiction.
La consommation est la mesure proportionnelle de LA REPRODUCTION. En effet, on ne fera pas annuellement des dépenses et des travaux pour se procurer des productions dont il ne doit résulter aucunes jouissances. Cette seule réflexion, en nous démontrant la justesse de cet axiome, nous conduit encore à découvrir d’autres vérités. Quand nous disons que la consommation est la mesure proportionnelle de la reproduction, il faut entendre une consommation qui tourne au profit de ceux dont les travaux et les dépenses font renaître les productions : une consommation qui ne leur serait absolument d’aucune utilité, ne les déciderait certainement point à travailler et dépenser pour renouveler les choses qu’elle absorberait.
Il y a donc dans la consommation, un ordre essentiel, un ordre nécessaire pour qu’elle puisse servir à assurer constamment une reproduction qui lui soit proportionnée. Cet ordre nécessaire dans la consommation est ce qui doit conséquemment régler la distribution des productions, après que le partage en a été fait avec le souverain ; car c’est en conséquence de cette distribution que s’opère la consommation. Il est sensible que cette distribution doit être nécessairement un moyen de jouissance pour les premiers propriétaires des [189] productions : ce n’est certainement qu’à cette condition qu’ils continueront de cultiver ou de faire cultiver ; qu’ils se livreront enfin aux dépenses nécessaires pour entretenir les terres dans un état convenable à la culture. Remarquez qu’en cela le système de la nature est toujours le même ; que son but est d’enchaîner les hommes les uns aux autres par les liens d’une utilité réciproque.
L’ordre dont on aperçoit ici la nécessité pour que la consommation soit utile à la reproduction, n’a rien de factice : le législateur universel n’a point laissé aux hommes le soin d’instituer des lois à cet égard ; ce même ordre est au contraire tout naturellement établi tel qu’il doit être dans toutes les sociétés du monde entier ; aussi se maintiendra-t-il toujours et nécessairement, pourvu que nous ne fassions rien pour le troubler.
Le désir de jouir, nourri par la liberté de jouir, met tous les hommes en action : les uns s’emploient à perfectionner les productions, à augmenter leur agrément ou leur utilité, tandis que les autres s’occupent à les faire renaître annuellement. Si les productions qui excédent la consommation en nature de leurs premiers propriétaires, n’étaient utiles qu’à la classe industrieuse, ces mêmes productions ne seraient ni cultivées, ni reproduites ; si les travaux de cette classe industrieuse n’étaient utiles qu’aux premiers propriétaires des productions, ces mêmes travaux cesseraient d’avoir lieu, et la majeure partie des productions devenant inutile, leur culture serait également abandonnée.
Il est donc d’une nécessité absolue que la distribution et la consommation des productions soient faites de manière que les uns trouvent un grand intérêt à se livrer aux travaux de leur industrie, et les autres à se charger des dépenses et des travaux de la culture. Mais pour remplir ces vues, et accorder des intérêts qui semblent se contredire, quelle règle de proportion doit-on observer dans la distribution des productions ? Ce n’est point à nous à chercher cette règle, il existe naturellement au milieu de nous, une puissance dont l’autorité despotique saura bien la faire observer, tant que nous n’empêcherons point son autorité d’agir.
La concurrence des agents de l’industrie les force de vendre leurs ouvrages au rabais : dès lors ils sont dans l’impossibilité de ne pas faire valoir les productions au profit de ceux qui les font renaître annuellement ; d’un autre côté, la concurrence des vendeurs de ces productions offre pareillement au rabais leurs marchandises à la classe industrieuse ; ils sont donc contraints de l’associer à leurs jouissances, tandis qu’ils les augmentent par son entremise. Il est clair que par ce moyen, chacun achetant aussi bon marché qu’il doit acheter, et vendant aussi cher qu’il doit vendre, il en résulte pour les [190] uns et pour les autres, un grand intérêt à multiplier les choses dont ils sont vendeurs. C’est ainsi que la concurrence régnant paisiblement dans le sein de la liberté, règle sans violence, quoique despotiquement, les droits de ces deux classes d’hommes, et les concilie si parfaitement, que la consommation est utile à chacune d’elles, autant qu’elle peut et doit l’être, et qu’à raison de son utilité commune, elle devient nécessairement la mesure proportionnelle de la reproduction.
D’après l’exposition sommaire de cet ordre essentiel, qui doit nécessairement régner dans la consommation, ou plutôt dans la distribution qui la précède et l’occasionne, il est facile de juger des effets qui doivent résulter des doubles emplois que forment les impôts indirects. Ces doubles emplois, qui surviennent toujours après la distribution des productions, dérangent nécessairement ce même ordre essentiel suivant lequel cette distribution s’est faite sous l’autorité de la concurrence ; alors par une suite naturelle et nécessaire de l’interruption de cet ordre, la consommation ne peut plus être de la même utilité à la reproduction ; les intérêts de celle-ci se trouvent directement ou indirectement sacrifiés : inde mali labes : la reproduction s’altère en raison de ce qu’on retranche de l’utilité qu’elle aurait trouvée dans la consommation.
Pour rendre ces vérités plus sensibles, parcourons les différentes professions sur qui peuvent frapper les impôts indirects ; examinons les rapports de ces impôts avec les consommations de ces mêmes professions, et les rapports de leurs consommations avec la reproduction.
Je commence par les cultivateurs ou entrepreneurs de culture : les richesses qui sont dans leurs mains, sont précisément celles qui ne sont pas disponibles, parce qu’elles sont spécialement affectées aux dépenses de la reproduction : impossible donc qu’on puisse se proposer d’établir sur eux personnellement un impôt, puisqu’il en résulterait nécessairement une diminution des dépenses productives : un tel impôt ne peut être mis en pratique, qu’autant qu’on se persuade que les cultivateurs en seront indemnisés par les reprises qu’ils feront sur la masse totale des productions ; mais ou ces reprises seront ainsi faites, ou elles ne le seront pas : au premier cas, l’impôt devient un double emploi bien évident, puisqu’en définitif, il est payé par le produit net, dans lequel le souverain partage avec les propriétaires fonciers. Dans le second cas, on peut dire que cet impôt ne forme point un double emploi sur les richesses disponibles ; mais en cela même il leur cause un préjudice bien plus grand, car il éteint le germe de la reproduction de ces richesses. [191] Un impôt sur les cultivateurs nous présente donc différentes hypothèses à parcourir séparément : s’il est connu avant la passation des baux à ferme, et payable après la récolte, il n’est autre chose qu’une surcharge peu indirecte sur les propriétaires fonciers, relativement à la portion qu’ils prennent dans le produit net : ainsi le double emploi qu’il forme, est de la même nature que celui qui résulterait d’un impôt établi directement sur la personne même des propriétaires fonciers. Mais outre les inconvénients propres et particuliers à un tel impôt, comme double emploi, et comme surcharge pour les propriétaires fonciers, si cet impôt est pris sur les cultivateurs par anticipation, et sans attendre la reproduction, il est clair qu’il frappe sur les richesses non disponibles, sur les avances de la culture : alors comme impôt anticipé, il porte à la reproduction un préjudice qui est au moins le double de ce qu’il prend sur ces avances : je dis au moins le double, parce qu’en général les avances annuelles rendent 2 pour 1, et que leur succès dépendant beaucoup de leur ensemble, il arrive souvent que faute des avances qu’on ne fait pas, celles qui sont faites deviennent moins productives.
Voici donc un premier désordre inévitable : détournez des avances de la culture une valeur de 100, vous éteignez au moins une reproduction de 200. Voyons maintenant les contre-coups de cette détérioration, en supposant toujours que l’impôt anticipé ait été prévu par le cultivateur lors de la passation de son bail, et que son marché avec le propriétaire foncier ait été fait en conséquence.
Le cultivateur, qui, au lieu d’employer cette valeur de 100 en avances de culture, la donne à l’impôt, n’en a pas moins fait les mêmes frais, et n’en a pas moins les mêmes reprises à exercer sur la masse des productions qu’il fait naître : mais cette masse est diminuée de 200 ; c’est donc 200 de moins sur le produit net que le cultivateur s’oblige de fournir annuellement ; or, en supposant que le souverain prenne le tiers dans ce produit net, c’est environ 70 de diminution dans son revenu direct, ce qui réduit à 30 ou à peu près, les 100 qu’il retire d’un tel impôt : pour peu que le recouvrement de cet impôt soit dispendieux, il est clair que de cette valeur de 100, il ne doit rien rester au souverain.
Si la valeur de 100, prise par l’impôt, n’avait pas été enlevée à la culture, il en serait résulté une reproduction de 100, dont la moitié aurait été une richesse disponible dans la nation ; et cette richesse se serait distribuée à tous ceux qui, par leur industrie, sont appelés à partager dans les richesses disponibles. Mais tandis que vous auriez eu plus de salaires à distribuer aux agents de l’industrie, vous auriez encore eu plus d’hommes entretenus par la culture, parce qu’elle aurait dépensé 100 de plus en travaux utiles : en deux mots, puisque [192] la reproduction annuelle est diminuée de 200, il faut bien que la consommation, et par conséquent la population, diminuent en proportion.
Nous venons de voir que l’impôt dont il s’agit, commence par être réduit pour le souverain, au tiers de son produit, par la diminution qu’il occasionne dans le revenu direct de la souveraineté ; et qu’ainsi pour peu que la régie d’un tel impôt soit dispendieuse, il doit être absorbé par les frais en totalité. Mais ne comptons pour rien ces mêmes frais, quoique indispensables, et attachons-nous à la première observation. Cette réduction du produit de l’impôt en question, fait que le souverain, qui perd les 2/3 de l’impôt, ne peut se procurer 100 par une telle voie, à moins qu’il ne porte l’impôt à 300 : or, ces 300, pris par anticipation sur les cultivateurs, éteignent une reproduction de 600, dans laquelle, suivant la proportion que nous avons supposée ci-dessus, le souverain aurait pris 200, et les propriétaires fonciers 400. Si maintenant vous voulez revenir sur les frais, et ne les évaluer qu’à 10% seulement, vous trouverez que cet impôt, pour donner 100 de revenu net au souverain, doit être aumoins de 400, par conséquent éteindre une reproduction de 800 : quiconque doutera de cette vérité, peut s’en convaincre par un calcul qui serait ici superflu, vu la facilité dont il est.
Je demande à présent s’il est socialement possible qu’on établisse jamais un impôt anticipé sur les cultivateurs, lorsqu’on sera publiquement et évidemment convaincu qu’il n’en revient pas le tiers de net au souverain, et qu’un tel impôt ne peut lui rendre 100, qu’en éteignant une reproduction de 800, extinction qui est entièrement en déduction d’un revenu commun, que nous supposons se partager des deux tiers aux tiers entre le souverain et les propriétaires fonciers, et qui conséquemment coûte à ceux-ci, au-delà de quatre fois plus que le souverain ne retire de l’impôt.
Oui, je dis que cette opération est doublement impossible : elle l’est à raison de ses rapports avec le souverain, et à raison de ses rapports avec les propriétaires fonciers. Dès que nous admettons que l’évidence de ces vérités est publiquement reconnue, il serait contre nature qu’un souverain voulût se procurer 100, par une voie qui anéantit une reproduction de 800, et détruit ainsi la souveraineté, tandis qu’il le peut faire par une autre voie qui n’a nul inconvénient, j’entends, en demandant directement cette valeur de 100 aux propriétaires fonciers. En vain m’alléguerez-vous qu’il peut vouloir abuser de son autorité pour augmenter son revenu ; mais s’il voulait en abuser, ce ne serait pas par des pratiques évidemment contraires à ses vues, à ses intérêts les plus chers, et qui le mettraient en contradiction avec lui-même : en supposant cet abus possible, il en résulterait [193] qu’il se garderait bien de préférer une forme d’imposition qui lui rendrait beaucoup moins, à une autre forme d’imposition qui lui rendrait beaucoup plus : au contraire, plus vous le supposerez avide de richesses, et moins vous aurez à craindre que cette avidité lui permette de changer ainsi la forme naturelle de l’impôt : l’ignorance en cette partie est le seul principe des maux qu’on ait à redouter.
À l’égard de la nation, nous découvrons dans l’évidence de ses intérêts, les mêmes preuves de l’impossibilité dont il est qu’un tel impôt s’établisse : il serait également contre nature que sachant évidemment qu’il lui en coûte 100 et plus pour fournir au souverain une valeur de 100, elle ne se mît pas à l’abri de cette perte en allant au-devant des besoins du souverain, sitôt qu’elle les connaîtrait, et prenant sur les revenus particuliers dont elle jouit, la portion nécessaire pour satisfaire à ces besoins.
Tout ce que je viens de dire d’un impôt pris par anticipation sur les cultivateurs, suppose, comme on a dû le voir, que cet impôt est connu avant la passation des baux à ferme ; qu’il est entré dans les calculs des frais et des reprises à faire par les fermiers sur le produit brut, et en diminution du produit net. Si au contraire un tel impôt s’établissait sans qu’il eût été prévu par les fermiers, et qu’on obligeât néanmoins ceux-ci à payer les sommes convenues par leurs baux, il en résulterait que la diminution de la reproduction serait entièrement à la charge de ces cultivateurs ; que la première année une valeur de 100, enlevée aux avances d’un cultivateur, lui occasionnerait un vide de 200 dans la récolte ; que l’année suivante, le même impôt continuant de subsister, la diminution de ses avances se trouverait être de 300, ce qui en causerait une de 600 dans la reproduction.
Je ne pousserai pas plus loin cette progression géométrique : il est aisé d’en apercevoir le dernier résultat : il faut peu d’années de cette espèce pour que les fermiers soient ruinés. C’est donc autant de richesses productives éteintes dans la nation. Il est vrai que cette progression s’arrête au renouvellement des baux passés avec de nouveaux fermiers ; mais pour qu’il s’en présente, il faut faire cesser les risques ; il faut qu’ils n’aient point à craindre d’être ruinés comme ceux qui les ont précédés : sans cela les propriétaires fonciers sont réduits à faire eux-mêmes les avances de la culture, et les terres restent en friche, s’ils ne sont pas en état de pourvoir à cette dépense : ainsi tant que le risque subsiste, l’appauvrissement du souverain et de la nation doit avoir une progression très rapide ; car la diminution des avances en occasionne une dans les produits ; et celle-ci en occasionne à son tour une autre dans les avances. Ce cercle sans fin est une chose bien effrayante pour quiconque veut lui donner une légère attention. [194] En général, il y a dans chaque nation une classe d’hommes salariés par les cultivateurs ; une classe d’hommes dont la maind’œuvre et l’industrie sont immédiatement employées aux travaux de la culture, et aux différents ouvrages dont elle a besoin. Les fonds qui servent à payer les salaires de ces ouvriers, font partie des richesses non disponibles, de ces richesses que les cultivateurs doivent prélever sur la masse totale des productions, avant même qu’elles se partagent entre le souverain et les propriétaires fonciers. On conçoit bien que ce prélèvement privilégié n’est plus qu’un jeu, qu’une illusion, s’il n’assure pas aux cultivateurs la liberté de consacrer en leur entier ces richesses à la culture, ou plutôt, si après le prélèvement qu’ils en ont fait, ils ne peuvent les appliquer à leur destination, sans qu’une partie de ces mêmes richesses leur soit enlevée pour l’impôt.
Tel est pourtant l’inconvénient de toute imposition qui serait établie sur les salaires des hommes entretenus au service direct ou indirect de la culture : une telle imposition fait nécessairement renchérir d’autant leurs salaires ; alors ce renchérissement équivaut à une diminution directe des avances du cultivateur ; car il est parfaitement égal de lui prendre directement 100 francs, par exemple, sur 300, ou de lui faire payer 300, ce qu’il n’aurait dû payer que 200 : dans l’un et l’autre cas, les travaux, et généralement tous les secours, dont la culture profite, sont également diminués de 100 ; d’où résulte l’extinction d’une reproduction de 200, suivie de tous les maux progressifs dont je viens de parler.
Mais, nous dit-on, si la main-d’œuvre de ces salariés ne renchérit point, le désordre que j’expose ici n’aura plus lieu. Je veux bien qu’elle ne renchérisse point, à condition que vous trouverez un secret pour empêcher cette classe d’hommes de dépérir de jour en jour ; un secret pour lui procurer les moyens de faire la même dépense avec une moindre recette.
Examinez bien quel est l’état de tous ceux dont la profession est de servir aux différents travaux que la culture occasionne ; en général, vous ne verrez en eux que des hommes réduits à des consommations qu’on peut regarder comme l’étroit nécessaire ; il s’en faut bien qu’ils soient salariés en raison de l’utilité qui résulte de leurs travaux : leurs diverses professions sont communément d’une pratique si facile, qu’elles sont à la portée d’une multitude d’hommes, et d’hommes nés sans aucune sorte de richesses ; par cette raison, la grande concurrence de ces ouvriers qui se forment promptement et sans frais, tient nécessairement leurs salaires au plus bas prix possible, je veux dire, à un prix au-dessous duquel on ne trouve que l’indigence et la misère, fléaux toujours destructifs des classes d’hommes dont ils forment l’état habituel. [195] Voici donc un premier point évident : si les salaires des hommes en question n’augmentent pas en raison de l’impôt établi sur eux, vous verrez nécessairement cette espèce d’hommes se détruire ; et en cela, contradiction frappante dans notre hypothèse ; car il est moralement impossible que le prix d’une main-d’œuvre n’augmente pas, quand la concurrence des ouvriers diminue, et que le besoin qu’on en a, est un besoin indispensable. Il n’y a qu’une seule circonstance qui puisse permettre qu’en pareil cas cette augmentation n’ait pas lieu ; c’est que les ouvriers qui subsistent encore, soient tellement pressés par la nécessité, qu’ils ne puissent profiter du besoin qu’on a de leurs services ; mais aussi un tel état est-il un état de misère excessive, un état homicide des hommes nés et à naître ; bientôt ainsi, faute d’ouvriers, les travaux manquent à la culture, et l’on voit ses produits s’éteindre progressivement, comme les hommes dont les travaux sont nécessaires à la reproduction.
Cependant faisons violence à la nature ; supposons que la population soit toujours la même parmi les hommes employés à la culture, quoiqu’un impôt leur enlève une portion des salaires que la concurrence a réglés pour leur subsistance. Toujours est-il vrai que ces mêmes hommes ne pourront plus faire les mêmes consommations, à moins qu’ils n’achètent moins cher les productions qu’ils consomment : dans l’un et l’autre cas le contre-coup d’un tel impôt cause un préjudice égal au cultivateur : celui-ci perd en raison de la diminution du débit ou de la valeur vénale de ses productions.
Arrêtons-nous un moment à considérer les effets de ce contrecoup : si cette perte est imprévue pour le cultivateur ; si elle trompe les calculs des produits annuels qu’il a dû supposer en passant son bail, et que néanmoins il soit forcé de remplir rigoureusement les engagements qu’il a contractés par ce bail, il est clair que ce contrecoup, qui fait diminuer sa recette, sans faire diminuer ses frais, équivaut à un impôt anticipé qui serait établi sur ce cultivateur personnellement : on a vu ci-dessus quelle est la progression géométrique de la perte qui en résulte pour lui d’année en année, et comme cette perte progressive altère progressivement aussi la masse des productions, la richesse nationale et la population.
Formons donc l’hypothèse la moins défavorable, et supposons que la non valeur qui vient de survenir dans les productions, soit en déduction du produit net, dont le partage doit se faire entre le souverain et les propriétaires fonciers. J’observe d’abord qu’il est impossible d’évaluer cette non valeur ; car en général il règne une sorte d’équilibre nécessaire entre les prix de toutes les productions, de celles du moins qui se consomment en nature ou avec peu de préparations. On sent bien que les cultivateurs, autant que le physique [196] et leurs facultés pourront le permettre, cultiveront toujours par préférence les productions dont le débit sera le plus avantageux ; par conséquent que l’abondance de ces productions croissant en raison de cette préférence, il doit en résulter une diminution dans leur prix, jusqu’à ce qu’il soit rentré dans la proportion qu’il doit avoir avec les prix des autres productions.
Remarquez d’ailleurs que le prix d’une production est ce qui sert à payer le prix d’une autre production : celui qui n’a que des prés, ne paie ce qu’il consomme, qu’avec le prix qu’il retire de ses foins ; de même celui qui ne cueille que du blé ; de même celui qui ne cueille que du vin ; qui ne cueille que des légumes, que du bois, que de la laine, que du lin, etc. Ainsi quand il ne serait pas possible aux cultivateurs de changer de culture, dès que telle espèce de production diminue de prix, il n’en est pas moins nécessaire que le prix des autres productions diminue proportionnellement, car il se trouve alors qu’il y a moins de moyens pour les payer.
Les salaires des hommes consacrés aux travaux de la culture ou analogues à la culture, sont relatifs au prix courant des productions qu’ils consomment ; c’est sur ce prix courant que la concurrence règle leurs salaires, parce que les salaires sont le gage et le signe de la part qu’ils doivent prendre dans les productions : si donc, en conséquence d’un impôt qui leur enlève une portion de leurs salaires, le prix de ces productions diminue, les vendeurs de ces productions ne peuvent plus faire la même dépense en argent, ne peuvent plus mettre le même prix à ce qu’ils achètent ; ainsi de contre-coups en contre-coups, les prix de presque toutes les autres productions éprouvent une diminution proportionnelle ; et en vertu de cette diminution presque générale (car elle devient un mal épidémique, qui de proche en proche, occupe tout le territoire d’une nation) ; en vertu, dis-je, de cette diminution, le souverain et les propriétaires fonciers font une perte immense sur leurs revenus en argent ; perte qu’il est, comme je viens de le dire, impossible d’évaluer.
Heureusement nous n’avons pas besoin de cette évaluation pour arriver au but que je me suis proposé : l’argent étant reçu chez toutes les nations policées pour servir de mesure à toutes les valeurs, il est évident qu’une nation fait une perte réelle sur ses revenus, quand ses reproductions perdent de leur valeur en argent. Cette perte, il est vrai, ne serait rien, chez un peuple qui ne ferait aucune sorte de commerce avec les étrangers : mais aucun des peuples policés ne peut être dans ce cas : c’est donc dans les rapports d’une nation avec les autres nations par le moyen du commerce, que cette même perte se réalise ; c’est aussi dans ce point de vue que nous allons la considérer. [197] Les revenus communs du souverain et des propriétaires fonciers se dépensent, partie en achat de productions, et partie en achat des ouvrages de l’industrie. Si la diminution du prix des productions leur a fait perdre une portion de leurs revenus, on peut regarder comme une indemnité pour eux, la diminution de la dépense qu’ils font en achetant ces mêmes productions pour leur consommation. Mais une semblable indemnité n’a pas lieu pour la partie de ces revenus qu’ils emploient en achats des ouvrages de l’industrie, du moins relativement à tous ceux de ces mêmes ouvrages qui sont susceptibles d’être transportés et consommés chez l’étranger. La concurrence des étrangers dans l’achat de ces marchandises, fait qu’elles se maintiennent au prix courant de toutes les nations commerçantes, chez lesquelles ce prix courant se proportionne toujours à la bonne valeur que leurs productions ont en argent. Il est sensible, par exemple, que les manufacturiers des toiles et des draps ne les vendront pas dans la nation au-dessous de ce que l’étranger les leur paie, quoiqu’ils aient acheté de la nation les matières premières, ou les productions qu’ils consomment journellement, à des prix qui leur permettent de vendre moins cher.
Je sais qu’on peut m’objecter que les gains de ces fabricants en feront augmenter le nombre, et que leur concurrence fera renchérir les matières premières qu’ils emploient ; cela se peut, et je le crois. Mais qu’en résultera-t-il ? Il en résultera que les prix de ces productions seront affranchis de la diminution commune aux prix de toutes les autres productions qui se consomment dans la nation sans pouvoir être exportées ; par cette raison le préjudice national sera moins grand ; mais il le sera toujours beaucoup pour le souverain et les propriétaires fonciers ; car tandis que les productions territoriales dont la valeur vénale forme leur revenu commun en argent seront à bas prix, ils n’en paieront pas moins cher toutes les marchandises qu’ils seront dans le cas de tirer de l’étranger.
Tout ceci cependant n’est encore qu’un aperçu de ce même préjudice ; il faut l’envisager présentement dans les suites qu’il doit nécessairement avoir, et qui l’aggravent singulièrement. Vous voyez ici la classe industrieuse qui achète à bas prix les productions, sans qu’elle en vende moins cher ses ouvrages au souverain et aux propriétaires fonciers : il n’est donc pas possible que le souverain et les propriétaires fonciers, dont les revenus perdent en proportion de la non valeur des productions, achètent autant d’ouvrages de l’industrie, qu’ils pourraient en acheter, si leurs revenus en argent étaient plus considérables : alors la classe industrieuse se trouve dans le cas d’avoir besoin d’une plus grande exportation de ses marchandises ; par conséquent de faire de plus grands frais de débit ; car les [198] consommateurs éloignés achètent moins cher en raison des frais que les marchandises ont à faire avant de leur parvenir ; par ce moyen cette classe est constituée dans des dépenses dont elle ne peut s’indemniser que par le bas prix des productions qu’elle achète ; ainsi moins on consommera dans l’intérieur de la nation, et plus ce prix diminuera ; or plus il diminuera, et moins on consommera : essayez de couper cette chaîne circulaire de diminutions progressives : si vous ne commencez par en détruire le principe, je vous défie d’en arrêter le cours.
Le même inconvénient a lieu pour toutes les productions susceptibles d’être exportées en nature : la concurrence de l’étranger soutient chez vous leur valeur vénale ; mais, comme je viens de le dire, cette valeur perd toujours en raison des frais de transport ; frais que le prix de vos productions n’aurait point à supporter, si la diminution de vos revenus en argent ne vous avait mis dans l’impossibilité d’avoir chez vous des consommateurs en état de payer et de faire valoir ces mêmes productions : ainsi à cet égard, même cercle encore ; même progression dans la dégradation.
Voyez donc combien vos pertes se multiplient ; voyez quel enchaînement de désordres résultants d’une seule cause, d’un impôt établi sur les salaires des hommes entretenus par la culture ; cependant la progression nécessaire de ces désordres tient encore à d’autres contre-coups qui l’accélerent, et qu’il est aisé de vous rendre sensibles ; ce dernier tableau achèvera de vous démontrer qu’un tel impôt ne peut jamais être établi, quand ses effets seront évidents aux yeux du souverain et de la nation.
Vous avez dû remarquer que la diminution du prix des productions n’étant pas suivie d’une diminution semblable dans les prix des ouvrages de l’industrie, il en résulte que la classe industrieuse est dans le cas de s’enrichir aux dépens des propriétaires fonciers ; par conséquent que l’état du propriétaire foncier n’est plus, dans la société, le meilleur état possible ; que les hommes ne sont plus pressés de convertir leurs richesses mobilières en richesses foncières ; que la classe propriétaire des terres doit se trouver presque toujours sans intérêt, sans volonté, et sans moyens pour améliorer ses possessions, souvent même dans l’impuissance de subvenir aux dépenses nécessaires à leur exploitation : de là, la dégradation de ces mêmes possessions ; de là, une multitude de terres incultes ; de là, l’extinction progressive des revenus nationaux et de la population.
Pour se former une idée juste de la nécessité de cette progression, il faut observer qu’une fois que les revenus en argent sont diminués dans une nation, il se fait chez elle moins de dépenses en achat des ouvrages de l’industrie ; que la diminution des dépenses en cette [199] partie entraîne nécessairement une diminution dans la population ; que la diminution dans la population en occasionne nécessairement une autre dans la consommation des productions ; que de celle-ci résulte encore nécessairement une diminution nouvelle dans le débit ou la valeur en argent des productions, par conséquent dans ce qui forme les revenus en argent du souverain et des propriétaires fonciers : partez maintenant de ce dernier point ; vous allez décrire nécessairement un nouveau cercle de diminutions ; un nouveau cercle qui, par les mêmes raisons, sera nécessairement suivi d’un troisième ; ce troisième le sera nécessairement d’un quatrième ; et toujours ainsi croîtra nécessairement la détérioration, jusqu’à ce que vous en ayez fait cesser les causes, ou que tout soit détruit.
[II-168 / 200]
CHAPITRE XXXIII.↩
Les doubles emplois formés par les impôts indirects retombent tous sur les propriétaires fonciers. — Cette vérité démontrée par l’analyse des contre-coups d’un impôt sur les rentes et sur les loyers des maisons. — Le souverain paie lui-même une grande partie d’un tel impôt.
Tout impôt est payé par le produit des terres ; tout ce que l’impôt prend sur ce produit, après le partage fait avec le souverain, forme un double emploi ; tout double emploi retombe sur les propriétaires fonciers, avec déprédation de la richesse nationale et de tout ce qui constitue la puissance politique de l’État : voilà l’ordre des idées que j’ai voulu présenter. Les deux premières propositions sont déjà démontrées, et le double emploi résultant d’un tel impôt est évident. Nous avons vu pareillement que lorsqu’il frappe sur les richesses non disponibles, il éteint progressivement les revenus communs du souverain et des propriétaires fonciers, ainsi que la population : il ne reste donc plus à remplir qu’une partie de notre démonstration ; qu’à prouver que les doubles emplois qui s’opèrent par d’autres voies, sont aussi des charges sur la propriété foncière ; et qu’il n’est pas une de ces charges qui ne soit préjudiciable aux intérêts du souverain, quoiqu’elles ne le soient pas toutes au même degré.
Il est deux manières de diminuer un revenu : on peut en anéantir une partie ; on peut aussi faire augmenter les frais des jouissances auxquelles on emploie ce même revenu. On sent bien qu’il ne faut pas confondre une jouissance avec les frais qu’on fait pour se la procurer. Moins ces frais sont considérables, et plus on est riche ; car richesse et moyens de jouir ne sont qu’une même chose : or l’augmentation des frais à faire pour parvenir aux jouissances, est évidemment une diminution des moyens de jouir : aussi tel qui est riche dans un lieu, serait-il très mal aisé dans un autre où il serait obligé de payer beaucoup plus cher les choses qu’il voudrait consommer.
Parmi les impôts qui paraissent les plus étrangers aux propriétaires fonciers, il n’en est pas un qui n’ait un de ces deux inconvénients ou tous les deux à la fois ; pas un qui n’occasionne aux propriétaires fonciers ou la destruction d’une partie de leur revenu, ou l’augmentation des frais qu’ils ont à faire pour le convertir en jouissances, ou ces deux pertes en même temps : deux exemples suffiront pour établir évidemment ces vérités.
Je suppose deux lois, dont l’une fixe l’intérêt de l’argent à 5%, et l’autre assujettisse les rentes à un impôt du cinquième de leur [201] valeur : n’est-il pas vrai que ces deux lois combinées réduisent l’intérêt de l’argent à 4% pour le prêteur ; et que quiconque prêtera, comptera bien ne placer son argent qu’à 4% ?
Observez présentement que ces lois n’obligent pas de prêter ; que le prêt n’a lieu qu’autant que l’intérêt fixé par les lois convient au prêteur, que souvent aussi les prêts se font à un intérêt plus bas que celui qu’elles ont établi ; qu’elles peuvent, tout au plus, empêcher qu’on prête ouvertement à un intérêt plus fort qu’elles ne le permettent ; mais que leur pouvoir ne s’étend point jusqu’à faire prêter, quand cette façon de placer son argent ne paraît pas préférable à tout autre emploi ; car c’est là ce qui détermine la volonté des prêteurs.
Malgré les lois qui règlent l’intérêt de l’argent, l’action de prêter, et celle d’emprunter, sont des actions pleinement libres : je n’emprunterai pas au taux fixé par les lois, si je me vois lésé par une telle opération ; et quand personne ne voudra emprunter à 5% les prêteurs seront forcés de diminuer l’intérêt de l’argent. Quand personne aussi ne voudra prêter au-dessous de 5%, il faudra bien que l’intérêt de l’argent s’établisse sur ce pied. Dans toutes les opérations qui se font librement, la fixation de cet intérêt dépend donc beaucoup moins des lois, que de la concurrence des prêteurs et des emprunteurs ; il se règle naturellement entre eux, d’après le produit qu’on peut retirer de son argent dans d’autres emplois : voilà pourquoi les prêts se font souvent à un intérêt au-dessous de celui fixé par les lois ; et pourquoi, lorsque cet intérêt ne peut convenir aux prêteurs, les prêts n’ont lieu que dans des cas où l’on trouve moyen d’éluder la disposition des lois.
Ainsi quiconque se détermine librement et volontairement à placer son argent à 5% dont il en revient 1 à l’impôt, prêterait tout simplement à 4% si cet impôt ne lui prenait rien ; ainsi le cinquième de cette rente, remis à l’impôt, n’est point pris sur le rentier, mais bien sur le débiteur de cette rente ; ainsi ce cinquième n’est qu’une augmentation de dépense pour tous ceux qui ont besoin d’emprunter ; ainsi cette augmentation de dépense n’est qu’une surcharge établie sur le produit des terres, par la raison que toute dépense est acquittée par ce produit ; ainsi cette surcharge retombe sur les propriétaires fonciers, parce qu’elle augmente les frais qu’ils ont à faire pour convertir ce produit en jouissances.
Je ne crois pas devoir insister sur cette dernière conséquence ; elle doit être sensible, évidente pour quiconque sait qu’il n’y a que le produit des terres qui puisse annuellement fournir les fonds pour payer les rentes. D’après cette vérité, on comprend facilement qu’un impôt, qui tient l’intérêt de l’argent à un taux plus haut qu’il ne le [202] ferait sans cela, grève le débiteur de la rente : or ce débiteur est ou un propriétaire foncier ou un autre homme qui, en vertu des services qu’il rend à la classe propriétaire du produit des terres, partage dans ce produit : au premier cas, point de doute que la propriété foncière ne soit lésée d’autant ; au second cas, la cherté de l’argent que cet autre homme emprunte, est pour lui une augmentation de dépense, augmentation qui doit faire renchérir à proportion les services qu’il rend à la classe propriétaire : ainsi c’est toujours sur cette classe que tombe directement ou indirectement la cherté de l’argent.
Le second exemple que j’ai à proposer, c’est celui d’un impôt sur le loyer des maisons. S’il était plus utile d’employer son argent d’une toute autre manière qu’à bâtir ou acheter des maisons, personne assurément ne s’aviserait d’en faire la dépense, à moins que ce ne fût pour soi personnellement, et par une suite de l’impossibilité où l’on serait de se loger. Il est donc indispensable que l’emploi de l’argent en achat ou en construction de maisons, donne un intérêt proportionné à celui qu’on trouverait dans un autre emploi. De là résulte qu’il est de toute nécessité que le loyer des maisons renchérisse, si vous l’assujettissez à un impôt ; par conséquent que la jouissance d’une maison sujette à cet impôt, soit plus dispendieuse. Faites-la maintenant occuper par quel homme il vous plaira : si c’est un propriétaire foncier, il est évident qu’il sera grevé par le renchérissement nécessaire de son loyer ; si c’est un autre homme, quel qu’il puisse être, il ne peut payer qu’avec ce qu’il reçoit directement ou indirectement des propriétaires fonciers : ainsi de toute manière cet impôt n’est pour eux qu’une augmentation de dépense, et conséquemment une diminution de leur richesse.
Observez présentement que quand je dis que ces sortes d’impôts sont des charges qui retombent sur les propriétaires fonciers, il faut étendre cette proposition jusqu’au souverain personnellement ; car il est impossible que dans les dépenses qu’il fait par lui-même et par ceux qu’il entretient, il ne soit pas grevé par la cherté que de tels impôts occasionnent et entretiennent : ainsi ces mêmes impôts reprennent dans ses mains, une grande partie de ce qu’ils lui ont donné.
Il peut arriver cependant qu’un impôt sur les rentes et sur les loyers des maisons ne retombe point sur les propriétaires fonciers, et c’est le cas d’un impôt accidentel et imprévu. Mais si de tels évènements étaient assez fréquents pour qu’il en résultât ce qu’on appelle un risque pour les acquéreurs des rentes et des maisons, qui est-ce qui voudrait s’y exposer gratuitement ? On ne court un risque qu’autant qu’on est payé pour le courir : il faudrait donc que ce risque fût [203] balancé par de gros profits, qui ne pourraient être faits qu’aux dépens des propriétaires fonciers et du souverain.
Vous remarquerez ici, qu’un tel risque serait très réel, si l’on établissait arbitrairement des impôts personnels sur les rentiers et sur les propriétaires des maisons : au moyen de ces impôts arbitraires, ils se trouveraient avoir perdu la propriété des capitaux qu’ils auraient dépensés pour faire de telles acquisitions ; car ce n’est pas avoir la propriété d’un fonds, que de ne pas avoir la propriété de son produit. Un tel désordre mettrait donc les richesses pécuniaires dans le cas de chercher d’autres emplois, fût-ce même chez l’étranger, à moins, comme je viens de le dire, que le risque de placer ainsi son argent dans la nation, n’y trouvât des contre-poids qui seraient eux-mêmes un autre désordre à la charge du souverain et des propriétaires fonciers.
Il me semble entendre déjà une multitude d’hommes s’élever contre moi ; s’écrier qu’il serait bien singulier de prétendre que les rentiers et les propriétaires des maisons ne contribuassent point aux charges de l’État, ne payassent aucun impôt. Qu’ils me permettent de leur demander de quelles charges et de quel impôt ils entendent parler : si par le mot de charges, ils veulent désigner les charges annuelles et ordinaires, je leur répondrai que dans le système de l’ordre, personne n’y contribue ; que ces charges sont acquittées par le revenu public annuel, qui n’est qu’une portion déterminée dans le produit net des cultures ; que cette portion est une richesse commune, qui se renouvelle perpétuellement à mesure que les richesses particulières de chaque propriétaire foncier se renouvellent par la reproduction ; qu’ainsi c’est la terre qui paie elle-même l’impôt, en l’acquit de toute la nation. Ne voyez-vous pas, leur dirai-je, qu’on achète une rente ou une maison, comme on achète une terre ? Qu’on ne met un prix à celles-là, comme à celle-ci, qu’en raison du revenu qu’elles donnent à leur propriétaire ; qu’en les achetant on ne paie rien pour la portion que l’impôt prend chaque année dans ce revenu ; qu’on n’achètera pas les rentes et les maisons, ou qu’on les achètera moins cher, si vous les assujettissez à un impôt ; par conséquent que l’impôt, bien loin de porter sur ces acquéreurs, se trouvera toujours à la charge de ceux qui paient les rentes et les loyers ; en un mot, que le sort des rentiers et des propriétaires des maisons n’est pas, en cela, plus avantageux que celui des propriétaires fonciers, puisque ceux-ci ne paient point l’impôt.
Il n’en est pas ainsi des charges accidentelles et momentanées : il peut se trouver des circonstances impérieuses et passagères qui exigent des secours extraordinaires ; alors il n’est pas douteux que ces secours doivent être pris sur les rentes, comme sur les revenus des propriétaires fonciers : la raison en est bien simple : les rentes [204] sont une portion du produit net, c’est-à-dire, de la seule richesse qui soit disponible dans une nation, et qui puisse être employée aux besoins politiques de l’État : les rentiers doivent donc nécessairement être exposés à tous les évènements qui sont inséparablement attachés à la propriété de cette richesse disponible, et qui sont même dans l’ordre des opérations qui peuvent être nécessaires pour assurer ou faire valoir cette propriété.
Si dans de telles circonstances les rentes n’étaient pas imposées, l’intérêt commun du souverain et de la nation serait blessé ; et par contre-coup, l’intérêt particulier du rentier serait compromis : les rentes se trouveraient être une diminution des revenus de l’État ; diminution qui altérerait la force et la consistance de l’État ; diminution qui tournerait ainsi, de toute façon, au détriment de la propriété foncière, et par conséquent de la sûreté des rentes établies sur les produits nets de cette propriété.
Ce que je dis ici des rentiers ne peut cependant s’appliquer aux propriétaires des maisons : leurs loyers diffèrent des rentes, en ce qu’ils sont susceptibles de renchérir ; au lieu qu’une rente ne peut point augmenter au gré du rentier : le renchérissement est ainsi une voie toujours ouverte à ces propriétaires, pour faire reprise sur le produit de la culture, de tout ce qu’ils seraient obligés de payer à l’impôt ; ils ne pourraient donc en être personnellement chargés que jusqu’au moment du renouvellement des baux de leurs maisons : l’impôt alors retomberait sur ceux qui paient les loyers plus chers, et par contre-coup, sur les produits des propriétés foncières qu’on aurait cru soulager d’autant.
C’est ainsi qu’un impôt habituel et proportionnel sur les rentes et sur les loyers des maisons porte indirectement, partie sur les propriétaires fonciers, et partie sur le souverain : à l’égard des propriétaires fonciers, il est pour eux une diminution de richesses, parce qu’il est pour eux une augmentation des frais qu’ils ont à faire pour parvenir aux jouissances. Un tel impôt est donc non seulement un double emploi, mais encore un double emploi qui, lorsqu’il est arbitrairement établi sur la personne des rentiers ou des possesseurs des maisons, grève arbitrairement la propriété foncière, la réduit, pour ainsi dire, à n’être qu’un vain titre, et attaque ainsi dans son essence, l’ordre constitutif des sociétés. Par ces sortes d’impôts, on peut juger de tous ceux qui leur ressemblent ; de tous ceux qui ne sont point une portion prise directement et immédiatement dans le produit des terres : il est évident qu’il n’en est pas un qui ne devienne une charge indirecte sur les revenus des propriétaires fonciers, charge qui n’est allégée pour eux que par la portion que le souverain en supporte [205] personnellement, en quoi il est toujours trompé dans les calculs qu’il peut faire sur les produits de ces impôts.
Cependant, comme je l’ai déjà dit, les effets des impôts indirects ne sont point toujours les mêmes ; aussi les grands désordres qu’ils produisent, ne sont-ils pas les suites des doubles emplois dont je viens de parler : c’est principalement lorsque de tels impôts se trouvent assis immédiatement sur la personne ou les salaires des agents de l’industrie, que le mal qui en résulte, devient énorme, et ne cesse de s’accroître, tant qu’il est entretenu par le principe qui l’occasionne. La démonstration de cette dernière vérité achèvera de faire connaître évidemment combien le souverain personnellement et les sujets sont intéressés à ne point changer la forme essentielle de l’impôt, et conséquemment combien on doit être certain que dans le gouvernement d’un seul, dès qu’on y suppose l’évidence de cet intérêt publiquement établie, on n’a rien à craindre des abus qui résulteraient d’un tel changement.
[II-183 / 206]
CHAPITRE XXXIV.↩
Doubles emplois résultants des impôts sur les salaires de l’industrie, ou sur la vente des choses commerçables ; ils retombent tous à la charge du propriétaire foncier et du souverain, en raison de la portion que chacun d’eux prend dans le produit net des cultures. — Ces impôts sont dans tous les cas possibles, progressivement et nécessairement destructifs des revenus de la nation, de ceux du souverain, et de la population.
Rappelez-vous ce que j’ai précédemment observé sur la nécessité dont il est que la distribution et la consommation des productions se fassent dans une proportion dont il puisse résulter un avantage commun à ceux qui les font renaître et à la classe industrieuse ; rappelez-vous que toutes les productions qui ne peuvent être consommées en nature par leurs premiers propriétaires, ne leur deviennent utiles que par l’entremise des travaux de l’industrie ; rappelezvous que les salaires ou les prix payés pour ces travaux ne sont que des portions prises dans ses productions en nature, ou, ce qui revient au même, dans leur valeur en argent ; rappelez-vous que la mesure de chacune de ces portions n’a rien d’arbitraire ; qu’elles sont au contraire toutes déterminées par l’autorité despotique de la concurrence, qui, pour l’intérêt commun de toute la société, fait ainsi régner l’ordre le plus avantageux dans la distribution et la consommation des productions ; ordre qui ne peut plus subsister, dès qu’un impôt vient dénaturer les proportions suivant lesquelles la concurrence a fait faire cette distribution.
Tout homme qui par ses travaux et ses dépenses, se procure plus de productions qu’il n’en peut consommer en nature, se propose nécessairement de changer la forme de cet excédent, de le convertir en ouvrages de l’industrie ; d’un autre côté, ceux qui se consacrent aux professions relatives à ces ouvrages, comptent certainement sur l’échange de leur main-d’œuvre contre des productions. Il faut donc nécessairement qu’il y ait une proportion établie entre la valeur vénale des productions et la valeur vénale des ouvrages de l’industrie : ce n’est que d’après cette proportion, que chacun peut se déterminer sur l’emploi de sa personne, de ses richesses mobilières et de ses talents.
Remarquez bien la nécessité de cet équilibre qui doit régner entre le prix des productions et celui des travaux de main-d’œuvre. Inutile d’examiner lequel des deux commande le premier à l’autre : le point essentiel à saisir, c’est qu’ils sont tous deux dans une dépendance réciproque ; qu’ils se servent mutuellement de mesure ; et que vous [207] ne pouvez changer l’ordre de leurs rapports, qu’au détriment commun de tous les intérêts que nous cherchons le plus à ménager.
Cet équilibre dont je veux ici vous faire comprendre toute la nécessité, n’a rien de mystérieux : pourquoi cet artisan me paie-t-il la mesure de mon blé 30 sols ? C’est parce que ses salaires le lui permettent : et qui est-ce qui lui paie ces salaires ? Les premiers propriétaires de la valeur des productions, ou d’autres hommes à qui déjà ils ont distribué une partie de cette valeur. Retranchez la moitié de ces salaires : cet artisan ne peut plus me payer mon blé au même prix, à moins qu’il ne diminue la somme des achats qu’il fait à d’autres vendeurs ; mais dans ce cas, ces autres vendeurs n’auront plus les mêmes moyens pour acheter mon blé : c’est toujours le même inconvénient, le même contre-coup. Le mouvement de l’argent n’est qu’une circulation, suivant laquelle chacun doit en recevoir autant qu’il en donne, et chacun doit en donner autant qu’il en reçoit. Suivez cette circulation dans toutes ses branches ; vous verrez facilement que la classe industrieuse ne peut mettre un prix aux productions, qu’en raison du prix que leurs premiers propriétaires mettent à sa main-d’œuvre ; qu’ils ne peuvent mettre un prix à sa main-d’œuvre, qu’en raison de celui auquel ils vendent aussi leurs productions ; qu’ainsi ce sont ces premiers propriétaires qui fournissent eux-mêmes à cette classe, les valeurs en argent avec lesquelles elle paie les productions : aussi est-ce parce que tous les salaires sont payés par les valeurs des productions, que nous avons donné le nom de double emploi, à tout impôt qui se trouve établi sur les salaires.
De ces observations il résulte que dans une nation qui ne ferait aucune sorte de commerce extérieur, qui dans ses dépenses n’aurait aucune sorte de relation avec les étrangers, il serait très indifférent que les productions eussent une grande valeur en argent, ou qu’elles n’en eussent qu’une médiocre ; ce dernier même serait plus avantageux, parce qu’il y aurait moins d’embarras dans le transport de l’argent pour faire ses paiements : quelle que fût cette valeur en argent, celle des travaux de main-d’œuvre se mettrait au niveau, et l’équilibre nécessaire se maintiendrait également.
Mais pour peu qu’une nation fasse quelque commerce extérieur, la valeur vénale des productions devient une chose très intéressante ; parce que cette valeur est ce qui décide du plus ou du moins des productions territoriales qu’elle doit donner en échange des marchandises étrangères. Il est donc, par contre-coup, d’une égale importance pour elle, que les salaires proportionnels de l’industrie ne soient point altérés par une force majeure ; car ce sont ces mêmes salaires qui, placés dans les mains de l’industrie, sont destinés à [208] maintenir la valeur des productions ; valeur qui d’ailleurs est la seule et unique richesse disponible pour le souverain et la nation.
Pour mieux démontrer ces vérités et les conséquences qui en résultent, parcourons les différents désordres qui naissent nécessairement à la suite du double emploi formé par un impôt sur les agents de l’industrie. Cet impôt ne peut être acquitté que par une partie de leurs salaires : cela est évident. Mais alors veut-on que les salaires augmentent, ou veut-on qu’ils n’augmentent pas ? Chacune de ces deux hypothèses demande un examen particulier.
Si les salaires augmentent, il est clair que l’impôt retombe à la charge de ceux qui les paient ; et qui sont-ils ? D’abord le souverain ; par conséquent il se trouve lui-même supporter une partie de cet impôt, en raison du renchérissement des ouvrages de l’industrie, qu’il achète pour sa consommation personnelle ou celle des hommes qui sont à ses gages ; ensuite les propriétaires fonciers, qui en cela, se trouvent très réellement privés d’une portion du revenu ou des jouissances qui doivent leur appartenir en propriété ; enfin les cultivateurs, qui par eux-mêmes et par leurs entretenus, sont dans le cas de faire divers achats à la classe industrieuse.
Un impôt sur les salaires de l’industrie, et qui les fait augmenter, est donc un impôt indirect, non seulement sur le souverain et sur les propriétaires fonciers, mais encore sur les cultivateurs ; aussi ce dernier contre-coup est-il la principale cause des maux progressifs que cet impôt entraîne nécessairement après lui. L’augmentation qu’il occasionne dans les dépenses des cultivateurs, est une diminution réelle de la masse des richesses productives ; un tel impôt est donc destructif de la reproduction, en raison doublée de ce qu’il prend indirectement sur les avances ; je veux dire que s’il coûte un million aux cultivateurs, il éteint une reproduction qui vaudrait au moins 2 millions.
Je ne répéterai point ici que si les cultivateurs ne sont pas indemnisés du vide que le détournement d’une partie de leurs avances occasionne ainsi dans la masse totale de la reproduction, il faudra qu’ils se ruinent, et que la culture tombe dans un état de dégradation progressive : je suppose au contraire qu’ils aient calculé le contrecoup de cet impôt, et que leurs baux soient analogues au résultat de ce calcul : dans ce cas, le produit net se trouvera nécessairement diminué du double de ce que l’impôt prend indirectement sur les cultivateurs. Mais dès lors nous découvrons un désordre dont la progression est évidente : les propriétaires fonciers se trouvent tout à la fois avoir un moindre revenu, et néanmoins payer plus cher une partie des choses qu’ils consomment ; il est donc indispensable qu’ils diminuent doublement leurs consommations ; par conséquent qu’ils [209] ne fassent point assez d’achats à la classe industrieuse, pour qu’elle puisse s’indemniser avec eux des sommes qu’elle paie à l’impôt.
Bien des gens cependant se persuadent que la masse totale des achats faits à cette classe industrieuse, sera toujours assez considérable pour que ses agents puissent se dédommager de l’impôt, par la voie du renchérissement de leurs marchandises. La raison vague qu’ils en rendent, est que si les propriétaires fonciers consomment moins, le souverain, disent-ils, consommera plus, soit par lui-même personnellement, soit par ses entretenus. Mais un calcul très simple peut mettre cette erreur dans une grande évidence.
Considérons le revenu du souverain et celui des propriétaires fonciers, comme ne formant qu’une seule masse, qui paie les deux tiers des ouvrages que vend la classe industrieuse ; en conséquence, supposons que les cultivateurs joints avec les hommes qu’ils entretiennent, achètent l’autre tiers de ces ouvrages. Notre hypothèse ainsi présentée, soit 30 le total d’un impôt établi sur les salaires de l’industrie, renchérissant par conséquent de 30 ces mêmes salaires : n’est-il pas vrai que ce renchérissement coûte 10 aux cultivateurs, puisqu’ils achètent le tiers des ouvrages renchéris de 30 ? N’est-il pas vrai que ces 10 dérobés aux avances de la culture, éteignent une reproduction de 20 ? N’est-il pas vrai qu’en suivant notre supposition, il doit en résulter une diminution de 20 dans le revenu commun du souverain et des propriétaires fonciers ? Quel est donc présentement l’état de ce revenu ? D’un côté, il augmente de 30 par un impôt sur les salaires ; d’un autre côté, il diminue de 20 par l’extinction de la reproduction ; le bénéfice net qu’il retire de cet impôt, n’est donc que 10. Observez maintenant que ce revenu doit payer les deux tiers des ouvrages de l’industrie, conséquemment que le renchérissement des salaires doit lui coûter 20 ; mais comment peut-il augmenter de 20 sa dépense, tandis que sa recette n’augmente que de 10 ? Impossible donc qu’il puisse les fournir, impossible que sur les 30 pris par l’impôt, il n’y en ait pas 10 qui soient en pure perte pour la classe industrieuse qui les a déboursés.
De quelque côté que vous jetiez les yeux, vous n’apercevez présentement que détérioration, et détérioration progressive : quoique le revenu commun du souverain et des propriétaires fonciers soit augmenté de 10 en argent, ils sont cependant moins riches qu’ils ne l’étaient auparavant, parce que les choses qu’ils achètent sont, en total, renchéries de 20 pour eux. Ils sont donc obligés de consommer moins ; conséquemment d’entretenir moins d’hommes en faisant cependant une dépense plus forte en argent. Tandis que la population s’affaiblit par ce moyen, vous voyez aussi que la classe industrieuse perd, sans retour, le tiers de l’impôt qu’elle paie, et qu’elle [210] fera toujours la même perte tant que le même impôt subsistera : il faut donc que d’année en année les richesses de cette classe, le nombre de ses agents et ses consommations diminuent ; par conséquent que d’année en année on voie grossir la quantité des productions qui, dans l’intérieur de la nation, manquent de consommateurs en état de les payer. Ainsi la décadence progressive de la classe industrieuse va réfléchir sur la reproduction, et la décadence progressive de la reproduction va réfléchir sur la classe industrieuse : ces deux désordres vont, pour ainsi dire, se donner la main, pour accélérer mutuellement la rapidité de leur progression.
Peut-être, me direz-vous, que la classe industrieuse a la ressource de vendre aux étrangers : mais les étrangers ne lui tiendront pas compte de l’impôt ; ne se prêteront pas au renchérissement de ses ouvrages pour raison de l’impôt ; ainsi elle sera toujours en perte. D’ailleurs les étrangers n’achèteront pas toujours en argent ; il faudra donc que cette classe reçoive d’eux aussi des marchandises en paiement ; mais quand elle les aura reçues, qu’est-ce qu’elle en fera ? Dans notre hypothèse tout le revenu national est déjà dépensé ; où donc trouvera-t-elle, dans la nation, des consommateurs auxquels elle puisse revendre ces marchandises étrangères pour recouvrer les 10 en argent dont elle est en perte : elles resteront invendues, comme l’auraient été celles auxquelles elles se trouveront substituées ; et la classe industrieuse aura dépensé de plus les frais qu’une telle opération entraîne nécessairement après elle.
Si je me permettais d’entrer dans de plus grands détails, je démontrerais par le calcul, qu’il n’y a pas une partie du corps politique qui n’éprouve quelque préjudice à l’occasion de la diminution qui survient dans la reproduction, et qu’il n’y a pas un préjudice particulier qui ne devienne à son tour un préjudice commun, d’où résulte qu’ils concourent tous mutuellement à leur progression. Mais sans nous appesantir sur cette démonstration, il suffit d’en indiquer le principe ; de faire voir que l’ordre qui doit régner dans la circulation des valeurs en argent, est interrompu ; que l’impôt s’approprie une portion de ces valeurs avant qu’elles aient été employées aux dépenses de la reproduction ; que par ce moyen la reproduction ne peut plus les rendre annuellement à ceux qui les ont données à l’impôt ; qu’ainsi chaque année le vice de cette circulation leur occasionne une nouvelle perte dont ils ne peuvent être dédommagés, parce que rien ne peut suppléer la reproduction, source unique où les dépenses peuvent puiser les moyens de se renouveler.
Voulez-vous présentement partager le revenu national pour en former le revenu public, et considérer séparément les effets d’un tel impôt par rapport au souverain en particulier ? Sur le produit total [211] de l’imposition trois articles à déduire : 1°. les frais de la perception ; 2°. la diminution que le souverain éprouve dans son revenu direct ; 3°. la perte que lui cause le renchérissement des ouvrages de l’industrie. Malgré cela, je vous accorde que le revenu du souverain est d’abord augmenté : mais combien subsistera cette augmentation ? À mesure que la classe industrieuse s’éteindra, ne faudra-t-il pas que le produit total de cet impôt diminue, sans cependant que le renchérissement cesse d’être le même dans ses détails ? Ne faudra-t-il pas qu’en même temps son revenu direct décroisse faute d’un débit suffisant pour les productions nationales, dont la valeur vénale forme ce revenu ? Ne faudra-t-il pas que cette double diminution dans son revenu influe sur ses achats à la classe industrieuse, et qu’en cette partie il se fasse un vide qui croisse de jour en jour ? Voulez-vous qu’en raison des contribuables qui disparaissent à la classe industrieuse, on augmente les cotisations particulières de ceux qui sont encore existants ? Analysez cette prétendue ressource et ses contre-coups ; vous trouverez qu’elle n’est qu’un moyen de hâter la dégradation ; qu’il doit en être alors de la progression de ce désordre, comme de la chute des corps, dont le mouvement s’accélère en raison de leur pesanteur, et se multiplie par le quarré des temps.
Nous avons déjà de si bons ouvrages modernes sur cette matière, que je crois devoir ne pas m’y arrêter plus longtemps, quoique j’en laisse à dire beaucoup plus encore que je n’en dis ; mais mon objet n’est point de faire un traité particulier de l’impôt : je me dépêche donc d’examiner la seconde branche de notre alternative ; de voir ce qui résultera d’un impôt sur les salaires de l’industrie, en supposant qu’ils ne renchérissent pas.
Chaque homme de la classe industrieuse ne consomme qu’en raison de ses salaires : ainsi retrancher ses salaires, c’est retrancher ses consommations. Mais si ses consommations diminuent, qui estce qui les remplacera ? Et comment les premiers vendeurs des productions pourront-ils s’en procurer le débit à un bon prix ? Ne vous figurez pas pouvoir à cet égard substituer les entretenus par l’impôt aux agents de l’industrie : premièrement, il n’est pas possible que les consommations de ceux-là soient les mêmes que les consommations de ceux-ci ; en second lieu, la marche de ces consommations est absolument différente.
Le produit d’un impôt sur les salaires se cantonne, se distribue à un certain nombre de consommateurs, qui sont ordinairement rassemblés dans un même lieu, ou du moins dans quelques lieux particuliers ; par ce moyen la consommation se trouve éloignée du lieu de la reproduction. Or il est certain que les productions perdent nécessairement de leur valeur vénale en proportion des frais qu’elles [212] ont à faire pour aller trouver les consommateurs. Ajoutez à cela qu’il est beaucoup de productions qui par leur nature, ne sont pas propres à être transportées, beaucoup encore qui à raison de leur volume, de leur pesanteur, et de la modicité de leur valeur première, ne sont pas susceptibles d’un transport qui deviendrait si dispendieux, qu’il n’en résulterait que des dépenses en pure perte pour ceux qui se proposeraient de s’en procurer ainsi le débit.
Une fois que vous apercevez dans une nation, une multitude de productions qui manquent d’un débit suffisant, vous tenez le germe d’une dégradation nécessairement progressive, lorsque l’insuffisance du débit est occasionnée, comme dans notre hypothèse, par une cause qui détruit la proportion qui doit régner entre la valeur vénale des productions et celle des travaux de main-d’œuvre. Dans une telle position, si ceux qui achètent ces travaux les paient toujours au même prix, ils ne peuvent en acheter la même quantité, parce qu’ils ont un moindre revenu : alors les agents de l’industrie reçoivent moins de salaires, et cependant n’en ont pas moins le même impôt à payer. Ainsi dans cette hypothèse, où ces travaux ne renchérissent point, l’impôt sur leurs salaires forme un contraste singulier : plus il prend sur les salaires, et plus il les fait diminuer ; j’entends que plus les agents de l’industrie paient à l’impôt, et moins ils ont de salaires à recevoir, parce que la diminution de leurs consommations en occasionne une autre dans les revenus de ceux qui leur paient ces salaires.
Le produit d’un tel impôt peut, il est vrai, se reverser dans la nation, et de ce reversement on verra résulter des consommations. Mais pour couper court à tous les mauvais raisonnements qu’on pourrait faire à ce sujet, il suffit de faire observer que ce reversement ne peut rendre à la consommation que les sommes prises par l’impôt sur les salaires : il ne dédommage donc point de toutes les non valeurs dont je viens de parler, et qu’il occasionne dans la vente d’une partie des productions. Ces non valeurs sont des pertes sèches, qui diminuent d’autant les moyens qu’on avait pour payer et faire valoir les autres productions, ainsi que les travaux de la maind’œuvre. Il n’est donc pas possible qu’il y ait après l’impôt, une distribution de salaires égale à celle qui se faisait avant l’impôt : cela posé, tant que le même impôt subsistera, le mal croîtra progressivement, parce que la consommation des agents de l’industrie diminuera de plus en plus, sans être remplacée ; et qu’ainsi de plus en plus le débit ou la valeur vénale des productions, les revenus et la masse des salaires diminueront.
Une autre observation importante à faire sur le reversement fait par le souverain, des sommes que lui fournit un impôt levé sur les [213] salaires, c’est que ce reversement est en partie chimérique : une partie de ces sommes peut bien être employée à acheter en nature une portion des productions que les agents de l’industrie ne peuvent plus consommer ; mais l’autre partie de ces sommes ne peut être pareillement employée en achats d’ouvrages de l’industrie fabriqués dans la nation. Pour que les vendeurs de ces ouvrages pussent faire ainsi repasser dans leurs mains cette partie des sommes qu’ils ont payées à l’impôt, il faudrait qu’ils eussent des marchandises à donner en échange de cet argent ; qu’ils échangeassent valeurs pour valeurs, ce qui leur est physiquement impossible, dès que leur maind’œuvre ne renchérit point ; et quand ils le pourraient, donnant deux fois pour ne recevoir qu’une, ils seraient toujours en perte.
Faites attention à cette dernière observation ; elle est d’une force et d’une simplicité singulière : vous me forcez de vous donner 10 francs, et avec ces 10 francs, vous venez m’acheter une marchandise de la même valeur : mais pourquoi cette marchandise vaut-elle 10 francs ? C’est parce que ce prix lui est fixé par la concurrence comme étant son prix nécessaire, son prix relatif aux dépenses nécessaires de ceux qui parviennent à la mettre en vente. Cette marchandise est donc, dans mes mains, représentative d’une valeur de 10 francs que j’ai dépensés ; ainsi quand je vous la vend, je vous livre une valeur de 10 francs ; par ce moyen les 10 francs d’argent que je vous avais donnés, et que vous me rendez en échange de ma marchandise, n’empêchent point que je sois en perte de cette somme tout aussi réellement que quand un autre me prend pareille marchandise sans la payer. Il faut donc qu’une telle opération me ruine progressivement.
Soit dans une nation la valeur de la main-d’œuvre égale à 100, prix fixé par la concurrence ; prenez-en 20 pour l’impôt, et de ces 20 employez-en une portion en achat de productions, toujours est-il vrai que l’autre portion ne pourra plus circuler dans cette nation, et qu’il faudra qu’elle passe à l’étranger pour y acheter d’autres ouvrages de main-d’œuvre. Mais, dira-t-on, les ouvriers travailleront davantage : vaine supposition ; car avant l’impôt, chacun d’eux était forcé, par la concurrence, de travailler autant qu’il était en son pouvoir. D’ailleurs comme il n’y a point, après l’impôt, plus de matières à employer qu’il y en avait auparavant, si chaque ouvrier pouvait travailler plus longtemps, il y aurait moins d’hommes salariés, moins de consommations faites par conséquent. C’est une autre voie qui nous conduit au même désordre.
Ainsi quelque ressource que nous imaginions, nous n’en trouverons point qui puisse empêcher que de la diminution des salaires il ne résulte une diminution des revenus, et que de la diminution des [214] revenus il ne résulte une nouvelle diminution des salaires. On conçoit bien qu’un tel enchaînement doit bientôt être suivi d’un décroissement progressif de la population, autre principe d’une nouvelle diminution progressive dans le débit des productions territoriales, dans les revenus de la nation et du souverain. Ce décroissement sera même d’autant plus prompt, que l’industrie est cosmopolite ; elle ne connaît de patrie que les lieux où elle est appelée par son intérêt particulier ; sa devise est ubi bene, ibi patria : la nature le veut ainsi.
Cependant si vous forcez l’industrie de s’éloigner de vous, il va se trouver encore, dans la nation, moins de consommateurs en état de payer vos productions, et moins de moyens pour les convertir en jouissances : vous serez obligés d’aller chercher au loin des consommateurs étrangers, qui vous déduiront les frais d’exportation ; et les marchandises étrangères dont vous voudrez jouir en retour, seront grevées aussi des frais d’importation. Vous croirez peut-être que le commerce extérieur rétablira la valeur vénale de vos productions ; mais cette espérance ne peut avoir lieu que pour celles qui seraient susceptibles d’être transportées chez l’étranger, encore faudrait-il à cet égard défalquer les frais qu’elles ont à faire avant d’y arriver. D’ailleurs entre les premiers propriétaires de ces productions et les consommateurs étrangers ne faut-il pas qu’il y ait des agents intermédiaires, des commerçants, qui auront grand intérêt à tenir vos productions à bas prix pour vous, afin de gagner plus, en les revendant au prix courant des autres nations.
Vous voyez donc que vos ressources mêmes sont pour vous de nouvelles causes d’une dégradation progressive ; que vous ne gagnez rien à supposer qu’un impôt sur les salaires ne les fera point renchérir ; que cette seconde hypothèse ne diffère de la première que par la marche de ses inconvénients ; et que dans tous les cas un impôt sur les salaires est progressivement destructif de la richesse nationale et de la population.
Parmi les diverses manières de mettre un impôt sur les salaires, il en est une à laquelle on a donné le nom d’impôt sur les consommations. Sous ce titre, cette forme d’imposition a pris faveur dans l’opinion d’une multitude de personnes à qui ce nom a fait illusion : le paiement de cet impôt leur a paru n’avoir aucun inconvénient, parce qu’il leur a paru libre et volontaire, du moins tant que cet impôt ne porte point sur les choses qu’on regarde comme étant de premier besoin. Ainsi dans leur système on peut établir un tel impôt sur mon vin, et non sur mon blé : mais ils ne voient pas que le salarié qui achète mon blé, ne peut le payer qu’avec l’argent que je lui donne pour ses salaires, et qui provient en partie de la vente de mon vin ; ils ne voient pas que le prix d’une denrée est ce qui sert à payer [215] et faire valoir le prix d’une autre denrée ; par conséquent que tout ce qui tend à faire diminuer la valeur vénale et l’abondance d’une production, devient un préjudice commun à la valeur vénale et à l’abondance de toutes les autres productions.
Un impôt sur les consommations n’est qu’un impôt sur les moyens de consommer. Le propre d’un tel impôt est donc de faire diminuer la consommation ou la valeur vénale des marchandises sur lesquelles il est établi. Dans les deux cas le premier vendeur de ces marchandises est également en perte ; mais le dernier cas est celui qui doit naturellement arriver, parce qu’on veut vendre à quelque prix que ce soit ; que d’ailleurs la diminution du prix d’une marchandise est une suite nécessaire de la diminution de son débit.
Cette règle cependant n’a pas lieu par rapport aux marchandises qu’on tire de l’étranger : il faut ou s’en passer ou les payer au prix courant des autres nations. Elles renchérissent donc dans une nation chez laquelle elles ne peuvent entrer qu’en payant des droits. Mais ce que ce renchérissement coûte à chaque consommateur de ces marchandises étrangères, est en déduction des dépenses qu’il ferait en achat de marchandises nationales ; il faut qu’il achète celles-ci ou à plus bas prix ou en moindre quantité. Un tel impôt tourne donc au détriment du débit, de la valeur vénale et de l’abondance des productions nationales ; il est par conséquent destructif du revenu du souverain, de celui de la nation, et de la population.
À l’égard d’un impôt sur la vente des productions cueillies dans l’intérieur de la nation, et dont le commerce reste libre cependant entre le vendeur et l’acheteur, comme il n’est pas possible d’y assujettir toute une même espèce de production, il en résulte un inconvénient singulier : cette marchandise diminue de prix non seulement pour les consommateurs qui ne peuvent se la procurer qu’en payant des droits ; mais encore pour tous les autres qui n’ont point de droits à payer, en supposant néanmoins que cette production ait besoin de cette première classe de consommateurs.
Chaque lieu où se cueille une production est une sorte de marché public formé par la concurrence des vendeurs : là, chacun achète au même prix, toutes choses égales d’ailleurs ; et la concurrence des acheteurs établit un prix courant qui devient une loi commune : que vous ayez des droits à payer après l’achat, ou que vous n’en ayez point, vous n’achetez ni plus cher ni à meilleur marché. Ainsi dès que parmi les consommateurs dont le débit d’une production a nécessairement besoin, il s’en trouve qui sont chargés de payer des droits, ils sont forcés de diminuer le premier prix d’achat ; et cette diminution fait tomber également le prix courant de cette production pour tous les autres acheteurs. [216] Je dis que les consommateurs sujets aux droits sont forcés de diminuer le premier prix d’achat, et cela est facile à concevoir : l’établissement de ces droits n’augmente point, dans ces consommateurs, les moyens qu’ils avaient pour dépenser ; il faut donc qu’ils achètent cette production moins cher, ou qu’ils en achètent une moindre quantité : mais s’ils en achètent une moindre quantité, la surabondance de cette production en fait nécessairement diminuer la valeur.
Impossible donc d’empêcher que le prix de cette production ne diminue, et ne diminue pour tous les acheteurs indistinctement. Cela posé, voyez quelle disproportion énorme entre le revenu qu’une telle imposition peut donner au souverain, et les préjudices qu’elle lui cause ainsi qu’à la nation ; qu’il y ait seulement les deux tiers d’une telle production qui ne soient point sujets aux droits, il est évident que l’impôt devient nul pour le souverain, puisqu’il en résulte l’extinction d’une valeur qui vaudrait trois fois l’impôt, et dans laquelle le souverain prendrait le tiers. L’impôt alors pour donner 10, éteint 30 et dans ces 30 qui seraient un produit net, 10 appartiendraient au souverain : il est donc évidemment en perte, si cet impôt n’est établi que sur une partie qui ne soit pas le tiers de la production.
Cette première perte cependant n’est rien encore en comparaison de celles que ses contre-coups occasionnent : au moyen de ce qu’il est dans la nation une production dont la valeur vénale éprouve une diminution considérable, tous les premiers propriétaires de cette production se trouvent jouir d’un moindre revenu ; ils sont par conséquent moins en état d’acheter et de faire valoir les autres productions ; il faut donc qu’elles perdent aussi proportionnellement de leur valeur vénale ; en conséquence, qu’il se fasse une diminution prodigieuse dans toutes les valeurs qui concourent à former le revenu de la nation et celui du souverain.
Suivez maintenant les contre-coups de cette diminution des revenus par rapport aux salaires de l’industrie et à la population qu’elle détruit ; du dépérissement de celle-ci passez au vide qui doit en résulter dans ses consommations, et de là au nouveau préjudice que ce vide doit, à son tour, causer au débit et à la valeur vénale des productions ; vous retrouverez ainsi cet enchaînement de dégradations progressives qui sont successivement occasionnées les unes par les autres, et sur lesquelles on ne conçoit pas que les hommes puissent longtemps s’aveugler ; surtout quand les cultures se détériorent de jour en jour, par l’impossibilité dont il est que la faiblesse des produits nets puissent entretenir dans les mains des propriétaires fonciers et des cultivateurs, des richesses suffisantes pour toutes les dépenses relatives à l’exploitation. [217] Il est donc dans la nature même de cette sorte d’impôt d’appauvrir le souverain au lieu de l’enrichir : impossible par conséquent qu’un tel impôt soit mis en pratique, quand les effets qu’il produit nécessairement seront publiquement et évidemment connus. Il est même un inconvénient particulier qui lui est propre, et qui seul doit suffire pour le faire proscrire à jamais, dès qu’on sera convaincu que les doubles emplois qu’il forme, retombent en entier sur les propriétaires fonciers, à la réserve de la portion que le souverain en supporte personnellement. Cet inconvénient particulier est celui des frais prodigieux dont on ne peut exempter la régie de cet impôt.
Je comprends sous le nom de frais, non seulement ceux qui sont inséparables de cette régie, mais encore le prix du temps que ses formalités font perdre au commerce ; les avaries et les augmentations de dépenses que les visites et les entrepôts occasionnent ; les procédures et les vexations auxquelles cet ensemble doit donner lieu ; les manœuvres de toute sorte qui tendent à détourner de sa destination, une portion du produit même de l’impôt. Quelle que soit la somme à laquelle peuvent monter tous ces objets cumulés, il est certain qu’elle ne peut être qu’un objet très important ; il est certain que l’impôt dont il s’agit, doit augmenter en proportion de ces mêmes frais, pour que le souverain puisse se procurer, par cette voie, les fonds dont il a besoin ; il est certain que par ce moyen, l’impôt sur les choses commerçables se trouve réunir en lui nombre d’inconvénients majeurs qui lui sont particuliers, et tous ceux encore qui sont attachés à l’impôt sur les personnes ; il est certain que cette multitude de frais ne peut être acquittée que par le produit net, et que si le souverain doit prendre le tiers dans ce produit, il se trouve payer le tiers de ces frais ; il est certain enfin que le tiers des dégradations que les contre-coups de ces frais doivent occasionner dans le produit net, est encore à la charge du souverain ; qu’ainsi il lui est impossible de regarder un tel impôt comme une ressource pour lui, puisque le produit d’une telle ressource est absorbé par les pertes qu’elle occasionne, et qui bientôt font progressivement diminuer ses revenus au lieu de les augmenter.
Tels sont donc les inconvénients qu’on éprouve dès qu’on veut changer la forme directe et naturelle de l’impôt : je crois que leur évidence suffit pour remplir l’objet que je me suis proposé ; pour démontrer que cette forme est une forme essentielle ; une forme dont les intérêts communs du souverain et de la nation ne permettront jamais qu’on s’écarte, lorsqu’on sera convaincu des maux affreux qui doivent en résulter. Un tel désordre n’est certainement point à craindre dans un État monarchique parvenu à une connaissance évidente et publique de l’ordre, parce que l’unique intérêt de l’autorité [218] gouvernante, de cette autorité qui réunit à elle toutes les volontés, est que cet ordre soit suivi. Aussi par cette raison le gouvernement monarchique serait-il le plus propre à rétablir ce même ordre, lorsqu’il aurait reconnu qu’on s’en serait écarté : il est sensible qu’un tel avantage ne peut se trouver dans tout autre gouvernement ; car pour rentrer dans l’ordre il faudrait qu’il commençât par devenir monarchique ; le despotisme de l’ordre ne pouvant jamais s’établir solidement que dans une monarchie, seule et unique forme de gouvernement où l’intérêt personnel du souverain est nécessairement un intérêt commun avec toute la nation ; seule et unique forme de gouvernement où l’État gouvernant ne peut jamais avoir de plus grand intérêt que celui de bien gouverner.
Nous devons voir avec douleur que les hommes aient si longtemps ignoré des vérités si simples, si précieuses à tous les membres d’une société. Ce malheur est d’autant plus grand, qu’une fois que les générations passées se sont écartées de l’ordre à cet égard, les générations qui leur succèdent, ont les plus grandes difficultés à surmonter pour y revenir : les maladies dont les corps politiques sont alors affligés, exigent des ménagements, et ne peuvent se guérir que par une gradation à laquelle il est socialement impossible de se refuser. Mais le premier pas à faire pour rétablir ces corps dans leur état naturel, est de rendre publique la connaissance évidente des premiers principes du mal, et de l’ordre immuable dans lequel il faut aller puiser les remèdes qu’on peut employer : sans cette connaissance évidente et publique, le zèle et les bonnes intentions des dépositaires de l’autorité se trouveront toujours trop faibles contre la force aveugle des préjugés anciennement établis ; contre la force opiniâtre de l’habitude chez les hommes ignorants ; contre la force tyrannique des besoins impérieux du moment ; contre la force perfide et tumultueuse des intérêts particuliers et désordonnés : voilà les ennemis puissants qu’ils ont à combattre, et contre lesquels la publicité de l’évidence doit les armer, pour la gloire des souverains, la prospérité de leur empire, la félicité de leurs sujets.
Qu’on me permette de terminer ce chapitre par une réflexion, qui doit faire une vive impression sur toutes les âmes honnêtes et sensibles, et qu’on ne peut désapprouver, à moins de commencer par avouer qu’on a perdu tout sentiment d’humanité. Quand un gouvernement est organisé de manière que la culture des terres tend perpétuellement vers son meilleur état possible, l’abondance progressive des productions précède toujours l’accroissement progressif de la population : tous les hommes alors ne naissent que pour être heureux ; et par la raison que le dernier degré possible de la multiplication des productions nous sera toujours inconnu, on peut dire que [219] le dernier degré possible auquel l’ordre peut porter la prospérité d’une nation, est une mesure que personne ne peut concevoir. Mais dans un gouvernement contraire à l’ordre ; dans un gouvernement où la culture est dans un état progressif de dégradation, il doit toujours et nécessairement se trouver plus d’hommes que de productions, parce que c’est la diminution de la masse des productions qui précède et entraîne celle de la population : la terre alors doit être couverte d’un grand nombre de malheureux destinés à traîner partout la misère qui doit enfin les détruire, et qui jusqu’à ce moment, ne peuvent s’offrir à vos yeux, sans que leurs importunités naturelles vous avertissent que c’est dans l’appauvrissement général qu’on doit chercher la cause première de leur malheur particulier.
Dans une telle position c’est en vain qu’on fait des lois contre la mendicité ; impossible d’éteindre une profession qui se perpétue par une nécessité physique, et qui se renouvelle sans cesse : le décroissement progressif et annuel des productions fait que chaque année il se trouve une nouvelle disproportion entre la somme des salaires à distribuer, et le nombre des hommes qui en ont besoin pour subsister ; entre la masse des choses à consommer, et celle des choses nécessaires pour pouvoir fournir à toutes les consommations. Le germe intérieur de cette maladie circulant dans toutes les parties du corps politique, c’est ce germe qu’il faut attaquer pour la guérir ; sans cela, les plaies que vous aurez fermées, n’empêcheront point d’autres plaies de s’ouvrir. Heureux encore si les douleurs qu’elles causent, ne jettent point ceux qui les souffrent dans un désespoir qui ne craint rien, parce qu’ils n’ont rien à perdre, si ce n’est une existence qui leur est à charge et qu’ils regardent comme un malheur.
[II-220 / 220]
CHAPITRE XXXV.↩
Des rapports entre une nation et les autres nations. — Il existe, sous une forme différente de celle des premiers temps, une société naturelle, générale et tacite parmi les nations ; devoirs et droits essentiels qui en résultent, et qui sont réciproques entre elles. — L’ordre naturel qui régit cette société générale, est ce qui assure à chaque nation son meilleur état possible. — Cet ordre, qui n’a rien d’arbitraire, doit être la base fondamentale de la politique. — Il est de l’intérêt d’un souverain et d’une nation de s’y conformer, quand même il ne serait point adopté par les autres nations. — Balance de l’Europe ; observations sur ce système.
La troisième classe des différents objets qui appartiennent au gouvernement des empires, renferme, suivant la division que nous en avons faite, tous les rapports qui se trouvent naturellement et nécessairement entre une nation et les autres nations. Pour montrer clairement comment l’évidence de l’ordre naturel et essentiel des sociétés doit régner despotiquement dans cette branche d’administration, il nous faut remonter à la source de ces mêmes rapports, aux temps qui ont précédé la formation des sociétés particulières ; aux devoirs et aux droits réciproques que les hommes alors avaient naturellement et nécessairement entre eux, et qui constituaient le juste et l’injuste absolus.
Nous avons vu ces sociétés naître de la nécessité de multiplier les subsistances par la culture : tant que les hommes ont été assez peu nombreux pour pouvoir subsister des productions spontanées de la terre, il n’existait entre eux qu’une société naturelle, générale et tacite ; société naturelle, parce qu’elle consistait en ces premiers droits respectifs que la nature a établis sur les premiers devoirs dont elle a grevé notre existence ; société générale, parce que ces devoirs et ces droits, liés au physique de notre constitution, étaient les mêmes pour tous les êtres de notre espèce, et dans tous les lieux où des hommes errants pouvaient se transporter ; société tacite, parce qu’elle se trouvait établie sans aucune convention expresse ; sa justice et sa nécessité étaient sensibles à chaque homme en particulier ; elle existait enfin par la seule impossibilité physique et évidente que sans elle le genre humain pût se multiplier et se perpétuer.
Ce n’est pas que je prétende que chacun s’abstint alors scrupuleusement de tout ce qui pouvait troubler l’ordre de cette société primitive, et que les hommes n’eussent aucune sorte d’association pour leur sûreté commune : nous devons au contraire supposer des [221] crimes, parce que leur germe qui est en nous, a été le même dans tous les temps ; nous n’avons fait que lui donner plus d’activité, par les écarts dans lesquels notre ignorance nous a fait tomber ; nous devons supposer aussi des associations, parce qu’elles sont une suite naturelle du besoin que nous avons les uns des autres ; besoin impérieux, que notre premier âge ne nous permet pas de méconnaître, et qui paraît ne s’affaiblir en nous, que pour être remplacé par notre sensibilité pour les plaisirs d’attrait dont la nature a rendu notre union susceptible pour nous.
Cette société naturelle, générale et tacite, qui a dû nécessairement précéder l’établissement des sociétés particulières, n’a point été détruite par leur institution ; elle n’a fait que se distribuer en différentes classes ; prendre ainsi une forme nouvelle pour se donner plus de consistance, pour consolider parmi les hommes les devoirs et les droits essentiels et réciproques qui étaient inséparables de l’humanité. C’est donc dans ces devoirs et ces droits primitifs qu’il faut aller puiser les devoirs et les droits que les nations ont respectivement entre elles ; c’est le moyen de les mettre en évidence, de les juger sans aucune sorte de prévention, et de nous convaincre qu’ils ne comportent rien d’arbitraire.
Ô lecteur ! qui que vous soyez, faites attention aux vérités simples que je viens de mettre sous vos yeux ; elles ne vous annoncent que ce que vous savez, que ce que vous voyez vous-même : pénétrez chez les peuples les moins connus, les moins fréquentés ; présentez-vous à eux dans un état qui ne puisse les alarmer ; si des expériences fâcheuses ne leur ont point appris à se défier des autres hommes, vous trouverez chez eux un asile et des secours ; vous les reconnaîtrez pour être naturellement et tacitement en société avec votre nation, dont peut-être ils n’ont aucune idée. Regardez aussi cette multitude de peuples qui ont entre eux des relations de commerce ; voyez comme, malgré les distances prodigieuses qui les séparent, ce lien commun les rapproche les uns des autres ; voyez comme ils respectent tous et ces devoirs et ces droits réciproques qui les tiennent unis les uns aux autres pour leur avantage commun ; ces devoirs et ces droits par le moyen desquels la société se perpétue, et embrasse toutes les parties de la terre habitée.
Les sociétés particulières ne sont donc véritablement que différentes branches d’un même tronc dont elles tirent leurs substances ; que différentes classes de la société naturelle, générale et tacite qui a précédé leur institution. Nous pouvons même les regarder comme ayant été, dans leur origine, des sociétés errantes, mais devenues sédentaires, par la nécessité de demeurer attachées à tel territoire en particulier pour le cultiver. Chaque nation n’est ainsi qu’une province [222] du grand royaume de la nature ; aussi seraient-elles toutes gouvernées par les mêmes lois, par des lois qui, dans ce qu’elles ont d’essentiel, seraient parfaitement semblables, si toutes ces nations s’étaient élevées à la connaissance du juste et de l’injuste absolus ; à la connaissance de cet ordre immuable, par lequel l’auteur de la nature s’est proposé que les hommes fussent gouvernés dans tous les lieux et dans tous les temps, et auquel il a attaché leur meilleur état possible.
L’idée de cette société générale toujours existante est antérieure à l’établissement du christianisme : ce rayon de lumière brillait dans les ténèbres du paganisme, et plusieurs philosophes de l’antiquité païenne en ont parlé avec force et dignité [4]. Cette vérité philosophique cependant n’a point été suffisamment approfondie ; et nous voyons qu’elle ne s’est présentée que très confusément à ceux qui se sont proposé d’en faire une maxime politique : faute de remonter aux premiers principes de cette société générale, ils ne se sont pas aperçu que cette même société générale qu’ils désiraient d’établir, existait déjà ; qu’elle était l’ouvrage de la nature même ; qu’il ne s’agissait pas de la former, mais de l’entretenir, de ne pas la troubler, de connaître évidemment les lois qui constituent son ordre essentiel, afin de nous y assujettir par la seule force des avantages évidents qu’on trouve à s’y conformer. L’établissement de cet ordre politique parmi les nations, ou plutôt son observation doit même paraître encore une chimère à tous ceux qui ne seront pas convaincus par l’évidence, qu’il n’est autre chose que l’ordre évidemment le plus avantageux à chaque nation, comme il l’est à chaque souverain et à chaque homme en particulier, par conséquent qu’il suffit que ce même ordre soit connu pour être observé.
On peut dire que jusqu’ici chaque nation a pris pour base de sa politique, le dessein de s’enrichir ou de s’agrandir aux dépens des autres : quand les traités entre quelques nations confédérées n’ont pas eu pour objet des conquêtes communes, leur but a du moins été de se ménager de grands profits par le moyen du commerce, aucune d’elles ne s’est peut-être jamais demandé qui est-ce qui paierait les profits qu’elles se proposaient de faire : aucune d’elles n’a jamais songé que l’état respectif de leurs intérêts factices et arbitraires pouvait changer d’un instant à l’autre ; que leurs traités n’étaient ainsi que des édifices élevés pompeusement sur un sable mouvant ; qu’il est physiquement impossible qu’une politique qui blesse les intérêts des autres nations, n’ait pas les autres nations pour ennemis ; que [223] cette fausse politique nous fait payer bien cher de prétendus avantages qui, par les guerres qu’ils occasionnent, compromettent la sûreté d’un État, et qui, dès qu’on les approfondit, non seulement s’évanouissent, mais encore se convertissent en privations, en pertes réelles pour les nations et les souverains que ces avantages illusoires ont séduits.
La politique, science dont l’obscurité fait la profondeur, et dont les contradictions n’osent se montrer au grand jour, a inventé dans notre continent, le système de la balance de l’Europe, terme énigmatique dont le vrai sens me paraît impossible à définir. Mais sans vouloir approfondir ce mystère, nous pouvons dire que les effets de ce système en démontrent évidemment les inconséquences : certainement il est peu propre à prévenir les guerres parmi les puissances de l’Europe ; il semble plutôt leur servir d’occasion, ou de prétexte ; car tous les jours elles se font la guerre pour maintenir la balance ; les peuples ainsi s’entr’égorgent, armés les uns contre les autres par un système imaginé pour les empêcher de s’entr’égorger.
Quoi qu’il en soit, distinguons, dans ce plan politique, l’objet qu’il se propose, et les moyens qu’il emploie pour le remplir. Son objet, nous dit-on, est la pacification de l’Europe ; d’arrêter les entreprises arbitraires du plus fort qui voudrait opprimer et dépouiller le plus faible ; de maintenir ainsi chaque nation dans la jouissance paisible de ce qui constitue son État politique ; de ne pas permettre enfin qu’aucune puissance puisse acquérir un tel degré de forces, qu’il ne soit plus possible de lui en opposer de supérieures, dans le cas où des passions effrénées la porteraient à vouloir étendre sa domination sur d’autres peuples.
Ce projet est assurément bien louable ; tous applaudissent avec raison à sa sagesse, à sa justice ; mais il n’en est pas ainsi des moyens de l’exécuter ; c’est un article sur lequel une politique factice, une politique séparée de ses vrais principes tient les nations divisées ; et l’expérience ne nous a que trop appris combien nous devons redouter les suites funestes et naturelles de cette division. Il faut donc que la théorie de la politique ne soit pas exacte à cet égard, puisqu’elle s’égare dans la pratique, et qu’elle ne peut arriver à son but.
Cependant le système de la balance de l’Europe, quelque mal combiné qu’on puisse le supposer, nous fournit de grands arguments pour prouver que toutes les nations de cette partie de la terre se regardent comme une seule et même société formée par un intérêt commun, par un intérêt qui doit nécessairement réunir toutes leurs forces particulières, pour leur donner une seule et même direction, afin que leur sûreté commune en soit le résultat. La base de ce système est la persuasion où l’on est que chaque nation veut naturellement [224] sa sûreté personnelle ; que toutes celles dont la sûreté personnelle est directement ou indirectement menacée, sont naturellement décidées, par ce danger commun, à s’unir pour lui opposer une résistance commune ; qu’ainsi leur confédération, sans être même ni prévue ni convenue par aucuns traités antérieurs, doit nécessairement embrasser toutes les nations qui ont à craindre d’être tôt ou tard enveloppées dans le même danger.
Une confédération générale de toutes les puissances de l’Europe n’est donc point une chimère, comme bien des gens l’ont imaginé ; elle est même tellement dans l’ordre de la nature, qu’on doit la supposer toujours faite, ou plutôt toujours existante sans l’entremise d’aucunes conventions expresses à cet égard, et par la seule force de la nécessité dont elle est à la sûreté politique de chaque nation en particulier. Le système de la balance de l’Europe n’a pu s’établir sur un autre fondement que sur l’existence de cette confédération naturelle et nécessaire ; et la manière de régler les procédés qui devaient en résulter, a été le seul point dont la politique a dû s’occuper.
Si ce système, vu dans le principe dont il est émané, dans l’ordre naturel des intérêts des nations et des procédés que ces intérêts leur suggèrent, nous montre que tous les peuples de l’Europe ne forment naturellement qu’une seule et même société, ce même système envisagé dans les mauvais effets dont il est suivi, nous offre encore une seconde preuve de cette vérité, pour peu que nous voulions remonter aux causes naturelles de ces mêmes effets : par lui-même le projet d’entretenir la paix ne peut jamais occasionner la guerre, à moins que pour l’exécution de ce projet, on n’ait choisi des moyens qui soient contradictoires avec la fin qu’on se propose : alors les causes de la guerre sont dans les moyens, et non dans le dessein projeté : ainsi par la raison que le système de la balance de l’Europe ne la préserve point de la guerre, nous devons conclure avec certitude que ce point de vue politique pèche dans les moyens de l’exécuter.
Deux circonstances peuvent rendre vicieux ces moyens : ils le sont, s’ils tendent à diviser les puissances de l’Europe, pour les mettre en contre-forces et en opposition les unes aux autres ; ils sont vicieux encore s’ils blessent les intérêts naturels et légitimes de quelques nations : essayons maintenant de nous développer.
Si, pour établir un équilibre entre elles, les puissances de l’Europe forment des confédérations particulières et se divisent, il est impossible qu’elles parviennent à leur but ; et quand elles y parviendraient, il serait impossible que cet équilibre pût se conserver.
Supposons, par exemple, la masse générale des forces égale à 12 : pour trouver l’équilibre, en les divisant seulement en deux parties, il faut les composer chacune de 6 ; mais cette égalité de [225] forces devient nécessairement égalité de danger pour chacune de ces deux divisions ; et par ce moyen leur sûreté respective est fort équivoque. Cette égalité parfaite est donc une position inquiétante et périlleuse, que chaque puissance a grand intérêt d’éviter, et qui naturellement doit la décider à se confédérer de manière qu’elle ait pour elle la supériorité des forces.
Rien de plus simple que l’argument qu’on propose ici contre la division des puissances : en supposant leurs forces dans l’équilibre le plus parfait, chacune d’elles se trouve réellement en danger ; car si deux forces égales s’attaquent, rien de plus incertain que l’événement. Comment donc peut-on se flatter d’établir ou de conserver ce même équilibre parmi des puissances dont il n’en est pas une qui ne doive le redouter ?
Cependant si, dans le cas que nous venons de supposer, une seule puissance, pressée par cet intérêt majeur, se détache de son parti pour se réunir à l’autre, voilà que celui-ci se trouve être 7 contre 5, alors plus d’équilibre ; il faut que toutes les autres branches du parti qu’elle vient d’abandonner, suivent son exemple, auquel cas la confédération devient générale, ou que la guerre s’allume entre les deux divisions, soit parce que celle qui se croit supérieure en forces, peut être tentée d’en abuser, soit parce que l’autre, qui redoute cette supériorité, doit se proposer de faire les plus grands efforts pour la dissiper : aussi dans ces circonstances, la politique épuise-t-elle toutes ses ressources pour faire naître de nouveaux intérêts qui puissent faire changer l’état des confédérations ; et de là, les méfiances, les jalousies, les haines nationales, les guerres enfin qui ne se terminent que par des traités faits par force, et destinés à être rompus sitôt qu’on croira pouvoir le faire avec quelque avantage.
Il est encore une autre raison à rendre de l’impossibilité de pouvoir compter sur un équilibre parfait entre les puissances de l’Europe, en les divisant pour les opposer les unes aux autres : il est certain que pour établir cet équilibre il faudrait pouvoir calculer et garantir de toute variation, un genre de puissance qui est tout à la fois incalculable et sujet à des révolutions qui le changent du tout au tout. Les forces physiques d’une nation n’ont, pour ainsi dire, d’autre valeur, que celle qu’elles acquièrent par la manière de les employer : de là s’ensuit que le génie, les talents, l’art, en un mot, de faire valoir les forces physiques d’une nation, font une grande partie de sa puissance ; or, ces avantages ont une si grande influence dans les opérations pour lesquelles on cherche à balancer les forces, qu’un homme de plus fait pencher cette balance ; ajoutez que ces mêmes avantages sont reconnus pour être si inconstants, si passagers, qu’on ne peut jamais savoir de quel côté se trouvera cet homme de plus. [226] Le projet de diviser des puissances pour les forcer, les unes par les autres, à vivre en paix, renferme donc une contradiction évidente entre la fin et les moyens. Mais observez que cette idée chimérique tient essentiellement au second vice qui peut se trouver dans les pratiques par lesquelles on croit pouvoir maintenir la balance de l’Europe : toutes fois que les intérêts naturels et légitimes de quelques nations seront blessés, il y aura nécessairement division entre elles ; ce schisme politique ne cessera même de changer de forme et d’état, jusqu’à ce que l’arbitraire ait été banni des prétentions.
Si dans les confédérations on se rappelait que tous les peuples ne forment entre eux qu’une même société générale ; si d’après cette première vérité, on examinait de bonne foi les droits essentiels dont chacun d’eux doit invariablement jouir dans cette même société ; qu’on évitât avec soin de préjudicier à ces droits ; que les traités ne fussent que l’expression fidèle de cet ordre naturel et immuable dont il ne nous est pas possible de nous écarter sans être injustes, toutes les nations regarderaient comme avantageux pour elles d’accéder à ces mêmes traités, au moyen de quoi la confédération deviendrait naturellement et nécessairement générale. Ainsi quand le système de la balance laisse subsister cette division, nous devons être certains qu’elle est le fruit de ses inconséquences, des injustices qui se trouvent dans les moyens qu’il emploie ; ainsi lorsque cette division devient une occasion de guerre, c’est par une suite naturelle et nécessaire de cette même injustice ; ainsi considéré dans son principe ou dans ses mauvais effets, ce système est également une preuve qu’une confédération générale est l’état naturel de l’Europe ; et que tous les peuples de notre continent, divisés dans le fait et par des méprises, ne forment cependant dans le droit, qu’une seule et même société.
Au fond, ce qu’on entend par la balance de l’Europe ne peut être qu’une sorte de ligue défensive, dans laquelle les engagements auxiliaires sont conditionnels et relatifs aux différents événements qui peuvent troubler la paix. Sous ce point de vue, il est encore évident que le système de cette balance ou ne peut produire l’effet qu’on en attend, ou suppose une confédération générale. De quelque côté que vienne l’orage, la confédération ne doit-elle pas avoir lieu ? Quelle que soit la puissance qui veuille former des entreprises, ne compromet-elle pas la sûreté de toutes les autres ? Par conséquent toutes les autres ne doivent-elles pas se réunir pour faire force contre elle ? Ainsi par la raison qu’on ne sait pas quel sera l’ennemi commun qu’on pourra dans la suite avoir à combattre, la confédération, si elle n’était pas générale, ne pourrait maintenir l’équilibre dans tous les cas. [227] Non seulement le système de la balance, sous quelque face qu’on l’envisage, nous montre que depuis longtemps on a regardé les nations de l’Europe comme ne formant qu’une seule et même société ; mais cette vérité est encore consacrée par des pratiques qui seraient pour nous d’excellentes leçons, si nous leur donnions toute l’attention qu’elles méritent de notre part. Les rois sont dans l’usage de se traiter réciproquement de frères : cette qualification qu’ils se donnent mutuellement entre eux, est un titre précieux dont je réclame ici l’autorité. Les rois n’emploient cette expression que dans les actes où ils parlent en rois, en chefs des nations qu’ils représentent : ce n’est donc point précisément une fraternité personnelle qu’ils veulent désigner par cette manière d’écrire ou de parler, c’est au contraire une fraternité nationale : comme rois ils se reconnaissent pour frères, parce que chaque peuple, chaque État doit se reconnaître pour frère d’un autre peuple, d’un autre État.
Par quelle fatalité voudrait-on donc que cette fraternité ne fût qu’un nom ? Par quelle fatalité ce nom si saint, si cher, serait-il fait pour frapper nos yeux ou nos oreilles, sans nous peindre aucune idée sensible que nos esprits puissent comprendre, et dont nos âmes puissent être affectées ? Si jamais nous sommes assez heureux pour nous dégager des préjugés qui nous aveuglent sur nos véritables intérêts, et chercher dans l’établissement de l’ordre naturel des sociétés, le meilleur état possible des souverains, des nations, de chaque homme en particulier, la politique changera de système et de langage ; au terme de balance elle substituera celui de fraternité ; alors il lui sera facile de n’être plus inconséquente ; de ne plus faire contraster son langage et ses procédés ; les objets qu’elle se propose et les effets qu’elle produit ; l’intérêt commun des puissances et un système qui, pour les accorder, les tient désunies.
La fraternité des nations n’est donc point une vérité nouvelle ; il y a longtemps qu’elle est découverte par les hommes ; mais ils ne l’ont vue ni dans sa véritable source, ni dans ses rapports essentiels ; et voilà pourquoi les plans mal combinés d’une politique factice et arbitraire nous ont si souvent donné la guerre, en se proposant de nous donner la paix. Mais puisque cette vérité nous est connue ; puisque nous sommes forcés d’avouer cette fraternité naturelle ; qu’elle est même un dogme fondamental de notre religion, regardons-la donc comme étant le point fixe d’où la saine politique doit nécessairement partir, pour fixer l’ordre et la nature des procédés respectifs qui doivent être adoptés par toutes les nations.
Sitôt que nous prendrons pour base de notre politique la fraternité naturelle des nations, nous examinerons ce qui appartient à l’essence [228] de cette fraternité, et nous trouverons que de nation à nation la nature a établi les mêmes devoirs et les mêmes droits qu’entre un homme et un autre homme ; nous trouverons que le meilleur état possible de chaque homme en particulier est attaché à la plénitude de son droit de propriété, et de la liberté qui en est un attribut essentiel ; or dès que nous connaissons ce qui constitue le meilleur état possible de chaque homme en particulier, nous connaissons aussi ce qui constitue le meilleur état possible de chaque nation ; car enfin l’intérêt public, l’intérêt général d’une nation n’est autre chose que le produit des divers intérêts particuliers de ses membres.
À peine avons-nous saisi ce premier aperçu, que la politique cesse d’être un mystère ; elle ne cherche plus les ténèbres pour cacher sa difformité ; elle n’a plus besoin d’artifices pour étayer sa faiblesse chancelante ; loin de se couvrir d’un voile épais, elle se met en évidence, se place au milieu des nations, et d’un front serein leur tient à toutes ce langage :
« Le meilleur état possible d’une nation consiste dans la plus grande abondance possible de ses récoltes annuelles, jointe à la plus grande valeur vénale possible de ses productions. Ces deux avantages réunis, parce qu’ils doivent l’être nécessairement, lui assurent, en raison de son territoire, la plus grande richesse possible, la plus grande population possible, la plus grande industrie possible, la plus grande consistance possible parmi les autres nations. Pour arriver ainsi à son plus haut degré possible de prospérité dans tous les genres, elle n’a qu’une seule chose à faire, c’est de protéger chez elle le droit de propriété, de lui procurer la plus grande solidité possible et la plus grande liberté : voilà son premier devoir essentiel, devoir qui détermine tout à la fois ceux qui sont réciproques entre ses sujets, et ceux dont elle est tenue envers les autres nations.
« Par la raison qu’il n’est point de droits sans devoirs, que les devoirs sont la mesure des droits, et qu’un homme, qui prétend qu’on respecte ses propriétés, ne peut l’exiger qu’en vertu de l’obligation qu’il s’impose de respecter celles des autres, une nation aussi ne peut établir solidement ses droits de propriété et sa liberté, que sur le devoir qu’elle se fait de ne jamais attenter sur les droits de propriété et sur la liberté des autres peuples. De ces vérités résulte qu’un intérêt capital, un intérêt évident, et commun à toutes les nations, les tient toutes naturellement et nécessairement confédérées entre elles pour consolider le droit de propriété et la liberté par une garantie commune : cette confédération naturelle et générale, qui est la même que celle qui subsiste entre les membres d’une société particulière, impose à chaque nation le devoir de concourir au maintien des droits des autres nations ; mais aussi par ce devoir elle achète le droit [229] de s’approprier à son tour les forces des autres nations pour la défense de ses propres droits.
« Ainsi vos devoirs et vos droits respectifs sont établis les uns sur les autres ; et leur proportion est déterminée par un ordre essentiel dont vous ne pouvez vous écarter qu’à votre préjudice ; ainsi vous n’avez rien à régler entre vous, que la forme extérieure des procédés, dans le cas où quelque nation aura besoin du secours des autres. Ce cas même ne sera jamais problématique ; car les entreprises qu’une nation peut faire à force ouverte sur les sujets d’une autre nation, n’ont rien d’équivoque ; et c’est là le seul désordre que votre confédération doive se proposer d’arrêter. D’ailleurs laissez chaque peuple mettre, comme il le voudra, son commerce extérieur à la gêne ; plaignez en cela son aveuglement, mais ne lui en faites point un crime par rapport aux nations qu’il prive de la liberté de commercer dans ses États ; c’est à lui-même qu’il préjudicie ; un tel désordre porte nécessairement sa punition avec lui. Mais vous devez respecter jusqu’à son erreur, parce que vous ne pouvez lui faire violence, sans offenser ses droits de propriété et sa liberté : gardez-vous surtout d’user vis-à-vis de lui de représailles ; ses méprises alors vous deviendraient communes, et elles vous causeraient les mêmes dommages.
« Ne se permettre aucune entreprise sur une autre nation, s’unir et faire force pour contenir les autres dans le même devoir, voilà l’ordre essentiel de votre société générale, comme celui des sociétés particulières ; il est tout entier renfermé dans ces deux maximes ; leur simplicité, ou plutôt l’évidence de leur justice et de leur nécessité vous annonce même que cet ordre est fait pour assurer de proche en proche, et dans toutes les parties de la terre, la paix et le bonheur de l’humanité. »
Ce qui prouve bien la sagesse et la vérité de la politique ainsi ramenée à ses premiers principes, c’est qu’elle convient aux intérêts particuliers de chaque nation indépendamment des systèmes contraires que les autres nations pourraient adopter. Il importe assurément à une nation que ses procédés à l’égard des étrangers s’accordent avec la forme de son gouvernement intérieur, pour annoncer une politique exclusive de ces projets ambitieux que les autres nations ne peuvent soupçonner sans s’alarmer, et sans chercher à les prévenir ; or elle ne peut trouver cet avantage que dans l’établissement de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, parce que cet ordre est le seul qui mette en évidence l’intérêt personnel que les souverains ont à conserver la paix, et qui permette ainsi à cette évidence d’enchaîner l’arbitraire dans les motifs qui peuvent les porter à [230] déclarer la guerre, et dans l’usage des moyens dont ils ont besoin pour la soutenir.
En même temps qu’une nation inspire cette confiance, il est important pour elle aussi de porter ses forces à leur plus haut degré possible, afin de jouir de toute la considération à laquelle elle peut prétendre parmi les autres puissances. Enfin, elle ne peut ni conserver ni même acquérir au-dehors une grande consistance, qu’autant qu’elle jouit au-dedans d’une grande prospérité ; or, le germe de cette prospérité est cette même politique que l’ordre essentiel des sociétés vient de nous indiquer : respecter les propriétés et la liberté des autres nations ; donner chez elle à ces mêmes droits toute l’extension et toute la solidité dont ils sont susceptibles ; d’après ces principes, et sans avoir aucun égard aux entraves que les étrangers peuvent mettre à leur commerce extérieur, accorder à celui qu’elle fait, la plus grande liberté possible ; s’assurer par ce moyen une grande richesse, une grande population, une grande puissance, voilà la vraie politique, une dans ses principes et dans ses effets : il est évident qu’une nation peut l’adopter pour elle indépendamment des autres nations : le droit de propriété peut devenir pour ses sujets un droit sacré, sans qu’il le soit pareillement chez tous les étrangers ; l’ordre essentiel dont ce droit est la base et le principe, peut gouverner despotiquement chez elle, sans gouverner despotiquement chez les autres ; enfin, pour rendre le commerce pleinement libre dans tous les pays de sa domination, il n’est pas nécessaire qu’il le soit également sous les dominations étrangères ; et c’est ce que je me propose de démontrer dans les chapitres suivants. Il est évident encore que cette politique ne comporte rien d’arbitraire ; qu’elle n’est qu’une conséquence naturelle de l’ordre essentiel des sociétés, qu’elle s’établit naturellement et nécessairement avec lui ; qu’ainsi toute nation qui fera régner chez elle cet ordre essentiel, doit être au-dehors et au-dedans dans son plus haut degré de puissance et de splendeur ; dans l’état le plus florissant, le plus tranquille, le plus heureux que le souverain et les sujets puissent espérer.
[II-249 / 231]
CHAPITRE XXXVI.↩
Du commerce. — Premières notions qui conduisent à reconnaître la nécessité de sa liberté. — Tout acheteur est vendeur, et tout vendeur doit être acheteur. — Les sommes de ces deux opérations doivent être égales entre elles. — Les ventes, même en argent, ne sont que des échanges de valeurs égales. — Erreurs et préjugés contraires à ces premières notions.
J’ai dit dans le chapitre précédent qu’il était dans l’ordre naturel et essentiel des sociétés, par conséquent dans les intérêts communs du souverain et de la nation, qu’on donnât au commerce extérieur la plus grande liberté possible : il s’agit maintenant de porter jusqu’à l’évidence la démonstration de cette vérité. Pour y parvenir, il suffit de présenter d’une manière simple et claire les premières notions du commerce ; de fixer ainsi la véritable signification des expressions dont on se sert journellement, sans les entendre ; de donner, par ce moyen, du corps, pour ainsi dire, et de la précision à des idées abstraites et vagues qui prêtent à tous les différents systèmes, nourrissent l’illusion et les préjugés, jusque dans ceux mêmes qui de bonne foi cherchent à s’en garantir.
Si je ne parle point ici du commerce intérieur, c’est que je me persuade qu’on est d’accord aujourd’hui sur la nécessité de le faire jouir de la plus grande liberté. La consommation est la mesure de la reproduction ; car des productions qui resteraient sans consommation, dégénéreraient en superflu sans utilité, sans valeur ; et dès lors on cesserait de faire les avances de leur culture. Mais il n’est pas possible de reconnaître cette vérité, sans reconnaître aussi que le commerce intérieur étant le moyen par lequel la consommation s’opère, la liberté dont il jouit est toute à l’avantage de la reproduction.
Cependant en même temps qu’on s’éclaire sur cet objet, on ne s’achemine que lentement vers l’établissement de cette même liberté : ses progrès sont retardés par quelques préjugés qui subsistent encore : on se persuade que les profits faits sur une nation par ceux qui dans son intérieur, achètent d’elle et lui revendent, sont néanmoins une augmentation de richesse pour cette nation. Cette erreur évidente n’aurait aucun inconvénient, si elle ne décidait pas les gouvernements, non seulement à mettre des entraves aux consommations, par les impôts qu’ils établissent sur les consommateurs, en croyant les établir sur ceux qui ne font que leur vendre leur ministère, mais encore à sacrifier souvent la liberté du commerce intérieur aux intérêts particuliers des revendeurs, par les privilèges qu’on leur [232] accorde au détriment de cette même liberté : l’effet de ces privilèges, qui diminuent la concurrence, est de faire passer dans des mains stériles, une portion des richesses qui pourraient servir à l’augmentation des dépenses productives ; opération qui nécessairement devient destructive de la reproduction.
De quelque manière que se fasse le commerce, il n’est qu’un échange de marchandise pour marchandise. L’action de vendre ou d’acheter n’est que l’action d’échanger, lors même que cette action s’opère par l’entremise de l’argent ; car l’argent n’est qu’une marchandise. Le but de cet échange est la jouissance, la consommation : de sorte que le commerce peut être défini sommairement l’échange des choses usuelles pour parvenir à leur distribution dans les mains de leurs consommateurs, de ceux enfin auxquels la jouissance en est destinée.
Il est important de se former une idée précise du commerce ; de bien saisir qu’il n’est qu’un échange pour parvenir à une consommation. Cette première notion nous apprend à ne pas confondre le commerce avec le mouvement et les frais du commerce ; à ne voir dans chaque opération de commerce, que deux hommes et deux valeurs : deux hommes, dont l’un est premier vendeur, et l’autre, dernier acheteur ou consommateur ; deux valeurs, dont une part de ce premier vendeur pour arriver à ce dernier acheteur consommateur ; tandis qu’une autre valeur, en échange de la première, part à son tour de celui-ci pour arriver à celui-là. C’est dans cet échange uniquement que le commerce consiste, et qu’il faut le considérer pour juger de son importance. Si cet échange pouvait être fait immédiatement et sans frais, il n’en serait que plus avantageux aux deux échangeurs : aussi se trompe-t-on bien lourdement quand on prend pour le commerce même, les opérations intermédiaires qui servent à faire faire le commerce.
Cette méprise cependant est très ordinaire : avant qu’une chose commerçable soit rendue à sa dernière destination, souvent elle éprouve plusieurs reventes, fait beaucoup de circuits et de frais : le commerce en cette partie produit l’effet des glaces disposées pour réfléchir en même temps, et dans différents sens, les mêmes objets ; comme elles, il semble les multiplier, et trompe ainsi les yeux qui ne le voient que superficiellement : ils croient apercevoir un grand commerce, lorsqu’en réalité ce n’est qu’un commerce très médiocre, mais qui occasionne un grand mouvement et de grands frais. Cependant pour peu qu’on veuille y faire quelque attention, on ne peut plus être dupe de cette multiplication illusoire ; il devient évident que par la répétition des ventes et des reventes, la chose commercée ne gagne rien en volume ou en quantité ; que quelques circuits qu’elle fasse, quelques changements de main qu’elle éprouve, lorsqu’elle [233] arrive à sa dernière destination, elle se trouve n’être que ce qu’elle était en partant.
Il est vrai, me dira-t-on, qu’une marchandise ne se multiplie point par les reventes qui en sont faites ; mais elle augmente de valeur vénale, et cette augmentation de valeur est une augmentation de richesses pour l’État. Si cette maxime est vraie, nous pouvons aisément nous rendre aussi riches que nous le voudrons : ne permettons pas qu’aucune marchandise soit consommée sur le lieu de sa production, à moins qu’elle n’ait fait le tour du royaume ; défendons les transports par eau ; imaginons encore d’autres polices qui grossissent les frais, et renchérissent les marchandises pour les consommateurs ; notre commerce intérieur et nos richesses vont doubler, vont décupler : je laisse à juger de l’absurdité du principe par l’absurdité des conséquences.
Il en est qui pressés par l’évidence de cette même absurdité, abandonnent une partie du système, et se tiennent comme retranchés dans l’autre partie. Nous reconnaissons, disent-ils, que le voiturier et le simple revendeur n’augmentent point la masse des richesses nationales ; qu’ils ne sont que des instruments servant à la consommation ; mais il n’en est pas ainsi du manufacturier, des artistes qui avec des matières premières d’un prix médiocre, font des ouvrages d’une grande valeur. Ceux-là multiplient donc réellement les richesses ; ils les triplent, les quadruplent, et plus encore ; toute faveur ainsi doit leur être acquise dans l’intérieur de l’État.
Je pardonne aux hommes d’avoir pris pour des réalités, les faux produits de l’industrie ; mais je ne leur pardonne point leurs contradictions ; ils auraient dû, d’après leur illusion, défendre chez eux l’usage de tout ouvrage qui n’exigeait pas la main-d’œuvre la plus chère : au moyen de cette police, ils se seraient ménagé le brillant avantage de ne consommer que des choses d’un grand prix. Oh, qu’ils auraient été riches, s’ils avaient été conséquents ! Cette courte réflexion pourrait peut-être suffire pour montrer que cette seconde erreur n’est pas moins évidente que la première : mais comme elle est plus séduisante, j’en traiterai dans un chapitre particulier, où j’espère achever de la démasquer.
Si les hommes avaient bien compris que le commerce n’est qu’un échange, ils ne se seraient laissés séduire ni par les dehors imposants des ventes et des reventes qui se succèdent les unes aux autres, ni par l’éclat trompeur des renchérissements simulés que causent les frais de la main-d’œuvre : ils n’auraient point cru voir un accroissement de richesses et de commerce, dans ce qui n’est qu’une dépense onéreuse au commerce. Autant vaudrait juger de l’utilité d’une mécanique par la complication de ses mouvements, et par les frais de son [234] entretien, sans avoir aucun égard à l’effet qui en résulte : on verra dans la suite combien cette comparaison est juste dans tous ses points.
Comme il n’est point ici question de la vente des biens-fonds, mais seulement de celle des effets mobiliers et susceptibles de transport, je dirai que nous ne connaissons que deux espèces de choses commerçables ; les productions en nature ou les matières premières, et les travaux de la main-d’œuvre ou les ouvrages de l’industrie. Ces deux sortes de marchandises ont donné lieu à distinguer deux sortes de commerce ; mais dans l’un comme dans l’autre, acheter c’est vendre, et vendre c’est acheter ; car acheter ou vendre c’est échanger.
On appelle vendre échanger une marchandise contre de l’argent ; et les hommes attachent un si grand intérêt à cette façon de commercer, qu’ils voudraient pouvoir toujours vendre et ne rien acheter en argent. Cet intérêt est une manie inconcevable, sous quelque face qu’il soit considéré. Mais sans m’arrêter à parcourir ici tous ses rapports, je vais l’attaquer dans son principe, et faire voir que les ventes qu’on se propose de faire en argent, ne peuvent constamment avoir lieu, qu’autant qu’à son tour on achète en argent ; qu’il est d’une nécessité absolue que les vendeurs et les acheteurs se rendent alternativement par leurs achats l’argent qu’ils ont reçu par leurs ventes.
Un homme salarié, quel qu’il soit, vend sa main-d’œuvre, son talent, et du prix de ses salaires il paie ce qu’il consomme. Le cultivateur vend les productions qu’il récolte, donne une partie du prix qu’il reçoit au souverain et au propriétaire foncier, et du surplus paie ce qu’il consomme. Le souverain et le propriétaire foncier doivent être aussi regardés comme vendeurs de productions par l’entremise du cultivateur ; du prix de ces ventes ils paient ce qu’ils consomment. Le rentier touche un revenu qui est le fruit d’une richesse qu’il a vendue pour un temps ou à perpétuité, et avec ce revenu il paie ce qu’il consomme. Le propriétaire d’une maison vend la jouissance annuelle des dépenses qu’il a faites pour l’acquérir, et qu’il est obligé de faire encore pour l’entretenir ; la vente de cette jouissance annuelle est ce qui lui donne annuellement les moyens de payer ce qu’il consomme.
Ainsi en considérant le commerce comme une multitude de ventes et d’achats faits en argent, personne n’est acheteur qu’autant qu’il est vendeur ; et comme acheter c’est payer, personne ne peut acheter qu’en raison de ce qu’il vend, parce que ce n’est qu’en vendant qu’il se procure l’argent pour payer ce qu’il achète.
De ce que tout acheteur doit être vendeur, et ne peut acheter qu’autant qu’il vend, il résulte évidemment un deuxième axiome ; [235] c’est que tout vendeur doit être acheteur, et ne peut vendre qu’autant qu’il achète ; qu’ainsi chaque vendeur doit, par les achats qu’il fait à son tour, fournir aux autres l’argent pour acheter les marchandises qu’il veut leur vendre.
N’est-il pas évident que si les ventes que nous nous faisons l’un à l’autre, se soldent en argent, je ne peux acheter de vous qu’autant que vous achetez de moi ; qu’entre vous et moi la somme de nos ventes et celle de nos achats alternatifs doivent être égales entre elles : si après m’avoir vendu pour 100 francs, vous voulez ne m’acheter que pour 50, comment ferai-je pour vous payer ? Et quand je le pourrais une fois, comment pourrai-je continuer de toujours vous donner plus d’argent que je n’en reçois ? Un troisième achètera de moi peut-être ; mais qui est-ce qui achètera de lui ? Et comment peut-il acheter s’il ne vend ? Prolongez tant qu’il vous plaira la chaîne des vendeurs et des acheteurs en argent, il faudra toujours que chaque achat soit payé par le produit d’une vente ; qu’ainsi chacun soit alternativement acheteur et vendeur en argent pour des sommes égales. Dès que l’argent devient le moyen unique dont on peut se servir pour acheter, tout serait perdu s’il cessait de circuler ; il est d’une nécessité absolue qu’il ne fasse que passer dans chaque main.
Je conviens cependant que cette balance peut bien n’être pas exacte dans les ventes et les achats que fait chaque homme en particulier ; mais si l’un vend plus qu’il n’achète et s’enrichit, un autre se ruine en achetant plus qu’il ne vend ; et par l’opposition qui règne entre ces deux sortes de désordres, l’équilibre se rétablit dans la masse générale des ventes et des achats.
Que la consommation soit la mesure de la reproduction, c’est une vérité que personne aujourd’hui ne révoque en doute, et c’est par cette raison que j’en ai parlé si succinctement. Pour peu qu’on médite un moment cet axiome, on trouvera qu’il nous dit en d’autres termes que chacun doit vendre en proportion de ce qu’il achète, et acheter en proportion de ce qu’il vend.
La consommation ne peut s’opérer que par deux sortes de personnes ; les unes qui sont premiers propriétaires des productions, et les autres qui ne le sont pas : ces dernières ne peuvent consommer, qu’autant qu’elles paient en valeurs factices, les productions qu’elles achètent, et qu’ainsi ces valeurs factices sont achetées ou prises en échange par les vendeurs des productions. Si dans ces doubles opérations de ventes et d’achats alternatifs, vous voulez ne voir que des échanges, vous apercevez tout d’un coup que la somme des valeurs factices échangées contre les productions, et la somme des productions échangées contre les valeurs factices doivent être nécessairement [236] égales entre elles. Mais si au lieu de simplifier les choses en supposant ces échanges faits en nature, vous admettez l’argent comme un moyen commun d’échange, comme un gage intermédiaire qui facilite ces mêmes opérations, vous devez sentir qu’il est d’une nécessité absolue que ce gage circule perpétuellement ; qu’il revienne sans cesse dans les mains dont il est parti pour en ressortir encore ; sans quoi l’usage de cet intermédiaire cesserait d’avoir lieu, attendu qu’on ne peut le reproduire comme on peut reproduire les valeurs naturelles ou factices qu’il représente.
Cette vérité n’eut jamais été contestée, si les termes de vente et d’achat, ainsi que l’usage de l’argent monnaie, n’avaient jeté dans les idées une telle confusion, qu’il n’a plus été possible aux hommes ni de s’entendre, ni de s’accorder sur leurs intérêts communs. Qu’est-ce donc que vendre ? C’est échanger. Qu’est-ce donc que l’argent considéré comme monnaie ? C’est une marchandise dont la valeur a la faculté d’être représentative d’une valeur égale en toute autre espèce de marchandises. Au moyen de cette faculté qu’une convention, ou du moins un usage presque universel lui attribue, les ventes en argent ne sont que de véritables échanges d’une marchandise pour une autre marchandise. Cependant comme il n’est point une chose usuelle, et que celui qui le reçoit en vendant, ne peut s’en servir qu’autant qu’il le rend en achetant, on ne l’emploie que dans le cas où quelqu’un veut acheter les marchandises des autres, sans avoir, en nature, les choses que ceux-ci désirent de recevoir en échange : alors l’argent peut être regardé comme un gage intermédiaire, par le moyen duquel l’échange se commence entre l’acheteur et ces vendeurs, pour ensuite être consommé par eux avec d’autres hommes, qui, sur ce gage commun, fournissent les marchandises que le premier acheteur n’avait pas dans sa possession.
Proscrivons pour un moment l’usage de l’argent monnaie, ainsi que les termes de vente et d’achat, pour leur substituer celui d’échanges, et supposons ceux-ci réellement faits en nature : n’est-il pas évident que si je veux me procurer votre marchandise, il faut que j’en aie une d’une valeur égale à vous donner, et qu’en cela, je sois vendeur pour être acheteur ? N’est-il pas évident aussi que si je veux trouver le débit de ma marchandise, il faut que je prenne en échange quelque autre marchandise d’une semblable valeur, et qu’en cela, pour être vendeur je sois acheteur ?
Mais vous avez la chose qui me convient, et celle que j’ai ne vous convient pas ; alors rappelons l’argent que nous venons de bannir ; employons-le entre nous comme un gage intermédiaire, comme une valeur représentative pour vous de la chose que je ne [237] peux vous donner en échange ; dans ce cas, comme je ne cueille point l’argent, il faut que je m’en procure par un autre échange de ma chose contre ce même argent ; de là résulte que je fais deux échanges au lieu d’un, et que de votre côté vous en faites autant, en portant mon argent à un autre vendeur qui vous donne la marchandise que vous désirez. Il est donc évident qu’au fond l’opération est toujours la même : on peut bien acheter avec de l’argent sans avoir dans le moment même une chose usuelle à vendre ; mais pour avoir cet argent il faut avoir vendu.
Telle est pourtant cette vérité si simple en elle-même qu’une infinité de gens n’ont pas voulu voir : j’aurais honte de m’y être arrêté si longtemps, si notre aveuglement sur cet article ne nous avait fait adopter des systèmes monstrueux, au point qu’on s’est persuadé qu’on pouvait toujours vendre en argent à quelqu’un qui ne vendrait rien. Cette idée, telle que je la présente ici, paraît sans doute être le comble de l’extravagance : cependant je ne charge point le tableau ; car c’est d’après elle qu’on a posé comme des principes incontestables, qu’il importait à une nation de faire un grand commerce d’exportation ; de vendre beaucoup en argent et d’acheter peu, se persuadant que par ce moyen le commerce l’enrichirait. Dans ces prétendus principes autant de termes, autant d’hérésies, qui toutes proviennent de ce qu’on ne s’est pas aperçu qu’on ne peut absolument donner de l’argent pour des marchandises, à moins d’avoir commencé par donner des marchandises pour de l’argent.
Avec de l’argent on achète des marchandises, et avec des marchandises on achète de l’argent ; ainsi vendre ou acheter, c’est toujours, comme je l’ai dit, échanger une valeur quelconque contre une autre valeur quelconque : que l’une de ces deux valeurs soit argent, ou qu’elles soient toutes deux marchandises usuelles, rien de plus indifférent en soi, si ce n’est que celui qui reçoit l’argent est moins avancé que s’il avait reçu immédiatement les choses en nature dont, avec ce même argent, il compte se procurer la jouissance.
[II-267 / 238]
CHAPITRE XXXVII.↩
Définition du commerce vu dans tous ses rapports essentiels. — De la manière dont il peut enrichir une nation : fausses idées des hommes à cet égard. — Son utilité est dans les rapports qu’il a avec les intérêts de la culture. — Le commerce extérieur n’est qu’un pisaller et un mal nécessaire.
Il est facile à présent de donner du commerce une définition dans laquelle on embrasse tout à la fois les choses qui entrent dans le commerce, les intérêts qui l’occasionnent ; les hommes qui font le commerce entre eux ; les objets qu’ils se proposent en commerçant, et les moyens qu’ils emploient souvent pour commercer. Le commerce est un échange de valeurs pour valeurs égales, pratiqué par le moyen d’agents intermédiaires ou sans ces agents, pour l’intérêt commun des échangeurs qui fournissent ces valeurs, et les échangent entre eux pour les consommer. Ainsi après une telle opération chacun d’eux n’est ni plus riche ni plus pauvre qu’il était, quoiqu’il ait en sa possession une chose qui lui convient mieux que celle qu’il avait auparavant.
Un homme qui possède beaucoup de vin et point de blé, commerce avec un autre homme qui a beaucoup de blé et point de vin : entre eux se fait un échange d’une valeur de 50 en blé, contre une valeur de 50 en vin. Cet échange n’est accroissement de richesses ni pour l’un ni pour l’autre ; car chacun d’eux, avant l’échange, possédait une valeur égale à celle qu’il s’est procurée par ce moyen. Cet échange néanmoins leur est également utile : sans lui, chacun de ces deux hommes serait dans le cas de ne pouvoir jouir d’une partie de sa récolte, et par cette raison, chacun aussi diminuerait sa culture.
On voit ici bien clairement dans quel sens on doit entendre que le commerce enrichit une nation : il ne lui procure point, par lui-même, un accroissement de richesses ; mais il est pour elle, une ressource qui lui permet de les augmenter par la culture. Plusieurs cependant se persuadent qu’une nation gagne sur une autre nation ; ils ne voient pas que par rapport au commerce, une nation n’est qu’un corps composé de plusieurs hommes qui tous séparément ne peuvent payer le prix de ce qu’ils achètent qu’avec le prix de ce qu’ils vendent ; que des millions d’hommes réunis en corps de nation ne trouvent point, à la faveur de leur nombre, le moyen de s’élever audessus de l’impossibilité de donner ce qu’on n’a pas ; qu’ainsi les lois naturelles et fondamentales du commerce, les conditions essentielles sans lesquelles il ne peut se soutenir, sont entre une nation et une autre nation, les mêmes qu’entre un homme et un autre homme ; [239] qu’une nation enfin ne peut vendre qu’autant qu’elle achète, ne peut acheter qu’autant qu’elle vend.
Quelle que soit la nation qui, par le moyen du commerce, se propose de gagner sur les autres nations, qu’elle me dise donc comment elle pourra gagner si les autres ne perdent rien, ou comment elles pourront toujours perdre. Toutes les nations commerçantes se flattent également de s’enrichir par le commerce ; mais, chose étonnante ! elles croient toutes s’enrichir en gagnant sur les autres. Il faut convenir que ce prétendu gain, tel qu’elles le conçoivent, doit être une chose bien miraculeuse ; car dans cette opinion, chacun gagne et personne ne perd. Comme le mystère d’un gain sans perte n’est point un article de foi, nous pouvons bien dire que la contradiction évidente qu’il renferme, en démontre l’absurdité.
Un homme, ou une nation (car encore une fois le nombre ne change rien à l’ordre essentiel des choses dans l’espèce dont il s’agit) un homme donc commence par prélever sur ses productions, la quantité qu’il peut et doit en consommer en nature, et vend le surplus : pourquoi cet homme a-t-il fait des dépenses pour se procurer, par la culture, une masse de productions qui excède ses consommations ? C’est qu’il savait bien qu’en raison de leur utilité, elles ont dans le commerce une valeur vénale, un prix qui leur est habituellement attribué, et qu’il a compté trouver à ce prix, le débit de cet excédent. Faites disparaître une de ces deux conditions, un de ces deux points de vue qui entrent dans l’espoir du cultivateur ; faites perdre à ces productions leur valeur vénale ou leur débit : certainement la culture qui les faisait renaître, va cesser, ou tout au moins se rétrécir au point de ne plus en donner que la quantité nécessaire aux consommations que ce cultivateur fait personnellement.
Quand on dit que la consommation est la mesure de la reproduction, on doit entendre par le terme de consommation, celle qui est faite par des consommateurs en état de payer la valeur courante des choses qu’ils consomment. C’est dans cet axiome considéré sous ce point de vue, qu’il faut aller chercher la manière dont le commerce extérieur enrichit une nation, ou plutôt lui présente des occasions dont elle peut profiter pour multiplier les richesses que son territoire peut lui fournir. Le commerce offre à cette nation des consommateurs qu’elle ne trouve pas chez elle ; cette augmentation de consommateurs procure le débit des productions nationales ; ce débit leur assure, et leur conserve toute la valeur vénale qu’elles doivent avoir parmi les choses commerçables ; le cultivateur trouve ainsi cette valeur vénale et ce débit, dont l’espoir l’a déterminé à faire les avances de la culture, pour obtenir des récoltes dont l’abondance pût excéder la consommation [240] nationale. On peut dire en deux mots que par le moyen du commerce, la consommation n’a plus de bornes connues : de là s’ensuit que l’abondance des productions ne peut jamais devenir à charge aux cultivateurs ; avantage inestimable pour ceux qui sans lui seraient dans le cas de redouter cette même abondance, parce qu’elle ne peut plus servir qu’à faire tomber la valeur vénale de leurs productions, et rendre leur débit insuffisant.
Maintenant il est aisé d’expliquer l’énigme, et de voir comment le commerce enrichit une nation : il en enrichit une comme il les enrichit toutes ; non en les mettant dans le cas de gagner les unes sur les autres ; car ou ces gains seraient alternatifs et conséquemment nuls, ou bientôt ils ne pourraient plus avoir lieu ; mais il les enrichit en ce que, procurant le débit de toutes les productions nationales au meilleur prix possible, il fait passer dans les mains des cultivateurs tout le produit sur lequel ils ont dû compter. L’effet direct de cette opération est que les richesses consacrées à la reproduction reviennent avec profit à la classe productive ; que cette classe se trouve avoir ainsi tout à la fois plus de moyens pour améliorer ses cultures, et plus d’intérêt à s’occuper de ces améliorations.
Ne croyez pas que le cultivateur, proprement dit, soit la seule et unique classe d’hommes que le commerce enrichisse : ce nom ne doit point être pris ici dans un sens étroit, littéral, et par opposition à tous les autres hommes, comme il est d’usage à plusieurs égards. Premièrement par le terme de classe productive, j’entends non seulement les entrepreneurs de culture, mais aussi les propriétaires fonciers qui en cette qualité sont spécialement chargés de diverses dépenses nécessaires à la reproduction, soit pour l’entretenir, soit pour l’améliorer. En second lieu, je parle du cultivateur, parce que sa richesse personnelle est la source principale de toutes les richesses, et que pour augmenter la masse des richesses nationales, il faut nécessairement rendre leur source plus abondante. Mais aussi nous devons considérer ensuite la manière dont l’abondance se partage dans les autres classes que cette source arrose : nous devons voir que le souverain et les autres co-propriétaires du produit net profitent de cette même abondance, et que sans s’arrêter dans leurs mains, elle continue son cours, pour se répandre sur la classe industrieuse, ou plutôt sur toute la nation.
Observez que le commerce extérieur, considéré comme moyen d’enrichir une nation, ne peut absolument avoir une autre marche ; que celle-ci est dans l’ordre physique même, et que vous ne pouvez vous en écarter, que vous n’en soyez puni : disposez le commerce de manière qu’il enlève aux cultivateurs une partie du prix auquel ils devraient vendre leurs productions ; tout change de face en un [241] instant : la culture n’a plus ni les mêmes motifs d’encouragement, ni les mêmes moyens pour fructifier ; non seulement vos productions ont moins de valeur vénale, mais encore vous en avez une moindre quantité ; vous perdez ainsi de tous côtés ; alors les revenus du souverain et ceux des propriétaires fonciers se trouvant plus faibles, leurs dépenses diminuent à proportion ; par conséquent moins de salaires à distribuer, moins d’hommes occupés et entretenus : le commerce extérieur n’enrichit plus une nation, il l’appauvrit ; et si ce désordre continuait, il parviendrait à la ruiner, à l’anéantir.
De ces premières notions nous devons conclure que le commerce extérieur peut être nuisible, comme il peut être avantageux ; que son utilité consiste entièrement dans celle dont il est à la reproduction ; qu’ainsi cette utilité résulte, non du commerce précisément, mais de la façon dont le commerce se fait.
Une autre conséquence encore, c’est que le commerce extérieur n’est qu’un pis-aller ; qu’il suppose toujours qu’une nation manque au-dedans d’un nombre suffisant de consommateurs en état de mettre un bon prix à ses productions ; que par cette raison elle est obligée d’aller chercher au-dehors d’autres consommateurs, dont l’éloignement ne peut lui être qu’onéreux. Ne m’alléguez point qu’elle peut être réduite à cette nécessité par le physique, par le climat dans lequel elle est placée ; cela peut être ; mais c’est un malheur, et ce malheur ne prouve rien, si ce n’est que partout l’ordre physique est l’ordre sur lequel il faut nécessairement calquer celui de la société ; d’où je conclus que de tels peuples ont encore plus de besoin que tous les autres, d’une grande liberté. Règle générale : plus on est contrarié par le physique, et plus la liberté devient importante à la prospérité d’une nation.
Je conviens donc que le commerce extérieur peut être indispensable, par rapport à quelques productions étrangères qu’une nation ne peut obtenir de son territoire, et dont cependant elle a besoin : sous ce point de vue, nous devons dire que le commerce extérieur est un mal nécessaire ; car si cette nation avait l’avantage de trouver chez elle les mêmes productions qui lui manquent, elle ne prendrait pas la peine de faire de gros frais pour les aller chercher chez les autres. Je crois que cette dernière proposition est évidente par elle-même : tout le monde sait que les productions qui viennent de loin, doivent être plus chères que celles qui croissent autour de nous, et qu’il faut que le consommateur paie les frais de transport, soit par l’augmentation du prix de ces productions étrangères, soit par la diminution du prix de celles qu’il donne en échange ou en paiement ; en un mot, que l’intérêt de la reproduction est d’être voisine du lieu de la consommation, et que l’intérêt de la consommation est d’être voisine du lieu [242] de la reproduction. Je laisse le lecteur méditer ces vérités, en attendant que je les lui présente dans un nouveau jour, et dans un degré d’évidence qui ne lui permette ni de douter des principes, ni de rejeter les conséquences qui en résultent en faveur de la liberté.
[II-279 / 243]
CHAPITRE XXXVIII.↩
De l’intérêt du commerce. — Ce qu’on doit entendre par cette façon de parler : il n’est point chez un peuple de commerçants le même que chez une nation agricole. — Véritable idée du commerçant. — Ce sont les consommateurs et non les commerçants, qui font le commerce. — Opposition entre les intérêts particuliers des commerçants et l’intérêt commun des autres hommes.
Que le commerce extérieur, selon qu’il se comporte bien ou mal, enrichisse une nation ou l’appauvrisse, c’est une vérité que personne ne peut révoquer en doute, mais qui se trouve tellement dénaturée par la façon bizarre de l’interpréter, que les hommes ne peuvent convenir entre eux de l’idée qu’on doit se former de l’intérêt du commerce : je sais qu’en général ce qu’on nomme l’intérêt du commerce est l’intérêt de ceux qui font le commerce ; car le commerce n’est point un être particulier. Mais qui sont ceux qui font le commerce ? Voilà ce que les politiques auraient dû nous expliquer, pour nous mettre d’accord. Ils conviennent uniformément cependant que par l’intérêt du commerce, on doit entendre l’intérêt de la nation ; mais demandezleur ensuite ce que c’est qu’une nation considérée comme corps politique ; de quels hommes elle est essentiellement composée, et quels sont les liens qui les tiennent unis entre eux ; demandez-leur si l’intérêt de la nation, vu dans le commerce, est un intérêt commun à tous ses membres, ou s’il n’est qu’un intérêt propre à une classe particulière ; alors vous voyez les opinions se diviser, et les contradictions qu’elles présentent, les armer les unes contre les autres ; chacun, d’après l’idée qu’il se forme d’une nation, et des intérêts d’une nation par rapport au commerce, fabrique des principes, et sur ces principes factices établit un système dont il prétend qu’on ne peut s’écarter, que tout ne soit perdu.
La méprise la plus commune sur ce qui constitue l’intérêt du commerce, celle même dans laquelle sont tombés des hommes à grande réputation, c’est de confondre l’intérêt commun de la nation relativement au commerce, avec l’intérêt particulier des commerçants nationaux, qui pourtant ne sont que les instruments du commerce : en conséquence, on n’a plus jugé de l’importance et de l’utilité du commerce, que par les fortunes de ces commerçants ; sans examiner aux dépens de qui ces fortunes sont acquises, ni pour qui elles sont disponibles ; on s’est bonnement persuadé que la nation s’enrichissait quand on voyait ces mêmes commerçants s’enrichir ; ce n’est que dans leurs opérations qu’on a considéré le commerce ; et c’est à [244] leur intérêt personnel exclusif, présenté comme étant l’intérêt général, qu’on a sacrifié les intérêts communs de tous les membres essentiels d’une nation.
Un des moyens les plus puissants dont on se sert pour fortifier et entretenir cette illusion, c’est d’alléguer des exemples ; d’attacher nos regards sur quelques peuples de commerçants enrichis par le commerce seulement ; de les présenter comme des modèles à suivre par toutes les nations. On s’est laissé séduire par ces prétendus exemples, sans faire aucune attention à la différence qui doit se trouver entre les intérêts de ceux qui trafiquent les productions des autres, et les intérêts des propriétaires de ces mêmes productions : et qui ne voit pas que ces deux positions n’ont rien de commun ? Que leurs intérêts sont diamétralement opposés entre eux ? Que la manière dont les salariés s’enrichissent, n’est point la même que celle qui enrichit ceux qui les paient ? Par quel excès d’aveuglement a-t-on donc pu confondre, et prétendre assujettir aux mêmes polices, les intérêts de ces peuples de commerçants, qui ne trouvent point chez eux les productions qu’ils trafiquent, et les intérêts des nations agricoles et productives, qui cueillent sur leurs propres territoires toutes les productions qu’elles commercent entre elles ?
Il est très différent de servir le commerce ou de faire le commerce : il est très différent encore de trafiquer ou de commercer. Le voiturier, soit par mer, soit par terre, sert le commerce, mais ne le fait pas ; le commissionnaire, qui ne fait qu’exécuter les ordres qu’on lui donne, sert le commerce, mais ne le fait pas ; le commerçant, qui achète et revend à ses risques et pour son compte, sert le commerce, mais ne le fait pas. Ce dernier cependant fait quelque chose de plus que les deux premiers : il trafique, et les autres ne trafiquent point ; mais trafiquer n’est pas commercer. On trafique quand on achète et revend les marchandises dont d’autres hommes sont premiers propriétaires ; on commerce quand on tire de son propre fonds, les marchandises qu’on échange contre des valeurs quelconques, en autres marchandises ou en argent. Ainsi celui qui trafique n’est qu’une espèce de salarié, qui, par son industrie, parvient à s’approprier une portion des richesses des autres hommes ; et ceux qui commercent, ne font en cela que jouir de leurs propres richesses.
En prenant le terme de commerce dans la plus grande étendue qu’on puisse lui donner, nous avons vu qu’il n’en est que deux espèces, celui des productions ou matières premières, et celui de l’industrie ou travaux de main-d’œuvre. Ces deux sortes de commerce sont utiles l’un à l’autre ; mais ils diffèrent entre eux, en ce que le second ne peut absolument exister sans le premier, au lieu que [245] le premier peut exister sans le second, dont il est le germe et l’aliment.
Il serait à souhaiter qu’on ne perdît jamais de vue les rapports essentiels qui se trouvent entre ces deux espèces de commerce, et que jamais on ne voulût renverser l’ordre immuable de leur génération : il serait à souhaiter qu’on sentît que pour multiplier les enfants, il faut nécessairement commencer par féconder la mère dans le sein de laquelle ils prennent naissance, et du sein de laquelle ils se nourrissent après qu’ils sont nés ; qu’on ne se proposât point d’augmenter la masse des travaux de l’industrie par des moyens propres à diminuer nécessairement l’abondance des matières qui donnent occasion à ces mêmes travaux, et servent encore à les payer.
Je n’insiste point quant à présent sur ces inconséquences ; j’en parlerai dans un autre moment : revenons à l’idée qu’on doit se former du commerce et des commerçants. Le commerce n’est qu’un échange de valeur pour valeur égale ; ainsi il ne peut se faire qu’entre les propriétaires de ces valeurs ; et les commerçants eux-mêmes ne font véritablement et réellement le commerce, qu’en proportion des valeurs en industrie qu’ils échangent contre des valeurs en autres marchandises propres à leurs consommations. Gardons-nous donc de nous tromper sur l’idée que nous devons attacher au nom de commerçant ; ce nom ne désigne point les hommes qui font le commerce ; car alors il deviendrait commun à tous les consommateurs, vu que tous les consommateurs font le commerce, étant tous dans la nécessité d’être alternativement acheteurs et vendeurs. Mais par le nom de commerçants nous ne devons entendre autre chose que des hommes consacrés au service immédiat du commerce.
Point de doute assurément que les opérations du commerce, pour peu qu’elles deviennent multiples et compliquées, n’aient besoin d’une classe particulière d’hommes qui s’en occupent : mais le commerce ainsi organisé renferme quatre objets qu’il ne faut pas confondre. Ces quatre objets sont, 1°. Les causes du commerce ; 2°. La matière du commerce ; 3°. La fin du commerce ; 4°. Les moyens du commerce. Les consommateurs considérés comme premiers vendeurs et comme derniers acheteurs, sont les causes du commerce ; car ce sont eux qui le provoquent et l’occasionnent. La matière du commerce est la masse de toutes les choses commerçables fournies par les consommateurs. La fin du commerce est la consommation de ces mêmes choses commerçables ; et les moyens du commerce sont tous les instruments, tous les agents par les procédés desquels on parvient à cette consommation. Ce n’est donc qu’en qualité de moyens, que les commerçants tiennent à cet ensemble que nous appelons [246] commerce ; il est évident que les consommateurs, qui sont les causes du commerce, qui fournissent les matières du commerce, et dont l’utilité réciproque est la fin du commerce, sont ainsi ceux qui font véritablement le commerce.
On regardera peut-être comme un pointillage, comme une dispute de mots, ce que je viens d’observer sur les termes dont nous nous servons. C’est cependant pour leur avoir attaché des idées vagues et superficielles, que nous nous sommes égarés au point de prendre les effets pour les causes, et le voiturier pour le premier propriétaire même des marchandises qu’il transporte. Quand on oppose à des préjugés établis, des vérités importantes et rigoureuses, on ne peut mettre trop de précision dans les idées qu’on attache aux termes dont on fait choix : ces vérités ne sont susceptibles ni de plus ni de moins : à cet égard, le plus ou le moins ne serait qu’erreur et contradiction.
Il en est du commerce comme des procès : ce ne sont point les officiers subalternes de la justice qui les font, à moins qu’ils n’en aient en leur propre et privé nom ; dans tous les autres cas ils ne sont que les instruments des procès : il est vrai qu’ils peuvent bien les susciter, les multiplier, en grossir les frais ; mais enfin les procès, lors même qu’ils les occasionnent, sont toujours entrepris par les parties et pour les parties : les prétentions et les intérêts de celles-ci forment la matière des procès ; ce sont donc elles qui les font, aussi est-ce par elles que les frais en sont payés. Nous devons dire la même chose des agents du commerce : ils sont pour le commerce des instruments dont chaque consommateur se sert au besoin, pour pratiquer les échanges qu’il se propose ; mais lors même qu’on emploie leur ministère, ce ne sont point eux qui font commerce des choses qui entrent dans ces échanges ; ce sont au contraire les consommateurs qui le font réellement entre eux par l’entremise de ces agents ; et ces derniers, en les servant ainsi, ne font véritablement d’autre commerce que celui de leurs travaux qu’ils échangent contre des salaires.
Ceux qui prétendent que par l’intérêt du commerce nous devons entendre l’intérêt de ceux qui font le commerce, ont donc raison dans le principe ; et ils auraient raison encore dans les conséquences, s’ils n’avaient pas mis les commerçants à la place des consommateurs ; s’ils avaient voulu voir que ce sont ceux-ci, et non ceux-là, qui font le commerce. Il est donc à propos de leur faire connaître le point fixe dans lequel ils se sont mépris.
La conséquence qui résulte de ces observations, c’est qu’il n’y a que deux sortes d’hommes qui soient essentiels au commerce, le premier vendeur et le dernier acheteur consommateur ; aussi commercent-ils souvent entre eux directement et sans agent intermédiaire [247] : les circuits que fait une marchandise, les changements de main qu’elle éprouve, les reventes qu’elle occasionne ne font point le commerce, quoique le commerce soit leur objet : ces opérations ne sont en elles-mêmes qu’un mouvement intermédiaire entre le lieu de la production et celui de la consommation, entre le premier vendeur et le dernier acheteur consommateur. Ce mouvement intermédiaire est celui de la chose commercée, qui part toujours de celui-là pour arriver à celuici, et qui, comme je l’ai déjà dit, fait des frais sur la route, mais n’acquiert point une nouvelle valeur.
Au premier coup d’œil, les intérêts de ces deux hommes paraissent être entre eux en opposition, et cela parce que le vendeur veut vendre cher, et le consommateur acheter à bas prix : mais un ordre naturel, un ordre immuable a pourvu, et pour toujours, à la conciliation de leurs intérêts, quelque nombreuse que puisse être la multitude des vendeurs et des acheteurs.
Chaque marchandise jouit dans le commerce d’un prix qui lui est propre, et qui est principalement déterminé par l’utilité ou l’agrément dont elle est, et par les dépenses que sa reproduction ou sa main-d’œuvre exigent. Ce prix doit être aussi nécessairement relatif aux facultés des consommateurs ; mais que signifie cette dernière façon de parler ? Elle veut dire que le prix d’une marchandise ne pouvant être payé que par le prix d’une autre marchandise, et chaque consommateur ne pouvant acheter qu’en proportion de ce qu’il vend, il s’établit nécessairement, ainsi que je l’ai dit en parlant de l’impôt, un équilibre entre les valeurs vénales de toutes les choses commerçables ; équilibre qui fait que le prix de l’une est mesuré sur le prix des autres ; qu’ainsi la somme des choses à vendre est habituellement balancée par la somme des moyens que les consommateurs ont pour les payer.
Cet équilibre ne peut être dérangé qu’accidentellement : si le prix d’une marchandise s’élevait au-dessus de son niveau, il n’y aurait plus assez de consommateurs en état de l’acheter ; d’ailleurs tous les hommes s’empresseraient de profiter de sa faveur, et se feraient à l’envi vendeurs d’une telle marchandise ; on la verrait donc bientôt perdre tout son avantage, par un effet nécessaire de la concurrence, dont le propre est de vendre au rabais.
D’après toutes les différentes circonstances qui concourent à fixer les valeurs vénales des choses commerçables, la concurrence assigne naturellement à chaque espèce et qualité de marchandise, le plus haut prix auquel chaque vendeur puisse se proposer de vendre, et le plus bas prix auquel chaque acheteur puisse se proposer d’acheter. Il existe ainsi naturellement une puissance despotique qui marque le prix auquel chaque consommateur peut acheter, parce [248] qu’elle marque le prix auquel il peut vendre : chaque vendeur ne peut donc parvenir à renchérir habituellement ses marchandises, qu’en se soumettant aussi à payer habituellement plus cher les marchandises des autres vendeurs ; et par la même raison, chaque consommateur ne peut parvenir à payer habituellement moins cher ce qu’il achète, qu’en se soumettant aussi à une diminution semblable sur le prix des choses qu’il vend.
Remarquez ici combien sont vaines les spéculations de ceux qui dans une nation se proposent de faire parvenir une espèce de production à son plus haut prix possible, et à son dernier degré possible d’abondance, sans songer à procurer les mêmes avantages aux autres productions dont les valeurs doivent opérer la consommation et le paiement de celle qu’on veut favoriser. Un tel projet est précisément celui de vouloir établir plus de vendeurs que d’acheteurs, plus de choses à vendre que de moyens pour les payer. En vain on se flattera de trouver un débit suffisant chez les étrangers : certainement dans l’ordre général de la nature ils ne sont point ceux qui sont destinés à consommer la majeure partie des productions de votre territoire ; leur consommation a des bornes naturelles, parce que les moyens qu’ils ont pour acheter nos productions sont bornés comme leur population. D’ailleurs ils ne peuvent nous payer qu’en nous échangeant des productions de leur cru ; ainsi chaque fois que vous voulez augmenter chez vous, l’abondance d’une de vos productions, et vous en assurer le débit à son plus haut prix possible, il faut nécessairement que vous mettiez votre nation en état de faire plus de consommations, soit de ses propres productions, soit de celles des autres nations. Mais pour cet effet il faut aussi que vous vous occupiez également de l’abondance et du bon prix de toutes les autres productions nationales ; par conséquent que vous ayez grande attention de faire cesser tout ce qui peut être contraire aux intérêts des cultivateurs. À cette condition, vous verrez toutes les valeurs qui doivent être échangées les unes contre les autres, se multiplier en même temps, et s’acheminer d’un pas égal vers leur meilleur prix possible ; vous verrez aussi l’industrie nationale et la population croître en raison de votre abondance, qui par ce moyen trouvera toujours dans l’intérieur de la nation un nombre suffisant de consommateurs en état de mettre un bon prix aux choses qu’ils consomment : c’est dans l’ensemble que réside la perfection de l’ordre qui procure à chaque partie son meilleur état possible. Si vous perdez de vue la chaîne des rapports, vous ne pouvez plus vous promettre de grands succès ; quelque sages que soient vos opérations à quelques égards, dès qu’elles n’embrassent pas le tout, elles ne vous serviront que faiblement ; encore seront-elles sujettes à des inconvénients. [249] Qu’on ne m’objecte point que les hommes qui vendent et achètent, ne se conduisent pas sur ces spéculations philosophiques ; j’en conviens ; mais aussi, comme dit Pope, voyons-nous que l’auteur de la nature a greffé sur un sauvageon un arbre qui porte des fruits excellents : la cupidité, qui divise le vendeur et l’acheteur dans leurs projets, est précisément ce qui les rapproche et les concilie dans la pratique : c’est cette cupidité, ce désir de jouir qui devient l’âme de la concurrence, et la met en état de donner despotiquement des lois aux vendeurs comme aux acheteurs.
Il n’est point ici question de rendre les hommes philosophes et profonds pour qu’ils puissent garder toutes les proportions qui doivent se trouver dans les échanges qu’ils font entre eux : ces proportions s’établissent d’elles-mêmes, parce qu’il est physiquement impossible qu’elles ne s’établissent pas ; parce qu’il est physiquement impossible que la somme des ventes excède habituellement celle des moyens que les consommateurs ont pour acheter ; parce qu’il est physiquement impossible qu’une partie des marchandises renchérisse, et soit néanmoins consommée en totalité, si l’autre partie des marchandises, dont le prix sert à payer la première, ne renchérit à proportion ; parce qu’il est physiquement impossible qu’alors le manque de débit ne fasse pas cesser le renchérissement, et ne rétablisse pas l’équilibre dans les valeurs.
Lorsque je veux vous vendre pour 100 francs de marchandises, qui sans votre consommation deviendraient superflues, et ne seraient pour moi d’aucune utilité, mon intérêt est que vous ayez une valeur quelconque de 100 francs à me donner en échange ou en paiement : supposons donc que vous soyez en possession de cette valeur, mais aussi que vous n’ayez rien au-delà : si je prétends doubler le prix de cette marchandise que vous devez consommer, vous ne pouvez plus en acheter que la moitié, à moins que je ne consente qu’en me vendant, vous doubliez aussi le prix de la vôtre, auquel cas il n’est pour vous et pour moi ni perte ni gain. Mais si des circonstances passagères me permettent de vous faire la loi, il en résulte que vous perdez la moitié des jouissances que vous devriez avoir pour votre argent, et que moi, je n’y gagne rien, puisque dans notre supposition, je ne peux tirer aucun parti de ce qui me reste : de là s’ensuit qu’un tel commerce entre nous ne peut subsister, parce que je vous mets dans la nécessité de faire en sorte qu’il ne subsiste plus. C’est ainsi que je me prépare des pertes et des privations par une voie qui paraissoit me conduire à l’augmentation de ma richesse.
Une fois que l’argent a été institué le signe représentatif de toutes les valeurs, il est devenu la mesure commune dont on s’est servi pour les énoncer et les peindre d’une manière sensible : on ne s’informe [250] point du rapport que la valeur vénale d’une marchandise peut avoir avec celle de telle ou telle autre marchandise : combien vaut-elle en argent ? Quelle somme d’argent faut-il pour la payer ? Voilà tout ce qu’on demande à savoir : nous sommes si peu dans l’habitude de suivre le fil des liaisons que les choses ont entre elles, que sans nous mettre en peine du rapport que cette même somme d’argent peut avoir avec les autres marchandises, nous croyons gagner beaucoup en donnant moins d’argent pour les choses que nous achetons, ou en recevant plus d’argent pour les choses que nous vendons. Il est pourtant tout naturel de ne priser le signe qu’à raison de la chose qu’il représente.
Un homme qui ne cueille que du vin en augmente le prix en argent de 25%, tandis que toutes les autres productions sont renchéries de 50 : cet homme alors n’est-il pas moins riche avec un revenu plus considérable en argent ? Changeons l’hypothèse, et disons que le prix en argent de toutes les choses commerçables est diminué de 50%, et que celui du vin n’est diminué que de 25% ; dans ce cas, ce même homme n’est-il pas plus riche avec un revenu moins considérable en argent ?
L’argent n’est qu’un gage, n’est qu’un signe représentatif des choses usuelles : c’est donc une bien forte méprise que de le prendre pour ces choses mêmes, et de ne pas voir que les valeurs numéraires, les valeurs en argent ne sont que des noms, des termes que les hommes emploient pour se communiquer leurs idées, et parvenir à faire entre eux des échanges dont ils conviennent par le moyen de ces mêmes termes. Aussi, comme je l’ai déjà dit, faut-il ramener toutes ces différentes idées à celle de l’échange en nature, et c’est le moyen de ne pas tomber dans cette méprise inconcevable, qui pourtant n’est que trop commune parmi nous.
Sitôt que nous ne verrons plus dans le commerce que des échanges en nature, nous regarderons les prétentions au renchérissement d’une marchandise, comme autant de chimères, et les renchérissements eux-mêmes comme des mots et rien de plus : toujours faudra-t-il que chacun reçoive telle quantité de telle ou telle marchandise, pour telle quantité de celle qu’il donne en échange : à vous permis de donner un grand nom à la valeur des marchandises que vous possédez ; cela m’est absolument indifférent, pourvu que dans la réalité, les échanges des choses commerçables entre nous se trouvent toujours faits dans la même proportion.
Le nom des valeurs numéraires peut changer pour les marchandises, comme il change pour l’argent même : qu’un prince double la valeur numéraire de ses monnaies, en résultera-t-il qu’on pourra se procurer le double des marchandises pour la même quantité réelle [251] d’argent ? C’est ainsi que quand on laisse les mots pour s’attacher aux choses, on trouve que malgré les changements qui surviennent dans les dénominations, la réalité se trouve toujours être la même ; que les échanges des choses commerçables se font dans une proportion qui n’a rien d’arbitraire ; que la concurrence enfin ne permet à personne de s’en écarter habituellement, et cela par des raisons qu’il serait inutile de répéter.
Voila comment les prétentions du vendeur et de l’acheteur, quoiqu’elles soient opposées entre elles, se concilient cependant parfaitement ; voilà comment chacun d’eux est obligé de se soumettre à la loi qu’il reçoit de la concurrence ; comment leur intérêt particulier se borne à profiter, tant en vendant qu’en achetant, des prix qu’elle a réglés : cela posé, il devient évident qu’ils sont liés par un intérêt commun ; qu’il leur importe à l’un et à l’autre, que leurs échanges occasionnent le moins de frais qu’il est possible ; car il est de toute nécessité que ces frais soient à leur charge ; aussi leur intérêt commun est-il tout l’opposé de l’intérêt particulier des commerçants, qui profitant d’une partie de ces frais, doivent naturellement chercher à les augmenter, du moins dans la partie destinée à rester dans leurs mains.
[II-302 / 252]
CHAPITRE XXXIX.↩
Suite du chapitre précédent. — Par qui sont payés immédiatement les profits ou les salaires des commerçants ? — Erreurs relatives à cette question. — Comment l’intérêt particulier des commerçants se concilie, par le moyen de la liberté, avec l’intérêt des autres hommes. — La profession des commerçants est cosmopolite : rapports de cette vérité avec la nécessité d’une grande liberté de commerce. — Différences essentielles et plus détaillées entre un peuple de commerçants et les nations agricoles et productives. — Quel est chez elles le véritable intérêt du commerce : besoin qu’il a de la liberté.
Je commencerai ce chapitre par l’examen d’un rien de grande importance aux yeux des politiques ; d’une question qui parmi eux est débattue avec chaleur, partage leurs opinions, et pourtant ne porte que sur des mots qu’on n’entend pas. Les uns prétendent que les profits des commerçants sont payés par les consommateurs, d’autres soutiennent que ces profits sont faits sur les premiers vendeurs : quant à moi, je dis que les deux partis ont tout à la fois tort et raison ; que séparément elles ne considèrent qu’une portion d’un tout qu’on ne peut diviser, et qui souffre également, quelle que soit la partie dans laquelle il se trouve blessé.
Les profits des commerçants doivent être placés dans la classe des frais ; par cette raison, ils concourent à fixer le prix que les marchandises doivent avoir dans le commerce. Un commerçant achète ici pour revendre dans d’autres lieux avec un bénéfice qu’on ne peut lui refuser : au moyen de ce bénéfice à faire par cet intermédiaire, le prix courant des marchandises qu’il trafique, est plus faible pour les premiers vendeurs, et plus fort pour les acheteurs-consommateurs ; la différence qui se trouve entre ces deux prix, est précisément la somme qui doit en rester dans les mains du commerçant pour ses salaires et les frais de ses opérations. La question se réduit donc à savoir si dans le cas où il ne retiendrait pas cette somme, le vendeur vendrait plus cher, ou si le consommateur achèterait à meilleur marché. Mais cette recherche n’a aucun objet, aucune sorte d’intérêt : chaque consommateur n’est-il pas alternativement acheteur et vendeur pour des sommes égales ? Et ne doit-il pas toujours régner la même proportion entre toutes les valeurs vénales, afin que les vendeurs fournissent aux acheteurs même les moyens d’acheter ?
Le prix courant de ce que je vends 100 francs devient 110 livres pour vous qui le consommez, et le prix courant de ce que vous [253] vendez 100 francs devient 110 livres aussi pour moi qui le consomme : il est évident que vous et moi nous perdons chacun 10 francs à ce marché, et qu’il est fort inutile d’examiner si c’est en vendant ou en achetant que nous faisons cette perte. Ce qu’il y a de certain, c’est que sans cette différence entre le prix du premier vendeur et celui du dernier acheteur, ou nous paierions chacun 10 francs de moins en achetant, ou nous recevrions 10 francs de plus en vendant ; par conséquent votre consommation et la mienne se trouveraient plus fortes d’un dixième.
Nous échangeons vous et moi 100 mesures de votre vin contre 100 mesures de mon blé : des circonstances nous obligent de placer entre nous un agent intermédiaire, qui pour les services qu’il nous rend, retient sur votre vin 10 mesures, et autant sur mon blé. Sur lequel de nous deux prend-il les 10 mesures de blé, sur lequel prendil les 10 mesures de vin ? Belle question ! ce sera sur qui l’on voudra ; mais toujours est-il vrai qu’il s’approprie la dixième partie de ce que, sans lui, votre vin vous permettrait de consommer en blé, et la dixième partie de ce que mon blé me permettrait de consommer en vin.
Telle est pourtant au fond cette question importante aux yeux d’un grand nombre de politiques, qui, pour la plupart, l’ont décidée de manière qu’ils se sont persuadé que les agents du commerce gagnent tout sur les étrangers, et rien sur la nation dont ils trafiquent les productions. C’est une telle chimère qui a fait éclore les privilèges exclusifs et les autres polices que chaque nation adopte pour donner des entraves à son commerce extérieur, et favoriser l’accroissement des profits de ses agents nationaux.
Comme toutes les erreurs s’entretouchent et se tiennent, il a bien fallu que pour étayer leur système, ces mêmes politiques regardassent les bénéfices faits par les agents nationaux du commerce, comme étant des bénéfices faits par l’État ; et qu’ils donnassent aux intérêts particuliers de ces agents, le nom d’intérêt du commerce, ou plutôt, le nom imposant d’intérêt général de l’État. Je ne crois pas qu’il soit possible de se tromper plus lourdement, car il n’y a rien de plus opposé à l’intérêt général de l’État que l’intérêt personnel de ces mêmes agents, lorsque pour les favoriser on les sépare des commerçants étrangers, et qu’on renonce à la concurrence de ces derniers en leur donnant l’exclusion.
Les frais pour parvenir à la consommation, qui est la fin que tout commerce se propose, se partagent nécessairement entre tous les consommateurs, parce qu’ils sont alternativement acheteurs et vendeurs, et qu’ainsi ce sont les vendeurs qui fournissent aux acheteurs les moyens d’acheter. Ces frais sont une dépense commune à laquelle [254] chacun d’eux contribue en raison de ce qu’il achète ou de ce qu’il vend ; ils ont donc tous un intérêt commun à diminuer cette dépense autant qu’il est possible ; au lieu que ceux qui profitent de cette même dépense, ont tous intérêt de l’augmenter.
Ainsi par rapport au commerce, la société générale des hommes ne doit se diviser qu’en deux classes ; l’une est celle des consommateurs qui font entre eux des échanges auxquels nous avons donné le nom de commerce ; l’autre est celle des agents intermédiaires qu’ils emploient souvent dans ces échanges, et auxquels nous avons donné le nom de commerçants, c’est-à-dire, d’hommes servant le commerce.
Rien de plus facile présentement que de fixer la véritable idée qu’on doit se former de l’intérêt du commerce, ou de l’intérêt général de l’État vu dans le commerce. 1°. On ne peut le chercher dans l’intérêt particulier des commerçants nationaux ; car il ne serait plus général ; 2°. Cet intérêt ne peut être autre chose que l’intérêt commun des consommateurs, car ce sont eux qui font le commerce, et ce n’est que pour eux que le commerce se fait ; d’ailleurs ce n’est que dans leur classe qu’on peut trouver les hommes qui constituent réellement l’État.
Ce qu’on nomme l’État est un corps politique composé de différentes parties unies entre elles par un intérêt commun qui ne leur permet pas de s’en détacher sans se préjudicier à elles-mêmes. Cette définition nous fait voir que l’État ne réside essentiellement que dans le souverain qui en est le chef, dans les propriétaires du produit net, et dans les entrepreneurs de culture ; car leur profession est locale ; ils ne peuvent se proposer d’aller l’exercer dans un autre pays, attendu que chaque pays ne comporte qu’un certain nombre de cultivateurs, qui déjà sont en possession du sol : d’ailleurs leurs effets mobiliers ne sont pas transportables comme l’argent, et ils ne pourraient, sans perte, les convertir en argent.
Il n’en est pas ainsi d’un commerçant considéré comme commerçant seulement, et abstraction faite des propriétés foncières qu’il peut avoir : chez quelque nation commerçante qu’il veuille s’établir, il y trouvera place pour sa personne et pour sa profession ; son émigration est même d’autant plus facile, qu’il n’est étranger dans aucun des lieux où s’étendent les relations de son commerce, et souvent sa fortune est répandue beaucoup plus au-dehors qu’au-dedans.
Le commerçant, en sa qualité de sujet du commerce, d’homme attaché au service du commerce, n’appartient exclusivement à aucun pays en particulier ; il est nécessairement cosmopolite, parce qu’il est impossible que sa profession ne le soit pas : en effet, le commerce extérieur se fait toujours entre plusieurs nations ; ainsi le commerçant, comme instrument du commerce, est nécessairement aux gages [255] de plusieurs nations à la fois, et son utilité est commune à toutes celles entre lesquelles se fait le commerce dont il est l’agent : qu’il soit Anglais, Français, ou Hollandais, les échanges entre les nations qu’il sert en même temps, doivent toujours se faire aux mêmes conditions pour elles, et leurs avantages réciproques doivent à cet égard être toujours les mêmes, pourvu qu’il ne leur vende pas plus cher, ou qu’il n’achète pas leurs productions à meilleur marché que ne feraient d’autres commerçants : aussi une grande liberté de commerce est-elle nécessaire pour mettre à l’abri de cet inconvénient.
Quand un commerçant achète il ne considère point de quel pays sont ses vendeurs ; quand il revend il ne considère pas plus de quel pays sont ses acheteurs : il n’est, et ne doit être occupé que de deux objets, du prix de ses achats, ses frais compris, et du prix de ses reventes : tous les acheteurs et tous les vendeurs sont, et doivent être égaux à ses yeux ; de quelque nation qu’ils soient, sa profession les traite, et doit les traiter tous de la même manière ; aucun d’eux ainsi n’est par rapport à lui, comme commerçant, ni plus ni moins étranger que les autres ; il est donc comme commerçant, véritablement cosmopolite, homme pour qui nulle nation n’est étrangère, et qui n’est étranger pour aucune nation.
Une autre preuve que les commerçants nationaux ne sont point, en cette qualité, partie des hommes qui constituent l’État, c’est que leurs richesses mobilières et occultes, ne font jamais corps avec les richesses de l’État, et même ne s’accroissent qu’aux dépens de celles de l’État. Il n’y a que les productions annuellement renaissantes dans l’État, qu’on puisse regarder comme richesses pour l’État, en raison de la valeur vénale qu’elles ont dans le commerce. Cette sorte de richesse est la seule qui devienne disponible, et qui puisse contribuer aux charges de l’État : impossible d’établir des impôts sur les salaires ou bénéfices des commerçants : un tel impôt n’est pour eux qu’une augmentation de frais, dont il faut qu’ils soient indemnisés comme des loyers de leurs magasins et des autres dépenses qu’ils sont obligés de faire. Mal à propos s’imagine-t-on qu’un impôt sur eux diminue leurs bénéfices : ceux-ci sont réglés par la concurrence ; subsistent ainsi nécessairement et indépendamment des frais dont ils ne peuvent se dispenser : s’ils se ressentent d’un tel impôt, ce ne peut être qu’autant qu’il augmente tellement leurs frais que les consommations en soient sensiblement diminuées : ils gagnent moins alors, parce qu’il y a moins de consommateurs en état de les employer.
Je ne m’arrêterai pas plus longtemps sur cette vérité que j’ai déjà démontrée dans les chapitres où j’ai traité de l’impôt : j’ai fait voir que ces sortes d’impôts indirects retombent toujours et nécessairement sur les produits de la culture ; mais ce que je dois ajouter ici, c’est [256] que si des besoins urgents mettaient l’État dans la nécessité de chercher des ressources en argent, il n’aurait aucun moyen pour se procurer l’argent de ses commerçants nationaux à meilleur compte que celui des commerçants étrangers : ces deux richesses en argent ne lui appartiennent donc pas plus l’une que l’autre ; au lieu que dans un tel cas les revenus des propriétaires fonciers lui préparent des secours qu’ils ont intérêt de ne pas lui refuser, parce qu’il importe à la sûreté de leur propriété de les accorder.
Nous avons vu précédemment que le produit net des terres est la seule richesse disponible dans une nation : l’intérêt commun du souverain et de cette nation est donc d’avoir le plus grand produit net possible ; or, ils ne peuvent obtenir cet avantage, qu’en retirant le plus grand prix possible de leurs productions. Le commerçant au contraire, quoique national, a un intérêt tout opposé ; car ce qu’il gagne est en diminution de ce même prix, et par conséquent du produit net qui fait la richesse unique du souverain et de la nation.
Le commerçant, considéré relativement à la nature de ses richesses, est donc cosmopolite, comme il l’est à raison de sa profession. Le terme de cosmopolite ne doit point être regardé comme une injure : je parle ici des choses et non des personnes ; de la profession du commerçant, et point du tout de ceux qui l’exercent ; il se trouve souvent parmi eux d’excellents patriotes, nous en avons des exemples, et j’en ai même quelquefois été témoin, tandis qu’il s’en trouve de très mauvais parmi les hommes attachés au sol par un droit direct ou indirect de propriété, ainsi que par leur profession. La bigarrure des sentiments, des affections purement morales ne doit être ici d’aucune considération : nous sommes partis de l’ordre physique, et nous n’envisageons les hommes que dans les rapports physiques qu’ils ont entre eux, parce que ces rapports sont les seuls qui soient évidents, qui ne varient point, et qu’on puisse calculer avec sûreté.
Le nom de cosmopolite que je donne ici aux commerçants doit également convenir à un militaire considéré comme militaire uniquement ; à un savant considéré comme savant ; à tout homme dont la profession peut s’exercer partout. Celle du commerçant diffère seulement des autres, en ce qu’il lui est impossible de servir une nation sans en servir une autre en même temps, et que ses opérations sont naturellement et nécessairement établies sur les territoires étrangers comme sur celui de sa nation.
Qu’on ne m’impute donc point de vouloir déprimer les commerçants : non seulement je crois toutes les professions utiles ; mais j’honore même la leur en particulier ; elle est peut-être la seule où l’on puisse trouver les grands procédés de la bonne foi ; cette franchise [257] qui ne se dément jamais ; cette confiance si respectable, qui fait que la parole est un contrat ; qui tient lieu de gages, de sûreté ; qui par les facilités qu’elle met dans les négociations, accélère et multiplie nos jouissances. Aussi cette profession est-elle précieuse à raison des talents qu’elle exige, des vertus morales qu’elle suppose, des services qu’elle rend à l’humanité : c’est par son entremise que toutes les parties de la terre s’entre-touchent ; que chaque climat parvient à s’approprier les productions et l’industrie des autres climats ; que les hommes se sentent unis les uns aux autres par le lien de leur intérêt commun ; que la société générale enfin développe tous ses avantages, et nous fait jouir de tout le bonheur qui nous est destiné.
Telle est l’idée que nous devons nous former des vrais commerçants : mais en même temps que je rends à cette profession l’hommage qui lui est dû, je me fais un devoir, pour elle-même, de ne point dénaturer ses intérêts, de ne point les faire sortir du rang où cet ordre immuable, l’ordre essentiel des sociétés, les a placés ; ce serait leur rendre un mauvais office : au lieu d’être les amis et les associés des autres hommes, ils deviendraient leurs ennemis. Je dis donc que malgré l’utilité dont ils sont, ils ne forment dans la société générale qu’une classe d’hommes salariés par tous les autres hommes, et servant toutes les nations indistinctement, tous les premiers propriétaires des choses commerçables. Dans cette position il est évident que les intérêts particuliers des commerçants nationaux ne sont point cet intérêt majeur que nous nommons l’intérêt du commerce ; que ce dernier au contraire consiste principalement dans l’intérêt commun de ces premiers propriétaires, les seuls qui dans chaque nation forment essentiellement le corps politique de l’État, parce que tous les avantages de leur existence sociale sont attachés à la conservation de l’État, et des liens qui les tiennent unis à l’État.
Si le commerce extérieur était institué de manière que l’intérêt de ces premiers propriétaires fût sacrifié à celui des commerçants nationaux, la masse des reproductions, et par conséquent des choses commerçables, diminuerait progressivement ; le commerce alors altéré dans son principe, serait lui-même l’instrument de sa ruine, et les commerçants enveloppés nécessairement dans ce désordre général, deviendraient bientôt les victimes de leurs intérêts mal entendus.
Si au contraire le commerce favorise, comme il le doit, l’intérêt de ces mêmes propriétaires, on peut compter sur les plus grands efforts possibles pour féconder la reproduction, par conséquent sur la plus grande abondance possible des choses commerçables ; les moyens de consommer se multipliant ainsi de toutes parts, chaque nation s’assure le plus grand commerce possible ; et dans ce cas les profits des commerçants doivent se multiplier comme les consommations. [258] Tel est donc l’avantage inestimable de l’ordre, qu’il n’est dans la société aucune classe d’hommes dont l’intérêt particulier, quand il est bien entendu, ne fasse partie de l’intérêt général, ou plutôt dont l’intérêt particulier, pour être bien entendu, ne doive être parfaitement d’accord avec l’intérêt commun de toutes les autres classes.
Plus vous creuserez cette réflexion, et plus vous trouverez que l’ordre de la nature ramène à l’unité toutes les sociétés particulières, et même toutes les classes particulières de chaque société ; qu’elles peuvent se différencier par les fonctions, mais jamais par les intérêts ; que sur ce dernier article les hommes sont tous associés par une nécessité naturelle et impérieuse à laquelle ils ne peuvent se soustraire ; qu’il est dans cet ordre immuable qu’ils soient tous utiles les uns aux autres, qu’ils jouissent tous les uns par les autres, qu’ils s’entre-servent tous mutuellement pour l’augmentation commune de leurs jouissances : si quelques-uns d’entre eux veulent s’écarter de cet ordre essentiel ; se séparer de cette société générale ; isoler leurs intérêts particuliers, les détacher de l’intérêt commun des autres hommes, tous leurs intérêts alors s’entre-choquent, s’entre-nuisent réciproquement : troublés par les contradictions dans lesquelles ils tombent à chaque pas, ils ne se proposent plus de remédier à un désordre que par un autre désordre ; bientôt l’art de s’entre-nuire devient l’étude dont chacun croit devoir s’occuper ; et de cette étude on voit naître des principes politiques qui ne peuvent servir qu’à augmenter la confusion et les maux qui en résultent nécessairement.
La manière dont l’intérêt bien entendu des commerçants tient à l’intérêt commun des autres hommes, sape par les fondements tout système qui tend à concentrer le commerce d’une nation dans une classe particulière de commerçants, pour en exclure toutes les autres classes ; par ce moyen vous diminuez la concurrence, vous l’énervez ; elle n’a plus assez de force pour obliger les agents de votre commerce de tenir au rabais leurs salaires ou leurs profits : de là s’ensuit que les consommateurs nationaux achètent plus cher et vendent à plus bas prix. Ainsi la plus grande liberté possible du commerce est évidemment le moyen unique de concilier l’intérêt particulier des commerçants nationaux avec l’intérêt commun de la nation : sans cette liberté ces deux intérêts sont toujours et nécessairement en opposition ; dès lors l’intérêt particulier se détruit lui-même en détruisant l’intérêt commun.
Qu’on ne dise donc plus aux puissances foncières, aux nations agricoles et productives : « Voyez tel et tel peuple » ; voyez comme ils s’enrichissent par le commerce ; et que leur exemple vous apprenne que l’intérêt du commerce est dans l’intérêt de vos commerçants. » [259] Nous pouvons désormais leur répondre : Il est naturel que chez un peuple qui n’est composé que de commerçants, l’intérêt du commerce ne soit vu que dans l’intérêt particulier de ces mêmes commerçants ; puisque ces peuples n’ont d’autres revenus, que les salaires qui leur sont payés par les nations qui se servent d’eux pour commercer entre elles, toute leur politique, toutes leurs vues doivent se tourner vers l’augmentation de ces salaires ; mais chez les nations agricoles et productives, l’intérêt du commerce est l’intérêt de la reproduction ; car c’est par le moyen de la reproduction, et pour la reproduction, que le commerce est institué ; c’est sur elles-mêmes que sont pris les salaires ou les bénéfices des commerçants ; la diminution de ces mêmes salaires, est donc ce qu’elles doivent se proposer, parce que cette diminution devient pour elles augmentation de richesses.
De tels peuples diffèrent des puissances foncières, en ce qu’ils ne forment point de véritables corps politiques, au lieu que ces puissances ont une consistance physique, et dont rien ne peut ébranler les fondements. En effet, chez ces peuples un commerçant ne tient à l’État par aucun lien qu’il ne puisse rompre aisément ; partout ailleurs il peut être également commerçant, faire les mêmes opérations et les mêmes profits. Il n’en est pas ainsi des hommes vraiment nationaux ; leurs intérêts les tiennent attachés au sol, de manière qu’ils ne peuvent que perdre en s’expatriant. D’ailleurs un peuple de commerçants n’existe que par le commerce qu’il fait des productions étrangères ; commerce qui demain peut lui être enlevé par d’autres nations. Son existence politique dépend de quelques préférences qu’il peut perdre d’un instant à l’autre ; ainsi le propre d’une puissance de cette espèce est de pouvoir être détruite sans coup férir, et sans injustice.
Une autre différence encore c’est qu’un peuple de commerçants, quels que soient leurs profits, ne peut jamais former un État riche, parce que la richesse des particuliers n’est point du tout celle de l’État : il est sensible qu’ils ne peuvent s’enrichir que par leurs économies ; or, l’autorité publique d’un État ne peut rien prendre sur le produit des économies ; car on n’économise que pour jouir ; et nécessairement vous devez cesser d’économiser, dès que les économies cessent de rester à votre profit. Ce n’est pas cependant que chez un peuple de cette espèce, la richesse des particuliers ne puisse quelquefois permettre à l’État de faire de grands efforts ; mais cela ne peut avoir lieu que dans des temps d’une grande effervescence, d’un grand enthousiasme : ces sortes d’évènements, qui sont des jeux de l’opinion, et qui tiennent à l’arbitraire, n’ont rien de commun avec [260] un ordre immuable qui renferme en lui-même le principe de sa durée.
Il n’y a donc que les nations agricoles et productives qui, en raison de leur territoire, peuvent fonder une grande puissance, une puissance solide : chez elles la richesse de chaque particulier n’est point un bénéfice fait sur un autre particulier de la même nation ou sur un étranger ; elle ne peut croître que par une plus grande abondance ou par une plus grande valeur vénale de ses productions ; cet accroissement par conséquent ne peut avoir lieu, que la richesse personnelle du souverain, ainsi que la richesse commune et disponible de la nation, ne croissent en même temps. L’intérêt du commerce est donc pour une telle nation l’intérêt de la culture ; c’est là le seul et véritable objet qu’elle doive se proposer dans son commerce extérieur, si elle veut le faire servir à l’accroissement de sa richesse et de sa population. Or, il est évident que pour remplir cet objet, la plus grande liberté possible est celle qui convient à son commerce extérieur ; que ce n’est qu’à la faveur de cette grande liberté, que le cultivateur peut être assuré du plus grand débit possible et au meilleur prix possible ; conditions sans lesquelles la plus grande abondance possible des productions ne peut jamais avoir lieu, ni donner à aucune nation et à son souverain, la plus grande richesse possible.
[II-326 / 261]
CHAPITRE XL.↩
Du meilleur état possible d’une nation ; en quoi il consiste ; besoin qu’il a de la plus grande liberté possible dans le commerce. — Fausses idées sur l’argent et sur la richesse d’une nation : sa véritable richesse n’est qu’une richesse en productions. — Une richesse en argent n’est que l’effet de la première, et ne s’entretient que par la première. — Différences essentielles entre ces deux sortes de richesses.
Le commerce n’est qu’un échange de valeur pour valeur égale. De cette définition a résulté 1°. Qu’il n’y a que les premiers propriétaires des valeurs échangées qui fassent le commerce ; 2°. Que l’intérêt du commerce n’est autre chose que l’intérêt commun de ces premiers propriétaires ; 3°. Que leur intérêt commun consiste à faire entre eux leurs échanges à moins de frais qu’il est possible ; à profiter ainsi, tant en vendant qu’en achetant, des prix que la concurrence fixe à chaque chose commerçable.
Ces premières notions du commerce rapprochées de la véritable idée qu’on doit se former du meilleur état possible d’une nation, de celui qui convient le plus aux intérêts personnels du souverain et à ceux de ses sujets, démontrent sans réplique la nécessité dont il est que le commerce jouisse de la plus grande liberté. Vous ne pouvez trouver ce meilleur état possible, que dans la plus grande richesse possible. J’entends ici par le terme de richesse, une masse de valeurs disponibles, de valeurs qu’on puisse consommer au gré de ses désirs, sans s’appauvrir, sans altérer le principe qui les reproduit sans cesse.
Le meilleur état possible est évidemment celui auquel est attaché la plus grande somme possible de jouissances, et la plus grande sûreté ; il consiste donc dans la plus grande masse possible de valeurs disponibles ; car ce sont les seules dont nous puissions toujours jouir, et sur lesquelles la sûreté puisse s’établir. Je dis que la masse des richesses disponibles est dans chaque nation la mesure de la sûreté politique, parce que c’est toujours en raison de cette masse, que croissent l’industrie, la population, et de plus cet intérêt que chacun prend à la conservation du corps politique ; intérêt qui naît naturellement de l’aisance dont nous jouissons, et qui nous rend capables de tous les sacrifices, de tous les efforts nécessaires à sa conservation.
Le sens dans lequel on doit prendre ici le terme de richesse étant ainsi déterminé, il devient évident que la plus grande richesse possible ne peut être que le résultat de la plus grande abondance possible [262] des productions nationales, jouissant constamment de leur meilleur prix possible; prix qui ne peut régner dans une nation, que par le moyen de la plus grande liberté possible dans son commerce. Prenez garde que je ne dis pas que le bon prix des productions ne peut s’établir que par un grand commerce ; mais bien par une grande liberté de commerce, cette observation est importante ; car le commerce n’a lieu qu’après que les prix ont été fixés par une concurrence qui ne peut résulter que de la liberté. Ainsi ce bon prix peut très bien exister avec une grande liberté sans un grand commerce extérieur, mais jamais avec un grand commerce extérieur sans liberté.
Le bon prix des productions est une condition doublement essentielle pour se procurer une grande richesse : au moyen de ce que c’est lui qui fait que les productions nous enrichissent, il se trouve que nous lui sommes encore redevables de leur abondance : il est évident que sans un bon prix, les cultivateurs manqueront tout à la fois de moyens et de bonne volonté pour provoquer l’abondance, dès que son produit net ne répondra point à la somme de leurs avances et de leurs travaux. Ainsi par les effets que le bon prix produit, nous pouvons juger de quelle importance est la liberté qui procure ce bon prix.
Je voudrais bien que mes lecteurs donnassent à cette vérité toute l’attention qu’elle mérite : je voudrais bien qu’ils saisissent que la richesse ne consiste que dans les valeurs disponibles, qu’on peut consommer sans aucun inconvénient ; par conséquent, qu’il n’y a que le produit net des cultures qui soit richesse, parce qu’il est, dans la masse des reproductions, la seule partie dont nous puissions disposer pour nos jouissances : le surplus de cette masse n’est pas disponible pour nous ; il appartient à la culture ; c’est elle qui tous les ans doit le consommer ; nous ne pouvons le lui dérober, que nous n’en soyons punis par l’extinction de nos richesses.
Rien de plus simple donc que l’enchaînement des vérités qui naissent ici les unes des autres : le seul produit net est richesse ; mais sans le bon prix et l’abondance, point de produit net ; or sans la liberté, point de bon prix, point d’abondance ; ainsi sans la liberté, point de produit net, point de richesse.
Il ne faut pas confondre cependant le bon prix, avec la cherté ; une marchandise est chère quand son prix est au-dessus de son niveau, quand il excède la mesure qu’il doit avoir, en proportion du prix des autres marchandises. J’ai déjà fait voir que ce désordre ne peut être qu’accidentel et momentané. Ce qu’on appelle cherté ne peut donc être l’objet de nos spéculations ; elle contraste avec un ordre institué pour ne jamais varier, parce qu’il n’admet aucuns [263] profits faits par les uns aux dépens des autres. Une marchandise peut être très chère quoique son prix soit médiocre en lui-même ; elle peut aussi n’être pas chère, quoiqu’elle soit d’un grand prix. La cherté, qui n’est aussi qu’un prix démesuré, commence par être à charge aux acheteurs, et retombe ensuite sur le vendeur ; il ne peut plus trouver le débit de sa marchandise.
Le bon prix est tout l’opposé de la cherté : il est précisément le prix qui naturellement et nécessairement se trouve attribué par la concurrence à chaque marchandise, et en raison de ceux des autres marchandises. Ainsi quel qu’il soit, il est toujours proportionné, et jamais démesuré ; il est enfin ce qu’il doit être pour l’intérêt commun des vendeurs et des acheteurs.
L’abondance habituelle et constante suppose toujours le bon prix ; le bon prix habituel et constant amène toujours l’abondance ; les deux forment ensemble ce qui constitue le meilleur état possible d’une nation. Il n’est point de vérités plus sensibles, plus évidentes par elles-mêmes ; et je ne crois pas qu’un homme raisonnable puisse élever quelque doute à cet égard. Mais ces principes admis, vous ne pouvez plus en rejeter les conséquences ; elles sont également marquées au coin de l’évidence : vous ne pouvez plus vous dispenser de convenir de la nécessité dont il est de procurer au commerce la plus grande liberté possible, afin que la plus grande concurrence possible vous fasse jouir du meilleur prix possible tant en vendant qu’en achetant.
Qu’est-ce que c’est que l’intérêt du commerce ? C’est l’intérêt de ceux pour qui se fait le commerce.
Qu’est-ce que c’est que la liberté du commerce ? C’est la liberté de ceux qui font le commerce, et qui sont les mêmes que ceux pour qui le commerce se fait.
Pourquoi cette liberté leur est-elle nécessaire ? Pour acheter et vendre au prix qui convient le mieux à leurs intérêts.
Quel est-il ce prix qui convient le mieux à leurs intérêts ? C’est celui que la concurrence assigne à chaque chose commerçable, et qui ne peut être établi que par la concurrence.
Par quelle raison ce prix est-il le plus avantageux à tous ceux qui commercent entre eux ? Parce qu’il est celui sans lequel les marchandises ne pourraient plus s’entre-payer, s’échanger les unes contre les autres ; au moyen de quoi bientôt les acheteurs manqueraient de vendeurs, et les vendeurs manqueraient d’acheteurs.
Qui sont donc ceux qui font le commerce, et pour qui le commerce se fait ? Ce sont les premiers propriétaires des choses commerçables, ceux qui concourent à les faire renaître annuellement pour les échanger entre eux. [264] Comment enfin le bon prix qu’ils retirent des productions est-il un objet si important ? C’est que ce prix est nécessairement la mesure des efforts qu’ils feront pour accroître leurs cultures, les améliorer, les féconder ; il décide par conséquent de l’abondance des reproductions futures, de la richesse du souverain et de la nation : essayez maintenant de rompre la chaîne que ces vérités forment entre elles.
En général, on n’a qu’une idée très fausse de la richesse, et conséquemment du meilleur état possible d’une nation. Nombre de gens, par le terme de richesse, n’entendent autre chose que de l’argent ; ils se persuadent que l’argent est le principe et la mesure de la prospérité d’une nation. Il est pourtant vrai, et je l’ai déjà fait observer, qu’avec plus d’argent on peut être plus pauvre. On ne consomme point l’argent en nature ; une richesse en argent ne se réalise que par l’échange qu’on en fait contre des choses usuelles : cette richesse n’est donc point une richesse absolue, une richesse par elle-même ; elle n’est au contraire qu’une richesse relative, une richesse dont la valeur dépend absolument de la quantité des choses usuelles qu’on peut se procurer en échange pour son argent.
Une autre preuve encore que l’argent n’est ni le principe, ni la mesure de la prospérité d’une nation, c’est que l’argent ne multiplie point les choses usuelles ; mais les choses usuelles multiplient l’argent, ou du moins lui impriment un mouvement qui tient lieu de sa multiplication : un seul écu qui change de main 100 fois, équivaut à 100 écus, et rend les mêmes services ; car il est parvenu successivement à représenter une valeur de 100 écus en marchandises. Qu’a-t-il donc fallu pour que les ventes de ces 100 parties de marchandises aient eu lieu ? Il a fallu ces 100 parties de marchandises, la liberté du mouvement nécessaire à leur consommation, et un seul écu. L’emploi qu’on a fait de ce seul écu, à l’occasion de ces 100 différentes ventes successives, pouvait même se répéter pour 1000, pour beaucoup plus encore ; et son utilité sera toujours la même, tant qu’il se trouvera dans le cas de servir de gage intermédiaire aux consommateurs qui auront des marchandises à échanger entre eux. Au moyen de ce seul écu et de 100 parties de marchandises, il s’est fait 100 ventes, 100 consommations, qui toutes ensemble ont valu 100 écus. Qu’on me dise à présent en quoi consistait la richesse des 100 consommateurs qui ont fait ces consommations ; si c’était dans le seul écu qu’un d’entre eux possédait, qui existe encore parmi eux, et qui n’a servi qu’à faciliter leurs échanges par sa circulation, ou si c’était dans les 100 parties de marchandises dont ils ont joui, et qui avaient pour eux une valeur réelle de 100 écus. [265] Si vous êtes embarrassé pour décider cette question, changez l’espèce ; donnez à ces consommateurs 100 écus avec une seule des 100 parties de marchandises supposées ; calculez maintenant combien vaudra leur consommation : en vain ferez-vous passer d’un acheteur à un autre cette partie de marchandise ; certainement elle ne grossira point en changeant de main ; après 100 ventes et reventes, elle ne sera qu’une marchandise d’un écu, et ne pourra jamais occasionner qu’une consommation de la valeur d’un écu. Faites plus encore : supprimez cet écu ; laissez renaître annuellement les 100 parties de marchandises ; disposez les choses de manière qu’elles puissent être échangées en nature, et dites-moi si la valeur de la consommation annuelle ne sera pas de 100 écus.
Qui ne sait pas que l’argent n’est qu’un moyen d’échange ? Que tous les jours même on le supplée par le crédit et le papier, de manière que les plus grandes affaires dans le commerce se font sans argent ? Mais tandis qu’il est divers expédients qui suppléent l’argent, il n’en est aucun pour suppléer les productions : quelle est donc la véritable richesse, ou de la chose dont on se passe très bien, ou de celle dont on ne peut se passer ?
Voyez maintenant combien vous vous tromperiez grossièrement, si vous vouliez juger de la richesse d’une nation par la multitude des ventes et des reventes qui se font dans son intérieur, et par le plus ou le moins d’argent qu’elle peut posséder. Qui dit richesse, dit moyen de jouir ; et cette définition vous montre évidemment qu’il n’y a de richesse qu’un produit net, un produit disponible ; car il n’y a que ce produit qui puisse être consommé par nos jouissances.
Dans ces climats fortunés où des millions d’hommes vertueux et véritablement hommes, ont été inhumainement égorgés par des monstres qui se croyaient plus saints, plus parfaits ; où des furieux ont employé le fer et le feu, pour établir une religion qui n’est que de grâce et d’amour, dans ces climats, dis-je, l’or et l’argent n’étaient point une richesse, parce qu’ils n’étaient point des moyens de jouir, des valeurs représentatives des choses qui servent à nos jouissances : il est vrai qu’ils le sont devenus parmi nous ; mais lorsque nous les considérons comme une richesse, il ne faut point, dans nos idées, les détacher de leur ensemble, les séparer de la véritable source qui nous donne les moyens de les acquérir, et de la manière dont nous pouvons en jouir.
Qu’on me permette de répéter ici que l’argent ne pleut point dans nos mains, ne croît point dans nos champs en nature : pour avoir de l’argent, il faut l’acheter ; et après cet achat, on n’est pas plus riche qu’on l’était auparavant ; on n’a fait que recevoir en argent, une valeur égale à celle qu’on a donnée en marchandises. Une nation [266] agricole est très riche, nous dit-on, quand on lui voit beaucoup d’argent ; on a raison sans doute de le dire ; mais on a tort de ne pas voir aussi qu’avant d’acquérir cet argent, elle était également riche, puisqu’elle possédait les valeurs avec lesquelles elle a payé cet argent ; elle ne peut même jouir de cette richesse en argent, sans la faire disparaître pour toujours, à moins qu’elle ne l’entretienne par la reproduction des valeurs dont la vente ou plutôt l’échange lui ont procuré une richesse en argent. Cette richesse en argent n’est ainsi qu’une richesse seconde et représentative de la richesse première à laquelle elle est substituée.
Il est donc évident que ceux qui, pour apprécier la richesse d’une nation, ne font attention qu’à la quantité d’argent qu’elle possède, prennent l’effet pour la cause ; car une richesse en argent n’est que l’effet d’une richesse en productions, converties en argent par le moyen des échanges. Entre ces deux sortes de richesses il est une grande différence : la richesse en argent, séparée de la source qui la reproduit pour vous, se dissipe par vos dépenses, de sorte que vous ne pouvez en jouir, sans vous appauvrir ; elle n’est ainsi que passagère ; au lieu que la richesse en productions se nourrit et se perpétue par la consommation même, tant que cette consommation n’est point de nature à altérer les causes naturelles de la reproduction.
Une autre différence encore ; c’est que par la raison qu’on ne peut faire de l’argent le même usage qu’on fait des productions ; qu’il ne nous sert, qu’autant que nous l’échangeons contre les choses qui, par elles-mêmes et immédiatement, satisfont à nos besoins, il se trouve que plus une nation a de productions, et moins elle a besoin d’argent pour jouir ; plus au contraire elle a d’argent, et plus elle a besoin de productions pour le convertir en jouissances. Ainsi celles qui recueillent chez elles beaucoup de productions, et dont le commerce tant intérieur qu’extérieur se fait avec une grande liberté, auront toujours assez d’argent ; tandis que celles qui ne recueillent qu’une quantité médiocre de productions, sont obligées, pour jouir, de faire le sacrifice de leur argent.
Je sais bien cependant que par leurs grandes économies, disons le mot, par leurs privations, des peuples dépourvus de productions, et ne faisant commerce que de leur main-d’œuvre, de leur industrie, peuvent parvenir à thésauriser, à se former une grande richesse pécuniaire ; mais impossible à eux de la conserver, s’ils veulent en jouir : en effet qu’est-ce qui leur aura procuré cette richesse pécuniaire ? Les privations auxquelles ils se seront soumis : si donc les privations cessent, voilà la source de leur richesse absolument tarie ; il faut nécessairement que leurs jouissances les appauvrissent. La singulière richesse, que celle dont on ne peut jouir qu’on ne l’anéantisse sans [267] retour ! Telle est pourtant une richesse en argent, quand elle se trouve isolée, et séparée d’une richesse en productions annuellement renaissantes : aussi, tout peuple qui ne possède qu’une richesse en argent, doit-il régler ses dépenses avec une économie qui ne convient point aux nations agricoles et productives : ceux-là s’enrichissent en ne consommant point ; et celles-ci se procurent, par la voie de la reproduction, une richesse disponible qu’elles perpétuent par la consommation même qu’elles en font.
Un homme a gagné par son industrie 100 mille francs : que fait-il pour en jouir ? Il les échange contre une autre espèce de richesse qui puisse lui donner une reproduction annuelle de 4 ou 5 mille livres ; par ce moyen, il fait tous les ans, et sans jamais s’appauvrir, une consommation de 4 ou 5 mille livres. Cet usage constant nous montre bien qu’une richesse en argent n’est point une véritable richesse, n’est point une richesse dont on puisse jouir sans inconvénient, à moins qu’elle ne soit l’effet d’une richesse en productions.
[II-343 / 268]
CHAPITRE XLI.↩
Suite du chapitre précédent. — Erreurs contraires aux vérités qui y sont démontrées. — Balance du commerce. — Fausseté des systèmes établis à cet égard : leurs contradictions, et les préjudices qu’ils causent à une nation et à son souverain. — Fausses spéculations sur l’accroissement annuel de l’argent en Europe ; comme cet accroissement doit nécessairement se partager entre les nations commerçantes. — Nécessité de la libre circulation de l’argent. — Comment sa masse peut grossir dans une nation et en indiquer la richesse.
Je l’ai déjà dit, et je le redis encore : les erreurs forment entre elles une chaîne comme les vérités : c’est parce qu’on a pris l’argent pour le principe et la mesure de la prospérité d’une nation, que les politiques ont adopté comme une maxime d’État, que le commerce extérieur n’était avantageux qu’autant qu’il faisait entrer beaucoup d’argent chez une nation sans l’en faire ressortir : de là, le système de toujours vendre et de ne jamais acheter, du moins, de vendre beaucoup et d’acheter peu des étrangers ; de là, l’invention de ce qu’on a nommé la balance du commerce ; de cette manière de comparer la somme des ventes en argent avec celle des achats en argent, pour juger, par le résultat de cette comparaison, à qui restait l’avantage du commerce ; de là, pour tout dire enfin, cette idée chimérique de commercer avec les autres nations pour gagner sur elles, pour s’approprier une partie de leur argent. Mais que dis-je ? Une partie ? C’est la totalité que cette fausse politique doit se proposer de dévorer ; car un tel système n’a point de bornes ; personne ne peut marquer le point fixe auquel ses spéculations doivent s’arrêter : dès qu’on admet qu’il est utile de gagner sur les autres nations, cette utilité doit nécessairement être toujours la même ; il faut donc étendre nécessairement aussi cette spéculation jusqu’à faire passer chez vous tout l’argent qu’elles ont chez elles ; il faut en un mot, que dans votre système, elles ne cessent de perdre, jusqu’à ce que vous les ayez réduites à une impuissance absolue d’alimenter vos profits en argent.
Eh bien, aveugle et cupide politique, je vais combler vos vœux : je vous donne toute la quantité d’argent qui circulait chez les nations avec qui vous commerciez : la voilà rassemblée chez vous ; que voulez-vous en faire ? Je vois déjà que vous avez perdu autant de consommateurs étrangers que vous en avez ruinés : vous en aviez besoin cependant ; et faute de ces consommateurs, qui ne peuvent se remplacer pour vous, il va se faire un vide dans la consommation de [269] vos productions ; une partie doit rester invendue, et dégénérer en superflu ; dès lors vos cultivateurs vendent, non seulement en moindre quantité, mais encore à moindre prix ; car l’effet de la surabondance est de faire diminuer les prix ; elles ne renaîtront plus pour vous ces productions qui sont réduites à manquer de débit.
Voilà donc le désordre dans la classe qui chez vous reproduit les valeurs disponibles ; voilà qu’une portion de vos terres va rester en friche ; que la diminution de la masse de vos productions va en occasionner une proportionnelle dans votre population ; avec une plus grosse masse d’argent, vous allez avoir moins de valeurs renaissantes, moins de travaux, moins d’hommes entretenus, moins de revenus réels, moins de moyens de jouir pour le souverain et pour les propriétaires fonciers ; quel avantage l’accroissement de cette masse d’argent vous aura-t-il donc procuré ? Celui d’être obligé d’employer 100 écus pour payer ce qui ne se vendait que 10 ; mais en cela je ne vois qu’un fardeau de plus, qu’un embarras de plus dans votre commerce intérieur.
Il est pourtant encore d’autres inconvénients attachés à cette révolution : 1°. Votre nouvelle opulence invite toutes les nations à venir reprendre sur vous par la force, ce que vous leur avez enlevé par votre politique spoliatrice. En second lieu, la cherté excessive de tout ce qui se vend dans votre intérieur, est garante que malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre, il entrera chez vous une grande quantité de marchandises étrangères, qui ne seront point échangées contre les vôtres, parce que les vôtres sont trop chères, mais bien contre votre argent, parce qu’il est à bas prix. Par cette voie, votre argent, tel qu’une rivière, qui ne pouvant plus être contenue dans son lit, s’élève au-dessus des digues qu’on lui oppose, se déborde, et répand ses eaux de tous côtés, votre argent, dis-je, refluera chez tous les étrangers qui ne cesseront d’introduire clandestinement chez vous des marchandises ; ce même argent alors ne reviendra plus à votre classe productive ; celle-ci verra ses ventes diminuer d’autant ; nouvel échec dans les revenus du souverain et des propriétaires fonciers ; nouvelle cause du dépérissement de votre agriculture ; nouvelle diminution dans la masse de vos productions et dans votre population : tel est l’ordre de la nature, que vous ne pouvez le violer qu’à votre propre préjudice.
Je ne finirais point si je voulais parcourir tous les inconvénients inséparables de la prétendue fortune que vous venez d’acquérir par votre commerce extérieur, ou plutôt dont je viens de vous faire un présent funeste ; il me suffit de vous faire observer qu’à peine est-elle faite, qu’elle se change en appauvrissement ; que votre ruine est une [270] suite nécessaire de vos succès : ils sont donc des désordres, puisqu’ils portent avec eux leur punition.
Pour combattre d’une manière plus victorieuse encore les idées bizarres qu’on s’est formées de la balance du commerce, et des avantages qu’on a cru trouver à rendre aux étrangers moins d’argent qu’on n’en reçoit d’eux, perdons de vue la brillante et chimérique hypothèse que je viens de présenter, suivons pas à pas les systèmes de la politique à cet égard, et voyons s’ils ne seraient point impossibles dans leur exécution.
Le commerce extérieur ne peut faire entrer chez une nation plus d’argent qu’il n’en fait ressortir, qu’autant qu’elle porte aux étrangers plus de marchandises que d’argent, et qu’en retour elle en reçoit plus d’argent que de marchandises. Mais si chaque nation policée, ou soidisant, adopte la même politique, il n’est plus possible qu’il se fasse entre elles aucun commerce ; toutes n’auront que des marchandises à vendre pour de l’argent, et aucune ne voudra donner son argent en échange des marchandises des autres. Comme une telle politique est contre nature, comme elle fait violence au penchant naturel qui porte les hommes à vendre pour acheter et jouir ; qu’ainsi elle ne peut s’établir qu’en détruisant toute liberté, chaque gouvernement fera valoir sa politique par les prohibitions et la force qu’il emploiera pour les faire observer : dans cette position respective, la société des nations n’existe plus ; les voilà rivales, jalouses, ennemies les unes des autres ; bientôt des guerres cruelles et destructives viendront les punir de leurs contraventions à l’ordre essentiel de cette société.
Plus nous analyserons cette politique, et plus ses contradictions se multiplieront à nos yeux : nous venons de la voir anéantissant tout commerce, quoique son but soit de faire de grands profits en argent par le commerce ; examinons présentement dans le détail, quels moyens elle emploie pour se ménager ces mêmes profits.
Le commerçant, agent intermédiaire du commerce extérieur, est un homme qui doit être indemnisé de tous ses frais ; il lui est dû en outre, des salaires, et des intérêts pour toutes les sommes qu’il est dans le cas d’avancer : lorsqu’en retour des productions exportées, il rapporte des marchandises étrangères, toutes les reprises de ce commerçant lui sont payées en commun, par la nation dont il exporte les productions, et par les étrangers dont il fait consommer aussi les marchandises. Mais lorsqu’en échange des productions exportées, il ne rapporte que de l’argent, ces productions deviennent le seul objet sur lequel ses reprises puissent s’exercer : quoique ses voitures ou ses vaisseaux reviennent à vide, il n’en fait pas moins les mêmes frais pour leur retour, si vous en exceptez ceux qui sont particulièrement occasionnés par les chargements et les déchargements, et ce sont des [271] articles peu importants. Ce n’est donc que sur le prix de ces mêmes productions exportées, qu’il peut prendre tout ce que ses opérations lui donnent le droit d’exiger. Cela posé, il est de toute nécessité qu’il achète d’autant moins cher les productions qu’il exporte ; car il ne peut les revendre chez les étrangers qu’au prix courant du marché général : ainsi le propre de cette façon de commercer est de faire baisser nécessairement le prix de ces productions dans l’intérieur de la nation cultivatrice qui en est première propriétaire.
Cet inconvénient ne frappe pas sur les seules productions exportées, il affecte encore toutes celles qui se consomment chez cette nation, 1°. Parce qu’une même espèce et qualité de marchandise n’a qu’un même prix courant pour tous les acheteurs ; 2°. Parce qu’il règne habituellement un équilibre nécessaire entre les valeurs vénales de toutes les productions d’une nation : ainsi par la seule raison que les productions exportées perdent une partie du prix qu’elles devraient avoir dans les mains des premiers vendeurs, toutes les autres productions, quoique consommées dans l’intérieur de la nation, sont contraintes de subir le même sort. Jugez maintenant quelle doit être la diminution des revenus communs du souverain et des propriétaires fonciers : heureux encore si cette perte était la seule que cette fausse politique leur fait éprouver, mais nous en découvrirons d’autres dans un moment.
Voici donc que, déduction faite des reprises des commerçants, la valeur des productions exportées revient en argent ; il s’agit de savoir ce qu’il va devenir.
Quelle que soit cette somme d’argent, elle n’est que le représentant d’une valeur semblable en productions cueillies sur le territoire de la nation qui les vend, et consommées par l’étranger qui les achète. Cet argent se distribue donc à tous les premiers propriétaires de ces productions : ainsi par le moyen de cet échange, s’il pouvait se renouveler tous les ans, il se trouverait que l’étranger serait assuré d’un revenu annuel en productions, quoiqu’il n’en cueillît point, et que la nation supposée ne recevrait qu’un revenu annuel en argent, quoiqu’elle cueillît ces mêmes productions. Qu’on me dise donc de quelle utilité lui sera ce revenu en argent, si elle ne le convertit pas en choses usuelles, en choses propres à procurer des jouissances. Mais si elle veut faire cette conversion, comment pourra-t-elle y parvenir, puisque les choses usuelles ne se trouvent plus chez elle, et qu’elle ne veut point acheter de celles qui sont chez l’étranger ?
Peut-être me demandera-t-on pourquoi il ne se trouve plus dans cette nation une quantité de choses usuelles dans l’achat desquelles elle puisse dépenser son revenu en argent ; mais la raison en est bien simple : puisqu’elle a vendu aux étrangers une portion de marchandises [272] pour de l’argent, cela fait qu’il se trouve chez elle plus d’argent et moins de marchandises ; qu’ainsi la somme d’argent qu’elle a reçue de l’étranger, ne peut plus trouver à s’employer. Développons cette vérité, car elle est d’une grande importance.
Distraction faite de la portion des denrées que le souverain, les propriétaires fonciers et les cultivateurs consomment en nature, divisons les productions en deux parties, dont l’une est vendue aux étrangers, et l’autre à la classe industrieuse. Sur la partie que cette classe achète, elle doit prendre toutes ses consommations, et le surplus doit être revendu par elle en argent, aussi cher qu’elle l’a payé. Si elle le revend moins, elle se ruine, et ce commerce ne pourra bientôt plus avoir lieu ; si elle le revend plus, elle s’enrichit aux dépens du souverain, des propriétaires fonciers ; elle diminue la masse du produit net, et altère un des principes de la reproduction. Ainsi pour que personne ne soit lésé, l’ordre veut que l’argent déboursé par la classe industrieuse lui revienne, mais aussi qu’il ne revienne que la même somme, et que par ce moyen il se fasse une circulation qui ne puisse jamais être interrompue.
Les premiers propriétaires des productions vendues à la classe industrieuse doivent donc avoir dans leurs mains l’argent qui suffit à payer les ouvrages que cette classe se trouve à son tour avoir à leur vendre ; par conséquent celui que ces propriétaires reçoivent de l’étranger, ne peut plus trouver à s’employer dans la nation. Dans une telle position il est moralement impossible qu’ils n’achètent pas à l’envi les ouvrages de la classe industrieuse, et qu’ils ne les fassent pas renchérir fort au-dessus du prix que ces ouvrages devraient naturellement avoir ; car dans le cas supposé toute autre jouissance leur est interdite, et la concurrence des vendeurs étrangers ne vient point donner des lois à la cupidité des vendeurs nationaux de ces mêmes ouvrages.
Deux effets doivent alors nécessairement résulter de ce renchérissement : une double diminution dans la richesse et les jouissances du souverain et des propriétaires fonciers, et l’enrichissement de la classe industrieuse à leur préjudice. Ces conséquences paraissent peut-être un peu précipitées ; mais voici le développement méthodique et graduel des liaisons qu’elles ont avec leur principe.
Le renchérissement des travaux de la main-d’œuvre ne produit-il pas le même effet qu’une diminution réelle du revenu des propriétaires fonciers et du souverain ? Voilà donc déjà une première perte. Mais ce renchérissement peut-il avoir lieu sans frapper aussi sur les cultivateurs, et par contre-coup, sur les avances de la culture ? Voilà donc encore une seconde perte ; car de cette charge indirecte sur les avances de la culture, résulte une diminution dans la masse des [273] productions ; diminution qui, comme nous l’avons déjà fait voir, doit être entièrement supportée par les co-propriétaires du produit net.
Le résultat d’un tel système est donc tel que je viens de le présenter : il doit opérer l’appauvrissement du souverain et des propriétaires fonciers, et l’enrichissement de la classe industrieuse à leurs dépens. Mais comme tout se tient, et qu’il n’est point de désordre qui n’ait ses contre-coups, il nous faut encore examiner qui sont ceux de ce dernier inconvénient. Je demande donc quel usage la classe industrieuse fera de l’argent qu’elle gagne ainsi chaque année sur les premiers propriétaires des productions : certainement elle ne l’emploiera point en acquisitions de terres ; car dans notre hypothèse, l’état du propriétaire foncier est un mauvais état, au lieu d’être le meilleur état possible. Il faudra donc que les agents de l’industrie, à mesure qu’ils auront fait fortune, aillent avec leur argent s’établir chez l’étranger.
En dernière analyse, que gagnez-vous donc à vouloir toujours vendre aux étrangers sans rien acheter de leurs marchandises ? Vous leur échangez vos consommations, vos jouissances pour de l’argent que vous ne pouvez conserver, et qui ressortira de vos mains sans qu’il ait pu vous être utile. Cependant pour acheter ce triste et ridicule avantage, vous commencez par enlever à vos productions une portion de la valeur vénale qu’elles devraient avoir ; vous aggravez cette perte pour leurs premiers vendeurs, en faisant renchérir le prix qu’ils sont obligés de mettre aux ouvrages de la main-d’œuvre ; vous altérez ainsi la masse des reproductions en faisant supporter aux avances de la culture une partie du poids de ce renchérissement ; comptez-bien ; vous allez trouver le souverain et les propriétaires fonciers grevés de trois manières ; ils le sont par la diminution du prix des productions ; ils le sont par une autre diminution dans leurs récoltes ; ils le sont par le renchérissement d’une partie des choses qu’ils sont obligés d’acheter. Livrez-vous à tous les jeux de votre imagination ; choisissez entre toutes les suppositions que vous pourrez inventer ; je vous défie d’en trouver une qui puisse vous mettre à l’abri de tous ces inconvénients à la fois.
Toutes les différentes suppositions auxquelles l’imagination puisse se prêter un moment, se réduisent aux deux que voici : que les ouvrages de l’industrie ne renchériront point, ou que s’ils renchérissent, les productions renchériront à proportion.
Si les ouvrages de l’industrie ne renchérissent point, l’argent provenant des ventes faites à l’étranger est donc destiné à rester oisif dans les mains des premiers propriétaires des productions, à ne leur procurer aucunes jouissances. Mais dans ce cas pourquoi veut-on [274] qu’ils achètent, par des privations, un argent qui doit n’être pour eux d’aucune utilité ? Un tel argent n’est plus une richesse, dès qu’il n’est plus un moyen de jouir ; cet état au contraire est un appauvrissement très réel ; car être pauvre c’est être privé des moyens de jouir.
L’avare, cet esclave d’une passion qui le laisse manquer de tout pour enfouir son argent, est très véritablement pauvre : nous plaignons son aveuglement, et cependant le système de ce malheureux n’est en petit que ce que votre système politique est en grand ; car s’il est bien que les co-propriétaires du produit net se privent du quart ou du tiers de leurs jouissances pour s’enrichir en argent, il sera mieux encore qu’ils se privent de la totalité pour augmenter chez eux ce même argent. D’après les impulsions des mobiles qui sont en nous, les hommes ne sont avides des richesses en argent, que parce qu’ils sont avides des jouissances qu’on obtient par le moyen de ces richesses : tous désirent ainsi de s’enrichir pour jouir ; mais dans le système factice de notre politique, il faut renoncer à jouir pour s’enrichir ; cette seule contradiction suffit pour caractériser son absurdité.
Votre seconde ressource est de supposer que l’augmentation du prix des productions suivra celle du prix de la main-d’œuvre : ne vous égarez pas ici dans de vains raisonnements ; cette supposition est physiquement impossible : vous avez besoin des étrangers pour opérer la consommation totale de vos productions, puisque vous leur en vendez tous les ans une partie ; mais vous ne pouvez les leur vendre au-dessus du prix courant du marché général, et sur ce prix, il faut que les commerçants prélèvent toutes les reprises qu’ils ont à faire ; car les étrangers, qui ne vous vendent rien, ne paient pour vos productions, que le prix courant du marché général, et rien de plus. Or il est constant que le consommateur national n’achètera pas dans son propre pays, plus cher que le consommateur étranger ; que si ce dernier cesse d’acheter, vous manquez d’un débit suffisant pour vos productions ; et que toute fois que la reproduction excède la consommation, le prix de la marchandise surabondante doit diminuer au lieu d’augmenter. Cette supposition renferme ainsi deux choses absolument contradictoires : le renchérissement de vos productions, et néanmoins la continuation de leur vente aux étrangers.
Si je voulais analyser plus particulièrement cette même supposition, j’y trouverais encore d’autres contradictions ; mais celle-ci suffit : revenons donc à votre première hypothèse, et supposons, contre toute vraisemblance, que le produit en argent des ventes faites à l’étranger reste oisif dans les mains du souverain et des propriétaires fonciers, et qu’au moyen de son oisiveté, les ouvrages de l’industrie ne soient vendus qu’à leur prix naturel et nécessaire : dans [275] ce cas même, le moins défavorable de tous, vos prétendus avantages ne seront pas de longue durée : par la raison que les étrangers ne vous vendent rien, leur richesse en argent diminue nécessairement ; bientôt ils sont forcés d’acheter une moindre quantité de vos productions, ou de vous en donner un moindre prix, ou plutôt même de faire les deux à la fois : de toute façon, la diminution du produit de vos ventes est un malheur inévitable pour vous ; et ce malheur est d’autant plus grand, qu’il entraîne après lui une autre perte bien plus grande encore ; il enlève à toutes les productions qui se consomment dans l’intérieur de la nation, une partie du prix courant qu’elles avaient ; car encore une fois, le prix courant est un prix commun, pour tous les acheteurs, et toutes les valeurs vénales ont entre elles un équilibre habituel et nécessaire ; le prix des unes décide du prix des autres.
Il est donc évident que cette diminution de la valeur vénale et du débit de toutes vos productions doit être progressive ; ainsi pour peu qu’un tel désordre continuât, tout le territoire de votre nation se trouverait en non valeur : alors il ne vous faudrait que des yeux pour voir évidemment que la manière dont vous comptez vous enrichir aux dépens des autres nations, n’est qu’un secret pour ruiner le souverain et l’État.
Une objection à laquelle je m’attends, c’est que la masse de l’argent croissant d’année en année dans notre continent, le système en question peut, sans nul inconvénient, se réduire à s’approprier cet accroissement, du moins pour la majeure partie : je le veux bien, mais à condition que ce sera pour en jouir ; car enfin, jouir est le motif et l’objet ultérieur de tous nos travaux, de toutes nos spéculations : aussi voyons-nous qu’en général, si quelqu’un suspend ses jouissances, ce n’est que dans la vue d’augmenter ses jouissances à venir.
Cependant si vous prétendez jouir de cet accroissement d’argent, sans le faire repasser aux étrangers ; si vous comptez toujours qu’ils achèteront de vous beaucoup plus qu’ils ne ne vous vendront ; si vous parvenez, en un mot, à augmenter la masse de votre argent bien au-delà de ce qu’elle augmente chez les autres nations, toutes proportions gardées, il en résultera que cet argent diminuera chez vous de valeur vénale, tandis qu’il conservera toujours sa même valeur vénale dans les autres pays ; je veux dire, qu’à mesure que vos richesses en argent se multiplieront, il en faudra donner une plus grande quantité en échange des choses usuelles ; mais sitôt qu’il faudra 2 écus pour acheter de vous ce qui ne se vend qu’un écu chez les autres, ils vendront, et vous ne vendrez plus ; ainsi vos marchandises qui se consommaient au-dehors, resteront invendues : les suites [276] funestes de cet engorgement vous feront bientôt connaître que ce que vous avez regardé comme un bien, est pour vous le principe de beaucoup de maux ; qu’il est une proportion naturelle, suivant laquelle chaque nation commerçante doit participer à l’accroissement annuel de l’argent en Europe ; que prétendre excéder cette proportion, est une spéculation dont le succès ne peut être ni durable ni avantageux.
Observez cependant qu’une nation qui n’aurait que de l’argent à vendre, formerait une exception à la loi commune, qui règle entre les nations commerçantes le partage à faire dans l’accroissement de l’argent. Plus l’argent se multiplie, et plus il perd de sa valeur vénale, tandis que les autres marchandises augmentent de valeur par rapport à lui : cette contrariété de progression dans les révolutions des valeurs serait évidemment au détriment de la richesse d’une nation qui ne cueillerait chez elle que de l’argent : obligée de le cultiver par l’entremise des productions étrangères, d’année en année les frais de cette culture augmenteraient pour elle, tandis que la valeur vénale de l’argent qu’elle récolterait diminuerait ; elle s’appauvrirait de jour en jour.
Je n’ai jamais conçu comment la politique pouvait s’occuper sérieusement des moyens d’augmenter chez une nation la masse de l’argent. Je conçois bien moins encore qu’elle puisse se proposer d’obtenir cette augmentation par l’enchaînement de la liberté de son commerce : l’accroissement annuel de cette masse d’argent dans chaque nation commerçante, est un effet naturel et nécessaire de cette liberté ; et ce n’est que par cette liberté qu’il peut s’opérer.
Les nations qui exploitent les mines d’or et d’argent, multiplient ces matières dans notre continent. Cette exploitation les met dans le cas de faire une grande consommation de productions étrangères ; et quand elles ne seraient pas obligées d’envoyer ces productions dans les lieux dont elles tirent l’or et l’argent, il est évident que pour convertir ces matières en jouissances, elles seraient encore dans la nécessité de recourir aux autres nations, et d’en acheter les marchandises usuelles.
Les nations d’Europe commerçantes se divisent donc naturellement en deux classes ; les unes mettent dans le commerce plus de productions que d’argent, et les autres plus d’argent que de productions : ainsi, ce que vous appelez la balance du commerce, doit être nécessairement chaque année au profit des premières, à quelques variations près, qui ne peuvent être que momentanées.
Il ne faut donc point regarder comme le fruit d’une politique profonde, l’avantage d’augmenter chez une nation la masse de l’argent : cet accroissement s’opère de lui-même, quand on ne fait rien pour [277] l’empêcher ; il est l’effet nécessaire de la liberté, puisque c’est par la liberté que se multiplient les valeurs qui doivent être échangées contre l’argent, et que ce n’est qu’en raison de ces valeurs, que la masse de l’argent peut s’accroître chez tous les peuples qui font commerce de leurs productions.
L’argent est une espèce de fleuve sur lequel on voiture toutes les choses commerçables, et qui arrose tous les lieux où s’étend le commerce. Voulez-vous vous en procurer une grande abondance ? multipliez, creusez, élargissez les canaux qui le reçoivent ; mais disposez-les aussi de manière que rien ne puisse ralentir son cours : il ne doit faire que passer ; et la liberté de sa sortie doit être égale à la liberté de son entrée ; car le volume qui entre perpétuellement, se mesure toujours, et nécessairement sur le volume qui sort. Si pour le retenir chez vous, vous arrêtez son écoulement naturel, vous cesserez bientôt d’en recevoir la même quantité que la nature vous avait destinée ; en tout cas, ce que vous en possédez ne pourra s’accroître que pour vous occasionner de grands ravages par ses inondations, tandis que l’interception de son cours, ne vous permettant plus de vous en servir pour l’exportation de vos marchandises, vous perdez ainsi toute l’utilité que vous deviez en retirer.
Il est sensible que les canaux désignés par cette comparaison, pour recevoir l’argent, sont toutes les productions territoriales qu’une nation peut vendre aux étrangers, et que l’argent qui entre par ce moyen, doit ressortir par des achats qu’elle fait chez eux pour des sommes égales à celles de ses ventes. À mesure que la masse de l’argent s’accroît, il perd de son prix ; et conséquemment il entre en plus grande abondance ; vous en possédez ainsi toujours une plus grande quantité, quoique vous en fassiez ressortir une plus grande quantité. La même augmentation encore a lieu, si pour multiplier vos achats chez les étrangers, vous parvenez à multiplier les ventes que vous leur faites. Mais cet avantage alors suppose nécessairement la multiplication de vos productions, et en outre une grande liberté de vendre et d’acheter ; car richesse c’est moyens de jouir ; ainsi sans la liberté de jouir, les productions ne peuvent plus ni devenir de véritables richesses, ni se multiplier.
En considérant l’argent dans le point de vue où cette comparaison nous le présente, je conviens qu’on peut juger de la richesse d’une nation agricole par la quantité d’argent qu’on voit chez elle : cette quantité, qui sans cesse se renouvelle, est toujours proportionnée à la quantité et à la valeur vénale de ses productions, en un mot, au montant des ventes qu’elle est en état de faire annuellement aux autres nations. Mais ne nous y trompons pas : l’argent alors n’est que le signe de la richesse ; il l’annonce et ne la fait point ; aussi [278] est-ce d’après l’argent qui passe librement chez cette nation, et non d’après l’argent qui y demeure engorgé, que nous pouvons nous former une idée juste de sa véritable richesse ; de celle qui est disponible pour elle, dont elle peut jouir annuellement sans s’appauvrir ; disons plus, dont elle doit nécessairement jouir, si elle veut la perpétuer.
[II-371 / 279]
CHAPITRE XLII.↩
Suite du chapitre précédent. — Fausse idée des produits de l’industrie. — Erreurs résultantes de l’illusion que font ces produits apparents. — Quand et comment l’industrie manufacturière peut être utile au commerce des productions. — Elle n’en augmente jamais les valeurs au profit de la nation. — Nécessité d’une grande liberté à tous égards pour rendre cette industrie utile à la nation. — Contradictions et inconvénients des systèmes opposés à cette liberté.
Le terme de richesse a, dans notre langue, diverses significations : tantôt nous l’employons pour exprimer l’état habituel d’une personne ; et tantôt le substituant à celui de valeurs, nous le donnons aux choses, à raison de l’utilité dont elles sont à nos jouissances. Il est donc naturel qu’on ait regardé l’argent monnaie comme une richesse, puisqu’en général, on peut, avec de l’argent, se procurer toutes les choses qu’on désire, pourvu que leur valeur vénale n’excède pas celle de ce même argent.
L’argent figure dans le commerce comme le représentant de toutes les marchandises propres à nos jouissances, sans cependant être par lui-même aucune de ces marchandises. Les hommes éblouis par le brillant de cette faculté représentative, ont insensiblement pris l’argent pour les choses usuelles qu’il représente ; ils ont perdu de vue que son utilité n’est ni à lui, ni en lui ; qu’elle est au contraire dans les choses usuelles qu’on se procure par son moyen.
Cette illusion a produit deux effets ; le premier de nous empêcher de voir que si l’argent représente, dans nos mains, les choses que nous pouvons désirer d’acheter, il y représente aussi les choses que nous avons vendues pour avoir cet argent ; le second est de nous accoutumer à confondre les différentes idées qu’on attache au terme de richesse ; à juger de la richesse personnelle et habituelle par la somme des valeurs en argent qu’on possède, sans examiner si les possesseurs ont ou n’ont pas les moyens de renouveler ce même argent, après qu’ils l’auront dissipé par leurs jouissances.
Nous regarderions comme insensé tout homme qui, sans des raisons fort extraordinaires, ferait plus de cas d’une somme de 100 mille francs en argent, que d’un revenu annuel de la même valeur : telle est pourtant notre folie, lorsque nous ne prisons la richesse habituelle d’une nation, que par la quantité d’argent qu’elle possède, sans faire aucune attention à la différence énorme qui se trouve entre avoir ou n’avoir pas une reproduction annuelle, qui tous les ans lui [280] restitue la même valeur en argent, et lui permette ainsi tous les ans de le dépenser en consommations.
Parmi les valeurs qui peuvent exister dans une nation, il faut toujours distinguer celles qui sont accidentelles, de celles qui sont habituellement renaissantes : les premières, tant qu’elles existent, forment une richesse ; mais elles ne continuent d’être les mêmes qu’autant qu’on n’en jouit pas. Les secondes au contraire, se renouvelant constamment chaque année, forment une richesse habituelle qui est la véritable richesse, parce que chaque année on peut en jouir sans s’appauvrir.
Il n’est personne qui ne sente la nécessité de la distinction que je viens de présenter ; personne qui ne sache combien une richesse toujours renaissante diffère de celle que la jouissance éteint sans retour. Comment donc la richesse habituelle d’une nation peut-elle être envisagée séparément de la valeur vénale de ses reproductions annuelles ? Comment a-t-on pu perdre de vue que cette valeur est l’unique richesse qui lui permette de renouveler perpétuellement ses jouissances ; que l’argent ne peut jamais être une richesse habituelle, qu’autant qu’il est le prix et le représentant de cette même valeur ?
On me fera sans doute une grande querelle sur ce que jusqu’ici je n’ai fait consister la richesse habituelle d’une nation que dans l’abondance et la valeur vénale de ses reproductions annuelles, sans faire aucune mention des produits de l’industrie. Il est reçu partout comme article de foi que l’industrie donne des produits, et de très grands produits ; que c’est elle qui enrichit les nations, par la manière dont elle augmente les valeurs vénales des matières premières. Cette erreur a coûté bien cher à l’humanité : combien de valeurs réelles, combien d’hommes sacrifiés à ce préjugé ! Je vais donc essayer d’en démontrer tout le faux ; c’est un des services les plus importants qu’on puisse rendre à la société.
Je commence par observer que le prix des ouvrages de l’industrie n’est point un prix arbitraire, qui puisse augmenter au gré de l’ouvrier, ou diminuer au gré des acheteurs : nous devons au contraire le regarder comme étant un prix nécessaire, parce qu’il est nécessairement déterminé par toutes les dépenses dont il faut que l’ouvrier soit indemnisé ; dépenses qui sont elles-mêmes réglées par la concurrence, de manière que chaque ouvrier n’est pas libre de les augmenter selon sa volonté. Le prix nécessaire de chaque ouvrage n’est donc autre chose qu’une somme totale de plusieurs dépenses additionnées ensemble, et dont le vendeur de l’ouvrage a droit d’exiger des consommateurs le remboursement, parce qu’il est réputé les avoir faites, dès qu’elles n’excèdent point la mesure fixée par la concurrence des hommes de sa profession. [281] Je demande présentement d’où proviennent les choses dont la consommation forme la dépense nécessaire de l’ouvrier, et le prix nécessaire de son ouvrage ? Est-ce l’industrie elle-même qui en est créatrice ? Ou bien est-ce la culture qui les fournit par la voie de la reproduction ? Si c’est la culture, comme on ne peut en disconvenir, il est évident que le prix nécessaire d’un ouvrage de main-d’œuvre, se proportionne toujours et nécessairement au montant des valeurs en productions consommées par l’ouvrier ; que ce prix ne fait que représenter dans une nation, une valeur égale en productions qui n’existent plus ; qu’en cela la richesse première de cette nation n’a fait précisément que changer de forme, sans rien gagner à ce changement, si ce n’est une facilité de plus pour étendre la consommation ; par conséquent, que toute fois qu’elle pourrait vendre en nature aux étrangers, les productions que l’ouvrier consomme, et les leur vendre au même prix qu’il les paie, il est très indifférent pour elle de les vendre sous une forme ou sous une autre, puisque de toute façon elle n’en reçoit que le même prix, et ne se trouve avoir que la même richesse.
L’ouvrier ne peut-il donc vendre ses ouvrages à l’étranger plus cher que leur prix nécessaire ? À cela je réponds, 1°. Que la concurrence générale des autres vendeurs l’en empêchera ; 2°. Que cette cherté ne peut avoir lieu que dans le cas où un talent unique et supérieur n’aurait point de concurrents ; mais qu’alors aussi cette cherté retombera sur la nation même, sur les premiers vendeurs des productions : ou ils se priveront de la jouissance d’un tel ouvrage, ou ils seront mis, comme l’étranger, à contribution par l’ouvrier qui en sera vendeur ; car l’étranger et la nation ne lui achèteront pas plus cher l’un que l’autre.
Ces deux manières de commercer les productions nationales peuvent cependant différer entre elles, suivant les circonstances : il est des cas où la main-d’œuvre peut être nécessaire pour procurer un plus grand débit : alors elle est utile ; mais il ne faut pas prendre son utilité pour la faculté de produire ou de multiplier les valeurs : cette utilité prend sa source dans celle de la consommation même qu’elle provoque : personne ne conteste que la consommation ne soit nécessaire à la reproduction ; celle-là cependant est tout l’opposé de celle-ci.
Il arrive quelquefois encore qu’à l’aide de l’industrie qui manufacture les matières premières, on parvient à éviter de gros frais de transport, par conséquent à procurer aux premiers vendeurs de ces matières un débit plus avantageux : dans ce dernier cas, l’industrie est encore utile, sans cependant qu’on puisse lui attribuer aucune multiplication de valeurs ; on lui est seulement redevable de la cessation [282] des obstacles qui s’opposaient au débit des productions, et de la suppression des frais qui les auraient privés d’une portion du prix qu’elles doivent avoir suivant le cours du marché général. Dans toutes ces circonstances, la somme des valeurs en ouvrages d’industrie n’est jamais que la représentation d’une somme égale de valeurs en productions consommées : ce sont, pour ainsi dire, des productions qu’on vend sous une forme nouvelle, et pour la même valeur qui leur était acquise avant qu’elles en changeassent ; ainsi toute nation qui vend, par exemple, pour 20 millions en ouvrages de son industrie, ne parvient à faire cette vente, que par une dépense de 20 millions en productions.
Si vous voulez voir cette vérité dans toute sa simplicité, réduisez à deux classes seulement la société générale des hommes : vous en formerez une de tous les premiers propriétaires des productions, et l’autre de tous les agents de l’industrie : voyez maintenant s’il est une classe qui puisse porter constamment à l’autre plus de valeur en argent qu’elle n’en reçoit. Supposons que la classe propriétaire des productions en vende pour 100 mille francs aux agents de l’industrie ; n’est-il pas évident qu’ils ne peuvent à leur tour lui vendre que pour 100 mille francs d’ouvrages de main-d’œuvre ? S’ils vendaient moins ils se ruineraient, et ne pourraient plus continuer d’acheter ; s’ils voulaient vendre plus, la classe propriétaire ne pourrait les payer ; n’ayant reçu que 100 mille francs, elle ne peut leur rendre que 100 mille francs.
À quoi se réduisent donc les opérations de ces agents de l’industrie ? À acheter pour 100 mille francs de productions ; à prendre sur cette masse leurs consommations nécessaires ; à revendre le surplus manufacturé, et pour le même prix auquel ils ont payé la totalité. Ainsi après ces opérations, il se trouve sous une forme nouvelle, une valeur de 100 mille francs représentative d’une valeur égale en productions qui n’existent plus. La richesse première n’a donc fait en cela que changer de forme sans augmenter.
Si l’argent ne venait pas ici compliquer les opérations et les idées, vous verriez que les agents de l’industrie, bien loin d’enrichir la classe propriétaire des productions, ne sont pour elle qu’une charge, qu’un sujet de dépense. De cette charge, direz-vous, il résulte une utilité pour cette classe propriétaire ; oui sans doute ; et c’est à raison de cette utilité, qu’elle entretient les agents de l’industrie ; elle cultive pour eux, afin qu’ils travaillent aussi pour elle : mais encore ne fautil pas prendre une dépense pour une augmentation de richesse ; il faut du moins voir qu’une augmentation de richesse qui n’enrichit personne, est une chimère : telle est cependant celle qu’on attribue aux travaux de l’industrie : la dépense nécessaire faite par l’ouvrier, [283] est ce qui fait le prix nécessaire de son ouvrage ; et le prix des matières qui entrent dans cet ouvrage, ne paraît augmenter, que par l’usage où l’on est d’apprécier en argent toutes les valeurs vénales.
Donnez à un tailleur du drap pour faire deux habits, et convenez avec lui qu’un des deux lui restera pour son salaire ; trouvez-vous dans ce marché, une multiplication de valeurs, une augmentation de richesse ? Je crois que vous ne disconviendrez pas que vous avez sacrifié la moitié de votre drap pour jouir plus agréablement de l’autre moitié. De ce sacrifice résulte pour vous une utilité ; je le sais ; mais enfin, vous achetez cette utilité par une dépense ; et c’est cette dépense que vous prenez bonnement pour une augmentation de richesse, lorsque ces sortes de marchés se font par l’entremise de l’argent, et que vous ne considérez plus dans les ouvrages de l’industrie, que leur valeur en argent, sans prendre garde aux valeurs en productions, dont ces mêmes ouvrages ont opéré, ou du moins occasionné la consommation.
La seule objection que vous puissiez me faire, c’est que si l’industrie ne multiplie point les valeurs pour la partie de ses ouvrages qui se consomment dans l’intérieur d’une nation, cette multiplication paraît du moins avoir lieu pour l’autre partie des mêmes ouvrages qu’elle vend aux étrangers. C’est en effet cette illusion, si universellement accréditée, qui a fait regarder le commerce de ces ouvrages comme propre à enrichir un État ; c’est elle qui a fait éclore divers systèmes politiques pour encourager l’industrie par l’augmentation de ses profits ; pour favoriser ainsi aux dépens de l’État, les intérêts de ceux qui sont entretenus et payés par l’État ; qui vivent dans l’État sans tenir essentiellement à l’État, et sans que leurs richesses fassent partie de celle de l’État.
Le prix nécessaire d’un ouvrage, prix qui est le même pour tous les acheteurs, se forme des déboursés faits par l’ouvrier pour l’achat des matières premières, et du montant de toutes ses consommations pendant son travail. Lorsqu’il vend cet ouvrage aux étrangers, il ne fait que leur vendre sous une forme nouvelle, ce qu’il a acheté de sa nation sous plusieurs autres formes, en supposant néanmoins qu’elle lui ait tout fourni. Alors de deux choses l’une : ou ce prix nécessaire est de niveau au prix courant du marché général, ou il ne l’est pas : s’il est de niveau, l’ouvrier ne vend pas plus cher aux étrangers qu’à la nation ; car les étrangers n’achèteront pas à plus haut prix que le cours du marché général ; s’il n’est pas de niveau, il faut qu’il soit ou au-dessus ou au-dessous : au premier cas, les étrangers n’achèteront point ; au second cas, ils pourront faire renchérir l’ouvrage ; en le supposant ainsi, voyons si c’est un profit pour la nation. [284] L’ouvrier qui vend aux étrangers son ouvrage au-dessus de son prix nécessaire, fait un bénéfice ; mais il ne le fait pas sur les étrangers, puisqu’ils n’achètent pas plus cher que le prix courant établi entre toutes les nations commerçantes. Le bénéfice de l’ouvrier est donc pris sur sa nation même, et voici comment. Le prix nécessaire d’un tel ouvrage chez cette nation, n’est inférieur au prix nécessaire de pareils ouvrages chez les autres nations, qu’autant que l’ouvrier n’a pas été forcé de faire les mêmes dépenses que les ouvriers étrangers : mais cette différence dans les dépenses, ne peut provenir que d’une autre différence dans la valeur des productions employées et consommées par l’ouvrier ; elles ont nécessairement coûté moins cher à l’ouvrier qui a moins dépensé ; ces productions moins chères ne sont donc pas à leur plus haut prix possible, au prix courant du marché général ; ainsi l’ouvrier qui profite de ce bon marché pour les revendre plus cher qu’il ne les achète, gagne sur ceux qui les lui ont vendues, et non sur les étrangers auxquels il les revend sous une forme nouvelle. Ce gain est donc fait sur la nation, par un homme qui ne fait point nécessairement corps avec la nation, et qui, peut-être, n’est lui-même qu’un étranger établi chez la nation.
Une autre observation ; c’est qu’une marchandise n’ayant qu’un même prix courant pour tous les acheteurs indistinctement, si les étrangers achètent l’ouvrage en question au-dessus de son prix nécessaire, la nation sera forcée de supporter le même renchérissement : sa lésion alors est évidente ; elle est en perte jusqu’à ce que ses productions soient parvenues au prix courant du marché général ; et que jouissant ainsi de leur valeur naturelle, l’équilibre se rétablisse entre le prix des productions qu’elle vend à l’ouvrier, et le prix des ouvrages qu’elle achète de lui. Reste à examiner présentement comment cette révolution salutaire peut s’opérer.
Dans l’hypothèse où nous sommes, ce serait une méprise impardonnable que d’attribuer à l’ouvrier le renchérissement de ses ouvrages et celui de nos productions. 1°. C’est la concurrence des consommateurs étrangers qui fait monter le prix des ouvrages jusqu’au niveau de celui du marché général ; ainsi cette augmentation de prix, occasionnée par la concurrence, est le fruit de la liberté. 2°. C’est à la même concurrence encore, et non à cet ouvrier, que nous sommes redevables du renchérissement de nos productions ; car ce renchérissement est contraire aux intérêts de l’ouvrier, et s’opère certainement contre sa volonté.
Saisissez bien cette dernière observation ; elle est un des arguments les plus victorieux qu’on puisse proposer en faveur de la liberté du commerce. Quiconque achète les productions d’une nation pour les revendre aux étrangers, soit en nature, soit après les avoir [285] manufacturées, ne connaît d’autre intérêt que celui de les acheter à bon marché, et de les revendre cher : quelle folie donc de s’imaginer que c’est un tel homme qui met le prix aux productions, et qu’il les fait renchérir à son préjudice ! N’est-il pas évident au contraire, que si ce prix dépendait de lui, bien loin de le faire augmenter, il le ferait diminuer ; aussi voyons-nous qu’il ne donne jamais que le prix le plus bas auquel il lui soit possible d’obtenir les productions.
Il faut avouer qu’il est bien étonnant que les hommes n’aient pas fait cette observation, ou que d’après cette observation, ils ne se soient pas demandé, quelle est donc cette force majeure qui assujettit à des profits médiocres, celui dont le but est de faire les plus grands profits possibles ? Quelle est cette puissance despotique qui le contraint de donner aux vendeurs des productions, le prix qu’ils demandent ; de se prêter même à des renchérissements, qui ne peuvent que diminuer les profits qu’il se propose, et pour lesquels il agit ? Alors ils auraient facilement compris que la puissance qui enchaîne ainsi sous ses lois, les volontés de cet acheteur intermédiaire, est celle de la concurrence ; que la concurrence est le fruit de la liberté ; que partout où règne une grande liberté, la concurrence décide souverainement du prix auquel le marchand doit acheter, comme du prix auquel il doit revendre : éclairés par cette vérité, ils se seraient bien gardés de rien faire qui pût altérer la concurrence en altérant la liberté.
En vain le préjugé aurait voulu réclamer ; en vain il aurait élevé la voix pour persuader que les commerçants enrichissent une nation, parce qu’ils procurent à ses productions leur plus haut prix possible ; on lui aurait répondu, de quels commerçants voulez-vous parler ? De ceux sans doute qui achètent et vendent à la nation, au prix qui convient le mieux à ses intérêts ; car enfin il faut éviter de tomber dans des contradictions évidentes : si vous prétendez que les commerçants nous enrichissent en faisant valoir nos productions, laissez donc librement agir ceux qui pourront les faire valoir à plus haut prix : mais à quel signe les distinguerons-nous, si la concurrence ne nous les fait connaître d’une manière évidente ? Si vous nous privez de cette concurrence ; si vous rendez une classe particulière de commerçants indépendants de cette puissance naturelle, la seule qui puisse leur donner des lois ; si vous nous obligez de vendre à cette classe indépendante, et d’acheter d’elle, quel champ n’ouvrez-vous pas à la cupidité ?
Non, non, les hommes n’auraient plus été les victimes des préjugés qui ont fait adopter tant de privilèges exclusifs en faveur de quelques agents du commerce en particulier ; ils auraient cessé de confondre le commerce avec les commerçants ; ils auraient reconnu [286] que les bons effets de celui-là sont des effets naturels et nécessaires, qui n’ont besoin que de la liberté ; par conséquent qu’ils ne peuvent résulter des opérations des commerçants, qu’autant que la liberté ne reçoit aucune atteinte ; que sans elle enfin, la nécessité qui enchaîne ces mêmes effets, disparaît, fait place à l’arbitraire, et livre à la discrétion des commerçants privilégiés, les intérêts de ceux qui sont forcés de se servir d’eux pour faire le commerce.
L’illusion par rapport aux effets de l’industrie manufacturière n’est pas moins inconcevable que celle qui nous a trompés sur les effets de l’industrie simplement commerçante : le manufacturier a naturellement le même intérêt, le même système que les commerçants, et il tient nécessairement la même conduite : l’objet unique de ses spéculations est de faire des profits ; de les faire les plus grands qu’il lui soit possible, par conséquent d’acheter au plus bas prix possible, et de revendre au plus haut prix possible. En supposant donc que sa main-d’œuvre fasse augmenter le prix des productions, ne faut-il pas examiner encore au profit de qui revient cette augmentation ? Ne sent-on pas que si elle reste en entier à son profit, ce ne sont plus véritablement les productions qui se trouvent renchéries ; que c’est seulement la main-d’œuvre du manufacturier dont le prix excède celui qu’elle devrait avoir dans la nation ? Qu’un tel renchérissement, bien loin d’être avantageux à la nation, au souverain et aux autres co-propriétaires des produits nets, tourne au contraire entièrement à leur préjudice, puisqu’il les met dans le cas de vendre à bas prix et d’acheter cher ; de donner beaucoup de productions pour peu de main-d’œuvre ?
Je suis convenu cependant que par l’entremise de l’industrie manufacturière, il peut se faire que des productions parviennent à une valeur vénale dont elles resteraient éloignées sans ce secours. S’il fallait, par exemple, que nos chanvres et nos lins, au lieu d’être convertis en toile, fussent exportés bruts, et tels qu’ils sont cueillis dans nos champs, certainement nous n’en retirerions pas le même prix qu’en les vendant après les avoir fait préparer et manufacturer : ce prix diminuerait en raison de l’augmentation qui surviendrait dans les frais de transport. Il est beaucoup de vins qui ne peuvent être consommés qu’en eau-de-vie, et qui ne pourraient être transportés dans les lieux où l’eau-de-vie se consomme : sans l’industrie qui fabrique ces eaux-de-vie, ces mêmes vins resteraient sans débit, on cesserait de les cultiver. On peut dire la même chose des grains qui surabondent dans un pays faute d’une consommation suffisante en nature : l’industrie rend un très bon office, lorsqu’elle les convertit en liqueurs fortes, puisque sans cela, ces mêmes grains dégénéreraient en superflu sans valeur. [287] Mais de tels expédients fournis par l’industrie pour procurer le débit des denrées qui devraient être consommées en nature, doivent être regardés comme un pis-aller : ils sont pour une nation ce qu’une voiture est pour un malade hors d’état de marcher ; l’entretien de sa voiture est pour lui un surcroît de dépense : les expédients que je viens de prendre pour exemple, et tous les autres de la même espèce ont donc cet inconvénient ; ils sont des moyens dispendieux de provoquer les consommations ; et les frais qu’ils font, sont toujours en déduction du produit net, seule richesse disponible pour le souverain et pour la nation. Aussi la nécessité de ces mêmes expédients ne vient-elle qu’à la suite d’un défaut de population, d’un manque de consommateurs en état de payer leurs consommations. Mais n’importe ; quand le corps politique est languissant, il est encore heureux pour lui que sa langueur trouve dans l’industrie les secours dont il a besoin.
Point de doute assurément que dans de telles circonstances, l’industrie ne soit favorable à la reproduction, et à l’entretien de la richesse nationale ; mais faites attention aussi que dans les exemples ci-dessus allégués et dans tous les cas semblables, l’utilité de l’industrie tient essentiellement à la liberté, et que sans la liberté, non seulement cette même utilité s’évanouirait, mais encore dégénérerait en monopoles, et serait ainsi remplacée par des désordres dont la ruine de l’État serait un effet nécessaire.
Si vous prétendez qu’un manufacturier, qui achète à bas prix nos productions pour les revendre cher aux étrangers, enrichit la nation, il s’ensuit que, selon vous, les cultivateurs, le souverain et les propriétaires fonciers ne forment point la nation ; qu’elle ne consiste au contraire que dans les manufacturiers. Allez plus loin encore : soutenez que ces manufacturiers peuvent se passer des matières premières, de celles du moins que la nation leur fournit ; car il faut bien que vous le pensiez ainsi, pour que vous consentiez à regarder leurs intérêts comme étant d’un ordre supérieur à ceux de la reproduction, quoiqu’elle soit la richesse unique de l’État, la richesse unique qui fournisse à toutes les dépenses de l’État.
Le commerce qu’une nation peut faire de ses productions avec les étrangers, par l’entremisse du manufacturier, est un commerce nécessaire dans tous les cas où la consommation intérieure serait insuffisante, et où les matières premières ne seraient pas susceptibles de transport, du moins sans de grands frais. Ces matières premières étant manufacturées, vont jouir au marché général de leur meilleur prix possible, que le manufacturier ne fait pas, puisque c’est la concurrence qui en ordonne. Ce commerce ne contribue à la richesse de cette nation, qu’en raison de la portion que les premiers vendeurs [288] des productions prennent dans ce meilleur prix possible ; je veux dire, en raison du prix auquel ils les vendent au manufacturier.
Cette vérité me paraît être de la même évidence que celle du jour en plein midi. La conséquence que nous devons en tirer, c’est que dans les cas dont nous parlons, il est de la plus grande importance de ne gêner en rien le manufacturage des matières premières ; de faire jouir d’une telle franchise, d’une telle liberté, la profession de manufacturier, que personne de ceux qui pourraient l’exercer, n’en soit exclus : il est bien sensible que toute police qui resserrerait cette liberté, tendrait à diminuer le nombre des manufacturiers, par conséquent la concurrence des acheteurs de ces matières ; qu’ainsi une telle police ne pourrait être que très préjudiciable, puisque ce n’est que par le moyen de cette concurrence, que les premiers vendeurs de ces mêmes matières peuvent parvenir à prendre la plus grande part possible dans le meilleur prix possible de leurs productions.
De la même vérité résulte encore évidemment qu’il n’est point de pratique plus contraire aux intérêts d’une nation, que celle qui s’oppose au commerce de ses productions en nature avec les étrangers, quoiqu’elles soient susceptibles d’exportation. Le motif de cette politique est de nourrir et d’accroître dans la nation la masse des travaux de main-d’œuvre, parce que, prétend-on, c’est faire augmenter la richesse nationale et la population. On peut dire à ce sujet que l’intention est excellente, mais que les moyens dont elle fait choix pour remplir son objet, produisent un effet tout contraire à celui qu’elle se propose ; car ils font diminuer la richesse nationale et la population, au lieu de les faire augmenter.
L’exclusion factice donnée aux étrangers pour l’achat des matières premières dans une nation, ne devient sensible qu’autant qu’elle est préjudiciable, qu’elle empêche les étrangers de faire augmenter le prix de ces matières au profit de cette nation : tant que nos manufacturiers achèteront nos matières premières plus cher que l’étranger, l’autorité n’a pas besoin de lui donner l’exclusion ; nos acheteurs seront naturellement et nécessairement préférés ; or ils les achèteront plus cher que lui, tant qu’elles seront dans la nation à leur plus haut prix possible : si l’étranger les payait à ce prix, il se trouverait grevé par les frais de transport que nos manufacturiers n’ont point à faire comme lui : ces frais resteraient à sa charge, attendu que leur concurrence dans le débit des ouvrages l’empêcherait de les renchérir à proportion. Il ne peut donc se présenter pour acheter nos matières premières concurremment avec nos manufacturiers, qu’autant qu’elles ne sont point parmi nous à leur plus haut prix possible ; qu’elles y sont au contraire vendues à meilleur marché qu’elles ne le [289] seraient chez les autres nations, indépendamment des frais de transport que leur exportation occasionnerait.
En deux mots, il est évident que la politique d’exclure par autorité les étrangers de l’achat des matières premières dans une nation, suppose toujours et nécessairement qu’ils achèteront plus cher que les autres acheteurs qu’on veut favoriser. Ces étrangers cependant, n’achètent point au-dessus du prix courant du marché général : ainsi, ou cette politique est sans objet, ou elle tend à empêcher les productions nationales d’atteindre au prix qu’elles doivent naturellement avoir dans le commerce.
Impossible d’apprécier les contre-coups de cet inconvénient : on sent bien que d’abord la nation fait une première perte, qui est de toute la différence qu’on trouve entre le prix altéré par les prohibitions, et celui qui résulterait de la liberté. Mais cette première perte en occasionne une seconde : en raison de ce que la culture de ces productions donne moins de bénéfice, elle reçoit certainement moins d’avances, et devient moins productive ; la reproduction se trouvant donc fort au-dessous de ce qu’elle pourrait et devrait être ; vous perdez ainsi sur la quantité de ces productions autant et plus que sur leur valeur.
Ces deux premières pertes ainsi cumulées, d’autres encore viennent à leur suite : possédant moins de valeurs renaissantes, vous faites une moindre dépense annuelle ; vous avez moins d’hommes entretenus : les productions destinées à la consommation intérieure trouvent donc autour d’elles moins de consommateurs, et moins de moyens pour se procurer un bon prix. Il faut ainsi que par contrecoup, elles diminuent de valeur vénale, ou que vous ayez recours aux consommateurs étrangers : mais alors il vous en coûte des frais de transport, qui retombent à la charge des premiers vendeurs de ces productions, et préjudicient à leur culture.
Je sais qu’on répond à cela, que ces frais peuvent être, du moins en partie, gagnés par la nation même ; je sais que bien des gens les regardent comme utiles à la population : mais si cela est vrai, on a grand tort de ne pas les multiplier ; de ne pas grever de plus en plus les produits nets de la culture ; car encore une fois il faut être conséquent. En général, il suffit d’avoir des richesses à dépenser pour trouver les moyens de les dépenser : ces moyens se multiplient naturellement et nécessairement parmi des hommes, dont les uns ont grand intérêt à partager dans ces richesses, et les autres grand intérêt à consentir à ce partage pour augmenter leurs propres jouissances. L’industrie, sans cesse aiguillonnée par le désir de jouir, ne demande de nous que la liberté de jouir : ne craignez point que dans cette position, les moyens de dépenser manquent aux richesses : ce seront plutôt les [290] richesses qui manqueront aux moyens de dépenser. Ce dernier inconvénient est même d’une nécessité physique partout où les dépenses sont faites de manière qu’elles portent préjudice à la reproduction des richesses ; et c’est le cas des frais dont on charge la consommation des productions ; car ces frais qui sont toujours à la charge du premier propriétaire de ces productions, diminuent d’autant l’empressement et les moyens de les faire renaître. L’ordre de la nature est que pour augmenter les dépenses on augmente les richesses ; mais ici c’est tout le contraire ; on diminue les richesses pour augmenter les dépenses : autant vaudrait prendre les fondements d’un édifice pour les faire servir à lui donner de l’élévation. [5]
Procurer aux productions leur meilleur prix possible, c’est le moyen de s’assurer de leur plus grande abondance possible : de ces deux avantages combinés résulte la plus grande richesse disponible que votre territoire puisse comporter ; à l’aide de cette grande richesse disponible, vous pouvez faire une grande dépense en travaux de main-d’œuvre ; et dès lors vous pouvez compter sur les plus grands efforts de la part de l’industrie ; ils se proportionneront toujours à la masse des valeurs destinées à mettre le prix à ses ouvrages. Telle est la gradation par laquelle une nation peut parvenir à son dernier degré de prospérité : elle ne doit l’attendre que du bon prix de ses productions ; mais aussi ce bon prix ne peut se former que dans le sein de la liberté.
[II-402 / 291]
CHAPITRE XLIII.↩
L’industrie n’est aucunement productive : démonstration particulière de cette vérité.
Qu’on me permette maintenant de revenir sur quelques propositions sommaires que je crains de n’avoir pas suffisamment démontrées, et qui d’ailleurs sont celles dont les hommes paraissent être les plus éloignés. J’ai dit qu’une valeur de 20 millions en ouvrages de l’industrie n’était que représentative d’une valeur égale en productions consommées ; et qu’une nation qui vendait ces ouvrages aux étrangers, n’en était pas plus riche, que si elle leur eût vendu pour 20 millions de productions en nature, parce que ces 20 millions en ouvrage lui coûtent à elle-même 20 millions en productions. Il ne faut pas entendre par cette façon de parler, qu’après son travail, l’industrie vous revend pour le même prix, la même quantité de matières premières que vous lui avez vendues : elle vous revend bien pour le même prix, mais non pas la même quantité ; car elle a prélevé sur cette quantité, tout ce qui est nécessaire aux consommations de ses ouvrages et de ses ouvriers.
Un tisserand achète pour 150 francs de subsistances, de vêtements, et pour 50 francs de lin qu’il vous revend en toile 200 francs, somme égale à celle de sa dépense. Cet ouvrier, dit-on, quadruple ainsi la valeur première du lin ; point du tout : il ne fait que joindre à cette valeur première, une valeur étrangère, qui est celle de toutes les choses qu’il a consommées nécessairement. Ces deux valeurs ainsi cumulées forment alors, non la valeur du lin, car il n’existe plus ; mais ce que nous pouvons nommer le prix nécessaire de la toile ; prix qui par ce moyen, représente : 1°. la valeur de 50 francs en lin ; 2°. celle de 150 francs en autres productions consommées.
Telle est dans toute sa simplicité, la solution du problème de la multiplication des valeurs par les travaux de l’industrie : elle ajoute à la première valeur des matières qu’elle a manufacturées, et qui sont à consommer, une seconde valeur, qui est celle des choses dont ses travaux ont déjà opéré, ou du moins occasionné la consommation. Cette façon d’imputer à une seule chose, la valeur de plusieurs autres, d’appliquer, pour ainsi dire, couche sur couche, plusieurs valeurs sur une seule, fait que celle-ci grossit d’autant ; mais en cela vous ne pouvez attribuer à l’industrie aucune multiplication, aucune augmentation de valeurs, si par ces termes vous entendez une création de valeurs nouvelles qui n’existaient point avant ses opérations. [292] L’industrie n’est pas plus créatrice de la valeur de ses ouvrages, qu’elle est créatrice de la hauteur et de la longueur d’un mur : chaque pierre qu’elle emploie, a sa hauteur et sa longueur particulière ; et de toutes ces pierres assemblées par l’industrie, résulte naturellement la hauteur et la longueur du mur qu’elle a construit, et qui à cet égard représente sous une nouvelle forme, toutes ces différentes hauteurs et longueurs particulières, qui existaient séparément avant sa construction.
L’industrie est créatrice des formes, et ces formes ont leur utilité. C’est à raison de cette utilité, que celui qui veut jouir de ces formes nouvelles que l’industrie donne aux matières premières, doit l’indemniser de toutes ses dépenses, de toutes ses consommations, et en conséquence consent à cette addition de plusieurs valeurs pour n’en plus composer qu’une seule, qui devient ainsi le prix nécessaire de l’ouvrage qu’il veut acheter. Le terme d’addition peint très bien la manière dont se forme le prix des ouvrages de main-d’œuvre : ce prix n’est qu’un total de plusieurs valeurs consommées et additionnées ensemble ; or, additionner n’est pas multiplier.
Une grande preuve que l’industrie n’est point créatrice de la valeur de ses ouvrages, c’est que cette valeur ne lui rend rien par elle-même : les dépenses faites à l’occasion de ces mêmes ouvrages, sont tellement perdues sans retour pour l’industrie, qu’elle n’en peut être indemnisée, qu’autant qu’il existe d’autres valeurs et d’autres hommes qui veulent bien l’en aider.
Je vous loue un arpent de terre 10 francs ; vous dépensez 10 autres francs pour le cultiver, et il vous donne des productions qui valent 30 : cet arpent vous rend donc votre dépense de 10 ; plus, de quoi me payer, et en outre un profit. De cette opération résulte très réellement une augmentation de valeurs, une multiplication ; et pourquoi ? Parce qu’au lieu de 10 vous avez 30, sans avoir reçu 20 de qui que ce soit : c’est vous-même qui êtes créateur de ces 30, dont 20 sont dans la société un accroissement de richesses disponibles ; car elles n’existaient point avant votre travail. Il n’en est pas ainsi de l’industrie : l’indemnité de ses dépenses n’est point le fruit de son travail ; elles ne peuvent au contraire lui être remboursées, que par le produit du travail reproductif des autres hommes ; tout ce qu’elle reçoit enfin, lui est fourni en valeurs déjà existantes ; de sorte que ces valeurs qui lui sont remises, ne font en cela que changer de main.
Dans l’opinion de ceux qui se persuadent que l’industrie multiplie les valeurs des matières premières, les fabricants de dentelles doivent être des personnages bien importants : par leur entremise une valeur de 20 sols en lin brut devient une valeur de 1 000 écus : quel accroissement prodigieux de valeur pour ce lin, et de richesse [293] pour ceux qui le manufacturent ainsi ! Qu’une telle industrie doit être précieuse à l’humanité ! Que d’argent doit se trouver chez une nation qui de 20 sols fait 1 000 écus.
Modérez votre enthousiasme, aveugles admirateurs des faux produits de l’industrie : avant de crier miracle ouvrez les yeux, et voyez combien sont pauvres, du moins mal-aisés, ces mêmes fabricants qui ont l’art de changer 20 sols en une valeur de 1 000 écus : au profit de qui passe donc cette multiplication énorme de valeurs ? Quoi, ceux par les mains desquels elle s’opère, ne connaissent pas l’aisance ! Ah, défiez-vous de ce contraste, comme on se défie de ces gens qui sous un mauvais habit, viennent offrir de vous vendre à bon compte le secret de faire de l’or.
Pour dissiper le prestige qui vous fait illusion, décomposons ce qui cause votre admiration ; considérons-le successivement dans ce qu’il paraît avoir de plus miraculeux, et de plus intéressant pour une nation. Pour 20 sols de lin une valeur de 1 000 écus en dentelles, voilà le phénomène : d’où provient donc ce lin qui fait une si belle fortune ? Sans doute que son accroissement de valeur doit être au profit de la nation chez laquelle ce lin est cueilli : sans cela l’industrie qui procure cet accroissement de valeur, est un avantage absolument étranger à cette nation. Mais point du tout : le lin peut se cueillir dans un pays, et la dentelle se fabriquer dans un autre : cette industrie n’appartient exclusivement à aucune nation en particulier ; elle peut habiter partout où peut être transportée une très médiocre quantité de ce lin. Aucune nation ne peut donc regarder cet accroissement de valeur comme une richesse qui lui soit propre et personnelle, puisque aucune nation ne peut en avoir la propriété exclusive.
Arrêtons-nous un moment sur trois vérités bien sensibles qui viennent de se manifester à nous : la première est que 1 000 écus de dentelles n’appartiennent point nécessairement et exclusivement à la nation productive du lin ; la seconde est que ces 1 000 écus sont acquis à l’industrie qui fabrique la dentelle, quel que soit le lieu qu’elle habite ; la troisième est que les possesseurs de cette industrie ont souvent bien de la peine à subsister. Si vous rapprochez ces trois vérités, elles doivent naturellement vous conduire à douter de la réalité d’une augmentation de richesse par le moyen de cette même industrie.
Si le lin de 20 sols parvient à valoir 1 000 écus, comment l’accroissement de son prix ne se partage-t-il pas entre le producteur du lin et celui qui emploie cette matière ? Il faut donc qu’il ne soit pas vrai que la valeur première du lin ait véritablement augmenté. Puisque toutes les nations ne font pas de la dentelle, quoique toutes puissent se procurer du lin, il faut donc encore que cette fabrique [294] n’enrichisse pas une nation autant que vous vous l’imaginez. Enfin puisque les agents d’une telle industrie, bien loin d’être riches, ne connaissent point l’aisance, il est évident que leurs profits ne sont point réels ; car s’ils étaient réels, ces ouvriers posséderaient nécessairement de grandes richesses ou du moins feraient de grandes dépenses.
Les fabricants de dentelles sont pour l’ordinaire des gens du commun et de tout âge. Cette sorte d’ouvrage est abandonnée principalement aux personnes du sexe, vieilles, jeunes, enfants même, voilà les faiseuses de miracle, et les hommes rougiraient d’en faire leur occupation. Cependant ces mêmes hommes ne sont point honteux de faire une autre besogne qui ne leur est payée que 20, 30, ou 40 sols par jour, quoique plus pénible : cette préférence vous montre bien clairement que les profits des fabricants de dentelles ne sont point ce qu’ils paraissent être au premier coup d’œil.
Si ces profits apparents étaient en proportion du prix de la dentelle, il n’est personne qui ne voulût en être fabricant : bientôt ce commerce serait nul ; car bientôt chacun ne pourrait plus en faire que pour son usage personnel. Si cette industrie, qui s’acquiert aisément, ne devenait pas universelle, du moins serait-elle si commune, qu’il y aurait une grande multitude de fabricants, dont la concurrence ferait nécessairement diminuer les profits ; et dès lors la dentelle ne serait plus de la cherté dont elle est : cette cherté soutenue est donc encore une nouvelle preuve que ces mêmes profits ne sont point ce que nous les croyons.
Enfin, quand nous voyons l’industrie faire de 20 sols une valeur de 1 000 écus, n’est-il pas naturel que nous nous demandions, pourquoi cette valeur ne double pas ? La raison qui l’empêche d’augmenter, doit piquer notre curiosité autant que la raison qui l’empêche de diminuer.
Il faut convenir que voilà bien des mystères à pénétrer, bien des contradictions à concilier : rien n’est plus facile cependant : 1 000 écus sont le prix nécessaire de la dentelle ; prix nécessaire formé par le montant de toutes les dépenses que les fabricants ont à faire pendant le temps qu’ils emploient à cet ouvrage ; par d’autres dépenses encore de divers ouvriers qui concourent à la préparation des lins ; par celles aussi du marchand qui fait les avances de ces dépenses ; par les intérêts qu’il doit retirer de ces mêmes avances ; par les rétributions dues aux peines qu’il se donne personnellement ; par la valeur des différents risques auxquels son commerce l’expose.
L’addition de tous ces divers objets réunis vous donne un total qui devient le prix nécessaire de la dentelle ; et ce prix nécessaire vous apprend que la cherté de cette marchandise n’est qu’une restitution [295] de dépenses, de valeurs déjà consommées ; que cette cherté ne diminue point, parce que le marchand n’est pas marchand pour vendre à perte ; qu’elle n’augmente point non plus, parce que ces dépenses sont à peu près les mêmes dans tous les temps, et que la concurrence des vendeurs de dentelle ne leur permet pas de la renchérir arbitrairement, de la porter au-delà de son prix nécessaire ; par conséquent que les profits éblouissants de cette fabrique sont de vains fantômes qu’on croit voir dans l’obscurité de la nuit, et qui se dissipent dès que la lumière paraît ; que ces profits sont de la même espèce et de la même valeur, que ceux de toutes les autres manufactures qui exigent les mêmes avances et exposent aux mêmes risques ; que le prix de la dentelle ne fait que passer dans les mains du marchand pour aller payer toutes les valeurs que lui et les ouvriers consomment, ou sont réputés consommer, parce qu’ils en ont le droit ; qu’ainsi ce prix appartient à la nation qui fournit ces valeurs, et qu’il n’est richesse pour elle, qu’autant qu’elle tire de son propre fonds les productions qui entrent dans de telles consommations. Elle ne gagne donc pas plus à vendre ses dentelles, qu’elle gagnerait à vendre ces mêmes productions en nature.
Je me suis appesanti sur les fabriques de dentelles, parce que ce sont celles dont les faux produits doivent faire une plus forte illusion. Je me dispenserai donc de parler des autres : ce que je viens de dire de celles-ci me paraît suffisant pour détruire tous les arguments qu’on emploie pour persuader que l’industrie enrichit une nation en créant de nouvelles valeurs, ou en augmentant celle de ses matières premières.
Il est pourtant une objection qu’il est à propos de prévenir, parce qu’elle tient à des dehors fort imposants pour ceux qui ne veulent rien approfondir. Éblouies par les fortunes que font quelques agents du commerce et de l’industrie, nombre de personnes en concluent que ces agents s’enrichissent par des valeurs qu’ils multiplient ; elles se servent du moins de ces exemples pour ne pas reconnaître l’existence d’un prix nécessaire en fait d’ouvrage de main-d’œuvre.
Tout homme qui ne dépense que le quart ou la moitié de son revenu, doit certainement augmenter sa fortune : quel que soit un agent de l’industrie, il ne peut s’enrichir que par cette voie, s’il ne vend ses ouvrages qu’à leur prix nécessaire ; car ce prix nécessaire n’est que la restitution des dépenses qu’il fait ou qu’il est censé faire. Son profit à cet égard consiste donc dans les dépenses qu’il pourrait faire et qu’il ne fait point. Cette manière de grossir sa fortune préjudicierait à la circulation de l’argent, à la consommation et à la reproduction, si, comme je l’ai dit précédemment, ce désordre n’était balancé par un désordre contraire : lorsque la reproduction ne [296] souffre point de ce qu’il est des hommes qui vendent plus qu’ils n’achètent, c’est parce qu’il en est d’autres qui achètent aussi plus qu’ils ne vendent.
Une seconde observation à faire, c’est que dans la formation du prix nécessaire d’un ouvrage, on fait entrer la valeur des risques, parce que ces risques occasionnent des pertes qu’il faut évaluer et répartir. Ces risques cependant ne se réalisent pas toujours également pour tous les marchands, et de la différence qui se trouve dans ces accidents, doit naître une différence dans leurs profits : aussi en voyons-nous qui se ruinent, tandis que nous en voyons d’autres qui s’enrichissent.
Ces divers événements ne prouvent point que chaque ouvrage de l’industrie n’ait pas un prix nécessaire. Ce prix n’est nécessaire que pour le vendeur et non pour l’acheteur. Il est nécessaire pour le vendeur, parce qu’il serait en perte s’il vendait au-dessous, et dès lors il abandonnerait sa profession. Mais ce même prix n’est pas ce qui empêche qu’il ne vende au-dessus ; son désir à ce sujet ne peut être contenu que par la concurrence ; et en cela nous retrouvons encore la nécessité de la liberté du commerce. La suppression de cette liberté ne peut jamais assujettir l’industrie à vendre habituellement les ouvrages au-dessous de leur prix nécessaire, tel qu’il résulte du prix des productions ; elle doit au contraire lui donner des facilités pour les vendre beaucoup plus cher, et détourner à son profit une portion des richesses qui, sans cela, seraient disponibles pour le souverain, les propriétaires fonciers, et les cultivateurs, mais qui cessent de l’être, dès qu’elles ne sont plus employées qu’à payer à l’industrie un tribut exagéré.
Aux formes près, l’industrie ne crée rien, ne multiplie rien ; elle consomme par elle-même, et provoque les consommations des autres, voilà le point fixe dans lequel nous devons envisager son utilité ; elle est très grande assurément ; mais il ne faut pas la dénaturer ; regarder l’industrie comme productive, tandis qu’elle n’est que consommatrice, et que la consommation est l’unique objet de ses travaux.
Cette façon naturelle de considérer l’industrie, est même la seule qui puisse nous conduire à voir combien elle est avantageuse aux nations agricoles : les productions n’ont jamais tant de valeur vénale que lorsqu’elles sont voisines du lieu de la consommation ; d’un autre côté, les marchandises, quelles qu’elles soient, renchérissent toujours pour les consommateurs, en proportion de l’éloignement des lieux dont elles sont tirées ; il est donc doublement important pour une nation agricole et productive, que son industrie la dispense de faire venir de loin une partie de ses consommations, et d’envoyer [297] au loin, par conséquent, une partie de ses productions à l’effet d’y payer les marchandises étrangères. Pour favoriser la culture, il faut donc protéger l’industrie, et pour favoriser l’industrie il faut donc protéger la culture : tout se tient ainsi dans l’ordre naturel des sociétés.
Mais pour nous ménager ce double avantage, il est d’une nécessité physique de faire jouir le commerce, tant intérieur qu’extérieur, de la plus grande liberté possible ; ce n’est que par le moyen de cette grande liberté, qu’on peut s’assurer d’une grande concurrence d’acheteurs des productions nationales, et de vendeurs des productions étrangères ; ce n’est que par le secours de cette double concurrence qu’on peut faire jouir une nation du meilleur prix possible, tant en vendant qu’en achetant ; ce n’est qu’à l’aide de ce meilleur prix possible, que cette nation peut se procurer la plus grande abondance possible, la plus grande richesse possible, la plus grande population possible, la plus grande puissance possible : tels sont les derniers résultats de la liberté.
On trouvera peut-être extraordinaire que dans l’énumération des bons effets de la liberté, je ne parle point de l’accroissement progressif de son commerce extérieur, et que je n’aie point présenté le plus grand commerce extérieur possible, comme étant inséparable de la plus grande prospérité possible d’une nation. Mais il ne faut pas s’imaginer que ce commerce et cette prospérité croissent dans la même proportion ; au contraire, la suite naturelle d’une grande prospérité est de diminuer le commerce extérieur et d’augmenter le commerce intérieur.
Impossible qu’une nation trouve dans la masse de ses productions annuelles, une grande richesse disponible, sans que son industrie et sa population n’augmentent en proportion de cette richesse ; c’est dans le sein de l’abondance que les hommes, les arts, les talents se multiplient pour varier et multiplier nos jouissances. La prospérité d’une nation croissant ainsi dans tous les genres, il est sensible que pour jouir de sa richesse, elle a moins besoin que jamais du secours des étrangers : les premiers propriétaires des productions trouvent autour d’eux, pour ainsi dire, toutes les jouissances qu’ils peuvent désirer ; ils ont en outre l’avantage d’économiser les frais de transport, inséparables du commerce avec les étrangers ; de se ménager ainsi toute la valeur de leurs productions, qui, en pareil cas, doivent être toujours vendues à leur meilleur prix possible.
Ce tableau du dernier degré de prospérité auquel une nation puisse parvenir à l’aide de la liberté, prouve bien que le commerce extérieur n’est, ainsi que je l’ai déjà dit, qu’un pis-aller, qu’un mal nécessaire : son utilité peut bien conduire une nation à son meilleur [298] état possible, mais cette nation une fois parvenue à ce meilleur état possible, elle ne fait plus le même usage des secours dont elle avait besoin pour y arriver : à mesure que ses productions se multiplient, l’industrie croît chez elle, et les consommateurs nationaux deviennent plus nombreux : son commerce extérieur diminue donc en raison inverse de l’augmentation de son commerce intérieur. Cette révolution est conséquente à la manière dont le commerce enrichit une nation : on a vu que cet accroissement de richesse n’est pas l’effet propre du commerce, mais bien de la liberté du commerce, parce que c’est elle qui assure le bon prix, et conséquemment l’abondance des productions.
Je n’ai pas besoin que l’étranger achète mes productions, quand les consommateurs nationaux m’en offrent le plus haut prix possible ; mais pour me procurer constamment et nécessairement ce plus haut prix possible, il est indispensable que je puisse librement préférer l’étranger ; et que les consommateurs nationaux, au lieu de me faire la loi, la reçoivent de la concurrence. Il en est de même des ouvrages de l’industrie, qui entrent dans mes consommations : la concurrence des vendeurs étrangers m’est utile, non pour acheter d’eux, mais pour aiguillonner l’industrie nationale qui doit servir à varier et multiplier mes jouissances, et me mettre en même temps à l’abri d’un renchérissement démesuré de la part des vendeurs qui sont de ma nation : or, ces divers avantages que je trouve dans la liberté du commerce étant communs à tous les cultivateurs, et à tous les co-propriétaires du produit net, ils sont tous assurés de se procurer par ce moyen, leur meilleur état possible. Nous pouvons donc nous résumer, et dire qu’un grand commerce extérieur sans liberté doit nécessairement ruiner une nation ; que pour enrichir au contraire, et le souverain et les sujets, pour les porter au plus haut degré de prospérité et les y maintenir, le plus petit commerce extérieur peut être suffisant, pourvu qu’il jouisse de la plus grande liberté.
[II-423 / 299]
CHAPITRE XLIV.↩
Récapitulation et conclusion de cet ouvrage. — La loi de la propriété, établie sur l’ordre physique, et dont la connaissance évidente est donnée par la nature à tous les hommes, renferme en son entier l’ordre essentiel des sociétés. — Cette loi unique et universelle est la raison essentielle et primitive de toutes les autres lois. — Ses rapports avec les mœurs. — Combien les systèmes publics d’un gouvernement influent sur la formation de l’homme moral. — Les vertus sociales ne peuvent être que passagères, dès qu’elles sont séparées de l’ordre essentiel des sociétés.
L’établissement de l’ordre naturel et essentiel des sociétés ne demande point des hommes nouveaux, des hommes qui ne soient susceptibles ni de l’appétit des plaisirs, ni de l’aversion de la douleur. Ne vous imaginez pas que pour parvenir à cet établissement, il faille commencer par l’anéantissement de nos passions : il n’appartient pas à l’humanité de pouvoir les éteindre ; mais elle peut les modifier, les diriger : Passions, tho selfish, lyes under the reason [6] ; quoiqu’elles ne soient jamais affectées que de leur intérêt personnel, elles nous sont données cependant comme les moyens que la raison doit employer pour nous soumettre à un ordre immuable institué par l’auteur de la nature pour gouverner les hommes tels qu’ils sont, pour faire servir à leur bonheur temporel ces deux mobiles auxquels nous avons donné le nom de passions, ou du moins, qui sont le germe de toutes nos passions.
Si vous en exceptez la nécessité des ménagements qu’il faut garder quand il s’agit de rendre aux corps politiques la santé qu’ils ont perdue, il est sensible qu’un tel établissement ne peut plus trouver d’obstacles que dans une espèce de léthargie dont notre ignorance est le principe : effrayés de la distance prodigieuse qui se trouve entre l’ordre, et cette multitude de désordres qui dans tous les temps ont couvert la surface de la terre, et dégradé l’humanité, nous nous imaginons que leur réforme est un ouvrage au-dessus de nos forces ; nous nous persuadons que l’ordre propre à opérer cette réforme, est un ensemble très compliqué ; qu’il demande de nous une étude et des connaissances profondes ; qu’il exige des génies supérieurs, des travaux pénibles et assidus ; des efforts sur nous-mêmes ; des combats dans lesquels nous n’osons nous engager.
[300]
C’est ainsi qu’une masse énorme de difficultés imaginaires nous en impose au point qu’elle ne nous permet pas de former le projet de les surmonter ; elle n’est cependant qu’une pure illusion ; qu’une vaine chimère, dont l’idée factice agit sur nos esprits, comme celle des revenants ou des fantômes agit sur les enfants. Mais pour la dissiper, cette chimère, et nous faire sortir de notre abattement, ne suffit-il pas de montrer aux hommes combien est simple, combien est évident et sensible ce même ordre à la connaissance duquel ils désespèrent de pouvoir jamais s’élever ; de les convaincre qu’il est facile à comprendre, facile à mettre en pratique, plus facile encore à perpétuer ?
Qu’on me permette donc de rapprocher, de rassembler, pour ainsi dire, dans un même point de vue, les vérités contenues successivement dans cet ouvrage ; de faire voir, par la nécessité de leur enchaînement, qu’il en est une première dans laquelle toutes les autres sont renfermées, et qui est sensible à toute intelligence : ce coup d’œil mettra mes lecteurs dans le cas, non de croire à la possibilité de l’établissement de l’ordre naturel des sociétés dans toute sa perfection, mais de ne pouvoir plus imaginer quelle espèce d’oppositions un établissement si précieux, si désirable pourrait rencontrer, lorsque ce même ordre sera connu dans toute sa simplicité.
Nous avons commencé par attacher nos regards sur le premier état de l’homme, avant qu’il se réunisse librement à quelque société particulière : nous le voyons naître dans l’impossibilité de se passer du secours des autres ; mais aussi pour ménager ces secours à son impuissance absolue, nous trouvons dans ses père et mère, des devoirs, dont l’observation est assurée, tant par les plaisirs d’attrait dont la nature a rendu ces devoirs susceptibles, que par la contemplation du besoin que les père et mère auront un jour des secours de leurs enfants.
Sur ces premiers devoirs des père et mère envers ceux qui leur doivent le jour, vous voyez s’établir leurs premiers droits sur leurs enfants, et les premiers devoirs des enfants envers leur père et mère : cette réciprocité de devoirs et de droits forme entre eux une société naturelle. Mais à peine les enfants sont-ils en état de rendre quelques services, que les liens de cette société se resserrent encore, par les avantages sensibles que tous ceux qui la composent, trouvent à rester unis pour s’entre-aider mutuellement.
Nous avons passé rapidement sur ces premières époques de notre vie, pour considérer les hommes dans l’âge où le germe des passions s’est développé, dans l’âge où la force physique de leur individu les met en état de disposer d’eux-mêmes, et sert leurs volontés. Là, nous avons observé qu’une sensibilité involontaire au plaisir et au mal [301] physiques, les avertit perpétuellement qu’ils ont un devoir essentiel à remplir, celui de pourvoir à leur subsistance ; cette sensibilité les tient assujettis rigoureusement à ce devoir, et à tous les travaux qu’il exige d’eux pour les conduire à des jouissances qui leur sont précieuses. De là, le désir naturel d’acquérir ces jouissances et de les conserver ; désir qui les dispose naturellement à saisir tous les moyens de s’assurer la possession paisible des fruits de leurs travaux ; par conséquent à vivre en société.
Vivre en société, c’est connaître et pratiquer les lois naturelles et fondamentales de la société, pour se procurer les avantages attachés à leur observation. Cette définition nous montre que la nature est le premier instituteur de l’homme social parvenu à l’âge où ses passions et ses forces doivent être dirigées par la raison. Je dis qu’elle en est le premier instituteur, parce que c’est elle qui a voulu la réunion des hommes en société ; c’est elle qui a dicté les conditions essentielles à cette réunion ; c’est elle enfin qui leur rend sensibles la nécessité de la société, et celle des conditions auxquelles ils doivent se soumettre, pour que la société puisse se former et se perpétuer.
En effet, le désir d’acquérir et de conserver, nous presse naturellement d’éviter tout ce qui pourrait mettre des obstacles à l’accomplissement de ce désir : nous sentons même en nous, une disposition naturelle à employer toutes nos forces pour surmonter ces obstacles. Cette disposition, conséquente à notre premier désir, est donc une leçon très intelligible que la nature nous donne, et par laquelle elle nous fait comprendre qu’il est de notre intérêt de ne pas provoquer ces mêmes obstacles que nous nous proposons d’écarter ; en un mot, de ne rien faire qui puisse nous empêcher de jouir paisiblement et constamment du droit d’acquérir et de conserver.
Je me sers ici du terme de droit, parce qu’il n’est aucun homme qui, dans ce premier état, ne sente la nécessité absolue dont il est pour lui, de pouvoir librement se procurer les choses dont sa conservation a besoin ; aucun homme qui ne comprenne que la liberté de les acquérir serait nulle en lui, sans la liberté de les conserver ; qu’à raison de cette même nécessité absolue, qui fait son titre, on ne peut, sans injustice, offenser en rien sa liberté.
Dès ce moment je vois des hommes instruits et formés pour vivre en société : la sensation ou la connaissance intuitive qu’ils ont de leurs premiers droits, leur donne aussi nécessairement la connaissance intuitive de leurs premiers devoirs envers les autres hommes : ce qui se passe dans leur intérieur leur fait facilement comprendre que tous les hommes ont des droits de la même espèce ; qu’aucun d’eux ne peut se proposer de les violer dans les autres, qu’il n’éprouve de leur [302] part la plus grande résistance possible ; qu’il ne s’expose nécessairement à toutes les violences qu’ils pourront à leur tour exercer à son égard. Ainsi chacun, éclairé par l’attention qu’il donne à son intérêt personnel, à ses propres sensations, est forcé de se reconnaître sujet à des devoirs ; de s’imposer l’obligation de ne point troubler les autres hommes dans la jouissance du droit d’acquérir et de conserver, afin de n’être point aussi troublé lui-même dans la jouissance de ce droit.
Nous n’avons donc pas besoin d’un autre maître que la nature, pour parvenir à l’institution de la propriété personnelle et de la propriété mobilière ; car ces deux sortes de propriétés, qui au fond n’en font qu’une seule, présentée sous deux noms différents, ne sont autre chose que ce que je viens de nommer le droit d’acquérir et de conserver : elles se trouvent naturellement instituées par la seule force de la nécessité absolue dont elles sont à notre existence ; nécessité que le physique de notre constitution nous rend sensible, et d’après laquelle il ne nous est pas possible de méconnaître ni les premiers devoirs réciproques auxquels elle assujettit les hommes entre eux, ni l’intérêt qu’ils ont tous à s’y conformer.
Tel est le premier état du genre humain ; tel est l’état de la société primitive, de cette société naturelle, tacite et universelle qui a dû précéder l’institution des sociétés particulières et conventionnelles. C’est dans cette source que j’ai puisé les premières notions du juste et de l’injuste absolus, des devoirs et des droits réciproques dont la justice est absolue, parce qu’ils sont d’une nécessité absolue dans des êtres créés pour vivre en société.
Mais en quoi consistent-ils, ce juste et cet injuste absolus ? Présentent-ils, dans leurs principes ou dans leurs conséquences, des vérités compliquées, des vérités à la connaissance desquelles notre intelligence ne puisse s’élever que par de grands efforts ? Non, non, cette connaissance n’est point réservée à quelques hommes en particulier ; il n’en est point à qui la nature n’ait donné la faculté de voir évidemment ces vérités à l’aide de la lumière qui éclaire en eux cette faculté.
La lumière et la faculté de voir sont deux choses qu’il ne faut pas confondre ; car sans la lumière, les yeux de nos corps ne nous sont d’aucune utilité. La raison, cet assemblage de facultés intellectuelles, est ce que nous pouvons nommer les yeux de l’âme ; mais dans l’ordre des choses humaines, les seules qui appartiennent à mon sujet, la raison ne peut servir à nous conduire, qu’autant qu’elle est frappée d’une lumière qui lui permet de distinguer et de connaître les objets. Cette lumière dont je veux parler, est celle qui luit dans les [303] ténèbres, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, et qui est la vie des hommes [7] ; ce sont nos sensations physiques et involontaires qui forment en nous cette lumière par l’attention que nous leur donnons : au moyen de cette attention naturelle et volontaire, nous sentons, comme je viens de le dire, nous voyons évidemment qu’il est d’une nécessité, et par conséquent d’une justice absolues, que nous ne soyons point arbitrairement troublés dans le droit d’acquérir et de conserver les choses utiles à notre existence ; nous voyons évidemment que cette nécessité et cette justice sont nécessairement les mêmes dans tous les êtres de notre espèce ; qu’elles assujettissent invariablement chacun d’eux en particulier à ne point faire aux autres ce qu’il ne voudrait pas qu’il lui fût fait.
Nous voici donc, sans aucun effort, parvenus à la connaissance sublime du juste et de l’injuste absolus ; nous possédons le premier principe de tous les devoirs réciproques qui nous sont imposés par un ordre essentiel et immuable qui est la raison universelle [8] ; nous connaissons cette loi qui est écrite dans tous les cœurs, dans ceux même qui sont assez malheureux pour être privés du jour que répand le flambeau de la foi [9] ; cette loi qui nous est enseignée par la nature, et dont on ne peut s’écarter sans crime [10] ; cette loi dont l’institution est l’ouvrage d’une sagesse qui gouverne l’univers par des règles invariables [11] ; cette loi qui est moins un présent de la divinité que la divinité elle-même, de manière que pécher contre la loi c’est pécher contre la divinité. [12] Il ne s’agit plus ainsi que d’en développer les conséquences, et de trouver dans ce développement l’ordre naturel et essentiel des sociétés ; essayons donc de les former, mais sans autres secours que celui de cette première connaissance.
J’observe d’abord qu’il n’est point question entre nous de décider si chacun sera propriétaire de sa personne et des choses acquises par ses recherches ou ses travaux : ce premier droit est la première loi du juste absolu, dont nous savons que notre intérêt personnel ne nous permet pas de nous écarter. Il ne s’agit pas non plus de savoir si quelques-uns peuvent être autorisés à violer arbitrairement la propriété personnelle et mobilière des autres : nous ne nous réunissons en société que pour prévenir et empêcher ce désordre évident ; ce désordre qui anéantirait un droit dont la nécessité et la justice absolues [304] nous sont évidentes. Pour découvrir les devoirs que nous devons nous imposer réciproquement, prenons la voie la plus courte et la plus simple ; examinons qui nous sommes avant de nous réunir en société ; quels sont les droits dont nous jouissons, et quel est l’objet que nous nous proposons par cette réunion.
Chacun de nous est un être qui déjà connaît la justice par essence, mais qui cependant peut à tout instant devenir injuste ; chacun de nous se présente avec un droit de propriété pleinement indépendant, et dont il cherche à s’assurer la jouissance ; chacun de nous sait que ce droit est d’une justice absolue ; mais chacun sait aussi qu’il peut être troublé dans cette jouissance par les autres hommes, et qu’il lui importe beaucoup de ne pas l’être : alors l’objet de notre réunion en société est sensible ; il consiste à établir en faveur de chacun de nous, la sûreté qu’il désire de procurer à son droit de propriété, et dans toute l’étendue que ce droit a naturellement. Mais dès que l’évidence de cet objet réunit toutes nos volontés, nous serons bientôt d’accord sur les moyens de le remplir.
Il ne nous annonce donc que des vérités sensibles et évidentes, celui qui parmi nous élève la voix et nous dit :
« Mes frères, l’ordre immuable de la nature est que chacun soit pleinement propriétaire de sa personne et de ce qu’il acquiert par ses recherches ou ses travaux : ce double droit est d’une nécessité absolue ; et dans cette nécessité nous découvrons tous les premiers principes d’une justice par essence, d’une justice dans laquelle nous devons puiser toutes les conventions qu’il nous faut adopter pour notre félicité commune. Ce n’est même qu’en prenant pour guide la connaissance évidente de cette justice, qu’il nous sera possible de remplir l’objet de notre réunion en société ; qu’il nous sera possible de garantir le droit de propriété, de tous les troubles qu’il pourrait éprouver dans un homme dont la force personnelle ferait toute la sureté : il est donc dans l’ordre de cette justice, dans l’ordre de nos intérêts communs, et de l’objet que nous nous proposons tous uniformément, qu’il se fasse une réunion de toutes nos forces au soutien du droit de propriété ; par conséquent qu’il y ait un signe sensible de ralliement, au moyen duquel elles puissent se rassembler dans un seul tout, pour ne plus former qu’une force unique et commune, qui par ce moyen, le trouve toujours en état de protéger efficacement le droit de propriété : ainsi que chacun de nous s’impose le devoir de rallier ses forces particulières au centre commun dont nous conviendrons ; par ce nouveau devoir il acquerra le droit de jouir de la force de tous, et sa faiblesse, fortifiée par ce secours, sera toujours une force irrésistible ; il n’aura jamais rien à craindre pour son droit de propriété ».
[305]
Ce plan de réunion adopté, car il est impossible qu’il ne le soit pas, la rédaction des conventions est la partie dont notre société naissante va s’occuper ; mais nulle difficulté sur cet article, dès que nous ne perdrons pas de vue notre objet.
Nous cherchons à consolider le droit de propriété, et point du tout à l’énerver : nos vues et nos intérêts communs sont de garantir la jouissance de ce droit dans toute la plénitude, dans toute l’étendue qu’il avait avant de songer à nous réunir en société particulière ; or, avant cette réunion il était de l’essence du droit de propriété, que nous fussions tous également libres d’en retirer la plus grande somme possible de jouissances ; ce droit, qui dans chaque homme, était naturellement et nécessairement indépendant des volontés arbitraires des autres hommes, ne pouvait être borné dans chacun de nous, que par la nécessité de ne point blesser dans les autres le même droit et son indépendance.
Telle est l’étendue naturelle et primitive du droit de propriété que nous venons tous mettre sous la protection de la société, et qui doit nous être à tous conservé dans tout son entier : ainsi pour n’être point en contradiction avec nous-mêmes, nos conventions sociales, ou les lois que nous adopterons, ne doivent rien retrancher de ce droit : si elles l’assujettissent à des devoirs qui ne lui étaient point imposés avant la réunion, il faut nécessairement qu’il en résulte pour lui une nouvelle utilité ; que chacun, par les nouveaux devoirs qu’il contracte, acquière de nouveaux droits : sans cela il serait évident qu’on porterait atteinte à cette nécessité et à cette justice absolues qui caractérisent le droit de propriété pris dans toute son étendue naturelle, et qui doivent servir de base à toutes nos conventions.
Remarquez ici comme la liberté sociale se trouve naturellement renfermée dans le droit de propriété. La propriété n’est autre chose que le droit de jouir ; or il est évidemment impossible de concevoir le droit de jouir séparément de la liberté de jouir : impossible aussi que cette liberté puisse exister sans ce droit, car elle n’aurait plus d’objet, attendu qu’on n’a besoin d’elle que relativement au droit qu’on veut exercer. Ainsi attaquer la propriété, c’est attaquer la liberté ; ainsi altérer la liberté, c’est altérer la propriété ; ainsi PROPRIÉTÉ, SÛRETÉ, LIBERTÉ, voilà ce que nous cherchons, et ce que nous devons trouver évidemment dans les lois positives que nous nous proposons d’instituer ; voilà ce que nous devons nommer LA RAISON ESSENTIELLE ET PRIMITIVE de ces mêmes lois : celles-ci ne doivent être que le développement, que l’expression de cette raison essentielle dans l’application qu’elles en font aux différents cas qu’elles veulent prévoir : ce n’est qu’à cette condition qu’elles pourront porter l’empreinte sacrée d’une nécessité absolue, d’une justice immuable dont l’évidence deviendra le lien indissoluble de notre société, parce [306] que nécessairement cette évidence ne cessera de réunir nos volontés et nos forces pour maintenir et faire observer ces lois.
PROPRIÉTÉ, SÛRETÉ, LIBERTÉ, voilà donc l’ordre social dans tout son entier ; c’est de là, c’est du droit de propriété maintenu dans toute son étendue naturelle et primitive que vont résulter nécessairement toutes les institutions qui constituent la forme essentielle de la société : vous pouvez regarder ce droit de propriété comme un arbre dont toutes les institutions sociales sont des branches qu’il pousse de lui-même, qu’il nourrit, et qui périraient dès qu’elles en seraient détachées.
La première de ces institutions est la législation positive. Mais qu’est-ce que c’est que cette législation ? L’exposition, le tableau fidèle de tous les devoirs et de tous les droits réciproques que les hommes ont naturellement et nécessairement entre eux. Et quels sontils ces devoirs et ces droits réciproques ? Ils consistent tous dans la liberté de retirer de ses droits de propriété, la plus grande somme possible de jouissances, sans offenser les droits de propriété des autres hommes ; car c’est ce devoir qui assure le droit.
La propriété étant ainsi nécessairement dans chaque homme la mesure de la liberté dont il doit jouir, il est évident que les lois positives sont toutes faites ; qu’elles ne peuvent plus être que des actes déclaratifs des devoirs et des droits naturels et réciproques, qui sont tous renfermés dans la propriété : tout ce qu’elles peuvent y ajouter c’est l’établissement des peines, des réparations auxquelles il est évidemment juste d’assujettir le mépris de ses devoirs et la violation des droits d’autrui ; encore cet établissement n’est-il qu’une conséquence naturelle et nécessaire de la sûreté qui doit être invariablement acquise à la propriété.
Nos lois positives ne peuvent donc avoir rien d’arbitraire: comme il n’est point pour elles de milieu entre être favorables ou préjudiciables à la liberté, elles sont ou évidemment justes ou évidemment injustes ; elles sont évidemment conformes ou évidemment contraires à l’objet que nous nous sommes proposé.
Ainsi en partant de cet objet, de la nécessité de maintenir la propriété et la liberté dans toute leur étendue naturelle et primitive, rien de plus simple que les lois qui concerneront les différentes conventions que les hommes pourront faire librement entre eux, et généralement tout ce qu’on peut comprendre sous le nom de commerce : ces lois ne doivent tendre qu’à assurer l’exécution de ces mêmes conventions, et à prévenir tout ce qui pourrait altérer la liberté que chacun doit avoir de faire les marchés et les échanges qui lui conviennent ; de vendre et d’acheter au prix le plus avantageux qu’il puisse se [307] procurer ; de ne prendre, en un mot, que son intérêt personnel pour guide, dans tout ce qui n’excède point la mesure naturelle et nécessaire de cette liberté dont il doit jouir en vertu de ses droits de propriété.
On a vu qu’il est de l’essence de l’ordre que l’intérêt particulier d’un seul ne puisse jamais être séparé de l’intérêt commun de tous ; nous en trouvons une preuve bien convaincante dans les effets que produit naturellement et nécessairement la plénitude de la liberté qui doit régner dans le commerce, pour ne point blesser la propriété. L’intérêt personnel, encouragé par cette grande liberté, presse vivement et perpétuellement chaque homme en particulier, de perfectionner, de multiplier les choses dont il est vendeur ; de grossir ainsi la masse des jouissances qu’il peut procurer aux autres hommes, afin de grossir, par ce moyen, la masse des jouissances que les autres hommes peuvent lui procurer en échange. Le monde alors va de lui-même ; le désir de jouir et la liberté de jouir ne cessant de provoquer la multiplication des productions et l’accroissement de l’industrie, ils impriment à toute la société un mouvement qui devient une tendance perpétuelle vers son meilleur état possible.
Comme il est dans l’ordre physique que les hommes ainsi réunis en société se multiplient promptement, par une suite naturelle et nécessaire de cette multiplication ils vont être réduits à manquer de subsistances, s’ils ne les multiplient en même temps par la culture. Ainsi du devoir et du droit qu’ils ont tous de pourvoir à leur conservation, naissent le devoir et le droit de cultiver. Mais avant de cultiver il faut défricher, faire diverses dépenses pour préparer les terres à recevoir la culture. Ces premières dépenses une fois faites, on ne peut plus enlever aux terres défrichées, les richesses qu’on a consommées en les employant à ces opérations : il faut donc que la propriété de ces terres reste à ceux qui ont fait ces dépenses : sans cela leur propriété mobilière serait lésée. Ainsi de même que la propriété personnelle devient une propriété mobilière par rapport aux effets mobiliers que nous acquérons par nos recherches et nos travaux, de même aussi elle doit nécessairement devenir une propriété foncière par rapport aux terres dans le défrichement desquelles nous avons employé les richesses mobilières que nous possédions.
On voit ici que la propriété foncière n’est point une institution factice et arbitraire ; qu’elle n’est que le développement de la propriété personnelle, le dernier degré d’extension dont celle-ci soit susceptible ; on voit qu’il n’existe qu’un seul et unique droit de propriété, celui de la propriété personnelle ; mais qui change de nom selon la nature des objets auxquels on en fait l’application. [308] Une autre observation, c’est que déjà il ne nous est plus possible de ne pas reconnaître le droit de propriété pour être une institution divine ; pour être le moyen par lequel nous sommes destinés, comme causes secondes, à perpétuer la grande œuvre de la création, et à coopérer aux vues de son auteur. Il a voulu que la terre ne produisît presque rien d’elle-même ; mais il a permis qu’elle renfermât dans son sein un principe de fécondité, qui n’attend que nos secours pour la couvrir de productions. Il est évident que ces secours ne seront point administrés à la terre, si le droit de propriété n’est solidement établi ; par conséquent que ce droit est une branche essentielle de l’ordre physique même ; qu’il est une condition essentielle à la multiplication des êtres de notre espèce ; multiplication que nous voyons manifestement être dans les intentions du créateur.
Il serait superflu de dire que la propriété des terres renferme nécessairement la propriété de leurs productions : la propriété c’est le droit de jouir ; or la jouissance d’une terre est précisément la jouissance des productions qu’on peut en retirer.
Cependant comme il ne suffit pas d’avoir fait les premières dépenses préparatoires à la culture pour que les productions renaissent annuellement, et qu’il peut se faire que les propriétaires de ces premières dépenses manquent des facultés nécessaires pour subvenir à tous les frais que la culture exige encore chaque année, il est dans l’ordre de la propriété que quiconque se chargera de ces frais, partage dans les productions avec ceux par qui les premières dépenses ont été faites.
Quelle sera donc la disposition de nos lois à ce sujet ? Que statueront-elles sur ce partage, sur les proportions qu’on sera tenu de garder, afin que la reproduction ne puisse jamais manquer des avances annuelles dont elle a besoin ? Ma réponse est simple : les lois ne statueront rien ; comme il n’est point de liberté sans la sûreté, elles ne s’occuperont que des moyens d’assurer l’exécution des conventions, parce que cette sûreté est nécessaire pour faire régner dans cette partie, comme dans toutes les autres, la plus grande liberté possible : du sein de cette liberté on verra naître une grande concurrence d’hommes qui se présenteront à l’envi avec des richesses mobilières, et les offriront au rabais pour servir d’avances à la culture : au moyen de cette concurrence, les propriétaires fonciers se procureront ces richesses au meilleur marché possible, et se réserveront ainsi toujours la plus grande part possible dans les productions, qui par l’entremise de ces richesses, croîtront annuellement dans l’étendue de leurs domaines.
La liberté des conventions à faire entre les propriétaires fonciers et les cultivateurs ou entrepreneurs de culture, n’est point une liberté [309] stérile; car d’après ces traités, et en supposant que toute sûreté soit acquise, comme elle doit l’être, à la propriété personnelle et mobilière dans les cultivateurs, ils n’ont pas de plus grand intérêt que de multiplier leurs avances pour multiplier les productions, puisque leurs profits doivent s’accroître en raison de cette multiplication. Ainsi à cet égard la liberté est encore le germe de l’abondance et de tous les avantages que celle-ci procure à la société ; germe d’autant plus fécond, que l’abondance est naturellement progressive ; les profits faits par les cultivateurs devenant dans leurs mains des moyens pour provoquer de plus en plus l’abondance.
Considérons maintenant une troisième classe d’hommes, ceux qui ne sont ni propriétaires fonciers, ni cultivateurs : l’institution de la propriété foncière paraît préjudicier à leur droit de propriété ; les voilà privés de la liberté de profiter des productions spontanées qui croîtraient sur les terres que vous cultivez ; on leur impose, au contraire, le devoir de respecter celles qui naîtront annuellement à votre profit. Mais faites attention que vous ne pouvez jouir de toutes vos productions que par l’entremise des autres hommes ; que pour convertir en jouissances la majeure partie de ces productions, vous avez besoin de l’industrie et des travaux de cette troisième classe ; qu’ainsi vos propres besoins, soit naturels, soit factices, lui assurent le droit de partager dans vos récoltes.
Si la propriété des productions n’était point acquise à ceux qui les font renaître, il n’y aurait ni culture ni récoltes ; les productions seraient par conséquent insuffisantes ; et d’ailleurs chacun serait obligé d’aller les chercher, au risque de ne pas les trouver. Le devoir de respecter les récoltes est donc avantageux à cette classe industrieuse ; non seulement elle ne craint plus de manquer des productions dont elle a besoin ; mais elle est sûre encore que les productions viendront la trouver, dès qu’elle voudra les appeler à elle par ses travaux : ainsi dans cette classe le droit de propriété, bien loin de perdre, a beaucoup gagné.
Un partage à faire chaque année entre les premiers propriétaires des productions renaissantes et les autres hommes, est encore un article qui n’a rien d’embarrassant pour notre législation : le maintien de la propriété et de la liberté dans toute leur étendue naturelle et primitive, va faire régner à cet égard l’ordre le plus parfait, sans le secours d’aucune autre loi.
Quoique moi, agent de la classe industrieuse, je ne sois propriétaire que de ma personne, de mon industrie, de ma main-d’œuvre, il est de l’essence de mon droit de propriété qu’il me soit permis d’en retirer la plus grande somme possible de jouissances : je dois donc être pleinement libre d’échanger mes travaux contre la plus grande [310] somme possible de productions ; par conséquent de préférer entre tous ceux qui les font renaître, celui qui rendra cet échange plus avantageux pour moi. Par la même raison, vous, premier propriétaire des récoltes, vous devez avoir aussi une pleine et entière liberté de préférer parmi tous les hommes de mon espèce, celui qui dans l’échange de vos productions contre ses travaux, vous offrira les conditions qui vous conviendront le mieux : ainsi, sans offenser aucunement ni votre liberté, ni la mienne, cette double concurrence devient naturellement et nécessairement l’arbitre souverain de nos prétentions respectives : par ce moyen vous et moi nous retirons pareillement de nos droits de propriété, la plus grande somme possible de jouissances ; et pour nous procurer cet avantage, nous n’avons besoin que de la liberté qui préside à nos conventions, et de la sûreté de leur exécution.
La consommation, et par conséquent la reproduction, voilà les deux objets capitaux qui intéressent l’humanité ; c’est à ces deux objets que se rapportent directement ou indirectement tous les devoirs et tous les droits réciproques que les hommes contractent entre eux ; aussi est-ce à l’occasion de ces deux objets, que se forment les divers états qui composent une société : les uns disposent les terres à recevoir la culture ; d’autres les cultivent ; d’autres encore préparent les productions qu’elles donnent, en augmentent l’utilité par leur industrie ; d’autres aussi sont chargés du soin de maintenir l’ordre des devoirs et des droits réciproques que ces différentes classes ont entre elles pour raison du besoin qu’elles ont mutuellement les unes des autres.
Le besoin mutuel dont je parle, est naturel et non factice : la consommation est la mesure de la reproduction ; il faut qu’il y ait des hommes qui ne s’occupent qu’à faciliter les consommations, comme il faut qu’il y en ait qui ne s’occupent qu’à faire renaître et à multiplier les productions. Cependant cette distribution des travaux et des occupations de la société, n’est possible, qu’autant que la sûreté des droits réciproques est suffisamment établie. Cette sûreté est le lien commun de toute la société ; c’est elle qui permet que la mesure des devoirs et des droits soit dans tous les cas naturellement et nécessairement déterminée par une concurrence qui est le fruit naturel et nécessaire de la liberté.
Le résultat de cet ensemble n’est pas moins important que facile à saisir : chacun conserve sa liberté, et par conséquent ses droits de propriété dans toute leur étendue naturelle et primitive ; chacun, sans autre intérêt que celui de varier, de multiplier ses jouissances, se trouve être un moyen dont l’ordre se sert pour augmenter la somme des jouissances au profit commun de toute la société : de là nous [311] voyons naître la plus grande abondance possible de productions ; tandis que sur cette base, l’industrie s’élève à son plus haut degré possible, et que par le concours de ces deux avantages, le meilleur état possible est acquis à la plus grande population possible. Tels sont les biens dont nous sommes redevables à la liberté ; mais point de liberté sans la sûreté : il n’y a donc plus que ce dernier objet qui doive maintenant fixer notre attention ; ainsi reste à examiner comment les institutions qui lui sont relatives se trouvent toutes renfermées dans la loi de la propriété.
Faut-il une intelligence supérieure pour comprendre que des devoirs et des droits sont absolument incompatibles avec l’arbitraire ? Les premières connaissances que nous venons de découvrir dans les hommes ne sont-elles pas suffisantes pour leur faire sentir que l’arbitraire et le droit de propriété sont deux choses contradictoires ? N’est-ce pas même pour mettre ce droit à l’abri de l’arbitraire, qu’ils viennent de se réunir en société ? En un mot, leur objet est de maintenir le droit de propriété et la liberté dans toute leur étendue naturelle ; ils en ont reconnu la justice et la nécessité ; voilà la base de toutes leurs conventions sociales ; voilà la raison primitive et essentielle de toutes leurs lois positives.
Il est sensible que parmi des hommes pénétrés de ce principe, il ne peut s’élever des contestations que relativement aux faits, parce qu’il n’y a que les rapports des faits avec le principe qui peuvent ne pas se trouver évidents. Il est sensible aussi que la loi de la propriété ne permet point que dans aucun cas, un homme ait le privilège d’asservir à son opinion particulière un autre homme ; car ce serait tomber dans l’arbitraire, et anéantir la propriété. Il est donc d’une nécessité et d’une justice absolues, d’une nécessité et d’une justice conséquentes à celles du droit de propriété, que chaque fois qu’à raison des faits, il se formera des prétentions contraires les unes aux autres, aucune des parties intéressées ne puisse en décider elle-même ; par conséquent qu’il y ait des hommes préposés pour les juger souverainement et à la pluralité des voix ; des magistrats institués pour faire l’application de la loi aux faits particuliers sur lesquels sont fondés les prétentions ; pour être enfin les organes de la loi, et en annoncer les décisions, après avoir vérifié, par un examen suffisant, les rapports de ces faits avec la loi.
Ce que je dis ici sur la nécessité de la pluralité des magistrats pour rendre un même jugement, n’est qu’une conséquence évidente de l’obligation naturelle et absolue où l’on est de maintenir la propriété dans toute son étendue primitive. Par la raison que les magistrats ne peuvent avoir à juger que des conjectures, des faits dont les circonstances équivoques jettent dans l’incertitude, et prêtent à ce [312] qu’on nomme opinion, cette incertitude ne peut être fixée que par le plus grand nombre des opinions ; ce plus grand nombre étant la seule ressource que nous puissions employer pour nous guider au défaut de l’évidence. Il est donc sensible que la propriété serait compromise, si les jugements n’étaient pas invariablement rendus à la pluralité des suffrages.
Ainsi la nécessité de maintenir la propriété et la liberté dans toute leur étendue naturelle et primitive, nous conduit à la nécessité de proscrire l’arbitraire ; de là, à la nécessité d’instituer un corps de magistrats ; de là, à la nécessité que leurs jugements soient irréformables ; de là, à la nécessité de les assujettir eux-mêmes à des formes qui ne leur permettent de juger, qu’après avoir éclairé autant qu’il est possible, l’obscurité des faits sur lesquels ils ont à faire parler la loi.
Les rapports de ces formes avec le maintien de la propriété sont encore évidents : impossible de rendre justice sans examen, quand elle n’est pas évidente par elle-même. Les formes sont les procédés qui conduisent à rendre l’examen suffisant ; voilà pourquoi la violation de ces formes serait une injustice évidente ; or, en cela qu’elle serait évidente, elle n’est plus à craindre : quand les magistrats oseraient s’y porter, cette injustice aurait le sort de toutes les autres de la même espèce, contre lesquelles nous allons trouver un remède assuré.
Dans tous les cas équivoques, et qui paraissent prêter à ce qu’on appelle opinion, l’arbitraire étant une fois enchaîné par l’institution des magistrats, le droit de propriété n’a plus à redouter que la violence et les voies de fait, qui pourraient résulter d’une mauvaise volonté dont l’évidence serait manifeste. Mais nous avons vu que c’est précisément pour prévenir ce désordre évident, que les hommes ont institué leur société ; qu’ils sont convenus de réunir toutes leurs forces particulières, de n’en plus former qu’une seule force commune pour l’employer au maintien de la propriété : ainsi pour garantie contre les voies de fait, contre les injustices évidentes, vous avez une autorité tutélaire armée de toutes les forces physiques de la société : voyez s’il est possible d’imaginer une sûreté plus entière, plus solide, plus absolue.
En cela même que les hommes ont reconnu la nécessité de cette force commune, ils ont aussi reconnu la nécessité d’un souverain, et d’un souverain unique ; il est aisé de le prouver. Observez d’abord qu’au moyen de la réunion de toutes nos forces particulières, vous ne voyez qu’une seule force publique. Observez ensuite que la force n’est point active par elle-même : elle a bien tout ce qu’il faut pour agir ; elle est toujours prête à agir ; mais tout cela ne suffit pas : il lui faut encore une volonté qui la fasse agir. Il est donc évident qu’il [313] devient d’une nécessité absolue d’instituer un chef à la voix duquel la force publique se mette en action ; un chef dont la volonté prescrive à cette force, les mouvements qu’elle doit faire pour la sûreté commune de nos droits de propriété ; il est donc évident aussi que ce chef doit être unique ; car s’il y avait deux chefs, il pourrait se trouver deux volontés qui se contrediraient : à laquelle des deux alors faudrait-il que la force commune obéît ? Si c’est à l’une des deux par préférence, je ne vois plus qu’un souverain unique ; si ce n’est ni à l’une ni à l’autre, il n’existe plus de souverain tant que ces deux volontés ne sont pas d’accord pour n’en plus former qu’une seule ; dans ce cas, la force publique devient nulle, parce qu’elle ne peut plus être mise en action ; et le droit de propriété, qu’elle doit protéger, se trouve sans appui, sans sûreté.
Deux autorités égales présentent une contradiction évidente : elles sont toutes deux nulles, prises séparément. Deux autorités inégales présentent une contradiction dans un autre genre, mais de la même évidence : celle des deux qui est supérieure est tout, et l’autre n’est rien.
Qui dit autorité, dit le droit de commander joint au pouvoir physique de se faire obéir, ce qui suppose toujours et nécessairement la supériorité de la force physique. Mais qui est-ce qui a naturellement le droit de commander aux hommes, si ce n’est l’évidence ? Qui est-ce qui peut assurer au commandement la supériorité de la force physique pour se faire obéir, si ce n’est la force intuitive et déterminante de l’évidence, qui rallie à elle toutes nos forces, parce qu’elle rallie à elles toutes nos volontés ? L’évidence n’est-elle pas une, n’est-elle pas immuable ? Ainsi partout où elle est le principe de la réunion des forces, il ne peut se trouver qu’une seule force publique ; impossible de diviser celle-ci, à moins de la séparer de son principe, et c’est l’anéantir ; impossible par conséquent qu’elle puisse être placée dans plusieurs mains à la fois.
Quand les hommes sont malheureusement privés de l’évidence, l’opinion proprement dite est le principe de toutes forces morales : nous ne pouvons plus alors ni connaître aucune force, ni compter sur elle. Dans cet état de désordre nécessaire, l’idée d’établir des contres-forces pour prévenir les abus arbitraires de l’autorité souveraine, est évidemment une chimère : l’opposé de l’arbitraire, c’est l’évidence ; et ce n’est que la force irrésistible de l’évidence qui puisse servir de contre-force à celle de l’arbitraire et de l’opinion.
Pour calmer toute inquiétude sur les abus de l’autorité de la part d’un chef unique, il suffit de faire attention à la nécessité manifeste dont il est pour un souverain de protéger le droit de propriété : il n’est souverain que parce qu’il tient dans sa main toutes les forces [314] physiques de la société ; mais qu’est-ce qui réunit ainsi dans la personne du chef toutes ces forces particulières ? L’évidence de la nécessité et de la justice absolues qui caractérisent le droit de propriété, et qui nous imposent le devoir absolu de le maintenir dans toute son étendue naturelle et primitive. Ne séparez donc point l’effet et la cause qui le produit : l’évidence est ici l’intermédiaire par le moyen duquel toutes les forces de la société se rallient au souverain : si vous anéantissez la cause, qu’est-ce qui la suppléera pour en perpétuer les effets ? Faites attention maintenant, qu’il n’est rien de plus évident que l’étendue naturelle et primitive dont la propriété, et par conséquent la liberté doivent jouir ; qu’ainsi il est impossible de leur porter atteinte, sans qu’un tel abus de l’autorité soit publiquement évident ; d’après cette seule observation voyez si des abus de cette espèce sont à craindre ; voyez si la force naturelle et irrésistible d’une évidence publique, n’est pas suffisante pour vous en garantir ; voyez aussi combien se sont égarés ceux qui ont cherché à opposer à l’autorité du souverain, d’autres contre-forces que celles de cette évidence, qui doit être le principe même de l’autorité, parce qu’elle est celui de la réunion des volontés.
Les spéculations d’après lesquelles on a imaginé le système des contre-forces, sont d’autant plus chimériques, que l’intention d’abuser de son autorité, au préjudice de la propriété et de la liberté, est une chose qu’on ne peut jamais supposer dans un souverain, à moins que la loi fondamentale de la propriété, et les avantages qui en résultent nécessairement, ne soient totalement oubliés et du souverain même et de toute la société : sans cela il sera toujours et nécessairement le plus puissant protecteur de cette loi, parce qu’il trouvera toujours et nécessairement dans le maintien de cette loi, tous les intérêts personnels qui peuvent être l’objet de son ambition, et doivent par conséquent influer sur ses volontés : les détails suivants nous conduiront naturellement à reconnaître cette vérité.
La sûreté civile et politique que le souverain est tenu de procurer au droit de propriété ne peut s’établir que par des dépenses ; car il faut que tous ceux qui contribuent à cette sûreté soient payés : cherchons donc les moyens de pourvoir à ces dépenses communes ou publiques sans offenser le droit de propriété ; car c’est là l’objet dont nous ne devons jamais nous écarter.
Puisque nous avons dans la société des dépenses publiques, il faut y pourvoir par l’institution d’un revenu public, dont le souverain puisse avoir l’administration : au moyen de ce revenu public, les dépenses publiques ne coûtant rien aux revenus particuliers, les propriétés particulières et la liberté d’en jouir seront conservées en leur entier. [315] Par la raison que ce revenu public, destiné à une consommation annuelle, ne peut être entretenu que par une reproduction annuelle, et qu’il n’y a que les terres dont on puisse attendre cette reproduction, il est évident que ce revenu public ne peut être autre chose qu’une portion des valeurs ou des productions que les terres donnent annuellement. Voici donc que d’un seul trait nous rayons de dessus la liste des contribuables au revenu public, tous ceux qui partagent dans ces productions à tout autre titre que celui de propriétaires fonciers ; et cela parce que cette multitude d’hommes, de quelque espèce qu’ils soient, ne sont que des salariés par le produit des terres, et ne prennent dans ce produit, qu’une portion que la concurrence fixe au taux le plus bas possible. La propriété personnelle et mobilière de ces mêmes hommes est donc maintenue dans toute son étendue naturelle et primitive ; dès lors plus de doubles emplois dans la contribution au revenu public ; plus d’impôts arbitraires ni sur les entrepreneurs des cultures, ni sur les hommes qu’ils entretiennent au service de cette profession ; impôts qui frappant sur les avances, et diminuant ainsi la masse des richesses productives, causent à la reproduction un préjudice énorme, ruinent souvent les cultivateurs, et deviennent progressivement destructifs des richesses de la nation, de celles du souverain et de la population.
Par la même raison, plus d’impôts arbitraires ni sur les salaires ou la personne des agents de la classe industrieuse, ni sur les choses commerçables ; impôts qui enraient les travaux et arrêtent les progrès de l’industrie ; impôts qui font diminuer les consommations, le débit et la valeur vénale des productions ; impôts dont les contrecoups grèvent aussi les entrepreneurs des cultures et éteignent la reproduction ; impôts qui retombent à grands frais sur les propriétaires fonciers et sur le souverain même ; impôts qui commencent par coûter à ces propriétaires 4 et 5 fois plus que la somme qui en revient au revenu public ; impôts qui trompent toutes les spéculations ; qui ne permettent plus de compter sur aucuns produits ; qui bientôt appauvrissent le souverain au lieu de l’enrichir, et par une progression rapide, conduisent à la destruction totale des richesses, des hommes, de tout ce qui concourt à former la puissance politique de l’État. Voilà les maux que nous évitons naturellement et nécessairement tant que la propriété personnelle et mobilière est respectée parmi nous comme elle doit l’être ; tant qu’elle n’est point blessée par la manière de procéder à la formation d’un revenu public.
À l’égard de la propriété foncière, la nécessité de la faire jouir du même avantage, nous montre évidemment que le produit des terres doit se partager entre elle et le revenu public ou le souverain : il ne [316] s’agit donc plus que de savoir quelles sont les conditions essentielles de ce partage.
La première de ces conditions et la plus importante est que la proportion du partage n’ait rien d’arbitraire : elle ne peut l’être de la part des propriétaires fonciers ; car le revenu public n’aurait rien d’assuré ; ils pourraient à leur gré retenir à leur profit particulier, une portion de ce revenu public, qui est fait pour être une richesse commune, servant à l’utilité commune de toute la société.
Cette même proportion ne peut aussi être arbitraire de la part du souverain ; car par ce moyen la propriété des terres se trouverait séparée de celle de leurs produits ; à ce prix personne ne voudrait être propriétaire foncier ; et les terres incultes ne donneraient ni revenu public, ni revenu particulier ; alors il n’y aurait plus de souverain, parce que faute de subsistances suffisantes, il n’y aurait plus de société.
Cette première condition essentielle du partage nous indique naturellement la seconde : les propriétés foncières ne se forment et ne s’entretiennent que par des dépenses ; mais ces dépenses ne seront pas faites, si, toutes proportions gardées, le fruit qu’on espère en retirer n’est pas au moins égal à celui que donneraient les mêmes dépenses dans d’autres emplois. Cette parité, et je ne dis point assez, est donc essentiellement nécessaire pour que les hommes se portent à faire et entretenir toutes les dépenses qui doivent précéder celles de la culture, et que les terres ne cessent jamais de pouvoir être mises en valeur.
D’après les deux conditions essentielles du partage, la proportion suivant laquelle il doit être fait entre le souverain et les propriétaires fonciers, étant ainsi réglée pour toujours, il est évident que les propriétaires fonciers se trouvent, comme tous les autres hommes, exempts de la contribution au revenu public ; que la terre fournit elle-même au souverain, ce revenu annuel à l’acquit et au profit commun de toute la société ; que ce revenu par conséquent, au lieu d’être une charge commune, devient une richesse commune, par le moyen de laquelle la souveraineté se trouve naturellement et nécessairement en communauté d’intérêts avec les sujets ; car alors il lui importe personnellement que les produits des terres se multiplient pour eux, afin que la part proportionnelle qu’elle y prend, soit pour elle une plus grande richesse.
De cette communauté d’intérêts entre l’État gouvernant et l’État gouverné, nous voyons naître la dernière règle concernant l’établissement du souverain. Cette dernière règle est l’institution du droit de succéder à la souveraineté. Non seulement cette institution met à l’abri de tous les inconvénients, de tous les orages qui précèdent, [317] accompagnent et suivent ordinairement l’élection d’un souverain ; mais il en résulte encore un bien plus grand avantage : le souverain et la souveraineté se confondent et ne font plus qu’un ; les intérêts de la souveraineté deviennent ceux du souverain même ; c’est lui personnellement qui se trouve co-propriétaire du produit net des terres de sa domination ; c’est lui personnellement qui se trouve en communauté d’intérêts avec ses sujets : comment supposer alors qu’il voulût porter atteinte au droit de propriété ? Il voit évidemment que le maintien de ce droit et de la liberté dans toute leur étendue naturelle et primitive, est le germe de la prospérité progressive de ses sujets ; il voit que cet accroissement progressif est l’unique voie par laquelle il puisse parvenir au dernier degré possible de richesse, de puissance et de gloire ; il voit que cette loi sacrée de la propriété est instituée pour lui, et non contre lui ; que par le moyen de cette loi, qui lie tous les intérêts du corps politique ; qui nécessairement ramène à l’unité la multitude des membres qui le composent, c’est la divinité elle-même qui gouverne, et qu’elle semble avoir tout disposé pour embellir la souveraineté, pour que ceux qui sont sur la terre les ministres, les images vivantes du Très-Haut, ne connaissent plus que le bonheur de jouir et d’être adorés.
Il faut donc regarder l’institution de la souveraineté héréditaire, comme étant ce qui met le comble à la sûreté que nous nous proposons de procurer au droit de propriété. Ce droit dans aucun cas n’a plus rien à craindre : tout ce qui pourrait lui porter la plus légère atteinte serait nécessairement un désordre évident, qui ne peut jamais être dans les intentions d’un chef dont les intérêts sont inséparables de ceux de la souveraineté. La publicité de cette évidence est une contre-force naturelle sur laquelle le souverain peut compter dans tous les cas où l’on serait parvenu à le tromper, à lui surprendre, par des détours criminels, des ordres ou des lois contraires à ses véritables intérêts. Je ne dis point encore assez : il faut regarder cette évidence comme étant la divinité elle-même, qui veille sans cesse, et d’une manière sensible, à la sûreté commune des intérêts communs du souverain et des sujets, et qui ne permet pas que les minorités des rois soient susceptibles des plus légers inconvénients, parce qu’elle ne permet pas que des lois dont la justice et la nécessité sont publiquement évidentes, puissent perdre de leur vigueur dans aucun temps.
Si je parle ici des lois, c’est qu’il est évident que le pouvoir législatif ne peut résider que dans le souverain tel que nous venons de l’instituer. Au moyen de ce que nous avons acquis une connaissance évidente de la raison essentielle et primitive de toutes les lois, il est sensible que dans la main des hommes, le pouvoir législatif n’est point le [318] pouvoir de faire des lois nouvelles ; qu’il se réduit à publier celles qui sont déjà faites par Dieu même, et à les sceller du sceau de l’autorité coercitive dont le souverain est dépositaire unique. Ainsi du droit de propriété résulte encore que le souverain est naturellement et nécessairement législateur, et qu’il n’est de sa part aucun abus à craindre dans cette partie ; car il est de son intérêt personnel que les lois qu’il fait promulguer, n’aient rien de contraire à leur raison essentielle et primitive, et s’il tombait dans quelques méprises à ce sujet, il serait d’une impossibilité morale que leur évidence échappât à la nation et principalement aux magistrats.
Admirez présentement comme chacun jouit, tant en commun qu’en particulier, de son meilleur état possible ; j’entends, du meilleur état qu’il lui soit physiquement et socialement possible de se procurer réellement : en effet, en quoi consiste cet avantage ? Il consiste dans la plus grande liberté possible de jouir de ses droits de propriété, afin d’en retirer la plus grande somme possible de jouissances : or il est évident que la liberté ne peut être plus entière, plus complète que celle qui vient de nous être garantie pour toujours : chacun de nous est parfaitement libre d’employer ses biens-fonds, ses richesses mobilières, sa personne, son industrie, ses talents de la manière qui convient le mieux à son intérêt personnel ; chacun de nous est assuré que les fruits de ses travaux ne lui seront point ravis ; qu’il en retirera la plus grande somme de jouissances qu’il puisse se promettre ; et qu’en cette partie il ne connaît de lois que celles de la concurrence qui résulte naturellement et nécessairement d’une liberté semblable dans les autres hommes ; chacun de nous, à la faveur de cette pleine et entière liberté, et aiguillonné par le désir de jouir, s’occupe, selon son état, à varier, multiplier, perfectionner les objets de jouissances qui doivent se partager entre nous, et augmente ainsi la somme du bonheur commun en augmentant celui qui lui est personnel.
Remarquez ici quel est le prix inestimable de l’ordre simple et naturel qui vient de s’établir : chaque homme se trouve être l’instrument du bonheur des autres hommes ; et le bonheur d’un seul, semble se communiquer comme le mouvement. Prenez à la lettre cette façon de parler : de quelque nature que soient les efforts que vous faites pour accroître la somme de vos jouissances ; soit que les résultats de ces efforts donnent une plus grande abondance de productions, soit qu’ils rendent d’autres services à la société, toujours est-il vrai qu’ils ne vous seront payés qu’en raison de leur utilité ; que la concurrence ne vous permettra pas de mettre qui que ce soit à contribution ; que la balance en main, elle règlera les valeurs vénales de toutes les choses et de toutes les actions qui entrent dans le commerce, [319] qu’au moyen de cette police rigoureuse, à l’autorité de laquelle personne ne peut se soustraire, l’équilibre sera constamment gardé dans les échanges ; personne ne pourra jouir, ne pourra s’enrichir aux dépens des autres ; alors plus de ces fortunes démesurées dans lesquelles on voit une multitude d’autres fortunes venir s’engloutir ; plus de ces amas somptueux de richesses superflues, qui détournées de la circulation, laissent une partie des membres du corps social se dessécher et périr faute de substance ; chacun ainsi dans la somme totale du bonheur commun, prendra la somme particulière qui doit lui appartenir. Je ne sais si dans cet état nous apercevons des malheureux ; mais s’il en est, ils sont en bien petit nombre ; et celui des heureux est si grand, que nous ne devons plus être inquiets sur les secours dont ceux-là peuvent avoir besoin.
Un des grands avantages de l’ordre qui vient, pour ainsi dire, de s’établir de lui-même, est que le luxe, ce cruel ennemi du genre humain, ce monstre, dont le venin est si subtil, si actif, qu’on ne peut jeter les yeux sur lui sans en ressentir les atteintes mortelles ; ce tyran perfide, qui sous le voile trompeur de la prospérité publique, cache les cadavres des malheureux qu’il immole journellement ; le luxe, dis-je, ne peut pénétrer dans une société que nous voyons naître sous les auspices du droit de propriété.
C’est la nature et non la somme des dépenses, qui constitue le luxe ; aussi prend-il sa source moins dans les richesses acquises, que dans la façon de les acquérir ; je veux dire, dans des pratiques spoliatrices qui accumulent dans quelques mains seulement une masse considérable de richesses, dont la consommation ne peut plus se faire d’une manière utile à la reproduction.
Par le moyen de la circulation, toutes les valeurs qui partent de la classe productive, doivent y revenir pour servir encore de germe à la reproduction qui doit les rendre perpétuellement à la circulation. Le luxe, qui change toute la marche naturelle des consommations, est précisément le désordre opposé à l’ordre qui doit nécessairement régner dans les dépenses pour que cette circulation ne puisse jamais être interrompue : or il est impossible que ce désordre s’introduise parmi nous, tant que respectant la propriété et la liberté, nous ne nous prêterons à rien qui puisse fournir à quelques hommes, un titre et des facilités pour en ruiner d’autres, et s’enrichir de leurs dépouilles. Qu’on me permette de ne pas insister sur cette observation ; je ne pourrais le faire sans m’écarter de mon sujet. D’ailleurs il me semble qu’on n’ignore plus aujourd’hui que c’est au luxe que nous devons attribuer le mauvais emploi des hommes et des richesses ; que ce mal moral est enté sur un autre mal qu’il aggrave encore, et qui n’est autre chose que la violation habituelle du droit de propriété ; [320] que l’autorisation des abus qui donnent des moyens pour mettre à contribution la société, pour en dénaturer les richesses, changer en richesses stériles, celles qui sont destinées à être productives, épuiser ainsi le principe de la reproduction et du bonheur public.
Tandis que dans l’intérieur de notre société, la loi de la propriété fait régner l’ordre, la justice, la paix et la liberté ; tandis que le corps social s’organise de manière que depuis le chef jusqu’au dernier des membres, chacun jouit évidemment de son meilleur état possible, examinons ce qui peut nous intéresser à l’extérieur ; quels sont nos rapports politiques avec les autres sociétés.
J’observe d’abord que la paix est l’état naturel dans lequel les nations doivent être respectivement entre elles ; car la guerre entre deux nations est un état violent, dangereux, fâcheux pour l’une et pour l’autre, comme elle peut l’être entre deux particuliers : elles ont donc toutes deux également et naturellement intérêt de l’éviter.
Puisque l’état de paix est l’état naturel des nations, il doit avoir ses conditions essentielles ; ainsi on peut, en général, s’assurer cet heureux état, en remplissant ces mêmes conditions. Mais déjà je les vois former la base de notre système politique ; nous les trouvons toutes renfermées dans la loi de la propriété : sitôt que nous l’avons reconnue pour être la raison essentielle et primitive de toutes les autres lois, il nous est impossible de regarder cette loi divine comme une institution qui nous soit particulière ; il nous est impossible de ne pas voir que toutes les nations ne forment entre elles qu’une seule et même société, et que la loi de la propriété est une loi commune à toutes les différentes classes de cette société générale : il nous est donc évident que nous ne pouvons, sans injustice, troubler les droits de propriété et la liberté des autres nations ; il nous est évident aussi que le droit de propriété et la liberté seraient blessés dans chacun des membres de notre société, si l’on disposait arbitrairement de leurs personnes et de leurs richesses pour faire violence aux autres nations ; il nous est évident enfin que les sujets de guerre ne peuvent naître entre elles et nous, qu’à l’occasion des entreprises qu’elles voudraient faire ouvertement au préjudice de la sûreté et de la liberté qui doivent être acquises à nos droits de propriété.
Pour que les sujets de guerre ne puissent être arbitraires, il suffit donc de ne pas perdre de vue le droit de propriété ; de le considérer tel qu’il est, et tel qu’il doit être essentiellement soit dans chacun des membres de notre société particulière, soit dans les membres des autres sociétés ; car il est de la même justice et de la même nécessité dans tous les hommes. Cela posé les rapports politiques que les nations ont naturellement entre elles, ne sont plus que de deux [321] espèces ; les uns sont relatifs à la sûreté, et les autres à la liberté de jouir.
Il est sensible qu’une nation qui veut en opprimer une autre et s’agrandir par des conquêtes, menace, de proche en proche, toutes les autres nations : il est donc dans l’ordre du droit de propriété et de la sûreté dont ce droit a essentiellement besoin, que cette nation soit regardée comme un ennemi commun par toutes les autres nations : de là naît naturellement un intérêt commun, qui constitue toutes les autres nations dans la nécessité de se réunir pour faire une force commune capable de garantir à chacune d’elles ses droits de propriété. Sous ce point de vue les rapports politiques d’une nation avec les autres nations sont déterminés par ce même intérêt commun ; leur sûreté commune exige qu’elles se regardent comme ne formant qu’une seule et unique société, distribuée en différentes classes, lesquelles, malgré cette distribution, sont toutes personnellement et fortement intéressées à se garantir mutuellement leurs droits de propriété.
Quant aux rapports politiques qui sont relatifs à la liberté de jouir, c’est encore dans le droit de propriété qu’il faut les chercher. Ces mêmes rapports ont pour objet le commerce extérieur ou les différents échanges que les nations peuvent faire entre elles pour leur utilité commune. Mais nous avons déjà vu que la loi de la propriété veut que notre société jouisse à cet égard d’une pleine et entière liberté ; que chacun de nous puisse librement vendre aux acheteurs qui lui offrent un meilleur prix, et acheter des vendeurs dont les conditions lui conviennent le mieux. Ainsi sur cet article nulle querelle, nul sujet de guerre entre nous et les étrangers. Quelque chose de plus : je les suppose dans des systèmes absolument contraires à cet ordre naturel ; je veux bien qu’ils gênent chez eux la liberté du commerce : et que nous importe ? En cela ils ne nous font aucun tort ; c’est à eux-mêmes, c’est à leur liberté qu’ils portent préjudice et non pas à la nôtre : cet avantage précieux dont ils devraient jouir, n’est-il pas leur bien propre ? Ne sont-ils pas les maîtres d’en user ou de n’en pas user ? Ils ne font que ce que tout homme est libre de faire vis-à-vis d’un autre homme : ils interdisent à nos marchandises l’entrée de leurs pays ; mais ils en ont le pouvoir, parce que nous n’avons chez eux aucun droit, et que le commerce est une affaire de convenance réciproque : cette politique factice ne nous ôte point la liberté de recevoir chez nous leurs marchandises ; de traiter avec tous ceux à qui nos échanges conviennent ; en un mot, notre liberté est toujours la même et dans tout son entier.
Mais, dira-t-on, il faut que nous usions de représaille, et que nous fermions nos ports à ceux qui nous ferment les leurs : pour [322] décider cette question, c’est à la loi de la propriété qu’il faut recourir. Or, si nous la consultons, comme nous le devons, nous y trouverons que cette prétendue représaille blesserait notre liberté et par conséquent nos droits de propriété : ce procédé bizarre, ou plutôt ce désordre évident ferait diminuer la concurrence des vendeurs de qui nous achetons, et celle des acheteurs à qui nous vendons ; de là, il résulterait pour nous une diminution de consommateurs, de débit et de valeur vénale pour nos productions : en conservant au contraire cette concurrence dans toute sa force, nous nous ménageons évidemment la plus grande somme possible d’échanges et aux meilleures conditions possibles ; nous assurons ainsi à notre société, la renaissance annuelle de la plus grande abondance possible de ses productions, et conséquemment le plus grand revenu possible à la nation en général, et au souverain en particulier.
Ainsi sans autre loi que celle de la propriété ; sans autres connaissances que celle de la raison essentielle et primitive de toutes les lois ; sans autre philosophie que celle qui est enseignée par la nature à tous les hommes, nous voyons qu’il vient de se former une société qui jouit au dehors de la plus grande consistance politique, et au dedans de la plus grande prospérité ; nous voyons qu’il vient de s’établir parmi nous, une réciprocité de devoirs et de droits, une fraternité qui nous intéresse tous à la conservation les uns des autres, et dont les liens sacrés embrassent et tiennent unis avec nous tous les peuples étrangers.
Ne soyez point en peine maintenant ni de notre morale, ni de nos mœurs ; il est socialement impossible qu’elles ne soient pas conformes à leurs principes ; il est socialement impossible que des hommes qui vivent sous des lois si simples, qui parvenus à la connaissance du juste absolu, se sont soumis à un ordre dont la justice par essence est la base, et dont les avantages sans bornes leur sont évidents, ne soient pas humainement parlant, les hommes les plus vertueux. Pour que de tels hommes puissent se corrompre, il faut qu’ils commencent par tomber dans une ignorance qu’on ne peut supposer, parce qu’il est contre nature de passer de l’évidence publique à l’erreur ; parce que chacun est attaché par son intérêt personnel, à la conservation de cette évidence ; parce qu’enfin il est facile, et même conforme à l’ordre, de perpétuer cette même évidence par l’instruction, en prenant les mesures nécessaires pour que tous les membres du corps social puissent y participer.
Ainsi lorsqu’il s’élèvera parmi nous des sages qui publieront qu’on est homicide quand on n’empêche pas de périr celui qu’on peut [323] sauver [13] ; que c’est aimer Dieu, que c’est l’imiter, que de ne nuire à personne et de faire du bien à tous ses semblables [14]; que la Divinité, en nous permettant de vivre, nous fait un présent moins précieux, qu’en nous donnant les connaissances qui nous apprennent à bien vivre [15] ; que ceux qui violent la loi naturelle et universelle, devenue pour eux évidente par le moyen de ces mêmes connaissances, sont au-dessous des brutes [16] ; qu’on ne doit regarder comme un mal, que les choses honteuses, et comme un bien, que les choses honnêtes [17] , nous écouterons attentivement ces philosophes ; nous ne les admirerons peut-être pas avec étonnement ; mais nous ferons mieux : nous les croirons, et nous pratiquerons leurs leçons, parce qu’ils ne nous enseigneront rien alors qui soit nouveau pour nous, et qui ne puisse être facilement saisi par notre intelligence ; rien qui déjà ne nous soit sensible, et ne se trouve écrit au fond de nos cœurs ; rien qui ne soit conséquent à notre intérêt personnel évident, à la nécessité et à la justice absolues de la réciprocité de nos devoirs et de nos droits, de la garantie mutuelle que nous nous sommes promise, et que nous nous devons tous pour le maintien du droit de propriété et de la liberté dans toute leur étendue naturelle et primitive.
Nous pouvons dire avec vérité que dans l’ordre des choses humaines, le véritable instituteur de l’homme moral, c’est le système public du gouvernement. Regis ad exemplum totus componitus orbis : tel est l’esprit de l’État gouvernant, et tel est aussi l’esprit de l’État gouverné. Ce n’est pas seulement sur la seule force de l’exemple que cette grande vérité se trouve établie, c’est encore sur les premiers principes qui décident de notre caractère moral et de nos volontés. Quelles que soient dans une nation les voies qui conduisent aux dignités, aux honneurs, à la considération publique, soyez certain que le désir de jouir nous portera toujours à les embrasser. Partout où les richesses seront la mesure de cette considération publique ; partout où l’or sera publiquement encensé comme une divinité et plus honoré que la vertu ; partout enfin où il deviendra le germe des jouissances les plus piquantes, les plus propres à mettre nos mobiles en action, il faut nécessairement que les hommes soient avides de l’or, qu’ils sacrifient tout à l’or, qu’ils se vendent eux-mêmes pour de l’or. L’amour des jouissances et l’aversion de la douleur, voilà les deux grands ressorts de l’humanité ; voilà ce qui met en mouvement, non seulement l’homme physique, mais encore l’homme social ; c’est [324] même dans ce dernier que la force de ces deux mobiles se montre plus active et plus absolue : considérez de quelle chaleur, de quel enthousiasme nos affections, nos passions sociales sont susceptibles, et vous reconnaîtrez facilement que c’est au gouvernement à les diriger ; que c’est à lui, à son système public constamment et invariablement soutenu, qu’il est réservé de greffer les vertus sociales sur les mobiles qui sont en nous : le propre du désir de jouir est de saisir les moyens de jouir : c’est au gouvernement qu’il appartient de faire pour nous le choix de ces moyens.
Nous savons tous par notre propre expérience, combien nos opinions particulières influent sur notre caractère moral. Nous savons tous aussi combien nos opinions particulières tiennent à l’opinion publique, au système public du gouvernement. En général, chaque nation a un genre de fanatisme qui lui est propre, et qui se communique plus ou moins à tous ceux qui la composent ; les désordres privés qui naissent d’un dérèglement dans les opinions particulières, ne sont ainsi que des contre-coups naturels et infaillibles d’un premier dérèglement dans les opinions publiques, dans les systèmes admis par le fanatisme de la nation ; et voilà pourquoi on a donné le nom de vertus du siècle à toutes celles qui, après avoir régné pendant quelque temps avec éclat, ont totalement disparu.
Quoiqu’une simple opinion puisse produire en nous tous les effets de l’évidence et opérer les mêmes miracles, ne comptez pas cependant qu’ils puissent être de la même durée. Par la seule force de l’opinion les vertus sociales peuvent s’établir passagèrement dans une nation ; mais elles ne peuvent s’y perpétuer, dès qu’elles n’ont pour principe que l’opinion ; car il n’est rien qui soit plus inconstant, plus orageux ; aussi est-il impossible de la fixer sans le secours de l’évidence qui l’assujettit en l’éclairant et la dénaturant. Ces vertus d’ailleurs sont alors nécessairement séparées de l’ordre essentiel des sociétés ; vu que l’institution de cet ordre ne peut être que le fruit de la connaissance évidente que les hommes en auront acquise.
Entre les vertus sociales et l’ordre essentiel des sociétés, il est cette différence, que les vertus peuvent exister passagèrement sans l’ordre, au lieu que l’ordre ne peut jamais exister sans les vertus. En effet, cet ordre n’est autre chose que la pratique de ces mêmes vertus, mais instituée d’après l’évidence de leur nécessité absolue, de leur justice immuable, de l’intérêt que le corps social et chacun de ses membres en particulier ont à ne jamais s’en séparer : chacun alors voit évidemment que son meilleur état possible est inséparablement attaché à la pratique de ces vertus ; chacun est donc, pour ainsi dire, dans une impossibilité morale et sociale de n’être pas vertueux. [325] Vous voyez ici pourquoi de grandes vertus sociales ont brillé pendant quelques siècles dans Rome, dans Sparte, dans Athènes, dans Carthage, chez les Perses, chez les Égyptiens ; vous voyez aussi pourquoi elles ont dû s’éclipser : n’étant point nourries par l’évidence de l’ordre essentiel des sociétés, elles ne devaient leur existence qu’à l’opinion, et ne pouvaient avoir plus de solidité que leur principe. Non seulement ce fait est évident par rapport aux républiques que je viens de citer, puisque cet ordre, qui n’admet qu’un chef unique, est incompatible avec le gouvernement de plusieurs ; mais il est encore de la même évidence par rapport au gouvernement des Perses, à celui des Égyptiens, et de tous les gouvernements monarchiques de l’antiquité. Le despotisme n’y était que personnel et non légal : c’était la volonté personnelle et arbitraire d’un seul qui gouvernait, et non la justice et la nécessité d’un ordre essentiel dont l’évidence doit nécessairement réunir toutes les volontés. Quand ces despotes étaient sages et vertueux, la sagesse de leur gouvernement faisait fleurir leur empire ; mais à la mort de ces princes cette prospérité était ensevelie avec leurs vertus ; d’autres opinions montaient sur le trône ; l’arbitraire déployait toutes ses fureurs ; les despotes alors et les peuples devenaient tour à tour ses victimes ; arrivait le moment où ces prétendus corps politiques se trouvaient accablés sous le poids de leurs désordres ; il fallait bien qu’ils périssent enfin, puisqu’ils n’avaient aucune consistance intérieure, et qu’ils nourrissaient en eux-mêmes le principe certain de leur dissolution.
Une seule réflexion suffirait pour prouver qu’aucun gouvernement de l’antiquité n’a conçu la première idée de l’ordre essentiel des sociétés : il n’y en a pas un qui n’ait été conquérant ou qui n’ait voulu l’être : ils ne connaissaient donc pas la loi de la propriété, puisqu’ils étaient dans le système de ramener tout à la force par rapport aux nations étrangères. Comment se pourrait-il que cet esprit d’injustice, quand il forme le système public d’un gouvernement, ne passât pas dans les sujets, et ne parvînt pas à égarer leurs opinions sur l’usage qu’on peut faire de ses forces dans les cas particuliers ? Les lois alors ne peuvent plus être observées par religion de for intérieur ; elles doivent être violées chaque fois qu’on croit voir un grand intérêt à les violer.
Un gouvernement ne devient conquérant, qu’autant que ses sujets, en général, sont pénétrés de ces sentiments véhéments et audacieux qu’une grande ambition inspire. La violence de cette passion ne connaît point le repos ; c’est un feu dévorant qui ne peut exister sans consumer ; il faut tôt ou tard qu’il détruise ses propres foyers. Voyez ce qu’il en a coûté à la république romaine pour avoir établi chez elle le système de se croire permis tout ce que la force lui [326] permettait par rapport aux nations étrangères : ses sujets ont appris de leur gouvernement à ne reconnaître de droits que ceux de la force ; de lois qu’une volonté arbitraire et despotique : de telles opinions, dès qu’elles ne servaient plus à l’accroissement de la grandeur publique, ne pouvaient manquer de se proposer l’accroissement de la grandeur particulière des hommes chez lesquels elles fermentaient, et dont elles avaient formé le caractère : c’est ainsi que Rome, faute d’avoir acquis l’évidence de l’ordre essentiel des sociétés, a elle-même ourdi la trame de ses malheurs ; a elle-même produit et armé les tyrans par les mains desquels elle s’est vu déchirée.
Je parcours rapidement ces exemples parce qu’ils pourraient m’être opposés sans être approfondis ; on pourrait s’en servir pour essayer de persuader que les hommes seront toujours vicieux ; que les sociétés seront toujours déréglées ; que les vertus sociales ne seront que passagères parmi nous ; qu’on ne peut se flatter, en un mot, de voir jamais régner l’ordre essentiel des sociétés. Il est temps enfin de reconnaître que les maux qui ont affligé l’humanité ne paraissent naturels, que parce qu’ils résultent naturellement et nécessairement des écarts dans lesquels notre ignorance nous a fait tomber ; que les causes qui ont produit ces maux, sont factices ; qu’elles n’existent par aucune nécessité dont nous ne puissions nous affranchir ; que ces causes au contraire doivent disparaître d’elles-mêmes, sitôt que nous aurons acquis une connaissance évidente de l’ordre qui constitue naturellement et nécessairement le meilleur état possible d’un souverain, celui de chacun de ses sujets, et du corps entier de la société.
Vous venez de voir combien cet ordre est simple, combien son évidence est sensible : tout ce qu’il exige de nous, c’est le maintien de la propriété, et conséquemment de la liberté, dans toute leur étendue naturelle et primitive. Qu’elle se répande donc, cette évidence salutaire, puisqu’elle est susceptible d’être aperçue, d’être saisie par toute intelligence ; qu’elle se répande assez pour que l’erreur, les préjugés et la mauvaise foi aient épuisé leurs contradictions ; qu’elle se répande, qu’elle s’établisse, et qu’on me dise pourquoi nous ne devons pas tout attendre de sa publicité ; pourquoi les rois et leurs sujets n’embrasseraient pas un ordre si simple qui leur assure leur meilleur état possible évident ; pourquoi l’évidence cesserait d’être pour nous ce qu’elle a toujours été, d’agir sur nous comme elle a toujours agi, et comme il est dans la nature qu’elle agisse toujours : sa force irrésistible est faite pour enchaîner toutes nos opinions ; pour établir un despotisme légal et personnel, qui n’est autre chose que celui de cette même évidence, par le moyen de laquelle tous nos intérêts, toutes nos volontés viennent se réunir à l’intérêt et à la volonté du souverain, [327] et former ainsi, pour notre bonheur commun, une harmonie, un ensemble qu’on peut regarder comme l’ouvrage d’une divinité, et d’une divinité bienfaisante, qui veut que la terre soit couverte d’hommes heureux.
FIN.↩
[II-496]
Endnotes↩
[3] S’il est des cas où l’on pourrait croire que, pour des raisons d’État, on serait obligé de déroger à ces règles, nous ne pensons pas qu’il nous convienne de les prévoir :
1°. Parce que comme nous ne nous occupons ici que de ce qui se doit faire en règle, ou dans l’ordre, ce qui en sort par des considérations supérieures, n’est plus de notre sujet.
2°. Parce que la raison d’État étant alors difficile à apprécier, on pourrait aisément s’y méprendre.
[4] Voyez le dernier chapitre de cet ouvrage.
[5] Nota. On voit ici tout d’un coup les désordres que doit produire ce qu’on appelle luxe d’ostentation, et généralement tout usage qui tend à rendre les consommations très dispendieuses.
[6] Quoique nos passions rapportent tout à elles-mêmes, elles doivent cependant être protégées par la raison. Pope, Essais sur l’homme.
[7] S. Jean Évang. ch. I.
[8] Malebr. Tr. de Mor. ch. 2.
[9] S. Paul aux Rom. 2.
[10] S. Thomas 2. 2. q. 133. ar. I.
[11] Cic. de Leg. l. 2.
[12] Arist. de Caus. Civil.
[13] Senec. in Proverb. L. II.
[14] Id. de forma Vitæ.
[15] Aristot. Ep. 72 et de Mor.
[16] Aristot. de Vera Relig.
[17] Id. Ep. 9. — Tacit. Hist. L. IV.